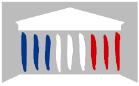N° 2238
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2014.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l’emploi,
PAR M. Gérard CHERPION,
Député.
——
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 2165.
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. UNE SITUATION TRÈS DÉGRADÉE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 11
II. L’EMPLOI DES JEUNES : UNE SITUATION INACCEPTABLE 12
1. Un taux de chômage élevé 12
2. Une inquiétante baisse de l’apprentissage 14
3. La loi du 10 juillet 2014 : un risque pour la formation des jeunes et leur insertion sur le marché du travail 17
III. UN DROIT DU TRAVAIL TROP COMPLEXE 19
1. Favoriser la simplification du droit du travail pour une meilleure sécurité juridique 19
2. Une nécessaire réforme des institutions représentatives du personnel 19
3. Un cadre trop contraignant en matière de temps de travail 22
4. Donner de nouveaux outils aux entreprises 23
IV. AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS LICENCIÉS 23
TRAVAUX DE LA COMMISSION 25
Chapitre 1er – Dispositions relatives à la vie en entreprise 47
Section 1 : Réforme du code du travail 47
Article 1er : Création d’une commission chargée de réformer le code du travail 47
Section 2 : Dispositions relatives au temps de travail 52
Article 2 (articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail) : Augmentation de la durée de travail à trente-neuf heures 52
Article 3 : Augmentation de la durée de travail dans la fonction publique 57
Article 4 (art. L. 3122-2 du code du travail) : Annualisation 60
Article 5 (Art. L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 et L. 3123-25 du code du travail et art. 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) : Abrogation de la durée minimale de travail de 24 heures dans le cadre du recours au temps partiel 61
Section 3 : Dispositions relatives au bulletin de paie 67
Article 6 (Art. L. 3243-2 du code du travail) : Simplification du bulletin de paie 67
Section 4 : Négociation sur la représentation des salariés des petites entreprises sur un plan territorial 70
Article 7 : Représentativité des salariés 70
Section 5 : Mesures en faveur de la sécurité juridique et de l’emploi 74
Article 8 : Expérimentation d’une procédure de rescrit social 74
Article 9 (art. L. 5151-1 à L. 5151-5 [nouveaux] du code du travail) : Accords de développement de l’emploi 78
Article 10 (art. L. 2242-23 du code du travail) : Motif de licenciement en cas de refus du salarié de se voir appliquer un accord de mobilité interne 84
Article 11 (art. L. 1236-8 du code du travail) : Élargissement du champ d’application du contrat de chantier 88
Article 12 (art. 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) : Pérennisation du CDD à objet défini 90
Chapitre 2 – Encadrement des indemnités liées à un plan de sauvegarde de l’emploi 93
Article 13 (art. 80 duodecies du code général des impôts) : Primes supra-légales 93
Article 14 (art. L. 421-2 du code de l’éducation) : Composition des conseils d’administration des collèges et des lycées 97
Article 15 (articles L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9 et L. 6222-10 du code du travail) : Durée du contrat d’apprentissage 99
Article 16 (articles L. 6221-2 et L. 6233-1-1 du code du travail) : Gratuité de l’apprentissage 101
Article 17 (article L. 332-3 du code de l’éducation) : Stage dans les collèges 104
Article 18 (articles L. 337-3-1, L. 337-3-2 du code de l’éducation et articles L. 6222-20 et L. 6222-21 du code du travail) : Apprentissage à quatorze ans 106
Article 19 (article L. 6222-31 du code du travail) : Travaux dangereux 112
Article 20 (articles L. 1599 ter A du code général des impôts) : Apprentissage dans les collectivités 116
Après l’article 20 119
Section 2 : Dispositions relatives aux stages 121
Article 21 (article 1609 quinvicies du code général des impôts) : Stagiaires de longue durée intégrés dans le quota d’alternance 121
Article 22 (articles L. 124-6 du code de l’éducation et L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale) : Gratification des stages 124
Article 23 (articles L. 1221-13 du code du travail et L. 124-21 du code de l’éducation) : Registre du personnel 126
Article 24 (article L. 124-8 du code de l’éducation) : Limitation du nombre de stagiaire par entreprise 128
Article 25 (article L. 124-13 du code de l’éducation) : Suppression des congés salariaux 130
Article 26 (article L. 124-20 du code de l’éducation) : Stages à l’étranger 131
Article 27 : Gage 132
Mesdames, Messieurs,
Le taux de chômage atteint en France un niveau très préoccupant : plus de 5 millions de demandeurs d’emploi sont aujourd’hui inscrits à Pôle emploi, dont un grand nombre de façon durable. Or, le Gouvernement actuel ne semble pas en mesure mettre en place une politique volontariste susceptible d’inverser l’évolution de la courbe du chômage dans les mois qui viennent. Les récentes prévisions de l’UNEDIC laissent même présager une hausse continue du nombre de chômeurs en 2014 et en 2015 et l’INSEE vient de réviser une nouvelle fois ses prévisions de croissance pour l’année 2014 à la baisse.
C’est pourquoi cette proposition de loi entend proposer un ensemble de mesures en faveur de l’emploi et de la formation, qui s’articulent autour de quatre objectifs.
Le premier objectif est de favoriser le dialogue social et de donner toute leur place aux partenaires sociaux, s’inscrivant ainsi dans la philosophie de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social (1).
Ainsi, plusieurs dispositions tendent à donner une importance de premier plan à la négociation dans les entreprises, notamment en matière de temps de travail. Celles-ci constituent, en effet, le meilleur moyen d’adapter les règles à la réalité économique des entreprises. De même, l’article 1er prévoit que les partenaires sociaux sont associés à la rédaction d’un nouveau code du travail et l’article 7 propose d’ouvrir une négociation relative à la représentativité territoriale des salariés dans les entreprises de moins de 100 salariés.
Le second objectif de cette proposition de loi est de simplifier le code du travail et la vie des entreprises.
En effet, le code du travail est passé de 600 articles en 1973 à 12 000 aujourd’hui. L’extrême complexité de la législation en matière de droit du travail est une source d’insécurité juridique et de tensions dans les entreprises. La réforme du code du travail, appelée de leurs vœux par de nombreux acteurs politiques ou économiques, est donc aujourd’hui nécessaire.
La proposition de loi prévoit que cette réforme sera confiée à une commission dédiée spécialement à ce sujet, et chargée de proposer un nouveau code du travail. Cette commission devra notamment faire des propositions pour simplifier les institutions représentatives du personnel.
De même, la mise en place d’un rescrit social, en matière de droit de travail est proposée afin de permettre à un employeur d’interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail.
Le troisième objectif est de permettre d’aménager plus facilement le temps de travail dans les entreprises.
Le présent texte propose donc de revenir à un temps de travail de trente-neuf heures hebdomadaires, la rémunération horaire des salariés restant inchangée. Il est grand temps d’en finir avec une vision malthusienne et dépassée du temps de travail. Il est notamment indispensable de donner de la souplesse aux entreprises. En fonction de leur carnet de commandes, celles-ci doivent pouvoir négocier pour augmenter ou pour baisser le nombre d’heures travaillées. Cette possibilité est compliquée à mettre en place actuellement. C’est pour cette raison que la proposition de loi prévoit que les accords aménageant le temps de travail peuvent se conclure sous la forme simplifiée des accords d’intéressement.
Enfin, la proposition de loi prévoit d’abroger le seuil minimum de vingt-quatre heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel. En effet, les reports successifs de la mise en œuvre de cette mesure démontrent qu’elle est inapplicable dans les faits. Nous sommes le seul pays où il est impossible de travailler moins de vingt-quatre heures, et difficile de travailler plus de trente-cinq heures. Les salariés, ainsi que les employeurs, souhaitent une plus grande liberté dans leurs relations de travail. Même si la question du temps partiel subit ne doit pas être écartée – notamment pour les femmes qui sont le plus touchées par cette question – nous devons aussi accepter que certains salariés souhaitent pouvoir avoir du travail à temps très partiel.
Enfin, le dernier objectif de la proposition de loi est de favoriser l’emploi des jeunes.
Alors que l’apprentissage est un outil très efficace d’insertion des jeunes sur le marché du travail, les atermoiements du Gouvernement – notamment en matière de financement de l’apprentissage – ont conduit à une chute du nombre d’apprentis depuis 2012. La présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures de nature à développer l’apprentissage et simplifier les procédures pour les entreprises qui recrutent des apprentis.
Par ailleurs, le présent texte propose de revenir sur certaines dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (2) car elles risquent, en assimilant le stagiaire à un salarié, de conduire à un recul du nombre de stages préjudiciable aux jeunes.
Bien entendu, cette proposition de loi à elle seule ne suffira pas à régler le problème du chômage dans notre pays. Elle doit être accompagnée de mesures fiscales, notamment en matière de baisse du coût du travail, de simplification de nombreux dispositifs trop complexes pour être utilisés par les chefs d’entreprise. Elle propose toutefois plusieurs mesures de nature à simplifier la vie des entreprises et à favoriser l’emploi des jeunes.
Telles sont les raisons, Mesdames, Messieurs, pour lesquelles je vous demande d’adopter la présente proposition de loi.
*
* *
Le taux de chômage en France atteint aujourd’hui un niveau des plus préoccupants. En moyenne sur le deuxième trimestre 2014, celui-ci s’est élevé à 10,2 % de la population active (3). Au total 5 380 200 demandeurs d’emploi étaient inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C à la fin du mois d’août dernier, soit une hausse de 6 % en un an.
Comme le montre le graphique suivant, le nombre de chômeurs, malgré des fluctuations, a connu une hausse continue depuis la crise économique et financière de 2008.
TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT
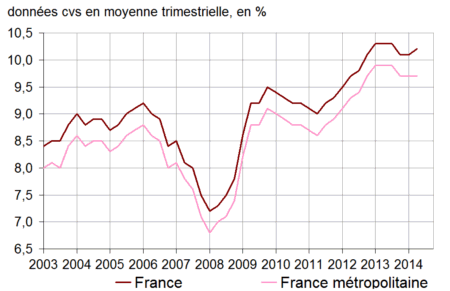
Autre fait inquiétant, le nombre de chômeurs de longue durée a atteint 2,13 millions en juillet dernier, soit une hausse de 10,3 % en un an.
Or, si la reprise semble se profiler dans certains pays européens, la France ne semble malheureusement pas devoir connaître de hausse de son activité à moyen terme. Comme le rappelle M. Bertrand Martinot, dans une note publiée en juillet dernier pour l’Institut Montaigne (4), : « Si les comparaisons internationales peuvent parfois laisser croire que la France est dans une “honnête moyenne” (taux de chômage sensiblement inférieur à la moyenne de l’Union européenne notamment), elles ne sauraient dissimuler deux éléments négatifs : le chômage est orienté clairement à la baisse dans plus de la moitié des États européens, contrairement à la France et plusieurs pays européens qui connaissent aujourd’hui des taux de chômage élevés se sont avérés capables, dans un passé récent, de revenir au quasi plein emploi, ce qui n’a jamais été le cas de la France depuis la fin des années 1970. »
Ainsi, l’Unédic a révisé, le 29 septembre dernier, ses prévisions en prévoyant 150 000 chômeurs de catégorie A de plus en 2014 et 96 000 supplémentaires en 2015. Le nombre de chômeurs devrait, dès lors, atteindre, 3,6 millions de chômeurs en 2016. Dans ce contexte, les finances de l’Unédic continueraient de se dégrader, puisque le déficit du régime devrait atteindre 3,8 milliards d’euros en 2014 et 3,5 milliards en 2015.
Le taux de chômage des jeunes atteint aujourd’hui un niveau inacceptable. C’est pourquoi le troisième chapitre de la présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures en faveur de l’emploi des jeunes. Ces mesures s’appuient notamment sur les préconisations du rapport sur les freins non financiers au développement de l’apprentissage de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale de l’administration, de l’inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche et de l’inspection générale de l’éducation nationale (5).
En France, la conjoncture économique est particulièrement problématique pour les jeunes qui rencontrent les plus grandes difficultés à entrer sur le marché du travail. En 2014, le taux de chômage des jeunes s’établit à 24,9 % (6). Comme le montre le tableau ci-dessous, après avoir fluctué entre 2005 et 2008, il a, depuis 2009, connu une progression continue pour atteindre aujourd’hui un niveau historiquement élevé.
LE TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
Janvier 2005 |
19,8 % |
Janvier 2006 |
22,1 % |
Janvier 2007 |
20,6 % |
Janvier 2008 |
17,3 % |
Janvier 2009 |
22,5 % |
Janvier 2010 |
22,9 % |
Janvier 2011 |
22,7 % |
Janvier 2012 |
22,4 % |
Janvier 2013 |
24,9 % |
2014 |
22,9 % |
Source : OCDE
Comme le montre le tableau suivant, la situation des jeunes sur le marché du travail en France est une des plus difficiles des pays de l’OCDE :
TAUX DE CHÔMAGE DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
(en % de la population active)
Pays |
Valeur |
Allemagne |
8,1 |
Autriche |
10,3 |
Belgique |
26,7 |
Danemark |
12,6 |
Espagne |
54,1 |
Estonie |
17,1 |
Finlande |
20,9 |
France |
22,9 |
Grèce |
56,3 |
Hongrie |
20,6 |
Irlande |
26,2 |
Islande |
11,4 |
Italie |
43,2 |
Luxembourg |
14,3 |
Norvège |
7,4 |
Pays-Bas |
11,2 |
Pologne |
25,8 |
Portugal |
37,9 |
République tchèque |
16,7 |
Royaume-Uni |
18,8 |
Slovaquie |
32,0 |
Slovénie |
21,5 |
Suède |
23,1 |
Suisse |
7,7 |
Turquie |
15,5 |
Union européenne |
22,8 |
Source : OCDE
Une enquête réalisée par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications relative à l’insertion des 700 000 jeunes ayant quitté le système éducatif en 2010 (7) – appelés « génération 2010 » – montre une dégradation de leur situation sur le marché du travail.
Ainsi, les jeunes de la « génération 2010 » ont en moyenne passé sept mois, soit un mois de plus, en recherche d’emploi au cours de leurs trois premières années de vie active que les jeunes de la « génération 2004 ». Parmi eux, environ 12 % ont eu une trajectoire « très éloignée de l’emploi » – c’est-à-dire avec moins de 10 % de leur temps en emploi – soit quatre points de plus que la « génération 2004 ».
La situation s’est particulièrement dégradée pour les jeunes sans diplômes : alors que 81 % des diplômés du « supérieur court » (jusqu’à bac + 4) ont un contrat à durée indéterminée au bout de trois ans, et que ce taux atteint 88 % pour ceux du « supérieur long » (bac plus cinq et au-delà), seuls 41 % des non-diplômés ont un emploi, soit une baisse de seize points par rapport aux jeunes de la « génération 2004 ».
Pour répondre à cette situation très problématique, le Gouvernement a mis en place les « emplois d’avenir » – 150 000 initialement prévus de 2012 à 2014, auxquels se rajoutent 45 000 décidés au premier semestre 2014 au regard de l’évolution du chômage – en plus des traditionnels contrats aidés dans le secteur public et parapublic. En tout, près de 4 milliards d’euros seront consacrés à ce type de contrats en 2014.
Or l’efficacité des contrats aidés dans le secteur public est particulièrement faible en termes d’insertion, comme l’a notamment montré un rapport de la Cour des comptes relatif à la politique de l’emploi (8) : « leur utilisation dans le secteur non marchand a persisté en France, alors qu’elle a été abandonnée dans la plupart des autres pays en raison de sa faible efficacité en matière d’insertion durable dans l’emploi. Le recours à ce dispositif dans le cadre de la réponse à la crise apparaît donc discutable. » Selon la Cour, moins de 40 % des personnes en contrat aidé non marchand sont en emploi six mois après, contre plus de 70 % pour ceux qui ont bénéficié de contrats dans le secteur marchand.
Au 31 décembre 2012, on dénombrait 441 709 apprentis en France. Mêlant formation théorique et apprentissage en entreprise, l’apprentissage obtient de très bons résultats en termes d’insertion professionnelle. En février 2013, sept mois après leur sortie de formation, 65 % des apprentis ont un emploi.
C’est pourquoi, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi proposé par l’actuel Gouvernement a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis à 470 000 en 2015 puis à 500 000 en 2017.
Or l’évolution du nombre d’apprentis connaît, au contraire, une chute très inquiétante. En effet, le nombre d’apprentis a baissé de 24 000 en 2013, soit une diminution de 8 % par rapport à 2012 et cette chute se poursuit au premier trimestre 2014 puisqu’a été enregistrée une baisse de 12 % par rapport au premier trimestre 2013. Dans les Vosges, on constate ainsi une baisse de 10 à 20 % du nombre d’apprentis selon les secteurs par rapport à la même période l’année dernière.
Certes la crise économique n’a pas été sans impact sur le nombre de contrats d’apprentissages. Il est plus difficile pour les entreprises qui sont confrontées à une insuffisance de l’offre de recruter des apprentis.
Mais on ne peut nier que les atermoiements du Gouvernement dans ce domaine ont contribué à la baisse du nombre d’apprentis. La réforme du financement de l’apprentissage, notamment par la loi de finances pour 2014 (9) et par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (10) a conduit à la suppression de la prime apprentissage pour les entreprises de plus de 10 salariés, à de fortes restrictions apportées au crédit d’impôt apprentissage et à la réforme du circuit de la taxe d’apprentissage, soit une diminution de 550 millions d’euros des aides aux entreprises embauchant des apprentis.
Dans la note précitée sur la politique de l’emploi (11), M. Bertrand Martinot conclut : « On doit constater que les résultats de la politique conduite sur l’apprentissage depuis 2012 sont très négatifs : les entrées en apprentissage ont subi une chute sans précédent (– 24 000, soit une baisse de 8 % en 2013) et cette tendance se confirme sur les premiers mois de 2014. Tant le risque de désengagement des régions que les restrictions considérables aux aides à l’embauche d’apprentis pourraient peser sur les résultats de cette filière de formation pourtant si probante. »
Par ailleurs, on peut se demander si la mobilisation des services de l’État au profit des emplois d’avenir ne s’est pas faite au détriment de l’apprentissage, d’autant plus que certaines entreprises ont pu être tentées de recruter des emplois d’avenir plutôt que des apprentis, compte tenu du caractère financier plus avantageux des premiers.
Des assises de l’apprentissage ont été organisées le 19 septembre dernier, afin de tenter de répondre à la crise actuelle. À l’issue de cette rencontre, le Président de la République, M. François Hollande, a présenté les actions qui seraient mises en place pour relancer l’apprentissage :
– la mise en place d’une nouvelle prime d’apprentissage de 1 000 euros versée aux entreprises de moins de 250 salariés pour toute embauche d’un apprenti supplémentaire, cumulable avec l’aide versée par les régions aux entreprises de moins de onze salariés (1 000 euros par année de formation) ;
– un objectif de 10 000 embauches d’apprentis au sein de la fonction publique d’État d’ici deux ans. Une mission sera créée pour identifier les moyens de développer l’apprentissage dans les fonctions publiques. Par ailleurs, dès 2015, les apprentis ne seront plus décomptés dans le plafond d’emplois budgétaires des administrations et 20 millions d’euros seront dégagés pour assurer les rémunérations et les formations nécessaires. Enfin, le nombre d’apprentis devrait être porté de 40 000 à 60 000 dans les établissements publics d’enseignement ;
– une mission de mobilisation des entreprises, confiée à Henri Lachmann, ancien président du groupe Schneider, afin de lever les freins à l’apprentissage Alors que beaucoup d’entreprises ne respectent leur quota d’alternants et payent la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), Pôle emploi et les services du ministère du travail devraient mettre en place un accompagnement de ces entreprises pour les inciter à proposer davantage de contrats d’apprentissage, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;
– des mesures de simplification des démarches administratives, notamment en matière de rémunération des apprentis ;
– la mise en place d’une concertation sur l’utilisation des machines dangereuses par les mineurs en apprentissage et plus largement la remise à plat des règles de sécurité « pour voir ce qui peut être assoupli sans remettre en cause la sécurité des apprentis » ;
– une campagne d’information pour changer l’image de l’apprentissage et une bourse web nationale de l’apprentissage créée par Pôle emploi pour diffuser les offres disponibles ;
– la mise en place d’un parcours de l’apprenti afin d’éviter le « décrochage » ;
– une réflexion sur l’évolution des règles de la rupture des contrats d’apprentissage.
Cependant, ces mesures ne semblent pas suffisantes pour contrecarrer la crise actuelle de l’apprentissage.
Ainsi, la nouvelle prime d’apprentissage ne fait que revenir sur l’erreur du Gouvernement de restreindre les financements de l’apprentissage en 2014 en supprimant la prime d’apprentissage pour les entreprises de plus de onze salariés et en restreignant le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (12).
Cette nouvelle prime devrait être mise en place par la prochaine loi de finances rectificatives avec un effet rétroactif au 1er septembre. Cependant, la rentrée dans les centres de formations des apprentis a déjà eu lieu et on peut regretter que cette aide ne concerne, cette année, que les jeunes déjà inscrits en CFA et toujours à la recherche d’un employeur. La mise en place de cette aide intervient donc beaucoup trop tardivement et ne devrait pas être en mesure d’enrayer la chute du nombre d’apprentis en 2014.
La présente proposition de loi présente plusieurs mesures fortes de nature à relancer l’apprentissage :
– l’article 14 vise à intégrer des représentants des salariés et des chefs d’entreprise dans les conseils d’administration des collèges et des lycées afin de mieux préparer les jeunes à leur avenir professionnel ;
– l’article 15 propose de simplifier fortement la durée du contrat d’apprentissage afin qu’elle soit négociée par l’apprenti, le centre de formation des apprentis (CFA) et l’entreprise accueillante ;
– afin de garantir la gratuité de l’apprentissage tant pour l’apprenti que pour l’employeur, l’article 16 réaffirme que les organismes gestionnaires de CFA ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement d’une contribution financière par ce dernier ;
– l’article 17 prévoit que les collèges organisent des sessions de découverte de l’apprentissage durant lesquels ils visitent des CFA, découvrent les métiers et rencontrent des acteurs du monde économique ;
– l’article 18 prévoit de réintroduire le dispositif du préapprentissage à partir de 14 ans, sous statut scolaire ;
– l’article 19 répond à l’absence de la prise de décret en matière de travaux dangereux pour les apprentis : il propose donc qu’en absence de décret, les accords de branche étendus puissent préciser les métiers pour lesquels les apprentis peuvent accomplir tous les travaux nécessaires à leurs formations ;
– enfin l’article 20 prévoit de soumettre les collectivités territoriales à la taxe d’apprentissage afin que soit pris en charge le coût de formation de leurs apprentis.
3. La loi du 10 juillet 2014 : un risque pour la formation des jeunes et leur insertion sur le marché du travail
La loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (13), récemment adoptée par le Parlement, a pour objectif d’encadrer le recours à des stagiaires et d’empêcher d’éventuels abus.
Or, sous couvert de bonnes intentions, cette loi risque d’avoir des conséquences néfastes sur les entreprises, sur le nombre de stages qu’elles offrent et donc in fine sur les jeunes.
La fixation d’un quota maximum de stagiaires par effectif de l’entreprise, notamment, est une erreur. Compte tenu de ce quota, les petites et moyennes entreprises ne pourront prendre que peu de stagiaires alors que c’est essentiel pour certaines d’entre elles, notamment les start-up et les entreprises innovantes. Celles-ci seront entravées dans leur développement et ne formeront plus ces jeunes qui, pour la plupart, trouvent, à l’issue de leur stage, du travail dans cette entreprise ou dans une autre, ou qui créent leur propre entreprise.
Par ailleurs, cette loi tend à brouiller la frontière existant entre le salarié et le stagiaire. Ainsi, le stagiaire, qui jusqu’à maintenant était inscrit dans un registre spécifique aux conventions de stage, est dorénavant inscrit au registre du personnel. De même, il bénéficie désormais des mêmes droits sociaux que certains salariés, notamment les congés familiaux.
Le Conseil économique, social et environnemental estime le nombre de stages à 1,6 million par an, contre 600 000 en 2006. Malgré ce chiffre impressionnant, seuls 32 % des étudiants d’université font un stage chaque année et un grand nombre d’étudiants n’arrivent pas à en trouver. Cette loi risque encore de réduire cette offre, en limitant l’utilisation faite par les entreprises et en cassant la confiance entre les étudiants, les entreprises, et les établissements de formation.
C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit de revenir sur un certain nombre de mesures adoptées en juillet dernier :
– l’article 22 prévoit de supprimer le niveau minimal de rémunération des stagiaires afin de revenir à la gratification de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévue par le décret. Par ailleurs, il exonère de charges patronales et salariales la gratification des stagiaires dans la limite de 80 % du SMIC ;
– l’article 23 propose de restaurer le registre de conventions de stage, prévu dans la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (14) ;
– l’article 24 abroge la limitation des stagiaires par entreprise ;
– l’article 25 abroge les congés salariaux en faveur des stagiaires ;
– enfin l’article 26 abroge l’obligation pour les organismes de formation de fournir une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil.
Par ailleurs, afin que les entreprises qui ne trouvent pas d’apprentis dans leur secteur d’activité, mais qui font un effort particulier de formation et de recrutement de jeunes cessent d’être sanctionnée par le paiement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), l’article 21 propose d’intégrer, pour le calcul de la CSA, les stagiaires de longue durée au quota d’alternance lorsqu’ils sont embauchés en CDI pour le calcul de la CSA.
Le code du travail est passé de 600 articles en 1973 à 12 000 aujourd’hui. À ces dispositions législatives s’ajoutent encore le contenu des conventions collectives, la jurisprudence élaborée par les juges et le droit européen.
Cette situation n’est plus tenable, ni pour les employeurs, ni pour les salariés. C’est devenu une raison d’insécurité juridique et de tensions dans les entreprises. Par ailleurs, cette complexité du code du travail crée une véritable fracture entre les petites et les grosses entreprises. En effet, les TPE et certaines PME ne disposent pas de moyens suffisants pour se doter de services juridiques, afin d’analyser et de comprendre cette législation complexe.
L’ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur ont considéré que la réforme du code du travail et sa simplification étaient, aujourd’hui, essentielles.
Plusieurs mesures proposées par la présente proposition de loi visent à simplifier la vie des entreprises et à assurer une meilleure sécurité juridique.
Ainsi, l’article 6 simplifie le bulletin de paie en limitant le nombre de lignes pour les cotisations sociales à quatre.
L’article 8 instaure un rescrit social, à titre expérimental. L’objectif est qu’un employeur puisse interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.
L’article 10 précise juridiquement le motif de licenciement en cas de refus de mobilité dans le cadre d’un accord de mobilité. Ainsi, le licenciement en cas de refus de mobilité est soumis aux règles relatives au motif personnel, et non économique. Ces dispositions reprennent ainsi exactement le motif de licenciement prévu par la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Comme le montre le tableau suivant, les entreprises sont confrontées à une législation particulièrement complexe en matière de seuils sociaux :
Seuils réglementaires portant sur l’effectif salarié en France
– À partir de dix salariés :
– versement mensuel des cotisations de sécurité sociale, au lieu d’un versement trimestriel ;
– obligation de versement d’une aide au transport dans les zones géographiques soumises ;
– prise en charge partielle de la formation économique, sociale et syndicale ;
– hausse du taux de cotisation pour la formation professionnelle continue ;
– À partir de onze salariés :
– versement d’une indemnité minimale de six mois de salaires en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
– obligation d’organiser l’élection d’un délégué du personnel, sans obligation de résultat (seuil dépassé pendant 12 mois consécutif au cours des trois dernières années) ;
À partir de vingt salariés :
– cotisation au Fonds national d’aide au logement ;
– obligation d’avoir un règlement intérieur ;
– obligation de travail des handicapés (effectif au 31 décembre de l’année précédente, délai de trois ans après le franchissement du seuil) ;
– participation à la construction ;
– hausse du taux de cotisation pour la formation professionnelle continue (seuil dépassé en moyenne sur 12 mois) ;
– repos compensateur obligatoire de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine et de 100 % (au lieu de 50 %) pour les heures effectuées au-delà du contingent.
À partir de vingt-cinq salariés :
– obligation de réfectoire si demandé par 25 salariés ;
– collèges électoraux distincts pour l’élection des délégués du personnel. Augmentation du nombre de délégués à partir de 26 salariés.
À partir de cinquante salariés :
– possibilité de désignation d’un délégué syndical (seuil dépassé pendant 12 mois consécutifs au cours des trois dernières années) ;
– obligation de mettre en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de former ses membres (seuil dépassé pendant 12 mois au cours des trois dernières années) ;
– obligation de mettre en place un comité d’entreprise avec réunion au moins tous les deux mois (seuil dépassé pendant 12 mois au cours des trois dernières années) ;
– affichage de consignes d’incendie dans les établissements où sont réunis plus de 50 salariés ;
– obligation de mise en place d’une participation aux résultats (seuil dépassé pendant six mois au cours de l’exercice comptable, délai d’un an après la fin de l’exercice pour conclure un accord) ;
– obligation de recourir à un plan social en cas de licenciement économique concernant 9 salariés et plus.
Source : INSEE analyses, n° 2, décembre 2011.
La négociation sur la modernisation du dialogue social, qui doit débuter en octobre, devrait aborder cette question de ces seuils sociaux. Le Gouvernement envisage, en effet, une réforme des seuils sociaux et des institutions représentatives du personnel.
Dans une note publiée en septembre dernier (15), le groupe de réflexion Terra Nova, constate que si de « mauvais procès » sont parfois faits à l’encontre des seuils sociaux : « Le bon procès consiste à reconnaître la complexité excessive d’une organisation qui a laissé s’accumuler de nombreuses couches de droit et de lourdes contraintes formelles sans avoir suffisamment le souci de la cohérence et des coûts induits par cette sédimentation réglementaire dans le quotidien des entreprises. Le pari qui est le nôtre est de proposer une voie qui permette de réduire cette complexité, d’en alléger les coûts non pour diminuer mais pour accroître l’efficacité du dialogue social et partant, la compétitivité des entreprises. »
Le groupe de réflexion propose :
– un « toilettage de la réglementation » afin de comptabiliser les effectifs de la même manière selon les obligations ;
– la mise en place d’une progressivité des prélèvements quand l’entreprise franchit certains seuils ;
– une mutualisation de la représentation du personnel dans les PME ;
– dans les entreprises volontaires, une réduction du nombre d’instances représentatives du personnel : l’entreprise garderait son comité d’entreprise mais le comité d’établissement, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seraient fusionnés.
Ces réflexions et les négociations actuelles témoignent du caractère impératif et consensuel de cette réforme. C’est pourquoi, l’article 1er de la présente proposition de loi crée une commission chargée de réformer le code du travail et plus particulièrement de faire des propositions en matière de réformes des seuils sociaux, des institutions représentatives du personnel et de simplification du contrat de travail Elle sera chargée de proposer un nouveau code du travail au Parlement dans un délai d’une année.
Celle-ci sera composée de représentants des syndicats des salariés et des organisations patronales, d’experts juridiques, de représentants de l’État et de représentants du Parlement.
L’article 1er prévoit aussi d’harmoniser les seuils sociaux et de fusionner les institutions représentatives du personnel, en proposant que le seuil pour la mise en place d’institutions représentatives du personnel soit de 100 salariés.
Par conséquent, l’article 7 propose donc d’ouvrir une négociation relative à la représentativité territoriale des salariés dans les entreprises de moins de 100 salariés. Ce sujet serait donc traité par un accord national interprofessionnel et un accord national multiprofessionnel qui proposerait au Parlement la réforme à adopter.
Cette réforme présente l’avantage de simplifier les formalités pour les entreprises jusqu’à 100 salariés, et de représenter les salariés dans les entreprises de moins de 10 salariés qui, actuellement, ne sont pas représentés.
La France fait partie des pays ou les salariés à temps plein ont une durée annuelle du temps de travail parmi les plus faibles d’Europe.
Si la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (16) a donné des outils aux entreprises pour assouplir la durée du travail, la conjoncture économique, depuis 2008, a été peu propice à l’utilisation de ces souplesses et on ne constate pas d’allongement du temps de travail au niveau macroéconomique.
Dans la note précitée sur la politique de l’emploi (17), M. Bertrand Martinot constate : « la durée effective annuelle de travail des salariés à temps plein serait en France la plus faible (après la Finlande) de tous les pays européens : 1 661 heures en 2013, soit 186 heures de moins que l’Allemagne, 120 heures de moins que l’Italie et 239 heures de moins que le Royaume-Uni. »
Si l’effet des trente-cinq heures sur l’emploi, la compétitivité, l’attractivité du territoire et la délocalisation des entreprises françaises est difficile à chiffrer, on ne peut exclure que la réduction du temps de travail ait eu un impact négatif sur la compétitivité française.
Ainsi, en 2010, le rapport de la mission d’information sur « Les faiblesses et les défis du commerce extérieur français » soutenait que « l’impact des lois de réduction du temps de travail de 1998 et 1999 sur le coût du travail en France, permet d’expliquer une bonne partie de l’affaiblissement commercial en France depuis le début des années 2000 » (18), l’introduction du dispositif ayant, en effet, augmenté de 10 % le coût horaire du travail entre 1998 et 2005 (19).
C’est pourquoi, l’article 2 de la présente proposition de loi vise à augmenter la durée du travail de trente-cinq à trente-neuf heures et à donner une priorité aux accords dans les entreprises, et à défaut aux accords de branche, en ce qui concerne la majoration des heures supplémentaires.
Par ailleurs, afin de faciliter la conclusion d’accords d’aménagement du temps de travail, l’article 4 prévoit que les accords qui aménagent le temps de travail se font sur le modèle des accords d’intéressement, permettant de simplifier la procédure.
En outre, l’article 5 propose d’abroger les dispositions relatives au temps de durée minimal de vingt-quatre heures par semaine mises en place par la loi de sécurisation de l’emploi. Les reports multiples de l’entrée en vigueur de la loi et les difficultés rencontrées par certaines branches pour conclure un accord témoignent de la complexité extrême de cette mesure et de son effet potentiellement néfaste pour l’emploi.
Enfin, l’article 9 prévoit la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions de coopération permettant d’aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, ainsi que la rémunération. En effet, les partenaires sociaux ont mis en place dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 les accords de maintien dans l’emploi, à vocation défensive dans un contexte de crise économique. L’article 9 propose de prévoir une disposition symétrique, à vocation offensive : les accords de développement de l’emploi.
Afin de donner aux entreprises de nouveaux outils pour leur permettre d’adapter les recrutements à l’évolution de leur activité :
– l’article 11 propose d’élargir le champ d’application du contrat de chantier au-delà du secteur du bâtiment et travaux publics et, notamment, aux domaines de l’industrie et des services. Il s’agit d’un contrat de travail par lequel un employeur engage un salarié en lui indiquant dès l’embauche que le contrat est exclusivement lié à la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude. À l’issue du chantier, l’employeur doit réaffecter le salarié sur un autre chantier. S’il ne peut le réaffecter pour un motif sérieux, il est autorisé à le licencier sans qu’il s’agisse d’un licenciement économique ;
– et l’article 12 propose de pérenniser le contrat à durée déterminée à objet défini puisque son expérimentation a pris fin le 26 juin 2014.
Les récentes évolutions des plans de sauvegarde de l’emploi démontrent que les négociations entre entreprise et représentants des salariés tournent principalement autour du montant des primes supra-légales, en dépit des mesures en matière de reclassement et de sécurisation des parcours professionnels.
Les salariés fragilisés se montrent souvent plus sensibles aux primes supra-légales qu’aux mesures d’accompagnement dans l’emploi. Or, le montant élevé de ces primes retarde parfois le retour des salariés vers l’emploi et constitue, dès lors, un frein à leur reclassement. Or celles-ci bénéficient d’un régime fiscal favorable puisqu’elles sont exonérées d’impôt sur le revenu.
C’est pourquoi, afin d’améliorer l’attractivité des dépenses en matière d’accompagnement dans l’emploi et de reclassement, et afin d’y consacrer des sommes plus importantes qu’aux primes supra-légales, le présent article propose de limiter le montant de ces primes :
– en les soumettant à l’impôt sur le revenu dès lors que leur montant dépasse celui de 2 SMIC dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
– et en diminuant la fraction des indemnités versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi exonérée d’impôt sur le revenu.
La Commission des Affaires sociales examine la présente proposition de loi lors de sa deuxième séance du mercredi 1er octobre 2014.
Mme la présidente Catherine Lemorton. La proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l’emploi, qui sera débattue en séance publique le 9 octobre, est un texte dense, reflétant les positions du groupe UMP sur de nombreuses questions liées au secteur du travail et de l’emploi, qu’il s’agisse du contrat de travail, de la durée du travail, de l’apprentissage ou des stages. Il me semble peu probable qu’elle fasse l’objet d’un consensus dans notre commission.
M. Gérard Cherpion, rapporteur. Plus de quatre-vingts collègues de l’UMP ont signé avec moi cette proposition de loi, et notre groupe, soutenu par son président, Christian Jacob, a décidé d’inscrire ce texte, très important pour la vie de nos concitoyens et des comptes publics, dans sa niche parlementaire. À l’heure où le plafond de notre dette atteint un sommet historique, à plus de 2 000 milliards d’euros, et où le déficit de notre système de sécurité sociale dépasse 11 milliards d’euros cette année, le plein-emploi s’avère essentiel pour drainer des cotisations sociales. Or notre société est marquée par un chômage de masse, blessure qui touche les plus de 5 millions de personnes qui y sont confrontées. Nous devons tout mettre en œuvre pour régler ce problème.
Je ne souhaite pas ici remettre en cause les efforts de la majorité actuelle qui, en raison de tensions internes, ne peut aller aussi loin qu’il le faudrait. Néanmoins, nous devons tout mettre en œuvre pour que la situation actuelle ne perdure pas et nous attaquer à certains tabous bien ancrés dans la société française. La population y est prête, y compris parmi les militants de gauche. Cette proposition de loi entend briser ces tabous, afin de libérer les forces créatrices d’emplois de notre pays, de donner une place plus importante aux partenaires sociaux et aux acteurs du terrain dans les entreprises – ou à défaut dans les branches –, et de faciliter la formation des jeunes à travers l’apprentissage et les stages.
Cette proposition de loi souhaite apporter une réponse à des problèmes présents dans le débat public depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Son examen permettra à chacun de se positionner, de sortir des postures et de démontrer sa volonté réformatrice au profit de notre pays. À travers cette loi, je souhaite donner toute leur place aux partenaires sociaux, que j’ai d’ailleurs reçus au cours de nombreuses auditions. La droite possède une forte tradition en la matière, la loi Larcher du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social ayant donné tout son poids au dialogue social. Prolongeant cet héritage, de nombreux articles de ce texte donnent davantage d’importance aux négociations ayant lieu dans les entreprises. Les négociateurs nationaux connaissent évidemment la réalité du terrain, mais ils ne peuvent pas apporter de réponses à l’ensemble des problèmes qui se posent dans toutes les entreprises du pays.
Faisant confiance à la négociation collective, je souhaite associer les partenaires sociaux à la rédaction d’un nouveau code du travail et leur confier la définition de la future représentativité territoriale pour les entreprises de moins de cent salariés. Ces deux mesures, situées aux articles 1er et 7, revêtent une grande importance. Le code du travail est passé de 600 articles en 1973 à 12 000 actuellement ; cette situation n’est plus tenable, ni pour les employeurs ni pour les salariés. Elle crée une insécurité juridique et des tensions dans les entreprises. De nombreux acteurs politiques et économiques appellent de leurs vœux la réforme du code du travail qui s’avère essentielle.
Je ne souhaite toutefois pas une réforme venant d’en haut, c’est-à-dire du pouvoir exécutif ou législatif, car un sujet d’une telle envergure mérite la constitution d’une commission dédiée spécialement à ce sujet et chargée de proposer un nouveau code du travail dont le Parlement déciderait l’adoption. Cette commission disposerait d’un an pour élaborer ce nouveau code, car le temps presse ; sa composition variée serait le gage de la qualité du dialogue social. Certaines lignes directrices, comme la mise en place de seuils sociaux simplifiés à partir de cent salariés, d’un contrat de travail à droits progressifs ou de la création d’une instance unique de représentation des salariés sont précisées pour la proposition de loi. Il revient au législateur de fixer les grandes lignes à une telle commission ; c’est d’ailleurs la méthode adoptée par le Gouvernement lorsqu’il adresse aux partenaires sociaux une lettre d’orientation contenant les sujets de négociation.
Tout le monde réclame l’harmonisation des seuils sociaux, les effets de ces derniers s’avérant néfastes pour la création d’entreprises. Il ne s’agit pas d’affirmer que cette mesure créera 10 000, 50 000 ou 100 000 emplois, mais nous devons l’adopter dès lors qu’elle simplifie la vie des entreprises. Il existe actuellement plus de trente seuils différents : comment les chefs d’entreprise pourraient-ils s’y retrouver ?
La représentation ne constitue pas une entrave aux embauches ; la proposition de loi prévoit un système dans lequel tous les salariés seront représentés, y compris ceux travaillant dans des structures de moins de dix employés. Elle constitue donc une avancée, et non une régression. Certes, les entreprises comprenant entre cinquante et cent salariés n’auront pas de comité d’entreprise, mais les salariés bénéficieront bien d’une représentation. L’article 7 dispose qu’une représentation territoriale leur sera assurée.
Nous devons faire confiance aux partenaires sociaux, et cet article propose l’organisation d’une négociation interprofessionnelle dont les résultats seraient transcrits par le Parlement dans la loi.
La disposition visant à revenir à la durée de 39 heures travaillées hebdomadairement dans le privé et dans le public, portée par l’article 2 du texte, ne fera probablement pas consensus. Nous dénonçons les 35 heures depuis de nombreuses années : le temps de travail ne constitue pas un gâteau à partager, et il convient de créer le travail, car c’est lui qui engendre la richesse. Ce n’est pas parce que neuf salariés travaillent quatre heures de moins que cela crée un poste pour une personne supplémentaire. Si tel était le cas, le débat aurait été tranché alors qu’il ne s’est jamais éteint. Les 39 heures travaillées seront payées 39 heures, et les salariés qui bénéficient actuellement d’une meilleure rémunération grâce à leurs heures supplémentaires conserveront leur situation, car ils n’ont pas à payer les erreurs du passé.
L’objectif n’est pas de perturber la vie des entreprises, et certaines d’entre elles se sont bien organisées sous le régime des 35 heures, quand d’autres ont négocié avec les représentants des salariés pour travailler moins de 35 heures. Dans certaines branches touchées par la crise, nous ne pouvons pas demander aux entreprises de travailler 39 heures, si bien que le texte prévoit que les conventions existantes resteront en vigueur ; elles devront être renégociées au bout d’un an, en prenant en compte le changement de législation, mais rien ne les empêche de négocier à l’identique. Nous devons donner de la souplesse aux entreprises, car toutes n’ont pas besoin de 39 ou de 35 heures ; en fonction du carnet de commandes, elles peuvent négocier pour augmenter ou diminuer le nombre d’heures travaillées. Cette possibilité existe déjà, mais elle s’avère compliquée à mettre en œuvre. Nous proposons donc, à l’article 4, de simplifier le recours à ce type de convention.
Nous devons également abroger le seuil de 24 heures hebdomadaires. Les reports successifs de la mise en œuvre de cette mesure démontrent qu’elle est inapplicable dans les faits : nous sommes ainsi le seul pays où il s’avère impossible de travailler moins de 24 heures et difficile de le faire plus de 35 heures par semaine. Les salariés et les employeurs souhaitent disposer d’une plus grande liberté dans leurs relations de travail, même si on ne doit pas écarter la question du temps partiel subi, notamment pour les femmes, les plus touchées par ce phénomène. Par ailleurs, nous devons accepter que certains salariés souhaitent ne travailler qu’à temps très partiel. Ainsi, le passage contraint de ces contrats à 24 heures détruira des emplois, et certains salariés passeront du temps partiel subi au chômage subi.
Enfin, la proposition de loi contient tout un chapitre sur les formations en alternance et les stages. L’avenir de notre pays passe par la jeunesse : alors même que l’apprentissage représente un véritable tremplin pour l’emploi – sept jeunes sur dix signant un contrat dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme –, le Gouvernement actuel l’a laissé péricliter. Le nombre d’entrées dans l’apprentissage s’est contracté de 8 % en 2013 – soit 24 000 jeunes en moins – et la tendance semble s’accélérer cette année pour atteindre une baisse de 14 %. Nous revenons ainsi au niveau de 1993, et nous devons donc collectivement sauver l’apprentissage. Certes, les mesures proposées dans ce texte ne seront pas suffisantes, mais elles participeront de sa réhabilitation. Il est de notre devoir de revenir sur la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, et de proposer une alternative avant qu’il ne soit trop tard, car le recul du nombre de stages suivrait celui des contrats en apprentissage, et les jeunes éprouveraient davantage de difficultés pour acquérir une expérience professionnelle.
Cette proposition de loi ne réglera pas à elle seule le problème du chômage dans notre pays : on doit l’accompagner de mesures fiscales – notamment en matière de baisse du coût du travail – et de simplification de nombreux dispositifs, trop complexes pour être utilisés par les chefs d’entreprise. Elle offre toutefois des solutions et s’attaque à des tabous ; la situation de notre pays est telle que nous devons tout envisager, dans le respect des salariés et des employeurs. Pour reprendre les mots du Premier ministre, prononcés le 29 septembre, « je compte sur l’intelligence collective ».
M. Denys Robiliard. Je ne m’attendais pas à ce que M. Cherpion nous propose une lecture freudienne du droit du travail, le renversement des tabous étant une allusion directe à Freud et à son livre Totem et tabou. Votre proposition de loi fait surgir l’inconscient de l’UMP, qui affiche ses totems qu’elle s’est bien gardée de mettre en œuvre lors des dix années qu’elle a récemment passées au pouvoir.
L’article 1er prévoit certes qu’une commission réunisse des représentants des salariés, des employeurs, de l’administration et du Parlement, mais vous choisissez de réformer le droit du travail sans négociation sociale et par le biais d’un processus administratif. Ce faisant, vous vous démarquez nolens volens de la réforme Larcher que la majorité que vous souteniez avait portée et que vous assumiez jusqu’à présent ; ainsi, vous n’avez pas saisi la présidente de la commission des affaires sociales d’une demande de consultation des partenaires sociaux sur le contenu de vos propositions. Vous avez certes organisé de nombreuses auditions, mais vous n’avez pas suivi les règles élaborées par l’Assemblée nationale sous la présidence de M. Accoyer.
Ainsi, vous voulez remettre en cause le plancher de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel. Il a pourtant été fixé récemment, en janvier 2013, par un accord national interprofessionnel (ANI), afin de lutter contre la précarité, et le législateur l’a simplement et fidèlement retranscrit dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. L’encre de cet accord est à peine sèche qu’il faudrait déjà le réformer, et le Parlement viendrait abroger ce qu’ont décidé les partenaires sociaux ? La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) a peut-être signé cet accord de mauvaise grâce, mais la négociation collective doit disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre les principes qu’elle a arrêtés.
Votre affirmation selon laquelle les seuils sociaux décourageraient l’emploi n’est pas démontrée par les statistiques de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Vous proposez de fixer le seuil à cent salariés, alors que les entreprises disposent de délégués du personnel à partir de dix salariés et d’un comité d’entreprise à partir de cinquante : si nous adoptions votre proposition, il n’y aurait plus de représentants du personnel ni de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cent salariés. Il s’agit d’une régression d’autant plus formidable que l’article 7 demande aux partenaires sociaux de développer un accord sur la représentation territoriale. Il reste singulier que le Parlement enjoigne aux partenaires sociaux de lui fournir la matière sur laquelle il légiférera.
Votre proposition de loi, monsieur Cherpion, est une négation de la négociation collective, qui est une richesse de notre droit.
Mme Valérie Lacroute. Avec une inflation négative en juillet et une croissance nulle depuis le début de l’année, la France se trouve dans la nasse : la dette publique dépasse pour la première fois les 2 000 milliards d’euros, soit 95 % du PIB. Le chômage atteint des niveaux inégalés, et notre industrie recule et a perdu des milliers d’emplois ces deux dernières années. La plupart des enquêtes récentes dans l’industrie, les services, le commerce et la construction font apparaître des tendances négatives.
Pour redonner une bouffée d’oxygène à nos entreprises, relancer le développement de l’activité et rétablir la croissance, il est grand temps de s’occuper du travail, de la formation et de l’emploi.
Les vingt-sept articles de la proposition de loi de Gérard Cherpion constituent les fondements d’une réforme courageuse. Il s’avère nécessaire d’alléger le code du travail, de revoir le temps de travail et d’offrir des perspectives à notre jeunesse en ouvrant plus largement l’apprentissage, notamment dans les collectivités territoriales, et en dynamisant l’offre de stages.
La réforme du code du travail n’est pas une gageure : il est passé de 600 articles en 1973 à plus de 10 000 actuellement, et, si cette croissance fait le bonheur des avocats, elle peut inciter de nombreuses personnes, découragées par la floraison de textes, à ne pas respecter le droit, à espérer ne pas subir de contrôle, voire à refuser d’embaucher. Les chefs d’entreprise vivent dans une insécurité permanente. La fiche de paie compte quatre lignes au Royaume-Uni, sept en Allemagne et vingt-deux en France : nous sommes loin du choc de simplification ! La France étant dans un tel état que nous devons conduire une réforme d’ampleur. Le temps n’est plus aux discours, mais à l’action.
Comme le dispose l’article 1er, il est vital d’installer une commission de simplification du code du travail, chargée de proposer un code de cent pages reprenant l’ensemble des accords collectifs et la réforme des seuils sociaux, qui simplifie le contrat de travail – notamment sa rupture –, et qui fusionne les instances représentatives du personnel.
L’article 2 lève le carcan tant décrié des 35 heures et donne aux entreprises la possibilité de faire évoluer le temps de travail et les salaires suivant le rythme des carnets de commandes. Libérons le temps de travail dans les branches, les entreprises et les administrations, en partageant entre employeurs et salariés les gains de production. Fixer la durée du travail à 39 heures, payées 39 heures, dans le privé et le public, et renvoyer la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires aux branches et aux entreprises constitue une réforme ambitieuse, inéluctable et courageuse.
Il en est de même pour l’article 5 qui abroge la durée minimale de 24 heures hebdomadaires travaillées ; cette mesure, source de complexité pour les employeurs, menace plusieurs millions d’emplois. Sa mise en œuvre a d’ailleurs été repoussée de six mois. Supprimons-la tout simplement !
Il nous faut également du courage pour accompagner et épauler la jeunesse. La voie de l’apprentissage représente le sillon qu’il convient d’explorer pour relancer l’emploi chez les jeunes. Aujourd’hui, l’apprentissage est déconsidéré, le nombre d’apprentis a d’ailleurs diminué de 8 % en 2013 et de plus de 14 % depuis janvier 2014. Les revirements du Gouvernement sont les principaux coupables de cette situation : la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a supprimé le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) et le projet de loi de finances a divisé par deux le crédit d’impôt pour l’apprentissage. Nous souhaitons que l’apprentissage soit reconnu comme une voie noble menant à la réussite sociale.
Je reprends ma proposition de loi relative à l’apprentissage par voie d’amendement à l’article 20, afin de cesser de décourager les collectivités territoriales et leurs élus qui souffrent des lourdeurs administratives. Il faut en finir avec ces contraintes. Nos propositions permettront de donner plus de souplesse.
Soutenir l’emploi des jeunes nécessite également de dynamiser l’offre de stages en baissant les charges et en revenant sur les absurdités votées dans la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, comme le quota maximal de stages par entreprise.
Cette proposition de loi s’attaque à plusieurs tabous et notre groupe assume pleinement cette offensive. Place à un texte qui porte l’ambition de lever les blocages, de redonner un sens à la « flexisécurité » et de simplifier l’environnement normatif. Du courage et de la persévérance, il en faut pour gagner des batailles !
M. Arnaud Richard. Le cadre de la journée d’initiative parlementaire paraît étriqué pour traiter les questions fondamentales soulevées par cette proposition de loi. Devons-nous augmenter le temps de travail ? Les seuils sociaux constituent-ils, comme l’affirme le Président de la République, un frein à l’emploi ? Doit-on encadrer les indemnités liées à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ? Toutes ces questions, essentielles pour l’avenir de notre pays, doivent nourrir un débat sans tabou ni caricature.
Cette proposition de loi risque d’empiéter sur le champ du dialogue social auquel notre groupe est très attaché. Nous ne voulons pas interférer dans les négociations qui doivent se dérouler dans un climat apaisé et serein, le Gouvernement ayant en outre indiqué qu’il légiférerait si les partenaires du dialogue social ne parvenaient pas à un accord sur la feuille de route qu’il leur a fixée. Nous voulons croire que les acteurs de la négociation sociale feront preuve d’un sens aigu de la responsabilité, la démocratie sociale constituant toujours un levier puissant pour moderniser la France et réformer le marché du travail.
En outre, monsieur Cherpion, ce texte ne répondra qu’imparfaitement aux immenses chantiers qu’il convient de lancer pour lever les rigidités du marché du travail. Ainsi, on ne peut réduire la question de la durée du travail au nombre d’heures hebdomadaires travaillées et il y a lieu de l’envisager de manière globale afin de concilier performance économique, cohésion sociale et épanouissement personnel. Dans la fonction publique, on ne peut traiter ce sujet indépendamment de l’indispensable réduction des dépenses publiques, de la définition d’un périmètre nouveau d’intervention de l’État et des collectivités locales, ainsi que des objectifs de qualité et de proximité du service public. La commission d’enquête relative à l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail remettra bientôt ses conclusions. Attendons-les avant de nous prononcer sur le sujet.
On doit tenir compte de l’équilibre entre la bonne représentation des salariés au sein de l’entreprise et l’indispensable simplification administrative de la vie des entreprises. Poser d’emblée le rehaussement à cent salariés du seuil au-delà duquel les élections de représentants du personnel doivent être organisées dans l’entreprise ne nous semble pas de nature à favoriser la recherche d’un tel équilibre.
Par ailleurs, nous nous inquiétons des dispositions prévues à l’article 13 qui prévoient l’encadrement des primes supra-légales dans les PSE. Sans une réforme profonde, tant attendue, de la formation professionnelle permettant de mieux accompagner les salariés et de sécuriser leurs transitions professionnelles, cette mesure pourrait fragiliser plus encore les salariés perdant leur emploi. Il nous faut faire confiance au dialogue social pour qu’émergent des solutions privilégiant une approche globale des imperfections de notre système.
Il convient de nous pencher sur la lutte contre la précarité, la protection des salariés et la sécurisation de leur parcours professionnel, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et l’anticipation des mutations économiques et sociales profondes liées à l’émergence d’un monde ouvert aux échanges et évoluant très rapidement.
Le groupe UDI ne soutiendra pas cette proposition de loi, car elle ne constitue qu’une réponse incomplète aux enjeux et ne suscitera pas le compromis stable auquel les partenaires du dialogue social pourraient parvenir.
En revanche, il est impératif de stopper la baisse spectaculaire de l’apprentissage, lequel a chuté de manière inquiétante depuis l’arrivée au pouvoir de François Hollande. Le Président de la République semble avoir pris conscience de la nécessité de soutenir l’apprentissage, et il a annoncé le rétablissement de la prime de 1 000 euros pour l’embauche d’un apprenti. Notre groupe appuie les mesures d’aide à l’apprentissage contenues dans la proposition de loi et espère que tous les députés en feront de même ; elles pourraient constituer un premier pas pour renforcer cet instrument essentiel de lutte contre le chômage, de sortie de la crise et d’émergence d’une solution pour chacun de nos compatriotes.
M. Christophe Cavard. Monsieur Cherpion, j’avoue avoir été surpris par le contenu de ce texte. Comme dirait M. Gattaz, il provoque le débat ! Je me demande d’ailleurs si ce n’est pas lui qui a rédigé la première partie de la proposition de loi.
Dans la logique du libéralisme économique, vous défendez l’idée selon laquelle la relance de l’économie passerait par le détricotage du code du travail. Ainsi, les salariés ne seraient plus qu’au service des bénéfices des entreprises et verraient disparaître les acquis dont ils jouissent aujourd’hui.
Pourquoi ce texte ne traite-t-il pas des différences entre les PME et les grands groupes du CAC 40 ? Pourquoi ne dit-il mot des dividendes versés aux actionnaires, le débat sur les excès de la logique financière traversant jusqu’au patronat ? Pourquoi ne pas reconnaître l’inégalité constitutive de l’économie classique entre les employeurs et les salariés ? Cette situation justifie-t-elle l’obtention de droits pour les salariés, consacrée par le code du travail qui en permet l’application ? Dans l’économie sociale, d’autres formes de relations sociales pourraient émerger, mais nous en sommes encore loin.
Partir du principe que le code du travail constitue un problème me semble plus que discutable. En quoi ce code constitue-t-il un frein à la relance économique et à la bonne santé de nos entreprises, monsieur Cherpion ?
L’article 1er remet en cause les droits de représentation des salariés, même si vous souhaitez créer une représentation territoriale – dont les modalités sont assez incompréhensibles d’ailleurs. Cette disposition contourne le dialogue social auquel nous sommes, pour la plupart, attachés. En effet, les représentants des salariés constituent les garants de l’existence du dialogue social.
S’agissant du temps de travail, attendons les conclusions de la commission d’enquête sur le temps de travail, demandée par le groupe UDI, avant d’affirmer qu’il convient de remplacer les 35 heures par les 39 heures. Vous affirmez, dans l’exposé des motifs, refuser toute perte de pouvoir d’achat. Comment conciliez-vous ces deux objectifs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires – mieux rémunérées – augmentant avec la hausse de la durée légale du travail ?
Monsieur le rapporteur, les écologistes ne soutiendront pas cette proposition de loi qui remet en cause tant d’acquis. Je crains qu’une grande partie des dispositions de ce texte soit davantage inspirée par des préoccupations idéologiques que pratiques.
Mme Dominique Orliac. Cette proposition de loi comporte des points intéressants qui ouvrent une réflexion indépendante du clivage habituel entre la gauche et la droite. Cependant, ses principaux objectifs, affichés aux articles 2 et 5, visent à revenir sur les 35 heures et sur le plancher de 24 heures de travail hebdomadaire.
La droite n’a cessé de critiquer les 35 heures, mais ne les a jamais remises en cause. En 2002, Jacques Chirac ne souhaitait plus la fin du dispositif ; Nicolas Sarkozy, lorsqu’il était ministre de l’économie, avait plaidé pour un système à deux vitesses, selon que les salariés voulaient ou non travailler plus de 35 heures. En 2007, lors de la campagne présidentielle, il n’a cessé de critiquer les 35 heures en appelant à la revalorisation de la valeur travail. Au total, l’UMP n’est jamais revenue sur le système des 35 heures lors des dix ans qu’elle a passés au pouvoir. Cette proposition de loi constitue donc plutôt une musique lassante qu’une surprise.
L’article 8 de la loi de sécurisation de l’emploi a mis fin au temps partiel subi en créant un plancher de 24 heures de travail hebdomadaire minimal et a instauré une majoration des heures complémentaires. Il s’agit bien entendu d’un nouveau droit pour les salariés. Notre majorité a élaboré ces bonnes mesures, et nous rejetons les dispositions contenues dans l’article 5 de la proposition de loi.
Ce texte s’attaque de front aux stagiaires et remet en cause la loi du 10 juillet 2014 qui vise à restreindre véritablement les abus trop souvent constatés, qu’il s’agisse d’emplois déguisés ou du flou entourant le statut du stagiaire. Il revient sur une mesure qui inscrit dans la convention de stage la possibilité de bénéficier de congés payés et d’autorisations d’absence.
Cette proposition de loi ne s’avère donc pas constructive.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Je suis étonnée que vous affirmiez, monsieur le rapporteur, qu’il n’est plus possible de travailler moins de 24 heures par semaine dans notre pays. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit des dérogations individuelles et dans les branches, qui sont utilisées pour les étudiants de moins de vingt-six ans et pour le travail à domicile. Mme Orliac a raison de dire que le seuil de 24 heures n’a été conçu que pour protéger les salariés.
M. Christophe Sirugue. Cette proposition de loi illustre la tendance de l’UMP à ne vouloir assurer que la flexibilité sans jamais accroître la sécurité des salariés. Le législateur est intervenu à cause de l’existence de la précarité professionnelle : ce n’est pas lui qui l’a créée. Le Parlement a procédé à un encadrement en privilégiant les accords de branche sur ceux passés dans les entreprises et en instaurant ce seuil des 24 heures, que l’on peut discuter, mais qui constitue une réponse à la précarité professionnelle, notamment celle vécue par les femmes.
Que proposez-vous ? Balayer ce dispositif, relancer une vague d’accords d’entreprise qui maintiennent les salariés dans la dépendance à l’égard de leur employeur et supprimer la représentation salariale qui permettait d’accompagner ceux qui se trouvaient confrontés à des difficultés ! Vous êtes animés d’une volonté dogmatique de supprimer tout ce qui permet de sécuriser le parcours d’un salarié, et rien dans ce texte ne répondra au problème de précarité professionnelle des femmes dont vous aviez pourtant reconnu l’existence.
M. Bernard Perrut. Si nous souhaitons redonner du souffle aux entreprises, enclencher une nouvelle dynamique de développement de l’activité, renouer avec la croissance, nous devons avoir le courage de mener de vraies réformes. L’augmentation d’un demi-million du nombre de chômeurs depuis deux ans montre la nécessité d’agir.
Tel est le sens de la proposition de loi pragmatique de Gérard Cherpion. Ce texte cherche à lever les blocages qui ne facilitent ni l’accès à l’emploi ni la vie de l’entreprise. Il simplifie le droit du travail – l’augmentation de la taille du code du travail pénalisant l’entreprise et le salarié, nous serons tous d’accord pour le rendre plus applicable –, il se penche sur la question du temps de travail en faisant écho aux propositions de la mission d’information sur la « flexisécurité », menée sous la précédente mandature et présidée par Pierre Morange. Nous sommes en retard sur la flexibilité, malgré le récent vote, dans la loi de sécurisation de l’emploi, de mesures – l’évolution du plan de sauvegarde de l’emploi et les accords de maintien dans l’emploi notamment – qui vont dans le bon sens. Hélas, leur impact sur l’emploi reste incertain du fait de contreparties pénalisantes pour les entreprises, comme l’ont montré plusieurs études. La rigidité du contrat de travail reste un obstacle à l’embauche, les entreprises préférant recourir à l’intérim et aux contrats précaires, au détriment du maintien des savoirs dans l’entreprise ; elle conduit également des sociétés à renoncer à des projets qui nécessitent le recrutement d’une main-d’œuvre aux compétences particulières.
M. Cherpion répond avec pragmatisme aux difficultés que nous constatons. Personne, dans cette commission, ne peut dire qu’il n’y a pas de lourdeurs administratives et qu’aucun fossé ne se creuse entre la sphère publique et le monde de l’économie.
M. Gérard Sebaoun. Ce texte propose le détricotage des 35 heures. Les lois Aubry ont constitué un bouleversement dans le privé et dans les trois fonctions publiques, mais également une grande avancée sociale, plébiscitée par la quasi-totalité des salariés. Attendons les conclusions de la commission d’enquête, demandée par l’UDI, sur la réduction du temps de travail. À ce stade de ses travaux, seul M. Jean-François Pilliard, vice-président du MEDEF, s’est opposé aux 35 heures. Je ne suis pas certain que les entreprises demandent de démanteler les 35 heures, et l’UMP est seule à répercuter la revendication du MEDEF.
La durée moyenne du travail s’élève à 39,5 heures en France, selon le bulletin de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) de juillet 2013, soit à peine moins que la moyenne de l’Union européenne, qui dépasse tout juste les 40 heures, et plus que dans des pays comme la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, l’Italie ou le Danemark. Dire que les Français ne travaillent pas relève d’une litanie erronée. Les cadres travaillent près de 44 heures avec le dispositif du forfait jour.
Les 35 heures ont permis une augmentation de 4 à 5 % de la productivité, celle-ci se situant largement au-dessus de la moyenne européenne. Elles ont créé environ 350 000 emplois – ce chiffre faisant l’objet d’un consensus.
Les salariés soutiennent la réduction du temps de travail, mais elle pose la question de la qualité de vie au travail et de la répartition entre le temps de travail et la vie personnelle.
Mme Isabelle Le Callennec. Cette proposition de loi fournit à la majorité les voies et moyens de changer de cap et de répondre aux attentes des chefs d’entreprise, ceux-là mêmes qui créent l’emploi.
Le Premier ministre nous invite régulièrement à nous associer à la lutte contre le chômage, et ce texte, porté par l’UMP, y contribue. Il répond aux besoins des chefs d’entreprise, des salariés et des demandeurs d’emploi que nous rencontrons. Il simplifie le droit du travail, revient sur la négociation du temps du travail dont nous pensons qu’elle doit être appréhendée à l’intérieur de chaque entreprise. Il soutient également l’emploi des jeunes via l’alternance et l’apprentissage, celui-ci ayant été maltraité par la majorité depuis deux ans, alors que chacun reconnaît le fort taux d’insertion dans l’emploi des jeunes ayant choisi cette voie d’excellence.
J’espère que le débat évitera les dogmes et sera animé par le pragmatisme et le bon sens ; je suivrai pour ma part le fil conducteur de la revalorisation du travail dans notre pays.
M. Michel Liebgott. Ce texte fait parfaitement écho au retour en politique de M. Sarkozy et aux propositions émises récemment par M. Fillon : il constitue un retour en arrière, avec les négociations par entreprise plutôt que par branche – qui laissent le salarié en situation de faiblesse face à son employeur – et procède à une remise en cause du dialogue social en revenant sur l’accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013. En proposant de supprimer le seuil des 24 heures, il renforce le temps partiel subi. Il stigmatise également les fonctionnaires en leur appliquant les 39 heures – là encore, c’est dans la ligne des déclarations de François Fillon, qui souhaite supprimer 600 000 postes dans la fonction publique, sans préciser les domaines touchés par cette politique. Enfin, il n’indique pas le nombre d’entreprises qui seront concernées par la modification arbitraire des seuils de représentation des salariés.
Mme Véronique Louwagie. Tout le monde veut simplifier, de même que tout le monde veut lutter contre la fraude. Encore faut-il s’accorder sur la méthode. Le code du travail, comportant 3 200 pages, s’est accru de 120 pages en deux ans. Cet instrument, qui devrait protéger l’emploi, le travail et prévenir la précarité, s’avère-t-il efficace ? Son obésité ne constitue-t-elle pas un frein à l’embauche ? N’est-il pas un ennemi de l’emploi ? La politique publique en la matière n’est-elle pas néfaste pour le développement de l’activité ?
M. le rapporteur propose une démarche vertueuse, reposant sur une méthode de bon sens : la création d’une commission poussera en effet au dialogue social. Je suis surprise de constater que les députés de la majorité ne souhaitent pas participer à la réussite de cette démarche visant à engager la simplification et le développement de l’emploi. Ainsi, ils n’ont déposé que des amendements de suppression, ce qui prouve bien qu’ils refusent de contribuer au débat. En outre, ils proposent d’éliminer tous les articles, ce qui trahit leur dogmatisme. J’aurais préféré qu’ils avancent des propositions, et je regrette qu’ils ne saisissent pas l’occasion de conduire un débat constructif.
Mme Monique Iborra. Ce texte relève d’une inspiration idéologique et opportuniste, ce qui m’étonne de votre part, monsieur le rapporteur. Il révèle la gêne de l’opposition face à la politique que nous menons en faveur des entreprises, de la compétitivité et de l’emploi, et qu’elle n’a jamais conduite !
Je suis déçue par vos idées en matière d’apprentissage. Auriez-vous oublié que les objectifs fixés par le précédent Président de la République n’avaient jamais été atteints ? Vous omettez de rappeler que les contrats de professionnalisation, financés par les partenaires sociaux, ont fortement diminué, concomitamment aux contrats d’apprentissage. Vous oubliez également de préciser qu’il est logique que l’alternance – contrats d’apprentissage comme de professionnalisation – pâtisse d’une conjoncture économique atone.
Le droit du travail satisfait déjà la plupart des articles de ce texte, qui est donc particulièrement décevant.
M. Gilles Lurton. Je vous félicite, monsieur Cherpion, pour les nombreuses avancées contenues dans cette proposition de loi, dont l’unique objectif est de permettre la relance de l’emploi par des mesures de fond. Les 35 heures, la simplification du bulletin de salaire – permettant de faciliter les processus de recrutement –, les accords sur l’aménagement du temps de travail, la flexibilité et l’apprentissage sont des sujets sur lesquels aucun progrès n’a été réalisé depuis deux ans et demi. Nous avons donc besoin de moderniser en urgence notre code du travail sur ces thèmes.
L’apprentissage reste la meilleure voie vers l’emploi et nous n’avons cessé de régresser dans ce domaine. Votre texte, monsieur Cherpion, ouvre la perspective d’une évolution positive. Tout d’abord, il limite fortement la durée du contrat d’apprentissage, qui sera dorénavant négociée par l’apprenti, le centre de formation et l’entreprise d’accueil. Ensuite, il réintroduit dans la loi les articles relatifs au préapprentissage à partir de quatorze ans et sous statut scolaire. Il répond à l’absence de décret en matière de travaux dangereux pour les apprentis, ce manque empêchant certains employeurs de recruter des apprentis. Enfin, il soumet les collectivités locales à la taxe d’apprentissage et facilite le recrutement d’apprentis dans ces structures.
Les collectivités locales peuvent rencontrer des difficultés pour recruter des tuteurs acceptant de prendre en charge des apprentis, si bien que nous devrons réfléchir au moyen de lever cet obstacle.
Mme Kheira Bouziane. Nous souhaitons tous contribuer au développement du travail, de la formation et de l’emploi, mais les propositions contenues dans ce texte me laissent perplexe. Vous sous-entendez, monsieur le rapporteur, que la simplification des règles créerait des emplois. Or j’ai récemment rencontré un représentant du secteur du bâtiment, qui m’a certifié que les 35 heures ne lui posaient aucun problème. Le dispositif des 35 heures a été adapté et ne constitue en rien un blocage. Par ailleurs, cette personne m’a affirmé que, si son carnet de commandes était rempli, la question des seuils ne se poserait pas. Les dispositions contenues dans ce texte ne répondent pas à l’objectif ambitieux de son titre.
La prime supra-légale traduit la reconnaissance du préjudice que certains salariés subissent lorsque des entreprises ferment des sites industriels afin d’accroître leurs profits et sans que leur compétitivité et leur rentabilité aient décliné. Revenir sur les primes supra-légales ne permettra pas de créer des emplois !
M. Rémi Delatte. La proposition de loi de Gérard Cherpion pourrait se résumer aux notions de simplification et de souplesse, tant en matière de droit du travail que de durée – minimale et maximale – du travail. L’une des conséquences des 35 heures est celle de la souffrance au travail – ressentie par les salariés qui doivent accomplir aujourd’hui en 35 heures ce qu’ils accomplissaient auparavant en 39. L’objectif de ce texte n’est pas de fragiliser le parcours du salarié ni de remettre en cause le dialogue social et les acquis sociaux, mais bien d’adapter notre droit à une situation exceptionnelle – celle d’une conjoncture fort dégradée –, d’engager des réformes structurelles en profondeur, sans tabou ni dogmatisme, de remotiver les capacités des chefs d’entreprise et de lever des freins à l’initiative et au développement économique. Il s’agit de redonner confiance aux acteurs de l’entreprise – dirigeants et salariés –, car il n’y aura de croissance et de création d’emplois que lorsque l’on retrouvera des conditions de confiance.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Cette proposition de loi est sans surprise, puisque, dans la plus pure essence des discours libéraux, elle n’est pas sans rappeler les récentes propositions du président du MEDEF. Son raisonnement est le suivant : les difficultés économiques du pays seraient majoritairement liées aux pseudo-rigidités du marché du travail et du code du travail. Or on sait qu’un tel diagnostic est erroné, d’abord parce qu’il fait fi des nombreux éléments de fluidité qui existent déjà sur le marché du travail, comme en témoigne le nombre croissant de ruptures conventionnelles, ensuite parce qu’il fait abstraction de l’absence de demande pour expliquer ces difficultés économiques. Et en réalité, ce diagnostic sert de prétexte pour attaquer certains droits sociaux.
Vous nous dites que les 35 heures sont une question taboue. Or, bien que les possibilités de dérogations à cette durée existent depuis 2008, en raison d’évolutions que vous avez décidées lorsque vous étiez au pouvoir, peu nombreuses ont été les entreprises qui y ont eu recours. Cela démontre bien qu’elles n’ont pas jugé prioritaire d’appliquer la faculté qui leur a été offerte pour faire face à leur situation économique. Sans revenir sur la nécessité d’attendre les conclusions de la commission d’enquête sur les 35 heures, dont plusieurs d’entre nous sont membres, je constate que votre approche de la question relève davantage du dogmatisme que de l’examen du réel.
Enfin, vous établissez dans cette proposition de loi des liens de cause à effet que je ne comprends pas : en quoi la diminution des droits des stagiaires faciliterait-elle leur embauche par les entreprises ? Ce n’est pas parce qu’une entreprise prend un stagiaire qu’elle l’embauchera nécessairement à l’issue de son stage – le recrutement dépendant notamment de la situation de l’entreprise et du remplissage de son carnet de commandes. Là encore, à part trouver un prétexte pour diminuer des droits obtenus et renforcés grâce à une proposition de loi de notre majorité, défendue par Chaynesse Khirouni, je ne vois pas l’intérêt que présentent vos propositions pour atteindre les objectifs que vous affichez.
M. Jean-Louis Costes. Le sujet qui nous occupe mérite mieux qu’un rejet en bloc – caricatural et idéologique – de nos propositions, sous prétexte qu’elles seraient celles de Nicolas Sarkozy ou de Pierre Gattaz. Nous nous accordons tous sur le fait que notre pays est au bord du gouffre économique. Or, votre politique économique n’apportant aucun résultat, vous pourriez au moins avoir la modestie d’accepter d’entrouvrir la porte des réformes. Lorsque j’entends le Président de la République ou le Premier ministre dire qu’ils envisagent d’encourager l’apprentissage, mais que, dans le même temps, les mesures en faveur des apprentis sont supprimées puis quelque peu rétablies, ou encore que nous sommes en train de précariser les salariés, j’ai envie de vous demander qui la favorise, cette précarité ! Les emplois d’avenir en sont l’exemple même, puisqu’ils font l’objet de contrats à durée déterminée. Je leur préfère, quant à moi, des contrats à durée indéterminée en entreprise. Surpris par votre comportement, je ne comprends pas votre idéologie : Karl Marx existe encore, mais uniquement en France !
Mme Chaynesse Khirouni. L’un de nos collègues de l’UMP vient d’évoquer les absurdités de la loi de juillet dernier encadrant les stages, qui fut portée par notre groupe. Or, en 2006, Mme Pécresse et l’ensemble des députés de droite ont déposé une proposition de loi visant à encourager et à moraliser le recours aux stages par les entreprises. L’objectif de ce texte était de lutter contre le chômage des jeunes et les abus. Cette proposition reposait sur quatre principes : permettre le suivi des stages dans la transparence, avec la généralisation de l’obligation de la signature de conventions de stages, tout en imposant aux entreprises la tenue d’un registre de stage ; donner aux stagiaires une rémunération équitable et proposer le versement d’une indemnisation à hauteur de 50 % du SMIC minimum ; définir clairement les abus de stage ; enfin, inscrire le stage dans le parcours professionnel du jeune. Nous ne sommes pas dogmatiques. Quant à vous, vous manquez de cohérence dans vos propositions.
M. Richard Ferrand. J’entends ceux de nos collègues qui soutiennent cette proposition de loi nous parler de pragmatisme, de bonne volonté et d’absence d’idéologie. Or la philosophie de ce texte tend à renforcer l’antagonisme entre les salariés et les employeurs : elle repose en effet sur le postulat qu’accorder trop de droits aux salariés tuerait l’emploi, ce afin de justifier que l’on diminue ces droits dans l’ensemble des chapitres du texte, sous couvert parfois de simplifications.
Une telle vision de la vie des entreprises est conservatrice et passéiste. Lorsque l’on s’attaque aux seuils, cela signifie que l’on ne considère pas le dialogue social comme un moteur d’enrichissement du processus de production susceptible d’apporter une réelle valeur ajoutée dans l’entreprise. Toujours avec ce même goût du paradoxe, vous affirmez qu’accroître la souplesse et la précarité créera de la sécurité et de l’emploi. Or ce n’est pas en fragilisant l’organisation des entreprises, les capacités des salariés à imaginer l’avenir avec leurs dirigeants, que l’on redonnera confiance aux acteurs économiques.
La modernité, c’est le dialogue social, la formation et l’innovation. Monsieur le rapporteur, le postulat qui fonde votre proposition de loi me paraît aux antipodes des nécessités de la modernité qui veulent que l’encadrement, les salariés et les dirigeants aient partie liée dans la définition du progrès de l’entreprise – ce qu’empêche votre proposition. Vous pensez l’organisation du travail en regardant dans le rétroviseur et en affirmant que les progrès sociaux sont des freins. Je crois à l’inverse que, mieux utilisés, ils peuvent être des accélérateurs de créativité dans les entreprises.
M. Jean-Pierre Barbier. La France enregistre aujourd’hui un taux de chômage record. Depuis deux ans, on compte mille chômeurs de plus par jour. La situation paraît complètement bloquée. J’entends bien que l’on se préoccupe des droits des salariés. Mais il serait bon de penser aussi à ceux qui n’ont pas d’emploi. Dans cette perspective, les dispositions de cette proposition de loi portant sur l’apprentissage – qui visent notamment à rétablir des moyens supprimés – me paraissent tout à fait bénéfiques au travail des jeunes. Enfin, le texte pose à nouveau la question de l’âge.
La simplification du code du travail ne va-t-elle pas dans le sens des orientations fixées par le Président de la République ? Ce choc de simplification qu’il appelait de ses vœux, pourquoi le refusez-vous systématiquement quand il s’agit du code du travail ? Quant aux 35 heures, à la flexibilité et aux seuils d’effectifs dans les entreprises, il me semble qu’Emmanuel Macron en a déjà parlé – avant d’être ministre, certes – en des termes qui prouvent que, loin d’être « de droite », certaines propositions sont transversales.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Les propos qu’a pu tenir M. Macron avant d’entrer au Gouvernement n’engagent que lui.
M. le rapporteur. Je me réjouis que cette proposition de loi ne laisse pas indifférent : elle a au moins le mérite de permettre un débat.
Monsieur Robiliard, la réforme Larcher, à l’élaboration de laquelle j’ai participé en tant que parlementaire, me paraît excellente : je l’ai d’ailleurs mise en application dans le cadre de la loi de juillet 2011 qui porte mon nom. Pour réviser le code du travail, je prévois la création d’une commission chargée de formuler des propositions – qui seront ensuite soumises au Parlement. Et ce n’est qu’entre le moment où la commission rendra ses conclusions et celui où elles seront soumises au Parlement que la loi Larcher s’appliquera. Concernant la durée minimale de travail de 24 heures, non seulement je ne l’ai pas votée, mais je me suis même battu contre. Et, si cette mesure éloigne tant les salariés de la précarité, pourquoi le Gouvernement en a-t-il déjà repoussé deux fois l’application ?
Je remercie Valérie Lacroute pour son exposé et son soutien, ainsi que pour ses amendements, fruit d’un travail de terrain, et qu’il me paraîtrait souhaitable d’adopter.
Arnaud Richard a adopté une position très centriste, affirmant que cette proposition de loi était bénéfique, mais que, en l’adoptant, on risquait d’empiéter sur le dialogue social. Or je tiens à lui rappeler que ce texte a été déposé avant que le Gouvernement ne prenne certaines décisions. Je ne disconviens donc pas que certains aspects aient évolué, comme je le mentionne dans mon rapport.
Je vous accorde que la prime supra-légale est une forme de reconnaissance du préjudice subi par le salarié : le code du travail prévoit en effet que les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) comprennent l’application d’une prime légale, et que le préjudice estimé donne lieu au versement d’une prime supra-légale. Toutefois, lorsque, dans ma circonscription, une entreprise familiale de textile d’une centaine de salariés est contrainte de faire un plan social, aucune prime supra-légale n’est versée. Dans le même temps, lorsqu’une grande entreprise ferme cinquante kilomètres plus loin, chaque salarié ayant accumulé deux années de présence touche une prime supra-légale de 50 000 euros. Une telle situation fait apparaître une double iniquité : d’une part, le salarié de la petite entreprise n’aura droit à aucune prime, alors qu’il aura probablement plus de difficultés à se reclasser ; d’autre part, le montant des primes versées diffère d’une entreprise à l’autre.
La prime supra-légale n’a aucun impact sur le reclassement, car elle ne relève pas du PSE. Je préférerais que la prime supra-légale soit moindre et que l’entreprise soit contrainte à faire davantage d’efforts en faveur de l’accompagnement et du reclassement des salariés. Lorsque, près de Charleville, une entreprise a fermé, le garage BMW local a fait les plus belles affaires de sa vie pendant un an. Puis les voitures ont été revendues, parce que les salariés licenciés s’étaient fait piéger par cette prime. Je comprends que des personnes qui perdent leur emploi aient envie d’utiliser leur prime pour se faire plaisir. Certains pensent aussi que cet argent est nécessaire pour leur permettre de se reclasser. Mais, en Lorraine, lorsque le secteur de la sidérurgie a fait l’objet de grands plans sociaux, les sommes considérables qui ont été versées au titre des primes supra-légales ont servi à l’ouverture de pizzerias et de services d’ambulance qui n’ont pas tardé à faire faillite. J’ai écrit, en 2009, un rapport sur les primes supra-légales, cautionné tant par la CGT que par la CFDT, qui estimaient que l’effort devait porter sur l’accompagnement et le reclassement, plutôt que sur cette prime.
Monsieur Cavard, non, ma proposition de loi n’a pas été rédigée par M. Gattaz ! Elle a été déposée avant qu’il ne formule ses propres propositions. Je ne prétends ni ne souhaite être son inspirateur.
C’est à tort que vous affirmez que nous proposons la suppression des seuils : nous proposons la fixation d’un premier seuil à cent salariés, tout en souhaitant que ce point fasse l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux. Nous proposons en fait de conserver trois seuils pour les grandes et très grandes entreprises.
Je n’ai effectivement formulé aucune proposition concernant les dividendes, qui relèvent davantage de la loi de finances que du code du travail. Vous reconnaîtrez d’ailleurs que ce code est fort complexe : ayant eu un problème à régler dans le cadre d’une autre de mes activités, j’ai été obligé de recourir à un avocat pour comprendre certaines dispositions du code, que je pense pourtant connaître assez bien.
S’agissant de la représentation territoriale, je rappelle que la représentation syndicale dans les petites entreprises n’existe pas. Souhaite-t-on que 4 millions de personnes continuent à ne pas être représentées ou, au contraire, assurer une représentation territoriale dans ces entreprises ? Celle-ci permettrait de faire le lien avec les régions, et notamment avec les contrats de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDF).
La mise en application de la durée minimale de travail, fixée à 24 heures, a déjà été reportée deux fois. Vous évoquiez, madame la présidente, les dérogations existantes. Permettez-moi de déplorer que le droit du travail soit fondé à la fois sur des textes législatifs, sur des décrets qui ne sont pas forcément en adéquation avec la loi, sur des circulaires et enfin sur des dérogations possibles : un tel système est trop complexe.
Madame Orliac, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la proposition de loi. En définitive, nos positions à tous sur les 35 heures ne paraissent pas si éloignées les unes des autres. Il serait idiot de demander aux salariés de PSA qui travaillent 32 heures d’en travailler 39. Il importe au contraire qu’une entreprise puisse, par le biais d’un accord, déterminer, pendant une période donnée, le nombre d’heures travaillées au-delà desquelles on parlerait d’heures supplémentaires. Les 39 heures ne seraient alors qu’une durée légale fixée pour encourager les entreprises à conclure des accords un an après la publication de la loi. Compte tenu des problèmes qu’a posés l’application des 35 heures dans les hôpitaux, la durée de 39 heures que nous proposons ne paraît pas dogmatique.
Madame la présidente, il faudra notamment prévoir une dérogation à cette durée minimale pour les porteurs de journaux qui ne travaillent que 2 heures par jour cinq jours par semaine, soit 10 heures au total. Il ne faut pas non plus supprimer ces petits boulots qui permettent aux étudiants de travailler.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Les étudiants de moins de vingt-six ans bénéficient déjà de dérogations !
M. le rapporteur. C’est exact. Mais ces emplois sont aussi occupés par des personnes ayant besoin d’un petit complément de salaire, ainsi que des retraités.
Mme la présidente Catherine Lemorton. Ces dérogations sont aussi prévues pour les compléments de salaire !
M. le rapporteur. Certes. Mais il s’agit de dérogations et non pas d’un système simple.
Monsieur Sirugue, je vous accorde que des rapports ont été rédigés sur la notion de flexi-sécurité : celle-ci est nécessaire pour permettre aux entreprises de s’adapter. Et, s’il est vrai qu’elle a pu poser des difficultés à certaines entreprises de la région de Chalon, d’autres exemples montrent qu’elle aide à trouver des solutions. C’est plus souvent un problème d’hommes que de lois qui se pose. Mais on est souvent obligé de recourir à la loi.
Je rappelle à Christophe Cavard que les salariés ne sont pas représentés dans les petites entreprises, de sorte que, en fixant le seuil à cent salariés, on ne remet nullement en cause la représentation des salariés dans les entreprises situées en deçà. En outre, le curseur pourra être réglé au terme d’une discussion entre les partenaires sociaux. Et la représentation des salariés pourra être assurée au niveau territorial, solution qui me paraît plus adaptée aux problèmes des petites entreprises.
Je remercie Bernard Perrut pour son intervention, qui tend à apporter de l’oxygène à notre vie sociale, à nos entreprises et à leurs salariés. Notre collègue a raison d’attirer notre attention sur le nombre de contrats précaires dont la durée déterminée est très courte, ou bien qui relèvent de l’intérim. Sans aller jusqu’à préconiser un contrat unique – dans la mesure où tous les contrats ne pourront suivre le même modèle –, il me semble qu’un contrat à droits progressifs permettrait de couvrir l’ensemble du système.
Monsieur Sebaoun, le MEDEF et l’UMP, ce n’est pas la même chose ! J’ai formulé mes propositions bien avant que le MEDEF n’énonce les siennes, et, s’il s’inspire des miennes, je n’en suis nullement responsable et ne réclame aucun droit d’auteur.
Par ailleurs, nous n’avons jamais dit que les Français ne travaillaient pas, et vous avez eu raison de rappeler que le nombre d’heures de travail qu’ils effectuent correspond à la moyenne, même s’il doit être possible, pour l’un comme pour l’autre, de produire des chiffres qui prouvent le contraire. Si, par exemple, les Allemands travaillent moins, c’est parce qu’ils concluent de nombreux contrats de petite durée. Et vous avez vous-même insisté sur le fait que les cadres travaillaient en moyenne 44 heures. Cela fait remonter la moyenne globale de la durée du travail à 39 heures, ce qui signifie que de nombreux salariés travaillent moins.
Je remercie Isabelle Le Callennec pour le message fort qu’elle nous a transmis concernant l’apprentissage.
Michel Liebgott, il n’est pas question de stigmatiser les fonctionnaires, car nous bénéficions d’une fonction publique de qualité. Cela étant, des problèmes s’y posent, notamment à l’hôpital. Il convient donc de déterminer comment régler le curseur à hauteur de 39 heures.
S’agissant de la négociation des seuils de salariés, je rappelle encore une fois que quelque 4 millions de salariés français ne sont pas représentés, dans toutes les entreprises de moins de dix salariés. J’ai fixé le seuil à cent salariés, mais la négociation permettra de préciser les choses, dans la mesure où ce texte doit être soumis aux partenaires sociaux.
Je remercie Véronique Louwagie d’avoir insisté sur le choc de simplification et d’avoir demandé si notre code du travail était protecteur. Nous nous accorderons tous sur le fait qu’il protège davantage les avocats que les employés et les employeurs. Elle a également raison de souligner la nécessité de laisser de côté tout dogmatisme. Je reprendrai d’ailleurs ici les propos du Premier ministre qui, chaque fois qu’il s’exprime dans notre assemblée, nous invite à nous rassembler pour essayer de trouver des solutions. Je veux bien que celles que je vous propose ne vous conviennent pas, mais ne soyons pas dogmatiques !
Madame Iborra, je ne suis ni un idéologue ni un opportuniste : c’est par conviction que j’ai rédigé cette proposition de loi, mon objectif étant de faire réfléchir l’ensemble de notre société et de trouver des solutions.
Gilles Lurton a raison d’insister sur le manque d’apprentis dans les collectivités locales : on n’en compte en effet que 8 000. Bien que de nombreux emplois de maintenance et dans les parcs et jardins puissent être exercés dans le cadre de contrats d’apprentissage, le système actuel n’y encourage pas. S’agissant des emplois d’avenir, nous nous sommes battus en faveur de leur volet formation. Mais des difficultés se posent au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), car certaines formations très courtes ne correspondent pas aux besoins des jeunes bénéficiaires de ces contrats d’avenir.
Madame Bouziane, vous nous dites que le chef d’entreprise du bâtiment que vous avez rencontré n’a eu aucun problème à appliquer les 35 heures. J’ai entendu les mêmes propos, mais certains patrons sont moins enthousiastes, dans la mesure où il leur faut prendre en compte dans le temps de travail de leurs employés le temps de transport nécessaire pour que ceux-ci se rendent sur des chantiers éloignés. De fait, la prise en compte du temps de transport et sa rémunération sont assez problématiques.
Monsieur Delatte, il est évident que, si l’on reste dogmatique, on n’obtiendra aucune souplesse. Quant à notre taux de productivité, il est plutôt élevé. Reste que se pose le problème de la qualité de vie au travail et qu’il est nécessaire d’accroître ce taux.
Madame Carrey-Conte, vous avez raison d’affirmer que les ruptures conventionnelles ont un revers : nombre d’entre elles conduisent à la précarisation de nombreux salariés, même s’ils bénéficient d’indemnités.
J’ai tout de même noté des contradictions entre les positions des uns et des autres, notamment en ce qui concerne les droits des stagiaires. Lorsque la loi a fait passer de 12,5 % à 15 % du SMIC le niveau de gratification qu’il était possible d’accorder à un stagiaire, le législateur n’a pas supprimé la possibilité d’exonérer de cotisations ces quelque 80 euros. Le chef d’entreprise qui embauche un stagiaire se trouve donc obligé de le déclarer pour cette modeste somme. Je propose donc de rendre l’exonération possible jusqu’à 80 % du SMIC. S’il est vrai que certains employeurs utilisent mal leurs stagiaires, il en est qui utilisent le stage comme tremplin pour l’emploi dans ou à l’extérieur de leur entreprise. Par conséquent, porter l’exonération à 80 % du SMIC leur permettra de mieux rémunérer les stagiaires.
Madame Khirouni, vous avez cité une proposition de loi sur l’encadrement des stages qui fut déposée en 2008, mais je vous rappelle que, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2011, j’ai négocié avec Laurent Berger, de la CFDT, et qu’il m’avait demandé de mettre fin à certaines dérives concernant les stages. La loi de 2011 a certes apporté de la sécurité en la matière, mais votre majorité a été trop influencée par un certain groupuscule lorsqu’elle a voté la loi de 2014 encadrant les stages.
Monsieur Ferrand, je n’ai nullement l’intention de renforcer l’opposition entre salariés et employeurs, et ne pense pas que l’on puisse me suspecter d’être l’adversaire du dialogue social.
M. Barbier citait le chiffre de 1 000 chômeurs de plus chaque jour : il est vrai que notre économie va mal et que nous nous heurtons à de grandes difficultés en matière d’emploi. Notre collègue a raison de souligner que l’on ne doit pas perdre de vue la situation des chômeurs, par rapport à celle des salariés. Je rappelle que la loi de 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle est le premier texte à conférer aux chômeurs la possibilité de se former grâce aux fonds de la formation professionnelle – escalier social conçu à l’origine pour que les salariés puissent évoluer au cours de leur parcours professionnel.
Enfin, il est vrai qu’Emmanuel Macron a exprimé des positions qui ne sont guère éloignées de nos propositions.
Chapitre 1er
Dispositions relatives à la vie en entreprise
Section 1
Réforme du code du travail
Article 1er
Création d’une commission chargée de réformer le code du travail
Le présent article propose de créer une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.
I. UN CODE DU TRAVAIL COMPLEXE ET RIGIDE
Le droit du travail est aujourd’hui perçu par beaucoup d’acteurs –salariés, entreprises, partenaires sociaux, administration, juge – comme difficilement compréhensible et donc difficilement applicable.
La complexité du code du travail s’est accrue au cours des dernières années, puisqu’il est passé de 600 articles en 1973 à 3 800 en 2003. Après avoir ainsi vu son volume multiplié par six en l’espace de 30 ans, il a triplé lors des dix dernières années, pour comporter aujourd’hui près de 12 000 articles.
Cette complexité constitue un frein à l’embauche, dans la mesure où les entreprises, confrontées à un corpus réglementaire particulièrement lourd, peuvent éprouver des difficultés à s’adapter à un environnement changeant et instable. On dénombre ainsi trente-huit contrats de travail différents et plus d’une dizaine de seuils.
La lourdeur du code du travail se traduit également par une forte insécurité juridique, qui nourrit un contentieux important. Elle crée en outre une véritable fracture entre les petites et les grandes entreprises, les premières ne disposant pas toujours de moyens suffisants pour se doter de services juridiques, afin d’analyser et d’intégrer toutes les règles en vigueur. D’après un sondage réalisé par l’institut IPSOS en mars 2014, un dirigeant de TPE ou PME sur cinq reconnaît avoir besoin d’un accompagnement juridique renforcé (20).
Cet article, en créant auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de réformer le code du travail, doit contribuer à rendre le droit du travail moins rigide, moins complexe, et à l’adapter aux évolutions du monde moderne, en donnant toute sa place au dialogue social.
II. LA SIMPLIFICATION DU CODE DU TRAVAIL
Le I du présent article institue une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Cette commission, placée auprès du ministre du travail, doit proposer un nouveau code du travail simplifié dans un délai d’un an. Ce délai d’un an laisse le temps à la commission de mener une réflexion approfondie afin d’identifier les dispositions trop complexes ou inopérantes et de proposer les mesures de simplification et d’adaptation appropriées.
A. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA COMMISSION
Les alinéas 2 à 6 précisent les principaux objectifs que devra poursuivre le nouveau code du travail simplifié.
L’alinéa 2 propose ainsi d’accroître les possibilités de dérogations, par accord collectif, aux dispositions du code du travail. Cette possibilité permet d’introduire davantage de souplesse dans la législation, de garantir l’adaptation du droit aux réalités de terrain et de favoriser le dialogue social.
L’alinéa 3 traite de l’harmonisation des seuils d’effectifs au-delà desquels des obligations spécifiques sont applicables aux entreprises. Alors que l’on dénombre plus d’une dizaine de seuils différents, la commission chargée de réformer le code du travail devra ramener leur nombre à trois et fixer leur niveau.
La simplification des règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail est prévue à l’alinéa 4. Certains droits devront être rendus davantage progressifs, afin d’éviter notamment les pertes de droits liés aux ruptures de contrats.
Afin de clarifier et de rationaliser la représentation du personnel, l’alinéa 5 précise que la commission devra réfléchir à la création d’une instance unique de représentation élue du personnel, pour les seules entreprises employant cent salariés et plus. Les différentes instances représentatives des salariés seront fusionnées dans cette nouvelle instance. La réforme de la représentation du personnel dans les entreprises de moins de cent salariés est détaillée à l’article 7 de la présente proposition de loi.
L’alinéa 6 fixe comme objectif d’instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail. En donnant une autonomie renforcée à la négociation collective, cette proposition s’inscrit dans l’évolution voulue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui a conféré une plus grande légitimité aux partenaires sociaux.
B. LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
Le II du présent article décrit la composition de cette commission. Elle serait constituée de vingt-cinq membres, nommés par arrêté du Premier ministre et répartis comme suit :
– deux députés ;
– deux sénateurs ;
– cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisies parmi les représentants des salariés ;
– cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisies parmi les représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
– cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
– quatre représentants de l’État ;
– un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;
– un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
Cette composition équilibrée est gage de dialogue social, puisque la commission réunit représentants de l’État, du Parlement, des syndicats de salariés et du patronat. La présence de personnalités qualifiées, reconnues en raison de leur expertise dans le domaine du droit du travail, permettra d’éclairer utilement les débats. La commission sera ainsi dotée d’une représentativité et d’une autorité incontestables.
Le III du présent article renvoie les modalités d’organisation de la commission à un décret en Conseil d’État.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS6 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Monsieur le rapporteur, je ne partage pas votre avis quant à l’application non pas de la loi Larcher – article L. 1 du code du travail –, je me référais pour ma part au protocole Accoyer, engagement de l’Assemblée nationale à l’égard des partenaires sociaux. Dans votre proposition de loi, vous ne vous bornez pas à instituer une commission : vous prenez une position précise sur plusieurs questions emblématiques en matière de droit du travail et dans les rapports sociaux. L’article 1er, où vous fixez le premier seuil d’effectifs à cent salariés, est bien une proposition provocatrice. Vous ne la soumettez d’ailleurs pas à l’arbitrage des partenaires sociaux, mais prévoyez que la commission ne pourra fixer de seuils d’effectifs qu’au-delà de cent salariés.
De même, il serait nécessaire de soumettre la question du passage de 35 à 39 heures aux partenaires sociaux. Or vous proposez d’en décider par la loi. Enfin, vous procédez de même pour la durée minimale de 24 heures, alors qu’elle est le fruit de la négociation sociale. Bref, avec cette proposition de loi, vous faites fi du processus de négociation sociale que l’ancienne majorité à laquelle vous avez appartenu avait elle-même institué par le biais de la loi Larcher.
Sur le fond, la question des seuils sociaux peut être soumise à la discussion. Mais vous instaurez un système à la fois complexe et imprécis. Vous fixez à cent salariés le premier seuil d’effectifs, et instaurez une représentation territoriale pour les entreprises de moins de cent salariés, libre ensuite aux partenaires sociaux d’en définir les modalités et de conclure un accord qui sera proposé au Parlement afin qu’il définisse des règles. Cela est totalement inacceptable ! Le législateur ne peut imposer aux partenaires sociaux de se mettre d’accord sur des règles. Imaginez qu’aucun accord ne soit conclu : je ne suis pas prêt à lâcher la proie pour l’ombre. Ensuite, il peut actuellement y avoir un représentant du personnel dans les entreprises dès lors que leur effectif dépasse dix salariés. Or, en proposant que les entreprises dont les effectifs se situent entre dix et cent salariés n’aient plus la possibilité de disposer d’un représentant du personnel, c’est-à-dire d’un salarié jouissant de la protection nécessaire pour pouvoir discuter avec l’employeur, vous assumez une régression complète du dialogue social au cœur de l’entreprise ! La représentation territoriale ne pourra jamais égaler la représentation au sein de l’entreprise. Je partage donc les propos de Richard Ferrand : le dialogue social, y compris dans les entreprises de moins de cent salariés, est facteur de progrès économique et social. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 1er.
M. Christophe Cavard. Dans l’exposé des motifs de l’article 1er, vous présentez le code du travail comme un frein à la vie des entreprises. Mais, lorsque je vous demande pourquoi vous en jugez ainsi, vous vous contentez de répondre que de nombreux articles ont grossi ce code et qu’il vous a vous-même fallu recourir à un avocat pour en comprendre le contenu. Voilà qui ne répond pas à ma question. Que vous ayez du mal à comprendre ce code sans l’aide d’une tierce personne ne me paraît pas anormal : les salariés eux-mêmes font appel à des experts pour pouvoir bien saisir le droit du travail, à la suite de quoi des juridictions tranchent les litiges. La réponse que vous m’avez fournie ne justifie pas que l’on détricote le code du travail, même en prenant la précaution de passer pour ce faire par une commission : en procédant ainsi, vous prenez une autre voie que celle du dialogue social que vous défendez pourtant vous-même.
Concernant les seuils, vous insistez sur la plus-value qu’apportera votre proposition dans les entreprises de moins de dix salariés. Mais, dans ce cas, réfléchissons ensemble, dans le cadre de textes futurs, à la manière de représenter les salariés dans ces entreprises. Si l’on sait qu’une telle représentation ne pourra s’exercer dans l’entreprise, pourquoi ne pas imaginer une représentation territoriale comme vous le proposez ? Seulement, en contrepartie de cette avancée potentielle, vous faites disparaître la représentation des salariés dans les entreprises de dix à cent salariés, telle qu’elle existe aujourd’hui. Et, dans le même temps, vous défendez davantage les accords d’entreprise que de branche ou de filière. Il y a donc une distorsion entre certaines de vos convictions et une position très entendue ces derniers temps et relevant d’une logique idéologique.
M. Jean-Pierre Barbier. Lorsque j’entends dire que le code du travail serait un « rempart pour protéger les droits des salariés », je me dis qu’un rempart en protège certains, mais en empêche d’autres d’accéder au marché du travail. Telle est bien la question sous-jacente à ce texte.
D’autre part, monsieur Robiliard, les partenaires sociaux feront partie de la commission qu’il nous est proposé de créer : s’ils ne vous y paraissent pas suffisamment impliqués, pourquoi ne pas renforcer leur participation plutôt que de déposer un amendement de suppression de l’article ? Et, en dépit de tout le respect que nous leur devons, l’Assemblée nationale doit-elle être la chambre d’enregistrement de leurs négociations ? La représentation nationale doit pouvoir intervenir sur ces sujets. Je ne comprends donc pas votre acharnement à refuser toute discussion. Compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, il serait bon que nous essayions d’avancer ensemble.
M. le rapporteur. M. Robiliard m’a demandé ce qui se passerait en l’absence d’accord entre les partenaires sociaux. Comment le Gouvernement procède-t-il aujourd’hui en l’absence d’accord sur les lettres d’orientation qu’il leur adresse ? Il fixe une date limite au terme de laquelle il prend position. On peut donc prévoir la même possibilité.
Nous ne cessons d’adopter de nouvelles normes sans supprimer celles qui existent. Le législateur devrait avoir l’obligation de toiletter le droit en vigueur lorsqu’il propose un nouveau texte. Un représentant de la Fédération française du bâtiment m’a ainsi expliqué que, pour construire une maison, il lui fallait respecter 2 800 normes !
En ce qui concerne la représentation dans les entreprises de moins de dix salariés, il me semble que nous en avons discuté en 2008 et que les propositions avaient effectivement été refusées à l’époque. L’instauration d’une représentation territoriale ne remet nullement en cause la représentation existant dans les entreprises : les délégués territoriaux seront bel et bien des élus des entreprises, mais leur action sera beaucoup plus large et de portée territoriale. Quant au nombre de délégués à désigner, il devra être déterminé par la négociation entre les partenaires sociaux et non pas dans le cadre de notre proposition de loi. Sachez qu’il existe aujourd’hui autant de représentants des salariés que d’élus. L’enjeu n’est pas de diminuer leur nombre, mais d’améliorer le dialogue social dans l’ensemble des entreprises.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à la suppression de l’article 1er.
Mme Véronique Louwagie. Les arguments développés en faveur de la suppression de l’article 1er font apparaître une vraie divergence de vues entre nous.
La première des questions qui se posent est de savoir si le code du travail est complexe ou pas pour les entreprises. Or nous répondons par l’affirmative : ce code effraie leurs dirigeants. Du fait de sa complexité, il entraîne de véritables difficultés qui se traduisent par des conflits et des litiges devant les conseils de prud’hommes. Il appartient donc au législateur de réagir à cette situation et de conférer une certaine sécurité à la relation entre le salarié et l’entreprise.
D’autre part, vous dénoncez, monsieur Robiliard, le fait que l’instauration de cette commission remette en cause le dialogue social. Or c’est faux. Plusieurs questions doivent être résolues pour simplifier le code du travail : les questions de fond relèvent des partenaires sociaux tandis que les questions de forme seront traitées par les membres de cette commission.
Enfin, si le passage du seuil de dix à cent salariés vous gêne, pourquoi ne pas proposer un amendement pour modifier cet article ?
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 1er est supprimé.
Section 2
Dispositions relatives au temps de travail
Article 2
(articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail)
Augmentation de la durée de travail à trente-neuf heures
Le présent article vise à réformer la durée du travail en France en augmentant celle-ci de trente-cinq à trente-neuf heures.
I. LA DURÉE DU TRAVAIL EN FRANCE : UN CADRE LÉGAL TROP CONTRAIGNANT
La loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (21) – dite loi « Aubry I » – a fixé la durée légale du travail à trente-cinq heures, au 1er janvier 2000 pour les entreprises d’au moins vingt salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres.
Cette réforme s’est accompagnée d’un dispositif d’allégements de cotisations sociales conditionné à une baisse du temps de travail et à des créations d’emplois (volet « offensif » du dispositif) ou à un maintien d’emplois pour les entreprises concernées par un plan social (volet « défensif »).
La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (22) – dite La loi « Aubry II » – a allégé les cotisations sociales des entreprises qui prévoient, dans un accord collectif majoritaire, une durée de travail collective de trente-cinq heures, et qui précisent le nombre d’emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail.
Cette loi a, par ailleurs, facilité les aménagements du temps de travail pour les entreprises : elle a simplifié, en les fusionnant, les règles relatives aux modulations du temps de travail, et permis de s’affranchir du cadre hebdomadaire de calcul des heures supplémentaires, en établissant une moyenne sur une période infra-annuelle ou annuelle.
Depuis l’adoption des lois « Aubry », plusieurs réformes ont donné aux entreprises des leviers leur permettant d’organiser le temps de travail au plus près de leurs besoins et de disposer d’une plus grande autonomie pour négocier :
– c’est le cas notamment de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi (23), dite loi « Fillon » ;
– et de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (24).
Mais c’est surtout la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (25) qui a donné des outils aux entreprises pour assouplir la durée du travail, comme le détaille l’encadré ci-dessous.
La loi du 20 août 2008 précitée permet aux entreprises de déroger plus facilement à la durée légale de trente-cinq heures et d’aménager plus facilement le temps de travail :
– en assouplissant les règles de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
– en facilitant le recours aux heures supplémentaires « hors contingent » ;
– en facilitant l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un unique régime juridique : tout aménagement du temps de travail et toute répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année doivent être mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord ou une convention de branche.
Plus récemment, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (26) a précisé que l’accord collectif peut primer sur le contrat de travail en matière d’aménagement du temps de travail.
Le législateur a donc mis en place de nombreux outils pour aménager le temps de travail et donner plus de flexibilité aux entreprises. Cependant, leur bilan est contrasté, la législation restant très complexe.
Ainsi, dans une étude relative aux accords collectifs d’entreprises conclus en 2010, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) (27) constate : « Malgré leur proportion élevée, les accords sur le temps de travail sont sensiblement moins nombreux en 2010 qu’en 2009 (- 6 %). Cette baisse est même légèrement plus marquée que celle du volume d’ensemble, après exclusion des accords seniors (-3,6 %). Elle semble témoigner d’une faible appropriation par les entreprises des possibilités offertes, depuis 2009, par le volet sur le temps de travail de la loi du 20 août 2008 qui donne la primauté aux accords d’entreprise plutôt qu’aux accords de branche pour les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail. La reprise conjoncturelle en 2010 pourrait avoir été jugée encore trop limitée pour justifier des modifications en matière de temps de travail et notamment des conditions de recours aux heures supplémentaires. »
Par ailleurs, outre son caractère trop contraignant, la législation sur la durée du travail en France a indéniablement pesé sur le coût du travail et sur la compétitivité française.
Ainsi, en novembre 2013, un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) « France, redresser la compétitivité » imputait à la réduction du temps de travail une bonne partie de la faiblesse de la croissance, la perte des parts de marchés des entreprises françaises ainsi que les écarts de revenus avec les autres pays européens. Selon l’OCDE : « cette faible croissance des revenus s’explique par un recul prononcé du nombre d’heures travaillées, recul tout juste compensé par les gains de productivité horaire » et « tient largement à la sous-utilisation du facteur travail » (28).
II. AUGMENTER LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE SOUPLESSE AUX ENTREPRISES
Le présent article propose, dans son I, d’augmenter la durée légale du travail de trente-cinq à trente-neuf heures et modifie en ce sens l’article L. 3121-10 du code du travail.
Il est, bien évidemment, exclut que le salarié qui travaille trente-neuf heures garde le même niveau de salaire que s’il travaille trente-cinq heures. Le III précise, par conséquent, que le passage de trente-cinq à trente-neuf heures ne peut être la cause d’une réduction du montant de la rémunération mensuelle habituelle du salarié.
Par ailleurs, cet article donne une place centrale à l’accord d’entreprise s’agissant de la négociation du montant de la majoration pour heures supplémentaires :
– alors que l’article L. 3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes mais qu’une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ;
– le II confère une prééminence à l’accord d’entreprise en proposant que le taux de majoration puisse être fixé par « un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». Cette disposition a pour objectif de développer la négociation sur la durée du travail au plus près du terrain, et de palier le faible nombre d’accords sur ce sujet dans certaines branches.
Enfin, le IV protège les entreprises qui se sont organisées sous le régime des trente-cinq heures. Afin de ne pas les déstabiliser, les conventions existantes restent en vigueur. Elles devront toutefois se mettre en conformité dans l’année suivant la promulgation de la loi.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS7 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Un ministère a été dévolu à la simplification, et nous avons habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la notion de « jours ». La clarté est nécessaire en ce domaine, mais l’épaisseur du code du travail dépend par définition de ce que l’on y introduit. Par « code du travail », on entend, au reste, le texte édité par Dalloz, Litec ou le groupe Revue fiduciaire, le plus riche en commentaires, en l’absence desquels les dispositions législatives tiendraient en cent pages.
Celles-ci comprennent les règles applicables, non seulement au contrat de travail, mais aussi à la formation professionnelle, à la sécurité au travail – précises, certes, mais comment pourraient-elles ne pas l’être ? – et à des professions telles que les journalistes ou les concierges. Bref, le code du travail est un assemblage de règles différentes quant à leur nature ; elles sont parfois complexes – sur les procédures de licenciement économique, par exemple –, mais il serait abusif de dire que, prises dans leur ensemble, elles sont devenues ingérables.
L’article 2 revient sur une avancée sociale : à supposer que l’on y soit favorable, comment pourrait-on en décider sans respecter le protocole Accoyer ? Outre le retour aux 39 heures, l’article prévoit des dérogations aux accords de branche via des accords d’entreprise : cette inversion de la hiérarchie des normes peut exister à travers les accords dérogatoires, mais de là à la généraliser pour la durée du travail, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Je ne retrouve pas dans votre rapport, monsieur Cherpion, les points de vue exprimés par les partenaires sociaux lors des auditions ; les représentants des employeurs eux-mêmes ont tenu des propos fort différents de ceux que l’on entend souvent dans les médias : ils réclament davantage de souplesse, sans doute, mais pas un retour aux 39 heures. Cela poserait même un vrai problème, de l’avis d’une représentante d’une organisation patronale, compte tenu de la charge de travail actuelle.
Quant au bénéfice pour les finances publiques, les employeurs n’entendent pas renoncer aux allégements obtenus en contrepartie des 35 heures : cela suppose un vrai débat avec l’ensemble des acteurs – et ce n’est pas ce que vous proposez.
Mme Bérengère Poletti. J’ai vécu l’arrivée des 35 heures à l’hôpital et j’ai constaté que les conditions de travail se sont considérablement dégradées : on a rogné sur les temps de transmission entre les équipes, sur les repas et sur les pauses. Cela a provoqué un grand malaise chez les salariés, sans parler des difficultés budgétaires, les comptes épargne-temps (CET) représentant une véritable bombe à retardement.
Contrairement à ce que vous prétendez, monsieur Robiliard, les hôpitaux, par la voix de la Fédération hospitalière de France (FHF) – qui est plutôt de votre bord politique –, réclament bel et bien un retour aux 39 heures. Au demeurant, de nombreux chefs d’entreprise, et même des salariés, se montrent tout aussi critiques vis-à-vis des 35 heures. On salue la productivité des salariés français, mais, avec les 35 heures, elle est obtenue au prix d’une dégradation des conditions de travail et d’une contribution accrue en termes de temps humain.
M. Gérard Sebaoun. Frédéric Valletoux, président de la FHF, est aussi le maire UMP de Fontainebleau, madame Poletti ; la FHF, me semble-t-il, n’est de toute façon pas une instance politique. Les difficultés de l’hôpital ne sont pas seulement liées aux 35 heures.
Souhaitez-vous faire des 39 heures le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires, monsieur le rapporteur ? Cela correspond sans doute au souhait de M. Gattaz, mais pas des responsables d’entreprise que nous avons entendus en commission d’enquête sur la réduction du temps de travail, à commencer par Jean-François Pilliard, dès lors qu’un tel retour remettrait en cause les exonérations de cotisations sociales liées aux 35 heures.
M. le rapporteur. La première solution consiste à laisser les entreprises décider du temps de travail, en supprimant donc toute référence à une durée légale ; la seconde, que j’ai choisie, est de relever le niveau de cette durée à 39 heures. Les 35 heures posent en effet de vrais problèmes dans le secteur hospitalier, madame Poletti ; d’autre part, si des accords fixent une durée moindre, il faut bien placer un curseur pour déclencher les heures supplémentaires.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 2 est supprimé.
Article 3
Augmentation de la durée de travail dans la fonction publique
Au moment de l’adoption des lois « Aubry », le temps de travail dans la fonction publique n’était pas soumis à réglementation. Seul un texte à caractère interministériel fixait la durée hebdomadaire à trente-neuf heures. La définition des astreintes et les dispositions liées aux cycles de travail ne faisaient l’objet d’aucun cadrage juridique.
Aujourd’hui, l’organisation du temps de travail dans la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière relève du domaine réglementaire, puisque la durée du temps est fixée :
– pour la fonction publique d’État, par le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature (29). Ce texte fixe le principe de la durée annuelle de 1 600 heures maximum, définit les différents cycles et types d’organisation du travail, les horaires variables, les astreintes, les horaires d’équivalence, et pose l’obligation de procéder à un contrôle automatisé par badge du temps de travail accompli. Enfin, il définit le régime spécifique de forfait applicable aux cadres ;
– pour la fonction publique territoriale, par le décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale (30). Certaines collectivités, ont engagé, dès 1998, des négociations et ont conclu des accords de réduction du temps de travail, prévoyant parfois des seuils inférieurs aux 1 600 heures annuelles, des cycles de trente-deux heures et la création concomitante d’emplois. La loi du 3 janvier 2001 dispose que les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont fixées par délibération de la collectivité dans les limites applicables aux agents de l’État ;
– et pour la fonction publique hospitalière, par le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (31).
Indéniablement certains secteurs de la fonction publique, notamment le secteur hospitalier, ont pâti de l’application des trente-cinq heures. La réduction du temps de travail non compensée par des embauches suffisantes a entraîné des dysfonctionnements importants dans l’organisation des services, générateurs de tensions sociales et de craintes vis-à-vis de la qualité de la prise en charge des patients. Des difficultés à organiser les plannings selon les nouveaux impératifs horaires sont apparues du fait des contraintes liées aux cycles de travail spécifiques des établissements de santé et à la coordination des équipes.
L’étude réalisée récemment par la Fédération des hôpitaux de France, en vue de l’audition de son président, M. Frédéric Valletoux, par la commission d’enquête sur les trente-cinq heures (32), met en évidence les difficultés suscitées par la mise en place des trente-cinq heures dans les hôpitaux.
Selon cette étude, la réforme a été une grande source d’inégalités, se traduisant, selon les hôpitaux et les accords signés, par une compensation de la réduction du temps de travail allant de moins de 10 jours par an à près de 30 jours. Par ailleurs, sur les 37 000 créations de postes non médicaux prévus pour compenser la réduction du temps de travail, les hôpitaux n’ont été autorisés à en créer que 32 000 et les 5 000 créations de poste de médecins n’ont pas vu le jour. Cette situation a abouti à une dégradation des conditions de travail, à la multiplication d’organisations dérogatoires basées sur douze heures consécutives de travail et au développement de l’intérim. Parallèlement, les hôpitaux sont confrontés au développement très important des comptes épargne temps de leurs agents et au surcoût du travail de nuit, le temps légal du travail de nuit à l’hôpital ayant été plafonné en 2004 à 32 h 30 par semaine du fait de sa pénibilité. Ce surcoût est estimé à 69 millions d’euros par la Fédération hospitalière de France.
C’est pourquoi le I du présent article propose de fixer la durée du travail à trente-neuf heures dans la fonction d’État (alinéa 2), dans la fonction publique territoriale (alinéa 3) et dans la fonction publique hospitalière (alinéa 3).
Le II du présent article précise que les modalités d’augmentation de quatre heures par semaine de la durée de travail des agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière seront déterminées par un décret en Conseil d’État.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS8 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Par cohérence, nous ne pouvons que proposer la suppression de l’article 3, qu’il faudrait s’empresser de voter si l’on souhaitait désorganiser l’hôpital et ouvrir une boîte de Pandore. Nous avons entendu, au sein de la commission d’enquête sur la réduction du temps de travail, les représentants de la fonction publique, y compris hospitalière. Les 35 heures, je le reconnais, ont posé d’importants problèmes dans les hôpitaux, qui les ont néanmoins « digérées » – même si elles demeurent indigestes pour ceux qui les désignent encore comme des boucs émissaires.
M. Gérard Sebaoun. Mme Poletti et M. Robiliard ont raison : le passage aux 35 heures n’a pas été simple pour les hôpitaux. Ceux-ci, toutefois, ont évolué depuis quinze ans, et pas seulement en raison des 35 heures. Le problème, pour les hôpitaux, est plutôt, désormais, l’accumulation des RTT.
Des responsables auditionnés par la commission d’enquête ont effectivement indiqué que les 35 heures avaient permis une réorganisation réelle de la fonction publique d’État et le retour à certaines normes.
Mme Véronique Louwagie. On parle de la digestion des 35 heures par les hôpitaux : ce n’est sans doute pas vrai du point de vue de l’organisation, mais moins encore sur le plan financier, le problème ayant été différé avec l’instauration des CET, qui, on l’a rappelé, sont une véritable bombe à retardement.
M. le rapporteur. Les CET n’ont fait que différer, en effet, le problème du financement des 35 heures : si digestion il y a eu, elle a laissé des séquelles dont il est devenu impossible d’évaluer l’impact financier. Il est vrai, monsieur Sebaoun, que l’hôpital s’est réorganisé ; mais certains problèmes, comme celui des RTT, s’apparentent à des épées de Damoclès. Au moins nos débats ont-ils le mérite de le rappeler.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est supprimé.
Article 4
(art. L. 3122-2 du code du travail)
Annualisation
La loi du 20 août 2008 précitée (33) a simplifié, de manière significative, la réglementation en matière de temps de travail en créant un nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail.
Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité – et éviter les heures supplémentaires en période de haute activité ou le chômage partiel en période de basse activité – l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année. Une convention ou un accord collectif doit cependant l’y autoriser et en prévoir les modalités.
Ainsi, l’article L. 3122-2 du code du travail prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
– les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
– les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
– lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’article L. 3122-2 précité précise qu’à défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
Afin de simplifier la procédure de signature des accords d’aménagement du temps de travail et faciliter la négociation au sein des entreprises, le présent article modifie l’article L. 3122-2 afin de prévoir que ces accords sont conclus selon la procédure des accords d’intéressement, détaillée à l’article L. 3312-5 du code du travail.
Les accords d’aménagement du temps de travail pourraient donc être conclus selon l’une des modalités suivantes :
– par une convention ou un accord collectif de travail ;
– par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
– par un accord conclu au sein du comité d’entreprise ;
– à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification serait demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Cette modification permet d’aménager le temps de travail dans l’entreprise sans qu’un accord d’établissement ou un accord collectif soit un préalable indispensable. Le temps de travail pourra ainsi être annualisé afin de s’adapter plus facilement aux aléas économiques et aux fluctuations des carnets de commandes des entreprises.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS9 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Cet article tend à appliquer aux accords relatifs au temps de travail les modalités dérogatoires applicables aux accords d’intéressement, lesquels n’offrent pas les mêmes garanties, pour les salariés, quant à la qualité des négociateurs. L’exercice de la négociation, même à l’échelle d’un établissement, suppose une culture syndicale que l’accord d’intéressement rend moins nécessaire.
M. le rapporteur. Il s’agit d’insérer, après le mot : « établissement », les mots : « conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 ». Nous ne parlons donc que de la procédure, qui, dans les accords d’intéressement, est plus souple et plus légère.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 4 est supprimé.
Article 5
(Art. L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 et L. 3123-25 du code du travail
et art. 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014)
Abrogation de la durée minimale de travail de 24 heures
dans le cadre du recours au temps partiel
Le présent article propose d’abroger les dispositions mises en place dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui ont instauré une durée minimale de travail à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DÉFINITION D’UN SOCLE MINIMAL DE 24 HEURES DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAR LA LOI DE SÉCURISATION DE L’EMPLOI
L’encadrement de la durée du travail à temps partiel a été opéré par l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui a introduit dans le code du travail les nouveaux articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 et L. 3123-25.
L’article L. 3123-14-1 a posé le principe d’un socle minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires de travail pour un salarié à temps partiel. Cette durée minimale est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour les contrats de travail nouvellement conclus à compter de cette date. Pour les contrats en cours à cette date, cette durée minimale ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2016 - sauf si un accord de branche sur l’organisation du temps partiel est conclu dans l’intervalle - si le salarié en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Les articles L. 3123-14-2 à L. 3123-14-4 aménagent les deux possibilités de déroger à ce socle minimal de vingt-quatre heures.
L’article L. 3123-14-2 prévoit qu’une durée inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié, pour deux raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles (garde d’enfants par exemple), soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou une durée au moins égale à vingt-quatre heures. Cette possibilité correspond à la levée de la contrainte du socle minimal pour le temps partiel choisi.
L’article L. 3123-14-3 prévoit qu’une durée hebdomadaire de travail inférieure à vingt-quatre heures peut être fixée par accord de branche étendu dès lors qu’il comporte des garanties d’horaires réguliers ou qui permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins une durée de travail égale à vingt-quatre heures.
En tout état de cause, que la dérogation au socle minimal de vingt-quatre heures soit issue d’une demande du salarié ou d’un accord de branche, cette dérogation ne peut être prévue que si les horaires de travail du salarié sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes : un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement d’heures.
Enfin, l’article L. 3123-14-5 prévoit qu’une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires peut être fixée de droit à tout salarié de moins de vingt-six ans qui poursuit des études.
Par ailleurs, la loi relative à la sécurisation de l’emploi a également modifié le régime des heures complémentaires prévu aux articles L. 3123-17 à L. 3123-19 et créé un dispositif de complément d’heures par avenant au contrat de travail.
Alors que les heures complémentaires dans la limite du 1/10ème de la durée prévue au contrat ne faisaient jusqu’alors l’objet d’aucune majoration de salaire, les nouvelles dispositions prévoient une majoration de ces heures complémentaires dès la première heure à hauteur de 10 % de la rémunération. S’agissant des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée du contrat qui peuvent être prévues par accord collectif, celles-ci faisaient jusqu’alors l’objet d’une majoration de 25 %. Désormais, le texte prévoit qu’il est possible de déroger à cette règle de majoration par accord de branche pour prévoir un taux inférieur, mais qui ne peut en tout état de cause pas être inférieur à 10 %.
La loi a également instauré un mécanisme de complément d’heures, dont le principe doit être prévu par accord de branche étendu : c’est l’objet de l’article L. 3123-25 nouvellement introduit par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Il s’agit de permettre d’augmenter temporairement la durée du travail prévue au contrat par un avenant précisant la durée pendant laquelle est appliquée la nouvelle durée de travail et le nombre d’heures concernées, ainsi que le cas échéant la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ce complément d’heures ne donne pas obligatoirement lieu à aucune majoration salariale (c’est l’accord de branche qui doit déterminer s’il y aura ou non majoration dans ce cas) ; néanmoins, toute heure complémentaire effectuée au-delà de ce complément d’heures doit obligatoirement donner lieu à une majoration salariale de 25 %. L’accord de branche qui aménage la possibilité de mettre en œuvre des compléments d’heures doit également déterminer le nombre maximum d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, sans toutefois qu’une limite temporelle ne soit fixée à ces avenants.
Enfin, l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a imposé aux branches dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel d’engager une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dans la branche : cette négociation devait être ouverte dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, autrement dit, avant le 14 septembre 2013. Elle doit porter notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
B. LES REPORTS SUCCESSIFS DE L’ÉCHÉANCE
L’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a suspendu temporairement l’application de certaines des nouvelles dispositions sur le temps partiel, en particulier celle de la durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires prévue à l’article L. 3123-14-1 ainsi que le dispositif transitoire applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2014, et cela afin de donner plus de temps à la négociation de branche sur l’organisation du temps partiel, ces négociations n’ayant pas pu être menées à leur terme à l’échéance initialement prévue.
En effet, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, sur les 31 branches qui comprennent au moins un tiers de leur effectif à temps partiel, 16 accords de branche ont pour l’heure fait l’objet d’un arrêté d’extension.
La suspension jusqu’au 30 juin 2014 de ces dispositions prend effet à compter du 22 janvier 2014. Cela signifie que les contrats de travail à temps partiel conclus au cours de la période de suspension, soit entre le 22 janvier et le 30 juin 2014, devraient comporter donc une durée de travail sans minimum légal, mais respecter, le cas échéant, une durée minimale conventionnelle. En revanche, les contrats de travail à temps partiel conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 ainsi qu’à partir du 1er juillet 2014, devraient respecter la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires, sauf si une exception légale trouvait à s’appliquer, telle qu’une dérogation encadrée par un accord de branche étendu.
Ce report conduit à une forte insécurité juridique pour l’ensemble des secteurs d’activité dans lesquels un accord de branche n’aurait pas été conclu avant le 1er janvier 2014 : les entreprises de cette branche devraient ainsi faire respecter le socle minimal de vingt-quatre heures pour les contrats conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014, puis ne seraient plus tenues de l’appliquer pour les contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin. Une telle situation est ubuesque, non seulement pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les salariés !
Afin vraisemblablement de tenir compte des délais nécessaires aux branches pour conduire leur négociation sur l’organisation du temps partiel, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 juillet dernier, prévoit, dans son article 2 quater, d’autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure législative destinée à simplifier et sécuriser les modalités de conditions d’application des dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel, ainsi que des modalités d’entrée en vigueur des dispositions d’encadrement du temps partiel, en particulier celles relatives au socle minimal de durée du travail de vingt-quatre heures.
Outre que nul ne sait précisément à ce stade quelle sera la teneur des aménagements qui sont susceptibles d’être pris dans ce cadre, le calendrier risque une nouvelle fois de s’avérer problématique : en effet, le texte relatif à la simplification de la vie des entreprises n’entrera a priori en vigueur qu’à la fin de l’année. Si un délai supplémentaire devrait raisonnablement être prévu pour laisser aux branches le soin de conclure leurs négociations sur l’organisation du travail à temps partiel, celui n’interviendra qu’au terme d’une période à laquelle légalement les entreprises sont d’ores et déjà censées se conformer aux nouvelles règles en vigueur.
D’après les informations transmises à votre rapporteur, l’ordonnance qui a vocation à être prise sur le fondement de l’habilitation prévue dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie des entreprises doit en particulier traiter de la question du « dédit », autrement dit, du cas du salarié qui souhaite revenir sur sa demande individuelle de déroger au socle minimal de 24 heures de travail à temps partiel. Il est en effet indispensable de sécuriser cette option du salarié, a fortiori en vue de l’échéance du 1er janvier 2016, date à laquelle les dispositions relatives au socle minimal de 24 heures doivent s’appliquer à l’ensemble des contrats, en cours ou nouvellement conclus.
II. L’ABROGATION DE LA DURÉE MINIMALE DE 24 HEURES DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Le I du présent article propose d’abroger l’essentiel des dispositions prises par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 pour encadrer le temps de travail à temps partiel, soit les articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 du code du travail, relatifs à la durée minimale de vingt-quatre heures et aux deux types de dérogations à ce socle minimal pour l’organisation du travail à temps partiel, celle à l’initiative du salarié et celle prévue par accord de branche étendu.
Il est en revanche proposé de conserver le mécanisme de majoration des heures complémentaires de 10 % dès la première heure, puis, au-delà du 1/10ème de la durée prévue au contrat, entre 10 et 25 % en fonction de ce que prévoira un éventuel accord de branche étendu, ainsi que le dispositif des compléments d’heures instauré par la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Le II modifie simplement les modalités selon lesquelles les compléments d’heures par avenant au contrat de travail pourront être instaurés : alors que l’article L. 3123-25 prévoit pour l’heure qu’une telle augmentation temporaire de la durée du travail prévue au contrat doit être aménagée par une convention ou un accord de branche étendu, il est proposé que ces modalités soient en priorité prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et seulement, le cas échéant, par convention ou accord de branche, sans que ce dernier n’ait d’ailleurs à faire l’objet d’une extension par arrêté ministériel.
En conséquence de l’abrogation du socle minimal de vingt-quatre heures hebdomadaires de travail à temps partiel, le III du présent article abroge le III de l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a organisé le report transitoire de l’application de cette durée minimale, qui devient en effet obsolète.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS10 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Derrière la procédure, il y a les interlocuteurs, monsieur le rapporteur.
L’article 5 touche presque à un problème moral. Des négociateurs, parmi lesquels la totalité des représentants de l’interprofession patronale, ont conclu, le 11 janvier 2013, un accord national interprofessionnel que le législateur a ensuite transposé dans la loi ; un an plus tard, vous entendez le remettre en cause. Si l’on voulait dénigrer la négociation sociale, on ne s’y prendrait pas autrement. Quelle confiance les partenaires sociaux pourraient-ils avoir si l’on remet sur la table un accord dont l’encre est à peine sèche ?
Depuis 1804, l’article 1134 du code civil dispose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Or la bonne foi suppose aussi de laisser le temps de l’épreuve. Certes, s’agissant de la règle des 24 heures, l’échéance a été reportée au 30 juin, et je ne méconnais pas les difficultés qu’elle soulève dans certaines branches professionnelles – l’exemple des porteurs de journaux l’illustre –, mais ses négociateurs les ont anticipées, précisément en prévoyant de possibles dérogations via des accords de branche et des conventions collectives. Bref, cet article témoigne d’une défiance inacceptable envers la négociation collective.
M. Christophe Cavard. Je souscris aux propos de M. Robiliard. Il est étonnant, monsieur le rapporteur, de vous voir détricoter un accord auquel vous avez souvent fait référence, nonobstant les questions qu’il soulève dans certains secteurs, qui d’ailleurs s’en étaient ouverts lors de la discussion du projet de loi de transposition de l’ANI.
Notre groupe a déjà exprimé ses inquiétudes sur le report de six mois d’un droit acquis, la règle des 24 heures ayant été retenue après la publication de plusieurs rapports faisant état de temps partiels subis, notamment – Christophe Sirugue l’a rappelé – par des femmes à qui l’on impose des horaires hachés. L’ensemble des partenaires sociaux, écartant tout dogmatisme, se sont accordés sur l’institution d’une règle qui répondait au problème, quitte à prévoir des dérogations dans certains secteurs. On évoque les porteurs de journaux et quelques autres cas problématiques, mais la liste des métiers qui trouveraient avantage à l’application de cette règle est assurément bien plus longue. Peut-être n’avez-vous pas écrit ce texte tout seul, monsieur le rapporteur, mais, je le répète, il m’étonne sous votre plume.
M. le rapporteur. La morale joue dans les deux sens, monsieur Robiliard : posséder un emploi, même à temps partiel, c’est déjà mettre le pied à l’étrier. Bien entendu, on pourra toujours citer des exemples de salariés exploités. Parce que leurs horaires sont hachés, les professionnels de l’aide à domicile en milieu rural bénéficient d’une dérogation, contrairement, par exemple, aux chauffeurs de cars scolaires : cela ne pose-t-il pas aussi un problème moral ? Pour trouver des solutions à court terme, les entreprises jouent sur le travail temporaire : ne vaudrait-il pas mieux qu’elles offrent de vrais temps de travail aux salariés ? Il y a des abus, j’en conviens, mais ils ne justifient pas que nous légiférions de façon globale.
Quant à l’ANI, certains des partenaires sociaux que j’ai auditionnés, du côté des salariés comme du patronat, ont souligné qu’il pose des problèmes.
M. Christophe Cavard. Ils ont signé cet accord !
M. le rapporteur. Je ne dis pas le contraire.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 5 est supprimé.
Section 3
Dispositions relatives au bulletin de paie
Article 6
(Art. L. 3243-2 du code du travail)
Simplification du bulletin de paie
Le présent article propose de limiter à quatre le nombre de lignes figurant sur les bulletins de paie.
En effet, la complexité des bulletins de paie des salariés français est régulièrement dénoncée, sans que les autorités soient parvenues, à ce jour, à y remédier. Dans son rapport de juillet 2011 sur « La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi », M. Jean-Luc Warsmann note que nombre d’acteurs économiques « ont souligné le particularisme français d’avoir un bulletin de paie exceptionnellement long, complexe et qui s’allonge au fil des ans. Les comparaisons avec nos partenaires européens ou même avec la situation qui prévalait en France il y a 20 ou 30 ans sont éloquentes et imposent une action résolue. Les professionnels qui accompagnent les entreprises et les conseillent, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats relèvent avec inquiétude cette complexité. Le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, conscient des risques d’erreur d’un nombre très élevé de lignes et des multiples calculs et interprétations qui y sont associés, recommande une réforme du bulletin de paie depuis plusieurs années. »
Le constat est ancien, mais les différentes mesures adoptées afin de simplifier le bulletin de paie ne se sont pas encore concrétisées.
• Le décret n° 2005-239 du 14 mars 2005 portant simplification de diverses dispositions dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et modifiant le code du travail
Le décret du 14 mars 2005, pris en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, elle-même prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, a pour objectif une simplification de l’élaboration et de la présentation du bulletin de paie.
Le contenu de ce décret a été codifié aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail. L’article R. 3243-2 dispose que le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
Malgré la circulaire du 30 juin 2005 relative à la simplification du bulletin de paie, qui décrit les modalités de présentation des différents prélèvements qui figurent sur le bulletin de paie et propose en annexe des exemples de modèles de présentation, la possibilité de simplification ouverte par le décret de 2005 a été très peu utilisée.
• La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives
L’échec de la tentative de simplification lancée en 2005 tient au fait qu’il ne suffit pas d’agréger les mentions actuelles afin de parvenir à une simplification du bulletin de paie. Il est nécessaire, au préalable, d’uniformiser la définition des assiettes de référence des cotisations sociales. C’est pourquoi la loi du 22 mars 2012 a prévu une simplification du bulletin de paie en deux étapes :
– La réduction du nombre de rubriques du bulletin de paie, à travers une harmonisation des assiettes des cotisations d’assurances sociales obligatoires et des éléments servant au calcul des droits à prestations de sécurité sociale en espèces, au plus tard le 1er janvier 2013 ;
– La mise en œuvre des mesures nécessaires par les instances chargées des régimes d’assurance chômage et des régimes de protection sociale complémentaires pour harmoniser les assiettes, au plus tard le 1er janvier 2015.
• Le Conseil de la simplification pour les entreprises
Le Conseil de la simplification pour les entreprises, créé par le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014, a fait de la simplification du bulletin de paie l’une de ses priorités. Parmi les cinquante premières mesures de simplification présentées, la mesure n° 48 consiste à « simplifier la fiche de paie ». Pour cela, un chantier portant sur l’architecture des prélèvements sociaux a été lancé. Un bilan d’avancement doit être réalisé tous les six mois.
Votre rapporteur est tout à fait favorable à cette mesure, à laquelle l’article 6 de la présente proposition de loi entend donner une base législative.
Les alinéas 1 et 2 précisent que l’article L. 3243-2 du code du travail sera complété, pour préciser que le bulletin de paie comportera quatre lignes :
– une ligne pour les cotisations patronales ;
– une ligne pour les cotisations salariales ;
– une ligne pour les cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
– une ligne pour les cotisations d’assurance vieillesse.
L’alinéa 3 prévoit, afin de permettre au salarié d’être pleinement informé de l’ensemble des cotisations déduites, qu’il pourra, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.
L’alinéa 4 renvoie les modalités d’application de ces nouvelles dispositions à un décret en Conseil d’État.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS11 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Outre qu’elles sont de nature réglementaire, les dispositions de l’article sont satisfaites.
M. le rapporteur. Elles ne sont ni réglementaires ni satisfaites : la longueur des feuilles de paie l’atteste.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 6 est supprimé.
Section 4
Négociation sur la représentation des salariés
des petites entreprises sur un plan territorial
Article 7
Représentativité des salariés
On dénombre en France entre 25 000 et 30 000 comités d’entreprise où siègent plus de 100 000 élus, autant de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, près de 300 000 délégués du personnel et un peu plus de 40 000 délégués syndicaux.
Le présent article a pour objectif de simplifier l’architecture des institutions représentatives du personnel en ouvrant une négociation liée à la représentativité territoriale des salariés dans les entreprises de moins de 100 salariés.
I. DES SEUILS MULTIPLES ET DES PROCÉDURES LOURDES POUR LES ENTREPRISES
A. LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL : LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
La mise en place de ces institutions représentatives du personnel dépend des effectifs de l’entreprise :
● les entreprises employant au moins 11 salariés sont tenues d’organiser l’élection de délégués du personnel. Ces délégués, élus par un collège unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles jusqu’au seuil de 25 salariés, disposent d’un crédit de 10 heures par mois afin d’accomplir leur mission. Ils doivent être réunis par le chef d’entreprise au moins une fois par mois. Le délégué du personnel peut être désigné, par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, comme délégué syndical, ou, par une organisation syndicale non représentative, comme représentant de la section syndicale ;
● les entreprises employant au moins 50 salariés doivent mettre en place, en plus des délégués du personnel :
– un comité d’entreprise, dont les membres bénéficient d’un crédit de vingt heures par mois, qui doit être réuni une fois tous les deux mois ;
– un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui se réunit obligatoirement une fois par trimestre. Le crédit d’heures de ses membres est fonction de l’effectif de l’entreprise (34). Le délégué du personnel se voit, par ailleurs, attribuer un crédit de quinze heures par mois.
Les entreprises de moins de 200 salariés peuvent décider de mettre en place une délégation unique du personnel dont les membres exercent tout à la fois les attributions de délégué du personnel et celles de membres du comité d’entreprise. La délégation unique du personnel est réunie mensuellement, et le crédit attribué à ses membres est de vingt heures.
Comme le détaille le tableau suivant, les seuils de 100, 500 et 1 000 salariés impliquent de nouvelles obligations pour les entreprises :
Mise en place des institutions représentatives du personnel
Seuils de l’effectif |
Mise en place |
Cadre géographique |
À partir de 11 salariés |
Élection des délégués du personnel (DP) |
Établissement |
À partir de 50 salariés |
– Élection du comité d’entreprise ou comités d’établissement ; – Désignation possible de délégués syndicaux (DS) par chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ; – Désignation possible d’un représentant syndical auprès du CE ; |
Entreprise ou établissements distincts (50 salariés et plus) |
À partir de 100 salariés |
Désignation d’un délégué syndical central |
Entreprise |
À partir de 500 salariés |
Désignation d’un DS supplémentaire « encadrement » |
Entreprise |
À partir de 1.000 salariés |
Élection d’un comité d’entreprise européen (CEE) |
Entreprise ou groupe d’entreprises |
Baisse de l’effectif | ||
Délégués du personnel |
Les mandats des DP se poursuivent jusqu’à leur terme. À leur expiration, lorsque les effectifs sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois, il n’y a pas de nouvelles élections. L’obligation de déclencher de nouvelles élections n’interviendra que lorsque l’effectif atteindra au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours de 3 années à partir de la fin du dernier mandat. |
|
Comité d’entreprise |
Suppression possible en cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous du seuil de 50 salariés. Il faut un accord préalable entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales, à défaut, le directeur départemental du travail et de l’emploi peut autoriser la suppression du CE. |
|
B. UN POSSIBLE IMPACT DES SEUILS SUR LA TAILLE DES ENTREPRISES EN FRANCE
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (35) a accordé davantage de temps aux entreprises qui franchissent les seuils de 11 et 50 salariés pour s’acquitter de leurs nouvelles obligations en matière d’institutions représentatives du personnel :
– elles peuvent désormais organiser respectivement les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage informant les salariés de ces élections, au lieu de quarante-cinq jours auparavant ;
– par ailleurs, l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement du seuil de 50 salariés pour se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise.
Cependant ces obligations restent lourdes et complexes pour les entreprises et ne sont, sans doute, pas sans effet sur la création d’emplois et la taille des entreprises en France.
En effet, une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalisée en 2011 à partir de données de 2005 et 2006 (36) sur l’impact des seuils sur la taille des entreprises françaises, a conclu qu’il n’y avait pas d’effet de seuil notable si l’on prenait en compte les données provenant de l’Union de recouvrement des cotisations pour la Sécurité sociale et les allocations familiales (Urssaf).
Cependant, en prenant en compte les données fiscales remplies par les entreprises elles-mêmes, des effets de seuil sont plus visibles, les données montrant « une accumulation d’entreprises ayant des effectifs situés juste en dessous des seuils ». Ainsi, selon ces données de 2006, il y a un peu plus de 1 600 entreprises comptant 49 salariés, contre 600 entreprises de 50 salariés, soit 2,5 fois plus. De plus, ces entreprises de 49 salariés ont un niveau de croissance de la masse salariale inférieur aux autres.
RÉPARTITION DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR TAILLE AUTOUR DES SEUILS,
SELON LES DONNÉES FISCALES (ANNÉE 2006)
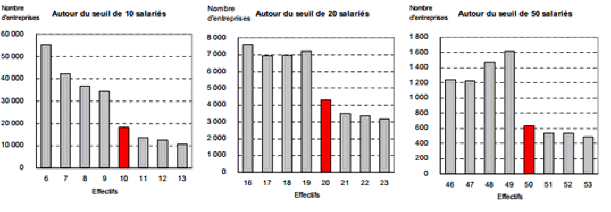
Selon l’INSEE, ce sont 22 500 entreprises qui changeraient de taille si les seuils actuels n’existaient pas, ce qui représente 40 000 emplois supplémentaires.
II. UNE NÉCESSAIRE RÉFORME DES SEUILS SOCIAUX ET DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Des réflexions sont actuellement en cours sur la réforme des seuils sociaux et des institutions représentatives du personnel. Ainsi, en mai dernier, le ministre du travail, M. François Rebsamen, a proposé de suspendre ces seuils pendant trois ans, afin d’évaluer l’existence d’un éventuel effet sur l’emploi.
La Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (IFRAP), propose quant à elle, de relever les seuils de 50 % et de ne rendre obligatoire la mise en place d’un comité d’entreprise qu’à partir de 75 salariés.
Dans une étude sur ce thème (37), La Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) constate que : « le franchissement de ce seuil [50 salariés] déclenche trente-cinq obligations administratives supplémentaires et aboutit à majorer le prix de l’heure travaillée de plus de 4 % » et souhaite que les trois instances représentatives du personnel (délégués, comités d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) soit fusionnées dans les entreprises de 50 à 299 salariés.
C’est pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit d’harmoniser ces seuils et de fusionner les institutions représentatives du personnel. Il propose aussi que le seuil pour la mise en place d’institutions représentatives du personnel soit de 100 salariés.
Le présent article propose donc d’ouvrir une négociation relative à la représentativité territoriale des salariés dans les entreprises de moins de 100 salariés. Ce sujet sera donc traité par un accord national interprofessionnel et un accord national multiprofessionnel qui proposeront au Parlement la réforme à adopter. Pour encadrer la négociation le présent article précise que ces salariés devront être représentés, et informés, « au niveau territorial ».
Cette réforme présente l’avantage de simplifier les formalités pour les entreprises jusqu’à 100 salariés, et de représenter les salariés dans les entreprises de moins de 10 salariés qui, actuellement, ne sont pas représentés.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS12 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Une injonction de conclure un accord me semble inconstitutionnelle.
M. le rapporteur. Pour toute négociation sont fixées une feuille de route et une date butoir, et le Gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, apporte sa touche, comme ce fut le cas avec l’ANI pour l’échéance du 11 janvier. Il ne s’agit donc pas d’une injonction, mais du respect du fonctionnement démocratique.
Mme Bérengère Poletti. S’il ne devait rester qu’un seul article de ce texte, ce serait bien celui-là, car il créerait de nombreux emplois : beaucoup d’entreprises bloquent l’accès à l’embauche en raison d’effets de seuil. Le Premier ministre l’a lui-même reconnu, et le problème devient urgent. D’ailleurs, si la rédaction de l’article ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours l’amender.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 7 est supprimé.
Section 5
Mesures en faveur de la sécurité juridique et de l’emploi
Article 8
Expérimentation d’une procédure de rescrit social
Le présent article propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure de rescrit social en matière de droit du travail.
I. LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DU RESCRIT
Dans une étude récente réalisée à la demande du Premier ministre (38), le Conseil d’État recommande de développer des instruments juridiques tels que le rescrit qu’il définit comme « une prise de position formelle de l’administration, qui lui est opposable, sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure » (1)
En effet, dans cette étude, le Conseil d’État constate le sentiment d’insécurité juridique que ressentent de nombreux citoyens face à la complexité de la législation (1) : « qu’il s’agisse d’agrandir son exploitation agricole, de construire un bâtiment, de créer une société de service ou de rénover un site industriel, le porteur de projet est aujourd’hui confronté à des difficultés importantes pour identifier l’ensemble des normes qui lui sont applicables, comprendre quelles en sont les implications sur sa situation personnelle, prévoir les évolutions possibles des règles, évaluer la faisabilité de son projet. […] La complexité et l’instabilité de la norme ralentissent la mise en œuvre des projets et nuisent à l’attractivité économique de la France. Elles ont un coût économique diffus qui se traduit par les mille détours qu’elles font emprunter à l’entreprise : étude de la législation, recherche de conseil et d’expertise, procédures administratives et contentieuses, erreurs et régularisations ».
Parmi ses quinze propositions, le Conseil d’État préconise une extension du mécanisme du rescrit à d’autres secteurs de l’activité administrative notamment dans le domaine du droit du travail.
Conformément à ces préconisations, l’article 3 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (39), actuellement en discussion au sein du Parlement, prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant le développement des rescrits et des pré-décisions.
Comme le montre le rapport de notre collègue Sophie Errante sur le projet de loi (40), l’extension envisagée du rescrit dans le cadre du projet de loi pourrait concerner en matière de droit du travail, conformément aux préconisations du Conseil d’État :
– la législation visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus précisément au regard des obligations sanctionnées pécuniairement par l’article L. 2242-5-1 du code du travail (obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle femmes/hommes – article L. 2242-5 du même code –, obligation de définition d’un plan d’action dans le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise – article L. 2323-57 du même code) ;
– la législation relative à la prévention de la pénibilité, et plus précisément au regard des obligations sanctionnées pécuniairement par l’article L. 138-29 du code de la sécurité sociale (obligation pour certaines entreprises d’être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité) ;
– la législation relative à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, et plus précisément des obligations sanctionnées financièrement par l’article L. 5212-12 du code du travail (obligation d’employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des personnes assimilées à hauteur de 6 % de l’effectif total des salariés).
Comme l’explique le Conseil d’État, « une procédure de rescrit pourrait permettre d’effectuer un contrôle préventif et de garantir une absence de sanction par le préfet au regard de la situation contrôlée. L’employeur bénéficierait sinon d’un délai de mise en conformité » (41).
II. EXPÉRIMENTER LA MISE EN PLACE D’UN RESCRIT EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL
Le présent article propose d’aller au-delà du projet de loi actuellement en cours de discussion et d’expérimenter, pendant une période de deux ans, la mise en place d’un rescrit social, qui permettra à un employeur d’interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail (alinéa 1).
Pour faire le bilan de cette expérimentation, il est prévu que le ministre chargé du travail transmette au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation dans les six mois précédant son terme (alinéa 7).
Le dispositif juridique et la procédure retenus sont celles du rescrit social mis en place par l’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants (42).
Le rescrit social
L’ordonnance du 6 juin 2005 a introduit à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale un mécanisme de rescrit permettant à tout cotisant ou futur cotisant, en sa qualité d’employeur d’obtenir, dans un délai déterminé, de son organisme de recouvrement, une prise de position explicite sur sa situation au regard de l’application d’une réglementation, qu’il pourra opposer ultérieurement à cet organisme.
La réglementation en question peut être celle des exonérations de cotisations de sécurité sociale, ou celle des rémunérations versées par les tiers ou encore celle des obligations déclaratives et du paiement des cotisations.
En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, l’organisme de recouvrement ne peut pas effectuer, au titre de la période de retard qui lui incombe, de redressement de cotisations et de contributions sociales fondé sur la législation au regard de laquelle la situation de fait exposée dans la demande a été tardivement appréciée.
Une procédure de publicité au Bulletin officiel et sur le site Internet www.securite-sociale.fr des décisions rendues par les URSSAF et anonymisées a été mise en place par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.
Dans le cadre de ce rescrit, un inspecteur du travail ou une Dirrecte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) doit se prononcer sur toute demande d’une personne « ayant pour objet de connaître l’application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative notifiant une sanction à l’encontre du demandeur, ou susceptible d’avoir pour conséquence directe la notification d’une sanction à l’encontre du demandeur » (alinéa 2).
La décision explicite de l’administration doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Celui-ci serait probablement de trois mois, comme c’est le cas pour le rescrit social (alinéa 4). Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue de ce délai, l’administration n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être notifié une sanction administrative, fondée sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande (alinéa 5).
Ce décret pourra prévoir également les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite (alinéa 4).
La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées (alinéa 6).
En revanche, la demande ne peut pas être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé (alinéa 3).
*
* *
La Commission examine l’amendement AS13 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. L’article est satisfait par le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, adopté, monsieur le rapporteur, le jour même du dépôt de votre texte.
M. le rapporteur. Je conviens de cette avancée, mais elle ne correspond pas exactement à ce que je propose ici.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 8 est supprimé.
Article 9
(art. L. 5151-1 à L. 5151-5 [nouveaux] du code du travail)
Accords de développement de l’emploi
Dans la continuité des accords de maintien de l’emploi mis en place par l’article 17 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, le présent article propose d’autoriser la conclusion d’accords de développement de l’emploi, à vocation plus offensive.
Les accords de maintien de l’emploi ont en effet pour objectif d’offrir à des entreprises qui rencontrent de graves difficultés économiques conjoncturelles de négocier un accord d’entreprise destiné à aménager temporairement la durée du travail et, le cas échéant, la rémunération des salariés, en contrepartie d’un engagement de la part de l’employeur de maintenir des emplois. Il s’agit donc d’offrir une souplesse supplémentaire pour passer un « cap difficile ».
Si l’on ne peut que se réjouir d’une telle possibilité, il semble en revanche qu’il faille aller beaucoup plus loin, en offrant aux entreprises la possibilité de procéder à tels aménagements en dehors de tout contexte déterminé de difficultés économiques : toute entreprise pourrait ainsi négocier un accord d’aménagement du temps de travail et/ou des salaires, en contrepartie d’un engagement de créer des emplois, dans une version donc résolument plus offensive, qui répond véritablement aux enjeux de la restauration de la compétitivité des entreprises françaises.
I. LES ACCORDS DE MAINTIEN DE L’EMPLOI MIS EN PLACE PAR LA LOI RELATIVE À LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI
Issus de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de sa traduction législative dans le cadre de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, les accords de maintien de l’emploi, codifiés aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7 du code du travail, ont un objectif essentiellement « défensif » : ils doivent permettre aux entreprises, dans un contexte économique difficile, de conclure des accords d’aménagement de la durée du travail, de ses modalités d’organisation et de répartition, ainsi que de la rémunération des salariés, pendant une période déterminée, en contrepartie de l’engagement de l’employeur de maintenir les emplois pendant toute la durée de validité de l’accord.
Rappelons tout d’abord que l’engagement d’une démarche de négociation d’un accord d’entreprise de maintien de l’emploi est subordonné à l’existence de « graves difficultés économiques conjoncturelles » pour l’entreprise, difficultés qui font l’objet d’un diagnostic partagé avec les syndicats présents dans l’entreprise.
L’article L. 5125-4 explicite les conditions de validité d’un tel accord d’entreprise. Celui-ci a, a priori, vocation à être signé par les syndicats majoritaires dans l’entreprise, soit celles qui ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Il s’agit là d’une condition de majorité renforcée : en effet, dans le droit commun, les accords d’entreprise doivent répondre au double principe de la signature par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans le cadre de ces mêmes élections, ainsi que de l’absence d’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants (article L. 2232-12 du code du travail).
En l’absence de délégué syndical, il peut être signé par un ou des représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par un ou des syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel ; en l’absence de représentants élus du personnel, enfin, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par des syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel, mais la validité de l’accord est conditionnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
L’article L. 5125-1 définit le cadre de l’accord de maintien de l’emploi.
Tout d’abord, l’aménagement des conditions de travail – de la durée du travail, des horaires ou de la rémunération – suppose, en contrepartie de la part de l’employeur, un engagement à maintenir les emplois faisant l’objet de l’aménagement pendant toute la durée de validité de l’accord, qui ne peut en tout état de cause excéder deux ans.
L’accord d’entreprise peut procéder aux aménagements prévus sous réserve de ne pas déroger aux éléments de l’ordre public social tels que le salaire minimum, la durée légale du travail, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés légaux, ainsi que la législation relative au 1er mai.
Les aménagements prévus par l’accord ne peuvent avoir pour effet de diminuer la rémunération horaire ou mensuelle des salariés lorsque celle-ci est inférieure ou égale au SMIC horaire majoré de 20 % ou lorsqu’elle est supérieure, de la ramener en deçà de ce niveau.
L’accord doit également prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés.
Il doit préciser les conditions du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, ainsi que les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, soit à l’issue de la période d’application de l’accord, soit dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord. En effet, l’article L. 5125-5 aménage une procédure de suspension de l’accord à la demande de l’un de ses signataires, par référé du tribunal de grande instance, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. L’accord est alors suspendu pendant un délai, fixé par le juge, à l’issue duquel il autorise la poursuite de l’accord ou le résilie, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis.
L’article L. 5125-2 prévoit que l’accord de maintien de l’emploi comporte une clause pénale, qui s’applique en l’espèce à l’employeur qui ne respecterait pas ses engagements, notamment en matière de maintien des emplois : dans cette hypothèse, les salariés lésés bénéficieront de dommages et intérêts, dont le montant et les modalités d’exécution doivent avoir été fixés par l’accord.
Les termes de l’accord de maintien de l’emploi s’imposent au contrat de travail : autrement dit, les dispositions du contrat de travail qui sont contraires à l’accord se trouvent suspendues pendant la durée d’application de ce dernier. Néanmoins, dans la mesure où il s’agit là d’une modification du contrat de travail et non d’un simple changement des conditions de travail du salarié, l’application de l’accord au contrat de travail individuel nécessite l’accord du salarié. Le refus du salarié de se voir appliquer les stipulations de l’accord occasionne un licenciement individuel pour motif économique, qui ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord.
II. LES ACCORDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ONT UNE VOCATION RÉSOLUMENT PLUS OFFENSIVE
À l’image des accords de maintien de l’emploi, à vocation exclusivement défensive – puisqu’il s’agit de préserver les emplois en place dans un contexte économique difficile -, le présent article ouvre aux entreprises la possibilité de conclure des accords de développement de l’emploi, dont l’objectif est résolument offensif. Il complète la cinquième partie du livre 1er du code du travail par un titre V, intitulé : « Développement de l’emploi », qui introduit les nouveaux articles L. 5151-1 à L. 5151-5.
D’après les informations fournies à votre rapporteur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 2013, six accords de maintien de l’emploi auraient été conclus, ce qui s’explique par le caractère relativement contraignant des conditions qui leur sont applicables. En l’occurrence, l’entreprise doit être confrontée à de « graves difficultés économiques conjoncturelles », ce qui signifie qu’une entreprise dont les difficultés économiques sont structurelles n’entre pas rigoureusement dans ce cadre : on pense au cas de l’industrie automobile. Toutefois, la mise en place des accords de maintien de l’emploi a clairement un effet bénéfique : elle pousse les entreprises, par la voie du dialogue social, à anticiper davantage les restructurations et à négocier en prévention d’un plan de sauvegarde de l’emploi. C’est cette vertu du recours à la négociation d’entreprise qui conduit à élargir le dispositif et à l’inscrire sur une voie plus offensive, celle de la création d’emplois.
En effet, contrairement aux accords de maintien de l’emploi, le dispositif prévu par le présent article consiste pour l’entreprise à s’engager à développer les emplois : c’est pour cette raison que la conclusion d’un accord collectif n’est pas, dans ce cas, subordonnée à une situation économique difficile. Afin de réellement favoriser la compétitivité des entreprises, il est en effet souhaitable de promouvoir une approche négociée permettant, par le dialogue social, d’apporter des aménagements transitoires à l’organisation du temps de travail, à la durée du travail et, le cas échéant, au niveau des salaires.
Si le dispositif s’inscrit dans la lignée de celui qui a été mis en place pour la négociation des accords de maintien de l’emploi, il s’en éloigne toutefois sur trois aspects majeurs :
● Celui, tout d’abord, du contexte économique. Alors que les accords de maintien de l’emploi ne peuvent être négociés que dans des entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles dont le diagnostic est en outre partagé par les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, les accords de développement de l’emploi peuvent être négociés quelle que soit, par ailleurs, la situation propre de l’entreprise. Il s’agit bien de faire du dialogue social d’entreprise un outil au service de la création d’emplois, par le biais de la mise en œuvre d’aménagements négociés de la durée du travail et de la rémunération des salariés, grâce donc à l’introduction temporaire d’une plus grande flexibilité et d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
● Celui, ensuite, des dispositions relevant de l’ordre public social auxquelles l’accord d’entreprise ne peut déroger (I du nouvel article L. 5151-1). Alors que les accords de maintien de l’emploi sont soumis au respect des dispositions relatives à la durée légale du travail, et donc du régime applicable aux heures supplémentaires, cette condition n’est pas exigée des accords de développement de l’emploi, qui doivent pouvoir y déroger de manière transitoire afin de redonner de la compétitivité aux entreprises.
● Celui, enfin, des conséquences de l’accord sur le contrat de travail individuel en cas de refus du salarié de se voir appliquer les stipulations de l’accord (III de l’article L. 5151-1). Contrairement à l’accord de maintien de l’emploi qui conduit au licenciement individuel pour motif économique du salarié qui en refuse l’application, l’accord de développement de l’emploi occasionne un licenciement sui generis, « lié aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service », mais soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel. Dans la mesure où les accords de développement de l’emploi ne sont pas limités à un contexte économique difficile pour une entreprise, il est logique que le licenciement consécutif au refus du salarié de se voir appliquer les aménagements de la durée du travail et/ou de rémunération prévus par l’accord ne relève pas du critère économique, mais repose bien sûr un motif d’ordre personnel, à savoir le refus par le salarié de se voir appliquer les conditions nouvelles et transitoires prévues par l’accord.
La durée – au maximum de deux ans – de l’accord (article L. 5151-1), ses conditions de validité – la signature par des organisations syndicales représentatives à plus de 50 %, ou le cas échéant, par des représentants du personnel mandatés ou des salariés mandatés – (article L. 5151-4), ainsi que la clause suspensive de l’accord par référé du tribunal de grande instance (article L. 5151-5), sont en revanche en tous points identiques aux critères qui s’appliquent aux accords de maintien de l’emploi.
Enfin, le dispositif juridique des accords de développement de l’emploi ne retient pas certaines conditions et dispositions applicables aux accords de maintien de l’emploi, en particulier :
– la possibilité de mandater un expert-comptable pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse de la situation de l’entreprise et pour la conduite de la négociation. Le rôle de l’expert-comptable a en effet moins de sens dans le cas d’accords qui ont vocation à être négociés hors contexte économique spécifique pur l’entreprise ;
– l’encadrement de la diminution de rémunération des salariés, qui ne peut, rappelons-le, être ramenée à un niveau inférieur au SMIC majoré de 20 %, et l’interdiction de la diminution des rémunérations inférieures à ce seuil ;
– l’engagement des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés de l’entreprise ;
– la fixation par l’accord des modalités d’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, ainsi que des modalités d’information des salariés quant à l’application de l’accord et à son suivi pendant toute sa durée. Dès lors que l’accord ne s’inscrit pas dans un contexte de difficultés économiques, un tel suivi n’a en effet pas lieu d’être instauré ;
– l’interdiction pour l’entreprise de procéder à un quelconque licenciement économique des salariés concernés pendant toute la durée de l’accord. Ici encore, dans la mesure où l’entreprise qui négocie un accord de développement de l’emploi ne le fait pas pour répondre à une situation économique difficile, il n’y a pas lieu d’interdire le recours au licenciement économique dans ce cadre ;
– les conséquences devant être prévues par l’accord d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur les salariés, que ce soit à l’issue de la période d’application de l’accord ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord par décision judiciaire. Il n’y a en effet pas lieu d’évaluer l’évolution de la situation économique de l’entreprise dans ce cadre ;
– la clause pénale qui a vocation à s’appliquer en cas de non-respect par l’employeur des engagements pris dans le cadre de l’accord, et qui donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés. En effet, la clause pénale a essentiellement pour but de se prémunir contre le non-respect par l’employeur de son engagement visant à maintenir les emplois. Dès lors qu’il s’agit ici d’un engagement à développer les emplois, il s’avérerait complexe d’estimer à partir de quel seuil il faudrait considérer que l’employeur a rempli ses engagements de création d’emplois ;
– et enfin, la disposition selon laquelle en cas de licenciement consécutif à une décision judiciaire de suspension de l’accord, le calcul des diverses indemnités dont peut bénéficier l’ancien salarié se fait sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord, si celle-ci est supérieure à la rémunération au moment de la rupture du contrat.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS14 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Cet article, qui s’inspire d’une disposition dite « défensive » de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, vise à ouvrir la possibilité d’accords de développement de l’emploi en contrepartie d’une réorganisation du temps de travail et des modalités de rémunération. Une autre disposition porte sur les conséquences d’un refus, par le salarié, de la modification de son contrat de travail sur la base de cet accord.
D’une part, les deux points relèvent clairement de la négociation collective ; de l’autre, même si votre texte reprend les termes de l’un des articles de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), le fait de présumer la légalité du licenciement empêcherait le contrôle juridictionnel, ce qui contrevient à l’article 8 de cette même convention.
M. le rapporteur. Nous ne sommes pas d’accord sur l’interprétation de la convention 158 de l’OIT. Le présent article est en effet le miroir du volet défensif de la loi sur la sécurisation de l’emploi, à cette différence près que le licenciement interviendrait pour motif personnel et non économique.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 9 est supprimé.
Article 10
(art. L. 2242-23 du code du travail)
Motif de licenciement en cas de refus du salarié
de se voir appliquer un accord de mobilité interne
Le présent article modifie le motif de licenciement consécutif au refus d’un salarié de se voir appliquer les stipulations d’un accord d’entreprise sur la mobilité professionnelle ou géographique interne. Alors que la loi prévoit aujourd’hui que dans cette hypothèse, le salarié fait l’objet d’un licenciement individuel pour motif économique, le présent article propose de prévoir que le licenciement repose dans ce cas sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et qu’il est soumis aux règles du licenciement pour motif personnel.
I. LES ACCORDS DE MOBILITÉ INTERNE MIS EN PLACE PAR LA LOI DE SÉCURISATION DE L’EMPLOI DU 14 JUIN 2013
L’article 15 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a ouvert la possibilité pour les entreprises d’engager une négociation sur l’organisation de la mobilité interne professionnelle ou géographique, transposant ainsi l’article 15 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, sans pour autant reprendre stricto sensu le souhait exprimé par les partenaires sociaux, s’agissant notamment du motif de licenciement d’un salarié refusant de se voir appliquer un tel accord.
Alors que l’ANI du 11 janvier 2013 prévoyait d’ailleurs une obligation triennale de négociation des accords de mobilité interne pour l’ensemble des entreprises en pratique dotées d’un délégué syndical, la loi n’a finalement retenu, dans le cadre des articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, qu’une simple faculté de négocier en la matière : si cette négociation s’inscrit toujours dans la section du code consacrée à la négociation triennale d’entreprise, ce rythme n’est de facto plus obligatoire, la négociation étant elle-même facultative. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, cette négociation a vocation à s’articuler avec la négociation triennale relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), qui s’impose par ailleurs à cette catégorie d’entreprises. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette négociation porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
La mobilité interne qui est l’objet de la négociation est de deux ordres : il peut s’agir d’une mobilité professionnelle, mais également d’une mobilité géographique. En tout état de cause, il s’agit d’une négociation « à froid », puisqu’elle doit s’inscrire, aux termes de l’article L. 2242-21, dans le cadre de « mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs ».
L’article L. 2242-22 précise que la négociation sur la mobilité interne doit porter notamment sur :
– les limites imposées à la mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
– les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
– et enfin, les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique.
Enfin, l’accord ne peut conduire à une diminution de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié ; il doit au contraire garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle, ce qui s’entend autant d’une mobilité professionnelle que d’une mobilité géographique ou des deux.
L’objectif de la mise en place d’un accord de mobilité interne consiste à permettre, par une voie négociée, de définir de manière consensuelle les périmètres respectifs de la zone géographique d’emploi du salarié et de la « zone de mobilité » de celui-ci, la définition de cette seconde zone n’étant plus dès lors considérée comme une modification substantielle du contrat de travail, nécessitant l’accord exprès du salarié. En effet, la jurisprudence estimait jusqu’alors que le licenciement d’un salarié refusant une mobilité hors du périmètre de sa zone géographique d’emploi était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La mise en place d’un accord de mobilité doit permettre d’introduire une plus grande souplesse dans l’organisation de la mobilité interne des salariés au sein d’une entreprise. Ainsi, l’article L. 2242-23 précise que l’accord de mobilité interne est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés et que les stipulations de l’accord sont applicables au contrat de travail individuel : autrement dit, les clauses du contrat contraires à l’accord sont suspendues.
Avant la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures individuelles de mobilité, l’employeur doit toutefois préalablement engager une concertation avec le ou les salariés concernés, afin de prendre en compte leurs contraintes personnelles et familiales ; il doit également recueillir l’accord du salarié. En cas de refus du salarié de se voir appliquer une mesure individuelle de mobilité prévue dans le cadre de l’accord, son licenciement s’analyse comme un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit par ailleurs prévoir l’accord de mobilité.
II. LA MODIFICATION DU MOTIF DE LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ REFUSANT L’APPLICATION D’UN ACCORD DE MOBILITÉ INTERNE
A. LA PROBLÉMATIQUE DU MOTIF DE LICENCIEMENT POUR REFUS DE MOBILITÉ
Le motif de licenciement retenu à l’article L. 2242-23 – licenciement individuel pour motif économique – ne correspond pas à ce qui avait été retenu par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI du 13 janvier 2013 : en effet, d’après l’article 15 de l’accord national interprofessionnel, le refus d’un salarié de se voir appliquer les termes de l’accord entraîne son licenciement pour motif personnel et ouvre droit à des mesures de reclassement spécifiques.
Le choix qui a été fait dans le cadre de la loi relative à la sécurisation de l’emploi de retenir le licenciement individuel pour motif économique est, d’après les explications qui ont été avancées dans le cadre du débat parlementaire sur le projet de loi, lié au souci de conformité avec la directive n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
L’article 4 de la directive n° 158 précise en effet qu’un travailleur ne peut être licencié « sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ».
Dans le respect des conventions internationales, le droit français du travail en matière de licenciement repose sur trois concepts-clés : la cause réelle et sérieuse, qui renvoie au « motif valable » de licenciement au sens de la convention n° 158 de l’OIT ; et ensuite, les deux catégories de motifs de licenciement : le motif personnel, autrement dit le motif inhérent à la personne du salarié d’une part, et d’autre part, le motif non inhérent à la personne du salarié, mais lié à la situation de l’entreprise, autrement dit, le motif économique.
Dans le cadre d’un accord de mobilité, il a été considéré que le licenciement consécutif au refus d’un salarié de se voir appliquer un tel accord relevait davantage des nécessités de fonctionnement de l’entreprise que d’un motif personnel, ce qui a conduit à opter pour la traduction juridique française de ce motif de licenciement, autrement dit le licenciement économique.
B. LE CHOIX D’UN MOTIF DE LICENCIEMENT SPÉCIFIQUE OPÉRÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose de revenir au souhait initial des partenaires sociaux tel qu’il s’est exprimé dans le cadre de l’ANI du 11 janvier 2013 : il modifie donc le dernier alinéa de l’article L. 2242-23 relatif aux conséquences du refus d’un salarié de se voir appliquer les stipulations d’un accord de mobilité interne.
Les partenaires sociaux avaient en effet souhaité que le refus d’un salarié de se voir appliquer un tel accord se traduise par un licenciement pour motif personnel, motif que le présent article propose donc de rétablir.
Afin de se prémunir contre la fragilité juridique d’un tel motif alors même qu’il est prononcé en conséquence d’un accord d’entreprise qui entend organiser de manière collective la mobilité interne des salariés, le présent article propose de préciser que le licenciement d’un salarié refusant l’application d’un accord de mobilité repose bien sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il s’agit là de reprendre mot pour mot le motif figurant à l’article 4 de la convention n° 158 de l’OIT. La procédure qui s’appliquera sera toutefois celle d’un licenciement pour motif personnel.
*
* *
La Commission se saisit de l’amendement AS15 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Vous entendez revenir sur l’analyse juridique que nous avions menée dans le cadre du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi. La question de l’application de la convention 158 de l’OIT sera de toute façon portée, un jour ou l’autre, devant la justice – si elle ne l’est déjà. Tout porte donc à croire que la Cour de cassation, voire le Bureau international du travail (BIT), aura à se prononcer sur le sujet. La situation juridique est complexe ; un choix a été fait, qui fut précédé d’une longue discussion au sein de notre assemblée, en commission comme dans l’hémicycle : il ne me paraît pas sain d’y revenir en l’absence d’éléments nouveaux.
M. le rapporteur. Vous invoquiez le respect de l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013, qui est ici bafoué puisqu’il prévoit, dans le cas dont nous parlons, un licenciement pour motif personnel.
M. Christophe Cavard. Nous ne sommes pas qu’une chambre d’enregistrement, disait un collègue du groupe UMP… Il se trouve que nous avions longuement débattu de la question ici visée, et nous étions d’ailleurs plusieurs à estimer que les allégements négociés au titre du PSE allaient trop loin. Le licenciement pour motif personnel, que vous entendez substituer au licenciement économique, isolerait le salarié face aux possibles dérives des PSE.
Un représentant du MEDEF, auditionné par la commission d’enquête sur la réduction du temps de travail, a évoqué le cas d’une entreprise frontalière ; depuis, il ne cesse d’y revenir dans les médias : est-il nécessaire de légiférer pour un cas unique ? Inutile de revenir sur un désaccord qui s’était clairement exprimé lors de la discussion du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.
M. le rapporteur. Ce que le législateur a fait, il peut le défaire : la majorité s’y emploie largement depuis deux ans.
Je n’écoute pas que le MEDEF, monsieur Cavard, mais l’ensemble des partenaires sociaux, en particulier les syndicats de salariés, qui déplorent que le licenciement pour refus de mobilité ne soit pas un licenciement pour motif personnel. Cela pose des problèmes au sein des entreprises, même si tel ou tel PSE peut effectivement prêter à discussion.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 10 est supprimé.
Article 11
(art. L. 1236-8 du code du travail)
Élargissement du champ d’application du contrat de chantier
Cet article propose d’élargir le champ d’application du contrat de chantier au-delà du secteur du bâtiment et travaux publics et, notamment, aux domaines de l’industrie et des services.
I. UN CONTRAT LIÉ À LA RÉALISATION D’UN CHANTIER
Le contrat de chantier est un contrat de travail par lequel un employeur engage un salarié en lui indiquant dès l’embauche que le contrat est exclusivement lié à la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude. Les contrats conclus pour la durée d’un chantier doivent être nécessairement à durée indéterminée.
Pour se prévaloir d’un tel contrat, l’employeur doit établir que :
– le salarié a connaissance de cette situation temporaire et qu’elle est précisée par une mention écrite ;
– la branche d’activité ne figure pas dans la liste, donnée par l’article D. 121-2 du code du travail, des activités pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
– le salarié doit être effectivement affecté au chantier invoqué dans le contrat.
À l’issue du chantier, l’employeur doit réaffecter le salarié sur un autre chantier. S’il ne peut le réaffecter pour un motif sérieux (sureffectif ou non-qualification), il est autorisé à le licencier sans qu’il s’agisse d’un licenciement économique.
En effet, aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail : « Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Afin que le contrat de chantier ne soit pas source de précarité, la jurisprudence de la Cour de cassation a veillé à un respect assez strict du régime propre à ce type de contrat, atypique lorsqu’il est conclu à durée indéterminée :
– pour être conforme, le contrat de chantier doit préciser non seulement le nom du chantier sur lequel le salarié est occupé mais aussi précisément les tâches pour lesquelles il a été engagé (43) ;
– le contrat doit clairement indiquer que l’embauche du salarié est limitée à l’exécution d’un chantier en particulier ou de plusieurs chantiers déterminés (44) ;
– l’achèvement du chantier mentionné contractuellement constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier (45), même si la durée estimée de ce chantier a été dépassée (46).
II. ÉLARGIR LE CHAMP DU CONTRAT DE CHANTIER
Certaines conventions collectives ont pu élargir le champ d’application du contrat de chantier : c’est le cas notamment de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseil et société de conseil (47) qui a consacré l’élargissement du contrat de chantiers aux missions d’ingénierie dans un avenant signé le 8 juillet 2013 (48), le préambule de cet avenant constatant : « que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie ».
Cet élargissement a été consacré par la Cour de Cassation dans une décision du 29 mai 2013 : « il n’est pas contesté que la sas ABMI, dont l’activité était le conseil et l’ingénierie pour l’industrie, et qui relève comme telle de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseil et société de conseil, puisse conclure de manière habituelle des contrats de chantier ».
Cependant il convient de donner une base législative au nécessaire élargissement des contrats de chantier au-delà du secteur des travaux publics. C’est pourquoi, le présent article propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 1236-8 du code du travail afin de préciser que le chantier peut être une « mission de travaux ou de prestation de services dont l’organisation a été à l’origine du recrutement du salarié ».
*
* *
La Commission examine l’amendement AS16 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. M. Cherpion propose d’étendre le dispositif des contrats de chantier à l’industrie et aux services. Certains auteurs estiment qu’il s’agit là d’une possibilité de droit, auquel cas cet amendement serait satisfait ; mais je n’ai pu le vérifier. Quoi qu’il en soit, ne complexifions pas le code du travail.
M. le rapporteur. L’article répond aux besoins d’autres types de chantiers, par exemple informatiques, dans le cadre d’études techniques de bureaux d’ingénieurs. Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a d’ailleurs consacré cet élargissement dans ce domaine précis.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 11 est supprimé.
Article 12
(art. 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008)
Pérennisation du CDD à objet défini
L’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui a transcrit l’article 12 b/ de l’ANI du 11 janvier 2008, a institué, à titre expérimental, un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD) qui se singularise principalement par la nature de son terme – la « réalisation d’un objet défini » –, sa durée plus longue et l’introduction, en conséquence, d’une faculté de rupture unilatérale anticipée.
Le présent article propose de pérenniser le dispositif mis en place de façon expérimentale en 2008.
I. LE CDD À OBJET DÉFINI : UNE NOUVELLE FORME DE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Le contrat à objet défini obéit aux règles applicables aux CDD, sous réserve des dérogations expressément prévues par l’article 6 de la loi 25 juin 2008 précitée.
• Les bénéficiaires
Le CDD à objet défini est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il doit être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d’entreprise.
• Les règles de forme
Le contrat à objet défini devra être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions – comme d’ailleurs l’ensemble des CDD – sous réserve d’adaptations telles que, notamment :
– la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
– l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue le contrat ;
– la description du projet à l’origine du contrat, sa durée prévisible, la définition des tâches correspondantes ;
– l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin au contrat ;
– le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en CDI ;
– la mention de la possibilité de rupture du contrat au bout de 24 mois, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux ;
– la mention du droit au versement au salarié d’une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à sa date anniversaire à l’initiative de l’employeur.
• La durée
La durée du CDD dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Il prend fin lorsque la mission est terminée. Cependant, il doit respecter une durée minimum de 18 mois, et une durée maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
• La fin du contrat
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance, fixé à deux mois minimum avant la date de fin du contrat, doit être respecté.
À l’issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. L’indemnité n’est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Le contrat peut être rompu avant son terme, par l’employeur ou le salarié, pour un « motif réel et sérieux ». La rupture anticipée est possible, soit 18 mois après le début du contrat, soit 24 mois.
L’indemnité de 10 % de la rémunération brute est due au salarié lorsque la rupture anticipée est à l’initiative de l’employeur.
II. UNE NÉCESSAIRE PÉRENNISATION
L’article 6 de la loi du 25 juin 2008 précitées a entouré la mise en place du CDD à objet défini de plusieurs garanties :
– le recours au CDD à objet défini est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise. Cet accord doit définir les « nécessités économiques » auxquelles le nouveau dispositif est susceptible d’apporter une réponse adaptée ainsi que les conditions d’accès des salariés concernés à des garanties en matière d’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la formation professionnelle, à une priorité de réembauchage et d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise, etc ;
– le CDD a objet défini est réservé aux cadres et aux ingénieurs ;
– enfin ce dispositif a été institué à titre expérimental. Initialement prévue pour une période de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, la durée de cette expérimentation a été portée à six ans par la loi du 22 juillet 2013 (49). À l’issue de cette période d’expérimentation, le Gouvernement devait présenter au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.
Ce bilan n’a pas encore été publié. D’après les informations transmises à votre Rapporteur, des négociations sont actuellement en cours sur ce sujet et concernent son éventuelle pérennisation.
Il apparaît néanmoins que cette nouvelle forme de contrat répond à de réels besoins, notamment dans le secteur de la recherche dans lequel il est beaucoup utilisé. Par ailleurs, on peut relever que dans plusieurs pays européens – l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne, notamment – existent déjà des CDD conclus pour la durée de la réalisation d’un objet, d’un ouvrage ou d’une prestation définis.
C’est pourquoi le présent article propose de pérenniser le CDD à objet défini, en supprimant les deux derniers alinéas de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008 précitée relatifs au caractère expérimental de ce dispositif et au bilan qui doit être produit à l’issue de l’expérimentation.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS17 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. L’article tend à proroger l’expérimentation du contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini. Une telle décision ne peut être prise que sur la base d’un rapport d’évaluation, et après consultation des partenaires sociaux : par nature, une expérimentation n’a pas vocation à se poursuive indéfiniment.
Contrairement à ce que vous pensez, la conclusion de ces contrats n’expose pas leurs signataires à une insécurité juridique, puisque le droit qui s’applique est celui qui a cours à la conclusion du contrat, conformément à une règle constante du droit transitoire.
M. le rapporteur. Le CDD à objet défini, qui ne concerne qu’un nombre restreint de personnes, répond aux besoins de certains secteurs, notamment celui de la recherche. Plusieurs pays voisins y ont recours : l’Allemagne, la Belgique ou l’Espagne. Que veut-on encourager ? Le développement de nos centres de recherche ou le départ de nos chercheurs à l’étranger ?
L’expérimentation n’a pas vocation à durer éternellement, et elle doit faire l’objet d’une évaluation, j’en suis d’accord ; mais il incombe également au législateur d’évaluer la loi, même s’il le fait trop peu.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 12 est supprimé.
Chapitre 2
Encadrement des indemnités liées à un plan de sauvegarde de l’emploi
Article 13
(art. 80 duodecies du code général des impôts)
Primes supra-légales
Un salarié, lorsqu’il est licencié pour motif économique et qu’il répond aux conditions établies par la loi, a droit au versement de l’indemnité légale de licenciement (50) ou de son équivalent conventionnel s’il existe. Cette indemnité se trouve parfois complétée par une prime dite « supralégale » d’un montant généralement très supérieur à ce qui est accordé par la loi ou le droit conventionnel et qui bénéficie d’un statut social et fiscal avantageux.
La judiciarisation importance des procédures collectives pour motif économique a déplacé le débat sur le terrain de la réparation des préjudices subis par les salariés concernés par les licenciements au détriment de la sécurisation de leurs parcours professionnels. En 2009, le montant des indemnités supra-légales de licenciement prévu dans les plans de sauvegarde de l’emploi s’est élevé en moyenne à 27 000 euros par salarié (51), et peut atteindre jusqu’à 70 000 euros, et parfois bien au-delà, souvent à la suite d’un conflit social se traduisant par des procédures judiciaires ou des menaces de procédures.
Cette prime engendre une inégalité considérable entre les salariés licenciés et produit des effets néfastes à moyen terme. Tout d’abord selon la taille de l’entreprise, le montant de la prime supralégale est plus ou moins élevé et lorsqu’un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire a été déclenché, aucune indemnité supralégale n’est versée aux salariés. Cette situation de fait peut créer un sentiment d’injustice entre les salariés d’un même bassin d’emploi.
Le recours aux indemnités supra-légales représente aussi un levier incitatif aux ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre d’un plan de départs volontaires. C’est alors l’équilibre du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui est remis en cause. En effet, les salariés les plus fragiles peuvent être sensibles au montant des indemnités offertes par l’entreprise, sans percevoir l’intérêt de bénéficier de mesures d’accompagnement leur permettant de se réinsérer sur le marché du travail. Cette sensibilité peut être accrue s’agissant de salariés dont l’âge de liquidation de la pension de retraite est proche.
Ensuite cette prime donne un sentiment d’aisance matérielle aux personnes licenciées qui peut constituer un risque pour leur avenir. Elle peut en effet mener à des cas de surendettement ou des situations de chômage de longue durée lorsqu’elle n’est pas investie ou épargnée dans l’optique du retour à l’emploi. Lors des auditions menées par votre Rapporteur à l’occasion du projet de loi de finances pour 2009 sur le thème du reclassement, il avait été constaté que, d’expérience, cette somme était rarement employée pour des actions de reclassement. Cette prime retarde même l’entrée du salarié dans le processus de retour à l’emploi puisqu’elle entraîne un délai de carence de la prise en charge par Pôle emploi de soixante-quinze jours. Elle ne semble donc pas généralement propice au reclassement des salariés.
Les conséquences négatives de la prime supralégale ont d’ailleurs été soulignées dans une instruction de la direction générale de générale de l’emploi, de la formation professionnelle du 30 juillet 2008 relative au rôle de l’État dans l’accompagnement des restructurations (52) : « Par ailleurs, si les revendications indemnitaires des salariés peuvent paraître compréhensibles, il n’appartient pas aux pouvoirs publics de les appuyer d’une quelconque manière, mais de veiller à ce que ces revendications n’aient pas pour conséquence une diminution de la qualité des mesures de reclassement. (…) En effet, les indemnités de licenciement, quand elles sont très élevées, peuvent se révéler un frein au reclassement des salariés licenciés et peuvent les conduire à des situations sociales difficiles (chômage de longue durée, situations de surendettement…). Elles retardent souvent l’inscription du salarié licencié dans une dynamique de retour à l’emploi ou de reconversion en lui donnant l’illusion d’une sécurité financière qui n’est que provisoire ».
Plus récemment, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle relatif à la prévention et accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi fait le même constat (53).
Les deux co-rapporteurs, M. Christophe Castaner et Mme Véronique Louwagie constatent d’ailleurs que si l’instauration dans la loi de sécurisation de l’emploi d’une procédure de validation ou d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) renforcera bien l’exigence en matière de qualité des mesures d’accompagnement et, par conséquent, permettra que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) puissent apprécier plus finement l’équilibre et l’intérêt des mesures d’accompagnement prévus dans le PSE, il semble peu probable qu’un DIRECCTE puisse s’opposer à un plan homologué par les partenaires sociaux, dont l’accord aura pu être obtenu en échange de la promesse d’une forte prime supra-légale, en arguant de l’insuffisance des mesures d’accompagnement prises.
Ils concluent : « À ce titre, l’État, garant de l’intérêt général doit plutôt veiller à l’accompagnement des salariés plutôt qu’à un enrichissement dont l’expérience montre qu’il est aussi rapide que temporaire et qu’il peut de surcroît allonger la période de transition professionnelle car il n’incite pas à la reprise immédiate d’un emploi. La mission recommande à cet égard de réfléchir à un mécanisme de plafonnement ou d’encadrement des primes supra-légales, à travers des outils fiscaux ou juridiques qui restent à préciser, à hauteur de l’équivalent de 30 SMIC nets par salarié, ce qui correspond à la moyenne des primes versés dans le cadre d’un PSE. Ceci permettrait d’éviter des primes individuelles excessives au regard des moyens mobilisés pour la reconversion professionnelle et pour le territoire. Une réforme en ce sens permettrait à l’administration de mieux vérifier si les mesures contenues dans un PSE sont bien tournées vers la réinsertion des salariés et leur accompagnement dans leur recherche d’emploi. »
Or, bien que, comme le constatent le rapport précité et l’instruction du 30 juillet 2008, les indemnités supra légales peuvent se révéler un frein au reclassement des salariés, celles-ci bénéficient d’un régime fiscal favorable.
En effet, en vertu de l’article 80 duodecies du code général des impôts :
– les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d’impôt sur le revenu ;
– les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi – c’est-à-dire versées dans tous les autres cas de licenciement (licenciement pour motif personnel ou licenciement pour motif économique ne donnant pas lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi) ne sont exonérées d’impôt sur le revenu que pour la fraction qui n’excède pas :
● soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale ;
● soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Le présent article propose donc de limiter l’avantage fiscal dont bénéficient les primes supralégales, qu’elles soient versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou non, et modifie l’article 80 duodecies du code général des impôts en ce sens :
– le I prévoit que l’exonération d’impôt sur le revenu ne concerne que la fraction des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui n’excède pas « deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;
– le II propose que la fraction de l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi exonérée d’impôt sur le revenu soit égale à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale (54).
*
* *
La Commission examine l’amendement AS18 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Les PSE doivent faire l’objet d’un accompagnement ; de ce point de vue, les primes supra-légales ne sont pas forcément la solution. Parce qu’elles indemnisent un préjudice, elles ne devraient d’ailleurs pas être soumises à cotisations et impôts, dans certaines limites bien entendu. D’un point de vue technique, une telle modification du code général des impôts relève du projet de loi de finances.
M. le rapporteur. Les sommes d’argent versées au titre des indemnités supra-légales ne sont pas à proprement parler constructives ; la CGT et la CFDT elles-mêmes reconnaissent qu’elles ne facilitent pas le reclassement. Une entreprise qui a décidé de verser 100 euros versera 100 euros quoi qu’il arrive ; si 40 euros sont réservés aux primes supra-légales, il ne restera que 60 euros pour l’accompagnement. Des syndicats m’ont d’ailleurs saisi d’un problème de cette nature ; force m’a été de leur répondre que l’on ne pouvait rien y faire ; si bien que les bénéficiaires de ces primes, d’un montant qui, sur le moment, peut paraître élevé, se retrouvent deux ans plus tard dans la précarité.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 13 est supprimé.
Chapitre 3
Politique envers les jeunes
Section 1
Dispositions relatives à l’apprentissage
Article 14
(art. L. 421-2 du code de l’éducation)
Composition des conseils d’administration des collèges et des lycées
Le présent article vise à garantir la présence de représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs dans les conseils d’administration des collèges et des lycées.
En effet, en vertu de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, les collèges et les lycées sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
– pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ;
– pour un tiers, des représentants élus des élèves et des parents d’élèves ;
– et pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
S’agissant des personnalités qualifiées, l’article L. 421-2 précité précise : « dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ».
La présence de représentants des partenaires sociaux dans les conseils d’administration des collèges et lycées n’est donc que facultative alors même que leur présence serait de nature à informer les conseils d’administration sur les réalités du marché économique local et d’éclairer les enseignants dans les choix d’orientation des élèves.
C’est pourquoi le présent article modifie l’article L. 421-2 du code de l’éducation afin que les personnalités qualifiées présentes dans les conseils d’administration des collèges et des lycées soient systématiquement des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs.
*
* *
La Commission se saisit de l’amendement AS19 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Évitons la rigidité dans les modalités de choix des représentants du monde économique au sein des conseils d’administration des collèges et des lycées. En ce domaine, l’introduction d’un paritarisme ne me paraît pas opportune.
M. le rapporteur. Ce paritarisme se résumerait en fait à un tripartisme, puisqu’il associerait les parents d’élèves, les enseignants et des personnalités qualifiées du monde économique. À l’heure où beaucoup de jeunes décrochent, des chefs d’entreprise du territoire pourraient apporter de précieux conseils d’orientation : cela permettrait de sensibiliser les enseignants et les parents d’élèves à l’intérêt des métiers de l’industrie. Dans ma circonscription, quarante postes restent en souffrance dans la métallurgie, faute de profils correspondants.
Mme Kheira Bouziane. Le conseil d’administration n’est sans doute pas le lieu approprié pour de tels conseils d’orientation. Les établissements et leurs enseignants me semblent à même d’organiser par eux-mêmes ce genre de rencontres avec les acteurs du monde économique.
Mme Valérie Lacroute. Le monde de l’éducation est régulièrement associé à des missions locales – j’ai ainsi personnellement mis en place, dans ma commune, un comité local du commerce. Aucune instance formelle n’existe au sein des collèges pour des rencontres avec les acteurs économiques : le conseil d’administration me paraît, de ce point de vue, un lieu intéressant.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 14 est supprimé.
Article 15
(articles L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9 et L. 6222-10 du code du travail)
Durée du contrat d’apprentissage
Afin de donner plus de souplesse aux employeurs et aux apprentis, le présent article propose de simplifier les règles régissant la durée du contrat d’apprentissage.
I. UNE DURÉE ENCADRÉE
La durée d’un contrat d’apprentissage est égale à la formation en apprentissage, soit généralement deux ans. Pourtant, le code du travail prévoit de nombreuses dérogations à cette durée. Bien que ce système puisse être flexible, il est extrêmement complexe.
En effet, l’article L. 6222-7-1 du code du travail prévoit que la durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat : elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés et elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11 du même code.
Le code du travail prévoit néanmoins des dérogations à la durée prévue par l’article L. 6222-7-1 :
● L’article L. 6222-8 dispose que la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent (55).
● l’article L. 6222-9 dispose que la durée du contrat d’apprentissage peut être réduite et varier entre six mois et un an lorsque la formation permet d’acquérir un diplôme ou titre :
– de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ;
– ou de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
– ou dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ;
– ou dont la préparation a été commencée sous un autre statut (article L. 6222-9 du code du travail).
● Enfin, l’article L. 6222-11 dispose qu’en cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.
II. UN ASSOUPLISSEMENT NÉCESSAIRE
Afin de donner plus de souplesse aux employeurs et aux apprentis, le présent article propose de supprimer les règles encadrant la durée du contrat d’apprentissage. En effet, un jeune qui a déjà une formation antérieure peut n’avoir, par exemple, besoin que d’une formation d’une année.
Le I du présent article propose donc que la durée du contrat d’apprentissage soit dorénavant négociée par l’apprenti, le centre de formations des apprentis (CFA) et l’entreprise accueillante. Dans le cas où la durée serait différente de 2 ans, le directeur du CFA informerait le recteur d’académie qui pourrait procéder à un contrôle a posteriori.
Par conséquent, par coordination, le II du présent article supprime les articles L. 6222-8, L. 6222-9 et L. 6222-10 du code du travail qui concernent les dérogations autorisées à la durée du contrat d’apprentissage.
*
* *
La Commission se saisit de l’amendement AS20 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. L’article L. 6222-7-1 du code du travail dispose que « la durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat ».
Il est donc d’ores et déjà possible de conclure des contrats d’apprentissage pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans. Auditionné par le rapporteur, le directeur général de l’Assemblée permanente des chambres des métiers de l’artisanat a confirmé la possibilité – et l’existence – de tels contrats. L’article est donc satisfait.
M. le rapporteur. Non, il ne l’est pas : il offre une possibilité d’apprentissage pratique à des jeunes qui possèdent déjà un socle de connaissances théoriques.
Mme Kheira Bouziane. La durée du contrat d’apprentissage peut être égale ou supérieure à deux ans.
M. le rapporteur. Oui, à condition qu’elle soit « égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification », ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, puisque les intéressés, je le répète, possèdent déjà le socle de connaissances.
Mme Véronique Louwagie. Cet article assouplirait les contrats d’apprentissage, dont 25 % sont rompus. Cette rupture, qui intervient souvent dans les deux premiers mois, laisse souvent les jeunes sur le carreau. L’article permettrait de les réorienter vers d’autres formations, pas forcément soumises aux cycles scolaires traditionnels. De tels dispositifs existent dans d’autres pays.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 15 est supprimé.
Article 16
(articles L. 6221-2 et L. 6233-1-1 du code du travail)
Gratuité de l’apprentissage
Le présent article propose d’affirmer clairement le principe de gratuité de l’apprentissage tant pour l’apprenti que pour l’employeur.
I. LA GRATUITÉ DE L’APPRENTISSAGE POUR LES APPRENTIS ET LES EMPLOYEURS
En déclarant que l’apprentissage concourt aux « objectifs éducatifs de la Nation » et qu’il est une forme « d’éducation alternée », les articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail soulignent le caractère éducatif de l’apprentissage qui entre dans le champ d’application du principe de la gratuité de la formation énoncé par le préambule de la Constitution de 1946 et fixé aux articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’éducation.
En effet, la formation de l’apprenti est gratuite à la fois pour l’apprenti et pour l’employeur, le coût de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA) étant pris en charge par la taxe d’apprentissage et par les régions.
Jusqu’à l’adoption de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (56), le code du travail ne contenait aucune disposition sur la possibilité pour un centre de formation des apprentis de facturer certains frais de gestion à un apprenti ou à un employeur d’apprenti. En effet, la seule disposition ayant trait à la gratuité était l’article L. 6224-4 du code du travail qui précisait que l’enregistrement du contrat par une chambre consulaire ne donnait lieu à aucun frais pour l’employeur ou l’apprenti.
Saisi d’un recours concernant la possibilité pour les CFA de demander une participation financière complémentaire aux apprentis, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne (57) et la cour d’Appel de Lyon (58) ont établi, respectivement en 2007 et 2008, une distinction entre :
– les frais liés à la formation qui sont les frais couvrant les frais de gestion administrative du centre de formation d’apprentis (CFA) et dont le règlement est obligatoire pour l’inscription de l’apprenti au CFA ;
– et les « services hors formation » qui sont les services ne se rapportant pas à la gestion administrative du CFA et dont le paiement facultatif ne détermine pas l’inscription de l’apprenti au centre (acquisition de produits et de matériel qui restent la propriété de l’apprenti, prestations de reprographie, accès à des bases de données documentaires, accès à une cantine, activités extra-éducatives) et pour lesquels une participation financière peut être demandée à l’apprenti.
Cependant ces décisions de justice n’ont pas totalement clarifié la question de la gratuité de la formation par la voie de l’apprentissage celle-ci donnant lieu à des positions différentes selon les directions ministérielles et les régions concernées.
L’article 14 de la loi du 5 mars 2014 précitée a posé le principe de gratuité de la formation pour les apprentis et les employeurs, y compris en ce qui concerne les frais « hors formation » :
– il a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 6221-2, qui énonce qu’aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage ;
– s’agissant plus spécifiquement des employeurs, la loi du 5 mars 2014 a inséré un nouvel article L. 6233-1-1 qui rappelle, s’agissant des ressources des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage que, sauf accord des régions, les organismes gestionnaires des CFA ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit.
II. UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION
Cette réforme n’a résolu que partiellement le problème de la gratuité de l’apprentissage pour les employeurs. En effet, lorsqu’une entreprise forme un apprenti, elle doit verser au CFA un « concours financier obligatoire » (CFO)
– imputé sur sa part « quota » de la taxe d’apprentissage –, dont le montant est fixé en référence au coût par apprenti figurant sur des listes préfectorales. Or, il arrive fréquemment que la part « quota » de l’entreprise ne suffise pas à couvrir la totalité du CFO, et certains centres de formation des apprentis
– essentiellement dans l’enseignement supérieur – conditionnent l’inscription de l’apprenti au versement d’une contribution complémentaire d’un montant non négligeable pour les entreprises.
Par conséquent, si l’enregistrement du contrat reste gratuit pour l’employeur, la conclusion ou la rupture de celui-ci pourra lui être facturée. Avec l’accord de la région, un CFA pourra solliciter auprès de lui une contribution financière supplémentaire, tout particulièrement pour des formations, comme dans l’enseignement supérieur, dont le coût est élevé.
Le présent article tend à garantir la gratuité de l’apprentissage tant pour l’apprenti que pour l’employeur :
– l’article L. 6233-1-1 du code de travail précise que l’inscription d’un apprenti ne peut être conditionnée au versement, par son employeur, d’une contribution financière. Le I du présent article propose donc d’élargir cette interdiction au bénéfice de l’apprenti ;
– l’article L. 6221-2 du code du travail, comme rappelé ci-dessus, dispose qu’aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement de ce contrat. Le II du présent article propose de modifier cet article afin de poser une interdiction beaucoup plus générale en disposant qu’aucune contrepartie financière « pour quelque prestation que ce soit ne peut être demandée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture ».
L’objectif de cet article, comme le rappelle l’exposé des motifs de la présente proposition de loi est de réaffirmer le principe de gratuité « au bénéfice de l’employeur, mais également de l’apprenti, afin que le développement de l’apprentissage ne soit pas freiné par des obstacles financiers tant en ce qui concerne la conclusion du contrat que son enregistrement. »
*
* *
La Commission examine l’amendement AS21 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale, l’Assemblée a adopté un article L. 6221-2, aux termes duquel « aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage ».
L’article 16 est donc lui aussi satisfait, à ceci près qu’un amendement n° 827 du rapporteur au projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale permet aux centres de formation des apprentis (CFA) de demander un financement complémentaire aux employeurs quand le coût de la formation est élevé, notamment dans l’enseignement supérieur. Pour ce faire, les organismes gestionnaires de CFA ou de sections d’apprentissage doivent obtenir un accord de la région.
M. le rapporteur. Je ne puis que souscrire à vos arguments. Cependant, saisis d’un recours sur la possibilité, pour un CFA, de demander une participation financière complémentaire aux apprentis, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et la cour d’appel de Lyon ont établi, respectivement en 2007 et 2008, une distinction entre les frais qui, liés à la formation, relèvent de la gestion administrative et les services hors formation. La situation n’est donc pas clarifiée.
Mme Kheira Bouziane. Ce sont à mon sens les collectivités territoriales, notamment les régions, qui sont compétentes en la matière.
M. Denys Robiliard. Je ne connais pas les jugements dont vous parlez, monsieur le rapporteur, mais, compte tenu des délais judiciaires, il me semble évident qu’elles se sont fondées sur des bases juridiques antérieures à la loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale. Votre article est donc satisfait par une évolution du droit que nous approuvons nous-mêmes.
M. le rapporteur. Je ne suis pas de cet avis : des responsables d’entreprise et même de CFA m’ont confirmé que le problème subsiste, même si la loi de mars 2014 a sans doute eu des effets bénéfiques.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 16 est supprimé.
Article 17
(article L. 332-3 du code de l’éducation)
Stage dans les collèges
Le présent article propose que les collèges organisent des sessions de découverte de l’apprentissage lors desquelles les collégiens auront la possibilité de visiter des centres de formation des apprentis, de découvrir les métiers et de rencontrer des acteurs du monde économique.
Il complète, par conséquent, l’article L. 332-3 du code de l’éducation relatif aux enseignements dispensés dans les collèges, en prévoyant l’organisation de ces stages de découverte.
L’objectif est de permettre aux élèves de mieux connaître ce mode de formation, encore trop souvent dévalorisé. Ces sessions de découverte amélioreront leur vision de l’apprentissage et leur ouvriront un panel plus large de formations et de qualifications.
Cet article complétera ainsi l’article 47 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (59) qui met en place un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, proposé aux élèves aux différentes étapes de leur scolarité du second degré « afin de leur permettre d’élaborer leur projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer leurs choix d’orientation ». Dans ce cadre, une visite d’un centre de formation des apprentis durant la scolarité en quatrième est prévue à compter du 1er janvier 2015. Le décret prévoyant cette visite obligatoire n’a cependant pas encore été publié.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS22 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. Une attention particulière est attendue en matière d’information et d’orientation pour assurer le succès du passage de la classe de troisième à la seconde.
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a remis la découverte des métiers et du monde du travail au cœur de l’enseignement au collège.
M. le rapporteur. Ces sessions de découverte permettront en effet d’ouvrir le choix des formations, mais la proposition de loi les complète par des parcours individuels. Vous avez supprimé les classes études-métiers à partir de la quatrième, alors qu’elles offraient une solution à des jeunes qui, pour des raisons personnelles ou sociales, avaient décroché. L’objectif est de faire naître dans leur esprit, peut-être, l’étincelle qui leur ouvrira une voie dans laquelle ils pourront s’épanouir.
Mme Kheira Bouziane. L’approfondissement de la découverte du monde économique est un objectif que nous pouvons partager, mais le collège, ne l’oublions pas, a d’abord vocation à transmettre des savoirs, et les enseignants ont déjà du mal à boucler le programme. La loi, je le répète, prévoit déjà des sessions de découverte des métiers.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 17 est supprimé.
Article 18
(articles L. 337-3-1, L. 337-3-2 du code de l’éducation
et articles L. 6222-20 et L. 6222-21 du code du travail)
Apprentissage à quatorze ans
Le présent article propose de remettre en place le dispositif de préapprentissage à partir de 14 ans, sous statut scolaire : il rétablit ainsi la formation d’apprenti junior pour les jeunes, à partir de 14 ans, qui souhaitent suivre une formation en alternance, sous statut scolaire.
I. UN DISPOSITIF TROP COMPLEXE
A. L’APPRENTISSAGE JUNIOR
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (60) a mis en place un dispositif de « formation d’apprenti junior », codifié à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. L’élève, sous statut scolaire, pouvait ainsi rentrer, dès l’âge de 14 ans, dans une première année d’« apprentissage junior initial », comportant un parcours d’initiation aux métiers. La formation comprenait des enseignements généraux, technologiques et pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. À l’âge de quinze ans, le jeune pouvait entrer dans la seconde phase d’« apprentissage junior confirmé » par la signature d’un contrat d’apprentissage à condition qu’il soit « jugé apte à poursuivre l’acquisition par la voie de l’apprentissage du socle commun ».
Le dispositif a été suspendu à partir de la rentrée 2007. L’apprentissage junior a, par conséquent, été réformé et a eu vocation à s’adresser en priorité aux élèves volontaires âgés de 15 ans. Trois types de dispositifs de préapprentissage pouvaient ainsi accueillir ces élèves :
– les classes préparatoires à l’apprentissage, créées par voie de circulaire en 1972 ;
– les parcours d’initiation aux métiers (PIM), constituant la première phase, effectuée sous statut scolaire, de la formation d’apprenti junior créée par l’article L. 337-3 du code de l’éducation. En 2010-2011, il restait dans ce dispositif seulement 43 élèves, dans deux académies (31 en Corse dans les centres de formation d’apprentis et 12 à Orléans-Tours en lycée professionnel). Depuis l’année 2011-2012, il n’accueillait plus d’élèves, étant remplacé par le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) ;
– le DIMA, formalisé par la circulaire de la rentrée scolaire 2008.
Si la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (61) a permis un accueil des élèves ayant atteint l’âge de 15 ans en centre de formation des apprentis pendant une durée maximale d’an pour découvrir des métiers en vue d’un projet d’apprentissage, c’est le décret n° 2010-1780 du 31 décembre 2010 qui a consacré le dispositif d’initiation aux métiers en alternance.
Il s’agit d’une formation en alternance, effectuée sous statut scolaire pour une durée d’un an maximum et partagée entre l’établissement de formation et des stages en milieu professionnel, pour faire découvrir aux élèves un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. Les élèves devaient être volontaires et âgés d’au moins 15 ans à la date d’entrée en formation du DIMA. Ils devaient rester inscrits dans leurs collèges d’origine (articles D. 337-172 à D. 337-182 du code de l’éducation).
La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (62) a étendu le dispositif aux élèves ayant accompli la scolarité du collège et modifié, à cet effet, l’article L. 337-3 du code de l’éducation. Sur ce fondement, pouvait accéder au DIMA tout jeune qui souhaitait entrer en apprentissage et :
– avait au moins 15 ans, en application de la loi du 24 novembre 2009 précitée ;
– ou avait terminé le collège et pouvait donc avoir moins de 14 ans révolus, en application de l’article 18 de la loi du 28 juillet 2011 précitée.
B. LE DISPOSITIF PEU SATISFAISANT DE LA LOI DU 8 JUILLET 2013
L’article 56 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation, de programmation pour la refondation de l’école de la République (63) a abrogé l’article L. 337-3 du code de l’éducation qui encadre la formation d’apprenti junior et supprimé le DIMA dans sa forme existante en ne retenant comme seul critère, que l’âge, fixé à 15 ans, pour effectuer une formation en alternance en CFA.
Cette modification a eu pour conséquence d’abroger les dispositions de la loi du 28 juillet 2011 ayant introduit le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes « ayant accompli la scolarité du premier cycle du secondaire » et pouvant avoir par conséquent moins de 15 ans.
Désormais, l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation dispose que : « Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant au moins atteint l’âge de 15 ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage, tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1. » Cette disposition a été confirmée par le décret n° 2013-769 du 26 août 2013 relatif à l’accès au dispositif d’initiation aux métiers en alternance.
De même, l’article L. 6222-1 du code du travail, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2013, dispose que les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Ainsi, seuls les jeunes ayant 15 ans effectifs et ayant achevé la scolarité du collège peuvent entrer en apprentissage alors que, précédemment, pouvaient y accéder les jeunes atteignant quinze ans au cours de l’année civile s’ils justifiaient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Se posait, par conséquent, le problème de la situation des élèves sortant de troisième et ayant 15 ans entre la rentrée et le 31 décembre et qui avaient un projet précis de formation professionnelle par l’apprentissage.
La circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013 du ministre de l’éducation nationale, a tenté de résoudre le problème en mettant en place un dispositif destiné aux jeunes :
– qui atteignent l’âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile ;
– qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ;
– qui bénéficient d’une promesse écrite d’embauche sous contrat d’apprentissage, d’une entreprise prête à les accueillir dès lors qu’ils auront 15 ans révolus ;
– et qui bénéficient de l’engagement d’un centre de formation d’apprentis (CFA) à les intégrer dans une formation préparant au diplôme visé.
Dans l’attente de la signature du contrat d’apprentissage, ces élèves sont inscrits selon les modalités ordinaires dans un lycée professionnel pour préparer un diplôme professionnel sous statut scolaire (CAP ou baccalauréat professionnel) de la spécialité souhaitée ou du même champ professionnel ou encore d’un champ connexe.
Un parcours personnalisé de formation est proposé à chaque élève, afin d’assurer la continuité éducative entre la rentrée scolaire et l’entrée en apprentissage. Ce parcours est assuré soit dans le lycée professionnel d’inscription, soit dans un CFA lorsque le lycée ne propose pas de formation dans la spécialité ou dans une spécialité connexe, sur la base d’un conventionnement entre l’établissement d’inscription de l’élève et le CFA.
La circulaire précitée indique que peuvent, par exemple, être envisagées durant cette période :
– une préparation à l’apprentissage (droits et obligations de l’apprenti, découverte de l’alternance, etc.) ;
– des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) rapprochées en début d’année scolaire, de préférence dans l’entreprise signataire de la promesse d’embauche (prise de connaissance de l’entreprise, du personnel, de son environnement, du poste de travail, etc.) ;
– une consolidation des acquis fondamentaux ;
– une initiation aux compétences et connaissances constitutives du diplôme visé.
À l’issue de la période d’accompagnement vers l’apprentissage, lorsque l’élève atteint l’âge de 15 ans, plusieurs situations peuvent se présenter :
– le contrat d’apprentissage est effectivement signé par l’élève, avec l’employeur prévu ou avec un autre employeur ;
– la signature du contrat d’apprentissage n’est pas réalisée. Dans ce cas, afin que l’élève puisse poursuivre sa formation :
* soit il continue la préparation du diplôme professionnel choisi, dans le lycée professionnel dans lequel il était inscrit ou dans un autre lycée professionnel ;
* soit, si la spécialité choisie n’existe pas en lycée professionnel, il peut être envisagé de lui permettre de poursuivre sa formation au CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle au titre de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, jusqu’au 30 juin au plus tard.
La loi du 5 mars 2014 précitée (64) a donné un socle législatif à la circulaire du 10 septembre 2013 en complétant l’article L. 6222-1 du code du travail par la mention suivante : « Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Ainsi, les jeunes ayant atteint quinze ans avant le terme d’une année civile et souhaitant s’orienter vers l’apprentissage pourront être inscrits sous statut scolaire en lycée professionnel ou en CFA pour débuter leur formation.
Enfin, le décret du 10 septembre 2014 (65) dispose que les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
– l’élève a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ;
– l’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
II. REMETTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE PRÉAPPRENTISSAGE SOUS STATUT SCOLAIRE
Afin de simplifier une réglementation excessivement complexe, le présent article propose donc de réintroduire le dispositif de « formation d’apprenti junior » créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et modifié par la loi du 28 juillet 2011 et permettant un accueil des élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans en centre de formation des apprentis pendant une durée maximale d’un an pour découvrir des métiers en vue d’un projet d’apprentissage.
● Le 1° du I du présent article, remet en place, au sein d’un nouvel article L. 337-3-2 du code de l’éducation, le dispositif de « formation d’apprenti junior ».
Ainsi, les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis – sur leur demande et celle de leurs représentants légaux – à suivre une « formation d’apprenti junior », visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage (alinéa 3).
L’élève bénéficie d’un projet pédagogique personnalisé – élaboré par l’équipe pédagogique, en association avec l’élève et ses représentants légaux – et d’un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique et chargé de son suivi (alinéa 4). Il bénéficie aussi d’une gratification versée par l’entreprise dans laquelle il est affecté, lorsque la durée des stages en milieu professionnel excède une durée fixée par décret (alinéa 7).
Les élèves peuvent, à tout moment mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage (alinéa 5).
Ce parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel (alinéa 6).
L’élève stagiaire, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences (alinéa 8).
Le présent article précise aussi le rôle de la région et du département dans ce nouveau dispositif en disposant :
– que l’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (alinéa 9) ;
– que les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’État (alinéa 10) ;
● En conséquence, le 2° du I du présent article modifie l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation en prévoyant que les CFA peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, « les élèves ayant au moins atteint l’âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire » pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage. La condition liée à l’âge
– 15 ans – n’est donc plus exclusive.
● Le II du présent article modifie le code du travail en conséquence :
– le 1° du II du présent article insère un nouvel article L. 6222-20 dans le code du travail qui dispose que lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il peut être rompu par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité ;
– en conséquence, le 2° du II du présent article modifie l’article L. 6222-21 du même code qui pose le principe d’une l’absence de versement d’indemnité en cas de rupture pendant les deux premiers mois d’apprentissage afin d’ajouter que cette indemnité n’est pas due non plus lorsque l’apprenti demande à reprendre sa scolarité dans les conditions prévues à l’article L. 6222-20 du code précité.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS23 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. Dans la continuité des mesures prises dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école, l’Assemblée a adopté un amendement n° 826 au projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale, afin de permettre aux jeunes répondant à la condition fixée par l’alinéa 2 de l’article L. 6222-1 d’entamer leur cycle de formation par voie scolaire ou sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle en attendant, pendant une durée limitée, d’atteindre l’âge leur ouvrant droit à un contrat d’apprentissage, c’est-à-dire quinze ans.
La France est d’ailleurs tenue de respecter la directive européenne du 22 juin 1994, aux termes de laquelle « les États membres [...] veillent à ce que l’âge minimal d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse l’obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans ».
M. le rapporteur. L’argument de l’âge ne tient pas, car nous ne sommes pas ici dans le cadre d’un contrat de travail : en Allemagne, l’apprentissage sous statut scolaire – et sous ce seul statut – commence à douze ans. Je souhaite seulement, pour ma part, ouvrir cette possibilité à partir de quatorze ans.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 18 est supprimé.
Article 19
(article L. 6222-31 du code du travail)
Travaux dangereux
Le présent article propose qu’un accord de branche puisse prévoir que pour certaines formations professionnelles, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur.
I. L’ENCADREMENT DE L’AFFECTATION DES JEUNES MINEURS AUX TRAVAUX DANGEREUX
Afin de garantir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, il est interdit de les affecter à certaines catégories de travaux particulièrement dangereux du fait des risques inhérents à l’opération visée et de la vulnérabilité du jeune (article L. 4153-8 et articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail). Cette interdiction concerne tous les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans qu’ils soient en formation professionnelle ou en emploi.
Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qui sont alors qualifiés de travaux réglementés (article L. 4153-9 du code du travail) (66).
Pour pouvoir affecter des jeunes en formation professionnelle à ces travaux, le lieu de formation – qu’il soit une entreprise ou un établissement de formation – doit alors obtenir une autorisation de déroger de l’inspecteur du travail, qui accorde cette autorisation pour une durée de trois ans. (67)
Peuvent être affectés à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle, les jeunes relevant des catégories suivantes (article R. 4153-39 du code du travail) :
– les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
– les stagiaires de la formation professionnelle (art. L et R. 6341-1 et suivants du code du travail) ;
– les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
– les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux.
II. L’ENCADREMENT DE L’AFFECTATION DES APPRENTIS AUX TRAVAUX DANGEREUX
S’agissant plus spécifiquement des apprentis – qu’ils soient mineurs ou majeurs – l’article L. 6222-30 du code du travail dispose, comme l’article L. 4153-8, qu’il est interdit d’employer l’apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
Cependant une procédure dérogatoire a été prévue par l’article L. 6222-31 du code du travail, modifié par l’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 précitée (68) : ainsi, pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur. L’employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
L’objet de la loi du 24 novembre 2009 qui a mis en place la procédure de la déclaration préalable de l’employeur est de responsabiliser les employeurs dans l’embauche des jeunes en apprentissage tout en allégeant les contraintes administratives, les autorisations de l’inspecteur du travail n’étant plus préalables à l’embauche. L’employeur satisfait ainsi à ses obligations lorsque des travaux avec certains équipements sont nécessaires à la formation de l’apprenti, en transmettant un acte déclaratif à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cependant aucun décret d’application de l’article L. 6222-31 n’a été publié et la procédure dérogatoire mise en place par cet article est restée lettre morte.
Cela provoque des situations très regrettables dans lesquelles certains apprentis – comme les charpentiers – ne peuvent apprendre correctement leurs métiers faute de pouvoir accomplir certains travaux.
Cette situation est d’autant plus étonnante qu’il existe un dispositif dérogatoire pour les apprentis mineurs – dans le cadre de l’article L. 4153-9 du code du travail – et que le dispositif dérogatoire pour les apprentis majeurs n’est toujours pas entré en application.
Lors de son audition par votre Rapporteur, une organisation patronale a considéré qu’une telle situation constituait « un véritable frein au développement de l’apprentissage ».
Ce sujet a d’ailleurs été inscrit à l’ordre du jour des Conférences sociales des 7 juillet et 19 septembre derniers. Clôturant la journée de mobilisation pour l’apprentissage, le Président de la République, M. François Hollande, a annoncé la mise en place d’une concertation sur l’utilisation des machines dangereuses par les mineurs en apprentissage et plus largement la remise à plat des règles de sécurité « pour voir ce qui peut être assoupli sans remettre en cause la sécurité des apprentis ».
Le présent article propose donc qu’en l’absence de décret, des accords de branche étendus puissent préciser les métiers pour lesquels les apprentis pourront accomplir tous les travaux nécessaires à leurs formations.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS24 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. La loi interdit d’affecter de jeunes travailleurs, âgés de quinze à dix-huit ans, à des travaux dangereux mentionnés dans le code du travail. Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle et sous certaines conditions, ces jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qualifiés de réglementés par l’article L. 4153-9 du même code, et dont un décret du 11 octobre 2013 a actualisé la liste. Pour ce faire, l’entreprise ou l’établissement de formation doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail.
Contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, la procédure de dérogation a bien été réformée par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013. Désormais, l’inspecteur du travail peut accorder cette autorisation pour une durée de trois ans. L’état actuel de la législation permet donc de répondre efficacement aux nécessités induites par la formation professionnelle tout en garantissant le respect par l’employeur de son obligation générale de sécurité, en application de la partie IV du code du travail.
M. le rapporteur. Nous sommes face à une contradiction. Le décret d’application de l’article L. 6222-31, qui vise les apprentis majeurs, n’ayant pas été publié, la procédure dérogatoire ne peut leur être appliquée alors même qu’elle l’est pour les apprentis mineurs, visés, eux, par le décret auquel vous avez fait allusion. Le 19 septembre dernier, le Président de la République a d’ailleurs annoncé une concertation sur l’utilisation des machines dangereuses par les mineurs en apprentissage, et, plus généralement, la remise à plat des règles de sécurité, en vue, s’il y a lieu, de les assouplir. Le fait est que, aujourd’hui, les mineurs sont protégés, mais pas les majeurs.
M. Denys Robiliard. À supposer que cela soit vrai, il appartiendrait au Gouvernement de modifier le décret. La disposition est donc de nature réglementaire. Quoi qu’il en soit, il est ressorti des auditions que les employeurs concernés souhaitent, s’agissant des questions de sécurité, être exemptés de contrôle par les inspecteurs du travail. Cela n’est évidemment pas acceptable. La mise aux normes n’est pas toujours facile, j’en conviens, et nous pouvons saisir le ministre du travail pour que, le cas échéant, il modifie le décret – un apprenti couvreur doit pouvoir monter sur un toit, bien entendu –, mais la loi, telle qu’elle est, a vocation à protéger les mineurs comme les majeurs.
M. le rapporteur. Il n’est évidemment pas question, le Président de la République le souligne lui-même, de transiger sur la sécurité, mais celle-ci n’obéit pas aux mêmes critères pour un apprenti charpentier et un apprenti boulanger. Il serait bon, de ce point de vue, que les branches formulent des propositions qui pourraient servir de référence aux contrôles, évidemment nécessaires, de l’inspection du travail. Des modules de formation spécifiquement dédiés aux questions de sécurité seraient même utiles.
Mme Véronique Louwagie. Nous sommes tous d’accord sur les impératifs de sécurité. Reste que la diminution des contrats d’apprentissage dans certaines branches résulte directement des difficultés rencontrées pour les apprentis mineurs. De plus, il serait absurde de se désintéresser de la sécurité des jeunes apprentis au motif qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 19 est supprimé.
Article 20
(articles L. 1599 ter A du code général des impôts)
Apprentissage dans les collectivités
Les personnes morales de droit public peuvent conclure des contrats d’apprentissage de droit privé avec des jeunes de 16 à 25 ans depuis la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (69).
Ces contrats comprennent une formation d’environ 400 heures par an dans un centre de formation des apprentis (CFA) agréé, en alternance avec un temps de présence chez l’employeur public, en fonction du diplôme préparé. La durée du contrat varie d’un à trois ans.
Pourtant, à l’heure actuelle, les collectivités territoriales ne recrutent que peu d’apprentis.
Dans un rapport relatif à l’apprentissage en alternance dans les collectivités locales (70), le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale constate : « l’apprentissage est encore relativement sous-utilisé dans la fonction publique, ainsi que le relevait un article de la Gazette, en octobre 2009. Quatre ans après, le bilan est toujours aussi mitigé. » Le rapport souligne que malgré la volonté des pouvoirs publics de développer l’apprentissage, celui-ci « reste, cependant aujourd’hui, marginal dans la fonction publique. Il a presque doublé depuis le début des années 2000 mais tend à se stabiliser : on recensait seulement 6 400 nouveaux contrats d’apprentissage en 2008, alors que le secteur privé en comptait près de 300 000. » Au 31 décembre 2010, les collectivités territoriales et leurs établissements comptabilisaient 8 060 apprentis.
Deux principaux obstacles au développement de l’apprentissage dans la fonction publique peuvent être identifiés :
– en premier lieu, la procédure de demande d’agrément pour l’établissement qui veut accueillir un apprenti – allégée pour les entreprises privées – reste contraignante et chronophage dans le secteur public, notamment pour les petites communes qui n’ont pas de service des ressources humaines ;
– par ailleurs, n’étant pas assujettie à la taxe d’apprentissage, les collectivités territoriales doivent, en principe, prendre en charge le coût de la formation en centre de formation d’apprentis (CFA). Dans quelques régions seulement, ces coûts peuvent être pris en charge, pour tout ou partie, soit par le CFA, soit par le conseil régional.
La conclusion du rapport est que « ce dispositif coûte cher et contrairement au secteur privé où il existe une taxe d’apprentissage, le financement de l’apprentissage dans la fonction publique repose principalement sur les collectivités elles-mêmes. Il s’agit donc d’une volonté politique de ces dernières, qu’il convient d’encourager et, pour ce faire, réfléchir à la mise en place d’outils permettant de rendre plus attractif, sur un plan budgétaire, la mise en œuvre de ce dispositif. À ce titre, toutes les mesures financières adéquates pouvant être mises en place dans les collectivités pour développer l’apprentissage doivent être étudiées attentivement. »
C’est pourquoi, le présent article propose de soumettre les collectivités territoriales à la taxe d’apprentissage afin que soit pris en charge le coût de la formation de leurs apprentis.
Le I du présent article modifie l’article 1599 ter du code général des impôts afin de rendre les collectivités territoriales redevables de la taxe d’apprentissage.
Afin de tenir compte de la spécificité des collectivités territoriales, le II du présent article prévoit qu’un décret précisera le taux auquel elles seront soumises, lequel devra être obligatoirement inférieur ou égal au taux appliqué aux entreprises et fixé par l’article 1599 ter B du code général des impôts.
Le III précise que l’article rentrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Cette réforme s’inscrit pleinement dans les priorités de la Conférence sociale du 7 juillet dernier qui a fixé un objectif de recrutement de 10 000 apprentis dans la fonction publique d’État.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS25 de M. Denys Robiliard.
Mme Kheira Bouziane. N’étant pas assujetties à la taxe d’apprentissage, les collectivités territoriales doivent en principe prendre en charge le coût de la formation en CFA. Cependant, dans certaines régions, cette prise en charge peut être assurée, pour tout ou partie, soit par le CFA lui-même, soit par le conseil régional, qui signe alors une convention avec le centre d’apprentissage pour en définir les conditions.
Une grande réforme de l’apprentissage a été récemment adoptée par notre assemblée : nous sommes dans sa phase de stabilisation. De plus, le 19 septembre dernier, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures fortes en faveur de l’apprentissage, parmi lesquelles certaines sont déjà mises en œuvre : l’article les fragiliserait.
Un rapport de M. Didier Pirot, remis en décembre 2013 au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et intitulé L’apprentissage en alternance dans les collectivités locales : constats et propositions d’évolution, soulève la question du financement du dispositif dans les collectivités ; il invite, au rebours de ce qui nous est ici proposé, à réfléchir aux moyens de rendre le dispositif plus attractif sur le plan budgétaire.
M. le rapporteur. Les collectivités territoriales emploient aujourd’hui moins de 10 000 apprentis. Le rapport de M. Pirot identifie deux obstacles : le caractère contraignant et chronophage, pour le secteur public, de la procédure de demande ; l’obligation faite aux collectivités, effectivement non assujetties à la taxe d’apprentissage, de prendre en charge le coût de la formation en CFA. Quelques régions assurent cette prise en charge, parfois même en totalité, mais le développement de l’apprentissage dans le secteur public sur l’ensemble du territoire exige une régulation. Les collectivités qui font des efforts s’y retrouveraient ; les autres seraient pénalisées. Avis défavorable à l’amendement.
M. Christophe Cavard. Nous retrouvons les termes du débat que nous avions eu lors de l’examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle, et dont nous étions d’ailleurs convenus qu’il n’était pas clos. Ni la majorité ni même le Gouvernement, me semble-t-il, n’ont opposé de refus catégorique à vos propositions sur l’apprentissage, qu’il s’agisse des questions touchant à l’âge ou au rôle des collectivités. Si nous sommes aujourd’hui conduits à demander la suppression des articles de votre texte, monsieur le rapporteur, c’est parce qu’il n’est pas logique de remettre tous les sujets en même temps sur la table : chacun viendra à son heure, étant entendu que nous souhaitons tous développer l’apprentissage, comme cela a d’ailleurs été rappelé au plus haut niveau de l’État.
Mme Valérie Lacroute. Je vous prends au mot, monsieur Cavard : M. Cherpion et moi reviendrons à la charge avec un texte consacré à l’apprentissage.
M. le rapporteur. Les niches ne sont pas très nombreuses, monsieur Cavard : pourquoi ne pas profiter de celle-ci pour faire avancer les choses ? Il y a, de plus, un lien évident entre l’emploi, le travail et la formation.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 20 est supprimé.
La Commission en vient à l’amendement AS2 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Valérie Lacroute. Je n’ai guère d’illusions sur le sort qui sera réservé à mes quatre amendements, qui visent à compléter le texte de M. Cherpion sur l’apprentissage, notamment au sein des collectivités territoriales.
À ce jour, le secteur public ne forme que 2,5 % des apprentis. Dans un souci de simplification, l’amendement AS2 a pour objet de permettre à l’organe délibérant de la collectivité d’adopter, en début de mandature, des dispositions permanentes relativement à l’accueil des apprentis, lequel, aux termes de la législation actuelle, doit obligatoirement être soumis à l’avis du comité technique paritaire et du conseil municipal : c’est un problème pour les petites collectivités, qui ne réunissent qu’irrégulièrement leur conseil municipal et ne possèdent pas de comité technique, si bien que la procédure de recrutement peut prendre six mois.
M. le rapporteur. Avis favorable : comme je l’ai indiqué précédemment, la signature d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public est trop complexe. Confier aux centres de gestion la mission de promouvoir l’apprentissage auprès des collectivités territoriales me paraît un bon moyen de simplifier les choses.
M. Jean-Patrick Gille. Je m’interroge sur le choix des centres de gestion, qui gèrent des contrats publics. Or les contrats en alternance sont des contrats de droit privé. D’autre part, ce type de mesures ne doit pas nécessairement figurer dans la loi.
Mme Kheira Bouziane. Le Gouvernement a récemment réaffirmé sa volonté d’accroître de 10 000 en deux ans le nombre d’apprentis dans la fonction publique. Des mesures devraient donc être prises, visant à la promotion de l’apprentissage au sein des collectivités territoriales. Laissons par conséquent le temps au temps et soyons vigilants.
M. le rapporteur. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la France, il n’est plus question de laisser du temps au temps, mais de passer aux actes. Ce n’est tout de même pas une révolution que nous propose Valérie Lacroute ! J’accorde à Jean-Patrick Gille qu’il ne faudrait pas alourdir le système. Mais, étant donné les chiffres de l’apprentissage dans le secteur public, il importe de mener rapidement des actions pour le développer.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS1 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Valérie Lacroute. Je souhaiterais à nouveau préciser que l’amendement AS2 avait pour objet de confier aux centres de gestion la mission de promouvoir le développement de l’apprentissage dans les collectivités. Cette proposition de loi n’est peut-être pas le véhicule le plus adapté pour le faire, mais mieux vaut cependant le préciser. Les petites collectivités étant souvent démunies lorsqu’il leur faut faire appel à des apprentis, les centres de gestion me paraissent adaptés à cette fin – notamment dans les métiers de la santé, du travail social et des services à la personne.
M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement AS1 : il convient effectivement de favoriser l’apprentissage au sein des collectivités territoriales.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS3 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Valérie Lacroute. Comme les précédents, cet amendement vise à promouvoir l’apprentissage dans les collectivités locales : nous proposons la publication d’un rapport détaillant les conditions dans lesquelles les services accomplis par l’apprenti au titre du contrat d’apprentissage pourraient être pris en compte, s’il a la chance d’être intégré au service d’une collectivité territoriale, dans la reconstitution de sa carrière. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, ce qui dissuade les jeunes de travailler pour les collectivités locales.
M. Jean-Patrick Gille. Vous soulevez un vrai problème, mais je ne suis pas certain qu’on puisse le résoudre ainsi. Les personnels des collectivités locales risquent en effet de craindre que l’on substitue des apprentis à des emplois de fonctionnaires.
L’un des freins à l’apprentissage est d’ordre culturel et statutaire. Il réside dans le passage des jeunes du statut d’apprenti – situation de formation qui relève du droit privé – à leur embauche par les collectivités locales.
Mme Valérie Lacroute. Mon objectif est de faire en sorte qu’un apprenti qui a effectué son apprentissage dans une collectivité locale pendant deux ou trois ans, puis qui y est embauché, voie cette période d’apprentissage comptabilisée dans sa reconstitution de carrière pour le calcul de sa retraite.
M. Denys Robiliard. La manière dont votre amendement est rédigé tend à orienter le contenu du rapport du Gouvernement. Or ces questions ne vont pas de soi. Je rappelle en effet que, dans le cadre de la loi sur les retraites, nous avons décidé que tout trimestre d’apprentissage compterait dans le calcul de la retraite des apprentis. En revanche, votre amendement risque de créer une inégalité. Car, dans l’hypothèse où deux apprentis feraient leur apprentissage dans une collectivité et que l’un serait embauché, et pas l’autre, ils ne seraient pas traités de la même manière du point de vue de leur retraite.
Mme Valérie Lacroute. Je suis d’accord avec vous, mais, compte tenu de l’article 40 de la Constitution, je n’avais d’autre choix que de proposer la rédaction d’un rapport.
M. le rapporteur. Avis favorable : la publication d’un rapport permettra d’ouvrir le débat sur la question. Il conviendrait en effet que tout apprenti ait les mêmes droits, qu’il effectue son apprentissage dans le secteur public ou dans le secteur privé.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS4 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Valérie Lacroute. Cet amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) au contrat d’apprentissage. Je vous rappelle que le PACTE est réservé aux jeunes de seize à vingt-cinq ans sans diplôme ni qualification professionnelle reconnue ou dont le niveau de qualification est inférieur au baccalauréat. Une telle disposition rendrait l’emploi d’un apprenti plus intéressant, car elle permettrait de donner un avenir à l’emploi formé de manière plus durable. En effet, un apprenti est actuellement obligé de passer un concours au bout de trois ans pour intégrer la collectivité dans laquelle il a effectué son apprentissage. Nous proposons donc qu’il puisse être titularisé dans un emploi de catégorie C sans qu’il ait besoin de concourir, si la collectivité est satisfaite de son travail.
M. le rapporteur. Cette mesure est judicieuse, car elle s’adresse à des jeunes en grande difficulté. Elle est néanmoins complexe à mettre en application, car elle risque d’entraîner une rupture d’égalité. Cela étant, j’émets un avis favorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Section 2
Dispositions relatives aux stages
Article 21
(article 1609 quinvicies du code général des impôts)
Stagiaires de longue durée intégrés dans le quota d’alternance
Le présent article propose d’intégrer les stagiaires de longue durée dans le quota d’alternance, lorsqu’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) à l’issue de leur contrat, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
I. LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises de 250 salariés et plus, redevables de la taxe d’apprentissage, qui emploient moins de 4 % d’alternants et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche par rapport à leur effectif annuel moyen. À partir des rémunérations versées en 2015, ce seuil passera à 5 %.
Le taux de la CSA varie en fonction du pourcentage d’employés en contrat d’alternance – c’est-à-dire les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation – par rapport à l’effectif global :
TAUX DE LA CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L’APPRENTISSAGE EN FONCTION DU NOMBRE D’ALTERNANTS PAR RAPPORT À L’EFFECTIF MOYEN ANNUEL
Nombre d’alternants en rapport à l’effectif moyen annuel |
Effectif salariés total |
Rémunérations versées en 2013 (taxe payable en 2014) |
Rémunérations versées en 2014 (taxe payable en 2015) |
Rémunérations versées en 2015 (taxe payable en 2016) |
Moins de 1 % |
De 250 à 2 000 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Plus de 2 000 |
0,5 |
0,6 |
0,6 | |
Entre 1 % et 2 % |
Quel que soit l’effectif |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Entre 2 % et 3 % |
0,1 |
0,1 |
0,1 | |
Entre 3 % et 4 % |
0,05 |
0,05 |
0,05 | |
Entre 4 % et 5 % |
0 |
0 |
0,05 |
II. INTÉGRER LES STAGIAIRES DE LONGUE DURÉE AU QUOTA D’ALTERNANCE LORSQU’ILS SONT EMBAUCHÉS EN CDI
Certaines entreprises ne trouvent pas d’apprentis, car les métiers pour lesquels elles embauchent ne bénéficient pas de formation en alternance. C’est le cas notamment de certaines entreprises de services et de conseil. Elles sont donc soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour non-respect du quota de 4 % d’apprentis.
Pourtant, ces entreprises embauchent un grand nombre de stagiaires de longue durée, en général rémunérés à hauteur de leurs études, au-dessus du SMIC et elles embauchent un nombre important de ces stagiaires à la fin de leur formation.
Lors de son audition par votre Rapporteur, un chef d’entreprise a ainsi souligné les plus grandes difficultés que son entreprise rencontrait pour recruter des apprentis dans son secteur d’activité alors qu’il recrutait chaque année, par ailleurs, 250 à 300 stagiaires, dont un grand nombre se voyait ensuite proposer un contrat à durée indéterminée.
C’est pourquoi, le présent article propose d’intégrer au quota d’alternance pour le calcul de la CSA, ces stagiaires de longue durée et embauchés en CDI.
Il modifie donc l’article 1609 quinvicies du code général des impôts afin d’ajouter aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation pris en compte pour le calcul de la CSA « les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
*
* *
La Commission examine l’amendement AS5 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. Les articles 21 à 26 visent à remettre en cause les dispositions de la loi encadrant les stages, adoptée par notre Assemblée cet été – ce qui est en contradiction avec le souci de stabilisation du cadre législatif, nécessaire aux entreprises et aux stagiaires. Monsieur le rapporteur, il semble que, à l’article 21, vous confondiez des statuts différents : l’apprentissage, d’une part, et, d’autre part, les stages et formations en milieu professionnel. L’apprenti est un salarié bénéficiant d’un contrat de travail. Son temps de formation est long, d’une durée de deux à trois ans. Il nécessite un encadrement et un accompagnement technique soutenus. À l’inverse, le statut du stagiaire est limité à six mois. Il s’inscrit dans une maquette de formation qui n’est pas celle de l’alternance. Le stagiaire qui termine sa formation est disponible sur le marché du travail. S’il est embauché dans le prolongement de son stage, c’est qu’il est doté des compétences et des qualités nécessaires pour occuper le poste et qu’il a donné satisfaction à son employeur. L’entreprise n’a donc pas à lancer une procédure de recrutement, car la personne est immédiatement employable. Cela est positif, tant pour le stagiaire que pour l’entreprise. Je ne vois donc pas pourquoi on intégrerait des stagiaires dans les quotas d’alternants, lorsqu’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée.
M. le rapporteur. Certaines grandes entreprises recrutent des stagiaires qui ont besoin, pour valider leur diplôme, d’effectuer un stage long. L’une des grandes entreprises que nous avons auditionnées recrute chaque année 250 jeunes en stage long de plus de quatre mois. Celle-ci paie ses stagiaires parce qu’ils sont déjà titulaires d’un bac + 5, voire + 6 ou + 7. Elle embauche 70 à 80 % de ces jeunes directement à l’issue de leur stage. Certes, 20 à 30 % ne sont pas embauchés, mais cela ne s’explique pas uniquement par le fait que l’entreprise n’en veuille pas, mais aussi par le fait que ces jeunes veulent acquérir d’autres expériences ou partir ailleurs. Lorsqu’une entreprise ne peut former à ses métiers par la voie de l’apprentissage, elle offre de véritables stages et embauche une grande partie de ses stagiaires à l’issue de leur stage. Il conviendrait qu’une telle entreprise, qui dépense des sommes importantes pour aider les stagiaires à entrer dans la vie active, soit exonérée d’une partie de la surtaxe sur l’apprentissage.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 21 est supprimé.
Article 22
(articles L. 124-6 du code de l’éducation et L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale)
Gratification des stages
Le stagiaire n’est pas un salarié c’est pourquoi il ne touche pas de rémunération. En revanche, l’article L. 124-6 du code de l’éducation dispose que le stagiaire peut percevoir une gratification, dès lors que son stage ou sa période de formation en milieu professionnel dure plus de deux mois consécutifs ou si, dans l’année, il passe plus de deux mois en stage dans le même organisme.
Le montant de cette gratification, versée mensuellement, est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal fixé par l’article L. 124-6 du code précité.
Dans le cadre de la discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Jean-Pierre Godefroy, le Sénat a modifié l’article L. 124-6 du code de l’éducation portant le montant de la gratification de 12,5 % du plafond de la sécurité sociale – soit 436,05 euros – à 15 % de ce plafond – soit 523,26 euros – ce qui représente une augmentation d’environ 90 euros de la gratification mensuelle minimale pour un stagiaire.
Il est évidemment essentiel de rémunérer les jeunes qui font des stages. Cependant, il est nécessaire que la législation relative aux stages – notamment les règles relatives à la gratification minimale– ne dissuade pas les chefs d’entreprise de recruter des stagiaires alors que beaucoup de jeunes ont du mal à trouver un stage dans une entreprise. Ce point de vue a d’ailleurs été partagé par le Gouvernement qui a émis un avis défavorable à cet amendement comme en témoignent les propos de la secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Geneviève Fioraso : « Nous ne pouvons pas bouger tous les curseurs à la fois, raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable. » (71)
Par ailleurs, cette modification ne correspond pas à la teneur de l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise et une consultation préalable des partenaires sociaux semblerait, à tout le moins, nécessaire avant de modifier ces règles.
C’est pourquoi, le présent article propose :
– dans son I, de supprimer la mention fait, au sein de l’article L. 124-6 du code d’éducation, au niveau minimal de 15 %. Par conséquent, dans la rédaction proposée, le montant minimal serait fixé par une convention de branche ou par un accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, ce qui permettrait de revenir au plafond de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale mentionné à l’article D. 612-60 du code de l’éducation ;
– dans son II, de modifier l’article L. 242-4-1du code de la sécurité sociale, afin d’exonérer de charges patronales et salariales la gratification des stagiaires dans la limite de 80 % du SMIC et non plus dans la limite de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale actuellement prévue par les articles
L. 242-4-1 du code précité et D. 612-60 du code de l’éducation.
En effet, l’augmentation de la gratification du stagiaire entraine une déclaration à l’URSSAF – c’est-à-dire de nombreuses formalités pour l’employeur – alors que cette augmentation est limitée. Une exonération de cotisations sociales dans la limite de 80 % du SMIC incite donc les entreprises à donner aux stagiaires une gratification plus importante.
Ainsi, le présent article incite les entreprises à donner aux stagiaires une gratification plus importante que les 12,5 %, tout en limitant l’augmentation du minimum pour les entreprises qui ne peuvent donner une telle gratification.
*
* *
La Commission en vient à l’amendement AS31 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. C’est la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances qui a introduit la gratification pour les stages de plus de trois mois, ce qui n’a pas tari le recours aux stagiaires, ceux-ci étant 600 000 en 2006 et 1,6 million six ans plus tard. Au moment du débat sur la loi de 2014 sur les stages, de nombreux parlementaires de l’UDI et de l’UMP soutenaient l’augmentation de la gratification des stagiaires. Enfin, il importe de ne pas entretenir de confusion avec ce qui pourrait s’apparenter à un SMIC jeunes, et votre proposition d’exonération des cotisations patronales et salariales jusqu’à 80 % des indemnités dépassant le plafond de la gratification, monsieur le rapporteur, fait courir ce risque.
M. le rapporteur. Les stagiaires bénéficient, depuis la loi de 2011 et sur mon initiative, d’une gratification à partir de deux mois de stage contre trois mois dans le texte de 2006. Je défends donc la gratification, mais il existe un problème d’exonération des charges entre 12,5 % et 15 % du SMIC. Je souhaite que l’employeur puisse aller plus loin : j’ai eu, cette année, pendant un mois et demi, un jeune stagiaire à l’Assemblée nationale ; bien qu’il n’ait droit à aucune gratification, je lui en ai donné une sur le temps passé, mais je n’ai pas pu lui en fournir davantage car les formalités auraient été excessivement lourdes pour une somme modeste.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 22 est supprimé.
Article 23
(articles L. 1221-13 du code du travail et L. 124-21 du code de l’éducation)
Registre du personnel
Le présent article propose de rétablir le registre des conventions de stage afin que les stagiaires figurent dans un registre spécifique – compte tenu de leur statut particulier – et non dans le registre unique du personnel.
I. L’INSCRIPTION DES STAGIAIRES DANS LE REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL
L’article 3 de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (72) a modifié l’article L. 1221-13 du code du travail afin de faire apparaître clairement la proportion de stagiaires dans les effectifs d’une entreprise. En effet, avant l’adoption de la loi précitée, l’établissement employant des salariés avait l’obligation de tenir un registre unique du personnel et devait tenir, par ailleurs, un registre des conventions.
L’article 3 de la loi précitée a donc créé une section spécifique aux stagiaires dans le registre unique du personnel dans laquelle sont intégrés leurs noms et prénoms et leur inscription suivant l’ordre d’arrivée.
II. LA NÉCESSAIRE DISTINCTION ENTRE LES SALARIÉS ET LES STAGIAIRES
Le présent article propose de restaurer le registre de conventions de stage, prévu par l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise et instauré par la loi de 28 juillet 2011 précitée (73).
Grâce à l’existence de ces deux registres, la séparation entre stagiaires et salariés est clairement établie : elle atteste que le stage est une formation, non un contrat de travail. L’article L. 1221-13 du code du travail, en prévoyant d’inscrire les stagiaires dans le registre unique du personnel, brouille malheureusement cette distinction.
Cette évolution a notamment suscité l’inquiétude de la Conférence des grandes écoles qui a souligné, dans un communiqué du 26 février 2014 : « Le stagiaire demeure fondamentalement un étudiant ; l’alignement partiel de son statut sur celui des salariés et notamment l’inscription au registre unique du personnel, préfigure une tendance qui pourrait aboutir à considérer et comptabiliser les stagiaires en tant que salariés et à augmenter les charges administratives des entreprises. »
Le I du présent article propose donc de modifier l’article L. 1221-13 du code du travail :
– le 1° complète le premier alinéa qui met en place le registre unique du personnel et précise que ce registre est établi : « indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 124-21 du code de l’éducation » ;
– le 2° supprime le troisième alinéa de l’article L. 1221-13 qui fait référence à la partie consacrée aux stagiaires dans le registre unique du personnel ;
– le 3° supprime la mention faite aux stagiaires au sein du registre du personnel dans le dernier alinéa de l’article L. 1221-13.
Le II du présent article insère un article L. 124-21 du code de l’éducation qui rétablit le registre des conventions de stage, indépendant du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 précité. Un décret précisera, dans un second temps, les mentions devant figurer dans le registre en question.
*
* *
La Commission étudie l’amendement AS30 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. S’agissant de la gratification, le ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social s’est engagé à exonérer dans un décret les cotisations à hauteur de l’augmentation du plafond de l’indemnité de stage. Par ailleurs, il est possible d’indemniser le stagiaire au-delà du plafond, mais vous devez alors acquitter des cotisations.
L’article 23, en inscrivant le stagiaire dans le registre unique du personnel, crée une confusion entre les salariés et les stagiaires, alors que le document comprend une rubrique spécifique permettant l’identification des stagiaires par la direction des ressources humaines. L’article revient donc sur cette simplification.
M. le rapporteur. Je ne parle que de gratification pour les stagiaires, et non de salaire, afin de lever toute équivoque. Quant aux décrets, ils sont toujours en cours d’élaboration, et les employeurs qui gratifient se trouvent contraints de remplir des déclarations.
La loi du 10 juillet 2014 brouille la distinction entre les stagiaires et les salariés. La conférence des grandes écoles (CGE) a publié, le 26 février 2014, un communiqué dans lequel elle indiquait que « le stagiaire demeure fondamentalement un étudiant ; l’alignement partiel de son statut sur celui des salariés et notamment l’inscription au Registre unique du personnel, préfigure une tendance qui pourrait aboutir à considérer et comptabiliser les stagiaires en tant que salariés et à augmenter les charges administratives des entreprises. » Hélas, ce que redoutait la CGE se vérifie sur le terrain.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 23 est supprimé.
Article 24
(article L. 124-8 du code de l’éducation)
Limitation du nombre de stagiaire par entreprise
L’article 1er de la loi du 10 juillet 2014 précité (74) a limité, dans le cadre d’un nouvel article L. 124-8 du code du travail, le nombre de stagiaires qu’un organisme peut accueillir simultanément.
L’article L. 124-8 précise que leur nombre est calculé sur une même semaine civile, selon des modalités qui seront déterminées par un décret pris en Conseil d’État, ce nombre tenant compte des effectifs de l’organisme d’accueil.
Le présent article vise donc à supprimer l’article L. 124-8 du code du travail afin de laisser aux entreprises la souplesse nécessaire pour leur recrutement et d’éviter une limitation importante du nombre de stages, compte tenu de leur rôle indispensable en matière de formation.
À titre d’exemple, il n’est pas rare que des PME innovantes aient recours à un nombre important de stagiaires au cours des premiers mois d’activité et, lorsque celle-ci se développe de façon satisfaisante, recrutent les personnes ainsi formées.
Au moment de la discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, la conférence des grandes écoles s’était d’ailleurs opposée à une telle mesure qui risquait de limiter le nombre d’offres de stage et de pénaliser les stagiaires eux-mêmes, en considérant que ces quotas auraient « un effet marginal sur les abus et un coup de frein sur l’offre de stages dans les entreprises ». Dans le communiqué du 26 février 2014 précité, la conférence des grandes écoles constate : « La mise en place de ce quota est en revanche susceptible de freiner considérablement le développement des stages dans les PME, les TPE et les start-ups. Ces entreprises accueillent une proportion significative de stagiaires, en raison de la nature de leur activité liée notamment aux projets de recherche et développement. Le risque est d’aboutir à un système complexe qui deviendra dissuasif, tant pour les entreprises que pour les établissements d’enseignement supérieur. »
La mise en place d’un quota de stagiaire par entreprise introduit donc une rigidité excessive pour les entreprises et risque de pénaliser avant les stagiaires : c’est pourquoi le présent article propose de l’abroger.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement AS29 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. Cet article concerne la limitation du nombre de stagiaires par entreprise. La loi de 2014 vise à assurer un encadrement pédagogique et un suivi de qualité en limitant le nombre de stagiaires qu’un tuteur peut encadrer. Elle cherche également à réduire les abus du recours aux stagiaires à la place de salariés, que l’on constate dans certains secteurs. Cette loi a pour objectif principal de lutter contre le chômage des jeunes, plaie de notre société, et nous souhaitons leur envoyer un message de confiance dans leurs compétences et leur talent qui doivent leur valoir, à la fin de leurs études, d’être embauchés en tant que salariés et non comme stagiaire.
M. le rapporteur. Les diplômés ne sont normalement plus stagiaires, sauf dans certaines professions qui prévoient cette période de stage. Ils sont embauchés sous des contrats qui ressemblent à ceux des stagiaires – notamment dans des organes de presse ou dans des structures de spectacle –, et je fais également confiance aux jeunes pour trouver de l’emploi, le stage pouvant représenter une solution lors de leur cursus.
Je suis d’accord avec vous pour dire qu’une très petite entreprise de trois personnes ne doit pas comprendre trois stagiaires, mais de jeunes chercheurs créant leur start-up tout en étant rattachés à un laboratoire universitaire doivent pouvoir être accompagnés de jeunes stagiaires se lançant avec eux. L’instauration d’un quota empêchera la naissance de nombreuses start-up.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 24 est supprimé.
Article 25
(article L. 124-13 du code de l’éducation)
Suppression des congés salariaux
L’article 1er de la loi du 10 juillet 2014 précitée a inséré un nouvel article L. 124-13 dans le code de l’éducation afin de permettre aux stagiaires de bénéficier de congés en cas de grossesse, de paternité et d’adoption.
L’article L. 124-13 dispose que les stagiaires concernés se voient reconnaître le bénéfice des congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés. Ces conditions sont définies par le code du travail, aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 (autorisations d’absence et congé de maternité), L. 1225-35 (congé de paternité et d’accueil de l’enfant), L. 1225-37 (congé d’adoption de 18 à 22 semaines) et L. 1225-46 (droit à congé de six semaines maximum en cas d’adoption internationale).
Les stagiaires ne sont pas des salariés, et ils ne doivent en aucun cas être considérés comme tels. En effet, un stage ne saurait être assimilé à un contrat de travail car il s’agit bel et bien d’une formation en milieu professionnel, régie par une convention de stage. Étendre aux stagiaires les droits afférents aux salariés concernant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption sera largement contre-productif dans la mesure où cela nuira à l’embauche des stagiaires.
C’est pourquoi le présent article propose d’abroger le premier alinéa de l’article L. 124-13 du code de l’éducation.
*
* *
La Commission examine l’amendement AS28 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. Cet article vise à revenir sur des dispositions de la loi de 2014 sur les stages touchant aux congés pour maternité, paternité ou adoption. Il s’agit de cas particuliers, mais il est important que la loi puisse répondre à des événements familiaux qui peuvent survenir dans la vie du stagiaire.
M. le rapporteur. Nous sommes tous d’accord sur le principe, et, dans la majorité des cas, l’employeur se montre sensible à ces situations. Cela ne relève pas de la loi, mais du savoir-vivre ensemble. A contrario, les chefs d’entreprise pensent que le registre et les congés transforment le stagiaire en salarié régi par un contrat de travail.
Il est question d’intégrer, dans le droit de l’Union européenne, les apprentis et les stagiaires dans les effectifs des entreprises ; or le statut de salarié entraînera plus de méfaits que de bienfaits pour le jeune stagiaire. Vos intentions sont louables, mais leur traduction s’avère défaillante.
Mme Kheira Bouziane. Je regrette que nous refassions le débat sur la loi relative aux stages.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 25 est supprimé.
Article 26
(article L. 124-20 du code de l’éducation)
Stages à l’étranger
Lors du débat à l’Assemblée nationale de la proposition de loi précitée, un volet supplémentaire consacré aux stages réalisés à l’étranger a été ajouté sur proposition du député Philip Cordery, rapporteur de la commission des affaires européennes :
– il institue un dialogue préalable sur le déroulement et l’encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil. La base en est la convention de stage, bien que le stagiaire se trouve dans les faits soumis au droit du pays dans lequel il se rend (article L. 124-19 du code de l’éducation) ;
– par ailleurs, un nouvel article L. 124-20 du code de l’éducation prévoit qu’une fiche d’information sur les « droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil » doit être annexée à toute convention relative à un stage à l’étranger. Un décret doit en définir les modalités de mise en œuvre. Celui-ci n’a pas encore été publié.
Le présent article propose d’abroger l’obligation pour les organismes de formation de fournir une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil.
Il semble extrêmement compliqué pour les organismes de formation de se tenir au courant des évolutions législatives de tous les pays qui vont accueillir des stagiaires. La direction générale du travail, interrogée à ce sujet par votre Rapporteur, a indiqué que des fiches génériques seraient élaborées par le ministère de l’Éducation nationale. Cependant, un travail d’actualisation sera nécessaire et il sera difficile pour les organismes de formation de se tenir au courant des évolutions législatives de tous les pays qui vont accueillir des stagiaires. Afin de ne pas surcharger les obligations de ces organismes, ce qui reviendra à baisser le nombre de stages proposés à l’étranger, cet article propose de supprimer cette disposition.
*
* *
La Commission aborde l’amendement AS27 de M. Denys Robiliard.
Mme Chaynesse Khirouni. L’exposé des motifs de cet article confond à nouveau les stagiaires et les apprentis ; ce n’est pas l’établissement d’enseignement qui est chargé de réaliser les fiches de renseignement pour les étudiants stagiaires qui partent à l’étranger. La loi de 2014 permet de donner aux jeunes des éléments sur le cadre dans lequel ils s’apprêtent à évoluer.
M. le rapporteur. Cet article ne mélange pas les apprentis et les stagiaires, les premiers bénéficiant du cadre Erasmus+, qui s’avère tout à fait satisfaisant. Mais un stagiaire canadien venant en France ne pourra pas bénéficier d’une fiche à jour, du fait de l’extrême rapidité de l’évolution de nos textes. Qui sera responsable du manque d’exactitude des informations données ?
Que l’on donne des éléments sur la vie et les mœurs du pays, j’y suis bien entendu favorable, mais il s’agit là de fiches qui engagent la responsabilité de celui qui envoie le stagiaire à l’étranger.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 26 est supprimé.
Le présent article a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi en gageant les charges pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.
*
* *
La Commission étudie l’amendement AS26 de M. Denys Robiliard.
M. Denys Robiliard. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le rapporteur. Tous les articles ayant été supprimés, il n’y a plus besoin de gage, si bien que, par cohérence, j’émets un avis favorable à l’adoption de cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 27 devient sans objet.
*
* *
Tous les articles ayant été rejetés, il n’y a pas lieu pour la Commission de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi, qui est ainsi rejetée.
En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l’emploi |
Proposition de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation et de l’emploi | |
Chapitre 1er |
Chapitre 1er | |
Dispositions relatives à la vie en entreprise |
Dispositions relatives à la vie en entreprise | |
Section 1 |
Section 1 | |
Réforme du code du travail |
Réforme du code du travail | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants : |
Supprimé Amendement AS6 | |
– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ; |
||
– harmoniser les seuils au-delà desquels des obligations spécifiques sont applicables aux entreprises en vertu du code du travail ; |
||
– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ; |
||
– instaurer une instance unique de représentation élue du personnel pour les seules entreprises employant cent salariés et plus et qui se substituent pour l’ensemble des entreprises aux dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
||
– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail. |
||
II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit : |
||
1° Deux députés ; |
||
2° Deux sénateurs ; |
||
3° Cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisis parmi les représentants des salariés ; |
||
4° Cinq personnalités qualifiées siégeant au Conseil économique, social et environnemental choisies parmi les représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ; |
||
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ; |
||
6° Quatre représentants de l’État ; |
||
7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ; |
||
8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire. |
||
III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. |
||
Section 2 |
Section 2 | |
Dispositions relatives au temps de travail |
Dispositions relatives au temps de travail | |
Code du travail |
Article 2 |
Article 2 |
Art. L. 3121-10. – La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. |
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-neuf ». |
Supprimé Amendement AS7 |
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1. |
||
Art. L. 3121-22. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. |
II. – Au début du second alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». |
|
|
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. |
II. – Au début du second alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». |
|
III. – L’application des dispositions du I ne peut être la cause d’une réduction du montant de la rémunération mensuelle habituelle du salarié. |
||
IV. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux accords collectifs conclus sur le fondement des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du I. Toutefois, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail, le I est applicable nonobstant les clauses contraires d’un accord collectif conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. |
||
Article 3 |
Article 3 | |
I. – La durée du travail effectif est fixée à trente-neuf heures par semaine : |
Supprimé | |
|
Amendement AS8 | ||
1° Dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement ; |
||
2° Dans les services et établissements publics administratifs des collectivités territoriales ; |
||
3° Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
||
II. – Les modalités d’augmentation de quatre heures par semaine, le cas échéant calculée sur une moyenne hebdomadaire, de la durée de travail des agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière sont déterminées par un décret en Conseil d’État. |
||
Article 4 |
Article 4 | |
|
Art. L. 3122-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit : |
Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « conclu selon les modalités prévues par l’article L. 3312-5 ». |
Supprimé Amendement AS9 |
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; |
||
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; |
||
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. |
||
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. |
||
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours. |
||
À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. |
||
Article 5 |
Article 5 | |
Art. L. 3123-14-1. – La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. |
I. – Les articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 du code du travail sont abrogés. |
Supprimé Amendement AS10 |
Art. L. 3123-14-2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. |
||
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1. |
||
Art. L. 3123-14-3. – Une con-vention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. |
||
Art. L. 3123-14-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement. |
||
Art. L. 3123-14-5. – Par déro-gation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. |
||
|
Art. L. 3123-25. – Une conven-tion ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. |
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3123-25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». |
|
La convention ou l’accord : |
||
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; |
||
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; |
||
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. |
||
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale |
||
Art. 20. – III. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014. |
III. – Le III de l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est abrogé. |
|
Section 3 |
Section 3 | |
Dispositions relatives au bulletin de paie |
Dispositions relatives au bulletin de paie | |
Code du travail |
Article 6 |
Article 6 |
Art. L. 3243-2. – Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. |
L’article L. 3243-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé Amendement AS11 |
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
||
« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d’assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes. |
||
« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire. |
||
« Les modalités d’application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d’État. » |
||
Section 4 |
Section 4 | |
Négociation sur la représentation des salariés des petites entreprises sur un plan territorial |
Négociation sur la représentation des salariés des petites entreprises sur un plan territorial | |
Article 7 |
Article 7 | |
Dans la perspective du rehaussement à cent salariés du seuil au-delà duquel des élections de représentants du personnel doivent être organisées dans les entreprises, un accord national interprofessionnel et un accord national multi-professionnel proposent au Parlement, dans un délai de deux ans, les moyens de déterminer les modalités de représentation au niveau territorial des salariés des entreprises de moins de cent salariés. |
Supprimé Amendement AS12 | |
Section 5 |
Section 5 | |
Mesures en faveur de la sécurité juridique et de l’emploi |
Mesures en faveur de la sécurité juridique et de l’emploi | |
Article 8 |
Article 8 | |
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social. |
Supprimé Amendement AS13 | |
Dans le cadre de cette procédure, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne ayant pour objet de connaître l’application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative notifiant une sanction à l’encontre du demandeur, ou susceptible d’avoir pour conséquence directe la notification d’une sanction à l’encontre du demandeur. |
||
La demande ne peut pas être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé. |
||
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit également les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. |
||
Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, lorsqu’à l’issue du délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, l’inspecteur du travail ou la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, n’a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être notifié une sanction administrative, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande. |
||
La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’autorité qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées. |
||
Dans les six mois qui précèdent l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation conduite en application du présent article. |
||
Article 9 |
Article 9 | |
Code du travail Cinquième partie L’emploi Livre Ier Les dispositifs en faveur de l’emploi |
Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé : |
Supprimé Amendement AS14 |
« Titre V |
||
« Développement de l’emploi |
||
« Art. L. 5151-1. – I. – Un ac-cord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-33 à L. 3121-36, L. 3122-34, L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. |
||
« II. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. |
||
« III. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique mais sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. |
||
« Art. L. 5151-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci. |
||
« Art. L. 5151-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion. |
||
« Art. L. 5151-4. – I. – La vali-dité de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. |
||
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
||
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26. |
||
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral. |
||
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. |
||
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25. |
||
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24. |
||
« Art. L. 5151-5. – À la demande de l’un de ses signataires, l’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. |
||
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. » |
||
Article 10 |
Article 10 | |
Art. L. 2242-23. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. |
Supprimé Amendement AS15 | |
Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. |
||
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6. |
||
Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. |
Au dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du même code, les mots : « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et » sont remplacés par les mots et la phrase : « est un licenciement qui repose sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Il ». |
|
Article 11 |
Article 11 | |
Art. L. 1236-8. – Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. |
Après le premier alinéa de l’article L. 1236-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé Amendement AS16 |
« Le chantier mentionné au premier aliéna peut être une mission de travaux ou de prestation de services dont l’organisation a été à l’origine du recrutement du salarié. » |
||
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. |
||
Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail |
Article 12 |
Article 12 |
Art. 6. – Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise. |
Supprimé Amendement AS17 | |
L’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise définit : |
||
1° Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; |
||
…………………………………………. |
||
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. |
||
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de six ans à compter de la publication de la présente loi. |
Les deux derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail sont supprimés. |
|
À l’issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation. |
||
Chapitre 2 |
Chapitre 2 | |
Encadrement des indemnités liées à un plan de sauvegarde de l’emploi |
Encadrement des indemnités liées à un plan de sauvegarde de l’emploi | |
Article 13 |
Article 13 | |
Code général des impôts |
Supprimé | |
|
Amendement AS18 | ||
Art. 80 duodecies – 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. |
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié : |
|
Ne constituent pas une rémunération imposable : |
||
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; |
||
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.1233-32 et L. 1233-61 à L. 233-64 du code du travail ; |
I. – Le 2° est complété par les mots : « dans la limite de deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance » ; |
|
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : |
||
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; |
II. – Au a) du 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». |
|
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; |
||
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas : |
||
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; |
||
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; |
||
5° (Abrogé) |
||
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : |
||
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; |
||
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. |
||
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. |
||
Chapitre 3 |
Chapitre 3 | |
Politique envers les jeunes |
Politique envers les jeunes | |
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives à l’apprentissage |
Dispositions relatives à l’apprentissage | |
Code de l’éducation |
Article 14 |
Article 14 |
Art. L. 421-2. – Les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1 sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. |
Supprimé Amendement AS19 | |
Celui-ci comprend : |
||
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de l’établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; |
Après les mots : « qualifiées », la fin du 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « représentant le monde économique, comprenant, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; » |
|
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ; |
||
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d’élèves et élèves. |
||
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt-quatre ou de trente membres. |
||
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l’établissement et, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative. |
||
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège. |
||
Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée délibérante. |
||
Toutefois, lorsque, en application du 1° de l’article L. 4221-1-1 ou du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, les compétences d’une région ou d’un département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseigne-ment concernés en lieu et place de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. |
||
Code du travail |
Article 15 |
Article 15 |
I. – L’article L. 6222-7-1 du code du travail est ainsi modifié : |
Supprimé | |
|
Amendement AS20 | ||
Art. L. 6222-7-1. – La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. |
a) Après la troisième occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « fixé par commun accord entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation des apprentis ». |
|
|
Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11. |
b) Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant : « Dans les cas où la durée est inférieure ou supérieure à deux ans, le directeur du centre de formation des apprentis en informe le recteur de l’académie. » |
|
Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. |
||
Art. L. 6222-8. – La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. |
II. – En conséquence, les articles L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10 du code du travail sont abrogés. |
|
Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation du service de l’inspection de l’apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
||
Art. L. 6222-9. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre : |
||
1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage ; |
||
2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ; |
||
3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ; |
||
4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut. |
||
Dans ces cas, le nombre d’heures de formation dispensées dans les centres de formation d’apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l’article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage. |
||
Art. L. 6222-10. – Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l’apprenti permettant d’adapter la durée du contrat ou de la période d’apprentissage en application de l’article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d’un centre de formation d’apprentis. |
||
Article 16 |
Article 16 | |
Art. L. 6233-1-1. – Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. |
I. – À l’article L. 6233-1-1 du code du travail, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « par celui-ci ou ». |
Supprimé Amendement AS21 |
Art. L. 6221-2. – Aucune contre-partie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage. |
II. – Après le mot : « financière », la fin de l’article L. 6221-2 du code du travail est ainsi rédigée : « pour quelque prestation que ce soit ne peut être demandée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. » |
|
Article 17 |
Article 17 | |
Code de l’éducation |
||
Art. L. 332-3. – Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. À chacun d’entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l’élaboration du projet d’orientation mentionné à l’article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d’enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d’enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège. |
Après la deuxième phrase de l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les collèges organisent des sessions de découverte de l’apprentissage, permettant à tous les collégiens de découvrir les métiers, les centres de formation des apprentis, et de rencontrer des acteurs du monde économique. » |
Supprimé Amendement AS22 |
Article 18 |
Article 18 | |
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : |
Supprimé | |
|
Amendement AS23 | ||
1° Après l’article L. 337-3-1, il est inséré un article L. 337-3-2 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 337-3-2. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage. |
||
« Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage. |
||
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 313-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage. |
||
« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements techno-logiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix. |
||
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. |
||
« L’élève stagiaire en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 dans la perspective d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. |
||
« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. |
||
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’État, dans des conditions fixées par décret. » |
||
Art. L. 337-3-1. – Les centres de formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant au moins atteint l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1. |
2° Au premier alinéa de l’article L. 337-3-1, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ». |
|
À tout moment, l’élève peut : |
||
– soit signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, conformément à l’article L. 6222-1 du code du travail ; |
||
– soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée. |
||
Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. |
||
Un décret détermine les modalités d’application du présent article. |
||
Code du travail |
II. – Le code du travail est ainsi modifié : |
|
1° Après l’article L. 6222-19, il est rétabli un article L. 6222-20 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 6222-20. – Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » |
||
Art. L. 6222-21. – La rupture pendant les deux premiers mois d’apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat. |
2° À l’article L. 6222-21, après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 ». |
|
Article 19 |
Article 19 | |
Art. L. 6222-31. – Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l’apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l’employeur. |
Au premier alinéa de l’article L. 6222-31 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « ou par accord de branche étendu ». |
Supprimé Amendement AS24 |
L’employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. |
||
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d’exécution du contrat de travail par l’inspection du travail. |
||
Code général des impôts |
Article 20 |
Article 20 |
Art. 1599 ter A. – 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. |
Supprimé Amendement AS25 | |
2. Cette taxe est due : |
I. – Le 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : |
|
1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; |
||
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de ceux désignés au 5 de l’article précité, quel que soit leur objet ; |
||
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; |
||
4°Par les groupements d’intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35. |
||
« 5° Par les collectivités territoriales ; » |
||
3. Sont affranchis de la taxe : |
||
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n’excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
||
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ; |
||
3° Les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l’exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d’une exonération, les autres groupements d’employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail. |
||
II. – Le taux auxquelles sont soumises les collectivités territoriales est fixé par décret, mais il doit être inférieur ou égal au taux prévu à l’article 1599 ter B de ce même code. |
||
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016. |
||
Section 2 |
Section 2 | |
Dispositions relatives aux stages |
Dispositions relatives aux stages | |
Article 21 |
Article 21 | |
Art. 1609 quinvicies. – I.– Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage. |
: |
Supprimé Amendement AS5 |
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 1599 ter A et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : |
||
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ; |
||
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche. |
Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé |
|
« 3° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. » |
||
Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015. |
||
Les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes : |
||
a) L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ; |
||
b) L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée. |
||
…………………………………. |
||
Article 22 |
Article 22 | |
Code de l’éducation |
||
Art. L. 124-6. – Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. |
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, les mots : « , à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. |
Supprimé Amendement AS31 |
Le premier alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique. |
||
La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. |
||
Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. |
||
Code de la sécurité sociale |
||
Art. L. 242-4-1. – N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
II. – Au premier alinéa de l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , le produit d’un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par les mots : « 80 % ». |
|
Les dispositions de l’alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. |
||
Article 23 |
Article 23 | |
Code du travail |
||
I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié : |
Supprimé | |
|
Amendement AS30 | ||
Art. L. 1221-13. – Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 124-21 du code de l’éducation. » |
|
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile. |
||
Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. |
2° Le troisième alinéa est supprimé. |
|
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. |
3° Au dernier alinéa, les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, » sont supprimés. |
|
Code de l’éducation |
II. – Après l’article L. 124-20 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-21 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 124-21. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. » |
||
Article 24 |
Article 24 | |
Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Ce nombre tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15. |
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est abrogé. |
Supprimé Amendement AS29 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent. |
||
Article 25 |
Article 25 | |
Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. |
Le premier alinéa de l’article L. 124-13 du même code est abrogé. |
Supprimé Amendement AS28 |
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. |
||
Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code. |
||
Article 26 |
Article 26 | |
Art. L. 124-20. – Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l’étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire. |
L’article L. 124-20 du même code est abrogé. |
Supprimé Amendement AS27 |
Article 27 |
Article 27 | |
I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
Supprimé Amendement AS26 | |
II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
III. – La charge résultant pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements de santé de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – M. Jean-François Pilliard, vice-président en charge du pôle Social et délégué général de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), M. Antoine Foucher, directeur des relations sociales, de l’éducation et de la formation, et Mme Emeline Touzet, chargée de mission à la Direction des affaires publiques *
Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – Mme Geneviève Roy, vice-présidente chargée des affaires sociales, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :
– Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) – M. Hugues de Balathier, chef de service, adjoint à la déléguée générale, et M. Michel Ferreira-Maia, chargé de la mission politique de formation et de qualification
– Direction générale du travail (DGT) – Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef de service
Ø Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) – M. François Moutot, directeur général *
Ø Barthélémy Avocats – M. Franck Morel, avocat associé
Ø Force Ouvrière (CGT-FO) – M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral en charge de l’emploi
Ø Confédération de l’artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) – Mme Valérie Guillotin, juriste, chargée de mission au pôle juridique et social *
Ø M. Bertrand Martinot, économiste, auteur de l’ouvrage « Chômage : inverser la courbe »
Ø Les Compagnons du devoir – M. Jean-Claude Bellanger, secrétaire général
Ø Chambre de commerce et d’industrie de France (CCI France) – M. Patrice Guezou, directeur Formation et Compétences à CCI France, M. Rachid Hanifi, directeur adjoint CCI France, M. Marc Canaple, CCI Paris-Île-de-France, M. Jérôme Pardigon, directeur des relations institutionnelles à CCI France *
Ø Association française des entreprises privées (AFEP) – Mme Stéphanie Robert, directrice, et Mme France Henry-Labordere, directrice affaires sociales
Ø Accenture – M. Christian Nibourel, président, et Mme Véronique Carantois, conseil en communication et relations institutionnelles
Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – M. Joseph Thouvenel, vice-président en charge du dossier emploi, et M. Michel Charbonnier, conseiller politique
Ø Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) – M. Jérôme Volle, vice-président de la commission emploi nationale, M. Morgan Oyaux, sous-directeur du service emploi et relations sociales, et Mme Nadine Normand, attachée parlementaire
Ø Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire – Mme Brigitte Doriath, sous-directrice de la sous-direction « Lycée et formation professionnelle tout au long de la vie », et Mme Marie-Annick Malicot, adjointe à la sous-directrice
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
© Assemblée nationale