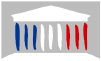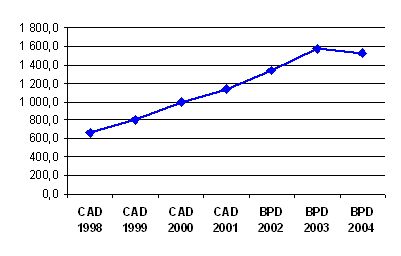N° 2436 _______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2005 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) SUR L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE
Président M. Augustin BONREPAUX, Rapporteur M. Hervé MARITON, Députés. -- TOME I Tome I - Partie 1
RAPPORT (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. La commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale est composée de : M. Augustin Bonrepaux, Président ; MM. Jean-Pierre Soisson, René Dosière, Vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Sandrier, Secrétaires ; M. Hervé Mariton, Rapporteur ; MM. Jean-Pierre Balligand, Joël Beaugendre, Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Mme Claude Darciaux, MM. Bernard Derosier, Jean-Jacques Descamps, Michel Diefenbacher, Marc Francina, Alain Gest, Louis Giscard d'Estaing, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Yves Le Drian, Jean-Louis Léonard, Maurice Leroy, Richard Mallié, Denis Merville, Pierre Morel-a-L'Huissier, Mme Béatrice Pavy, MM. Michel Piron, Michel Raison, Éric Raoult, Camille de Rocca Serra, Pascal Terrasse. AVERTISSEMENT L'augmentation des impôts est souvent perçue comme une fatalité. Il est évidemment de l'intérêt de ceux qui décident ces augmentations de brouiller l'image. Les auditions de la Commission d'enquête ont d'ailleurs été éclairées par quelques fortes paroles comme « toute comparaison des taux de fiscalité locale est vaine ». Alors... Les experts eux-mêmes nous ont décrit une sorte de fait sans cause, et donc sans véritable responsable. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de stabilisateurs dans le système fiscal de la décentralisation à la française. Les taux ne supportent pas la comparaison, les bases sont anciennes et incertaines. Souvent l'État décide et les collectivités paient. Alors, les collectivités votent l'impôt et, à son tour, l'État paie une bonne part. Les réformes successives de la fiscalité locale se sont le plus souvent traduites par un alourdissement de la part de l'État. L'inégalité entre les collectivités reste considérable. L'empilement des échelons s'aggrave. L'intercommunalité aura plus coûté qu'elle n'aura permis d'économiser. Les compétences sont éclatées. La qualité des services est mal évaluée. On n'en parle jamais. Les financements sont dispersés et l'on décide d'autant volontiers que d'autres paieront. L'autre, c'est le contribuable. Et le contribuable, ménage ou entreprise, paie une France sur-administrée et sous-organisée. Et voilà que des enjeux nouveaux apparaissent. Et l'on crée les pays. Et ce qu'une majorité fait, une autre n'ose pas le corriger vraiment. Pourtant, il ne se sache pas que ce soit d'un manque de structures dont la France souffre. Jean-Pierre Raffarin a eu raison de relancer le mouvement de la décentralisation. Car ultimement, c'est bien de responsabilité et de qualité de service dont il s'agit. Mais il est parfaitement clair, et le rapport le démontre à l'envi, que la décentralisation peut bien se passer comme elle peut mal se passer. Curieusement, lorsqu'il s'agit d'évaluer la décentralisation, on parle surtout de l'émetteur, l'État. En effet, il convient de juger de la qualité des méthodes de transfert de compétence, de la justesse des financements apportés. Mais la décentralisation, c'est aussi l'efficacité de la gestion locale, la qualité du service, la maîtrise des ressources. Le constat d'expérience, éclatant dans les choix des conseils régionaux en 2005, c'est la dérive régulière, parfois explosive, de la fiscalité locale. Dans la controverse du début de l'année 2005 sur l'explosion de la fiscalité régionale, on entendait d'ailleurs déjà se glisser les anticipations haussières de nombre de conseils généraux. Si la décentralisation pouvait justifier l'augmentation de fiscalité régionale en 2005, l'argument ne pouvait-il servir à nouveau en 2006 pour la fiscalité départementale ? Au passage, le relèvement de la fiscalité intercommunale, l'introduction d'impôts sur les ménages se glissaient discrètement. On peut au moins espérer que votre Commission d'enquête, éclairant le sujet par son analyse et ses conclusions, évite que ces augmentations ne se fassent trop facilement et peut-être même en épargne quelques-unes. Lorsqu'il s'agit de rétablir la confiance des acteurs économiques, de stimuler la croissance et l'emploi, d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages, de renforcer la compétitivité des entreprises, on ne saurait se résigner à une telle dérive. L'Assemblée nationale autorise les impôts de toute nature, elle contribue aussi à constater la nécessité de la contribution publique. Très logiquement, l'Assemblée nationale a alors décidé de créer une Commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale, de ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la vie des entreprises, ainsi que sur les conditions d'une responsabilité mieux assumée des décideurs. Nous avons cherché, dans ce rapport, à proposer des solutions pour davantage de clarté, davantage de responsabilité, davantage d'efficacité. L'engagement d'élu témoigne du refus de la fatalité. J'espère qu'il aura été ici utile, pour la vie quotidienne de nos concitoyens, pour la meilleure gestion de notre pays. La décentralisation est nécessaire à la qualité de vie des Français et au progrès de la France. Il faut réussir la décentralisation. Hervé MARITON Ce rapport à charge confirme les inquiétudes que mes collègues du Groupe socialiste et moi-même avions exprimées dès l'annonce de la mise en place d'une Commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale. Parce que les travaux ne sont pas limités dans le temps, une mission d'information aurait permis une étude plus approfondie. La majorité parlementaire a préféré choisir la procédure plus lourde d'une Commission d'enquête, il est vrai plus adaptée à l'inquisition. Son poids politique lui laissait en la matière le choix des armes. Le rapport rédigé par Hervé MARITON tourne finalement le dos à l'objectivité, que nous pouvions légitimement attendre du travail d'analyse et d'évaluation conduit par la Commission. Tout au long des auditions, la majorité n'a eu de cesse de diaboliser les choix des élus locaux - piétinant sans embarras le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales -, de stigmatiser systématiquement les collectivités dirigées par des élus appartenant à l'opposition, de cantonner la sphère de la dépense publique locale, sans jamais se préoccuper des vertus de l'action publique locale, de la qualité des services rendus aux habitants de ces territoires, de la nécessité pour les élus de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Cette Commission pouvait être l'occasion de mieux comprendre des questions essentielles qui intéressent tous les parlementaires. Certes, l'évolution des finances publiques à tous les niveaux d'administration publique, la complémentarité et l'interdépendance dans l'action de l'ensemble des acteurs publics et bien d'autres domaines ont été abordés. Malheureusement, ces questions ont été très rapidement mises en marge par la majorité, qui a préféré marteler le message dogmatique de la nécessaire diminution des impôts et de la dépense publique. Pour autant, il faut se féliciter de la qualité des auditions menées, et des très nombreux éléments d'analyses et de statistiques fournis qui permettent d'ores et déjà de cerner et d'évaluer les différents facteurs objectifs, chiffres à l'appui, ayant eu un rôle dans l'évolution de la fiscalité locale depuis 2000. Sans tomber dans la polémique stérile avec le Rapporteur, si son ambition était de placer au pilori un responsable, c'est bien l'État, qui se doit d'être le garant de la solidarité nationale et de l'égalité des chances sur tout le territoire mais assume de moins en moins son rôle depuis juin 2002. Le Rapporteur a relevé en effet le défi improbable d'ignorer toutes les conséquences les plus préoccupantes subies par les budgets publics locaux du fait de la politique menée depuis cette date. L'exemple de la décentralisation du RMI est édifiant. La compensation de cette dépense en augmentation par le produit d'un impôt, la TIPP, à très faible progression et que les collectivités ne pourront certainement pas faire évoluer, conduit à des déficits excessifs : 450 millions d'euros en 2004, certes compensés pour l'instant par l'État, mais sans qu'aucune compensation ne soit prévue pour des déficits bien supérieurs déjà constatés l'année suivante. Cette dénégation des principes qui doivent inspirer une réelle volonté décentralisatrice explique que, conformément à l'analyse faite par les exécutifs locaux, les marges de manœuvres des collectivités locales se trouvent de plus en plus réduites. Silence également sur les nombreux désengagements orchestrés par ce Gouvernement qui ne laissent d'autre choix aux collectivités territoriales que de prendre en charge les missions que l'Etat ainsi impécunieux ne peut ni ne veut plus assumer. La défaillance dans la mise en œuvre des contrats de plan État-régions en constitue la parfaite illustration. Ce constat est fait largement dans le rapport que j'ai présenté sur ce sujet devant la Commission des finances avec mon collègue Louis Giscard d'Estaing, constat qui tranche avec la vision partisane du Rapporteur. Mensonge quant à la réalité des ressources transférées aux collectivités locales, que plusieurs spécialistes s'accordent à qualifier de « pseudo-dotations », qui ne seront jamais à la hauteur des besoins, mettant ainsi les collectivités dans une impasse financière de plus en plus alarmante. Refus de mesurer l'ampleur de la nouvelle situation d'endettement des collectivités locales, qui ont bénéficié d'une période faste jusqu'en 2002, et qui connaissent depuis 2003 une dégradation de leurs comptes. On est en droit de se demander si la majorité parlementaire entend, au nom du leitmotiv de la baisse des impôts, suggérer aux collectivités de prendre modèle sur l'État qui connaît un endettement record ? Au final, le dogme de la réduction à tout prix des dépenses publiques, au mépris des besoins de la population et de la qualité du service public, aura donc servi de fil conducteur aux députés de la majorité, membres de la Commission d'enquête, et guidé la plume du Rapporteur. Cette vision réductrice de l'action politique se retrouve également dans la critique de l'intercommunalité. Il est manifeste que, pour la majorité parlementaire, seule est concevable une substitution pure et simple des dépenses des structures intercommunales aux dépenses communales, et ceci au mépris de la demande des citoyens de services supplémentaires concrets (crèches, équipements créateurs d'emplois, logements, équipements sportifs et culturels, routes, infrastructures numériques), permis uniquement par la mise en commun de moyens et qui ne peuvent pas être considérés comme des dépenses superflues et/ou somptuaires. Au mépris des choix exprimés par les électeurs, la majorité reste sourde à leurs demandes au nom du seul principe qui guide son action : « moins d'impôts, moins d'État, et donc moins de services publics ». Son obstination idéologique l'empêche de reconnaître l'évidence : les citoyens ont fait d'autres choix en 2004 en apportant leurs suffrages à des élus qui refusent cette vision restrictive de l'action publique. Au-delà des campagnes de communications réductrices et polémiques, gageons que les citoyens sauront faire prévaloir leurs choix. Augustin BONREPAUX S O M M A I R E _____ Pages INTRODUCTION 21 PREMIÈRE PARTIE : ENQUÊTE SUR L'EXPLOSION DE LA FISCALITÉ LOCALE EN 2005 29 I.- UNE HAUSSE BRUTALE ET MAL JUSTIFIÉE 29 A.- LE « FILM DES ÉVÉNEMENTS » ET LES ARGUMENTS PRÉSENTÉS 29 1.- La rupture de l'année 2005 29 · Fiscalité et budgets régionaux en 2005 : la flambée 30 · La hausse de la fiscalité départementale en 2005 : plus modérée, plus concentrée 34 · Les communes et les groupements : modération fiscale assez générale en 2005 38 2.- Les arguments des collectivités : une valse à trois temps 40 a) L'acte II de la décentralisation et les transferts de charges décidés par l'État 41 b) Le « désengagement de l'État » 47 c) L'argument du faible poids de la fiscalité régionale 49 B.- IL N'Y AVAIT PAS DE FATALITÉ À LA HAUSSE DES TAUX 52 1.- L'augmentation de la fiscalité ne saurait être justifiée par les compétences transférées en 2005 52 a) Des transferts peu nombreux et bien compensés 53 · Des transferts peu nombreux 53 · Des transferts bien compensés 54 b) L'absence d'impact de ces transferts sur le budget des collectivités concernées 60 2.- Le RMI : la moitié des masses financières transférées aux départements 64 a) Le dispositif initial va au-delà du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences 65 · L'application du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences 66 · L'extension exceptionnelle du périmètre de la compensation financière afin de tenir compte de la création du RMA 67 b) Jusqu'à présent, l'État a respecté l'intégralité de ses engagements 68 · La compensation versée à titre provisoire en 2004 68 · Les ajustements intervenus en loi de finances rectificative pour 2004 69 · L'inclusion des indus dans la base de compensation 70 · Il n'y a pas de treizième mois dont la charge aurait été affectée aux départements sans compensation 70 · Les personnels 70 c) L'augmentation importante du nombre de RMIstes et l'engagement exceptionnel du Premier ministre de compenser le surcoût qui en résulte 71 · Le décalage entre les recettes de TIPP et les dépenses de RMI des départements 71 · L'engagement exceptionnel du Premier ministre de compenser intégralement le différentiel 2004, en dehors de toute obligation juridique 72 · L'engagement du Premier ministre sera-t-il intégré dans la base de compensation ? 73 d) L'impact du RMI sur la fiscalité départementale en 2005 73 · L'engagement du Premier ministre a permis à de nombreux départements de modérer l'accroissement de leur fiscalité en 2005 73 · Des réponses fiscales d'amplitude très variable 74 e) Examen des revendications des exécutifs départementaux 75 · Une remise en cause du principe même de la décentralisation du RMI ? 76 · La perspective d'évolution comparée de la recette et de la charge liée au RMI 76 · Les coûts de trésorerie engendrés par le paiement du RMI 82 · Le surcoût que peut entraîner la signature d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'insertion RMA 83 · La suppression du cofinancement par l'État des agents de l'ANPE travaillant dans le champ de l'insertion 83 3.- L'importance de l'effort financier de l'État sur les territoires contredit la thèse de son « désengagement » 85 a) L'exécution des contrats de plan État-régions est banalement en retard 85 b) L'État a contractualisé à un très haut niveau dans les contrats de plan 91 c) La mesure de l'effort financier de l'État sur les territoires 96 4.- L'incidence, marginale en 2005, des dépenses nouvelles liées aux compétences exercées depuis 1996 103 a) La départementalisation des services d'incendie et de secours 104 b) La prise en charge de la dépendance des personnes âgées 111 c) La décentralisation des services collectifs de voyageurs 115 II.- De vraies causes en 2005 122 A.- LE CYCLE ÉLECTORAL 123 1.- Pertinence de la notion de cycle électoral 123 2.- L'application de la théorie du cycle électoral aux comportements des décideurs locaux en 2004 et 2005 125 a) Le cycle opportuniste 125 · La modération fiscale pendant l'année préélectorale implique un rattrapage l'année suivant l'élection. 125 · Le poids de l'héritage de la gestion précédente 126 · Les « artifices de présentation » du budget 128 b) Le cycle partisan 129 · L'augmentation des dépenses, assumée par les nouvelles majorités régionales 129 · 2005 : des augmentations de taux apparemment concentrées en début de mandat 130 B.- LE DYNAMISME DES DÉPENSES LOCALES EN 2005 131 1.- Le dérapage des frais généraux 132 a) La croissance des dépenses de communication, de représentation et d'action internationale 132 b) Les dépenses de personnel 135 · Départements : des administrations de gestion 136 · Régions : des administrations de missions ? 136 2.- Le libre choix de dépenser plus 139 a) La distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires des collectivités territoriales 140 b) La volonté de faire mieux et plus dans le domaine des compétences obligatoires 142 · Régions : la formation professionnelle 144 · Régions : les lycées 145 · Régions : les transports ferroviaires de voyageurs 147 c) La volonté d'élargir le champ des interventions 149 · La flambée des dépenses dites d'intérêt régional 149 · La stratégie de la région Alsace : maîtrise des dépenses, ciblage des interventions et choix pertinent de leurs modalités 157 · Une forme atypique d'intervention : la suppression de la taxe sur les permis de conduire 159 · La croissance des dépenses, obligatoires comme non obligatoires, exige une augmentation des ressources 160 C.- LA STRATÉGIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 162 1.- L'arbitrage des collectivités territoriales entre emprunt et autofinancement a pesé sur l'évolution de la fiscalité locale 162 a) Bilan de la situation financière des collectivités territoriales à la veille de l'acte II de la décentralisation 163 · Le poids de la dette des collectivités territoriales est soutenable 163 · Une épargne élevée, quoiqu'en légère diminution 166 b) Les choix des collectivités territoriales en matière d'emprunt expliquent en partie l'évolution de leurs taux de fiscalité 170 c) Les raisons de ce choix d'un recours limité à l'emprunt 177 · La volonté de certaines collectivités territoriales d'augmenter leur taux d'épargne en 2005 178 · Le cas particulier de la région Poitou-Charentes 181 d) Conclusion : la réduction de l'emprunt et la hausse de la fiscalité ont conduit à une amélioration des soldes d'épargne des régions en 2005 182 2.- Des hausses opportunistes et de précaution 185 a) La suppression envisagée de la part régionale de la taxe professionnelle a pu susciter des comportements opportunistes 185 b) L'impôt de précaution et d'anticipation 187 deuxième partie : causes et conséquences structurelles de la dérive de la fiscalité locale 191 les chiffres clefs des finances locales 191 I.- UN système institutionnel local structurellement dépensier 194 A.- LE MILLEFEUILLE FRANÇAIS 194 1.- La multiplication des acteurs locaux 194 a) La course à la subvention, cause d'illisibilité du système financier local et d'irresponsabilité des élus 196 b) Le marché politique local de la dépense publique, cause d'augmentation de la pression fiscale 198 2.- Les conséquences de l'acte I de la décentralisation 199 a) Une compensation financière rigoureuse et équitable 200 b) Des dépenses nouvelles allant bien au-delà des charges transférées 202 3.- L'abstention de l'État 205 a) Une multiplicité de services de l'État en relation avec les collectivités territoriales 205 b) Pas de pilote dans l'avion ! 208 B.- L'IMPACT DE L'INTERCOMMUNALITÉ 210 1.- Une inflation fiscale indiscutable 211 a) L'impact de l'intercommunalité sur la dépense : l'incomplète substitution entre dépense communale et dépense intercommunale 211 b) L'impact de l'intercommunalité sur la pression fiscale cumulée des communes et des intercommunalités 215 · Le développement de l'intercommunalité à fiscalité additionnelle s'est accompagné d'un alourdissement du poids des impôts locaux 216 · Les effets de la TPU sur la pression fiscale ne pourront être évalués que dans la durée 216 · L'intercommunalité semble avoir entraîné une inflation de la fiscalité affectée 219 · La tentation croissante de recourir à la fiscalité mixte 220 2.- Des facteurs multiples 221 a) L'intercommunalité élargit l'éventail des services publics proposés aux usagers. 221 b) La gestion à deux niveaux, au lieu de favoriser l'apparition d'économies d'échelle, s'accompagne le plus souvent de doublons et d'une augmentation des coûts de structure administrative et de production des services 223 · Ces charges de structure sont d'abord des charges de personnel. 223 · Les redondances dans les structures administratives et l'exercice des compétences ont pu entraîner d'importants surcoûts. 226 c) Le paysage de l'intercommunalité est encore trop compliqué 229 d) En fiscalité additionnelle, l'augmentation du niveau cumulé d'imposition pourrait résulter de la nature même du régime de coopération 232 e) Si la TPU a été conçue dans l'objectif de limiter l'inflation fiscale, sa complexité suscite de nombreuses interrogations quant à ses effets 233 II.- l'alourdissement des dépenses à financer 237 A.- TOUJOURS PLUS DE DÉPENSES LOCALES 238 1.- La dynamique de l'investissement public local et ses conséquences 238 a) Le moteur de l'investissement public en France 238 b) Les conséquences induites sur les budgets locaux 239 2.- Le poids du personnel dans les dépenses de fonctionnement 240 a) Une tendance lourde et inflexible 241 b) Les conséquences lourdes des 35 heures 245 3.- Le choix de dépenser : entre résignation et volontarisme 248 a) La pression citoyenne 248 b) Les choix des élus 251 B.- LE POIDS CROISSANT DES NORMES TECHNIQUES SUR LE BUDGET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 253 1.- Des normes nombreuses, d'une portée juridique variée et coûteuses à appliquer pour les collectivités territoriales 253 a) Des normes nombreuses, d'une origine et d'une portée juridique variée 253 b) Des normes de plus en plus coûteuses 255 2.- Les collectivités territoriales sont largement absentes du processus de normalisation et de réglementation technique 260 a) Le processus de normalisation 260 · La réglementation organisée par les administrations techniques 260 · La normalisation professionnelle 261 b) La faible participation des collectivités locales à l'élaboration des normes 262 · L'insuffisante représentation des collectivités territoriales dans les instances de normalisation 262 · L'insuffisante prise en compte par l'État des préoccupations des collectivités territoriales 264 · La conséquence : des normes s'imposant sans concertation, ni étude d'impact financier 266 III.- Un système de financement favorable à l'impôt 267 A.- LA COMBINAISON DES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES ET DES CHOIX FINANCIERS 267 1.- Les inégalités de richesse entre collectivités 267 2.- Les conséquences du principe d'équilibre budgétaire 268 3.- L'effet de levier des dotations 269 4.- L'arbitrage des collectivités territoriales en faveur de l'autofinancement 271 B.- L'IMPÔT LOCAL INDOLORE... POUR LES COLLECTIVITÉS 272 1.- L'État contributeur à la fiscalité locale et la dégradation du lien fiscal 273 a) Faute d'une réforme de l'assiette, les crises à répétition de la fiscalité locale ont été désamorcées grâce à une accumulation d'allègements financés par l'État 273 b) Conséquences : l'affaiblissement du lien fiscal, des augmentations de taux opportunistes et l'érosion de l'autonomie financière 275 · La détérioration du lien fiscal 275 · L'érosion de l'autonomie financière des collectivités territoriales 282 2.- La superposition du pouvoir de vote des taux sur une même assiette 282 3.- Des interdépendances qui conduisent à une fiscalité excessive 284 Iv.- des conséquences sous-estimées 285 A.- L'IMPACT TRÈS CIBLÉ DE LA FISCALITÉ LOCALE SUR LES MÉNAGES 285 1.- Un impact malaisé à mesurer 286 a) Les impôts payés par les ménages aux collectivités territoriales ne représentent qu'une faible part des prélèvements obligatoires 286 b) La charge pesant sur le contribuable national augmente en raison de la multiplication des allègements décidés par l'État et compensés aux collectivités territoriales 289 c) L'impact des transferts et des prestations versées par les collectivités territoriales sur le pouvoir d'achat des ménages 290 · Le poids des transferts et des prestations versés aux ménages par les collectivités territoriales atténue l'impact de la fiscalité locale sur leur pouvoir d'achat 290 · La fiscalité locale a également un effet redistributif indirect 291 2.- Un prélèvement très inégalement réparti entre les ménages 292 a) Les inégalités géographiques en matière de fiscalité locale 292 b) La multiplication des dégrèvements et des exonérations a abouti à concentrer l'impact de la fiscalité locale sur certaines catégories de ménages 294 B.- POUR LES ENTREPRISES : UN PRÉLÈVEMENT INÉQUITABLE ET UN HANDICAP DE COMPÉTITIVITÉ 297 1.- Le poids du prélèvement local sur les entreprises 297 a) La part non négligeable des APUL dans l'ensemble des prélèvements supportés par les entreprises 297 b) Comparaisons internationales : les singularités françaises 299 · La taxation des investissements à l'échelon local 299 · Collectivités territoriales : un pouvoir étendu de fixation des taux 300 · Le poids élevé de l'impôt local en France, facteur de délocalisation 301 · Les secteurs à forte intensité capitalistique lourdement taxés 302 2.- La répartition inéquitable du poids de la taxe professionnelle 303 a) Un impôt dont le poids n'a cessé d'augmenter en dépit de la suppression de la part salariale de son assiette 303 b) Un impôt dont la charge, inégalement répartie, est faiblement corrélée aux indicateurs traditionnels de la capacité contributive. 304 3.- La taxe professionnelle pèse sur la croissance et l'emploi ; elle handicape la France dans la concurrence internationale 308 a) La taxe professionnelle renchérit le coût des facteurs de production, pénalisant ainsi l'investissement, la croissance et l'emploi 308 b) La taxe professionnelle entraîne des distorsions de concurrence entre entreprises. 309 c) Enfin la taxe professionnelle, spécificité de notre système d'imposition, handicape la France dans la concurrence internationale. 310 troisième partie : quelles perspectives pour la fiscalité locale ? 313 I.- Pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'acte II de la décentralisation 313 A.- UNE COMPENSATION ENTOURÉE DE GARANTIES SANS PRÉCÉDENT POUR DES COLLECTIVITÉS FINANCIÈREMENT SOLIDES 313 1.- Une compensation entourée de garanties sans précédent 313 a) Les principes régissant la compensation 314 · Une compensation intégrale 314 · Une compensation concomitante 315 · Une compensation contrôlée 315 · Une compensation conforme au principe d'autonomie financière 317 b) Les ressources transférées 317 · La TSCA : une ressource dynamique 317 · La TIPP : une ressource fiable 320 2.- Des fondements financiers solides à la veille des transferts de compétences 324 B.- LES TRANSFERTS À VENIR 325 1.- Le transfert des personnels T.O.S. aux régions et aux départements 325 a) Une procédure de transfert en deux temps 326 b) Un transfert intégralement compensé 327 · Les personnels concernés par la compensation 327 · Une compensation intégrale par un transfert de fiscalité à partir du 1er janvier 2006 328 · L'absence d'impact du transfert des TOS en 2005 330 c) Le transfert d'une situation confuse 331 2.- Le transfert des routes nationales aux départements 331 a) La détermination concertée du périmètre des routes transférées et des compensations financières allouées 333 b) La garantie du maintien en bon état des routes par le transfert de tous les personnels de l'équipement concernés 335 c) La possibilité pour les départements de développer le réseau transféré grâce au décroisement des financements 339 3.- Au-delà de l'acte II : la création de la prestation de compensation du handicap 344 a) Une nouvelle prestation sociale dont le surcoût sera intégralement compensé aux départements par la solidarité nationale 346 · Une enveloppe prédéterminée, un calendrier d'élaboration des critères 346 · Trois garanties de maîtrise et de compensation des coûts 349 b) La possibilité offerte aux départements d'engager d'autres actions 351 II.- Comment mieux responsabiliser les décideurs locaux et l'état ? 353 A.- QUELLES RÉFORMES POUR LE SYSTÈME FISCAL LOCAL ? 353 1.- La difficile révision des valeurs locatives cadastrales 353 a) Les limites des opérations périodiques de révision générale 354 b) Quelques pistes envisageables 355 2.- Quelle réforme pour la taxe professionnelle ? 356 a) Une réforme dans la lignée des conclusions du « rapport Fouquet » : 357 · Deux assiettes : valeur ajoutée et valeurs locatives foncières 357 · Deux impératifs : éviter les collectivités perdantes, alléger le prélèvement 358 · Des effets secondaires dommageables 359 b) La seconde catégorie d'options serait ciblée sur les entreprises qui acquittent une cotisation de taxe professionnelle supérieure à 3,5 % de leur valeur ajoutée 360 3.- Faut-il une plus grande spécialisation de la fiscalité locale ? 363 4.- Quels ajustements pour l'intercommunalité ? 368 a) Simplifier le paysage de l'intercommunalité : 368 b) Améliorer notre connaissance de l'intercommunalité : 369 c) Renforcer le contrôle de l'intercommunalité et sa responsabilité démocratique 370 d) Interdire aux groupements à TPU d'avoir recours à la fiscalité mixte 371 B.- QUEL PILOTAGE MACROÉCONOMIQUE POUR LES FINANCES LOCALES ? 373 1.- Faire partager la culture de la maîtrise de la dépense publique 375 a) Les contraintes pesant sur les finances publiques 376 b) La nécessaire prise en compte de ces contraintes par les collectivités territoriales 380 2.- Mettre en place les moyens et les conditions d'une régulation systémique partagée 382 a) Créer des instances de concertation sur l'évolution des finances locales 382 b) Renouer des relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales 387 c) Que l'État, par sa réforme, montre l'exemple 390 d) La notion de collectivité chef de file comporte bien des inconvénients ; le plafonnement des subventions serait plus efficace 392 C.- MESURER LA PERFORMANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 393 1.- Une meilleure communication budgétaire pour plus de transparence et de démocratie locale 394 a) De nombreux progrès ont déjà été réalisés 394 b) Plus de lisibilité et de transparence sont encore à rechercher 397 2.- Des indicateurs de résultat dans un souci de bonne gestion 401 a) Les modalités actuelles d'examen de la gestion des collectivités territoriales sont largement insuffisantes 401 b) Mettre en place des indicateurs de résultats autoconsentis par les collectivités territoriales 405 D.- QUELQUES PISTES DE BONNE GESTION 409 1.- En ce qui concerne les TER 410 2.- En ce qui concerne les SDIS 411 3.- En ce qui concerne l'APA 413 4.- En ce qui concerne le RMI 414 5.- En ce qui concerne les TOS 417 a) La question du temps de travail des TOS 418 · Les dispositions de la « circulaire Lang » du 7 février 2002 418 · L'absence de connaissance précise du temps de travail des TOS 419 · Les collectivités locales disposeront de marges de manœuvre pour accroître le temps de travail des personnels TOS 420 b) La décentralisation des personnels TOS peut permettre aux collectivités territoriales d'exercer plus efficacement leur compétence 421 · La gestion des personnels par la collectivité 421 · Les collectivités territoriales peuvent améliorer la gestion de cette compétence en développant la polyvalence et la mutualisation des personnels, ainsi que l'externalisation de certaines tâches 422 c) Conclusion : les recrutements supplémentaires découleront des décisions - ou de l'absence de décisions - des collectivités territoriales et non d'une sous-dotation des collèges et des lycées en personnel TOS 425 quinze causes d'augmentation des impôts locaux en 2005 427 Propositions de la Commission d'enquête 429 A.- Pour un processus de décentralisation plus confiant 429 B.- Pour un système fiscal local plus responsable 429 C.- Pour un pilotage global des finances locales 430 D.- Pour une obligation de performance 431 EXAMEN DU RAPPORT 433 EXPLICATIONS DE VOTE 435 EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE Socialiste 437 EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE U.D.F. 469 EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE des député-e-s Communistes et républicains 471 Mesdames, messieurs, L'année 2005 s'est ouverte par une vive controverse sur la fiscalité locale. En annonçant, au début janvier, une forte augmentation de leurs impôts directs, vingt régions de métropole prenaient à parti le Gouvernement, accusé de mal compenser les compétences transférées lors de l'acte II de la décentralisation. Lorsque le groupe UMP de l'Assemblée nationale, dès le 2 février, a proposé la création d'une Commission d'enquête, cette initiative a pu être présentée comme une contre-attaque circonstancielle. Pourtant, les deux signataires de la proposition de résolution n° 2051, MM. Pierre Méhaignerie et Bernard Accoyer, mettaient en avant deux préoccupations de fond : éclairer les conditions d'une responsabilité mieux assumée des décideurs et faire le point, aussi, sur les conséquences de la fiscalité locale pour les ménages et les entreprises. L'esprit constructif de la proposition, rapportée en séance publique le 15 février 2005, a convaincu le groupe socialiste de la voter, sans pour autant faire mystère de certains désaccords. Majorité et opposition partageant ainsi l'objectif d'une démarche pluraliste, la Commission se donnait, le 2 mars 2005, un président socialiste, M. Augustin Bonrepaux, la fonction de rapporteur revenant au groupe UMP, en bonne logique institutionnelle. La Commission nouvellement constituée décidait aussitôt de travailler vite, afin de rendre ses conclusions avant la mi-juillet. Elle choisissait également de travailler dans la clarté, et d'ouvrir à la presse ses auditions, afin d'éclairer le débat public. Chacun des trente membres de la Commission, issus de tous les groupes de l'Assemblée nationale, avait conscience de ce que, selon le mot de Bossuet, « Le pire dérèglement de l'esprit est de croire que les choses sont ce qu'on veut qu'elles soient et non ce qu'elles sont en effet. » * * * Pourquoi une Commission d'enquête ? Pour y voir clair. Les citoyens, les contribuables, et les élus eux-mêmes éprouvent le besoin de faire le point et de prendre la mesure des bouleversements liés à l'acte II de la décentralisation. Mais d'abord, une Commission d'enquête au nom de quoi ? Certains exécutifs locaux se sont émus de ce qu'une commission parlementaire fasse porter ses investigations sur des domaines relevant à leurs yeux de la libre administration des collectivités territoriales, constitutionnellement garantie. Il convient naturellement de faire la part du ton très vif du débat politique au début 2005. C'est ainsi que M. Michel Vauzelle, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a pu voir dans votre Commission d'enquête un « tribunal d'inquisition »... Plus étonnant encore est le fait qu'il ait pu oublier son expérience d'ancien Garde des Sceaux au point de déclarer qu'elle n'était « pas conforme à l'esprit de la Constitution et à la liberté de gestion des collectivités locales » (sic). Ces propos, parmi d'autres, reflètent au mieux un malentendu, au pire une conception inquiétante de la décentralisation, qui fait bon marché des dispositions très claires et très précises de la Constitution. La décentralisation ne procède à aucun transfert de souveraineté, ni à l'instauration d'un régime fédéral. Avant de se comparer aux Länder allemands, les régions doivent se souvenir que, même depuis l'acte II de la décentralisation, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui, conformément à l'article 3 de la Constitution, l'exerce notamment par ses représentants, c'est-à-dire par le Parlement. Deux séries de conséquences en découlent, qui touchent aux pouvoirs du Parlement, à l'égard des collectivités territoriales et en matière d'impôt, local ou non. L'article 34 de la Constitution dispose, en son quatorzième alinéa, que la loi votée par le Parlement, « détermine les principes (...) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». En tout état de cause, l'article 72 prend soin de préciser que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Pour être plus étendue dans son champ d'application, avec l'acte II de la décentralisation, la libre administration n'est nullement devenue inconditionnée. Le législateur conserve sa compétence de principe. De surcroît, en matière d'impôt, cette compétence est dotée d'un double fondement constitutionnel. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée », tandis que, selon le sixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». D'où le fait que l'autorisation annuelle de percevoir les impôts figurant en début de loi de finances concerne aussi les impôts affectés aux collectivités territoriales. Donc, le Parlement est pleinement dans son rôle en désignant une Commission d'enquête pour constater la nécessité de la contribution publique que sont les impôts locaux et pour en suivre l'emploi. Pour autant, procéder à une enquête ne signifie en aucune façon remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales. Pour en douter, il faut tout ignorer de l'esprit dans lequel votre Commission a fonctionné. Animée par un « tandem » pluraliste, comprenant des membres actuels ou passés d'exécutifs locaux, comment aurait-elle pu fonctionner dans un sens tendancieux sans parvenir aussitôt à une situation de blocage ? Votre Rapporteur n'a pas souvenir qu'à aucun moment, au cours de leurs échanges empreints...d'une grande franchise, le Président de la Commission d'enquête ou un membre des groupes de l'opposition aient fait état d'une velléité de remise en cause par la majorité du principe de libre administration des collectivités territoriales. De la même façon, la méthodologie retenue n'a jamais cessé d'être consensuelle. Sans renoncer aucunement à leurs convictions, les membres de la Commission partageaient une même curiosité. Il s'est d'ailleurs toujours agi, non pas de donner des leçons aux collectivités, mais de comprendre les mécanismes en œuvre, de prévenir leur dérive, de proposer des solutions mieux adaptées à une meilleure modération fiscale. * * * La Commission d'enquête ne pouvait avoir ni prétention scientifique, ni ambition encyclopédique. Les budgets locaux pour 2005 ont été votés alors qu'elle avait commencé ses travaux. Comment la DGCL aurait-elle pu traiter en quelques semaines les quelque 50 000 budgets concernés ? En tout état de cause, procéder à leur étude systématique autour de quelques thèmes exigerait de longs mois de travail pour des équipes d'économistes rompues à l'exercice. Quant à traiter l'ensemble de la problématique des finances locales et de leur réforme, objet de savants ouvrages, d'articles et de colloques depuis plus d'un quart de siècle, c'eût été illusoire. La Commission a d'emblée choisi de centrer ses investigations sur la compréhension des hausses de taux pour l'année 2005. Ce n'est que dans la mesure où cette compréhension l'exigeait qu'elle a étendu le champ de ses travaux : vers les dépenses, vers les années antérieures et vers les phénomènes de structures liés à la « décentralisation à la française ». Faute de pouvoir prétendre à l'exhaustivité, la Commission a croisé les approches, à la faveur d'auditions, de questionnaires, ainsi que de demandes de contributions écrites. Elle a d'abord procédé à des auditions nombreuses, compte tenu du délai de trois mois et demi entre la première et la dernière. Quarante-sept auditions ont permis de recueillir le point de vue de très nombreux observateurs extérieurs et parties prenantes de la fiscalité locale. Une première série de cinq auditions était destinée à assurer un cadrage général du sujet : des universitaires-chercheurs (MM. Hertzog et Guengant), un économiste, directeur du service des études de Dexia (M. Hoorens), et deux consultants reconnus (MM. Laurent et Klopfer). La deuxième série a porté sur les associations représentatives des collectivités territoriales et de leur établissement de coopération : départements, régions, intercommunalités et communes. La troisième série d'auditions, la plus longue, était destinée à éclairer la commission d'enquête sur les différents transferts de compétences pouvant justifier des hausses de fiscalité : Réseau ferré de France, SNCF, etc. De nombreux responsables d'administrations de l'État ont été entendus : le délégué à l'aménagement du territoire sur les contrats de plan, le directeur des transports terrestres, qui a complété le cycle relatif aux TER, le directeur général des collectivités locales, entendu deux fois par la Commission sans compter plusieurs réunions techniques avec le Rapporteur et le Président, le directeur général des routes, le directeur général des affaires sociales, en particulier à propos de l'APA, du RMI, et de la loi sur le handicap, le directeur de la sécurité civile, pour parler des SDIS, les directeurs du personnel et des affaires financières du ministère de l'Éducation nationale, afin de faire le point sur les TOS. La Commission a décidé en outre de rencontrer des collectivités de tous bords politiques et ayant fait varier, soit très fortement, soit très modérément, leur fiscalité en 2005. La Commission avait décidé des déplacements en province, pour aller à la rencontre des différents échelons de collectivités et des représentants de l'État. Elle s'est rendue le 19 avril 2005 à Montpellier, dans la région qui a augmenté le plus fortement ses impôts ; le 18 mai, durant toute une journée, c'est à Paris, pour des raisons de calendrier, que différentes collectivités alsaciennes ont été entendues, en particulier la région Alsace, qui s'est singularisée par sa modération fiscale en 2005. Les points de vue des collectivités et des représentants de l'État ont été confrontés aux informations recueillies auprès de trois Chambres régionales des Comptes : Languedoc-Roussillon, Alsace et Antilles-Guyane. La Commission a achevé ses travaux en entendant quatre ministres, pour recueillir la position du Gouvernement sur le système fiscal et la compensation des transferts de compétences. Plusieurs fortes séries de questionnaires ont été adressées par la Commission. Les premiers ont, de façon classique, été adressés à des administrations : la DGCL, la Direction générale des impôts, la Direction du budget ou la Direction générale du Trésor et de la politique économique, mais aussi des administrations spécialisées, concernées par des transferts de compétence, comme la Direction générale des affaires sociales. Ils portent sur des éléments d'information statistique, juridique ou économique ; ils sollicitent également les analyses du Gouvernement sur différents phénomènes. Plus originale est la série des quelque 240 questionnaires aux collectivités territoriales. Ils ont été adressés aux régions, aux départements (avec des versions particulières pour le cas de la Corse et de Paris), aux 57 communes chefs-lieux d'agglomérations de plus de 100 000 habitants, aux 14 communautés urbaines et aux 41 communautés d'agglomérations ou de communes regroupant plus de 150 000 habitants. Les questions ont porté sur l'exercice des compétences et sur l'analyse que les collectivités et intercommunalités font de leurs conséquences fiscales. C'est un lourd travail qui leur a été demandé, mais leurs réponses ont constitué une mine d'informations irremplaçable. Votre Rapporteur souhaite remercier les collectivités territoriales et les établissements publics qui ont fait l'effort de jouer le jeu de la clarté des comptes. À l'inverse, le refus de certains exécutifs locaux de répondre, sinon par l'envoi de comptes bruts dépourvus de pertinence, n'en est que plus regrettable lorsque leur président détient des fonctions emblématiques, comme dans le cas du département des Côtes d'Armor. D'autres questionnaires, plus spécialisés, ont été adressés par exemple à des Agences de l'eau, qui ont su répondre dans des délais serrés. En complément, des contributions écrites ont été demandées à des associations représentatives de collectivités territoriales, notamment l'Association des petites villes de France, dont le point de vue a complété les réponses aux questionnaires naturellement tournés vers les grandes communes. Le rapporteur de toute commission d'enquête dispose de pouvoirs d'investigation qui lui sont propres. Ils sont comparables à ceux d'un rapporteur spécial de la Commission des finances. Au cas présent, pour assurer le caractère pluraliste de la démarche, le Président a été associé à ces travaux. Ceux-ci ont porté sur des aspects plus spécialisés, comme la normalisation, avec l'AFNOR, ou le point de vue des entreprises, avec le MEDEF. L'Association « Contribuables associés » a été reçue. Le calendrier ne permettait pas la tenue de l'ensemble de ces auditions en formation plénière. * * * La masse considérable d'informations recueillies - les réponses des collectivités aux questionnaires représentent des mètres cubes de dossiers - permet de croiser les approches : les informations de portée générale, pas toujours assez précises sur l'année 2005, ont été, dans toute la mesure du possible, confirmées, illustrées ou précisées par des éclairages particuliers. Il s'agissait de faire ressortir les grandes tendances, tout en rendant compte de la diversité des situations locales et des choix adoptés. L'abondance et la pertinence des informations recueillies ont conduit votre Rapporteur à présenter un rapport en trois tomes : - le tome I est le rapport d'enquête proprement dit, composé de trois parties, centrées respectivement sur l'année 2005, sur les causes systémiques et les conséquences de la hausse fiscale, et sur les perspectives d'avenir ; - le tome II reprend les procès-verbaux des auditions de la Commission, y compris celles effectuées à Montpellier, soit un total de plus de 70 heures ; - le tome III vient compléter les deux premiers. Il comprend, d'une part, les nombreux tableaux de chiffres détaillant par collectivité ou catégorie de collectivités les développements du tome I, et d'autre part, divers documents remis par les témoins à l'appui de leurs propos durant les auditions. Par la publication de ces informations brutes, le rapport a l'ambition de permettre à chacun de se forger une opinion. Il prolongerait ainsi la démarche de clarté qui a guidé votre Commission d'enquête tout au long de ses travaux. * * * PREMIÈRE PARTIE : ENQUÊTE SUR L'EXPLOSION DE LA FISCALITÉ LOCALE EN 2005 Depuis le mois de janvier, les passions se sont apaisées. Votre Commission d'enquête a pu travailler sereinement. L'enquête montre qu'en 2005, la hausse de la fiscalité n'était nullement inéluctable : ses justifications ne résistent pas à l'examen. Les vraies causes immédiates résident dans le cycle électoral, l'explosion de la dépense et les stratégies de financement. Elles traduisent de libres choix politiques. I.- UNE HAUSSE BRUTALE ET MAL JUSTIFIÉE Revenons sur le choc fiscal du début 2005, « fait générateur » de votre Commission d'enquête. Celle-ci a tenu à prendre la juste mesure de l'événement et à suivre les arguments des exécutifs locaux dans leur évolution. Puis, au moment d'en mesurer la valeur explicative, elle a vu tomber un à un, ces différents arguments : leur effet, en 2005, a été, soit nul, soit marginal. A.- LE « FILM DES ÉVÉNEMENTS » ET LES ARGUMENTS PRÉSENTÉS 1.- La rupture de l'année 2005 Dès les premiers jours de l'année 2005, les contribuables locaux ont appris par les journaux qu'ils seraient fortement mis à contribution. Le ton était donné dès le 11 janvier 2005, avec ce titre du Figaro économie : « impôts locaux : 2005 ouvre un nouveau cycle d'augmentation ». L'Express du 7 février 2005 évoquait « la flambée régionale », Les Échos du 11 avril 2005 annonçant quelques semaines plus tard : « les départements signent la fin de la trêve fiscale ». Les budgets votés confirment qu'après quelques années de relative stabilité de la fiscalité locale, l'année 2005 se caractérise par de fortes augmentations de taux. Pour les régions, la rupture est brutale et quasi-générale. Plus contrastées, les décisions des départements font apparaître quelques fortes augmentations : trente départements ont relevé les taux de leurs impôts directs de 5 % ou plus. Encore faut-il rappeler que ces augmentations s'ajoutent au mouvement spontané de progression des bases. · Fiscalité et budgets régionaux en 2005 : la flambée La quasi-totalité des régions métropolitaines ont, en 2005, vivement augmenté les taux des trois taxes qu'elles perçoivent : taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et taxe professionnelle. On se souvient que la part régionale de la taxe d'habitation a été supprimée en 2000 par l'article 11 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000. Une récapitulation des bases, des taux et des produits de la fiscalité régionale en 2005, ainsi que de leur évolution par rapport à l'année 2004, figure en annexe, en page 7 du tome III du présent rapport. Le tableau ci-joint se borne à retracer l'évolution globale des taux des trois taxes régionales. La hausse globale des taux de la fiscalité des régions de métropole et de la Corse - laquelle n'a pas relevé ses taux - est de 21,1 % (+ 19,9 % hors Île de France), conformes aux annonces des régions dès le mois de janvier. Par-delà les disparités, l'augmentation globale des taux est de 30 % ou plus dans six régions, la palme - revendiquée - revenant au Languedoc-Roussillon. Souvent discrètes, les hausses fiscales ont été, cette année, l'objet d'une active communication dès le stade du projet de budget, certaines régions n'hésitant pas à acheter à cet effet des pages publicitaires dans la presse régionale. ÉVOLUTION DES TAUX DES TROIS TAXES RÉGIONALES EN 2005 Métropole
Source : DGCL En ce qui concerne les bases d'imposition, la croissance est de 2,6 % pour la taxe professionnelle en 2005, comme en 2004. La progression spontanée des bases était sensiblement plus forte au cours des années précédentes : de l'ordre de 4 % à 6 % (avant effet de la suppression en cinq ans, de 1999 à 2003, de la part salaires de la taxe professionnelle). Les bases ont progressé de 3,7 % pour le foncier bâti et de 3,3% pour le foncier non bâti. Par ailleurs, la disparité très forte en matière d'imposition régionale s'est légèrement réduite en 2005 par rapport à 2004 : pour la taxe professionnelle, l'éventail des taux va de 1,38 % à 4,06 %, soit un rapport de 1 à 2,9 (1 à 3,4 en 2004). Pour le foncier bâti, il s'ouvre de 1,07 % à 4,8 %, soit un rapport de 1 à 4,9 (1 à 5 en 2004). La hausse quasi-générale des taux, ajoutée à la dynamique des bases, s'est naturellement traduite par une forte augmentation des produits perçus par les régions. Ainsi que l'a déclaré M. Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, lors de son audition, « la réalité des rentrées fiscales dues aux augmentations de l'année 2005 [est de] 715 millions d'euros pour les régions ». Pour en prendre la juste mesure, rappelons que le produit des impôts directs votés par les régions de métropole s'élève à 3,8 milliards d'euros en 2005, soit 24,9 % de plus qu'aux budgets 2004. C'est donc une augmentation d'un quart de leurs produits d'impôts directs qui a été votée par les régions pour 2005. Ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales lors de son audition du 15 juin 2005 « il faut remonter aux années 1987 et 1989 pour constater d'aussi fortes hausses ». Les régions d'outre-mer se singularisent, puisqu'elles se caractérisent par une stabilité de leurs taux de fiscalité, à l'exception de la Guadeloupe, et par le fort dynamisme de leurs bases, ainsi que le montre le tableau suivant. OUTRE-MER : ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ RÉGIONALE EN 2005 (en millions d'euros)
Source : DGCL Cette flambée de la fiscalité régionale fait suite à une période de relative stabilité. M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, a ainsi remarqué, le 10 mai 2005, que, « entre 2001 et 2004 inclus, une très large majorité de conseils régionaux a choisi de ne pas relever les taux d'imposition, l'augmentation de produit générée par la progression des bases apparaissant suffisante. Aussi les taux d'imposition n'ont-ils progressé que de quelques dixièmes de points durant cette période ». Le tableau ci-après est révélateur de la rupture que constitue l'année 2005 pour la fiscalité régionale. ÉVOLUTION DES TAUX DES QUATRE TAXES RÉGIONALES DEPUIS 1998 Métropole
Source : DGCL Une analyse par région pour l'année 2004 révèle que seules trois d'entre elles, Alsace, Limousin et Nord-Pas-de-Calais avaient augmenté leurs taux en 2004, du reste dans des proportions relativement modestes. La Picardie les a même baissés. Cependant, en dépit de la stabilité des taux, le produit brut des trois taxes avait augmenté en moyenne de 3,4 %, ce qui atteste du dynamisme des bases d'imposition des régions. Si la forte hausse des taux de la fiscalité directe régionale a, à juste titre, retenu l'attention, les régions tirent une part non négligeable de leurs ressources de la fiscalité indirecte. Toutefois, les années récentes ont connu un mouvement d'allègement et de suppression des taxes qui leur sont affectées. Les recettes résultant de la taxe sur le permis de conduire sont ainsi en chute depuis 1998 - de 56 % en 2005 -, et de nombreuses régions renoncent progressivement à cette taxe. Elles n'étaient plus que cinq en métropole à la prélever en 2005, pour une ressource globale d'environ 5 millions d'euros. Quant à la taxe régionale additionnelle aux droits de mutation, elle a été supprimée par la loi de finances pour 1999, la compensation de la perte de recette ayant été intégrée en 2004 dans la dotation globale de fonctionnement. En conséquence, le champ de la fiscalité indirecte des régions s'est fortement contracté, pour ne plus recouvrir, en 2005, que la taxe sur les cartes grises, dont elles fixent le tarif de base par CV. Force est de constater que la flambée de la fiscalité régionale n'a pas seulement affecté les impôts directs, puisque le produit de cette taxe, selon M. Dominique Schmitt, « devrait augmenter de 175 millions d'euros - + 12,7 % - sous l'effet d'un relèvement des tarifs de 12 % en moyenne », ce qui porterait le produit de la taxe à 1 553 millions d'euros en 2005. Quinze régions de métropole sur vingt-deux ont décidé d'augmenter leur tarif de la taxe sur les cartes grises en 2005. Tarif de la taxe régionale sur les cartes grises en 2005
Source : DGCL La brutale augmentation des différentes composantes de la fiscalité régionale a nourri une croissance conséquente des budgets régionaux. Les budgets primitifs des régions de métropole s'élèvent globalement à 18,8 milliards d'euros, en croissance de 2,1 milliards d'euros par rapport à 2004, soit une augmentation de 12,6 %. Hors montée en charge de la compétence apprentissage, la progression est tout de même de 1,4 milliards d'euros, soit 11,3 %1 . Les régions gèrent ainsi plus de 12% du total des dépenses des collectivités territoriales. Leurs dépenses de fonctionnement, qui s'élèvent à 10,1 milliards d'euros, augmentent de 1,2 milliard d'euros (soit +13,8 %) tandis que les dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 8,7 milliards d'euros progressent de 11,3 %. · La hausse de la fiscalité départementale en 2005 : plus modérée, plus concentrée Les départements métropolitains ont également connu en 2005 une poussée de leurs taux de fiscalité de 4,3 %, poussée qui succède à une année de relative stabilité. Ainsi que l'a résumé M. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France lors de son audition, « la pression fiscale départementale moyenne, entre 2002 et 2003, a progressé de 4 % alors qu'elle a été limitée à 1,3 % en 2004 ». Le tableau suivant montre la rupture intervenue en 2002 dans la fiscalité directe départementale. ÉVOLUTION DES TAUX DES QUATRE TAXES DÉPARTEMENTALES DEPUIS 1998 (MÉTROPOLE)
Source : DGCL En 2004 - année électorale - selon les chiffres publiés par la Direction générale des collectivités locales, cinquante-huit départements métropolitains - soit plus des trois cinquièmes - n'avaient pas augmenté leurs taux (la Meuse n'ayant augmenté que le taux de sa taxe professionnelle de 2,5 %). Seuls deux départements les avaient relevés de plus de 8 % : les Bouches-du-Rhône, (avec des hausses respectivement de 12,8 % pour la taxe d'habitation, de 18,4 % pour la taxe sur le foncier bâti et de 19,1 % sur la taxe professionnelle, le taux de la taxe sur le foncier non bâti étant resté inchangé) et la Marne, avec une augmentation uniforme de 8 % de ses quatre taxes directes. Ainsi que l'a rappelé M. Dominique Schmitt, au cours de son audition du 10 mai 2005, « la progression est beaucoup plus modérée en 2004, en dépit du transfert de compétence sur le RMI et de la poursuite du transfert de l'APA, dont la montée en charge est désormais terminée. Les augmentations relevées sont souvent le fait des départements qui n'avaient pas encore augmenté leurs taux en 2002 et 2003 ». Un tableau figurant en annexe, en page 11 du tome III du présent rapport, récapitule l'évolution de l'ensemble des bases, des taux et des produits de la fiscalité départementale en 2005. On observe que vingt-quatre départements métropolitains - ainsi que les quatre départements d'outre mer - n'ont pas augmenté leurs taux de fiscalité directe en 2005 : DÉPARTEMENTS N'AYANT PAS AUGMENTÉ LEUR TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE EN 2005
Source : DGCL Dans quarante et un départements, l'augmentation des taux des quatre taxes n'a pas dépassé 5 % en 2005 : DÉPARTEMENTS AYANT AUGMENTÉ LE TAUX DE LEUR FISCALITÉ DIRECTE
Source : DGCL Vingt-deux départements n'ont pas observé la même modération, augmentant les taux de leurs quatre taxes entre 5 % et 10 % en 2005 : DÉPARTEMENTS AYANT AUGMENTÉ LE TAUX DE LEUR FISCALITÉ DIRECTE
Source : DGCL. Enfin, l'augmentation des taux des quatre taxes est de 10 % ou plus dans huit départements en 2005. DÉPARTEMENTS AYANT AUGMENTÉ LE TAUX DE LEUR FISCALITÉ DIRECTE
Source : DGCL. Par ailleurs, le produit des droits de mutation à titre onéreux a, lui aussi, augmenté fortement ces dernières années, du fait du dynamisme du marché immobilier. Le taux de droit commun applicable aux ventes d'immeubles est fixé, jusqu'au 31 décembre 2005, à 4,89 %. Il se décompose entre un droit départemental de 3,6 % auxquels s'ajoute une taxe communale de 1,2 % et le prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement calculé sur le montant du droit départemental. Ainsi que le reconnaît l'audit commandé au cabinet Ernst & Young par l'Assemblée des départements de France, « les recettes liées aux droits de mutation ont augmenté de 45 % entre 2001 et 2004, soit 1,45 milliard d'euros » à 5,288 milliards d'euros en 2004. M. Claudy Lebreton l'a admis : « il est clair que depuis 5 ans, les droits de mutation représentent pour les départements une ressource extrêmement dynamique », tout en précisant que les différences sont grandes entre les départements en raison de la diversité de situation du marché immobilier local. L'évolution de la fiscalité départementale en 2005 ne se traduit donc pas par une hausse quasi-générale comme pour les régions, la situation des départements étant en effet très contrastée. Toutefois, le sens de l'évolution est également, au niveau global, une hausse des taux de fiscalité. Si plus d'un quart des départements métropolitains ne les ont pas augmentés cette année, un tiers les a relevés de plus de 5 %. Comme pour les régions, la hausse de la fiscalité départementale, dont le produit a été estimé par M. Alain Rousset à 1 059 millions d'euros, a contribué à une augmentation des budgets des départements. Ainsi que l'a déclaré M. Brice Hortefeux, ces derniers « sont en augmentation sensible, de 6 à 7 %, soit un rythme supérieur à celui des années précédentes, exception faite naturellement de l'exercice 2004, marqué par le transfert du RMI, mais néanmoins inférieur à celui observé pour les budgets régionaux ». · Les communes et les groupements : modération fiscale assez générale en 2005 En ce qui concerne les communes et les groupements, la hausse de la fiscalité n'est pas vraiment un sujet en 2005. Ainsi que l'a relevé, au cours de l'audition du 3 mai 2005, M. Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, « les communes et leurs groupements ne sont pas les collectivités qui ont enregistré les plus fortes hausses de taux ou de produits : en 2004, toutes tailles confondues, ils se sont même caractérisés par un ralentissement de la hausse des taux d'imposition », propos confirmés par le tableau suivant.
Source : DGCL. L'analyse des réponses au questionnaire envoyé aux plus grandes villes vient confirmer ces déclarations. En effet, onze communes sur quinze ont choisi de laisser leurs taux inchangés par rapport à 2004, seuls Strasbourg, Valenciennes, Lorient et Calais ayant décidé d'augmenter leurs taux, d'ailleurs dans une proportion toujours inférieure à 2 %. Certaines communes, comme Montreuil, ont certes fortement augmenté leur fiscalité en 2005, comme l'a rapporté le journal Les Échos du 11 avril 2005. Toutefois, non seulement ces hausses s'inscrivent dans des contextes strictement locaux, mais elles ne traduisent aucunement un mouvement de grande ampleur comparable à ceux des régions et des départements. Pour expliquer la sagesse d'ensemble des communes en matière de fiscalité en 2005, M. Philippe Laurent, président de la commission des finances et de la fiscalité locale de l'Association des maires de France, a expliqué le 3 mai 2005 à votre Commission que « premièrement, ce sont évidemment elles qui détiennent les plus gros encours de dette. La chute des taux d'intérêt de ces dernières années a réduit leurs frais financiers. Deuxièmement, avec les intercommunalités, elles sont les premiers bénéficiaires de la taxe professionnelle, dont les bases ont très fortement crû (deux fois plus vite que le PIB), notamment ces dernières années. C'est pourquoi les villes, en particulier les plus grandes d'entre elles, ont pu financer des dépenses en progression plus rapide que la richesse nationale avec une augmentation modérée des taux ». M. Jacques Pélissard a souligné par ailleurs que « dans la période récente, les communes n'ont pas connu de nouveaux transferts massifs de charges ». À compétences égales, la hausse fiscale est moins justifiable, sinon moins justifiée. S'agissant spécifiquement des intercommunalités. M. Marc Censi, président de l'Association des communautés de France, a déclaré lors de son audition du 6 avril 2005 « qu'il n'y a pas eu, globalement, de dérapage de la fiscalité dans le cadre intercommunal », et même, « dans les anciennes structures intercommunales, c'est une remarquable stabilité de la fiscalité globale, sur dix ou douze ans ». Lors de la même audition, M. Charles-Éric Lemaignen, vice-président chargé des affaires financières et fiscales, commentant une étude sur l'évolution de la fiscalité des groupements en 2005, a déclaré que « 54 % des agglomérations étudiées n'envisageaient pas de faire évoluer leur taux de taxe professionnelle ». Cependant, il a reconnu que « si la taxe professionnelle n'a pas été inflationniste, en revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères l'a été très fortement », ce qu'a confirmé M. Dominique Schmitt le 25 mai 2005 : « la TEOM, dont le produit atteint 4 milliards d'euros en 2004, en hausse de 9 %, connaît une progression nettement supérieure à celle des quatre taxes ». La dynamique de la TEOM est même telle, ajoutait-il, que « si l'on y intègre la TEOM, la fiscalité communale devient presque aussi dynamique que celle des départements, puisque sa progression sur sept ans atteint 25,8 %, à comparer aux 27,3 % déjà cités ». Cependant, la forte augmentation de la TEOM n'est pas propre à 2005, puisque cette taxe connaît depuis dix ans une progression soutenue, ainsi que le montre le tableau suivant : 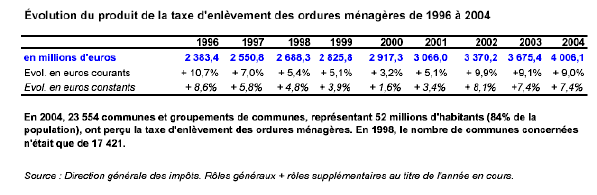 L'analyse des réponses aux questionnaires envoyés aux établissements publics de coopération communale confirme les propos du président Censi. Parmi ceux qui ont renseigné l'évolution de leurs recettes ainsi que les taux applicables, on observe une relative stabilité de la taxe professionnelle unique, exceptée dans les communautés d'agglomération de Marseille et de Clermont, où son taux augmente respectivement de 6,4 % et de 6,5 %. En revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères subit une hausse quasi-générale, à titre d'exemple de 5,77 % et de 6,8 % respectivement dans les communautés d'agglomération de Sophia-Antipolis et de Perpignan. En revanche, elle baisse de 1,7 % dans la communauté d'agglomération de Montpellier. En conclusion de ce rapide panorama de l'évolution de la fiscalité locale en 2005, on retiendra que la hausse des taux a concerné la quasi-totalité des régions, une grande partie des départements - mais à un niveau moindre - et seulement quelques communes et intercommunalités, abstraction faite de la TEOM. De plus, l'ampleur de la hausse de l'année 2005 constitue une véritable rupture avec les années précédentes, marquées par une relative stabilité des impôts locaux. La belle unanimité des décideurs régionaux à imputer cette hausse aux mêmes causes n'est pas l'élément le moins troublant. Tout est-il donc si simple ? Pour comprendre, votre Commission d'enquête a tenu à entendre les explications données par les représentants des exécutifs locaux. 2.- Les arguments des collectivités : une valse à trois temps Les citoyens sont en droit d'exiger de leurs élus qu'ils justifient publiquement leurs décisions, surtout dans une matière qui les touche aussi directement que la fiscalité. Les responsables locaux, dans les rapports de présentation des budgets 2005, dans les débats d'orientation budgétaires et par voie de presse, se sont très largement exprimés sur les raisons qui, selon eux, ont motivé leur décision d'augmenter les taux de la fiscalité locale en 2005. La hausse étant générale et la campagne de presse simultanée, du moins de la part des régions, les arguments avancés par les collectivités territoriales, et repris lors de l'audition de leurs représentants par votre Commission, s'organisent autour d'un petit nombre de thèmes. Ces arguments ont en commun de désigner l'État comme responsable de la hausse des impôts locaux en 2005. Comme on le verra avec les argumentations successives de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la critique de l'acte II de la décentralisation a succédé celle du « désengagement de l'État », l'argument ultime consistant à relativiser l'impact de la fiscalité locale, en particulier régionale. a) L'acte II de la décentralisation et les transferts de charges décidés par l'État Certains décideurs locaux, comme M. Michel Vauzelle, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, n'hésitent pas à parler d'un « impôt Raffarin » pour justifier l'augmentation des taux votée dans leur budget primitif. La plupart se contentent de dénoncer les conséquences de l'acte II de la décentralisation et en particulier les transferts de compétences et les modalités de leur compensation. À ce propos, le discours des collectivités entretient parfois la confusion terminologique entre ce qui résulte d'un transfert de compétence à proprement parler - c'est-à-dire une compétence précédemment exercée par l'Etat que celui-ci décide de transférer aux collectivités territoriales - et les compétences nouvelles que le législateur leur a dévolues. En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les régions se sont vues confier, à partir du 1er janvier 2005, la formation initiale des travailleurs sociaux, les bourses pour la formation initiale des travailleurs sociaux, la formation des professions paramédicales et des sages femmes, les bourses pour la formation initiale des professions paramédicales et l'inventaire du patrimoine culturel. Pour M. Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, dans son « mémorandum en réponse au questionnaire de la commission d'enquête parlementaire sur l'évolution de la fiscalité locale », « les conséquences financières de la loi du 13 août 2004 ont été estimées à l'équivalent de 1,2 point de fiscalité directe. Il s'agissait d'anticiper les coûts organisationnels engendrés par les transferts de charges ». Que les contribuables se rassurent : cette estimation est, somme toute, modeste compte tenu des « conditions calamiteuses de mise en œuvre de la loi dite de « décentralisation » du 13 août 2004 et des initiatives dangereuses prises à l'instigation du Gouvernement en matière de réforme du financement des collectivités territoriales » dont a fait état M. Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, lors de son audition du 19 avril 2005. Le même avait été plus précis encore, dans son rapport pour le débat d'orientations budgétaires du 8 février 2005 : « la loi du 13 août 2004 n'est pas une loi de décentralisation, c'est une loi de délestage de ses charges de l'État sur les collectivités locales. Ce n'est pas davantage une loi relative aux libertés et responsabilités locales, ainsi qu'elle s'intitule. C'est une loi de contraintes locales et d'irresponsabilité gouvernementale ». Comme les régions, les départements mettent en avant les coûts résultant de l'acte II de la décentralisation, avec plus de précision dans la critique. Principale pomme de discorde : le RMI, dont la forte progression, depuis 2003, du nombre d'allocataires a creusé l'écart entre la compensation que verse l'État aux départements et le coût effectif de cette compétence. M. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France a présenté les principaux éléments de ce dossier complexe lors de son audition le 23 mars 2005 : « s'agissant du RMI, le déficit cumulé de l'ensemble des départements, pour 2004, est de 456 millions d'euros. Il résulte d'une progression de 9 % du nombre d'allocataires par rapport à 2003. Ce déficit implique pour les départements un décalage de trésorerie, décalage qui s'est accru au cours des premiers mois de l'année 2005. Or, je rappelle que le droit à compensation des départements demeure calculé sur la base du montant des dépenses exécutées par l'État au titre du RMI en 2003, auquel il convient d'ajouter le surcoût induit par la réforme de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) et la création des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), même si nous avons entendu le Premier ministre annoncer qu'il financerait le dépassement enregistré en 2004, au vu des comptes administratifs 2004 des départements. L'incertitude reste entière sur les modalités de compensation du coût du RMI pour les années suivantes, et sur l'année de référence qui sera retenue pour le calcul du droit à compensation des départements. La loi précise que c'est sur la base des dépenses 2003 que se fait la compensation. Il ne faudrait pas non plus oublier des dépenses secondaires qui n'ont pas été prises en compte dans le périmètre de la compensation, comme celles relatives à la convention passée par les départements avec l'ANPE au sujet des conseillers en insertion sociale et professionnelle. Le montant global de cette « facture » à la charge des départements et non compensée par l'État est de 45 millions d'euros pour l'année 2004». À cette charge s'ajoute celle liée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) qui, pour M. Michel Gaudy - entendu le 19 avril à Montpellier, est dans l'Hérault « la première cause de dépenses supplémentaires [...] puisque l'on est passé de 9 millions d'euros de PSD en 2002 à 89 millions pour l'APA en 2005 ». Faut-il rappeler que l'APA, antérieure à l'acte II de la décentralisation, ne constitue pas, à proprement parler, un transfert de compétence puisque les départements avaient auparavant la charge de la PSD, la Prestation spécifique de dépendance ? L'APA est bien, pour les départements, l'extension d'une compétence préexistante, au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'en reste pas moins, a souligné M. Claudy Lebreton, que, « en ce qui concerne les dépenses au titre de l'APA, elles ont doublé entre 2002 et 2004, passant de l,8 milliard à 3,6 milliards d'euros. La charge nette, pour les départements, est passée de 937 millions d'euros à 2,29 milliards d'euros. Quant à la compensation versée par l'État, via le fonds de financement de l'APA, le FFAPA, elle est passée de 48 % en 2002 à 36,4 % en 2004. Ces chiffres permettent de mieux apprécier quelles peuvent être les difficultés financières de l'ensemble des départements. Il faut savoir que le nombre de personnes de plus de quatre-vingt-cinq ans devrait doubler d'ici à 2025 et que les bénéficiaires de l'APA sont très inégalement répartis entre les départements ». Enfin, les départements n'ont pas manqué d'invoquer les charges liées aux services départementaux d'incendie et de secours. M. Claudy Lebreton a rappelé que « les SDIS représentent au total 1,49 milliard de contributions, dont, en moyenne, 48,5 % de ce coût à la charge de départements ». M. Louis de Broissia, président du conseil général de la Côte d'Or, a précisé quant à lui, le même jour, que : « dans un département moyen comme le mien, le transfert progressif de la charge du SDIS [des communes aux départements] d'ici au 1er janvier 2008 représente chaque année quatre points de pression fiscale. Les charges liées au SDIS représentent donc 11,6 points de fiscalité depuis l'application de la loi relative à la démocratie de proximité ». De plus, les départements devront assumer la décision du législateur, d'accorder une prime de fidélité et de reconnaissance, analogue à une retraite par capitalisation, aux sapeurs-pompiers volontaires. Lors de l'examen de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, a rappelé M. Claudy Lebreton, « l'État a estimé que la prime de fidélité et de reconnaissance, en fonctionnement normal (puisqu'il y aura une montée en charge progressive) et en année pleine, coûterait 60 millions d'euros par an. Un fonds géré notamment par une entreprise spécialisée sur ce sujet sera alimenté par les départements et par l'État. La participation de l'État s'élève à 20 millions d'euros cette année. Elle sera de 30 millions d'euros l'année prochaine. Il restera donc 30 millions à la charge des départements ». Régions comme départements se retrouvent pour dénoncer le flou qui aurait, à leurs yeux, entouré le transfert des charges découlant de l'acte II de la décentralisation. Ainsi que le remarque M. Martin Malvy dans son mémorandum : « la région Midi-Pyrénées est extrêmement inquiète des conséquences à venir de la loi du 13 août 2004. Nos appréhensions de départ ont été depuis confirmées par la mise en œuvre chaotique de la loi (non-publication des décrets d'application, absence de données chiffrées préalables à la signature des conventions de transferts de personnels, refus d'un audit contradictoire, absence de réelle concertation avec les services de l'État... ». Quant à M. Alain Rousset, président de l'association des régions de France et du conseil général d'Aquitaine, il a déclaré lors de son audition du 30 mars 2005 : « l'État décide d'augmenter le montant des bourses versées aux étudiants après le transfert de la compétence, mais aucune indication n'est donnée sur le montant de la compensation. Le financement des formations paramédicales était inclus dans le budget global des hôpitaux, lesquels sont dès lors incapables d'évaluer le montant qui doit être transféré. La caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) n'est pas capable, actuellement, d'individualiser le montant de ces formations, auxquelles elle contribuerait ». Enfin, s'agissant du transfert des personnels techniciens et ouvriers de service (TOS) de l'éducation nationale, effectif à partir du 1er janvier 2006, M. Georges Frêche a déclaré: « nous sommes maintenus dans la méconnaissance totale des dispositions exactes à venir [...]. C'est peu dire que l'on avance dans le brouillard ». Le manque d'information, interprété comme le signe de transferts mal préparés, voire improvisés, a également été mis en avant par Mme Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidente chargée des finances de la région Île-de-France, s'exprimant en particulier sur le Syndicat des transports d'Île de France, le 8 juin 2005, devant le Président et le Rapporteur de la Commission d'enquête. Au-delà du défaut ou du retard de l'information, c'est naturellement l'insuffisance des diverses compensations qui est critiquée. En ce qui concerne les TOS, M. Claudy Lebreton a fait ses calculs : « on dénombre pour les départements 43 770 agents TOS dans les collèges publics, soit 42 590 TOS en équivalent temps plein, hors contrats aidés. Sachant que le salaire moyen annuel d'un TOS s'élève à 19 300 euros, nous arrivons à une charge globale de 845 millions d'euros, à laquelle il convient d'ajouter 128 millions d'euros de charges sociales ainsi que d'autres charges, telles que les crédits de suppléance, évalués à 31 millions d'euros, soit un total de 1 milliard d'euros. Des incertitudes demeurent sur plusieurs aspects comme le transfert des personnels sous contrats emplois solidarité (CES) ou contrats emplois consolidés (CEC), les conséquences du passage aux cotisations de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) pour les TOS qui intégreront la fonction publique territoriale, ou l'incidence du passage au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale qui est en moyenne 2 fois et demie supérieur au régime indemnitaire servi pour les mêmes cadres d'emploi dans la fonction publique d'État, sans oublier les besoins en personnels de gestion que suscitera le transfert des TOS, notamment au sein des directions des ressources humaines ». M. Bernard Cazeau, président du conseil général de Dordogne, a précisé quant à lui lors de son audition du 23 mars 2005 : « la difficulté principale à laquelle nous sommes confrontés est l'insuffisante compensation des charges patronales ». Enfin, certaines collectivités, s'exprimant en début d'année, craignaient de devoir recourir à des recrutements massifs, les effectifs de TOS leur semblant en nombre insuffisant pour assurer un fonctionnement correct des collèges et des lycées. Le rapport de M. Georges Frêche pour le débat d'orientations budgétaires de la région Languedoc-Roussillon relève ainsi que « le gouvernement va donc transférer à l'euro près une enveloppe budgétaire de misère, qui est aujourd'hui sous-évaluée de l'ordre de 45 % selon les paramètres retenus, soit compte tenu de la masse salariale estimée, 15 points de fiscalité ». Quant à M. Alain Rousset, il s'est placé sur le terrain de la « pression citoyenne » : « comment vais-je résister aux parents d'élèves qui vont venir me dire qu'il manque deux postes au lycée de Bazas ? Comment vais-je résister aux organisations syndicales » ? Dans le même ordre d'idées, si les compensations sont jugées insuffisantes, c'est aussi au nom des recrutements futurs à prévoir pour assurer les compétences transférées, pas seulement en ce qui concerne les TOS. Ainsi que l'a déclaré M. Alain Rousset : « le Gouvernement souhaite calculer le transfert des ressources sur la base des trois dernières années. Or, nous sommes tous d'accord pour dire que nous manquons de personnel d'accompagnement des personnes âgées, de travailleurs sociaux, d'infirmières, d'aides-soignantes ». De même s'agissant de la compensation pour le transfert des routes, suffira-t-elle si, ainsi que l'a déclaré M. Bernard Cazeau, le 23 mars 2005, « l'état de la voirie transférée est extrêmement dégradé », pointant par là l'évaluation trop parcimonieuse par l'État des dépenses d'investissement nécessaires dans ce domaine. De manière générale, certains départements doutent du respect des principes constitutionnels dans les transferts à venir, à l'image de M. Vincent Éblé, président du conseil général de Seine et Marne, dans son rapport de présentation pour le budget 2005 : « plusieurs autres transferts de compétences suscitent d'ores et déjà l'inquiétude et sont de nature à s'interroger sur le respect des engagements constitutionnels ». Cette inquiétude est d'autant plus de mise, ainsi que le rappelle M. Martin Malvy dans le rapport de présentation du budget 2005, que « les expériences de transfert de compétence en matière de lycées ou de transports régionaux de voyageurs nous ont déjà instruits ! » En somme, comme lors de l'acte I de la décentralisation, l'État transférerait des équipements en mauvais état ou des moyens qui ne sont pas au niveau des missions nouvellement confiées aux collectivités. Il est accusé de leur transférer sa pénurie. Les craintes d'une compensation insuffisante apparaissent d'autant plus fondées aux collectivités territoriales que le choix a été fait d'une compensation par un transfert d'une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Ainsi que l'a déclaré le 30 mars 2005 M. Alain Rousset : « la TIPP n'est pas une ressource dynamique, et en tout cas, elle ne l'est pas au point de faire face à la montée en charge des besoins d'infirmières, d'aides soignantes, de personnels permettant d'accompagner les personnes âgées ». En effet, « depuis plusieurs années, elle est devenue presque immobile, pour des raisons dont il faut d'ailleurs se réjouir : la sécurité routière, la baisse de la consommation d'essence par les automobiles, le développement des transports en commun ». À ce propos, M. Michel Mercier a d'ailleurs fait remarquer le 10 mai 2005 que : « dans le communiqué de Bercy sur les recettes fiscales de l'année, tout augmente, sauf la TIPP qui baisse de 1,4 %. La TIPP n'a rien à voir avec le RMI, et si on choisit une recette qui baisse pour financer une dépense qui monte, on peut toujours courir ! ». Pour M. Georges Frêche, le 19 avril 2005 à Montpellier : « c'est donc un marché de dupes qui est imposé aux régions, dont les ressources seraient liées au développement de l'utilisation de l'automobile alors qu'elles ont compétence en matière de transports ferroviaires et s'investissent dans l'aménagement durable de leur territoire ». Enfin, les collectivités territoriales redoutent les conséquences de la future prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Comme l'a déclaré M. Michel Gaudy : « à partir de 2006, il nous faudra faire face aux conséquences de l'application de la loi sur le handicap qui ne figure pas dans votre questionnaire mais qui aura un impact très fort sur les finances départementales. C'est en quelque sorte une seconde APA qui se profile là, et nous estimons à 40 millions d'euros notre charge à ce titre en 2006 ». Pour M. Michel Mercier, « compte tenu de la façon dont la nouvelle loi organise la compensation par l'État et l'octroi de l'allocation de compensation, les demandeurs étant membres de la commission qui organise les choses, ça va être un sacré chantier, peut-être le plus difficile, car le côté affectif est bien plus lourd encore que pour les personnes âgées ou exclues. S'il y a un vrai souci pour demain, c'est celui-là ». Enfin, le président de l'Assemblée des départements de France, M. Claudy Lebreton, a tenté une première synthèse : « s'agissant du financement de l'accueil des personnes handicapées, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées s'appliquant à compter du 1er janvier, nous avons commencé un travail estimatif : dans les comptes administratifs 2002 de soixante-dix-huit départements, les dépenses au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, représentaient 700 millions d'euros. Pour le financement de la prestation de compensation du handicap (PCH), nous avons estimé, par extrapolation, qu'il faudra prévoir 1,8 milliard d'euros dès 2006. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dispose de 2 milliards d'euros pour financer, à hauteur de 40 %, l'APA et le reste, notamment la PCH. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a, dans une intervention, souligné les difficultés qui seront les siennes pour permettre aux départements d'assumer totalement cette charge financière ». Intervenant deux mois plus tard, le 26 mai 2005, M. Philippe Lavaud a évalué à « 14 points de pression fiscale supplémentaires » la charge nette de financement de la PCH pour le budget du département de la Charente, sur la base d'« hypothèses plutôt optimistes ». Le contribuable a de quoi s'inquiéter. b) Le « désengagement de l'État » D'abord centré sur l'acte II de la décentralisation, l'argumentaire s'est enrichi. Pour M. Alain Rousset : « la cause principale de l'augmentation de la fiscalité locale est le désengagement de l'État en 2003, 2004 et 2005 des politiques partagée avec les régions », M. Jean-Paul Huchon, président de la région Île de France, ainsi que le rapporte la Tribune du 28 janvier 2005, n'hésitant pas, quant à lui, à fustiger « le désengagement brutal de l'État ». De l'avis des régions, l'État n'aurait pas respecté ses engagements au titre des contrats de plan État-régions 2000-2006, obligeant ainsi les régions, soucieuses de limiter le retard pris dans l'exécution des projets - voire leur abandon pur et simple - à contribuer au financement en lieu et place de l'État. Ainsi que l'a déclaré M. Alain Rousset : « la plupart des régions ont dû consentir, l'année dernière, des avances de trésorerie à l'État, correspondant à sa propre part dans le financement des travaux qu'il a lui-même commandés [...] Si nous n'avions pas consenti ces avances, la conséquence en eût été l'arrêt de beaucoup de chantiers. Ces crédits ne sont toujours pas remboursés à ce jour ». La région Bretagne, ainsi que l'indique le rapport du président de son conseil régional pour le débat d'orientations budgétaires 2005, a été contrainte, « sur certaines lignes, pour répondre aux fortes attentes de l'économie bretonne, à intervenir dans des proportions deux à dix fois supérieure à ce que fait l'État ». De plus, le « désengagement de l'État » allégué par les collectivités territoriales serait loin de se limiter aux contrats de plan. Non seulement les collectivités territoriales seraient contraintes d'intervenir dans les domaines de compétences mais également, de plus en plus, dans les domaines de compétence propres de l'État. Ainsi que l'a rappelé M. Alain Rousset, les régions assument, plus que les autres collectivités, des compétences partagées avec l'État, particulièrement en matière de développement économique, de formation professionnelle ou d'infrastructures. « Or, nous assistons depuis au moins deux ans à un retrait systématique de l'État de ces compétences partagées, mais on peut aussi dire de ses propres compétences, car celles-ci ne sont aucunement transférées dans le cadre de la décentralisation ». M. Jean-Paul Huchon, lors de son audition du 30 mars 2005, a déclaré : « j'ai fait le calcul du désengagement de l'État dans les seuls domaines des compétences que l'État exerce en partenariat avec la région. Le total est de 383,3 millions d'euros » (montant rectifié à 393,3 millions d'euros par Mme de La Gontrie, lors de son audition par le Président et le Rapporteur, le 8 juin 2005). Le président de la région Midi-Pyrénées invoque aussi les conséquences du « désengagement de l'État » « qu'il s'agisse de l'action sociale, de la culture, de la formation professionnelle ou de l'action économique, l'État baisse ses taux d'intervention, supprime sa participation ou se retire des dispositifs pourtant négociés par le passé avec les régions ». En conséquence, « à moins de renoncer à ces politiques - ce que la majorité actuelle ne souhaite pas faire - les régions doivent compenser au moins en partie la défaillance de l'État ». Dans sa situation particulière, la région Midi-Pyrénées a évalué à 11,39 millions d'euros, soit 6,33 points de fiscalité, l'effort supplémentaire en 2005. De plus, M. Alain Rousset a souligné que, de plus en plus, « l'État demande aux régions d'intervenir dans ses compétences propres. S'agissant des TGV, il leur demande par exemple de financer non seulement les études mais aussi les travaux. Il leur demande en outre de consentir aux autres collectivités territoriales les avances des crédits d'études et des crédits d'investissement. Il demande même à l'Aquitaine d'avancer les crédits européens, pour plusieurs millions d'euros ». Le président de la région Aquitaine pose alors la question « est-ce que les régions sont compétentes pour financer le TGV ? Mais si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas de TGV ». L'État solliciterait en effet les collectivités territoriales pour contribuer au financement d'autres politiques nationales, notamment dans le domaine de l'emploi. Ainsi que l'a déclaré M. Claudy Lebreton, « les bénéficiaires du contrat d'avenir créé dans le cadre du plan de cohésion sociale toucheront une rémunération brute mensuelle de 857 euros pendant trois ans, soit 957 euros avec les charges. Elle sera financée par une aide dégressive de l'État atteignant 398,52 euros par mois la première année, par une participation progressive de l'employeur partant de 132 euros pas mois la première année, et par le versement obligatoire à taux plein du RMI par le département, soit 425,40 euros par mois pendant toute la durée du contrat. Or, je rappelle que la moyenne nationale de l'allocation RMI réellement versée est de 270 euros par mois. Avec les contrats d'avenir, la charge supplémentaire, pour les départements, sera de 1 850 euros par an. Si l'on envisage la signature 250 000 contrats d'avenir par an pour atteindre l'objectif d'1 million de contrats, un calcul simple permet d'estimer la charge supplémentaire que cela représentera pour nos départements ». Enfin, ces dépenses régionales se caractérisent par un fort dynamisme alors que la ressource transférée -la TIPP - ne l'est pas. Le rapport du président pour le débat d'orientations budgétaires pour 2005 de la région Languedoc-Roussillon observe donc que « cet effet de ciseau devra être compensé par la région sur son budget de fonctionnement, donc exclusivement par recours à la fiscalité ». En effet, le « désengagement de l'État » (hors contrat de plan) ainsi que les charges liées aux divers transferts de compétences correspondent à des dépenses qui, s'imputant sur la section de fonctionnement des budgets des régions et des départements, ne peuvent donc être financées que par la fiscalité. Ce recours à la fiscalité est d'autant plus nécessaire, ainsi que le remarque le rapport du président pour le débat d'orientations budgétaires de la région Bretagne, que l'évolution des dotations telle qu'elle est prévue par le contrat de croissance « sera notoirement insuffisante pour couvrir l'évolution très dynamique des dépenses de fonctionnement transférées aux régions ». c) L'argument du faible poids de la fiscalité régionale Les collectivités territoriales et les régions en particulier, ayant plaidé la culpabilité de l'État, ont en outre invoqué les circonstances atténuantes. Le débat devrait être relativisé, eu égard au faible poids des impôts régionaux dans la fiscalité locale. L'importance de la hausse fiscale devrait, a-t-on dit à la Commission d'enquête, être mesurée à l'aune de son incidence sur le pouvoir d'achat des ménages, incidence dont l'unité de compte pouvait être la place de cinéma ou le paquet de cigarettes. Ainsi que l'a déclaré M. Alain Rousset, le 30 mars 2005 « la fiscalité régionale représente 5 % de la feuille d'impôt local. Exprimer les augmentations en pourcentage ne veut strictement rien dire. Une augmentation de 20 % de la fiscalité régionale équivaut à une augmentation de 4 % décidée par le département, et de 2% par une commune ». Au cours de la même audition, Mme Ségolène Royal a ajouté : « quand un conseil régional augmente la fiscalité de dix euros par habitant, cela revient à des taux d'augmentation qui se situent entre 30 et 50 % alors que des taux d'augmentation qui se situent entre 8 % et 15 % correspondent dans certains départements à une contribution par habitant trois fois plus élevée ». Rappelons que le levier fiscal des régions est en effet limité, singulièrement depuis les allègements des années 1999-2001. Les produits de la fiscalité régionale ne représentent qu'environ 30 % de leurs ressources contre plus de 50 % pour les autres collectivités. À côté de l'impôt sur le foncier non bâti, qui ne représente qu'un produit dérisoire, les régions ne disposent plus que de deux impôts directs : la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle. La faiblesse de leur levier fiscal a été aggravée par les allègements des années 1999 et 2000. La part régionale des droits de mutation à titre onéreux a été supprimée en 1999, de même que la part régionale de la taxe d'habitation en 2000 ainsi de la part salaire de la taxe professionnelle. En conséquence, comme l'a rappelé M. Robert Hertzog : « plus la part de la fiscalité dans les ressources totales est faible, plus il vous faudra en augmenter le taux pour compenser l'alourdissement des charges pesant sur l'ensemble ». Or, de surcroît, il n'a pas échappé aux conseils régionaux que « la suppression de la part régionale de la TP semble acquise », ainsi que le note le rapport du président pour le débat d'orientations budgétaires de la région Languedoc-Roussillon. Cette perspective signifierait la perte d'une ressource fiscale dynamique et modulable, sans qu'aucune information ne leur ait été donnée sur son remplacement. A par ailleurs été évoquée la suppression de la taxe sur le foncier non bâti. L'impact limité de la hausse régionale sur les ménages est donc martelé par les exécutifs régionaux. Pour M. Georges Frêche, s'agissant de la hausse de près de 80 % de la taxe foncière : « payer l'équivalent de quelques paquets de cigarettes ou de quelques places de cinéma en plus n'est donc pas dramatique pour les propriétaires ». En Midi-Pyrénées, ainsi que l'écrit M. Martin Malvy dans son mémorandum : « le contribuable ménage sera sollicité pour exactement 8,42 euros, soit 0,70 centime d'euros par mois ». Enfin, dans le rapport de présentation sur le budget primitif 2005 de la région Centre, on trouve même des exemples chiffrés afin d'illustrer le peu d'impact de la hausse de la fiscalité sur les ménages. Il peut même arriver aux collectivités territoriales de se défausser les unes sur les autres du poids de la fiscalité locale. Par exemple, s'agissant de la hausse de la taxe professionnelle qui pèse sur les entreprises, la région Aquitaine, par la voix de son président dans une lettre adressé au président de votre Commission en date du 8 avril 2005, affirme que « ce n'est pas la part régionale de la taxe professionnelle qui grève leurs résultat » mais celle des autres collectivités, puisque la part régionale est très réduite. On remarque d'ailleurs que les régions sont beaucoup plus nombreuses à invoquer l'impact - faible - sur les ménages que celui sur les entreprises. Il est vrai que les personnes morales, pour être contribuables, ne sont pas pour autant citoyens ni électeurs. En conclusion, peu nombreuses sont les collectivités territoriales qui se reconnaissent la moindre part de responsabilité dans la hausse de leur fiscalité en 2005. Parmi celles-ci, le département du Rhône, présidé par M. Michel Mercier :« Il y a eu certes des augmentations dues à notre propre action, comme pour le périphérique de Lyon, dont le péage ne nous rembourse que le milliard de francs que nous avons emprunté sur les 6 milliards de francs du coût total ». De même, M. Jean-Yves Chamard reconnaît que les problèmes financiers du Futuroscope ont pesé sur le budget du département suite à sa recapitalisation et à la division de son loyer par deux. Pour les autres, un ton catégorique est de mise. Ainsi, Mme Ségolène Royal a écrit dans une lettre adressée au président de votre Commission en date du 8 avril 2005 : « la hausse de la fiscalité a été rendue nécessaire pour pouvoir financer les transferts de compétence et le désengagement de l'État ». Elle a de plus déclaré, lors de son audition du 30 mars 2005, que « l'augmentation de 6 euros par habitant correspond en effet, à l'euro près, à une augmentation des charges due aux transferts en provenance de l'État ». De fait, « cela signifie que toutes les dépenses nouvelles ont été financées par des économies ou des redéploiements ». De même, selon M. Alain Le Vern, président du conseil régional de Haute Normandie, dans un courrier adressé au président de votre Commission en date du 19 avril 2005, « l'augmentation de la pression fiscale à laquelle la région a dû se résoudre pour 2005 est exclusivement destinée à financer les conséquences des transferts de charges résultant de la loi du 13 août 2004 et de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ». Pour M. Pascal Perrineau, directeur du Centre d'étude la vie politique française : « aujourd'hui, tout le monde se renvoie la responsabilité de cette hausse : l'impôt devient un enjeu électoral ! Par pitié, arrêtons de dire : c'est pas moi, c'est l'autre comme dans une cour d'école »2 . C'est pourquoi, afin de déterminer les causes de la flambée de la fiscalité locale en 2005, il convient d'examiner le bien-fondé de ces différents arguments. B.- IL N'Y AVAIT PAS DE FATALITÉ À LA HAUSSE DES TAUX Ayant entendu les arguments des collectivités, votre Commission les a soumis à une enquête approfondie. Elle a constaté que ni l'acte II de la décentralisation, ni un prétendu « désengagement de l'État », ni même les transferts antérieurement décidés ne sauraient expliquer l'exceptionnelle explosion des taux en 2005. Un tableau présentant une évaluation des charges transférées, par catégorie de collectivités territoriales, figure en page 19 du tome III du présent rapport. 1.- L'augmentation de la fiscalité ne saurait être justifiée par les compétences transférées en 2005 Certaines régions affirment haut et fort que les hausses d'impôts locaux votées en 2005 ont été rendues nécessaires par les transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi peut-on lire dans le document de présentation au public du budget 2005 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), accessible sur Internet, que « ce nouvel exercice budgétaire doit prendre en compte la décentralisation - maladroite - aujourd'hui imposée aux régions. Les premiers transferts de compétences et les charges consécutives à la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004 [...] ont ainsi amené la région à présenter un amendement au budget pour financer les bourses des étudiants des formations sanitaires et sociales (6,724 millions d'euros, plus de la moitié de l'augmentation de 11 millions d'euros du chapitre formation de ce nouvel exercice !). D'où une hausse de la fiscalité régionale du budget 2005 à hauteur de 30 %. » La démonstration est pour le moins rapide. L'impact financier des transferts 2005, qui sont peu nombreux, est en effet modeste (ils représentent, selon la DGCL, 0,3 % du budget des départements et 2,5 % du budget des régions) et la hausse des budgets des collectivités concernées va très au-delà de l'effet brut que l'on pourrait leur imputer. À titre d'exemple, la hausse de la fiscalité directe en région PACA, qui correspond à une recette supplémentaire de 77 millions d'euros, ne saurait s'expliquer par les compétences transférées en 2005 qui représentent un montant d'environ 23 millions d'euros pour la région. Surtout, la région omet de préciser que les compétences transférées en 2005 font l'objet d'une compensation intégrale d'un même montant et que les 6,724 millions d'euros de « charges » supplémentaires mentionnées au titre du financement des bourses des étudiants des formations sanitaires et sociales correspondent très précisément au montant provisionnel de la compensation que l'Etat doit verser à la région en 2005 au titre du transfert de cette compétence. a) Des transferts peu nombreux et bien compensés Le produit de la fiscalité directe, voté par la région Languedoc-Roussillon en 2005, est en augmentation de 85,6 % par rapport à 2004. Interrogé le 19 avril dernier sur la proportion de cette augmentation qui serait imputable à l'acte II de la décentralisation, M. Georges Frêche, président du conseil régional, a répondu : « pour cette année, des broutilles, puisque la décentralisation sera pour 2006 avec, en particulier, le transfert des TOS (...). Nous n'avons cette année que des bribes de charges nouvelles décentralisées. » En effet, ont été transférées aux régions, à compter du 1er janvier 2005, les seules compétences suivantes (le dossier détaillé de la CCEC figure en page 25 du tome III du présent rapport) : - la formation des travailleurs sociaux ; - les aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux ; - le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes3 ; - les aides aux étudiants des instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes ; - le financement de l'inventaire général du patrimoine culturel ; - les lycées internationaux et établissements publics nationaux d'enseignement agricole ; - le syndicat des transports d'Île-de-France4. Parallèlement, les seules compétences transférées aux départements en 2005 au titre de la loi du 13 août 2004 sont les suivantes (le dossier détaillé de la CCEC figure en page 45 du tome III du présent rapport) : - le fonds d'aide aux jeunes (FAJ) ; - la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées consistant à transférer les crédits de fonctionnement afférents au financement des centres locaux d'information et de coordination (CLIC) ; - le fonds de solidarité pour le logement (FSL) auquel sont associés les fonds eau-énergie ; - les conventions de restauration ; - les crédits d'intervention dédiés à la conservation du patrimoine rural non protégé. · Des transferts bien compensés Conformément aux dispositions constitutionnelles et organiques, ce transfert de compétences s'accompagne d'une compensation qui est annoncée : - intégrale, puisque les ressources transférées seront équivalentes aux dépenses, directes et indirectes, effectuées par l'État au titre des compétences transférées ; - concomitante, puisque les transferts de ressources s'effectuent au rythme des transferts de compétences ; - contrôlée, puisque le montant des accroissements de charges résultant de ces transferts sera constaté par arrêté interministériel, après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) ; - et conforme au principe d'autonomie financière, puisqu'elle s'opérera à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature. On notera en particulier, qu'à la différence des transferts antérieurs, la compensation est définie de manière dynamique, résultant non pas d'un chiffrage instantané au moment de la décision, mais d'une analyse contradictoire des situations. Il n'est pas niable que la qualité de la méthode s'accompagne ainsi d'une incertitude sur les chiffres définitifs plutôt que sur leur correspondance effective à la charge. Conformément à ces principes, l'article 52 de la loi de finances pour 2005 attribue aux régions et aux départements respectivement une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) afin de financer les transferts intervenant en 2005. Ces fractions de tarif ou de taux ont été calculées de telle sorte que, appliquées sur la base nationale 2004 des impôts précités, elles permettent la détermination d'un produit couvrant l'estimation provisoire des charges transférée, c'est à dire 397,8 millions d'euros pour les régions et 126,6 millions d'euros pour les départements. Ces fractions ont ensuite été réparties entre chaque région et chaque département en fonction d'une clé de répartition permettant le maintien d'un lien entre la collectivité et la ressource transférée. Chaque région se voit donc attribuer un pourcentage de tarif de la TIPP qui correspond au rapport entre le montant de son droit à compensation et celui de l'ensemble des régions. De même, chaque département se voit attribuer un pourcentage de taux de la TSCA qui correspond au rapport entre son droit à compensation et celui de l'ensemble des départements. Chaque année, les départements et régions percevront le montant obtenu par application des ces fractions de taux ou de tarif à l'assiette nationale des impôts correspondants. Le droit à compensation provisionnel de chaque région, pour l'année 2005 est précisé dans le tableau ci-joint. Celui des départements figure en annexe, dans le tome III du présent rapport. 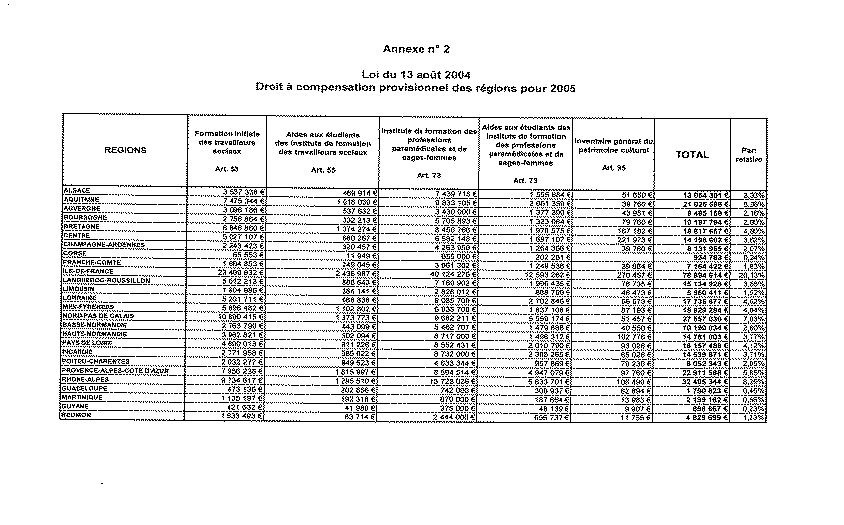 Ces montants sont évaluatifs et provisoires. Le montant définitif du droit à compensation doit être constaté, dans le courant de l'année 2005, par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et du Budget pris après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC). La loi de finances devra alors, le cas échéant, modifier les fractions de tarifs de TIPP et de taux de TSCA, afin de tenir compte du montant définitif des droits à compensation et de l'assiette 2004 définitivement constatée pour chacune de deux taxes. Si le montant versé aux départements et aux régions, obtenu par application des fractions de taux et de tarif aux assiettes nationales des deux taxes concernées, s'avérait inférieur à leur droit à compensation, il appartiendrait à l'Etat de prévoir une compensation supplémentaire destinée à maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait aux compétences avant leur transfert. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi du 13 août 2004, les collèges et les lycées à sections internationales et le lycée et collège d'État de Font-Romeu ont été respectivement transférés aux départements et aux régions à compter du 1er janvier 2005. Les départements concernés par ce transfert sont l'Ain, les Alpes-maritimes, les Pyrénées-orientales, le Bas-Rhin, les Yvelines et les Hauts-de-Seine et les régions sont l'Alsace, l'Île-de-France, le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes. La compensation financière provisionnelle afférente à ce transfert a été prise en considération, dans le calcul de la DGD revenant aux départements et aux régions concernés en 2005, conformément aux dispositions du VI de l'article 121 de la loi du 13 août 2004. Toutes les compétences transférées en 2005 sont donc intégralement compensées. Les modalités d'établissement de la compensation provisoire et définitive de chacune des compétences transférées aux départements et aux régions sont détaillées en annexe, dans le tome III du présent rapport. La CCEC a pu contrôler la conformité de ces compensations. b) L'absence d'impact de ces transferts sur le budget des collectivités concernées Il convient de noter tout d'abord que peu de régions intègrent dans leur budget primitif les nouvelles compétences transférées en 2005. Seules cinq régions de métropole semblent avoir prévu des crédits afférents à ces compétences et seules 10 régions sur 26 ont inscrit des recettes au titre de la TIPP, les montants inscrits par certaines étant d'ailleurs très inférieurs aux crédits prévus par l'Etat. Au total, les régions n'ont inscrit que 114 millions d'euros de TIPP dans leurs budgets, montant très inférieur à celui provisionné par l'Etat (près de 400 millions d'euros). Dans la plupart des cas, les crédits seront votés à l'occasion de décisions modificatives qui peuvent intervenir tout au long de l'année. À titre d'exemple, la région Lorraine, en réponse au questionnaire adressé par votre Commission d'enquête, indique que « ces dispositifs n'ont pas fait l'objet d'inscription au budget primitif 2005. Ils feront l'objet d'une inscription ultérieure. » Quant à la région Alsace, elle déclare que « le budget primitif 2005 voté en décembre 2004 n'a pas prévu de crédit au titre des compétences transférées le 1er janvier 2005. Le ministère de l'Intérieur nous a fait part en janvier 2005 de l'estimation des compensations financières au titre de la TIPP (...). À la date du 8 avril 2005, 2,7 millions d'euros ont d'ores et déjà été perçus par la région Alsace. À la même date, la région Alsace n'a rien dépensé au titre des compétences [concernées]. Lors de la décision modificative 1 pour 2005, il est prévu d'inscrire en dépenses et en recettes le montant de TIPP notifié par l'État, soit la somme de 13,05 millions d'euros. » Parmi les régions qui intègrent dans leur budget primitif les nouvelles compétences transférées en 2005, certaines ont inscrit en recette et en dépense un montant identique correspondant au montant provisionnel de leur droit à compensation pour 2005. C'est le cas notamment de la région Nord-Pas-de-Calais qui indique, en réponse au questionnaire adressé par votre Commission d'enquête, que « les dépenses et la recette relatives à l'entrée en vigueur progressive de la loi de décentralisation du 13 août 2004 ont été budgétées en 2005 dans le cadre d'une décision modificative pour des montants strictement limités à ceux figurant dans la circulaire du 11 février 2005 de Mme le Ministre de l'Intérieur. » Les contradictions de la région Midi-Pyrénées En réponse au questionnaire adressé par votre Commission d'enquête, la région Midi-Pyrénées indique que, s'agissant des transferts résultant de l'acte II de la décentralisation, « les dépenses budgétaires au titre de l'année 2005 correspondent aux recettes de TIPP estimées au moment du budget primitif 2005, à partir des rares éléments communiqués lors du vote de la loi de finances 2005. Pour ces transferts, il y a donc pour l'instant égalité entre les dépenses et les recettes. » Compte tenu de ces précisions, on peut s'étonner que, dans un document transmis à votre Commission d'enquête intitulé Mémorandum en réponse au questionnaire de la commission d'enquête parlementaire sur l'évolution de la fiscalité locale, le président du conseil régional, M. Martin Malvy, fasse figurer au premier rang des causes de la hausse de la fiscalité de la région en 2005, « les conséquences de la loi du 13 août 2004 » en expliquant que « les expériences passées en matière de décentralisation ont suffisamment instruit les élus locaux quant aux modalités de calcul des dépenses transférées et quant à l'évolution du droit à compensation qui ne prend pas en compte les rattrapages qualitatifs et quantitatifs exigés par le citoyen local. Les grandes étapes de la décentralisation ont été inévitablement accompagnées par une hausse de la fiscalité locale. En conclusion sur ce point je confirme que la région Midi-Pyrénées est extrêmement inquiète des conséquences financières à venir de la loi du 13 août 2004. (...) Mais pour autant, ce point reste mineur dans la hausse de la fiscalité en Midi-Pyrénées en 2005. Tous les documents joints relatifs à la préparation du budget primitif l'attestent : les conséquences financières de la loi du 13 août 2004 ont été estimées à l'équivalent de 1,20 point de fiscalité directe. Il s'agissait d'anticiper les coûts organisationnels engendrés par les transferts de charges (frais de personnels, de structure et frais généraux). (...) Nous ne l'avons pas fait pour les dépenses nouvelles auxquelles nous devrons faire face avant la fin de cette année. » Les explications apportées, à défaut d'être cohérentes, ont le mérite de montrer comment fonctionne ce qu'il convient d'appeler l'impôt « d'inquiétude » ou « d'anticipation. » Il en va de même en ce qui concerne les départements. L'impact des transferts résultant de la loi du 13 août 2004 sur leur fiscalité est nul ou dérisoire. Lors de son audition par votre Commission d'enquête le 23 mars 2005, le président de l'Association des départements de France, M. Claudy Lebreton, évoquant les « compétences récemment transférées aux départements qui ont déjà un impact sur les budgets 2005 », a abordé successivement les conséquences de la gestion du RMI, de l'APA et des SDIS mais n'a même pas mentionné les transferts résultant de la loi du 13 août 2004. M. Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, entendu le 25 mai dernier par votre Commission a expliqué, que s'agissant des « cinq domaines dans lesquels le département se substitue à l'État, et ce dès le budget 2005 », le département de la Vienne a « pris pour hypothèse que la recette égalerait la dépense. Encore faut-il savoir que le total - 850 000 euros - équivaut à un point de fiscalité ; si d'aventure les dépenses, par insuffisance de contrôle ou autre raison, se mettaient à croître 10 % plus vite que les recettes, cela ne représenterait guère que 0,1 % de fiscalité, autrement dit rien de significatif. Il ressort de tout cela, et la Vienne n'est pas un département très spécifique, qu'en aucun cas on ne saurait justifier en 2005 une augmentation des impôts départementaux par la décentralisation. » La plupart des collectivités qui n'ont pas intégré les nouvelles compétences dans leur budget expliquent l'absence d'inscription de crédits par un manque d'information ou par le caractère trop tardif de cette information. La région Aquitaine explique que « le transfert de compétences 2005 a une incidence mineure sur le budget primitif 2005. En effet, en l'absence de connaissance des montants des dépenses transférées à la région Aquitaine, seule une provision d'un montant d'1 million d'euros a été votée par mesure de précaution afin de faire face à la demande de financement des aides individuelles, à savoir les bourses sociales et paramédicales. En effet, la circulaire du 11 février 2005 déterminant les montants et la répartition des droits à compensation provisionnels par compétence transférée est postérieure à la date à laquelle s'est tenue la séance plénière consacrée au vote du budget primitif, soit le 3 février. Dans la continuité, le conseil régional d'Aquitaine a donc prévu d'adopter le 11 avril 2005 une décision modificative budgétaire entièrement dédiée au transfert de compétences afin de prendre en considération ces montants provisionnels (...). Naturellement, les nouveaux transferts de compétences sont, de fait, sans effet sur la fiscalité régionale votée en 2005. » La Basse-Normandie fait remarquer que « les informations venues de l'État se contredisent (...). Dans un courrier du 26 janvier 2005, M. le Préfet de la région Basse-Normandie nous notifiait, en effet, l'arrivée de 10 341 441 euros. Mais quelques jours plus tard, Mme le Ministre délégué à l'Intérieur, par lettre du 11 février 2005, ramenait pour sa part, sans explications, cette somme à 10 190 034 euros. Les deux lettres nous étant de toute façon parvenues bien trop tard pour être prises en compte dans la contribution du budget primitif, nous espérons y voir clair lors de la préparation de la prochaine décision modificative. » Il semble en effet que, dans la préparation de leur budget primitif pour 2005, les collectivités territoriales aient pâti du retard, voire de l'absence d'information de la part des services de l'État, s'agissant du montant de la compensation des différentes compétences transférées. Un montant provisionnel de compensation a été porté à la connaissance des départements et des régions en janvier 2005. Ces montants figurent dans la circulaire du 30 décembre 2004 (n° NOR/LBL/B/04/10092/C) publiée par la DGCL. Les collectivités ayant voté leur budget avant la communication de ces éléments n'ont donc pas été en mesure d'en tenir compte dans la construction de leur budget. Par ailleurs, les collectivités ne disposaient à cette date que d'un montant global de compensation pour l'ensemble des compétences transférées en 2005, et non de sa répartition par compétence. Une deuxième évaluation de leur droit à compensation, détaillée par compétence transférée, a été communiquée aux collectivités dans le courant du mois de février. Cette évaluation est inscrite dans la circulaire du 11 février 2005 n° NOR/LBL/05/10006/C. Les collectivités concernées ont pu constater une différence entre les deux montants communiqués, les dernières informations transmises correspondant à une évaluation plus fine du droit à compensation provisionnel. En tout état de cause, compte tenu du fait que ces montants présentent nécessairement un caractère évaluatif et provisoire, une marge d'incertitude est inévitable et l'information des collectivités lors de l'adoption de leur budget primitif ne pouvait, par définition, pas être parfaite. Cependant, votre Rapporteur estime que l'administration aurait sans doute pu améliorer l'information des collectivités au moment du vote de leur budget. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que les nouveaux transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 sont sans effet sur la fiscalité régionale et départementale votée en 2005. M. Thierry Camuzat, directeur adjoint chargé des finances de la région Languedoc-Roussillon, en conclut à très juste titre : « il serait donc fallacieux de dire que nous avons pris en compte la décentralisation dans la préparation du budget, sauf à considérer que la région aurait voulu se constituer une cagnotte, ce qui est parfaitement faux. » Compte tenu de ces éléments, M. Jean-Yves Chamard, Président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, entendu par votre Commission d'enquête le 25 mai 2005, a dénoncé le caractère « mensonger » des déclarations de certaines régions : « Pour ce qui est de la région Poitou-Charentes, Mme Ségolène Royal s'est répandue dans tous les journaux en expliquant que la forte augmentation de la fiscalité régionale - 19 % en moyenne entre les impôts directs, la carte grise en augmentation de 27 % et le reste - était en quelque sorte un « impôt Raffarin ». C'est un mensonge pur et simple, la décentralisation ne s'étant pas encore traduite, pour la région comme pour les départements, par un poids réel supplémentaire. En fait, Mme Royal a voulu réduire la charge d'emprunt qu'elle considérait, à juste titre, trop élevée. (...) Je suis vraiment très remonté contre cette présentation totalement biaisée, ainsi qu'en témoigne la comparaison entre les budgets régionaux 2004 et 2005. La décentralisation n'est pour rien là-dedans, si ce n'est à la marge. » 2.- Le RMI : la moitié des masses financières transférées aux départements La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) aura été la première loi donnant un contenu concret à l'acte II de la décentralisation. Depuis le 1er janvier 2004, le président du conseil général est le responsable unique de la gestion de l'allocation RMI et du pilotage de l'insertion. Ce transfert, qui représente une masse financière de près de 5 milliards d'euros en 2004, correspond à près de la moitié du poids financier des compétences que le Gouvernement doit confier aux départements dans le cadre de l'acte II de la décentralisation. Ce constat appelle une première remarque. L'année 2004, première année d'exercice de la compétence RMI-RMA par les départements, a été marquée par un net ralentissement de la pression fiscale départementale : en 2004, les taux des quatre taxes départementales ont augmenté de 1,2 % contre 3,9 % en 2003. Le contraste est donc marquant avec ce que l'on observe pour la plupart des régions en 2005, alors même que ces dernières n'ont en 2005 que « des bribes de charges nouvelles décentralisées », selon les termes de M. Georges Frêche. Contrairement, aux régions, les départements ne semblent donc pas avoir pris prétexte du RMI pour se constituer une « cagnotte ». Il est vrai, l'année 2004 était année d'élection. Pour permettre aux conseils généraux d'assurer les charges ainsi transférées, un dispositif de compensation financière a été élaboré dans le respect du principe de compensation intégrale, mis en œuvre depuis les lois Defferre et désormais consacré par l'article 72-2 de la Constitution selon lequel « tout transfert de compétences entre I'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Le RMI a cependant été présenté par certains exécutifs départementaux comme une cause d'augmentation de la fiscalité départementale en 2005. S'il est indiscutable que les hausses fiscales votées par les régions en 2005 n'étaient aucunement justifiables par la décentralisation, l'impact du RMI exige un examen plus approfondi. En effet, pour l'exercice 2004, un différentiel de l'ordre de 450 millions d'euros a été constaté entre la recette transférée et la dépense, différentiel qui s'est amplifié au cours du premier semestre 2005. Cependant, le Premier ministre a annoncé le 7 mars dernier, en dehors de toute obligation légale et par dérogation aux modalités traditionnelles d'application de la règle de compensation intégrale des transferts de compétences, le principe d'un abondement exceptionnel destiné à combler l'intégralité de l'écart constaté entre la dépense et la recette au titre de l'exercice 2004. Il convient de bien mesurer l'ampleur de cet effort totalement discrétionnaire qui porterait sur un montant de près de 465 millions d'euros. Cet engagement exceptionnel, combiné au refus de nombreux départements de céder, en 2005, à la tentation de l'impôt d'inquiétude, a permis à de nombreux conseils généraux de modérer l'accroissement de la fiscalité départementale en 2005. Malgré cet effort exceptionnel de l'État, certains présidents de conseils généraux ne s'estiment pas satisfaits de l'économie générale du dispositif de compensation. Leurs revendications et inquiétudes portent essentiellement sur le principe même de la décentralisation du RMI, sur la dynamique comparée des dépenses de RMI et des recettes fiscales affectées aux conseils généraux, sur les coûts de trésorerie occasionnés par la gestion du RMI, sur les personnels transférés et sur la question du financement du surcoût qui peut résulter de la signature d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'insertion RMA. Avant d'examiner point par point ces revendications et ces inquiétudes, un rappel du dispositif de compensation financière du RMI s'impose. Un dossier documentaire figure par ailleurs en annexe, en page 60 du tome III du présent rapport. a) Le dispositif initial va au-delà du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences · L'application du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences Mis en œuvre depuis les « lois Defferre » de 1983, ce principe est codifié à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales qui en précise les modalités d'application : les ressources transférées doivent être « équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées. » Dans un premier temps, l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu, conformément à ce principe, que la compensation financière, versée sous forme d'une quote-part de la TIPP, serait « calculée sur la bases des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003. » L'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 est venu préciser que cette part est obtenue, chaque année, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national et que cette fraction de tarif « est calculée de telle sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation RMI et de l'allocation de revenu de solidarité. » Notons qu'en l'attente de la connaissance définitive des quantités de carburants vendues et des dépenses de RMI de 2003, la loi de finances pour 2004 a fixé, à titre provisoire, le niveau de la fraction de tarif attribuée aux départements et prévu qu'il serait modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 20045. Il convient de souligner qu'en vertu des dispositions de valeur constitutionnelle encadrant la compensation financière des transferts de compétence6, les départements bénéficient d'un mécanisme de « garantie plancher », destiné à assurer, quel que soit le dynamisme des consommations de carburants, que le produit de TIPP versé chaque année aux départements soit au moins égal au montant consacré par l'État au RMI en 2003. · L'extension exceptionnelle du périmètre de la compensation financière afin de tenir compte de la création du RMA Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, le Parlement a prévu une dérogation au principe de compensation intégrale, compte tenu d'un contexte particulier marqué par la création du RMA et l'annonce d'une réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Le Parlement a en effet tenu à ce que soit pris en compte le « surcoût » que la création du RMA et la réforme de l'ASS étaient susceptibles d'entraîner pour les départements. L'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 dispose ainsi que le niveau de la fraction du tarif de la TIPP attribuée aux départements : « est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. « Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ». S'agissant du RMA, ce coût supplémentaire résulte du fait que, le RMI étant une allocation différentielle, son montant est en moyenne un peu inférieur au plafond que constitue le montant fixe de l'aide aux employeurs. Le Parlement avait également élargi le périmètre de la compensation financière afin qu'il soit tenu compte de la réforme annoncée de l'ASS qui était de nature à entraîner une augmentation non négligeable du nombre d'allocataires du RMI. Cependant, le 1er janvier 2004, le Président de la République a annoncé la suspension de cette réforme.7 Le RMA étant un outil mis à la disposition des départements et non une compétence obligatoire mise à leur charge, il n'existe pas d'obligation constitutionnelle d'assurer la compensation du surcoût pouvant en résulter. Le dispositif de compensation, ainsi modifié par le Législateur, est donc plus favorable que ne le serait l'application du principe de compensation intégrale. Afin que soit intégré dans la base de compensation le surcoût lié au RMA en 2004, surcoût qui ne pourra être constaté qu'après l'adoption des comptes administratifs des départements pour 2004, laquelle interviendra au plus tard le 30 juin 2005, un ultime ajustement des fractions de tarif sera opéré en loi de finances rectificative pour 20058. b) Jusqu'à présent, l'État a respecté l'intégralité de ses engagements · La compensation versée à titre provisoire en 2004 La fraction du tarif de la TIPP attribuée à l'ensemble des départements a été calculée dans un premier temps à partir d'une évaluation provisoire des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre du RMI et de l'assiette 2003 de la TIPP. Sur la base de cette fraction de tarif provisoire, les recettes de TIPP collectées par la Direction générale des douanes et des droits indirects ont été réparties au fil de l'eau entre un compte de l'État et un compte de tiers au profit des départements, puis par les services de la comptabilité publique, entre les différents départements, sur la base des pourcentages fixés par l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en date du 14 janvier 2004. Pour l'ensemble des départements, la somme versée en 2004 avant régularisation s'est élevée à 4 855 millions d'euros. · Les ajustements intervenus en loi de finances rectificative pour 2004 Cette première régularisation est le résultat de deux mécanismes : - La fraction de tarif fixée à titre provisoire par la loi de finances pour 2004 a été ajustée afin de tenir compte des données définitives afférentes aux dépenses et aux consommations enregistrées en 20039. Cet ajustement s'est traduit par une recette supplémentaire d'environ 53 millions d'euros du fait de la sous-évaluation initiale des quantités de carburants consommées en 2003 ; - À l'issue de cet ajustement, le montant total versé aux départements en 2004 (4 855 + 53 = 4 908 millions d'euros) demeurait inférieur d'environ 33 millions d'euros aux dépenses exécutées par l'Etat en 2003 (soit 4 941 millions d'euros), la fraction de tarif attribuée aux départements ayant été calculée sur la base de l'assiette 2003 de la TIPP, qui était supérieure à l'assiette 2004. Aussi, la garantie de ressource trouve-t-elle à s'appliquer dès 2004 en raison d'un moindre dynamisme des consommations de carburants. La première régularisation du montant de TIPP affecté aux départements s'élève donc au total à 86 millions d'euros environ. À ce stade, les départements ont donc perçu au titre de l'exercice 2004 un montant égal « à l'euro près » aux dépenses effectuées par l'État en 2003 au titre du RMI, soit 4 941 millions d'euros. Cette compensation est intégrale, et strictement conforme à la lettre de l'article 72-2 de la Constitution. · L'inclusion des indus dans la base de compensation Il est important de préciser qu'il n'y a pas eu déduction des indus de la base de la compensation, soit les dépenses exécutées par l'État en 2003, contrairement à ce qu'affirme le rapport du sénateur Michel Mercier, publié dans le cadre des travaux de l'Observatoire de la décentralisation du Sénat. La créance sur les allocataires qui résulte de ces indus a été transférée aux départements. La règle fixée par la loi du 18 décembre 2003 est donc à l'avantage des conseils généraux. Il leur appartient de recouvrer leurs créances. L'ensemble des indus constitués au titre de 2003 s'élève, selon les informations fournies par la Direction générale de l'action sociale, pour les dépenses servies par les CAF à plus de 78 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les indus facturés par les caisses de mutualité sociale agricole, qui gèrent 2 % des allocataires. · Il n'y a pas de treizième mois dont la charge aurait été affectée aux départements sans compensation La compensation est bien calculée sur douze mois de dépenses de l'État (de décembre 2002 à novembre 2003 en droits constatés) et finance douze mois de dépenses des départements (décembre 2003 à novembre 2004 en droits constatés, puis décembre de l'année N à novembre de l'année N+1 les années suivantes). Rappelons que les CAF et la MSA assurent gratuitement le versement (et en partie l'instruction des demandes) du RMI pour le compte des départements comme cela était le cas lorsque la prestation dépendait de l'Etat. L'ensemble des agents des CAF gestionnaires du RMI ont donc été mis gratuitement à la disposition des départements. S'agissant des personnels transférés pour la gestion du RMI, en application de l'article 42 de la loi du 18 décembre 2003, « les agents de l'État dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de RMI, transférées au département » ont été « mis à disposition du département », à compter du 1er janvier 2004. » Une fiche fournie par la DGAPB et figurant en annexe dans le tome III du présent rapport précise les étapes de leur transfert. La question des personnels de l'ANPE contribuant à l'insertion professionnelle des allocataires sera traitée dans la partie e). c) L'augmentation importante du nombre de RMIstes et l'engagement exceptionnel du Premier ministre de compenser le surcoût qui en résulte · Le décalage entre les recettes de TIPP et les dépenses de RMI des départements Le différentiel pour 2004 entre les versements de TIPP et les dépenses des départements au titre du RMI est actuellement évalué à 426,4 millions d'euros pour la métropole et à 465,5 millions d'euros en incluant les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon (chiffres DGCP). Les chiffres définitifs ne seront cependant connus que lorsque les comptes administratifs des départements pour 2004 seront restitués. Les chiffres provisoires par département figurent dans le tome III du présent rapport. Fin 2004, le nombre d'allocataires effectivement payés au titre du RMI ou bénéficiaires d'un RMA, en métropole et dans les DOM, s'élève en données brutes à 1,2 million, soit une augmentation de 8,5 % par rapport au 31 décembre 2003. On dénombre en leur sein environ 1 000 bénéficiaires du RMA dans 47 départements. Les versements effectués en 2004 au titre du RMI ont par ailleurs représenté 5,4 milliards d'euros et progressé de 10,5 % par rapport à 2003. La conjoncture économique de l'année ne suffit pas à expliquer la forte progression du nombre d'allocataires du RMI. Une note de la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques (DREES) publiée en mars 2005 et reproduite en annexe du présent rapport,10 met en évidence l'impact important en 2004 de la réforme de l'assurance chômage décidée en décembre 2002 sur l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI, le raccourcissement des durées d'indemnisation ayant conduit à une élévation du nombre de chômeurs non indemnisés et, partant, du nombre de personnes susceptibles d'avoir recours au RMI 11. · L'engagement exceptionnel du Premier ministre de compenser intégralement le différentiel 2004, en dehors de toute obligation juridique Compte tenu à la fois de l'importance de l'écart constaté et du fait que cet écart résulte en partie de décisions exogènes, à savoir la réforme de l'allocation de recherche d'emploi (ARE), le Premier ministre a annoncé le 7 mars dernier que l'État compensera l'intégralité du différentiel entre les dépenses de RMI des départements pour 2004 et les recettes transférées pour financer cette compétence. Dans la mesure où certains départements ont tendance à le considérer comme un dû, il importe de bien rappeler le caractère exceptionnel de cet engagement supplémentaire qui intervient en dehors de toute obligation légale ou constitutionnelle. La formulation de l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 n'entraîne aucunement pour l'État l'obligation de compenser le différentiel 2004, conformément aux modalités traditionnelles d'application du principe de compensation intégrale des transferts de compétences. Cette interprétation a été confirmée par une circulaire de la DGCL en date du 18 février 2005, qui précise que « le droit à compensation, définitivement établi à l'issue de cette procédure, ne pourra (...) tenir compte que des dépenses exécutées par l'État en 2003 et, lorsqu'il sera connu, d'un éventuel surcoût résultant des effets de la réforme de l'ASS et du RMA, à l'exclusion de l'évolution des dépenses de RMI liées aux effets conjoncturels ». L'engagement de l'ancien Premier ministre va donc bien au-delà des obligations posées par le Législateur. Il s'agit d'une décision purement discrétionnaire, non dénuée d'élégance, comme l'a noté M. Jean-François Copé, et qui s'inscrit dans une perspective de maintien de relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Malheureusement, la première année d'application du transfert se trouve être une année d'accroissement important des dépenses de RMI. Il aurait pu en être autrement. Si le nombre de RMIstes avait diminué, les départements auraient bénéficié d'un surcroît de recettes. Faisant une légère entorse aux « règles du jeu » de la décentralisation, le Gouvernement a cependant jugé bon de « mettre de l'huile dans les rouages » la première année du transfert. Il s'ensuit que la compensation financière allouée aux départements pour l'exercice 2004 sera beaucoup plus favorable que ne le serait l'application stricte du principe de compensation financière intégrale des transferts de compétences. · L'engagement du Premier ministre sera-t-il intégré dans la base de compensation ? Le Premier ministre a clairement annoncé que l'État comblerait le différentiel entre dépenses de RMI et recettes transférées pour l'exercice 2004. Une incertitude demeure : il n'a pas été précisé s'il s'agira d'un abondement exceptionnel, versé sous forme budgétaire, ou si le droit à compensation des départements sera redéfini de façon définitive sur la base des dépenses de l'année 2004, auquel cas la fraction de tarif attribuée aux départements serait recalculée à partir du coût 2004 de la compétence RMI. Votre Commission d'enquête a constaté qu'aucun arbitrage n'a été rendu sur ce sujet. d) L'impact du RMI sur la fiscalité départementale en 2005 · L'engagement du Premier ministre a permis à de nombreux départements de modérer l'accroissement de leur fiscalité en 2005 Les auditions menées par votre Commission ont montré que de nombreux conseils généraux ont tenu compte de l'annonce du premier ministre, intervenue le 7 mars dernier et modéré en conséquence l'accroissement de la pression fiscale. M. Michel Mercier, président du conseil général du Rhône, entendu le 10 mai 2005 par votre Commission a déclaré : « Lorsqu'il a fallu fixer les impôts pour 2005, je n'ai pas tenu compte de ce qui nous a manqué sur les allocations du RMI : compte tenu de la parole du Gouvernement, j'ai considéré que c'était fait.. » M. Louis de Broissia, président du conseil général de la Côte d'Or entendu le 23 mars 2005 a indiqué que son département avait tiré toutes les conséquences de l'engagement du Premier ministre en limitant la hausse des impôts à 2,1 % au lieu de 4,5 % : « Puisque le Gouvernement nous a promis que les 453 millions d'euros nous seront reversés, j'ai considéré qu'il ne fallait pas alourdir inconsidérément la charge pesant sur le contribuable départemental. » M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin, a déclaré au cours de son audition le 18 mai 2005 que l'engagement du Premier Ministre « devrait (...) permettre [au département du Haut-Rhin] de ne pas avoir un déficit aggravé de ressources. Nous sommes donc à même d'assurer les compétences que nous avons à exercer, sans que cela justifie une augmentation supérieure à celle qui a été décidée » (+2,9 %). Le 25 mai 2005, M. Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, affirmait devant votre Commission d'enquête : « Pour ce qui est du RMI, l'État s'étant engagé à rembourser à l'euro près, il n'aurait dû entraîner aucun surcoût, si ce n'est en trésorerie ; aussi n'avions-nous inscrit aucune dépense supplémentaire à ce titre dans notre budget 2004, le niveau de notre ligne de trésorerie étant suffisant. Dans le budget primitif 2005, nous avons inscrit un montant identique en recettes et en dépenses. Mais si la croissance des dépenses de RMI est supérieure à celle des recettes compensatoires, nous devrons utiliser une partie du reliquat du compte administratif 2005 pour financer la différence. Rappelons que nos 13 % d'augmentation découlent de décisions prises il y a trois ans et non d'une progression des charges du RMI. » Au cours de l'audition du 3 mars, Mme Anne d'Ornano, présidente du conseil général du Calvados a déclaré faire « confiance à l'avenir », « car la Constitution prévoit que les transferts nous serons remboursés à l'euro près. Pour le moment, s'agissant du RMI, cela fonctionne bien, même si nous devons avancer un peu de trésorerie. En résumé, l'augmentation des impôts, à laquelle je regrette d'avoir dû procéder est uniquement imputable à l'APA, pas à la décentralisation. » · Des réponses fiscales d'amplitude très variable La progression du nombre d'allocataires inscrits au RMI entre décembre 2003 et décembre 2004 a concerné la quasi-totalité des départements, mais avec une ampleur différente. Dépassant 13 % dans la plupart des départements de l'Est de la France et de l'Île de France, l'évolution est plus modérée dans les départements du Sud et de l'Ouest (entre + 3 % et + 8 % environ). Cette très forte disparité des taux d'évolution du nombre d'allocataires par département est une donnée permanente. Par ailleurs, tous les départements ne sont pas dans la même situation face à une augmentation des dépenses liées au RMI. Selon M. Erwan Le Bot, « l'augmentation théorique des taux de la fiscalité directe nécessaires pour chaque département, pour faire face à une augmentation générale de 10 % des charges d'allocation du RMI (et hors augmentation de la compensation) est très variable. Pour un tiers des départements, une augmentation de 10 % des allocations de RMI représenterait une augmentation des taux de fiscalité comprise entre 1,2 % et 2,5 % pour un autre tiers l'augmentation serait comprise entre 2,5 % et 3,5 %, enfin pour le dernier tiers, l'augmentation serait comprise entre 3,5 % et 9,7 %. »12 Le directeur général des collectivités locales, lors de son audition du 10 mai 2005 a rappelé que l'effet d'un transfert de compétence sur la fiscalité des collectivités territoriales est très variable d'une collectivité à l'autre. Si l'on prend le cas de l'APA, sa mise en œuvre et sa montée en charge ont eu des impacts fiscaux différents et non simultanés. Pour un même niveau de surcoût de dépenses liées à l'APA, l'augmentation du produit fiscal peut varier de 1 à 7 d'un département à l'autre. Par ailleurs, certains départements ont augmenté leur fiscalité dès 2002, d'autres ont attendu 2003, voire 2004. Certains ont étalé la hausse sur deux ou trois années, d'autres ont préféré ne procéder qu'à une augmentation. Enfin, plusieurs départements n'ont pas augmenté leur taux de fiscalité directe, se contentant de la progression des bases. On voit là l'effet des décisions individuelles des collectivités qui usent pleinement de leur autonomie de décision, en fonction des politiques qu'elles entendent mener ou développer et des marges de manœuvre dont elles disposent : capacité d'épargne, pression fiscale, niveau et charge de la dette. e) Examen des revendications des exécutifs départementaux · Une remise en cause du principe même de la décentralisation du RMI ? Ainsi que l'a très justement fait remarquer M. René Dosière lors de l'audition du directeur général de l'action sociale, M. Jean-Jacques Trégoat, le 25 mai 2005, « si l'État devait tout compenser, pourquoi transférer ? » Il convient en effet de rappeler que la décentralisation repose sur la responsabilité. L'actualisation permanente d'une compensation au rythme de la dépense transférée est en totale contradiction avec la logique même de la décentralisation. C'est ce qui la distingue d'un système déconcentré. Depuis 1982, toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales ont toujours fait l'objet d'une compensation sur la base de ce que l'État faisait avant la date du transfert. Après le transfert de la compétence, la collectivité devient pleinement responsable de l'évolution de la dépense et de son financement. Pourquoi rappeler ces évidences ? Parce que certains paraissent souhaiter changer en la matière les règles du jeu qui sont le fondement de la centralisation depuis les « lois Defferre ». Il convient donc de s'assurer que le principe même de la décentralisation du RMI n'est pas contesté par les départements. · La perspective d'évolution comparée de la recette et de la charge liée au RMI Tout d'abord, l'écart enregistré en 2004 entre les dépenses de RMI et de RMA et les ressources affectées sera intégralement compensé. La question de l'année 2004 n'est donc plus un sujet. Cependant, pour les années à venir, certains départements redoutent un phénomène de ciseaux entre les dépenses de RMI et les ressources de TIPP. « La réponse du Premier ministre à propos du RMI nous satisfait tout à fait pour 2004 mais j'appelle de mes vœux une vraie réflexion pour les années 2005 et suivantes. En effet, la TIPP ne constitue pas un financement dynamique, et cela risque de nous placer dans des situations délicates. » déclarait M. Claude Haut, président du conseil général de Vaucluse, entendu le 23 mars 2005 par votre commission. Il convient tout d'abord de noter que la dynamique comparée de la recette et de la dépense et partant l'impact financier de la décentralisation du RMI ne sauraient être appréciés de façon pertinente que dans la durée. S'agissant de la dynamique de la recette, la compensation repose sur l'application de trois tarifs différenciés à trois assiettes différentes, dont l'évolution dans le temps est contrastée. Après la régularisation intervenue en loi de finances rectificative pour 2004, les trois fractions de tarif attribuées aux départements s'élèvent à : - 12,50 euros par hectolitre sur les carburants sans plomb ; - 13,56 euros par hectolitre sur le carburant sans plomb « contenant un additif anti-récession de soupape » (ARS) ; - 8,31 euros par hectolitre sur le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. La ventilation du produit de TIPP versé aux départements en 2004 entre les trois types de carburants est la suivante :
À la différence des régions, les départements ne disposeront pas d'une capacité de modulation. La recette de TIPP évoluera donc pour chaque département comme la consommation des carburants pour lesquels une fraction figée du tarif de la TIPP lui a été attribuée. Quel que soit le dynamisme de ces consommations, il importe de souligner que les départements bénéficient d'une garantie de ressources : ils sont assurés de percevoir chaque année un minimum, égal au montant consacré par l'État au RMI en 2003, soit 4 941 millions d'euros.
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects ÉVOLUTION DE 1993 À 2002 DE LA CONSOMMATION DES CARBURANTS (base 100 en 1993)  Source : Comité professionnel du pétrole. Le graphique précédent permet de constater que les consommations de carburant sans plomb (qui en représentent environ 37 % de la compensation versée aux départements pour 2004) et le gazole (qui représente environ 60 %) ont connu une évolution positive continue entre 1993 et 2002, même si le rythme de cette progression s'est ralenti en fin de période. Parallèlement, si l'assiette des supercarburants avec ARS diminue fortement et de façon continue, il convient de souligner qu'elle ne génère qu'une très faible part de la compensation (environ 3 %). Le ralentissement de la consommation de carburants à partir de 2002 s'explique par plusieurs facteurs examinés dans le A du I de la troisième partie du présent rapport. Évidemment, les évolutions récentes ne permettent pas de tirer de conclusion définitive sur le dynamisme de la recette et l'équilibre financier à long terme du transfert du RMI. En tout état de cause, la directrice de la législation fiscale, Mme Marie-Christine Lepetit, entendue le 26 mai dernier par votre commission, a fait remarquer à très juste titre que « jamais on ne parviendra à mettre en place, devant chaque nouvelle dépense permise dans une catégorie donnée de collectivité, un impôt qui lui corresponde exactement, avec la dynamique appropriée. Il faut davantage raisonner en mettant en rapport l'ensemble des dépenses et l'ensemble des impôts dans une catégorie donnée de collectivités. » S'agissant de l'évolution de la dépense, il est admis que l'évolution globale du nombre d'allocataires est liée à la conjoncture économique générale. Si pour 2004 et 2005, un surcoût est effectivement observé, il résulte largement de la réforme de l'assurance chômage. On peut admettre que sur le long terme, les fluctuations à la hausse comme à la baisse de la conjoncture économique sont susceptibles de neutraliser ce surcoût. Si, l'année 2004 avait été marquée par une diminution du nombre d'allocataires du RMI liée à une meilleure conjoncture dans les années antérieures, les départements auraient bénéficié d'un surcroît de ressources que l'État n'aurait pas été fondé à contester. Le montant du droit à compensation de chaque département lui sera versé, quelle que soit l'évolution, à la hausse ou à la baisse, de la dépense correspondante. D'ailleurs les chiffres transmis par la direction du budget et figurant en annexe dans le tome III montrent que trois départements (la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et la Martinique) sont « gagnants » en 2004. Les décalages positifs que peuvent constater ces départements entre le paiement du RMI et les versements de TIPP ne feront évidemment l'objet d'aucune reprise par l'État. Au surplus, l'augmentation importante du nombre d'allocataires du RMI constatée en 2004 et en 2005, dans un contexte de reprise conjoncturelle, laisse supposer que ce nombre constitue un plafond et que la tendance s'inversera dans l'avenir. M. Erwan Le Bot précise, dans son article précité, que « pour des raisons démographiques, le chômage en France devrait diminuer à l'horizon 2006-2008, et une reprise économique significative ne doit pas être exclue dont les départements pourraient alors être doublement bénéficiaires, d'une part, du fait de l'augmentation de leurs ressources, et, d'autre part, du fait d'une stabilisation, voire d'une baisse de leurs charges liées au RMI.13 » Rappelons que dans un contexte conjoncturel favorable, et après avoir connu une croissance continue depuis la création de l'allocation liée à la montée en charge du dispositif, le nombre de bénéficiaires du RMI a enregistré une décrue entre décembre 1999 et décembre 2002.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DU RMI 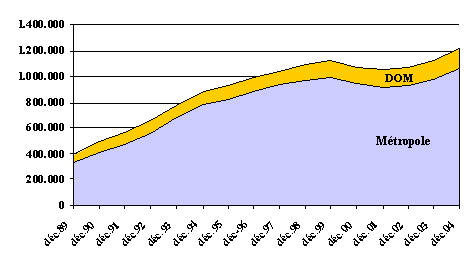 Source : CNAF fichier FILEAS. Enfin, face à l'évolution de la charge que représentent les allocations de RMI, les départements disposent de marges de manœuvre réelles, comme nous le verrons dans la troisième partie (II- D) du présent rapport. · Les coûts de trésorerie engendrés par le paiement du RMI Certains départements souhaitent que l'État prévoie une compensation des coûts de trésorerie occasionnés par le caractère irrégulier des versements de TIPP et le caractère tardif des régularisations. En effet, la législation prévoit que les départements reçoivent chaque mois une part des recettes de TIPP correspondant aux consommations de carburant du mois. Si le montant annuel de la recette fiscale est garanti, en revanche, son versement mensuel peut connaître des fluctuations en fonction de la conjoncture. Il faut cependant reconnaître que la TIPP compte parmi les impôts dont le profil mensuel est le plus régulier. D'autre part, les coûts de trésorerie supportés par les départements dépendent aussi de leur politique de gestion financière. Les départements ne sont donc pas fondés à exiger de l'État qu'il les compense. M. Jean-Jacques Trégoat, Directeur général de l'action sociale, l'a noté : « il serait d'ailleurs extrêmement difficile de distinguer, parmi les frais de trésorerie supportés par les départements, ceux qui sont occasionnés par la gestion du RMI. Il convient de rappeler que la TIPP est une recette non affectée dans la comptabilité des départements. » Et le ministre du Budget de rappeler l'avantage de trésorerie tiré par les départements du dispositif de versement par avances mensuelles du produit voté de leurs impôts. Quant à l'impact de l'écart provisoire d'environ 450 millions d'euros entre la dépense et la recette 2004, toujours selon le DGAS, « il semble avoir été atténué : dans de nombreux départements, les versements aux organismes payeurs ont été ajustés au rythme de versement de la TIPP, si bien qu'en fait, c'est principalement la Sécurité sociale (l'ACOSS) qui a supporté une avance aux départements. La direction de la sécurité sociale (DSS) a estimé le solde moyen négatif à la charge des CAF à 226 millions d'euros. » Lors de l'examen par l'Assemblée nationale de l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le président Augustin Bonrepaux a présenté un amendement, tendant à ce que soit compensée la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, du transfert du RMI et les ressources attribuées en compensation par l'État majorée du taux d'intérêt légal. Il s'agissait ainsi d'intégrer dans le périmètre de la compensation le coût de trésorerie supporté par les départements du fait du caractère ex post de la régularisation. L'Assemblée nationale ayant rejeté cet amendement, le principe d'une compensation par l'État des effets de trésorerie n'a pas été retenu par le Parlement. En tout état de cause, compte tenu du fait que la compensation due au titre de 2004 sera majorée d'un montant supplémentaire de plus de 450 millions d'euros qui est évidemment sans commune mesure avec les coûts de trésorerie qu'ont pu supporter certains départements, il n'apparaît pas raisonnable d'en exiger une compensation par l'État. · Le surcoût que peut entraîner la signature d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'insertion RMA Le RMA et le contrat d'avenir étant des outils mis à la disposition des départements et non une compétence obligatoire mise à leur charge, il n'existe pas d'obligation constitutionnelle pour l'État de compenser le surcoût pouvant en résulter. Dans sa décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale, le Conseil constitutionnel a expressément précisé que les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi », ne visent que les créations et extensions de compétences « qui présentent un caractère obligatoire ». S'agissant des contrats d'accompagnement vers l'emploi, le Conseil a jugé en particulier que l'article 44 de la loi « ne contraint pas les collectivités territoriales à recruter des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi par la voie de « contrats d'accompagnement vers l'emploi » ; que dès lors, s'agissant de compétences dont l'exercice demeure facultatif, le grief tiré du non-respect de l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté. » Néanmoins, comme il a été indiqué précédemment, le législateur a prévu que soit pris en compte le surcoût lié au RMA dans l'ajustement du droit à compensation des départements qui doit intervenir sur la base des comptes administratifs 2004 des départements. · La suppression du cofinancement par l'État des agents de l'ANPE travaillant dans le champ de l'insertion Depuis la création du RMI en 1988, les départements et l'État copilotaient le volet insertion du RMI. Dans ce cadre, l'État cofinançait avec les départements certains agents de l'ANPE qui contribuaient à l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation. La loi du 18 décembre 2003, en unifiant au profit du département le pilotage de l'insertion des RMIstes, a logiquement induit la fin du cofinancement de ces agents. De nombreux départements contestent ce principe et demandent que cette mesure fasse l'objet d'une compensation. Parallèlement, dans le contexte de l'ouverture du marché du placement et pour se conformer au droit communautaire de la concurrence, l'ANPE a été contrainte de facturer de façon précise et complète ses prestations aux départements. Elle y intègre désormais les frais de structure, alors que les conseils généraux ne supportaient auparavant que les salaires des agents mis à disposition. La combinaison de ces deux facteurs - fin du cofinancement et facturation du coût complet de ces agents - explique l'augmentation du coût des agents de l'ANPE constatée par les conseils généraux. Cependant, ces deux facteurs découlent nécessairement de la décentralisation et de l'ouverture du marché du placement. Il convient tout d'abord de souligner que ces personnels travaillent dans le champ de l'insertion. Or, le volet insertion doit être clairement distingué de la gestion de l'allocation proprement dite. Il est donc légitime que ces agents ne soient pas intégrés dans la base de compensation du transfert aux départements du versement de l'allocation. Il ne s'agit pas d'une dépense obligatoire et il est loisible aux départements d'organiser leur politique d'insertion comme ils l'entendent. Les conseils généraux sont en effet libres de recourir à leurs propres moyens, aux services de l'ANPE ou de tout autre opérateur de leur choix. Il convient de rappeler que pour laisser aux départements le temps nécessaire à la redéfinition éventuelle de leur politique d'insertion et à la renégociation des conventions passées avec l'ANPE, compte tenu de cette nouvelle donne, le ministre de l'emploi a demandé à l'ANPE de maintenir la mise à disposition de ses agents pendant six mois en 2004. Compte tenu de ces éléments, la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) n'a pas demandé l'inclusion de la part autrefois prise en charge par l'État dans le financement de ces agents dans la base de la compensation. Les frais occasionnés par la mise à disposition d'agents de l'ANPE ne constituent en effet pas une dépense obligatoire mais une dépense discrétionnaire. En sus de ces mises à disposition, il convient de rappeler que les allocataires du RMI continuent de bénéficier des services de l'ANPE et notamment des plans d'accompagnement personnalisé (PAP) dans les conditions de droit commun. 3.- L'importance de l'effort financier de l'État sur les territoires contredit la thèse de son « désengagement » Trois mots sont revenus dans les propos des collectivités territoriales à longueur d'auditions et de réponses aux questionnaires de votre Commission d'enquête : « désengagement de l'État ». Le retard dans l'exécution des contrats de plan n'implique en rien une augmentation de la fiscalité locale. En réalité, c'est un effort financier accru de l'État sur l'ensemble des territoires qu'il faut constater. Comme l'a affirmé M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer : « l'exécution de ces contrats de plan se fait de façon globalement satisfaisante : aucune région n'a eu à payer plus que ce qu'elle devait. [...] Les régions apportent comme prévu les financements attendus, au niveau convenu. Il ne ressort donc aucun impact nouveau sur la fiscalité locale de l'exécution des contrats de plan. » a) L'exécution des contrats de plan État-régions est banalement en retard Tous les travaux cofinancés par l'État et les collectivités territoriales seraient-ils vraiment arrêtés, comme le laissent entendre la plupart des présidents de conseils régionaux, et notamment M. Alain Rousset, président de l'association des régions de France : « les contrats de plan [...] n'ont jamais été suspendus par le passé, comme aujourd'hui. [...] En Aquitaine, aucun des travaux prévus dans le contrat de plan n'est actuellement en cours de réalisation. [...] L'ensemble des chantiers subissent des coupes sombres qu'on n'a jamais connues. [...] L'ensemble des grands chantiers d'infrastructures sont quasiment arrêtés. Pire, aucun des engagements de l'État, notamment ceux relatifs au développement économique et social et à la modernisation industrielle de notre pays, n'est honoré » ? Tous les éléments recueillis par votre Commission permettent de rejeter ces affirmations mensongères, juste utiles pour tenter vainement de justifier des hausses d'impôts locaux. M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, a parfaitement rendu compte de cette problématique : « parler de « désengagement » laisse à entendre qu'un engagement n'aurait pas été respecté. Certes, la mise en œuvre de certains engagements prend plus de temps que prévu : c'est le cas d'une partie du contrat de plan État-région où, dans le domaine routier notamment, nous sommes en retard sur le taux nominal d'exécution. Mais cela a toujours été le cas pour tous les contrats de plan État-régions. » Et, sauf exception, l'engagement n'est pas renié, il sera bien tenu. Pour résumer la situation, M. Pierre Mirabaud, Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a exprimé grosso modo le même sentiment devant votre Commission : « je ne crois pas qu'on puisse dire que l'État se désengage : si le rythme d'exécution des contrats de plan s'est ralenti, l'État n'a pas, à ce jour, renoncé à des projets. Il met en place les crédits sur un rythme différent de l'engagement initial. » Cela s'est toujours produit : si on se donne toujours l'ambition d'exécuter totalement les contrats de plan, on n'y parvient presque jamais, et il est assez classique de connaître des difficultés durant le parcours, particulièrement aujourd'hui compte tenu de la situation économique et budgétaire très tendue, notamment depuis 2003. Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a cependant jugé possible et nécessaire de faire plus sur les contrats de plan, ce qui permettra sans doute de rattraper le retard actuel. Il a ainsi annoncé un nouvel effort supplémentaire dans sa déclaration de politique générale, le 8 juin 2005 : « j'entends relancer des grands chantiers d'infrastructure, en particulier dans les domaines routier et ferroviaire. Dans l'état de la conjoncture, notre économie a besoin d'un signal fort de redémarrage de l'investissement public, y compris en recourant à des financements innovants. J'ai, en outre, décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroute afin de financer ces grands travaux et de leur permettre de souscrire aux appels d'offre européens. Le produit de ces cessions ira notamment à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport afin d'accélérer les contrats de plan État-régions. » Le choix de ce vecteur d'action de l'État sur le territoire est évident : comme l'a précisé M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, « nous avons tout intérêt, dans une perspective de relance économique, à affecter des moyens financiers complémentaires à des projets existants. » En attendant cette relance, les derniers chiffres disponibles fournis par la DATAR, dont le détail par région et par ministère figure dans le tome III du présent rapport, conduisent à constater que l'exécution des contrats de plan14, pour la part relevant de l'État, était de 56 % des crédits engagés fin 2004, soit une année de retard puisque il aurait fallu être théoriquement à 71 %. Avant la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a présenté, en toute prudence, ses estimations à votre Commission : « nous serons à 75 % fin 2006 si nous restons sur le rythme d'un peu plus de 10 % de l'année dernière, et à 80 % si ce rythme peut être accéléré. [...] J'ai dit que nous avions actuellement un an de retard. Si nous sommes à 80 % fin 2006, cela signifiera que nous aurons un an et demi de retard, et deux ans si nous sommes à 75 %. » À titre de comparaison, les contrats de plan de la génération précédente (1994-1999) avaient aussi été exécutés avec une année de retard, au bout de six ans au lieu de cinq, avec un taux de 92,5 %. Les contrats relatifs aux routes, qui représentent près du quart des crédits contractualisés, sont exécutés par l'État à 56,3 % - en y incluant les sommes budgétées dans le cadre du plan de relance de la fin de l'année 2004, soit 244 millions d'euros sur un total de 300 millions d'euros. M. Patrice Parisé, directeur général des routes au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a estimé, s'agissant du volet routier des contrats de plan, que « si le rythme actuel des moyens budgétaires mis en place est maintenu en 2006 et au-delà, nous devrions pouvoir terminer en 2008. Mais évidemment, si les moyens sont inférieurs, les délais seront plus longs. » Des travaux ont été retardés, et quelques chantiers temporairement suspendus, mais aucune opération n'est abandonnée : l'exécution se fera au rythme de la délégation des crédits, sans aucun surcoût pour les régions. Les engagements seront de toute façon intégralement tenus, comme le prévoit l'article 24 de la loi du 13 août 2004, lequel garantit l'achèvement de toutes les opérations inscrites aux contrats de plan, même au-delà du 31 décembre 2006. Pour le volet ferroviaire, l'État en est à 33 % d'engagements par rapport au milliard d'euros programmé, mais on constatera que la programmation, neuf fois supérieure à ce qu'elle était dans la génération précédente des contrats de plan, était démesurée et donc inatteignable dès le départ. Des opérations nouvelles n'ont pas encore pu être engagées, mais aucune opération en cours n'a été interrompue. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, l'État en est à 64 %, avec un certain ralentissement en 2004 ; à 54 % pour l'environnement ; à 59 % pour l'agriculture ; à 36 % pour la santé et le social, en raison en particulier des difficultés sur le volet humanisation des hospices. La politique de la ville est le seul domaine où la prévision initiale est à peu près tenue à temps, avec 68,3%. Par ailleurs, l'État met en place, en 2005 comme en 2004, un septième des engagements du FNADT sur la partie contractualisée, attribuée aux préfets de région au titre des contrats de plan. Sur 1,1 milliard d'euros contractualisé au titre du FNADT pour la génération actuelle, plus de 150 millions d'euros ont été délégués en 2004, et plus de 170 millions d'euros devraient l'être en 2005. L'essentiel sera consacré aux contrats d'agglomération et aux contrats de pays, dont le démarrage a été assez lent jusqu'à présent. Les contrats de plan actuels, qui représentent un engagement annuel théorique de 2,5 milliards d'euros, ont été exécutés, selon les années, entre 1,8 et 2,2 milliards d'euros, soit 10 % à 13 % du budget civil d'investissement de l'État. Au cours des onze dernières années, l'investissement de l'État sur les contrats de plan a été, en moyenne, de 2 milliards d'euros, avec d'assez faibles variations. On observe donc une certaine constance en la matière. L'État est très linéaire dans la mobilisation de ses crédits. Il faut donc bien constater qu'il était en retard dès le départ : il a mis en place environ 10,9 % de l'enveloppe initiale en 2000 et 12,4 % en 2001, pour une part théorique d'un septième, soit 14,29 %. M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ne peut que constater qu'« avec de petits septièmes au début et des gros à la fin, les contrats sont très difficiles à respecter. » L'État n'est donc guère plus en retard que d'habitude, et il continue d'avancer, à son rythme, compte tenu des contraintes lourdes pesant sur son budget : c'est bien pourquoi on peut considérer l'exécution des contrats de plan comme tout à fait correcte. En revanche, une tension peut apparaître du fait que les régions sont, elles, globalement « en avance ». On constate en effet que, si l'État a exécuté les contrats à 56 %, les conseils régionaux sont à 65,5 % fin 2004. Il faut noter que ce taux est gonflé par le fait que plusieurs conseils régionaux sont allés bien au-delà de leurs engagements initiaux pour certaines politiques, par exemple pour les aides à l'agriculture ou le développement des entreprises : ils ont alors comptabilisé leur engagement pour la part supérieure à l'inscription dans le contrat, ce que ne fait pas l'État. De même, la plupart des conseils régionaux ont comptabilisé dans ce chiffre des programmes complémentaires, en réalité hors contrat de plan, comme le théâtre auditorium en Poitou-Charentes ou le programme Saône-Rhin et RN 7 en Bourgogne. Que faut-il entendre alors par les nombreuses « avances » que les régions auraient faites à l'État ? On constate très traditionnellement que, pour un certain nombre de politiques où l'État est maître d'ouvrage et où les conseils régionaux, voire les conseils généraux, interviennent sous la forme de fonds de concours, ceux-ci sont souvent appelés en début de programme et représentent donc une avance de trésorerie qui s'efface au fur et à mesure de l'avancement des chantiers et de la mobilisation concomitante des crédits d'État. Les collectivités territoriales ne font pas une avance remboursable, il s'agit simplement d'une mobilisation plus rapide de leur engagement initial. Comme l'a confirmé M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, « autant il est exact que les régions ont payé plus vite que l'État, autant les régions n'ont jamais payé la part de l'État. » M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a bien décrit le processus classique des avances en ce qui concerne le volet routier des contrats de plan : « les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes ont assez systématiquement versé leur concours dès l'engagement des opérations, conformément au plan initial, l'État intervenant pour sa part plus tard que prévu. Il s'agit alors d'une avance de trésorerie pour l'État, mais cela ne coûte pas plus aux régions et on ne peut pas parler de transfert de financement. [...] Lorsqu'il y a des fonds de concours sur des opérations à maîtrise d'ouvrage de l'État, ces fonds sont versés au démarrage de l'opération. La collectivité fait donc une avance de trésorerie à l'État, qui met plus de temps à verser les fonds, ne serait-ce que parce qu'il doit obtenir le visa du contrôleur financier au titre des marchés publics. Il a pu arriver que cette avance soit assez longue en raison du gel des crédits de l'État, mais on ne peut pas parler pour autant de dépense supplémentaire pour les collectivités territoriales. [...] S'il y a des intérêts moratoires parce que les travaux ont été achevés avant la disponibilité effective des crédits de paiement, c'est l'État qui les acquitte. Je le répète, il s'agit d'un phénomène de mobilisation plus ou moins rapide des crédits de l'un ou de l'autre, et pas du tout d'un transfert de charges, ou de l'engagement de frais financiers particuliers. » M. Patrice Parisé, directeur général des routes au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a décrit le même processus lors de son audition par votre Commission : « chacune des opérations inscrites aux contrats de plan fait l'objet d'une convention, conclue entre l'État et la région concernée, comportant un échéancier de déroulement des travaux et de versement des fonds de concours. Ensuite, les échéanciers peuvent être révisés ou non. Certaines régions préfèrent verser les fonds de concours prévus initialement sans tenir compte de l'avancement physique des opérations, tandis que d'autres sont très attentives à adapter leurs versements à l'avancement réel des travaux ; cela se fait d'un commun accord entre les services déconcentrés de l'État et les régions. Certaines d'entre elles choisissent même parfois, pour accélérer la réalisation de telle ou telle opération, de verser leurs fonds de concours alors même que l'État n'est pas en situation de dégager des crédits de paiement. » Plutôt que de faire de prétendues avances, à seule fin de justifier une augmentation de la fiscalité locale, les régions ont fini par comprendre qu'elles pouvaient beaucoup mieux gérer leur argent. Il n'est en effet pas de bonne gestion de laisser ainsi « dormir » des crédits. Selon le constat de M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, « la période n'est quand même pas très longue, puisqu'on mobilise le fonds de concours de la collectivité territoriale quand le projet est prêt et quand on espère pouvoir l'engager. Le décalage peut donc être d'un ou deux ans, pas de sept, et il a plutôt tendance à se réduire, car les conseils régionaux se sont aperçus qu'ils faisaient un peu de trésorerie pour le compte de l'État, ce qui les a amenés à être plus attentifs à la date de versement des fonds de concours. » M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, est du même avis : « si certains cas me paraissent justifier qu'une collectivité, estimant qu'il y a une réelle urgence, souhaite faire l'avance sur un financement à venir, de telles interventions doivent rester ponctuelles et ne pas obérer ses finances, ni celles de l'État. » Du point de vue de M. Michel Thénault, préfet de la région Alsace, « il est exact que les collectivités territoriales en Alsace, toutes catégories confondues, ont, par rapport aux engagements de l'État sur l'ensemble des infrastructures, 7 millions d'euros d'avances en fonds de concours. Mais l'an dernier, c'était le contraire... Autrement dit, même si c'est un peu cavalier, nous sommes dans l'épaisseur du trait par rapport aux volumes d'investissements inscrits dans le contrat de plan, en ce qui concerne le rythme d'appel de fonds. » De manière plus générale d'ailleurs, M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, constate, en ce qui concerne le rythme d'exécution des engagements des régions sur les contrats de plan « de grandes variations, qui peuvent aller du simple au double voire au triple, entre les années comme entre les régions, en fonction de l'état d'avancement des projets. » Il faut quand même signaler un nombre limité de cas où, en l'absence de crédits d'État disponibles, des collectivités territoriales ont décidé librement, soit de payer le surcoût d'une opération, comme cela a été fait pour l'opération ferroviaire Cannes-Grasse, soit de décroiser les financements, notamment en Rhône-Alpes - la région prenant totalement en charge une opération et l'État une autre, sans que les deux soient alors simultanées. Les opérations avancent chacune à des rythmes différents, chacun reprend ses billes selon ses intérêts et on ne parle plus alors de contrat de plan. Il eut mieux valu, dès l'origine, ne pas contracter sur ce qui n'était pas tenable ou réaliste. S'agissant maintenant des fonds structurels européens, le total objectif 1 + objectif 2, toutes dépenses confondues, est de 28,3 milliards d'euros pour la période 2000-2006 ; l'Union européenne en apporte 8,3 milliards d'euros. Les crédits des contrats de plan ont pu servir, dans un certain nombre de cas, de contreparties nationales aux fonds européens ; c'est souvent le cas dans les départements d'outre-mer, où les crédits européens sont abondants. Mais les champs de compétence et les poids relatifs de ces crédits ne sont pas les mêmes : alors que 40 % des contrats de plan sont consacrés aux infrastructures de transports, il ne s'agit que d'un investissement marginal au titre de l'objectif 2, au moins en métropole, avec quelques exceptions comme Port 2000 ou le tunnel du Lioran. Selon la DATAR, entre 15 % et 20 % des champs d'action des crédits européens et des contrats de plan se chevaucheraient. Les documents de programmation (DOCUP) ont été préparés en liaison entre l'État et les régions et l'exécution se fait dans le cadre d'un comité de programmation coprésidé par le préfet de région et par le président du conseil régional. La part de l'État et celle des régions dans les contreparties aux crédits européens sont équivalentes, soit environ 20 % du total de la dépense. Le taux de programmation des DOCUP est élevé : on était, au 31 mars 2005, à 73 % pour les crédits FEDER et FSE (objectifs 1 et 2), et à 92 % en termes de dossiers déposés. Ce taux s'est amélioré après les mesures de simplification prises en 2002, pour éviter que ne joue le dispositif européen de dégagement d'office des crédits non consommés dans les deux ans qui suivent la programmation. Ainsi, la France n'a rendu, pour 2003 et 2004, qu'une trentaine de millions d'euros, soit 0,02 % du total des programmes. Il n'y a donc pas non plus de « désengagement de l'Europe » à déplorer. b) L'État a contractualisé à un très haut niveau dans les contrats de plan D'où proviennent les « difficultés » rencontrées aujourd'hui dans l'exécution des contrats de plan ? D'abord de l'importance des montants concernés, presque pharaoniques pourrait-on dire - donc il faut du temps pour les « digérer ». Ensuite de la relative incohérence des contrats conclus par le gouvernement de M. Lionel Jospin. Que signifie un désengagement de l'État quand les montants sur lesquels il contractualise sont de plus en plus importants en volume. À chaque génération des contrats de plan - la quatrième est actuellement en cours d'exécution -, les crédits engagés se sont accrus de façon considérable,, avec des inscriptions en valeurs absolues de plus en plus fortes sur un certain nombre de lignes budgétaires et un élargissement du champ à de nouvelles préoccupations, comme la politique de la ville ou la cohésion sociale. L'annuité théorique initiale des contrats de plan, s'agissant de la part de l'État, est ainsi passée de 1,25 milliard d'euros pour la première génération (1984-1988) à 2,5 milliards d'euros pour la génération actuelle. L'État s'est au total engagé pour un montant de 17,7 milliards d'euros, si on ajoute aux contrats de plan actuels les grands programmes interrégionaux comme le plan Loire, le programme du Mont-Saint-Michel, le programme « après mines » en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais, les conventions interrégionales de massifs, les grands programmes et les contrats spécifiques pour les territoires d'outre-mer, ainsi que les avenants « marée noire » et « intempéries » après les événements de la fin de l'année 1999 (pour 600 millions d'euros). Le financement des approches territoriales est aussi apparu progressivement à partir de la deuxième génération des contrats de plan, avec le fonds régionalisé d'aide aux initiatives locales pour l'emploi (FRILE) et les programmes d'aménagement concentré du territoire (PACT) et, aujourd'hui, avec les crédits substantiels (25 % de la part État) du Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire (FNADT) pour financer les contrats de pays, d'agglomération, de ville, de réseau de ville et de parcs naturels régionaux. On ne peut aucunement affirmer, comme M. Philippe Laurent, président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, lors de son audition par votre commission, que le plan « Universités 2000, dès l'origine, constituait de fait un désengagement de l'État. » Bien au contraire, l'État a décidé de s'engager, en partenariat avec les collectivités territoriales, pour faire plus qu'il ne faisait avant en matière d'enseignement supérieur. Les investissements réalisés ne l'auraient pas été si l'État seul, ou les collectivités territoriales seules, avaient souhaité les réaliser. Il est apparu nécessaire à tous les décideurs politiques, nationaux et locaux, que le développement des formations supérieures serait un atout pour la France et ses territoires. Tout le monde, à commencer par l'État, a donc fait plus. Comme le décrit fort justement M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la situation est en fait exactement inverse : « il y a eu aussi, de la part des acteurs locaux, un intérêt marqué pour la réalisation d'un certain nombre d'investissements. Chacun sait, par exemple, l'intérêt que portent les collectivités au réseau routier ou aux universités. Le plan Universités 2000 a ainsi été l'occasion de créer, dans de nombreuses villes moyennes, des antennes universitaires pour lesquelles les contributions locales ont été assez faciles à mobiliser. J'ai même l'impression que, dans certains cas, l'État n'a pas mis beaucoup d'argent pour la réalisation de l'opération. Je ne crois pas en tout cas qu'il ait beaucoup brusqué les collectivités territoriales, et, la plupart du temps, un accord a été obtenu sur l'augmentation des sommes en jeu. » Le volet ferroviaire a été très largement surdimensionné. Ainsi que l'a rappelé M. Jean-Marie Bertrand, directeur général de RFF, lors de son audition par votre commission, « les contrats de plan État-régions actuels sont la première génération de contrats de plan avec un volet ferroviaire aussi important. Son montant a été multiplié par neuf par rapport à la génération précédente. Les engagements signés dans des conventions de financement, pour la génération des contrats de plan en cours 2001-2006, s'élèvent à 1,6 milliard d'euros, dont 821 millions d'euros à la charge des collectivités territoriales, soit 51 % du total, et le reste se répartit entre l'État et RFF. Ce sont des engagements de la génération 2001-2006, mais la réalisation des travaux pourra déborder au-delà de 2006. Les conventions en cours de signature, qui sont dans la « moulinette » de RFF et qui concernent les projets prêts à être réalisés, représentent 1,45 milliard d'euros, dont 740 millions d'euros seront fournis par les collectivités territoriales, soit la même proportion de 51 %. Il faut encore ajouter 140 millions d'euros d'opérations tronçonnées dans le temps, compte tenu des contraintes de disponibilité des autorisations de programme du budget de l'État, mais dont on peut penser qu'elles seront finalement réalisées. Au total, les investissements programmés s'élèvent donc à 3,2 milliards d'euros courants. » D'une certaine façon, cette pléthore de projets est la conséquence d'une préparation au mieux brouillonne, voire plutôt démagogique et peu responsable, des actuels contrats de plan par le gouvernement de M. Lionel Jospin. La plupart des difficultés d'exécution rencontrées aujourd'hui résultent d'une mauvaise programmation initiale. Comme peut le constater aujourd'hui M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, « l'État est sans doute allé, dans la génération actuelle, au bout de ses possibilités financières. Certes, on n'avait pas prévu la mauvaise conjoncture économique internationale qui a entraîné des difficultés budgétaires et a amené l'État à réduire son financement annuel, mais il y avait, au moment de la signature des contrats, une ambition très forte. » Le rapport commun de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration sur l'avenir des contrats de plan État-régions, remis au Premier ministre en mars 2005, constate également que « l'État se met lui-même en difficulté, prenant des engagements qu'il ne s'est pas assuré de pouvoir tenir. » Le système des contrats de plan a été plutôt inflationniste en raison de la multiplication des intervenants sur toutes les problématiques, sans désigner réellement de chefs de file ni cibler d'axes principaux. Un recentrage sur quelques grands axes thématiques serait souhaitable pour la négociation de la prochaine génération des contrats de plan. Une plus grande coordination avec le cadre européen permettra également de disposer d'une vision stratégique plus cohérente. D'ailleurs, pour la prochaine génération des contrats de plan, les analyses convergent assez largement entre acteurs en faveur d'une approche stratégique préalable aux documents de programmation, d'un contenu des contrats plus sélectif, de la notion de chef de file de la région et d'une amélioration des dispositifs de suivi. Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) de décembre 2003 a aussi fixé un certain nombre de principes de bon sens, qui ne semblent pas avoir été respectés en 2000 mais qu'il faudra avoir à l'esprit pour l'avenir : notamment, inscrire l'action publique dans une vision à long terme et redonner une lisibilité et une crédibilité aux contrats de plan - ce qui implique des contrats plus courts et plus resserrés. Le processus initial de contractualisation de la génération actuelle des contrats de plan a aussi poussé à des engagements plus importants que ce qui était prévu initialement. En effet, il y a eu deux étapes : la première enveloppe attribuée concernait la majeure partie des crédits et a donné lieu à des négociations entre l'État et chacune des régions, une deuxième enveloppe a été attribuée ensuite pour procéder à des ajustements. Cela a sans doute poussé à majorer les enveloppes globales et à contractualiser des sommes considérables par rapport aux chapitres budgétaires concernés, parfois à hauteur de 100 % de leur montant de l'époque - pour répondre à la fois aux demandes des collectivités territoriales et des ministères. Sans doute certains ministères avaient-ils aussi alors l'idée que les crédits des contrats de plan pourraient être sanctuarisés et échapper à la régulation budgétaire. Ceci contribue à expliquer la très forte progression des contrats de plan. Plus grave encore, M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a constaté qu'« une des difficultés de l'exécution des contrats de plan actuels tient au fait qu'ils ont été bâtis avec des projets qui n'étaient pas suffisamment mûrs. » M. Jean-Marie Bertrand, directeur général de RFF, confirme ainsi que nombre de projets ferroviaires étaient mal préparés : « les programmes des contrats de plan État-régions étaient ambitieux, tels que définis au départ [...]. Ils ont été établis à partir d'évaluations assez grossières parce que les projets initiés n'avaient pas toujours été étudiés de façon approfondie, ce qui a posé certaines difficultés par la suite, certains s'étant révélés plus onéreux que prévu. Ces projets correspondaient généralement à des besoins avérés. Mais l'analyse que nous avons faite de certains projets a montré ensuite, soit qu'il fallait les modifier, soit que le coût était différent de celui qui avait été estimé, soit qu'ils ne revêtaient pas de caractère prioritaire en termes d'analyse des capacités. RFF s'est attaché à faire partager cette appréciation à ses partenaires, de sorte qu'un nombre non négligeable de projets ont été abandonnés. » Toujours en ce qui concerne le volet ferroviaire des contrats de plan, M. Patrice Raulin, Directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, fait le même constat et propose une nouvelle méthode pour l'avenir : « les opérations d'électrification, de doublement de capacité ou de suppression de nœuds ferroviaires pour améliorer la capacité ont foisonné, parfois sans études techniques préalables, et les régions ont beaucoup insisté pour les inclure. [...] La plupart de ces opérations n'étaient pas prêtes techniquement [...] Objectivement, que ce soit pour le fret ou le transport de voyageurs, l'utilité de certaines opérations, notamment au regard du taux de rentabilité ou du trafic induit espérés, n'était pas totalement justifiée en période de pénurie budgétaire. [...] Après cette génération de contrats de plan, il faudra donc négocier de manière plus sélective et critique avec les régions. [...] Il convient aussi d'introduire plus de rigueur économique, et cela passe notamment par des études socioéconomiques plus poussées que celles dont nous disposions lors du lancement des contrats de plan en cours. » M. Francis Idrac, alors préfet de la région Languedoc-Roussillon, a aussi relevé, le 19 avril 2005, l'inanité de certaines inscriptions aux contrats de plan : « certains engagements inscrits dans le contrat de plan État-région relèvent soit du surbooking, soit du « sous-booking ». Ainsi la ligne Béziers-Neussargues fait-elle l'objet d'une inscription budgétaire qui ne correspond pas à grand-chose : totalement insuffisante si l'on vise à en faire une ligne de fret remontant vers Paris et totalement surabondante dans le cas de travaux d'entretien visant à assurer son niveau de prestations actuel. » Il vaut mieux parfois aussi attendre des études complémentaires avant d'engager des travaux qui ne répondraient en fait absolument pas aux objectifs recherchés. On comprend mieux la nécessité de ne pas engager n'importe quelle opération pour sécuriser les berges du Rhône, malgré les pressions bruyantes des élus, quand on entend M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, expliquer, « s'agissant de la protection contre les inondations, [que] le problème ne s'est pas tant posé au niveau de la mobilisation des crédits, au niveau du CPER comme des fonds européens, qu'à celui de la maturation de projets prêts à être financés. Il est toujours très difficile et très long de mettre au point des projets arbitrant valablement entre l'amont et l'aval, la rive gauche et la rive droite. La philosophie de la protection elle-même a évolué, dans la mesure où l'on s'est rendu compte que la technique des digues était finalement le système de protection le plus meurtrier et qu'il convenait d'adopter une approche différente de gestion dynamique des crues. La protection contre les inondations appelle un effort considérable, que nous avons récemment chiffré à environ 700 millions d'euros. Mais c'est une problématique pour l'avenir ; les crédits disponibles, au niveau tant du CPER que des fonds européens, sont longtemps restés inemployés. Ainsi, la protection des basses plaines de l'Aude, à la suite des inondations de 1999, n'a toujours pas donné lieu à un projet faisant consensus. » Au total, l'État s'est donc trop largement engagé en 2000, sur des projets qui ne le méritaient pas nécessairement, et il a raison de faire des choix selon les actions qu'il juge aujourd'hui les plus prioritaires, compte tenu de la situation économique du pays. Pour autant, son volume d'engagements reste très élevé, bien au-delà des seuls contrats de plan, ce qui discrédite par avance toute augmentation de la fiscalité locale dont la responsabilité serait imputée à l'État. c) La mesure de l'effort financier de l'État sur les territoires L'effort de l'État sur le territoire d'une région ne s'apprécie pas uniquement en additionnant les divers engagements de l'État au profit de chacune des collectivités territoriales ; il peut prendre d'autres formes. En effet, l'intervention financière de l'État dans une région est multiforme. Elle traduit d'abord la mise en œuvre de ses missions traditionnelles. Elle correspond aussi au développement d'un certain nombre de fonctions de production de biens et services, ou à l'exécution d'opérations de redistribution ou de transfert. L'exercice de ces fonctions et de ces missions se traduit chaque année par des dépenses financées sur le budget de l'État et qui, d'une façon ou d'une autre, viennent alimenter et soutenir l'économie régionale. Les dépenses enregistrées sont de nature très diverse, elles relèvent du fonctionnement comme de l'investissement, elles s'expriment par le versement de salaires et de pensions, l'exécution de marchés publics, l'attribution de subventions aux collectivités territoriales et d'aides aux particuliers ou aux entreprises. Tous les secteurs d'activités sont concernés, la culture comme la défense nationale, l'enseignement, le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture, l'environnement, la justice et la sécurité publique. M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, a cité quelques unes des nombreuses interventions de l'État qu'il coordonne : « le désengagement de l'État est parfaitement contredit par la réalité des chiffres, particulièrement dans tous ceux liés à la cohésion sociale, où les dépenses de l'État se sont élevées à des sommets auparavant jamais atteints. Ainsi, en matière de logement social, nous avons financé en 2004 quelque 4 000 PLU, PLAI et PLS, contre 2 300 en 2003. De la même façon, la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, si elle ne s'est traduite en 2004 que par quelques subventions d'urgence, devrait mobiliser dans les mois qui viennent plus de 200 millions d'euros au bénéfice des collectivités territoriales qui font agréer leurs projets de restructuration urbaine. Bref, le thème du désengagement de l'État me paraît devoir être pondéré au vu des nombreux cas où l'État va au-delà de ses précédents engagements. [...] Si l'A 750 fait l'objet d'un financement dans le cadre du contrat de plan, l'A 75 est payée en totalité par l'État et représente un montant grosso modo égal à la somme des crédits routiers engagés au contrat de plan. Autrement dit, si l'État est en retard dans le CPER, il consent hors CPER un effort tout à fait considérable. » L'engagement financier de l'État hors contrat de plan En Île-de-France, le contrat de plan ne constitue qu'une faible part des crédits consacrés à la région par 1'État, comme le montrent les données fournies par la préfecture de région. S'agissant du volet logement, les crédits contractualisés concernent seulement la région et s'élèvent à 130 millions d'euros sur la période 2000-2006, soit 20 millions d'euros par an. L'État apporte de son côté une contribution, hors contrat de plan, de 250 millions d'euros par an. S'agissant du volet enseignement supérieur, l'État assure seul le financement des opérations de désamiantage de Jussieu et de la location des locaux tampons. Le coût estimé de l'opération est de 750 millions d'euros. Plus de 500 millions d'euros ont été dépensés depuis 1997. La part des crédits de l'État pour le volet emploi- formation du contrat de plan - 42 millions d'euros - est mineure au regard de l'ensemble de l'effort financier de l'État pour l'emploi dans la région Île de France, soit 6 milliards d'euros selon la loi de finances pour 2004, dont : - 3,5 milliards d'euros au titre du développement de l'emploi (allégements de charges) ; - 1,4 milliard d'euros au titre de la politique d'accès et de retour à l'emploi et des contrats aidés ; - 0,9 milliard d'euros au titre de l'accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques (apprentissage, formation à l'alternance, VAE...). S'agissant de la politique de requalification urbaine, l'État a prévu, hors contrat de plan, de déléguer 310 millions d'euros sur la durée du contrat pour les opérations des grands projets de ville (GPV) et les opérations de renouvellement urbain (ORU). Fin 2004, 200 millions d'euros sont programmés. Face à ces 310 millions d'euros hors contrat de plan, la région programme 75 millions d'euros hors contrat de plan. Si on ajoute à ces engagements financiers de l'État et de la région, la programmation inscrite dans les contrats de plan (300 millions d'euros pour l'État et 225 millions d'euros pour la région), l'État consacre à la politique de la ville 610 millions d'euros, alors que la région y consacre 300 millions d'euros. Par ailleurs, l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) a programmé sur la région 120 millions d'euros en 2003 et 2004, dont 60 millions d'euros à la charge de l'État. Hors contrat de plan, l'ANRU a programmé, en 2003, 15 millions d'euros, financés uniquement par le budget de l'État, et, en 2004, 87 millions d'euros, qui sont pris en charge à parité par l'État et la région. Quand les départements se plaignent d'une compensation insuffisante au titre du RMI, ont-ils vraiment conscience des dépenses supplémentaires pour l'État que représente la montée en charge mécanique du dégrèvement total de taxe d'habitation, qui augmente en même temps que le nombre de titulaires du RMI et vient donc alimenter le budget du conseil général ? En fait, sait-on mesurer la totalité des dépenses de l'État sur un territoire donné, qu'il s'agisse du salaire des enseignants ou de la contribution aux investissements inscrits en contrat de plan ? Autrement dit, combien la République a-t-elle mis sur telle ou telle région, année après année, sur l'ensemble de ces fonctions, qu'elles soient régaliennes ou partagées ? Cette connaissance est un complément indispensable de la décentralisation, l'État n'ayant en rien à abdiquer son rôle sur les territoires. D'ailleurs, la loi du 2 mars 1982 prévoit que « chaque année, le représentant de l'État dans le département informe le conseil général par un rapport spécial de l'activité des services de l'État dans la région. » La plupart des rapports d'activité annuels réalisés par les préfectures ont cet objectif, mais selon une nomenclature non harmonisée, qui ne facilite pas les comparaisons et n'intègre pas toutes les dépenses qui pourraient être concernées. Comme le précise M. Pierre Mirabaud, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale : « un certain nombre de préfets de région travaillent avec l'INSEE dans ce sens. C'est un exercice compliqué parce que bon nombre de dépenses sont difficilement localisables, comme celles liées aux retraites militaires, qui ne sont pas territorialisées. Dans le cadre de la création de l'Observatoire des territoires au sein de la DATAR et en liaison avec l'INSEE, nous avons la volonté de mieux approcher la totalité des dépenses de l'État, région par région. » M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, a expliqué sa démarche devant votre Commission : « je me livre tous les ans à un exercice peu aisé, qui consiste à donner une vision globale des interventions de l'État, hors dépenses de personnel, sur le territoire de la région et sur celui du département de l'Hérault. Ces indications sont consignées dans le rapport d'activité des services de l'État, dont la version 2003 est disponible et accessible sur Internet ; le rapport 2004 sera produit en juin. Exercice difficile, ai-je dit, dans la mesure où je ne peux pas me contenter des chiffres fournis par la trésorerie générale, qui se décomposent en trois grands " paquets " : les dépenses de personnel, les retraites et le reste. C'est précisément ce reste qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire les interventions de l'État, en fonctionnement comme en investissement. Or - et c'est toute la difficulté de l'exercice -, je tiens à y faire également figurer les dépenses de l'État qui ne transitent ni par la trésorerie générale, ni par la préfecture, et qui peuvent représenter des montants considérables : ainsi les financements qui sont originellement de l'État, mais qui transitent par le CNASEA et peuvent concerner des aides aussi bien au logement qu'à la personne, les CES, CEC et emplois jeunes, des aides à l'agriculture et à la viticulture, autant de « tuyaux » non maîtrisés par la trésorerie générale et qui n'en doivent pas moins figurer, à mon avis, dans l'effort de l'État. » Il faut aussi tenir compte des versements de la France à l'Union européenne. En effet, le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne permet de financer les aides versées sur le territoire français, ce qui permet de calculer un taux de retour. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi aujourd'hui des crédits relevant de l'objectif 2 (bassins industriels et zones en déclin, banlieues en difficulté) des fonds structurels, et demain de l'objectif de compétitivité au titre de la nouvelle politique de cohésion de l'Europe à 25. Mme Bernadette Malgorn, préfète de la région Bretagne, a transmis à votre Rapporteur l'état de ses travaux, en s'inquiétant de ce que certaines applications informatiques dérivées des conséquences de la mise en œuvre de la LOLF pour le budget de l'État, pourraient rendre plus difficile la traçabilité des crédits concernés. En la matière, le passage au nouveau régime juridique issu de la LOLF est certainement plus un révélateur qu'une source de difficultés dans le suivi territorial des actions del'État. Il serait possible à cet égard d'envisager un rapprochement avec le dispositif PRESAGE, mis en place par la DATAR pour assurer un suivi fiable des programmes européens et des contrats de plan. Pour donner un ordre d'idée, le total des sommes versées par l'État en crédits de paiement dans la région Bretagne s'est élevé pour l'exercice 2003 à 12,5 milliards d'euros, à comparer aux 6,2 milliards d'euros dépensés par les collectivités territoriales, et compte non compris de 630 millions d'euros de fonds européens. On citera quelques difficultés d'ordre méthodologiques rencontrées en la matière par la trésorerie générale de la région Bretagne. Le recensement effectué concerne exclusivement les crédits relevant directement du budget de l'État. La multiplicité des circuits de paiement, le nombre et la compétence géographique très disparate des ordonnateurs rendent cependant la tâche difficile. À titre d'exemple, une part importante des dépenses militaires est payée directement au niveau des services parisiens, comme pour certains organismes de recherches pourtant localisés dans la région. À l'inverse, certaines dépenses (justice, police) payées dans la région peuvent concerner des régions limitrophes. En outre, des sommes importantes en matière d'emploi ou dans l'agriculture sont directement versées par les ASSEDIC ou le CNASEA, sans transiter par les écritures des trésoreries générales. Il en est de même des aides personnalisées au logement payées par les CAF et de certaines dépenses militaires. Ces démarches devraient être encouragées et harmonisées, pour aboutir à une communication claire de l'effort réel de l'État sur chaque territoire. Dans ce sens, il serait souhaitable de demander au Gouvernement, à l'occasion du débat à l'automne sur le prochain projet de loi de finances, de compléter la présentation de deux documents annexes « jaunes », celui relatif à l'effort financier de l'État en faveur des collectivités locales et celui concernant l'aménagement du territoire, afin qu'ils répartissent l'ensemble des crédits de l'État entre régions. Les deux tableaux suivants, qui en sont extraits, récapitulent une grande partie de l'effort financier territorialisé de l'État, hors fonctionnement de l'institution administrative elle-même : 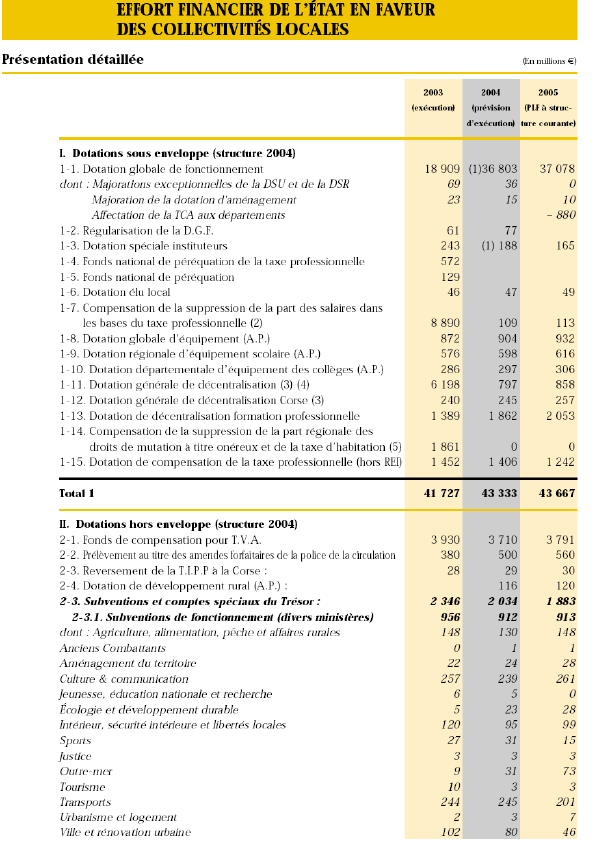 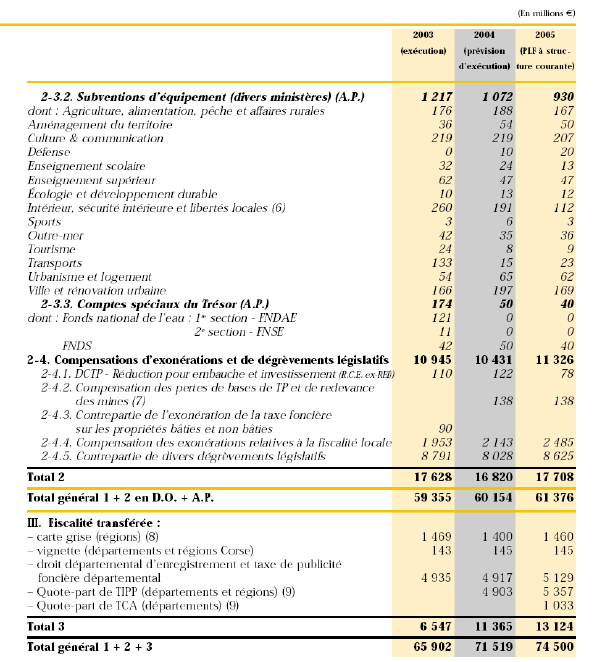 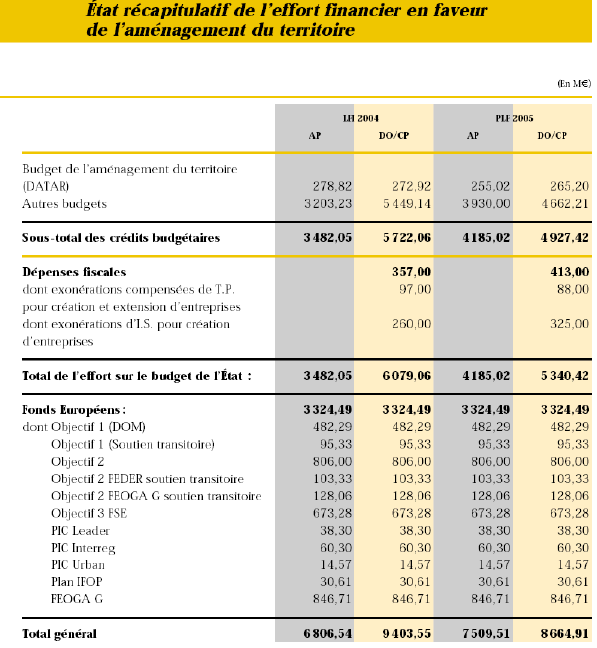 4.- L'incidence, marginale en 2005, des dépenses nouvelles liées aux compétences exercées depuis 1996 Outre le RMI, un certain nombre de transferts ou extensions de compétences et de financements ont eu des incidences sur les budgets locaux, avant l'acte II de la décentralisation. Les secteurs les plus lourds concernent l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les départements et les trains express régionaux (TER) pour les régions. Ils seront détaillés ci-après. On doit aussi mentionner, pour être exhaustif, la prime d'apprentissage et le CIVIS. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux régions la prise en charge du versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis. Ce transfert est applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2003, les indemnités servies au titre des contrats conclus avant le 31 décembre 2002 restant à la charge de l'État jusqu'au terme desdits contrats, soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. La loi de finances initiale pour 2003 a fixé les conditions du transfert aux régions des ressources destinées à compenser la charge du versement de cette prime d'apprentissage. De même, la loi de finances pour 2004 a confié aux régions la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) destinés aux jeunes en difficulté. Les charges qui en résultent pour les régions sont compensées par l'État au moyen d'une majoration des crédits du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Les projections budgétaires de la loi de finances pour 2004 ont été établies jusqu'en 2006 pour accompagner la montée en charge du CIVIS. Pour 2004, le cumul des crédits transférés aux régions au titre de la mise en œuvre du CIVIS représente 36,02 millions d'euros. Selon le rapport présenté en septembre 2004 par M. Joël Bourdin au nom de l'Observatoire des finances locales sur Les finances des collectivités locales en 2004, « suite à ces transferts opérés de 2002 à 2004, les budgets des départements ont progressé d'environ 25 % de 2001 à 2004 et la part prise par l'aide sociale dans leurs dépenses de fonctionnement est passée de 56 % à près de 64 %. Quant aux régions, leurs budgets ont progressé d'environ 16 % sur la même période, avec un net renforcement du poste transports. » On peut cependant commencer avant la décennie 2000 pour étudier certaines des causes d'augmentation de la fiscalité locale, en remontant à la départementalisation des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). a) La départementalisation des services d'incendie et de secours Un dossier relatif aux charges des départements au titre des SDIS figure en annexe, en page 81 du tome III du présent rapport. Comme l'a rappelé devant votre Commission M. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France, « les SDIS représentent au total 1,49 milliard d'euros de contributions, dont, en moyenne, 48,5 % de ce coût à la charge de départements. Là aussi, les disparités de coûts entre départements sont considérables : l'Aube consacre 5,90 euros par habitant au financement des SDIS, la Seine-et-Marne dépense 59,20 euros par habitant et la Corse-du-Sud 83,40 euros par habitant. À partir de 2008, la charge du financement des SDIS sera totalement supportée par les départements. » M. Jean-Yves Chamard, président de la commission des finances du conseil général de la Vienne, a expliqué devant votre Commission que « s'agissant du SDIS, tous les conseillers généraux connaissent le problème : la loi et les décrets ont eu un double effet mécanique d'augmentation des coûts. Pour commencer, l'amélioration des statuts des sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, a amené une meilleure rémunération, donc un surcoût ; mais celui-ci, pour les communes et les EPCI qui cofinancent les SDIS, a été plafonné en pourcentage et ne peut dépasser l'augmentation de la DGF. Pour parler simple, avec 10 % d'augmentation théoriquement payés moitié-moitié, si les communes ne paient que 3 %, les départements doivent financer 17 % ! Pour la Vienne, cela représente 2,2 millions d'euros. [...] Nous étions dans un système absurde, qui heureusement sera corrigé : nous ne contrôlions pas politiquement l'assemblée délibérative du SDIS, mais c'est nous qui supportions pratiquement la totalité de l'augmentation, celle des communes étant plafonnée ! » Dans le département du Rhône également, le président du conseil général, M. Michel Mercier, constate que « les dépenses sont passées de 4 millions d'euros par an à 90 millions d'euros entre 1996 et 2005. Aujourd'hui, nous avons un corps qui est un des premiers de France, sinon le premier, avec 4 000 volontaires. Nous avons créé 2 000 postes de volontaires pour remplacer des professionnels, bien qu'on nous ait dit à l'époque que ça ne pouvait pas marcher en ville, plus 1 500 professionnels. [...] Et ça va continuer, car l'an prochain il faudra changer tous les uniformes, ce qui coûtera 7 millions d'euros, soit encore deux points de fiscalité, et changer aussi toutes les radios des véhicules. » Selon M. Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin, « la compétence nous a été transférée, mais nous n'avons pas de référentiel de besoins d'équipement par habitant, ni en moyens humains ni en matériels. Comment savoir s'il nous faut, et où, un nouveau fourgon-pompe-tonne, une autre grande échelle, etc. ? Faute d'avoir une idée précise des standards, il y a un risque que la dépense explose sous la pression des demandes. » Pour M. Gérard Burel, président du conseil général de l'Orne, « le problème, [...] c'est que les sapeurs-pompiers ont pris l'habitude de négocier directement au ministère de l'Intérieur, sans que nous soyons conviés et sans qu'on nous demande notre avis. Nous n'avons plus, ensuite, qu'à financer ! » On a beaucoup dit qu'il s'agirait d'une compétence transférée, et qui devrait donc être compensée, mais tel n'est pas le cas : l'État n'a jamais financé les SDIS. Il s'agit de services historiquement communaux, dont la départementalisation a été engagée par la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Les départements contribuent aujourd'hui pour 50 % en moyenne15 aux budgets des SDIS, lesquels représentent 2,9 milliards d'euros au total. On comprend que l'impressionnant taux de croissance annuelle des dépenses, après la départementalisation, ait pu contrarier tous les gestionnaires et les responsables politiques de ces services. Il s'est en effet établi à 10,8 % en 1998 puis, successivement, à 26,8 %, 44 %, 17 %, 11,2 %, 8 % et enfin 6,4 % en 2004. Pour 2005, l'estimation fondée sur les budgets primitifs est encore de 6,2 %. Le plafonnement au taux d'évolution de la DGF des contributions des communes et des EPCI depuis 2002 se répercute mécaniquement avec un effet de levier sur les contributions des départements, qui doivent payer l'excédent. De ce fait, l'augmentation de leur contribution est de l'ordre de 10 % à 11 %, et il leur faut donc trouver encore cette année 0,32 point de recettes supplémentaires pour les SDIS. Évolution des contingents des départements aux SDIS de 1998 à 2004 France entière - (en millions d'euros)
Dans son rapport public pour 2004, la Cour des comptes a relevé les raisons de cette évolution des budgets des SDIS depuis la départementalisation : augmentation des effectifs liée à la forte croissance des interventions et à la mise en place progressive de la réduction du temps de travail, réformes indemnitaires et statutaires en faveur des sapeurs-pompiers professionnels, nécessité de moderniser des équipements matériels et immobiliers très souvent en état de vétusté ou d'obsolescence. Sur ce dernier point, la responsabilité en incombe très clairement aux communes, qui ont parfois cessé d'investir ou d'entretenir les équipements à l'annonce de la départementalisation. L'État n'y est pour rien sur ce point. Il convient toutefois de relativiser cette dépense, car la contribution au SDIS représente seulement 3,25 % des recettes de fonctionnement des départements et 2,05 % des recettes de fonctionnement des communes et des EPCI, soit une contribution de 26 euros par habitant pour les conseils généraux, à comparer aux 379 euros de dépenses d'aide sociale. Si, donc, les dépenses liées aux SDIS ont évolué extrêmement vite et continuent d'évoluer de manière significative, elles ne représentent pas un budget aussi considérable qu'on s'en inquiète souvent. Pour autant, le fait que ces dépenses de sécurité soient indispensables ne doit pas dissuader de chercher à les maîtriser. C'est pourquoi, comme l'a exposé devant votre Commission M. Christian Gaillard de Lavernée, directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, une rationalisation de ces services a enfin été engagée avec le vote de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Elle devrait consolider la modération de la croissance des dépenses engagée depuis 2004 et permettre de répondre à la plupart des critiques des conseils généraux. Lors de la préparation de la loi, le gouvernement a préféré corriger les quelques défauts de la départementalisation plutôt que de choisir l'étatisation, solution pourtant demandée par l'assemblée des départements de France mais qui paraissait contraire à l'histoire de ces services et contraire, aussi, au mouvement de décentralisation que le gouvernement entendait poursuivre à cette époque. Certaines mesures ont donc introduit dans la loi le principe d'un contrôle politique réel des départements, seuls financeurs à terme, sur l'ensemble de la vie des SDIS. La première mesure a consisté à modifier les règles de désignation des membres du conseil d'administration du SDIS - pour que chaque conseil général soit désormais assuré d'y avoir la majorité politique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il a aussi été inscrit dans la loi que le président du conseil d'administration du SDIS est, de droit, le président du conseil général, sauf s'il souhaite désigner un autre membre du conseil d'administration du SDIS pour assumer cette fonction ; en tout état de cause, il en est désormais la source de l'autorité politique. Ensuite, les dépenses ne sont plus votées librement par le conseil d'administration du SDIS pour se traduire en dépenses obligatoires du département : c'est au contraire le conseil général qui détermine librement sa contribution et indique au conseil d'administration du SDIS dans quel cadre budgétaire il doit exercer ses responsabilités de gestion. En outre, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est désormais soumis à l'avis du conseil général, et non plus seulement à celui du conseil d'administration du SDIS, avant son adoption par le préfet. Enfin, la loi donne aux conseils généraux qui le souhaitent la faculté de passer avec le SDIS une convention pluriannuelle, qui s'apparente au mode de tutelle moderne des établissements publics qu'est le contrat d'établissement. C'est donc un contrôle nouveau par le conseil général qui a été instauré, son président devenant l'unique autorité de gestion. En créant par ailleurs la conférence nationale des SDIS, la loi institue un second contrôle politique : celui du pilotage national des SDIS. La conférence est en effet composée d'élus, de représentants des sapeurs-pompiers et de représentants de l'État, mais les élus, avec vingt sièges sur trente-deux - dont quatorze pour l'assemblée des départements de France -, y disposent de la majorité. Et, même si des constitutionnalistes, consultés par le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, ont souligné à juste titre qu'une commission administrative ne peut pas émettre des avis conformes sur la préparation de projets de loi, les ministres de l'intérieur successifs, MM. Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, se sont engagés à respecter les avis de la conférence. Il s'agit d'un engagement politique, à défaut de pouvoir être juridique. Aucune normalisation concernant les matériels d'intervention et l'équipement des sapeurs-pompiers ne se fera sans l'avis favorable de la conférence nationale des SDIS. En d'autres termes, le gouvernement ne veut pas imposer des réformes ou des mesures nationales coercitives pour les SDIS sans avoir recueilli au préalable l'avis favorable de la conférence, où les élus sont majoritaires. On a donc créé avec cette conférence l'expression nationale du pouvoir local, ce qui manquait à un pilotage harmonieux et responsable des SDIS. La gestion départementalisée demeure, car il s'agit d'un optimum pour la gestion, mais les présidents des conseils généraux ont désormais les moyens de contrôler les mesures nationales qui peuvent s'imposer pour des raisons de qualité ou d'interopérabilité du service, ou en raison du statut unique des sapeurs-pompiers professionnels, lesquels font partie de la fonction publique territoriale. Enfin, la loi a été l'occasion de clarifier les responsabilités financières entre l'État et les conseils généraux qui, dans le prolongement de l'option retenue par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, deviendront les seuls et uniques financeurs des SDIS à partir du 1er janvier 2008. À cette date, la totalité des contingents incendie des communes sera remise sous forme de DGF aux départements. Dans le même temps, l'État a voulu marquer sa responsabilité dans deux domaines. En premier lieu, lors de circonstances exceptionnelles dans lesquelles un département ne se suffit pas à lui-même pour porter secours, la chaîne opérationnelle de l'État (avec les préfets de zone) organise les secours extérieurs et les finance : c'est la solidarité nationale qui s'exprime. En 2003, année lourde avec des feux de forêt et des inondations, cet effort lui a coûté 30 millions d'euros. La fiscalité locale finance le risque courant et le contribuable national les risques exceptionnels, par solidarité. D'autre part, l'État a substitué en 2003 au versement de DGF pour les SDIS un fonds d'aide à l'investissement, doté initialement de 45 millions d'euros, qui s'élève à 65 millions d'euros en crédits de paiement en 2005, et avec un objectif à cinq ans de 90 millions d'euros. L'objet de ce fonds est de faciliter l'adhésion de tous les SDIS aux projets d'investissement d'importance nationale, tel le projet ANTARES qui vise à assurer la modernisation des transmissions des SDIS et leur interopérabilité avec le réseau de transmission des services de police, et bientôt de gendarmerie. De plus, l'État a considéré, compte tenu de la demande sociale forte qui s'exprime en matière de sécurité, qu'il convenait de prévoir une progression des dépenses de sécurité civile supérieure à l'augmentation moyenne des autres dépenses. La loi de finances pour 2005 a donc prévu l'attribution aux départements d'une fraction de taux de la taxe sur les conventions d'assurance automobile (TCA), correspondant à 900 millions d'euros, en échange d'une part de la DGF. Cette ressource étant de 2,5 % plus dynamique en moyenne sur les cinq dernières années que la part de la DGF à laquelle elle se substitue, les départements en retireront chaque année un surcroît cumulatif de recettes de quelque 22 millions d'euros au départ, ce qui les aidera à supporter l'évolution des charges liées aux SDIS. Les inquiétudes exprimées à ce sujet devant votre Commission par M. Michel Klopfer, président-directeur général du cabinet Michel Klopfer, sont totalement infondées : il ne risque guère de se produire « un effet de ciseaux si jamais il s'avère que la TCA ne progresse pas, elle aussi [comme la DGF], de 3 % par an. » La loi de modernisation de la sécurité civile a également créé un régime de retraite par capitalisation pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cette mesure a été proposée par le gouvernement - et votée par le Parlement - avec la conviction que le tarissement du volontariat aurait des conséquences financières désastreuses sur l'organisation de la sécurité civile française. Cette politique de fidélisation a aussi pour avantage d'éviter de devoir répéter, à l'issue de chaque engagement de cinq ans, les frais que représentent l'équipement de chaque volontaire et les 240 heures de formation qui font un sapeur-pompier. Le coût de cette mesure, soit 60,3 millions d'euros, correspond, à très peu de chose près, à l'estimation initiale. Le budget de l'État en financera la moitié par de la DGF supplémentaire ; 20 millions d'euros ont été provisionnés à cette fin dans la loi de finances initiale pour 2005, et le projet de loi de finances pour 2006 devra prévoir un complément de 10 millions d'euros pour garantir l'accord politique et financier intervenu entre l'État et les départements. La charge des SDIS est donc bien réelle pour les départements, mais, notamment avec les moyens nouveaux accordés par l'État aux départements depuis 2003, il n'y a aucune raison pour qu'elle pèse de manière significative sur l'évolution des taux de fiscalité locale. Il importe pour cela que les responsables - les présidents de conseils généraux -, qui ont maintenant une responsabilité pleine et entière en la matière, optimisent la gestion de ces services. Il faut prendre la mesure des casernements nécessaires en redéfinissant le maillage territorial, ne pas nécessairement - comme c'est trop souvent le cas - atteindre les plafonds d'officiers définis par les statuts, gérer de manière plus dynamique les périodes de repos et de garde des sapeurs-pompiers professionnels et travailler à une bonne répartition des tâches entre SDIS, SAMU et professionnels de santé libéraux, notamment les ambulanciers privés. La Cour des comptes suggère également, dans son rapport public 2004, de mettre en œuvre des outils de contrôle de gestion et une véritable comptabilité analytique pour mieux mesurer l'activité, ainsi qu'une plus grande mutualisation des moyens. b) La prise en charge de la dépendance des personnes âgées La gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) a été confiée aux départements par la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, en substitution de la prestation spécifique dépendance (PSD). Il s'agit d'une extension de compétence, car la nouvelle prestation n'est soumise ni à condition de ressources - même si montant varie en fonction des revenus des bénéficiaires -, ni à récupération sur succession, et que son barème est national et étend la prise en charge aux personnes âgées moyennent dépendantes (relevant du GIR 4). Un dossier figure en page 141 du tome III du présent rapport. Selon M. Claudy Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France, « en ce qui concerne les dépenses au titre de l'APA, elles ont doublé entre 2002 et 2004, passant de 1,8 milliard à 3,6 milliards d'euros. La charge nette, pour les départements, est passée de 937 millions d'euros à 2,29 milliards d'euros. Quant à la compensation versée par l'État, via le Fonds de financement de l'APA (FFAPA), elle est passée de 48 % en 2002 à 36,4 % en 2004. Ces chiffres permettent de mieux apprécier quelles peuvent être les difficultés financières de l'ensemble des départements. Il faut savoir que le nombre de personnes de plus de quatre-vingt-cinq ans devrait doubler d'ici à 2025 et que les bénéficiaires de l'APA sont très inégalement répartis entre les départements : ainsi, le financement de l'APA coûte 8,59 euros par habitant dans le Val-d'Oise contre 23,98 euros par habitant dans la Creuse. » Ainsi que l'a joliment décrit M. Michel Mercier, président du conseil général du Rhône, l'APA « a été à la fois un coup et un coût pour le département ». Comme l'a rappelé M. Patrick L'Hôte, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin, « l'APA est souvent évoquée par les conseils généraux. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une compétence décentralisée, puisque l'État ne l'assumait pas auparavant. L'APA a été créée pour répondre à un besoin lié au vieillissement de la population. Ce serait un raccourci abusif, sinon une erreur de la considérer comme une compétence décentralisée. L'APA mériterait un traitement à part dans la mesure où ce n'est pas une conséquence de la décentralisation, mais une nouvelle prestation que les conseils généraux ont d'ailleurs revendiquée. Rappelons également que l'augmentation de l'APA tient principalement à l'évolution démographique. » En fonction des éléments communiqués à votre Commission par M. Jean-Jacques Trégoat, Directeur général de l'action sociale au ministère de la santé et des solidarités, on constate que l'APA a connu une montée en charge très rapide, à un rythme beaucoup plus soutenu que prévu. En effet, alors que le gouvernement de M. Lionel Jospin avait estimé le nombre de bénéficiaires à 500 000 au 31 décembre 2002, 550 000 au 31 décembre 2003 et 800 000 au 31 décembre 2004, leur nombre réel s'est établi, respectivement à ces dates, à 605 000, 792 000 et 865 000. La population potentiellement éligible à l'APA s'inscrivait dans une fourchette allant de 790 000 à 950 000 personnes ; les prévisions ont été fondées sur la partie basse de la fourchette, si bien que l'évolution de la dépense a été mésestimée. L'APA explique à elle seule plus de 50 % de la hausse globale des dépenses de fonctionnement des départements en 2002. Dès sa première année d'existence, elle représente ainsi 4,5 % du montant total des dépenses des conseils généraux, 12 % de leurs budgets d'aide sociale (budgets primitifs) et 8 % de leurs dépenses de fonctionnement. Pour financer ces dépenses, les départements ont bénéficié d'un concours financier, géré par un établissement public national - le Fonds de financement de l'APA (FFAPA) -, destiné à prendre en charge une partie du surcoût de l'allocation, au moyen de l'affectation d'une part de CSG. Le montant total du concours financier du FFAPA aux départements a atteint 798 millions d'euros en 2002, soit 43 % des dépenses d'APA. Pour autant, malgré l'importance des concours financiers nationaux, des hausses de la fiscalité locale se sont souvent avérées nécessaires. Le surcoût net pour les départements représenté par l'APA a été financé pour partie en 2002 par une hausse des taux de fiscalité directe. Cette hausse a été de 3,5 % en moyenne, 66 départements ayant voté de telles hausses en 2002. L'année 2003 a vu une montée en charge très rapide de la nouvelle prestation. Les dépenses effectivement mandatées par les départements se sont élevées à 3,2 milliards d'euros, soit 73 % d'augmentation par rapport à 2002 ! Pour mémoire, les dépenses consacrées antérieurement par les départements à la PSD, à l'ACTP, à l'aide ménagère ou représentées par l'économie à réaliser sur l'aide à l'hébergement s'élevaient à 1,1 milliard d'euros. Par ailleurs, selon les estimations de la DREES, la gestion de l'APA nécessite en moyenne 5,1 agents départementaux en équivalents temps plein pour 1 000 bénéficiaires, sans que l'on puisse distinguer la part des recrutements de celle des redéploiements internes. En 2003, le montant du FFAPA aura été de 1,28 milliard d'euros ; celui-ci a donc assumé 40 % de la dépense totale (après prise en compte de la dépense résiduelle de PSD). Les dépenses supplémentaires ont été financées par des réductions de l'épargne et des augmentations de la fiscalité départementale. Les taux de fiscalité des départements ont ainsi progressé de 3,9 % en 2003 en moyenne (73 départements ont augmenté leur taux, certains de plus de 10 %). Encore la crise financière a-t-elle finalement été contenue. En effet, face au constat d'une impasse budgétaire, le Parlement a adopté en urgence une proposition de loi apportant des correctifs au plan de financement initial, afin de garantir la continuité du service de l'allocation. Ces mesures d'urgence, qui figurent dans la loi du 31 mars 2003, ont consisté dans le lancement d'un emprunt exceptionnel de 400 millions d'euros, une rationalisation des conditions d'ouverture des droits avec, notamment, l'abandon du caractère rétroactif de l'attribution de la prestation, un nouveau barème équilibré et des mesures de péréquation avec la création d'un concours spécifique pour les départements. Le montant de ce concours spécifique supplémentaire a été de 50 millions d'euros en 2003 ; il a permis de contenir à 21 % au maximum le taux d'effort fiscal destiné à l'APA pour tous les départements. Conséquence, en 2004, la croissance des dépenses liées à l'APA s'est infléchie très sensiblement, les dépenses atteignant 3,6 milliards d'euros, soit 10,6 % de croissance par rapport aux dépenses 2003. Il faut cependant tenir compte des moindres dépenses liées à la suppression de la PSD, soit 700 millions d'euros. La recette à percevoir par le FFAPA en 2004 aura été de 1,33 milliard d'euros ; le niveau de compensation de la dépense d'APA des départements par la solidarité nationale a ainsi correspondu à 37,4 %. Le concours spécifique, égal à 40 millions d'euros cette année là, a permis de plafonner le taux d'effort fiscal des départements à 30 %. Il convenait cependant encore de pérenniser le dispositif par le partage de la prise en charge des dépenses. Ce fut l'objectif de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, qui a institué la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la journée nationale de solidarité. Il sera ainsi possible d'affecter chaque année 400 millions d'euros de ressources pérennes supplémentaires à la Caisse, pour abonder le concours versé aux départements au seul titre de l'APA. Les dépenses d'APA connaissent encore une hausse significative en 2005, quoique un peu plus faible qu'en 2004 : + 7 %. Mais cette hausse est très localisée sur un petit nombre de départements où la montée en charge n'est pas terminée : l'exemple de la Creuse est le plus connu. La phase de montée en charge de l'APA semble désormais terminée dans la majorité des départements : la progression du nombre de bénéficiaires sur l'année 2004 n'est supérieure à 20 % que dans huit départements, la moyenne nationale étant de 9 %. Au vu de l'évolution passée et en se basant sur une certaine stabilisation du nombre de bénéficiaires, une augmentation de l'ordre de 5 % de ceux-ci en 2005 peut être raisonnablement envisagée. M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales, a résumé devant votre Commission les conséquences de l'APA sur l'évolution de la fiscalité locale : « les années 2002 et surtout 2003 ont connu une hausse notable de la fiscalité départementale, avec une évolution moyenne des taux de 4 %, à relier à l'accroissement des charges liées au transfert de l'APA, ainsi que des frais de personnel ; encore convient-il de remarquer que ce phénomène est intervenu après des années de très grande modération des taux - pour certains départements, il s'agissait de la première hausse depuis dix ans - et que seize départements n'ont augmenté leurs taux ni en 2002, ni en 2003. Du reste, la progression est beaucoup plus modérée en 2004. [...] Les augmentations relevées sont souvent le fait des départements qui n'avaient pas encore augmenté leurs taux en 2002 et 2003. [par exemple les Bouches-du-Rhône, qui augmentent fortement en 2004 après des années de stabilité] » M. Dominique Schmitt constate cependant la très grande diversité des situations, qui empêche d'évoquer un effet global similaire de l'APA sur la fiscalité de tous les départements : « la mise en œuvre de l'APA et sa montée en charge ont eu des impacts fiscaux très différents et non simultanés : à surcoût égal lié à l'APA, l'augmentation du produit fiscal peut aller du simple au triple d'un département à l'autre. Ajoutons que certains avaient augmenté leur fiscalité dès 2002, alors que d'autres ont attendu 2003, voire 2004. De la même façon, certains départements ont étalé la hausse sur deux ou trois années, tandis que d'autres ont préféré ne procéder qu'à une seule augmentation. Enfin, plusieurs départements n'ont pas augmenté leur taux de fiscalité directe, se contentant de la progression des bases. [...] Le surcroît de dépenses lié à l'APA a été estimé à un milliard d'euros en 2002 et 2003, mais les incidences de ce surcoût en termes de fiscalité locale sont très variables d'un département à l'autre. » La mise en œuvre et la montée en charge de l'APA ont eu des impacts fiscaux réels, mais très différents et non simultanés, et aujourd'hui terminés pour l'essentiel. Pour un même niveau de surcoût de dépenses lié à l'APA, l'augmentation du produit fiscal peut varier de 1 à 7 d'un département à l'autre, comme le démontre le graphique élaboré par la Direction générale des collectivités locales et figurant au tome III du présent rapport, ce qui témoigne d'une assez forte autonomie dans les choix budgétaires des collectivités territoriales. La montée en charge de l'APA étant aujourd'hui quasiment achevée, grâce aux mesures prises par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin pour rationaliser le dispositif et consolider les financements alloués à titre de compensation aux départements par la solidarité nationale, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ne peut plus constituer en 2005, sauf exception, une cause réelle d'augmentation de la fiscalité locale. Ou alors, un conseil général décide délibérément de faire plus. C'est ce qu'a expliqué devant votre Commission M. Marcel Charmant, président du conseil général de la Nièvre : « nous distribuons des prestations supérieures à celles imposées par la loi. Nous continuons par exemple à assurer le versement de l'APA dès que le dossier est réputé complet, sans attendre le délai de deux mois instauré par la modification législative de 2003. [...] Le coût horaire des prestations, dans la Nièvre, est légèrement supérieur à celui d'un département voisin comme l'Allier. Il faut dire aussi que le conseil général a encouragé les associations gestionnaires à réévaluer les salaires des professionnels de l'aide à domicile. » Dans ces conditions, l'exercice de la compétence n'est plus en cause, et l'augmentation de la fiscalité résulte bien d'un choix discrétionnaire. c) La décentralisation des services collectifs de voyageurs
Source : DGCL ; 2002 : généralisation du transfert de compétences à l'ensemble des régions hors Île-de-France, Corse et DOM (auparavant 6, puis 7 régions). Pour les régions, l'année 2002 a été marquée par la généralisation du transfert de la compétence relative au transport ferroviaire de voyageurs. Conformément aux dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), l'ensemble des régions métropolitaines, à l'exception de l'Île-de-France et de la Corse, sont devenues les autorités organisatrices des services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs. Cette généralisation faisait suite à une expérimentation menée depuis 1996 avec 6, puis 7 régions volontaires Les régions se sont toutes fortement investies dans cette nouvelle compétence et ont réellement pris cette préoccupation en main. Il est possible de dresser un premier bilan positif de la dynamique enclenchée par la loi SRU dans les transports express régionaux. Les responsabilités de chacun ont été clarifiées et un réel esprit de partenariat s'est instauré entre les autorités organisatrices et la SNCF. Du côté du client, on peut relever, outre la modernisation des trains, la mise en œuvre par les régions de nouvelles tarifications adaptées à l'évolution des besoins de la population : ainsi, l'apparition de formules d'abonnements aidés pour des déplacements domicile-travail de plus de 75 kilomètres, au-delà de la tarification sociale nationale, ou les tarifications spéciales à destination des jeunes, des étudiants ou des chômeurs. Les autorités organisatrices ont fait preuve d'une grande imagination. Un effort a aussi été engagé, et il faudra le poursuivre, pour améliorer l'intégration du train dans la logique du transport autour des agglomérations, avec le développement d'offres cadencées ou de nouveaux produits comme le tram-train. L'évolution a également touché la distribution, avec l'apparition de nouveaux outils de « billettique ». L'amélioration a enfin porté sur la qualité du service au client avec la certification de lignes, des programmes de modernisation des gares et la mise en place de centres de relation clients permettant une information plus fluide entre clients et transporteur. Des conventions, avec effet au 1er janvier 2002, ont été passées entre chacune des régions et la SNCF, par lesquelles celle-ci s'est engagée sur la réalisation du service, sur la maîtrise des charges dont elle détient le contrôle direct, sur un objectif de recettes, avec toutefois un mécanisme de partage du risque variable selon les régions, et sur des objectifs qualité assortis d'un mécanisme de bonus-malus ; la SNCF verse enfin des pénalités en cas de non-exécution du service. De son côté, l'autorité organisatrice rémunère l'exploitant et prend à son compte les charges non maîtrisables par la SNCF, notamment les péages dus par le transporteur à l'opérateur qui gère les infrastructures ferroviaires, à savoir Réseau ferré de France (RFF). Les charges forfaitisées, maîtrisées par la SNCF, représentent 75 % du total du compte des trains express régionaux (TER) en 2004 ; les charges au réel, prises en charge par les régions, s'élevaient à 18 % à l'origine en 2002 et à 25 % aujourd'hui. Les péages en représentent la plus grosse part. Du côté des produits, les recettes directes provenant de la clientèle représentent 27 % du compte TER, les compensations tarifaires 10 % et la contribution d'exploitation assurée par les collectivités territoriales 63 %. Autrement dit, le client final paie en moyenne un peu plus du quart du service sur l'ensemble des TER et le contribuable un peu moins des trois quarts. Ce ratio se retrouve dans de nombreux transports de proximité. Entre 2002, première année des conventions, et 2004 - chiffres provisoires fournis par la SNCF mais encore susceptibles d'ajustements -, on peut relever que les recettes ont augmenté de 8 % pour un trafic en progression de 5,5 %, et les charges hors péage ont crû d'un peu moins de 10 % alors que l'offre a progressé de presque 6 %. Hors prise en compte des péages, la contribution financière globale des régions est restée relativement stable, ne progressant que de 4,6 % entre 2002 et 2004, soit de 0,13 € à 0,14 € par voyageur. Durant le même temps, le coût du train-kilomètre est passé de 8,48 € à 8,84 €. La première exigence des régions a été que la SNCF assume ses responsabilités dans le domaine des coûts. La rémunération que celle-ci perçoit en application des conventions ne tient pas compte de l'évolution de ses coûts internes ; ses charges sont forfaitisées et les seules indexations retenues par les conventions sont liées à des facteurs externes. Aussi la SNCF a-t-elle été conduite à réaliser des gains de productivité pour pouvoir tenir cet engagement. Dans le même temps, régions et SNCF se sont employées à travailler ensemble pour trouver les moyens d'améliorer l'offre de transport à coût donné. L'offre de services a fait l'objet de nombreuses restructurations au niveau des dessertes, afin d'optimiser au maximum l'efficacité du capital humain et matériel investi. La loi SRU a prévu que la compensation financière aux régions du transfert de compétence des TER, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation, est constituée de trois composantes. Premièrement, une contribution pour l'exploitation des services ferroviaires régionaux a été calculée à partir du déficit d'exploitation des comptes TER pour l'année 2000, attestés par un audit d'un cabinet de consultants à partir des comptes produits par la SNCF, puis indexée sur les taux d'évolution de la DGF de 2001 et 2002. Deuxièmement, une dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en œuvre par la SNCF à la demande de l'État (familles nombreuses,...). Elle remplace la contribution qui était versée par l'État à la SNCF. Troisièmement, une dotation complémentaire qui a vocation à aider au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services ferroviaires transférés. Le montant global du droit à compensation a donc atteint, en 2002, 1,5 milliard d'euros, réparti entre les régions par arrêté ministériel. La part de la dotation de l'État prévue pour le renouvellement du parc de matériel roulant a été calculée en relation entre l'État et les régions. Les commandes de matériel roulant portent toujours sur des périodes longues, d'où un effet d'anticipation. Pour la compensation financière aux régions, cet élément a été pris en compte dans la dotation générale de décentralisation. Les régions se sont lancées dans un gros effort de renouvellement et la modernisation du parc de matériel roulant, dont la durée d'amortissement est de l'ordre de trente ans. C'est pourquoi l'État a calculé la dotation sur la base du prix du parc divisé par trente. L'effort financier des régions est donc aujourd'hui important en investissement, mais il devrait diminuer naturellement à offre constante. Pour la période 1998-2009, le programme d'acquisition de matériel neuf financé par les régions représente à lui seul 4,5 milliards d'euros. Fin 2007, 55 % du parc aura été renouvelé ou fortement modernisé. Pour 2004, l'effort de la SNCF représente, en crédits de paiement, un montant de 47 millions d'euros, sur un total de 583 millions d'euros ; autrement dit, l'essentiel de l'effort d'investissement sur le parc de matériel aura été supporté par les autorités organisatrices. Une fois atteint l'objectif de 55 % en 2007, il restera encore un petit effort de rénovation pour les années 2010-2011, après quoi le stade d'une gestion normale de parc aura été atteint, avec des radiations de matériels plus anciens et d'inévitables rénovations, mais l'effort d'investissement en matériels neufs ne sera plus fonction que de la volonté de développement de l'offre manifestée par les autorités organisatrices. Un autre élément du droit à compensation a en revanche été fortement contesté par les régions : il s'agit des barèmes des péages. Les péages entrent en effet en ligne de compte dans les coûts de production des TER, et leurs augmentations se traduisent de ce fait par des dépenses supplémentaires pour les autorités organisatrices. Les règles de calcul de la compensation ont été fixées par l'article 125 de la loi SRU. Les mesures d'augmentation des péages décidées par le gouvernement s'accompagnent d'une autre mesure, symétrique, qui consiste à diminuer la subvention de fonctionnement que l'État verse à RFF, à due concurrence de l'augmentation estimée des péages. Le circuit financier lié à l'augmentation des péages TER est donc le suivant : les régions payent plus à RFF (via la SNCF), l'État verse une compensation financière équivalente aux régions, l'État diminue à due concurrence sa contribution budgétaire à RFF. Il s'agit donc bien, à l'instant t, d'un jeu à somme rigoureusement nul, sans gagnant ni perdant. Comme l'a précisé M. Jean-Marie Bertrand, directeur général de RFF, lors de son audition par votre Commission : « l'intérêt de l'opération, pour RFF, consiste à définir une nouvelle structure de prix, plus conforme à la réalité des coûts, laquelle s'applique pour l'avenir : le service supplémentaire désiré par les régions leur sera alors facturé au coût réel, sans que la charge ne repose indirectement sur RFF seul. Au fur à mesure que les investissements de capacité seront mis en service, l'augmentation du volume de trains-kilomètres assurés pour le compte des régions sera donc facturée au nouveau barème. [...] Mais cette augmentation des péages traduit aussi, plus fondamentalement, une amélioration de la rationalité économique, dans la mesure où les péages sont la rémunération d'un service. RFF vend des sillons, c'est-à-dire le droit de circuler sur une ligne entre deux points à une heure donnée, et ce service comporte un coût. Or, l'exploitation de RFF est structurellement déficitaire, notamment pour les lignes TER. Grâce à l'augmentation des péages, l'écart a été réduit entre les coûts et les produits, même si on est encore loin de l'équilibre. » Les péages d'infrastructure ont connu une première augmentation au 1er janvier 2002. La répartition de la dotation de compensation versée par l'État aux régions a été opérée sur la base d'une estimation des trafics réalisés en 2002. En fin d'exercice, des écarts ont été constatés et une compensation à l'euro près, région par région, a été opérée. Ces ajustements sont intervenus par amendement à la loi de finances rectificative pour 2004. En 2004, une nouvelle étape d'augmentation a été nettement plus sensible, puisque les péages se sont accrus de 214 millions d'euros hors taxes, soit un quasi doublement, et l'État a effectué un versement complémentaire aux régions de 225,8 millions d'euros à titre de compensation. Ce complément a été pris en compte dans le calcul de la dotation générale de décentralisation pour 2004, et le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est en train d'achever le même mécanisme de vérification, à partir des résultats des circulations des TER en 2004. Mais l'État n'augmente pas systématiquement les péages chaque année. Au contraire, pour les TER, après la forte hausse de 2004, une période de stabilité est prévue. En 2005 notamment, il n'y a eu aucune d'augmentation des péages TER qui aurait pu servir de justification à une quelconque augmentation de la fiscalité régionale. L'augmentation des péages TER effectivement perçus a été en fait de 286 millions d'euros en 2004. Elle a résulté de deux effets : un effet prix et un effet volume. S'agissant de ce deuxième élément, l'augmentation des circulations TER a été de 6,64 % : les circulations TER sont en effet passées de 148 millions de trains-kilomètres à 157,77 millions. Le nombre de trains augmente surtout sur les lignes les plus circulées, là où les tarifs sont les plus élevés. Il y a dans cet effet volume, d'une part, l'augmentation du réseau de dessertes et, d'autre part, l'augmentation du nombre de trains circulant sur les dessertes existantes. Dans ces deux cas, il s'agit d'une augmentation de l'offre de services décidée par les autorités organisatrices, et non d'une conséquence d'une décision de l'État. Les hausses des péages sont compensées par l'État à hauteur du trafic constaté au moment de celles-ci (et non simplement en référence au trafic à la date du transfert de compétence). Il est sans doute légitime et, en tout cas, avantageux, que les régions ne supportent pas financièrement les décisions prises par l'État en la matière, pour les services déjà existants. Si le conseil régional décide de créer un service nouveau qui sera opérationnel l'année suivante - où les péages auront augmenté -, le barème des péages dont il a connaissance est celui publié lorsque la décision intervient. La compensation correspond à l'effet qui n'a pas pu être prévu par l'exécutif régional. Celui-ci aurait en effet pu décider, à ce tarif, de ne pas créer de services nouveaux. Pour les hausses constatées sur le barème 2004, la compensation sera donc calculée en fonction de la réalité des TER en fonctionnement en 2004, c'est-à-dire pour les services décidés auparavant. En revanche - et c'est là que les régions expriment à tort leur mécontentement -, si un exécutif régional décide de créer de nouveaux services TER dans le courant de l'année, après la hausse des péages - ce qui s'est largement produit en 2004 -, il assume bien évidemment cette charge supplémentaire. Comme l'a affirmé M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer : « si les locations de réseau augmentent, le transfert de l'État vers les régions sera accru. En revanche, si les régions souhaitent créer de nouveaux services, cette décision leur appartient, et le financement aussi, sans quoi la décentralisation ne signifierait plus rien. Une dépense ne peut pas être décidée par une collectivité publique et assumée par une autre : c'est clair dans l'esprit de chacun. » Les régions ayant des projets de développement (et non simplement en référence au trafic à la date du transfert de compétence), les trains futurs paieront des péages plus chers, ce que l'État ne compensera pas. La dotation de compensation est réajustée au moment de la réévaluation du barème, sans préjuger des développements futurs décidés ultérieurement par l'autorité organisatrice. Le péage recouvre quatre éléments de tarification : le droit d'accès au réseau ; le droit de réservation d'un sillon tel jour à telle vitesse ; le droit de réservation des arrêts en gare ; le droit de circulation, c'est-à-dire la prise en compte de l'effectivité de la circulation. Sur les 430 millions d'euros de péages TER, le droit de réservation des arrêts en gare (DRAG) est le principal élément : il représente 42 %. En effet, l'augmentation des recettes de péages des TER en 2004 a essentiellement portée sur ce droit de réservation, la logique étant de tarifer l'occupation de capacité : sur les lignes très circulées, un train qui s'arrête est d'autant plus consommateur de capacité, alors qu'un train qui ne s'arrête pas passe rapidement et consomme moins de capacité. D'où la boutade, entendue lors des auditions : « il vaut mieux qu'un train ne s'arrête pas ! » Dans les comptes TER de chaque région, avant les 214 millions d'euros d'augmentation en 2004, les péages représentaient en moyenne 10 % des charges, à côté des frais de conduite, de gare, d'accompagnement ou d'amortissement du matériel. Aujourd'hui, ce poste - même s'il est en partie compensé - représente 20 %, autour desquels il y a une certaine dispersion. Le coût financier supplémentaire pour les régions est tout à fait apparent. Pour autant, les autorités organisatrices ne sont pas perdantes. Tout d'abord, elles peuvent récupérer en partie le coût de l'augmentation des péages lorsqu'elles décident de créer de nouveaux services. En effet, comme l'a indiqué M. Bernard Sinou, directeur du transport public de la SNCF, lors de son audition par votre commission, « la SNCF réalise régulièrement des gains de productivité : ainsi, le prix auquel nous vendons nos nouveaux services en développement est généralement inférieur au coût moyen du service tel que prévu dans la convention initiale. La région récupère de ce fait une partie de notre effort de productivité, à l'occasion des optimisations du service. » Par ailleurs, l'augmentation des péages a un effet indirect sur les investissements dont pourront bénéficier les régions, via la capacité de financement de RFF. En effet, selon l'article 4 de son décret statutaire, RFF a l'obligation de dimensionner sa participation aux investissements qu'il réalise - c'est-à-dire son apport en fonds propres - en fonction des cash-flows futurs que l'investissement dégagera. Dès lors que, par l'augmentation des péages, il y aura augmentation des produits, la capacité de RFF à participer aux investissements va augmenter. À terme, avoir un niveau de redevances plus élevé a un effet bénéfique sur l'amortissement des investissements futurs, qui conduira donc RFF à augmenter sa part dans le financement de l'investissement. Un niveau de péage plus élevé peut certes avoir des inconvénients immédiats, mais est porteur d'investissements futurs. L'exemple de l'Île-de-France montre qu'un niveau de péages élevé, facturé au coût complet - c'est-à-dire avec l'amortissement -, maintient un haut niveau d'investissement, et donc une qualité élevée du réseau. Compte tenu de la nouvelle offre de services décidée librement par les régions, l'exercice de la compétence TER a donc bien amené les régions à consentir un effort financier supplémentaire, sans que la compensation financière versée puisse être considérée comme insuffisante. Cet effort financier ne s'est jusqu'alors pas traduit, dans les budgets locaux, par une augmentation de la fiscalité : les taux d'imposition des régions n'ont augmenté en 2003 que de 0,1 % à 0,2 %. Pour 2004, la tendance est identique, les taux ayant augmenté de 0,4%. Selon M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales, « même si les régions ont, dans leur ensemble, décidé d'en faire plus, les dépenses correspondantes ne se sont globalement pas traduites par des hausses de taux. » Les dépenses pour les TER augmentent autant en 2005 qu'en 2004. On ne voit donc pas en quoi 2005 serait différent, et pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets. Il faut donc bien conclure à l'absence d'effet mécanique de la compétence TER sur la hausse des taux des régions en 2005. Crainte corollaire aux TER pour les régions, la question de la suppression des petits arrêts, liée à celle des trains interrégionaux (TIR), a été maintes fois soulevée au cours des différentes auditions de votre commission. La SNCF constate un déficit de l'ordre de 150 millions d'euros sur toute une série de lignes Corail - lesquelles, d'après son cahier de charges, relèvent de sa compétence - et se propose par conséquent de supprimer des arrêts et des services, avec des conséquences potentielles sur le système des TER. Comme l'a rappelé M. Patrice Raulin, Directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, « les ministres ont demandé à la SNCF de suspendre la mise en œuvre de ses décisions pour 2005, hormis là où des accords avaient été trouvés avec les exécutifs régionaux, et un autre groupe de travail a été mis sur pied avec l'ARF, la SNCF et mes services afin de poser le problème objectivement, sur la base d'une expertise des comptes. » Les régions redoutent de devoir intervenir financièrement pour trouver des solutions de remplacement, au travers de nouveaux services TER à proposer, sans bénéficier de compensation par l'État. Mais, là encore, la crainte est infondée, au moins en 2005. La réponse de M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a été très claire : un changement d'autorité organisatrice n'est pas à l'ordre du jour pour les transports interrégionaux, et les collectivités régionales « ne sont pas sollicitées par l'État ». Reste la sollicitation de la SNCF, mais on devrait être rassuré, puisque l'État reconnaît enfin, explicitement, être l'autorité organisatrice. Enfin, on rappellera que ce problème ne se pose pour les TGV. En effet, l'article 127 de la loi SRU a explicitement prévu le cas de la mise en service d'une nouvelle ligne à grande vitesse : si la mise en place de nouvelles dessertes TGV conduit à supprimer des dessertes classiques et à faire évoluer l'offre TER en conséquence, la compensation versée par l'État aux régions concernées sera révisée, en application de critères très précis. Ces dispositions, appliquées pour la première fois pour le TGV Méditerranée, semblent avoir, de l'avis des diverses autorités compétentes, donné satisfaction aux régions concernées. 1 La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux régions le financement des indemnités versées aux employeurs d'apprentis. Le dispositif prévoyait un taux progressif de versement de 6 % en 2003, de 63 % en 2004 et de 97 % en 2005. Il sera de 100 % à partir de l'an prochain. Le montant total versé par les régions atteint ainsi 696 millions d'euros en 2005, financés à due concurrence par une dotation. 2 In La lettre du cadre territorial n°292, mars 2005 p. 4. 3 Par exception, ce transfert est effectif au 1er juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi de finances pour 2005. 4 Ce transfert étant également effectif au 1er juillet 2005. 5 Le droit à compensation de chaque département pris individuellement correspond au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 sur son territoire. Ce montant a été converti en un pourcentage de la fraction de tarif provisoire attribuée à l'ensemble des départements. 6 Dans sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'État de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert ; (...) ». C'est sous cette réserve que l'article 59 de la loi de finances a été déclaré conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales. 7 L'allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être perçue par toute personne justifiant de 5 ans d'activité salariée au cours des 10 dernières années et ayant épuisé ses droits à indemnisation dans le cadre du régime de l'assurance chômage. La réforme annoncée devait limiter la durée de versement de l'allocation, soit à 3 ans, pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans à compter du 1er juillet 2004, soit à 2 ans, pour les nouveaux allocataires âgés de moins de 55 ans à compter du 1er janvier 2004. 8 Le montant définitif du droit à compensation sera alors constaté par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, arrêté préalablement soumis à la commission consultative d'évaluation des charges, conformément à la procédure prévue à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. 9 Compte tenu du très faible nombre de contrats RMA signés à ce jour (une centaine) et de la suspension de la réforme de l'ASS annoncée par le Président de la République, le surcoût induit par ces réformes pour les départements est nul. 10 Études et résultats, n° 384, mars 2005. 11 Fin 2002, un avenant à la convention Unedic pour 2001-2003 avait modifié les règles d'indemnisation du chômage (allongement des durées de cotisation et raccourcissement des durées d'indemnisation). Ces modifications ne devaient s'appliquer qu'aux personnes entrant au chômage à partir de 2003. Au 1er janvier 2004, dans le cadre de la nouvelle convention Unedic pour 2004-2005, la réforme a été étendue aux chômeurs dont la rupture du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003. Ces mesures ont conduit à un basculement plus précoce de certains demandeurs d'emplois dans le régime de solidarité ou dans le dispositif du RMI. L'agrément donné à cette convention a été annulé par le Conseil d'État en mai 2004. Dans le cadre du texte finalement agréé, les droits des personnes qui étaient entrées au chômage avant 2003, dans le cadre de la convention adoptée début 2001 ont été rétablis, les nouvelles conditions d'indemnisation étant toutefois maintenues pour les personnes entrées au chômage à partir du 1er janvier 2003. 12 Erwan Le Bot, « Les principales dimensions financières du transfert de la compétence RMI et de la création de la compétence RMA aux Conseils généraux », La Gazette des communes, 9 février 2004. 13 « Les principales dimensions financières du transfert de la compétence RMI et de la création de la compétence RMA aux conseils généraux », La gazette des communes, 9 février 2004. 14 Très traditionnellement, le critère retenu en la matière est l'affectation des autorisations de programme. 15 Il y a cependant des écarts très importants, tenant aux histoires locales, entre par exemple le département du Nord, dont la contribution est encore inférieure à 20 %, et celle de l'Essonne, qui est déjà de 99 %. © Assemblée nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||