-
 Prévenir les ingérences étrangères en France : examen d'un rapport d’information
Prévenir les ingérences étrangères en France : examen d'un rapport d’informationMercredi 20 mars, la commission des affaires européennes a examiné le rapport d’information portant observations sur la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France de Sacha Houlié et plusieurs de ses collègues.
Définies comme l’immixtion d’un état étranger dans les affaires d’un État tiers, les ingérences étrangères constituent une menace toue particulière en raison de son caractère hybride. Cette intervention malveillante en vue de saper les intérêts fondamentaux d’une autre Nation emprunte plusieurs vecteurs à l’instar de l’attaque cyber, de la désinformation ou de la tentative de corruption des élites.
La proposition de loi déposée par Sacha Houlié vient doter la France d’un dispositif législatif de nature à mieux appréhender le phénomène et à doter l’État français des moyens permettant de mieux caractériser la menace et de la contrer par une action de contre ingérence.
Le rapport de Constance Le Grip présente les spécificités de la situation française en matière d’ingérences et l’économie de la proposition de loi. Le rapport souligne la dimension européenne de la question et l’implication du Parlement européen dans la prise de conscience du phénomène. Il présidente également le contenu de la proposition de directive censée apporter à l’Union européenne les moyens de répondre aux ingérences constatées.
La France dispose d’ores et déjà de services de renseignements et d’organismes clés pour faire face aux ingérences étrangères. Ces capacités devront se renforcer, ce que permet la proposition de loi. De même l’Union européenne a entamé une réflexion et mis en œuvre un certain nombre de dispositifs qui ont besoin de trouver une cohérence dans la coordination.
Rapporteure : Constance Le Grip (RE)
partager -
 Protection européenne du consommateur : examen d'un rapport d’information
Protection européenne du consommateur : examen d'un rapport d’informationMercredi 13 mars 2024, la commission des affaires européennes a examiné le rapport d'information sur la protection européenne du consommateur.
Dans le cadre de la stratégie « de la ferme à la table » présentée en mai 2020, et du « plan européen pour vaincre le cancer » de 2021, la Commission européenne s’était engagée à déployer plusieurs outils pour faciliter l’adoption de régimes alimentaires sains et améliorer l’environnement nutritionnel dans l’Union européenne. Toutefois, à l’approche des élections au Parlement européen, force est de constater que la plupart des engagements en matière de protection des consommateurs de denrées alimentaires ne seront finalement pas honorés. Le rapport formule des propositions pour améliorer la santé des consommateurs autour du triptyque : information ; éducation ; droit à une sécurité sociale alimentaire pour tous.
Rapporteur : Richard Ramos (Dem)
partager -
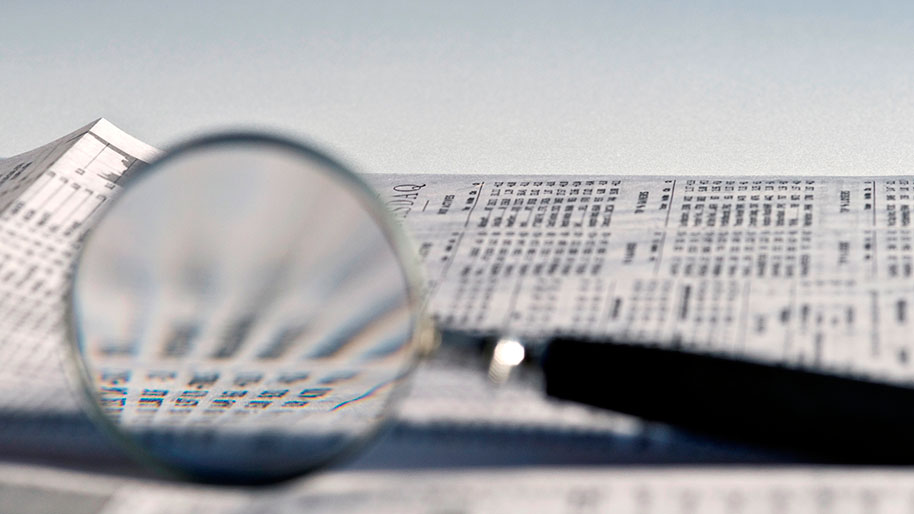 Abandonner la proposition de règlement du Parlement européen réduisant strictement les délais de paiement pour les commerçants : adoption d'une proposition de résolution européenne
Abandonner la proposition de règlement du Parlement européen réduisant strictement les délais de paiement pour les commerçants : adoption d'une proposition de résolution européenneMercredi 6 mars, la commission des affaires européennes a adopté, à l'unanimité, la proposition de résolution européenne de Fabien Di Filippo (LR) et plusieurs de ses collègues visant à abandonner la proposition de règlement du Parlement européen réduisant strictement les délais de paiement pour les commerçants.
Douze milliards de factures sont éditées chaque année au sein de l’Union européenne. Près de 50 % d’entre elles sont réglées tardivement. Ce règlement au-delà du délai légal n’est pas sans conséquences sur les entreprises quant à leur trésorerie.
La proposition de règlement présentée en septembre 2023 par la Commission européenne vise à réduire ce retard des paiements en agissant sur le délai légal actuellement fixé à 60 jours.
En proposant de le réduire de moitié, la proposition phare du règlement prétend régler le problème alors qu’elle ne fera qu’aggraver la situation. Cette réduction drastique menace de déséquilibrer un écosystème entrepreneurial déjà fragilisé par l’inflation et par le renchérissement des coûts dus à la guerre en Ukraine.
La résolution européenne adoptée à l’unanimité soutient des améliorations en matière de délais de paiements mais demande d’agir sur d’autres leviers. Elle invite également le gouvernement à peser dans les négociations engagées sur le projet de règlement afin de défendre le modèle français et de faire abandonner toute proposition de réduction des délais de paiement.
partager -
 Éviter la dérégulation des nouveaux OGM : rejet d'une proposition de résolution européenne
Éviter la dérégulation des nouveaux OGM : rejet d'une proposition de résolution européenneMardi 27 février, la commission des affaires européennes a rejeté la proposition de résolution européenne pour éviter la dérégulation des nouveaux Organismes génétiquement modifiés de Lisa Belluco (ECOLO-NUPES), Stéphane Delautrette (SOC) et plusieurs de leurs collègues.
La Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à réglementer les plantes issues des nouvelles techniques génomiques, dit règlement « NTG », le 5 juillet 2023.
Ce règlement instaure un cadre juridique pour les plantes issues des nouvelles techniques génomiques, apparues après 2001, et la publication de la directive régulant les organismes génétiquement modifiés (OGM) (Directive 2001/18/CE).
Aux termes de l’article 2 de la directive précitée, un OMG est un « organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle. »
En conséquence, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt de 2018, assimile les plantes issues des nouvelles techniques génomiques à des OGM, quels que soient les types de modifications génétiques opérés.
Pour les NTG, la modification de l’ADN de la plante n’implique pas d’ingérer un gène étranger comme pour les OGM « classiques ».
La proposition de règlement, en réponse à l’arrêt de la CJUE, propose de distinguer deux types de NTG. Les NTG de catégorie 1, qui n’auraient pas subi plus de 20 modifications, semblables aux plantes conventionnelles, et ne relèveraient plus de la réglementation relative aux OGM, et les NGT de catégorie 2 qui y resteraient soumis.
Pour les rapporteurs, cette proposition n’a pas d’autre objet qu’une dérégulation annoncée des nouveaux organismes génétiquement modifiés qui ne seraient pas sans conséquences sur la disponibilité du matériel végétal à disposition des agriculteurs ainsi que sur la santé humaine et environnementale. Leur rapport s’appuie, notamment, sur les travaux scientifiques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, du travail et de l’environnement (ANSES), qui s’est autosaisie et dans un avis, publié le 29 novembre 2023, alerte sur l’absence de scientificité de la distinction juridique opérée entre les deux catégories de NTG.
Outre le choix d’un nombre « arbitraire », 20 modifications maximum, ne reposant sur aucun fondement scientifique en l’absence de prise en compte de la taille du génome, 94 % des NTG seraient éligibles à la catégorie 1, dont le cadre juridique est particulièrement souple.
Chaque rapporteur avait déposé une proposition de résolution européenne pour alerter sur les risques relatifs à ce texte. Après un travail commun, ils ont décidé de proposer une initiative commune pour inviter l’Assemblée nationale à se positionner en défaveur de la proposition de règlement NTG. La proposition de résolution européenne invite le Gouvernement à rejeter cette proposition de règlement, lors des prochaines négociations au sein du Conseil de l’Union européenne. À défaut, elle invite le Gouvernement à tenir compte des modifications proposées par le Parlement européen le 6 février dernier, ainsi qu’à soutenir l’adoption d’une « clause de sauvegarde » (opt-out) permettant à chaque État membre de ne pas adopter cette législation sur son territoire pour conserver sa souveraineté agricole et alimentaire.
partager -
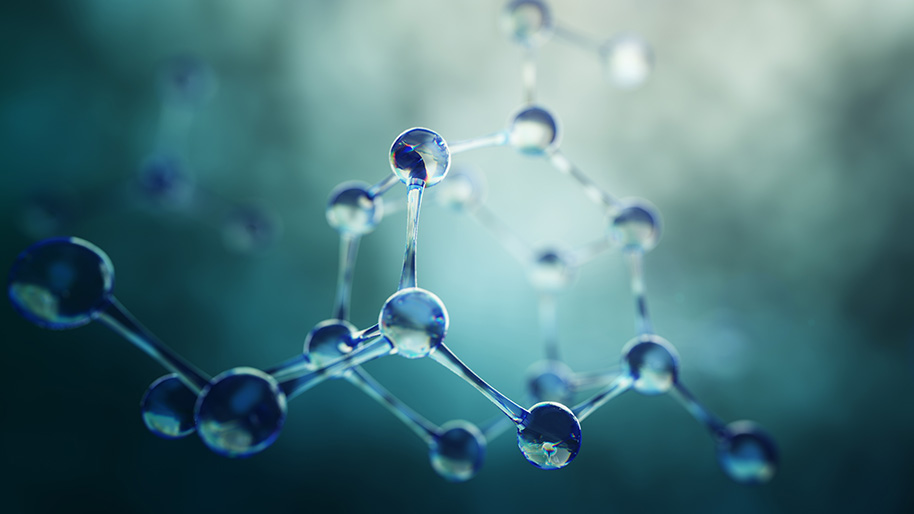 Révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques : adoption d'une proposition de résolution européenne
Révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques : adoption d'une proposition de résolution européenneMercredi 14 février, dans l'après-midi, la commission des affaires européennes a adopté la proposition de résolution relative à la révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques.
Rapporteur : Nicolas Thierry (ECOLO-NUPES)
Consulter le dossier législatif
Voir la réunion sur le portail vidéo
Chaque année, 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites sur le sol de l’Union, dont 74% sont considérées comme potentiellement dangereuses pour la santé et pour l’environnement par l'Agence européenne de l'environnement.
Le règlement REACH, clé de voûte de la régulation de la production et de l’emploi des substances chimiques dans l’Union européenne, date de 2007. Quatorze ans après, alors que l’état des connaissances scientifiques a désormais progressé, le rapporteur appelle à la révision de cette réglementation, alors que la Commission a reporté à plusieurs reprises sa mise à l'agenda depuis 2020.
La proposition de résolution européenne adoptée par la Commission européenne appelle notamment à un renforcement du rôle de l'Agence européenne pour les produits chimiques dans les procédures d'évaluation de la dangerosité des substances et à une meilleure prise en compte des "effets cocktails", soit des conséquences des mélanges entre produits chimiques dans la nature.
partager -
 Souveraineté alimentaire européenne : présentation d'un rapport d'information
Souveraineté alimentaire européenne : présentation d'un rapport d'informationMercredi 14 février, à 15h, la commission des affaires européennes a examiné un rapport d'information sur la souveraineté alimentaire européenne.
Rapporteurs : Charles Sitzenstuhl (RE) et Rodrigo Arenas (LFI-NUPES)
Voir la réunion sur le portail vidéo
La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les conséquences du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité suscitent une interrogation stratégique : l’Union européenne est-elle capable de satisfaire, en toutes circonstances, les besoins alimentaires de nos concitoyens en quantité, en qualité et en diversité ?
Les rapporteurs Rodrigo Arenas et Charles Sitzenstuhl établissent un diagnostic partagé des forces et des faiblesses des systèmes agricoles et alimentaires en Europe. La souveraineté alimentaire européenne, mesurée par les taux d’auto approvisionnement en produits agricoles, est globalement préservée. Cette situation d’autonomie et de résilience souffre toutefois de vulnérabilités localisées, en particulier au titre des protéines végétales, des produits de la mer et des intrants consommables, tels que les engrais.
Plus structurellement, le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité menacent la pérennité des filières agricoles européennes à moyen terme. Ces dernières souffrent notamment de l’augmentation des épisodes de stress thermique et hydrique, ainsi que de l’épuisement des sols.
Dans ce contexte, les rapporteurs appellent à la mise en place d’une véritable stratégie de souveraineté alimentaire européenne sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils formulent vingt-sept propositions communes en ce sens, qui couvrent aussi bien les modes de production que les habitudes de consommation et les échanges internationaux. Parmi recommandations clés du rapport d’information, le rééquilibrage la politique agricole commune (PAC) au bénéfice des petites et des moyennes exploitations et l’introduction de mesures « miroirs » dans la législation européenne doivent contribuer à soutenir le revenu des agriculteurs et à prévenir les distorsions de concurrence.
S’ils s’accordent sur l’essentiel, les rapporteurs portent une appréciation différente du rythme de la transition agroécologique dans le cadre du Pacte vert. M. Charles Sitzenstuhl estime que l’évolution des pratiques agricoles ne peut être que progressive, tandis que le M. Rodrigo Arenas plaide pour une transformation profonde et urgente du modèle productif actuel. Prenant acte du retrait de la proposition de règlement « SUR », ils appellent conjointement la prochaine Commission européenne à présenter une nouvelle initiative sur la réduction de l’utilisation des pesticides. Ce texte devra garantir l’accompagnement du monde agricole dans sa transition, via des financements européens dédiés et un effort de recherche sur les solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques.
partager -
 Évolution du marché des crédits carbone au niveau européen : examen d'un rapport d’information
Évolution du marché des crédits carbone au niveau européen : examen d'un rapport d’informationMercredi 7 février, la commission des affaires européennes a examiné le rapport d'information relatif à l'évolution du marché des crédits carbone au niveau européen (rapporteur : Henri Alfandari).
Voir la réunion sur le portail vidéo
Le marché carbone européen a fait l’objet d’une réforme en 2023, de manière à favoriser l’atteinte des objectifs climatiques de l’Union européenne, notamment la diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. La suppression des quotas gratuits qui bénéficiaient jusqu’ici les installations industrielles doit être compensée par l’instauration d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, préservant ainsi la compétitivité des entreprises européenne.
Aux termes de l'analyse du rapport adopté par la commission des affaires européennes, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières n’est toutefois pas encore un instrument mûr, notamment en raison de son champ d’application limité et des difficultés à évaluer réellement l’intensité carbone d’un produit conçu dans un pays tiers.
Sans remettre en cause la nécessité de donner un prix au carbone, ce rapport interroge donc le choix des instruments choisis pour parvenir à cet objectif : inefficace dans ses premières phases, potentiellement dangereux pour la compétitivité européenne à l’avenir, le marché carbone européen suscite de nombreuses interrogations critiques.
partager -
 Conditions de travail des travailleurs de plateformes : examen d'une proposition de résolution européenne
Conditions de travail des travailleurs de plateformes : examen d'une proposition de résolution européenneMercredi 7 février, la commission des affaires européennes a examiné la proposition de résolution européenne présentée par Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collègues visant à soutenir l’accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 concernant la directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (2021/0414).
Depuis une quinzaine d'années, l'essor des plateformes numériques d'emploi est considérable et touche un nombre croissant de travailleurs à l'échelle européenne (43 millions de personnes en 2025 selon les prévisions). Cette situation a des conséquences négative au plan économique (manque à gagner pour les comptes publics et concurrence déloyale), environnemental et social. Non seulement les plateformes détournent le statut d'indépendant afin d'échapper à leurs obligations d'employeur, mais les travailleurs subissent les conséquences néfastes de ces pratiques dérogatoires au droit commun (absence de protection sociale, précarisation, rémunération à la tâche, management algorithmique). C'est pourquoi la Commission européenne a présenté le 8 décembre 2021 une directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont l'objectif est notamment de créer une présomption de salariat. Au terme de longues discussions, le Conseil est revenu en grande partie dans son accord du 12 juin 2023 sur les avancées proposées par la Commission. Le Parlement a fait, quant à lui, de nombreuses concessions afin de parvenir à un accord équilibré bien que très éloigné des ambitions initiales du texte.
Un accord a été trouvé lors du trilogue du 13 décembre 2023 permettant d'établir un texte équilibré. Celui-ci a été salué par un grand nombre d'acteurs, dont les membres du groupe Renew Europe. Or à la surprise générale, cet accord n'a pas été validé au sein du Comité des représentants permanents (COREPER) et depuis décembre 2023, les négociations ne parviennent pas à aboutir, notamment du fait du gouvernement français. Cette position au niveau européen reflète l'étonnant biais favorable des pouvoirs publics à l'égard des grandes plateformes. L'enjeu est belle et bien la crédibilité de la France, en tant que membre fondateur de l'Union européenne, à agir non plus en faveur de la réalisation du marché, mais pour l’amélioration des droits des travailleurs. C'est pourquoi cette proposition de résolution européenne invite le Gouvernement français à soutenir l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023.
À l'issue des débats, la commission des affaires européennes a rejeté cette proposition de résolution européenne.
partager -
 Protection des élevages de bétail et du loup : adoption d’un projet d’avis politique
Protection des élevages de bétail et du loup : adoption d’un projet d’avis politiqueLors de sa réunion du 31 janvier 2024, la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a adopté l'avis politique et a autorisé la publication de la communication de
Mme Pascale Boyer (RE, Hautes-Alpes) relatifs au statut de protection du loup au sein de l'Union européenne et l'accompagnement des éleveurs.La réapparition du loup dans certaines régions d'Europe, la dynamique démographique de sa population et les pertes subies par les éleveurs ont relancé le débat sur l'ajustement du niveau de protection du loup et l'accompagnement des éleveurs. En réponse à la mobilisation des représentants des professionnels et des élus, la présidente de la Commission européenne,
Mme Ursula von der Leyen, a annoncé le 4 septembre 2023 une campagne d'actualisation des données sur les populations de loups en Europe. Sur la base de cette étude publiée
en décembre 2023, une proposition de révision de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage en Europe a été publiée le 20 décembre 2023 par la Commission qui suggère de faire passer le statut de protection du loup de "strictement protégé" à "protégé".La France doit, sur ce sujet sensible, promouvoir une solution d'équilibre qui assure la coexistence pacifique des loups et du monde agricole, en particulier de l'agropastoralisme, et jouer un rôle moteur dans la coopération transfrontalière. Cet avis politique vise surtout à alerter les autorités nationales et européennes sur la nécessité de mieux accompagner et soutenir les éleveurs qui se trouvent en grande difficulté du fait de la recrudescence des attaques.
partager -
 Présidence belge du Conseil de l'Union européenne : audition de l'ambassadeur de Belgique en France
Présidence belge du Conseil de l'Union européenne : audition de l'ambassadeur de Belgique en FranceMercredi 24 janvier, la commission des affaires européennes a auditionné M. Jo Indekeu, Ambassadeur de Belgique en France, sur les priorités de la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne.
partager -
 Politique de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni en Afrique : audition
Politique de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni en Afrique : auditionMercredi 24 janvier, les commissions de la défense nationale et des affaires européennes ont auditionné le Dr Martin Schäfer, ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Allemagne en France, M. Antonino Cascio, ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Italie en France et M. Benjamin Saoul, ministre-conseiller aux Affaires étrangères et stratégiques, intérieures et de justice à l’ambassade du Royaume-Uni en France, sur la politique africaine de leur pays respectif.
partager

Commission des affaires européennes
16e législature (22 juin 2022 - 9 juin 2024)
Présidence de Pieyre-Alexandre Anglade, député de la quatrième circonscription des Français établis hors de France
