N° 2521 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1)
Pages INTRODUCTION 9 AVANT-PROPOS HISTORIQUE 13 I.- UNE RÉALITÉ CARCÉRALE MÉCONNUE 21 A.- LE CONSTAT DE LA SURPOPULATION PÉNALE 21 1) La réalité de la surpopulation pénale 21 a) Le concept de surpopulation carcérale 21 b) Une surpopulation qui ne concerne que les maisons d'arrêt 23 2) Les causes de la surpopulation 27 a) Surpopulation et inflation carcérale 27 b) Surpopulation et carte pénitentiaire 32 3) Les conséquences de la surpopulation carcérale 35 a) Des règles du code de procédure pénale qui restent inappliquées 35 b) Des conditions de vie en détention rendues très difficiles 37 c) Une surpopulation qui rend difficile le travail du personnel de surveillance. 39 B.- UN CADRE PÉNITENTIAIRE SOUVENT INADAPTÉ. 40 1.- Une politique immobilière peu cohérente : 40 a) Des établissements pénitentiaires très majoritairement vétustes 41 b) Des locaux très dégradés en raison du manque d'entretien 45 c) Des établissements récents qui n'excluent pas des problèmes de conception. 47 d) Des coûts finalement considérables 49 2.- Des conditions de détention inégalitaires 52 a) L'hétérogénéité des établissements 52 ▪ des établissements de taille très variable 52 ▪ des choix technologiques contestables 54 ▪ des règles de vie disparates 55 b) La fiction des régimes de détention 56 ▪ Le régime applicable aux prévenus 56 ▪ Le cas des condamnés exécutant leur peine en maison d'arrêt 58 ▪ Le régime de détention atypique de Casabianda 59 C.- LES MUTATIONS DE LA POPULATION PÉNALE. 59 1. Les mutations 60 a) les « délinquants sexuels » 60 b) les toxicomanes 61 c) les détenus présentant des troubles psychiatriques 62 d) les mineurs 66 2) Les conséquences quotidiennes 68 II.- AFFIRMER L'IDENTITÉ DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 73 A.- UNE ADMINISTRATION DÉSORIENTÉE 73 1) La question cruciale des effectifs 73 a) Le constat : l'éternelle pénurie des effectifs 73 ▪ les effectifs totaux 74 ▪ les effectifs du personnel surveillant 74 b) L'insuffisance des réponses de l'administration centrale 77 ▪ un effort budgétaire pourtant conséquent 77 ▪ des essais de prospective à long terme 78 ▪ un raisonnement sur des organigrammes obsolètes 79 c) Les conséquences de la pénurie d'effectifs : un service pénitentiaire désorganisé 79 ▪ des conditions de travail pour le personnel rendues pénibles 79 ▪ des conséquences graves pour la sécurité 80 ▪ une capacité d'écoute rendue difficile 81 ▪ des conséquences sur la formation 82 ▪ l'ensemble de l'organigramme désorganisé 83 2) Des surveillants en quête de reconnaissance 84 a) Un métier qui a subi de profondes évolutions 84 b) Un isolement de plus en plus mal vécu 88 c) L'absence d'un cadre normatif adéquat 93 3) Le rôle de l'encadrement à redéfinir 95 B.─ UN CADRE DE GESTION À RÉORGANISER 101 1) L'incapacité à communiquer 102 a) Les cloisonnements de l'administration 102 b) Des relations conflictuelles avec l'extérieur 106 c) Une concertation hésitante 108 2) Une action entravée 109 a) Des directions régionales impuissantes 109 b) Une déconcentration qui marque le pas 111 c) Une condition préalable : des établissements autonomes porteurs d'un projet 112 III.- REPENSER LA PLACE ET LA MISSION DE LA PRISON 117 A.- L'EXIGENCE D'UNE RÉFLEXION SUR L'INCARCÉRATION 117 1.- Repenser la peine 117 a) la complexité de la peine 117 b) la peine, moyen de réparation pour les victimes et de protection de la société 119 c) Le sens de la peine, enjeu fondamental du débat démocratique et politique 120 d) Le sens de la peine, enjeu fondamental pour le détenu 125 e) les missions de l'administration pénitentiaire 127 2.- La place de la prison dans la cité 128 a) la place de la prison dans la ville 128 b) les liens avec la famille 130 c) la politique de décloisonnement 133 d) l'apport essentiel du bénévolat 135 e) le développement des médiations citoyennes 137 B.─ L'EXIGENCE DU DROIT EN PRISON 137 1) Les carences des normes 137 a) le foisonnement des règles 137 b) une hiérarchie des normes non respectée 140 c) diversité des règles et diversité des régimes 140 2) Un difficile accès au droit 141 a) l'ignorance des règles par les détenus 141 b) des droits au conditionnel 143 c) des règles insusceptibles de recours 143 3) Des garanties insuffisantes en matière de sanctions disciplinaires 147 C.─ L'EXIGENCE D'UN CONTRÔLE DU MILIEU CARCÉRAL 149 1) La multiplicité des contrôles 149 a) les inspections 150 b) les contrôles 153 2) Les carences du contrôle 154 a) redéfinir les moyens et les missions des inspections 155 b) mettre fin à l'indifférence des magistrats pour la prison 159 c) redéfinir les missions de la commission de surveillance 163 3) Instaurer un contrôle extérieur efficace 163 IV.- AMÉLIORER UNE PRISE EN CHARGE DÉFICIENTE 169 A.- REPENSER UNE MISSION D'INSERTION TROP SOUVENT RELÉGUÉE AU SECOND PLAN 169 1) Les contraintes du cadre carcéral 169 a) La prédominance des impératifs de sécurité 169 b) Un cadre carcéral qui a pu apparaître comme antagonique avec l'objectif d'insertion 173 2) Les moyens très insuffisants des services d'insertion 177 a) Des effectifs dérisoires 178 b) La mise en place des services pénitentiaires d'insertion et de probation 180 3) Les actions socio-éducatives 182 a) Une très grande diversité des activités et de l'accès à celles-ci 182 b) Le bilan global des activités de formation et d'enseignement 185 ▪ Les formations professionnelles 185 ▪ L'enseignement 186 ▪ La scolarité des mineurs 188 4) Le travail pénal 188 a) Le décalage entre l'objectif de réinsertion et la réalité du travail pénitentiaire 190 ▪ L'accès au travail pénal : seule la moitié de la population carcérale travaille. 190 ▪ Des locaux diversement adaptés au travail pénal 193 ▪ Des activités très généralement non-qualifiantes 194 b) un objectif de réinsertion compromis par la non-application du droit du travail 196 ▪ l'absence de contrat de travail 196 ▪ La non-application du droit du travail a pour conséquence la pratique d'un travail sous-rémunéré 198 5) Les aides à la sortie 204 a) L'aide administrative à la libération 204 b) Les aides matérielles aux sortants 206 B.- POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 206 1) Des avancées notables dans la prise en charge médicale 206 a) L'apport de la loi du 18 janvier 1994 206 b) Des enjeux de santé publique 208 c) Les besoins des UCSA 209 2) Une réforme inachevée 212 a) L'accès aux soins en milieu hospitalier 212 b) La prise en charge inégale de la toxicomanie 215 c) L'insuffisance de la prise en charge psychiatrique 218 3) Les suicides 224 C.- MIEUX ADAPTER LA PRISE EN CHARGE AUX PUBLICS 227 1) Les détenus indigents 227 a) Le repérage et le suivi des situations d'indigence : 228 b) Les aides fournies aux indigents : 229 2) Les femmes en détention 230 a) Les conditions d'accueil des femmes 230 b) Les enfants en détention avec leur mère 232 3) Les détenus âgés 233 V.- ALLER VERS L'INDISPENSABLE MAÎTRISE DE LA POPULATION PÉNALE 235 A.─ RETROUVER LA MAÎTRISE DES FLUX 235 1) Limiter les incarcérations 236 a) Les cas psychiatriques 236 b) Les mineurs 239 c) Les étrangers 242 d) Les toxicomanes 246 e) Les détenus malades ou âgés 249 2) Développer et crédibiliser les solutions alternatives 251 3) Limiter la détention provisoire 257 B.─ ÉVITER LA RÉCIDIVE 262 1) Développer la libération conditionnelle 262 a) L'exemple canadien 262 ▪ les programmes correctionnels 263 ▪ libération conditionnelle 264 ▪ un organe de décision indépendant : la commission nationale des libérations conditionnelles (C.N.L.C.) 267 ▪ les résultats obtenus 268 b) La pratique française 269 2) Accueillir l'ancien délinquant dans le corps social 274 3) Repenser le temps de l'incarcération 275 C.─ INSTAURER LE NUMERUS CLAUSUS 277 RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 283 EXPLICATIONS DE VOTE 293 EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU GROUPE SOCIALISTE 294 EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU GROUPE RPR 297 EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU GROUPE UDF 301 EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU GROUPE DÉMOCRATIE LIBÉRALE ET INDÉPENDANTS 307 EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT AU GROUPE COMMUNISTE 311 CONTRIBUTION DE MME CHRISTINE BOUTIN DÉPUTÉE DES YVELINES 315 CONTRIBUTION DE M. MICHEL MEYLAN DÉPUTÉ DE HAUTE-SAVOIE 325 En septembre 1999, une délégation parlementaire conduite par Mme Catherine Tasca, présidente de la commission des lois, visitait la maison d'arrêt de Saint-Denis de la Réunion. L'état lamentable de cet établissement, « une honte pour la République ! » comme a cru devoir le qualifier un des membres de la délégation, a permis d'entamer une nécessaire réflexion sur le système pénitentiaire français. Cette réflexion a bénéficié d'un appui particulièrement efficace avec la publication du livre de Mme Véronique Vasseur, « médecin chef à la prison de la Santé » et le retentissement inattendu qu'il a eu dans les médias et sur l'opinion, alors même que la situation qu'il décrivait était connue et avait été dénoncée par le comité européen pour la prévention de la torture en 1993 puis en 1998 et, plus récemment, par l'Observatoire international des prisons, organisation non gouvernementale dont la section française a été créée en 1996. Tout cela a donné l'occasion à des parlementaires sensibilisés aux difficultés du monde carcéral et venant de tous les horizons politiques, de déposer plusieurs propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les prisons : la première (n° 2078) de M. Claude Goasguen sur les conditions sanitaires dans les prisons françaises, la seconde (n° 2079) de Mme Christine Boutin sur les conditions de vie des détenus, la troisième (n° 2106) de M. Guy Hascoët sur l'état des établissements pénitentiaires, les conditions de vie des détenus et le respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les prisons, la quatrième (n° 2118) de MM. Laurent Fabius et Louis Mermaz sur la situation dans les prisons françaises. Le 3 février 2000, l'Assemblée nationale adoptait, à l'unanimité, sur le rapport de M. Raymond Forni, la proposition de M. Laurent Fabius. C'était la première fois depuis 125 ans, depuis la création de la IIIème République, qu'une commission d'enquête parlementaire était créée sur ce sujet. Une semaine plus tard, le Sénat créait à son tour une commission d'enquête sur « les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France. » Le champ d'investigation fixé à la commission de l'Assemblée nationale était vaste : la mission qui lui était assignée concernait tous les aspects du monde carcéral : état des lieux, conditions de détention, santé, travail, usage de la détention provisoire, situation des personnels pénitentiaires, conditions de la réinsertion sociale et solutions alternatives à l'incarcération. L'objectif qui lui était fixé était de formuler « des propositions de nature à améliorer la situation dans les prisons françaises. » C'est en fonction de telles orientations que son Président, Laurent Fabius, proposait d'emblée à la commission un objectif ambitieux : visiter tous les établissements pénitentiaires de métropole. Chaque membre de la commission fut donc chargé de visiter un certain nombre d'établissements et d'en rendre compte à la commission. Ce programme ambitieux, qui a exigé des commissaires une disponibilité et un investissement importants, a été pour l'essentiel réalisé. Ces visites ont permis à la commission de procéder à une sorte d'audit des établissements pénitentiaires sans précédent et lui ont permis de recueillir une foule d'informations concrètes d'une grande richesse. Surtout, elles ont permis à chaque député d'appréhender sur le terrain ce qu'est la vie en prison pour les détenus, mais aussi pour le personnel et pour tous ceux qui participent à la vie des établissements. Chacun a pu ainsi mesurer, à la fois, l'extrême diversité des établissements et la permanence d'un certain nombre de problèmes. La commission a, par ailleurs, procédé à de multiples auditions de personnalités et de responsables de l'administration pénitentiaire. La commission ne voulait pas se limiter aux seuls établissements métropolitains et a donc dépêché une délégation en Guyane, Martinique, Guadeloupe du 15 au 22 avril 2000, conduite par le Président Louis Mermaz, appelé à succéder à M. Laurent Fabius, nommé membre du gouvernement. 1 Enfin, la commission, afin d'élargir sa vision du sujet et dans le souci de s'inspirer de modèles étrangers, a également envoyé une mission au Canada du 29 mai au 2 juin. Il faut souligner ici combien les informations recueillies dans ce pays ont été riches d'enseignement et ont montré la voie à suivre pour parvenir, dans notre pays, à un système pénitentiaire plus efficace et plus apte à remplir sa mission première qui est de protéger la société de la délinquance, sans écarter pour autant définitivement ceux de nos concitoyens qui se sont rendus coupables d'infractions. Au terme de cinq mois de travaux intenses sur un sujet difficile et souvent douloureux qui n'a laissé aucun de ceux qui y ont participé indifférents, votre rapporteur tient à souligner que le présent rapport est le fruit d'un travail exemplaire, marqué par une parfaite collaboration entre tous les groupes parlementaires. Après avoir décrit la réalité carcérale en France aujourd'hui, marquée par l'extrême diversité des établissements et les inégalités de traitement des détenus qui en résultent, mais aussi par une inadaptation importante de beaucoup de lieux de détention et les difficultés rencontrées par une administration pénitentiaire désorientée et confrontée à une mission impossible, le rapport tente de répondre à la question de fond : à quoi sert la prison et quel est le sens de la peine ? De cette interrogation et des réponses qui lui sont données découlent les orientations qu'il propose : redonner toute sa place à la mission de réinsertion et éviter l'incarcération de ceux pour lesquels elle est inutile ou nuisible. Cela ne signifie pas que la sanction doive être écartée, mais, au contraire, que des modalités alternatives véritablement de nature à améliorer la sécurité de nos concitoyens en évitant la récidive, doivent être développées. Il faut également à chaque fois prendre en compte la douleur des victimes et des familles des victimes ; elles doivent pouvoir au minimum être informées si elles le souhaitent bien évidemment, des modalités d'exécution de la sanction. Cela veut dire aussi que l'administration pénitentiaire doit être reconnue comme un des grands services de la République, qu'aucun citoyen ne doit ignorer son existence ni méconnaître son fonctionnement ; qu'aucun parlementaire, lorsqu'il aura à décider d'une réforme du code pénal ou du code de procédure pénale, ne s'interroge : quelle protection pour la société, quelle réparation pour la victime, quelle application de la sanction pour ceux qui ont manqué à la loi ? qu'aucun magistrat chargé de dire le droit et de déterminer dans l'échelle des peines la plus juste ne se désintéresse du devenir de sa décision et de celui ou celle qui la subit. Pour mener à bien ces indispensables réformes, une mobilisation de tous est nécessaire. Un effort financier important doit aussi être consenti si l'on ne veut pas que, comme en 1875, les travaux du Parlement restent lettre morte. Retracer l'histoire de la prison est difficile, tant il existe de niveaux de lecture possibles. L'histoire de la peine et de l'emprisonnement se confond souvent avec l'histoire du droit pénal ou rejoint les réflexions philosophiques sur la condition de l'enfermement. Ces approches fournissent un apport essentiel dans l'appréhension du système pénitentiaire tel qu'il existe aujourd'hui ; elles paraissent néanmoins fragmentées ou partielles et ne traduisent qu'incomplètement l'histoire de l'enfermement, qui, elle, se caractérise par sa remarquable immobilité. L'enfermement, subi par le détenu, vécu comme la privation de liberté dans des conditions de contraintes et de promiscuité non choisies échappe à toute historiographie. Il est, selon l'historien Christian Carlier, un phénomène « a-historique ». La conception de la prison comme peine privative de liberté est une idée relativement récente ; elle a pu exister sous le haut Moyen Age en étant étroitement liée au développement de la pensée chrétienne. Elle est assimilée à la notion de pénitence lors du Concile d'Aix-la-Chapelle en 817, mais cette notion de pénitence disparaît par la suite (Concile de Béziers en 1246), et l'utilisation de la prison comme peine disparaît un peu plus tard. Au XVIème siècle, se développent à Amsterdam, Londres, Florence ou Gand, les constructions d'édifices destinés à l'emprisonnement ; les détenus y sont maintenus pour le rachat de leur faute, dans un but d'amendement. En France, l'idée de l'emprisonnement comme peine ne progresse que lentement; en 1670, l'ordonnance criminelle de Louis XIV, qui énumère les principales pénalités d'Ancien Régime, ne fait pas apparaître la prison comme une peine décernée par la justice ordinaire. Au XVIIIème siècle, apparaît un mouvement d'idées favorable à la substitution de l'enfermement individuel aux châtiments corporels. Ce mouvement est à la fois le fait de juristes et de philanthropes. Cesare Beccaria publie, en 1764, « Des délits et des peines » ; il s'élève dans cet ouvrage contre l'obscurité et la complexité des sources du droit pénal ; il réclame l'abrogation des infractions en matière religieuse, et prône l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autorités spirituelles. Surtout, il appréhende la peine du point de vue de son utilité sociale : il s'élève en conséquence contre la torture au cours du procès pénal, la barbarie des peines infligées et la peine de mort (hormis pour cas de sédition). Parallèlement à cette révolution dans la doctrine juridique sur le sens à donner à la peine et son utilité sociale, se développent des préoccupations philanthropiques sur le sort des prisonniers. La personne la plus emblématique de ce mouvement est John Howard, qui consacra sa vie à l'étude des prisons. Ses conceptions sont, à la différence de Beccaria, d'inspiration religieuse : il y a envers le prisonnier un devoir de charité chrétienne. La prison doit avoir pour but l'amendement des détenus et cet amendement passe par le travail et la religion. Pour favoriser cet amendement, il importe de ne pas négliger le milieu dans lequel vit le détenu et il est donc important de lui assurer une alimentation correcte et des conditions d'hébergement salubres. Aussi bien les conceptions howardiennes de la prison que l'ouvrage de Beccaria allaient avoir une influence décisive sur l'histoire du traitement pénitentiaire. Avant même la Révolution française, les édits de Louis XVI de 1780 et 1788 s'en inspirèrent : la torture est abolie et un plan de restructuration des établissements, entre les maisons de force, accueillant les prisonniers « par ordre du roi » et les dépôts de mendicité accueillant la petite délinquance, les vagabonds et les mendiants, est mis en place. Ce n'est cependant qu'en 1789, avec la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qu'est véritablement consacrée la conception moderne de la peine ; il est proclamé que la loi ne doit établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires » et que « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été jugé coupable ; s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Aujourd'hui encore, la Déclaration reste la référence et elle est affichée dans la plupart des établissements pénitentiaires, même si les principes qu'elle fixe n'y sont pas toujours respectés. La naissance de la prison, en tant que lieu d'accomplissement des peines, n'est véritablement instituée qu'en 1791 avec la rédaction du Code Pénal. Pour moderne qu'elle soit, cette conception de la peine est encore en retrait par rapport à l'ouvrage de Beccaria ; malgré les conclusions du rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau, le code pénal de 1791 ne fait pas de la prison et de l'enfermement la clé de voûte du système pénal. Se situent encore, au sommet de l'échelle des peines, la peine de mort et les travaux forcés ou les galères. Néanmoins, s'il n'en est pas la cime, l'enfermement constitue désormais l'axe fondamental de la répression des crimes et délits. L'histoire de la prison n'obéit pas à une évolution linéaire et ne se fait pas sans quelques retours en arrière ; le code pénal de 1810 montre ainsi davantage une volonté d'intimidation, voire de recherche de la souffrance, notamment par l'affectation de forçats aux « travaux les plus pénibles », qu'une recherche de l'amendement. Cependant, du fait de la reconnaissance de l'emprisonnement comme mode d'exécution des peines, se développe parallèlement toute une réflexion sur l'organisation de la carte pénitentiaire ; l'ambition de l'Empire est de créer une maison d'arrêt par arrondissement auprès de chaque tribunal pour les prévenus, une maison centrale pour les condamnés et une maison de correction par département pour l'exécution des peines de moins d'un an d'emprisonnement. Si ce principe de spécialisation des établissements par catégorie pénale ne fut guère respecté, il permit cependant de servir de fondement à une réorganisation de la carte pénitentiaire ; s'élevant à plus d'un millier d'établissements sous l'Ancien Régime, compte tenu de la dissémination de l'exercice de la justice pénale, le nombre d'établissements pénitentiaires se réduit à 400 au XIXème siècle. Dans ce contexte de réorganisation, surgit le débat sur le choix à opérer entre les régimes d'emprisonnement individuel : le régime pennsylvanien ou philadelphien, du nom de deux prisons construites en Pennsylvanie, l'une à Pittsburgh, l'autre à Philadelphie, est fondé sur l'isolement strict et permanent de jour comme de nuit. Le régime auburnien, du nom de la prison d'Auburn à New York créée en 1824, obéit à un régime mixte d'isolement nocturne et de travail en commun le jour, en silence. Après consultation de tous les conseils généraux du territoire, c'est le système philadelphien qui est finalement choisi. La construction des prisons, relevant du modèle choisi, est strictement définie par une circulaire de 1841 : cellules d'au moins 9 m² permettant le travail, promenoirs individuels, parloirs cellulaires. La formule architecturale retenue s'inspire du « panoptique » proposé par Bentham dès 1791 : la prison est circulaire ou semi-circulaire, permettant ainsi une surveillance générale et continue de toutes les cellules à partir d'un point central. Dès 1852, 45 maisons d'arrêt fondées sur ce modèle sont en service. Le principe qui prévaut lors de la conception de cette nouvelle carte pénitentiaire est inspiré des réflexions de la Société Royale pour l'amélioration des prisons, créée en 1819 ; il repose sur la capacité d'amendement du prisonnier. Ce principe va néanmoins se heurter aux contingences de la crise économique au début des années 1830 : les travailleurs libres exigent, à cause du chômage, que les prisonniers cessent de travailler. Les directeurs des maisons centrales profitent de cette revendication pour reprendre en main un pouvoir qu'ils partageaient auparavant avec les entrepreneurs qui fournissaient du travail. En 1839 est ainsi édicté un règlement imposant une discipline de fer aux détenus. Le Second Empire, par un retournement de tendances fréquent dans l'histoire pénitentiaire, abandonne définitivement l'objectif d'amendement et souhaite au contraire intimider. Le Prince-Président affirme dans cette optique dès 1849 qu'il faut que « les bons se rassurent et que les méchants tremblent ». L'emprisonnement individuel est abandonné au profit d'une simple séparation par quartiers. Les condamnés aux travaux forcés font l'objet d'une transportation hors de la métropole, en Nouvelle-Calédonie ou Guyane, par une loi de 1854. Sous la IIIème République, à l'issue d'une commission d'enquête parlementaire qui dura plus de trois ans, entre 1872 et 1875, fut votée le 5 juin 1875 une loi qui déterminera les grands principes de la politique pénitentiaire jusqu'en 1945. Les lignes directrices de cette réforme sont fondées sur une différence de traitement selon la nature des condamnations. Pour les prévenus et les courtes peines, le régime est celui de l'enfermement individuel de jour comme de nuit. Les peines d'emprisonnement correctionnel de un à cinq ans sont effectuées dans les prisons départementales. Les condamnés peuvent demander à effectuer leur peine sous le régime cellulaire ; considéré comme un traitement particulièrement dur à subir, le choix de l'enfermement individuel fait bénéficier le condamné d'une réduction du quart de sa peine. Les peines criminelles de droit commun à la réclusion de cinq à dix ans font l'objet d'un enfermement dans des maisons centrales selon le régime auburnien, avec isolement de nuit et travail en commun le jour. Enfin, les peines de réclusion criminelle supérieures à dix ans font l'objet d'une transportation aux colonies. C'est véritablement en 1875 qu'est née la conception moderne de la prison ; la « prison républicaine », pour reprendre l'expression de M. Robert Badinter, n'est plus la prison des philanthropes, inspirée des principes de la charité chrétienne, qui se distinguait à la fois par un certain laxisme dans les règles de détention et des conditions matérielles déplorables. La prison républicaine se veut une prison moderne, fondée sur l'emprisonnement individuel et des conditions de détention décentes accompagnées d'un règlement intérieur draconien, imposant l'interdiction de parler, d'user du tabac, de l'alcool, de cantiner, d'écrire, d'avoir de l'argent ou d'obtenir des informations de l'extérieur. Cependant, comme l'a observé M. Robert Badinter devant la commission d'enquête, il s'agit plus d'un discours républicain sur la prison que de la véritable naissance d'une prison républicaine. Construire des établissements cellulaires coûte cher ; l'enfermement individuel est perçu comme un traitement particulièrement sévère et la rigidité des règlements intérieurs se heurte rapidement aux contraintes de la vie en communauté. Les atermoiements des républicains sur la conception d'une prison moderne expliquent sans nul doute le maigre bilan de la loi de 1875 ; la valeur réformatrice de l'emprisonnement, prônée par la loi de 1875, s'est révélée médiocre. Surtout, la réforme bute devant les obstacles budgétaires : 54 maisons d'arrêt sur 177, soit 31 % seulement du parc pénitentiaire, sont cellulaires. De plus, la vétusté caractérise la très grande majorité du parc pénitentiaire. Les nobles ambitions du législateur, affirmées avec force dans la loi de 1875, n'ont ainsi guère trouvé de concrétisation dans la pratique. C'est finalement davantage par des lois plus limitées dans leurs ambitions, complétées par des pratiques constantes en matière de droit pénal, qu'une véritable amélioration de la condition pénitentiaire sera observée sous la IIIème République : en 1875 est adopté le principe de la réduction du quart de la peine pour enfermement individuel ; en 1885 est votée, en contrepartie de la loi sur la relégation qui sera peu utilisée par les magistrats, la loi sur la libération conditionnelle, en 1881 la loi sur le sursis simple et en 1912 la loi sur la liberté surveillée. En 1911, l'administration pénitentiaire devient un service du ministère de la Justice. Avant cette date, le ministère de l'Intérieur assurait cette tutelle. Dans le même temps, des pratiques consistant à déjudiciariser partiellement des infractions comme la mendicité ou le vagabondage, à augmenter les classements sans suite ou à atténuer les condamnations de certaines infractions contribuent également à diminuer la population pénale. En 1945, l'administration pénitentiaire est confrontée à de très sérieuses difficultés ; elle doit en effet faire face à une augmentation massive de la population pénale, tout en ne disposant que de bâtiments vétustes et d'un personnel peu formé. Elle se trouve également confrontée à la question de la gestion des longues peines : en 1938 a été aboli par un décret-loi le principe de la transportation. Il n'existait donc pas jusqu'à cette date d'établissements susceptibles d'accueillir cette population destinée à rester pendant une longue période en prison. Un grand nombre de résistants emprisonnés par le gouvernement de Vichy dénoncent, lors de leur libération, leurs conditions d'enfermement et les énormes difficultés rencontrées par les agents de la pénitentiaire. Sous l'impulsion de M. Amor, directeur de l'administration pénitentiaire, est réunie une commission de réforme des institutions pénitentiaires françaises. Inspirée des principes de la criminologie italienne, qui entend soigner et traiter le détenu plutôt que de le châtier, la réforme « Amor » va dégager les grandes lignes de la politique pénitentiaire valables jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à cette réforme que sera inscrit dans la loi l'objectif essentiel d'amendement et de reclassement social des condamnés. Le traitement infligé au prisonnier, hors de toute promiscuité corruptive, doit être humain, exempt de vexations et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration. Tout condamné de droit commun est astreint au travail et bénéficie d'une protection légale pour les accidents survenus pendant son travail. L'emprisonnement préventif ainsi que l'emprisonnement pénal jusqu'à un an sont soumis à l'isolement de jour et de nuit. Un régime progressif est appliqué dans chacun de ces établissements en vue d'adapter le traitement du prisonnier à son attitude et à son degré d'amendement. Ce régime va de l'encellulement à la semi-liberté. Enfin, tout agent pénitentiaire doit avoir suivi les cours d'une école technique spéciale. Les principes dégagés par la réforme « Amor » vont trouver des applications très concrètes : de 1946 à 1952 est mise en place la spécialisation des établissements et la répartition des condamnés en fonction de leur personnalité, complétée en 1950 par la création du Centre national d'observation. Peu après est développée l'institution des permissions de sortie et la semi-liberté, ainsi que les comités de probation et d'assistance aux libérés en 1946. Le développement du travail et de la formation professionnelle constitue également un axe essentiel de la réforme ; la création de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, puis en 1958 du juge d'application des peines, achève la réforme. Cette réforme ne connaîtra néanmoins qu'un succès mitigé : le régime progressif, notamment, s'est vite révélé inapplicable et n'a pas été étendu au-delà de huit établissements « réformés ». Elle initiait pourtant un nombre important d'avancées prometteuses, telles que l'ouverture de la prison sur l'extérieur. Le « décloisonnement » opéré se limitait dans un premier temps à la présence de personnels médico-sociaux et de bénévoles appelés pour des urgences sanitaires et sociales. Elle se poursuivra un peu plus tard par l'entrée des instituteurs dans les prisons. Le discours libéral sur les prisons va toutefois changer peu à peu sous la pression des événements extérieurs, et notamment de la guerre d'Algérie. S'élevant à 20 000 en 1954-1956, le nombre de détenus va ainsi augmenter pour atteindre en 1968 environ 34 000 détenus. Le contexte politique et l'inflation carcérale vont placer les préoccupations sécuritaires au centre de la politique pénale. Le régime de la détention va se durcir et très certainement contribuer à précipiter les prisons dans une succession d'événements dramatiques : en février 1971, des détenus parviennent à s'emparer d'armes et de munitions à Aix-en-Provence. En juillet de la même année, un surveillant est tué à Lyon. En septembre, à Clairvaux, une infirmière et un surveillant sont retrouvés égorgés après une prise d'otages dramatique. L'année s'achève par une insurrection de la maison centrale de Toul, première d'une longue série de révoltes dans les prisons qui vont durer jusqu'en 1974. Au total, des mutineries vont éclater dans plus de cent prisons ; les surveillants menacent également d'accompagner ces mouvements de détenus. La réforme des conditions de détention apparaît vite indispensable : il est d'abord instauré une diversification des régimes de détention entre centres de détention et maisons centrales. Cette diversification permet d'alléger la surveillance pour les premiers établissements, destinés à accueillir des détenus ne présentant pas de dangerosité, et à concentrer la surveillance sur les maisons centrales. Dans les maisons d'arrêt sont créés les quartiers de haute sécurité, qui permettent également de focaliser la surveillance sur quelques détenus particulièrement dangereux. Parallèlement à cette diversification des établissements est menée une politique de libéralisation : le port obligatoire du béret et de la tenue carcérale sont supprimés, le droit à l'information est reconnu par l'introduction des journaux en 1971 et de la radio en 1974 ; les femmes détenues obtiennent le droit de fumer. Est supprimée du Code de procédure pénale la disposition prévoyant que le détenu en cellule disciplinaire est nourri au pain, à la soupe et à l'eau trois jours par semaine. De façon symbolique, la règle du silence, imposée en 1839, est supprimée. Plus concrètement, les limitations de correspondance imposées aux condamnés, qui n'avaient auparavant le droit d'écrire que trois lettres par semaine chacune sur une seule feuille de papier, disparaissent. Les détenus obtiennent le droit de se marier en prison sans autorisation, et se voient accorder la possibilité de laisser pousser leurs cheveux, leur barbe et leur moustache à leur gré. La loi du 31 décembre 1975 reconnaît également au détenu le statut de citoyen à part entière en rétablissant le droit de vote dans les prisons. Cette interdiction reposait sur un décret prince-présidentiel du 2 février 1852. La condition des personnels reçoit aussi des aménagements qui seront officialisés par la promulgation de statuts en 1977. Après une nouvelle période de durcissement de la politique pénale, le mouvement d'humanisation et de libéralisation se poursuit après 1977 : les quartiers de sécurité renforcée et de haute sécurité sont supprimés. En 1983 sont généralisés les parloirs sans séparation. La volonté affichée est d'ouvrir le plus largement possible la prison vers l'extérieur ; le décloisonnement se traduit par l'intervention croissante de personnels extérieurs qualifiés dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, du sport ou de la culture. Cette ouverture vers l'extérieur se traduit également par l'entrée de la télévision dans les cellules en 1985 ; souvent contestée ou discutée, cette innovation marque incontestablement un tournant décisif dans l'histoire pénitentiaire. Les alternances politiques ne vont pas remettre en cause ce mouvement d'ouverture et de libéralisation. En 1987 disparaît l'obligation au travail ; la loi du 22 juin 1987 confirme également la mission de réinsertion sociale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Seules sont modifiées les modalités de gestion des établissements pénitentiaires : la loi de 1987 permet en effet de confier à une personne de droit public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires. Sur la base des conventions passées en application de la loi de 1987 avec quatre groupements privés seront construits 25 établissements d'une capacité totale de 12 850 places ; il s'agit du « programme 13 000 ». Le décloisonnement se poursuit avec la loi du 18 janvier 1994, qui transfère les soins en milieu carcéral du ministère de la Justice au ministère de la Santé. Comme on le voit, l'histoire pénitentiaire n'est pas linéaire ; elle est faite d'allers et retours répétés, sous la pression d'événements dramatiques et de réactions de l'opinion publique. Il importe aujourd'hui de dresser un état des lieux rigoureux et objectif afin de déterminer pour l'avenir les grandes orientations de la politique pénitentiaire. Comme l'a rappelé M. Robert Badinter : « Il y a des périodes favorables et des périodes défavorables : périodes favorables quand survient, comme maintenant, une prise de conscience de la réalité des prisons. Ces périodes cessent par le jeu des circonstances ; que survienne une prise d'otage, qu'un gardien soit, hélas victime d'un grave attentat dans une prison et aussitôt le climat change. Il existe donc des moments pendant lesquels on peut agir. Je pense que nous sommes à l'un de ces moments, mais qu'il est à la merci d'un incident qui peut survenir à tout instant, car la prison est un monde de violence, d'épreuves de force ; tout peut y advenir à tout moment ; c'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté de la gestion des prisons par les services de l'administration pénitentiaire. » I.- UNE RÉALITÉ CARCÉRALE MÉCONNUE A.- LE CONSTAT DE LA SURPOPULATION PÉNALE L'existence de cellules conçues pour une ou deux personnes et occupées par deux, trois voire quatre personnes, est une réalité. Elle concerne essentiellement les maisons d'arrêt. Les causes en sont multiples : banalisation de la détention provisoire, lenteur de la justice, maintien des condamnés en maison d'arrêt et augmentation de la durée des peines prononcées. Cependant, si elle se mesure par rapport au nombre de places disponibles, la surpopulation est aussi fonction du taux d'incarcération qui n'est pas une donnée intangible. Dès lors, la solution à la surpopulation ne passe pas uniquement, ni même essentiellement, par la construction de nouvelles places de prison. La modification de la politique pénale appliquée, la limitation de la détention provisoire et la mise en _uvre d'un véritable régime progressif d'application des peines devraient constituer autant de moyens d'abaisser le nombre de personnes incarcérées et, par-là même, de remédier à la surpopulation actuelle. 1) La réalité de la surpopulation pénale a) Le concept de surpopulation carcérale Les travaux de M. Pierre Tournier dans le cadre du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (C.E.S.D.I.P.) ont permis de faire la distinction entre les concepts d'inflation et de surpopulation carcérale. La période allant de 1975 à 1995 se caractérise par une forte inflation carcérale, l'accroissement du nombre de détenus, de l'ordre de 100 %, étant en effet sans commune mesure avec l'accroissement de 10 % de la population française totale. La surpopulation carcérale est une notion liée à l'inflation carcérale, mais qui ne la recouvre pas exactement : elle décrit l'inadéquation matérielle entre le nombre de détenus et le nombre de places dans les prisons. L'inflation accentue le problème de la surpopulation, faute de constructions suffisantes. Cependant, la définition de la surpopulation est également étroitement dépendante des critères retenus par l'administration pénitentiaire dans la définition du nombre de places dans les prisons. Cette définition a fait l'objet d'une circulaire en date du 17 mars 1988 définissant le mode de calcul des places dans les établissements pénitentiaires et l'usage qui doit en être fait. La notion de capacité d'accueil est définie par la somme du nombre de cellules et dortoirs utilisés pour héberger des détenus placés en détention normale, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, de mineurs ou d'adultes. Sont également comptabilisées dans cette capacité d'accueil les cellules utilisées pour les entrants, celles destinées à la semi-liberté, ainsi que les cellules des services médico-psychologiques régionaux. En revanche, ne doivent pas être incluses au titre de la capacité d'hébergement les cellules destinées à l'exécution des sanctions disciplinaires, à la mise à l'isolement ainsi que les cellules ou dortoirs à usage d'infirmerie. Le recensement des cellules effectué, la capacité d'accueil se calcule par référence à la surface au plancher, selon le barème ci-dessous reproduit. Tableau des barèmes en fonction de la superficie au plancher
Il ressort des statistiques fournies par l'administration pénitentiaire que l'on dénombre au 1er mars 2000 : 34 363 cellules monoplaces 34 363 places 4 079 cellules doubles 8 158 places 1 884 cellules de plus de deux détenus 6 895 places soit un total de 49 416 places. Le nombre total de places était de 36 615 au 1er janvier 1990 ; l'achèvement de 25 établissements du programme dit « 13 000 » (établissements à gestion mixte issus du programme de construction lancé en 1987), l'ouverture de 15 établissements à gestion « classique », d'un centre de semi-liberté à Montpellier, ainsi que la restructuration complète de 5 autres établissements ont permis cet accroissement de plus de 30 % des capacités d'accueil en dix ans. Le déficit en termes de places, dans les conditions d'hébergement actuelles, compte tenu du nombre de personnes incarcérées, est de l'ordre de 2 000. L'administration pénitentiaire indique qu'à l'achèvement du programme en cours portant sur six établissements, le solde net de places créées sera de 2 545 places supplémentaires. La question est de savoir si l'élargissement du parc pénitentiaire est la solution adéquate pour lutter contre l'inflation carcérale. Déjà en 1830, le ministre de l'Intérieur constatait, dans son rapport à la Société Royale des prisons, qu' « à mesure que les constructions s'étendent, le nombre de prisonniers augmente ». Cette interrogation est toujours d'actualité : les moyens de rompre le cercle vicieux entre l'accroissement du nombre de détenus et l'augmentation des capacités d'accueil en prison seront dès lors longuement évoqués dans ce rapport. En effet, la question de la surpopulation peut s'envisager de deux façons : soit on considère qu'il n'y a pas assez de places en détention, soit qu'il y a trop de personnes détenues. Une action sur ces deux variables est sans doute nécessaire. Il s'agit, dans un premier temps, de constater le déficit de places et d'en déterminer les conséquences sur les conditions de détention en établissements pénitentiaires, et notamment en maisons d'arrêt. b) Une surpopulation qui ne concerne que les maisons d'arrêt Le principe de l'encellulement individuel, qui impose d'attribuer à un détenu une place existante dans une cellule à une place, est prévu à l'article 716 du code de procédure pénale pour les personnes mises en examen et à l'article 719 pour les condamnés. Le respect du principe devrait prémunir les établissements pénitentiaires du surencombrement ; dans la pratique, l'emprisonnement cellulaire est bien respecté dans les établissements pour peine, qui accueillent les condamnés. Dans les maisons d'arrêt, en revanche, il n'est que très rarement respecté. Cette dérogation est explicitement prévue par trois articles de la partie réglementaire du code de procédure pénale : « le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale » (premier alinéa de l'article D.83 du code de procédure pénale). « Dans les maisons d'arrêt cellulaires ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail » (premier alinéa de l'article D.84 du code de procédure pénale). « Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe et, à défaut, dans les cellules » (premier alinéa de l'article D.85 du code de procédure pénale). Admettre d'entrée de jeu, par des textes réglementaires, que le surencombrement des maisons d'arrêt est une condition suffisante pour déroger à l'encellulement individuel démontre toute la fragilité du principe. Ce principe doit pouvoir être appliqué, sauf si le détenu ne souhaite pas assumer cette solitude. Les articles D.83 à D.85 du code de procédure pénale ne font que semblant d'organiser de manière rationnelle une situation dramatique de surencombrement endémique des maisons d'arrêt. La loi sur la présomption d'innocence, récemment adoptée par le Parlement, prévoit, dans son article 68, de ne pouvoir déroger au principe de l'encellulement individuel qu'à la demande du détenu ou pour les nécessités d'organisation du travail. Adoptée à l'initiative de votre rapporteur, cette disposition ne trouvera toutefois à s'appliquer que dans un délai de trois ans, afin de laisser à l'administration pénitentiaire le temps de prévoir les infrastructures nécessaires ; les articles D.83 à D.85 devront en effet être revus, le surencombrement ne pouvant plus constituer un motif suffisant de non-respect du principe de l'encellulement individuel. Le rapport entre le nombre de détenus et le nombre de places s'élève, au 1er avril 2000, à 132 % en moyenne en maison d'arrêt. Sept d'entre elles ont une densité égale ou supérieure à 200 % : Lyon Montluc (220 %), Meaux (220 %), Le Mans (206 %), Bayonne (232 %), La Roche-sur-Yon (227 %), Le Port à la Réunion (200 %) et Nouméa en Nouvelle-Calédonie (226 %). Sur les neuf directions régionales et la mission outre-mer, 42 maisons d'arrêt ont une densité comprise entre 150 et 200 %.
Au total, au 1er mars 2000, seuls 8 174 détenus sont placés en cellules individuelles, sur les 35 244 détenus que comptent les maisons d'arrêt. Par comparaison, les établissements pour peine, qui respectent à quelques exceptions près, le principe d'encellulement individuel connaissent une densité égale à 91 détenus pour 100 places. Descriptif du surpeuplement carcéral en Europe Parc pénitentiaire et surpeuplement : sur les 23 pays que l'on a pu étudier, 11 ont une densité carcérale globale inférieure à 100 détenus pour 100 places : Autriche, Croatie, Danemark, Finlande, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. Si on se contentait de cet indice, on pourrait donc dire que la moitié des pays n'a aucun problème de surpeuplement. En réalité, 3 Etats seulement sur les 23 étudiés n'ont aucun établissement surpeuplé, l'Autriche, la Macédoine et la Slovaquie. La Suède compte 4 % d'établissements surpeuplés, la Croatie 5 %, le Danemark 10 %, la Finlande 12 %, la Slovénie 15 %, la Norvège 17 %, les Pays-Bas 23 % et la Suisse 43 %. Dans les 11 autres pays étudiés, plus de 50 % des prisons sont surpeuplées. On trouve ainsi de 50 à 75 % d'établissements surpeuplés en Irlande, France, Lettonie, Belgique, Angleterre et Pays de Galles, Italie et Espagne. Plus de 80 % le sont en Hongrie, Portugal, Bulgarie, Roumanie et Estonie. Enfin on trouve des établissements qui ont une densité au moins égale à 200 en Bulgarie (maximum de 371 détenus pour 100 places), au Portugal (max. 368), en Hongrie (max. 311), en France (max. 299), en Roumanie (max. 242), en Estonie (max. 208 et en Espagne (max. 200). Nombre de détenus et surpeuplement : si l'on raisonne en proportion de détenus vivant dans un établissement surpeuplé, la situation est nettement plus tranchée entre les différents Etats. Un premier groupe est constitué des 10 Etats où la proportion de détenus vivant en situation de surpeuplement est inférieure à 30 % : Autriche, Croatie, Danemark, Finlande, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie et Suède. Dans les autres pays, 2/3 au moins des détenus vivent dans des conditions de surpeuplement. En tête on retrouve l'Estonie (100 % de détenus), la Bulgarie (95 %), la Roumanie (93 %), le Portugal (90 %), la Hongrie (89 %), et l'Italie (85 %), mais les autres pays de ce groupe ne sont pas loin (65 % pour la France). La situation la plus enviable, si l'on peut dire, est celle de la Suisse avec 57 % de détenus vivant dans un établissement suroccupé. Source : Conseil de l'Europe Tiré de « Prisons d'Europe, inflation carcérale et surpeuplement » P. Tournier - CESDIP, mars 2000 2) Les causes de la surpopulation a) Surpopulation et inflation carcérale Les chiffres fournis par l'administration pénitentiaire permettent de retracer l'évolution de la population pénale depuis 1852, première année pour laquelle l'administration pénitentiaire du ministère de l'Intérieur publie une « Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires ». Le nombre de personnes détenues a oscillé depuis cette date de 51 300 à 12 400 en 1940, chiffre le plus bas de toute cette période. La période allant de 1975 à 1995 est marquée par une inflation sans précédent de la population carcérale : s'établissant à 26 032 détenus au 1er janvier 1975, elle va s'élever à un record historique de 52 658 au 1er janvier 1996, soit un doublement de la population sur vingt ans. Les deux lois d'amnistie de 1981 et 1988, la loi du 9 juillet 1984 sur la détention provisoire, la loi du 19 septembre 1986 sur les réductions de peine ainsi que le recours de plus en plus fréquent, voire systématique, aux grâces collectives, ne semblent avoir que peu d'effets sur cette croissance. Depuis 1996, on observe une lente décrue des effectifs de la population carcérale, qui s'établissent, au 1er janvier 2000, à 48 049 détenus pour la métropole et 3 392 détenus pour l'outre-mer. Le quasi doublement sur vingt ans de la population carcérale a placé la question des capacités d'accueil des établissements pénitentiaires au centre de la réflexion sur les conditions de détention ; l'administration pénitentiaire ne dispose en effet d'aucun élément de maîtrise lui permettant de juguler cette inflation. M. Guy Canivet, Premier Président de la cour de cassation observe ainsi devant la commission d'enquête : « Il est exact que la décision d'un juge de placer en prison ne tient aucun compte des capacités d'exécution de la mesure. On place en détention sans limite de capacité des établissements et l'on demande à l'administration pénitentiaire d'exécuter ! Un directeur de maison d'arrêt vous dira qu'il lui est impossible de refuser une incarcération. Lorsqu'il reçoit une personne placée sous mandat de dépôt, il est obligé de l'écrouer. » L'accroissement de la durée de détention est le phénomène marquant de ces dernières années : la durée moyenne de détention s'établit à 8,3 mois en 1999 contre 4,3 mois en 1975. Il s'explique par plusieurs facteurs qui doivent être analysés : - l'alourdissement des peines prononcées - le moindre recours aux procédures d'individualisation des peines - l'allongement de la détention provisoire L'augmentation de la durée de détention est en premier lieu la conséquence directe de l'alourdissement des peines prononcées ; cette tendance concerne d'abord les peines prononcées par les cours d'assises ; si l'on excepte la peine la plus grave qui est la réclusion criminelle à perpétuité, dont l'évolution n'est pas linéaire, on observe que les peines d'emprisonnement allant de 5 ans à moins de 10 ans qui représentaient près de 40 % des peines d'emprisonnement ferme prononcées en 1990, diminuent régulièrement pour atteindre 36 % en 1997 ; en revanche, les peines de 10 ans à moins de 20 ans augmentent très régulièrement et représentent, en 1990, 30 % des peines prononcées, en 1993, 34 %, en 1995, 37 % en 1996 et 38,7 % en 1997. Les peines de 20 ans et plus sont également en augmentation, mais de façon moins marquée : 1 % entre 1990 et 1997. S'agissant des condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels, l'évolution est plus contrastée : les condamnations à un emprisonnement ferme allant de quelques jours à moins de deux mois sont en baisse très nette, représentant 24 % de l'ensemble en 1970, 19 % en 1974 et 18 % en 1997. L'adoption d'un nouveau code pénal inscrivant dans la liste des peines correctionnelles prononcées les peines alternatives à l'emprisonnement a très certainement été à l'origine du moindre recours à ces petites peines d'emprisonnement. En revanche, les peines d'emprisonnement plus longues sont en hausse, la durée moyenne de l'emprisonnement délictuel augmentant à partir de 1994 : inférieure ou égale à 7 mois jusqu'en 1993, elle passe à 7,1 mois en 1994, 8,5 mois en 1995, 7,9 mois en 1996 et 7,7 mois en 1997. L'allongement du temps de la détention est également dû à un moindre recours aux procédures d'individualisation des peines, telles que les réductions de peine ou les mesures de libération conditionnelle ; pour ces dernières, le taux d'octroi par le juge d'application des peines diminue d'année en année. Il s'établit ainsi à 14 % en 1999 contre 23 % en 1986. La libération conditionnelle paraît pourtant un élément essentiel de la maîtrise des flux de la population carcérale ; elle constitue également une démarche indispensable pour responsabiliser le détenu et le préparer à sa sortie. Les propositions pour réactiver cette procédure et les impératifs qui s'attachent à cette réactivation seront examinés ultérieurement dans le rapport. L'allongement des temps de présence en prison, facteur essentiel de l'inflation carcérale observée, est néanmoins compensé par une diminution des flux d'entrées en détention. Il semblerait ainsi qu'on entre moins en prison, mais qu'on y entre pour plus longtemps : de 1994 à 1998, les entrées en détention pour délit ont baissé d'année en année (- 14,7 % entre 1994 et 1998). Cette diminution se constate notamment sur des délits de masse comme le vol simple (- 47 %), les infractions à la police des étrangers
La diminution des entrées en détention est très certainement due au développement du recours aux mesures alternatives à l'incarcération. L'alourdissement des peines prononcées est plus difficilement explicable : il peut être dû à une évolution des contentieux soumis aux juges et aux jurés, mais également à un changement dans la façon d'appréhender l'infraction, de la tolérer ou de la sanctionner. L'allongement peut également apparaître comme une conséquence de la suppression de la peine de mort qui a conduit, sous la pression d'événements dramatiques, à modifier la législation : le nouveau code pénal de 1994 a ainsi instauré une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans en matière criminelle au lieu de 20 ans auparavant. Les périodes de sûreté, périodes pendant lesquelles le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure d'aménagement de la peine, ont également été progressivement allongées pour atteindre 30 ans dans le cas de meurtre ou d'assassinat d'un enfant de moins de quinze ans précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Enfin, la longueur des procédures s'est également traduite par un allongement de la détention provisoire qui a des répercussions importantes sur le surpeuplement carcéral dans les maisons d'arrêt. Evolution de l'indicateur de la durée moyenne
En 1999, la durée moyenne de la détention provisoire pour la métropole et l'outre-mer s'est établi à 4,2 mois, avec une population moyenne de prévenus, en attente de décision de première instance ou de jugement d'appel ou de cassation, s'élevant à 19 276 et un nombre d'entrées à 54 590. L'allongement de la durée de la détention provisoire est lié à la durée de l'instruction et aux délais d'audiencement préalables au jugement. M. Jean-Baptiste Parlos, membre de l'Association française des magistrats chargés de l'instruction observe ainsi : « D'après les statistiques du ministère de la Justice, la durée moyenne d'une détention provisoire à l'instruction est d'un peu plus de cinq mois, toutes matières confondues. De l'extérieur, on a le sentiment que la détention provisoire est souvent beaucoup plus longue. A ce titre, deux éléments nous semblent devoir être soulignés. Tout d'abord, la durée de la détention est souvent liée, pas toujours cependant, aux difficultés que nous rencontrons dans le déroulement de nos dossiers. Nous sommes en charge de beaucoup de dossiers et disposons de peu de moyens, ce que j'illustrerai d'un exemple concret : lorsque nous demandons aux services de police ou de gendarmerie d'exécuter dans des délais raisonnables et rapides des commissions rogatoires, ou lorsque nous demandons aux experts de réaliser rapidement leur mission, nous ne sommes pas toujours suivis. Ce sont là des éléments qui peuvent expliquer les difficultés que nous rencontrons en termes de durée de la détention. Cent trente dossiers en moyenne pour un cabinet d'instruction représentent une lourde charge de travail, et il faut bien observer qu'un dossier ne correspond pas toujours à un mis en examen, mais représente parfois dix mis en examen et plusieurs détenus. Le second point qu'il me paraît important de souligner à propos de la durée de la détention provisoire concerne les délais d'audiencement, lorsque le juge d'instruction a terminé ses investigations et que la personne est en attente d'être jugée. Je donnerai l'exemple de la cour d'assises de Paris. Une instruction criminelle dure en moyenne un an. Une personne qui est renvoyée devant la cour d'assises de Paris attend son jugement entre douze et vingt-quatre mois après l'instruction. C'est dire qu'une personne mise en examen le 5 février d'une année pourra attendre jusqu'à trois ans sa comparution devant la cour d'assises, ce qui n'est d'ailleurs pas sans créer une difficulté au regard de la nouvelle disposition sur l'appel des décisions de cour d'assises. Le délai de détention provisoire avant jugement sera d'autant plus augmenté que la personne, jugée une première fois, fera appel, retournera en détention provisoire et sera jugée une seconde fois. Sur le problème de la durée de la détention provisoire, nous sommes donc confrontés à deux difficultés : la première est liée aux conditions dans lesquelles se déroule notre instruction et aux moyens dont nous pouvons être dotés, notamment en ce qui concerne les services enquêteurs et les experts. La seconde difficulté est celle des délais d'audiencement beaucoup trop longs, non liés à la juridiction d'instruction, mais au retard pris par l'institution judiciaire pour le jugement des affaires. » b) Surpopulation et carte pénitentiaire Si l'administration pénitentiaire ne peut en aucun cas maîtriser les flux de la population carcérale, alors même que ceux-ci sont déterminants dans la constatation des taux de suroccupation des établissements pénitentiaires, elle est néanmoins responsable de la gestion de la carte pénitentiaire. A l'examen de cette gestion, le principe du numerus clausus appliqué aux établissements pour peine paraît également comporter des conséquences dramatiques pour les taux d'occupation des maisons d'arrêt. le principe retenu pour les établissements pour peine est celui du respect scrupuleux de l'encellulement individuel avec un impératif respecté à peu près partout : « une place, un condamné ». Il n'y a donc pas de surpopulation dans ces établissements. Pour respectable que soit le principe, force est de constater qu'il s'applique au détriment des maisons d'arrêt. L'encombrement chronique dans les maisons d'arrêt découle d'un « bouchon » qui se forme à l'entrée des établissements pour peine pour lesquels est appliqué un numerus clausus. Les condamnés doivent en effet attendre en maison d'arrêt qu'une place se libère dans les établissements pour peine avant de pouvoir y être affectés. Les maisons d'arrêt subissent cette gestion du numerus clausus et se trouvent dans l'obligation d'héberger, pendant des mois, voire des années, des condamnés, relevant d'une affectation en établissements pour peine. Ainsi, sur 33 141 condamnés que compte la population pénale au 1er janvier 2000, 9 497 sont maintenus en maison d'arrêt. Certes, parmi ceux-ci, tous ne relèvent pas d'une affectation en établissement pour peine. L'article 717 du Code de procédure pénale précise à cet effet qu'à titre exceptionnel, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an ou ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an peuvent être maintenus en maison d'arrêt. Dans la pratique, et les visites des maisons d'arrêt par les membres de la Commission d'enquête l'ont confirmé, il n'est pas rare de rencontrer dans ces établissements des détenus ayant des reliquats de peine allant jusqu'à deux ou trois ans d'emprisonnement. « Il n'est pas normal que des détenus condamnés à de longues peines aient à attendre de longues années, en maison d'arrêt, avant de rejoindre des établissements pour peine. Le délai d'attente, pour un transfert au centre de détention de Nantes, après une décision d'affectation, est de dix-huit mois, ce qui est sans doute vrai également pour Saint-Martin-de-Ré, Muret et d'autres établissements. Il n'est pas normal que des condamnés à de longues peines, alors qu'ils sont affectés depuis parfois deux ou trois ans dans un établissement pour peine, doivent attendre aussi longtemps. » (M. Louis Leblay, directeur du centre pénitentiaire de Nantes et membre du syndicat CFDT justice). Selon les statistiques de l'administration pénitentiaire, il faut 13 mois d'attente pour un transfert à Saint-Martin-de-Ré, 10 mois pour Clairvaux, Château-Thierry, Melun, 16 mois pour Val-de-Reuil, 17 mois pour Riom et 18 mois pour Nantes. Le phénomène est d'autant plus accentué que les procédures d'affectation et d'orientation dans les établissements pour peine sont lourdes et impliquent pour le condamné un temps d'attente souvent vécu comme excessivement long. Certes, un décret du 9 décembre 1998, assorti d'une circulaire parue le même jour, a réformé la procédure d'orientation et d'affectation dans le sens d'un allégement de procédures par une déconcentration accrue de la décision d'orientation. Le ministre de la justice, en application de l'article D.80 du code de procédure pénale, conserve toujours une compétence générale d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Néanmoins, cette compétence n'est désormais exclusive que pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale. Les affectations dans les centres de détention régionaux, destinés à accueillir les condamnés à une peine inférieure à cinq ans ou à une peine de moins de sept ans avec un reliquat de cinq ans à purger, relèvent dorénavant de la compétence des directeurs régionaux. Cette compétence peut même être déléguée au niveau du directeur d'établissement lorsque l'établissement en question comporte un quartier centre de détention régional, à condition que la durée d'incarcération du détenu concerné ne soit plus que de deux ans. La volonté d'accélérer les procédures est patente, mais les améliorations constatées dans la pratique restent timides. La remontée des dossiers jusqu'au ministre pour les détenus affectés en maison centrale ou centre de détention national exige des délais très longs, dont personne n'est en mesure d'expliquer la raison, et implique que le détenu soit maintenu plus longtemps en maison d'arrêt alors même qu'il paraît, compte tenu de la lourdeur de la condamnation, plus dangereux. Par ailleurs, selon la circulaire du 9 décembre 1998, tous les condamnés dont le reliquat de peine est égal ou supérieur à plus de 10 ans doivent faire l'objet d'une période d'observation au Centre national d'observation (CNO) de Fresnes. On conçoit l'intérêt que présente, pour les condamnés à de longues peines, une période d'observation, destinée à étudier la situation du détenu et à l'affecter dans l'établissement correspondant le mieux à son profil. Un tel système existe au Canada où il est utilisé pour préparer un programme d'application de la peine propre à chaque condamné, afin d'exploiter au mieux ses possibilités de réinsertion. Cependant, la lourdeur de la procédure en France et les temps nécessaires au transfert ne facilitent pas le désencombrement des maisons d'arrêt. De plus, les procédures d'affectation en établissements pour peine sont encore allongées par des difficultés pratiques résultant de l'article D.77 du code de procédure pénale et de l'obligation faite au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation de constituer un dossier relatant l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation, assorti d'une notice individuelle concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents. Le dossier doit également être accompagné, pour les peines supérieures à deux ans, d'un certain nombre de pièces ayant trait à l'affaire et de la copie des expertises médicales et psychiatriques auxquelles il aurait été éventuellement procédé. L'ensemble des pièces doit en théorie être envoyé dans le mois qui suit la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Dans la pratique, ce délai se révèle beaucoup plus long, compte tenu du manque de moyens à la disposition des greffes des tribunaux. Il en résulte, là encore, des délais insupportables pour les condamnés, en attente d'affectation dans un établissement pour peine et des répercussions importantes sur les taux de surpopulation dans les maisons d'arrêt. Le respect d'un numerus clausus ne s'applique pas qu'aux établissements pour peine ; certaines maisons d'arrêt, relevant du programme « 13 000 », en bénéficient également. Les établissements du programme « 13 000 » lancé en 1987, dont la gestion de certaines fonctions, telles que l'hôtellerie, la santé ou le travail, a été concédée au secteur privé, se voient appliquer un quota leur permettant de maintenir un taux de surpopulation dans des proportions acceptables. En effet, au-delà d'un taux de suroccupation de 120 %, des pénalités financières à la charge de l'Etat sont prévues. Là encore, ce respect d'un taux limite de surpopulation s'opère au détriment des maisons d'arrêt à gestion « classique » qui doivent faire face à des transferts de détenus lorsqu'il y a suroccupation dans les maisons d'arrêt du programme « 13 000 ». Plus généralement, l'administration pénitentiaire se trouve contrainte de gérer la carte du surencombrement pénitentiaire. Comme l'a indiqué à la commission Mme Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire : « Le surpeuplement est difficilement géré pour les maisons d'arrêt. Normalement, la personne est incarcérée dans la maison d'arrêt du ressort du tribunal où se trouve le juge d'instruction qui l'a incarcérée. Avec l'accord des juges d'instruction, nous procédons parfois à des transferts à l'intérieur d'une région pénitentiaire. Lorsqu'une maison d'arrêt est trop surencombrée, nous transférons à la maison d'arrêt la plus proche, la moins surencombrée, quitte pour celle-ci à procéder à un transfert en conséquence. Cela n'est possible qu'avec l'accord des juges d'instruction et à la condition que la région elle-même ne soit pas trop surencombrée. Pour la région Ouest, les établissements le sont tous. Nous rencontrons alors quelques difficultés à procéder à de « bons désencombrements. » Les visites ont permis de constater sur place ces pratiques. Ainsi, la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne est fréquemment utilisée pour désengorger Béziers, Perpignan ou d'autres maisons d'arrêt. Les conséquences qui en résultent pour les familles comme pour les détenus sont aisément imaginables. 3) Les conséquences de la surpopulation carcérale La surpopulation aboutit au non-respect des textes, rend très difficiles les conditions de vie en détention et empêche l'administration pénitentiaire d'assurer correctement son rôle. a) Des règles du code de procédure pénale qui restent inappliquées Le non-respect des dispositions du code de procédure pénale n'est bien évidemment pas ce qui choque au prime abord lors de visites dans les maisons d'arrêt. Les conditions difficiles de détention qui se traduisent par la promiscuité et le manque d'intimité sont véritablement le quotidien de la vie en prison ; le respect des dispositions législatives et réglementaires apparaît dès lors comme un impératif lointain, dépourvu d'implications concrètes aussi bien pour les détenus que pour le personnel surveillant ou d'encadrement. Il importe néanmoins d'en dire quelques mots afin de mesurer l'abîme qui sépare les textes de la réalité carcérale. La surpopulation carcérale est en premier lieu une réalité antinomique avec les dispositions des articles D.83 à D.85 du code de procédure pénale qui prévoient l'isolement individuel de jour comme de nuit dans les maisons d'arrêt. On l'a vu, ces dispositions sont assorties néanmoins de suffisamment de précautions pour que la responsabilité de l'administration pénitentiaire ne puisse être engagée en cas de non-respect du principe. La surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt rend également totalement utopique l'application de l'article D.90 du code procédure pénale qui prévoit la séparation, sur les lieux de détention, des condamnés, des détenus soumis à la contrainte par corps et des prévenus. L'article D.90 précise même qu'à l'intérieur de ces catégories doivent être séparés les détenus n'ayant pas subi antérieurement de peines privatives de liberté, et ceux ayant déjà encouru de nombreuses condamnations. Dans la pratique, les directeurs d'établissement sont contraints de gérer cette surpopulation en faisant en sorte que celle-ci soit acceptée le mieux possible par les détenus. Les affectations dans telle ou telle cellule obéissent dès lors à des impératifs tenant à la personnalité de détenu, son âge, son comportement et éventuellement dans certaines maisons d'arrêt comme la Santé à Paris ou Les Baumettes à Marseille, sa nationalité ou son origine ethnique. Les prescriptions prévues par le code de procédure pénale tenant à la situation juridique du détenu et son éventuel passé judiciaire sont au mieux prises en compte de manière subsidiaire, au pire totalement ignorées. Il arrive également que la séparation des mineurs et des détenus âgés de moins de vingt et un ans, prévue par l'article D.516 du code de procédure pénale, puisse, en conséquence, ne pas être respectée, comme a pu le démontrer la visite de la maison d'arrêt de Troyes. Cette séparation entre mineurs et majeurs semble également totalement ignorée dans les quartiers de détention des femmes. Les conséquences du non-respect du code de procédure pénale sont difficiles à évaluer. Elles ne semblent avoir aucune répercussion sur la vie quotidienne de la détention, et le mélange des détenus toutes catégories pénales confondues paraît même très bien accepté. Gageons cependant qu'en termes de prévention de la récidive, ces conditions de détention ne sont pas optimales. La prison n'est peut-être pas l'école du crime comme on a pu si souvent la présenter ; il est néanmoins certain que c'est en prison, par le mélange de l'ensemble des catégories de détenus, que peuvent se créer des réseaux et s'échanger des informations. La surpopulation pénale dans les maisons d'arrêt impose ainsi aux directeurs d'établissement et aux surveillants des contraintes de gestion qui nuisent aux possibilités de réinsertion des détenus. b) Des conditions de vie en détention rendues très difficiles Il est excessif de présenter le phénomène de surpopulation carcérale comme une généralité touchant l'ensemble des maisons d'arrêt. Néanmoins les nombreuses visites des membres de la Commission d'enquête notamment dans les maisons d'arrêt de Rouen, Fontenay-le Comte, La Roche-sur-Yon, Meaux, Nîmes, Bayonne ou Loos ont permis de constater de visu les dégradations des conditions de vie qu'une telle surpopulation implique. Concrètement, sur un plan purement matériel, la surpopulation est à l'origine d'un nombre considérable de dysfonctionnements. La distribution des repas met deux fois plus de temps que prévu en temps normal et les plats arrivent froids dans les cellules ; les capacités en eau chaude de l'établissement sont insuffisantes pour permettre le nombre de douches réglementaires ; les déplacements collectifs exigent beaucoup plus de temps ; les capacités des infrastructures sportives sont rapidement dépassées ; le nombre de places en ateliers ou en formation est insuffisant ; l'accès aux parloirs peut également devenir extrêmement difficile. La surpopulation se traduit également par la présence de trois, voire quatre détenus en cellule. Il arrive de voir, comme à Nîmes ou à Gradignan, des détenus coucher par terre sur des matelas. Un député membre de la commission a pu constater à Gradignan que trois détenus vivaient dans 6 m² vingt et une heures sur vingt-quatre. La vie en commun dans un espace aussi exigu que la cellule exigerait des qualités relationnelles et une discipline rigoureuse. Tout peut en effet devenir sujet à conflit : la télévision allumée en permanence, le fonctionnement du réchaud à une heure tardive, l'éclairage, l'utilisation des toilettes en commun et généralement sans séparation, l'ouverture de la fenêtre, l'usage du tabac... La vie quotidienne en prison est une succession de négociations et de tensions. De telles conditions de promiscuité peuvent être l'occasion de tous les abus. Le problème des viols entre détenus, s'il fait parfois la une des journaux, est totalement occulté et, comme le note l'un des parlementaires dans ses comptes-rendus de visite, « il est impossible de savoir, côté détenus comme administration, ce qui se passe vraiment la nuit dans les cellules. L'omerta sur ces questions semble très puissante et efficace. » S'agissant d'une population souvent déstructurée, dépourvue de repères et connaissant de graves difficultés d'insertion, la suroccupation dans les cellules relève dès lors de la gageure. Elle impose au détenu un véritable combat quotidien pour préserver sa dignité et son intimité. Le Comité européen pour la prévention de la torture, organe dépendant du Conseil de l'Europe, s'est élevé lors de ses précédentes visites des établissements pénitentiaires en France contre ces conditions de détention. M. Ivan Zakine, membre du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture) a ainsi cité devant la Commission d'enquête les conclusions des rapports établis à l'époque : « Le rapport publié en janvier 1993 indiquait - j'en parle d'autant plus à mon aise que je ne faisais pas alors partie du Comité - que « les conditions de détention observées aux maisons d'arrêt de Marseille-Baumettes et de Nice laissaient fortement à désirer. Ces deux établissements étaient sérieusement surpeuplés, dotés de programmes d'activités très insuffisants. De plus, les conditions sanitaires et d'hygiène, de l'avis du CPT... » [le Comité européen] « ...ainsi que les conditions de détention déplorables dans les bâtiments A et B de la maison d'arrêt de Marseille-Baumettes équivalaient à un traitement inhumain et dégradant. Le degré élevé du surpeuplement à la maison d'arrêt de Nice a conduit le CPT à la même conclusion. » La deuxième visite du CPT en France a été relatée dans le rapport de 1996, publié le 14 mai 1998 : « Il appert de ce qui précède que les conditions de détention dans plusieurs parties de la maison d'arrêt de Paris La Santé laissaient grandement à désirer. Dans les divisions B, C et D, celles-ci pourraient être qualifiées d'inhumaines et de dégradantes. » La surpopulation pénale est donc à l'origine d'un traitement infligé aux détenus qui peut être considéré, à juste titre, comme inhumain et dégradant ; elle n'est bien évidemment pas non plus étrangère à la survenance de plus en plus fréquente d'actes d'auto-agressions (automutilations, tentatives de suicides ou suicides), d'agressions entre détenus, de phénomènes de racket ou d'actes de violence envers les surveillants. Il faut rappeler, pour conclure, que ces conditions de détention rendues particulièrement pénibles et désocialisantes du fait de la surpopulation sont imposées à des personnes qui, soit sont prévenues et bénéficient à ce titre de la présomption d'innocence, soit condamnées à de très courtes peines et destinées à retourner très rapidement à l'extérieur. Le paradoxe est latent et paraît à bien des égards choquant. Il est vrai que la gestion des condamnés à de longues peines relève d'une autre logique et exige, on le verra, une véritable réflexion sur le sens de la peine. Il n'en reste pas moins que ce sont les prévenus et les condamnés aux courtes peines qui subissent les conditions de détention les plus rigoureuses et les plus pénibles. c) Une surpopulation qui rend difficile le travail du personnel de surveillance. Les visites effectuées dans les maisons d'arrêt connaissant une surpopulation carcérale ont toutes permis de constater à quel point ces conditions de détention étaient pesantes pour le personnel, et notamment le personnel de surveillance. Quel que soit le dévouement des personnes rencontrées, l'observation d'un taux d'absentéisme plus élevé dans ces établissements traduit véritablement le malaise des surveillants, réduits à un rôle de gestion des incidents dans un climat de travail tendu au détriment de leur mission d'observation et de surveillance. Le surveillant se sent ainsi dépossédé de toutes les missions gratifiantes au profit d'une mission exclusive de porte-clefs. M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires d'Ile de France, observe ainsi : « Si la surpopulation est déjà un problème en elle-même, compte tenu du surcroît de travail qu'elle occasionne, ses effets induits sur la crédibilité et l'autorité de l'institution sont encore plus destructeurs. En effet, l'impératif de gestion se fait encore plus prégnant, car, outre le manque de places en cellule, c'est bien souvent l'ensemble des services qui dysfonctionne. Cette situation conduit l'administration à temporiser, à compenser. Les contacts avec la population pénale, l'observation, sont réduits, voire inexistants, laissant le champ libre aux leaders négatifs. On ne sait plus ce qui se passe, on gère des flux, on « fait tourner » selon l'expression souvent employée. Que peut faire le surveillant lorsqu'il entre dans une cellule où il se retrouve face à trois détenus ? La moindre remarque ne peut qu'entraîner une réaction ironique ou violente, car il n'est pas question pour le détenu de perdre la face. » Il en résulte une démission de l'administration pénitentiaire face à sa mission d'observation, de surveillance et de réinsertion. A la question de savoir pourquoi les détenus préféraient souvent des prisons vétustes et surpeuplées telles que les prisons de Lyon plutôt qu'un établissement neuf pouvant à peu près assurer un encellulement individuel, le même directeur régional répondait devant la commission d'enquête : « Au sujet de la question de la surpopulation, il se peut que les détenus considèrent, entre autres éléments objectifs, qu'être incarcéré à Villefranche 2 pose certains problèmes pour les visites des familles. Mais surtout la surpopulation, par ses effets déstructurants, conduit à l'abandon de la prison par l'administration. La prison surpeuplée n'appartient plus à l'administration, mais aux détenus. Le reportage du magazine « Envoyé spécial » sur les prisons de Lyon l'a bien souligné. Ceux qui vivent, à l'extérieur, de trafics ou autres reproduisent ce mode de fonctionnement en prison. Dès lors, leur proposer un système - Villefranche - où l'administration est plus présente ne les intéresse pas du tout. S'y ajoute le fait que le personnel débordé est peut-être plus tolérant - c'est du moins ce que l'on dit pour un établissement comme la Santé. L'administration est moins pesante, moins présente, le détenu se trouve mieux, mais jouons-nous notre rôle ? Je ne le crois pas ; nous sommes complètement en dehors. » A ces conditions de détention désocialisantes s'ajoute une inadaptation du parc pénitentiaire, alors même que la population pénale connaît de profondes mutations. B.- UN CADRE PÉNITENTIAIRE SOUVENT INADAPTÉ. L'extrême hétérogénéité des établissements pénitentiaires contredit l'opinion commune selon laquelle l'incarcération est une condition unique, celle du prisonnier. Etre prévenu, en détention provisoire, ou bien condamné maintenu dans une maison d'arrêt surpeuplée, a finalement peu de points communs avec la condition du condamné qui purge sa peine dans une maison centrale, sinon la contrainte lourde de la privation de liberté. Les conditions de l'exécution de la peine sont inégalitaires sans que le plus souvent cette différence de traitement soit justifiée par l'application d'un régime de détention adapté. Toutes les situations sont donc possibles ; il existe cependant des constantes qui sont liées, notamment, aux bâtiments eux-mêmes. 1.- Une politique immobilière peu cohérente : Le poids de l'histoire, la volonté d'occulter la prison, des crédits budgétaires toujours insuffisants parce que jamais prioritaires ont abouti, au fil des ans, à ce qu'au sein du parc pénitentiaire français, coexistent des établissements majoritairement vétustes, dégradés ou mal adaptés à leur mission, avec d'autres établissements, bien rénovés ou récents, qui offrent aux personnels et aux détenus des conditions de travail ou de vie bien différentes. Dans son ensemble, comme le souligne le rapport sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires : « L'état actuel des prisons françaises constitue un obstacle déterminant à tout progrès décisif du droit dans les établissements pénitentiaires, alors pourtant que toutes les parties ont intérêt à ce que ceux-ci soient dans un état matériel convenable. L'administration, parce que cet état commande souvent la gestion de l'établissement et de la détention des personnes privées de liberté. Les agents pénitentiaires parce que l'état matériel leur facilite la tâche en contribuant à un ordre mieux accepté, mais aussi parce que la prison est leur lieu de travail et que l'on concevrait difficilement, dans d'autres administrations, d'offrir aux agents de l'Etat un lieu de travail aussi sinistré. Les détenus, parce que cet état matériel participe directement de leur statut et de son effectivité. La société, enfin, parce que le délabrement des prisons, par les effets qu'il entraîne, va à l'encontre du fondement de la peine privative de liberté : la réinsertion qui, à terme, participe de la sécurité. » a) Des établissements pénitentiaires très majoritairement vétustes Sans compter, l'hôpital de Fresnes, 186 établissements pénitentiaires sont aujourd'hui en fonctionnement : - 43 ont été construits depuis 1984 - 22 ont été construits entre 1961 et 1983 - 13 ont été construits entre 1912 et 1960 - 108 sont antérieurs à 1912 92 sont installés dans des immeubles qui ont été construits au 19ème siècle, pour certains d'anciens biens d'églises transformés en prison pendant la période révolutionnaire. 2 800 détenus sont incarcérés dans des établissements antérieurs à 1830. Les maisons d'arrêt de Cahors, Chartres, Clermont-Ferrand, Gap, Troyes, Rodez, Versailles et Le Mans n'ont de révolutionnaire que leurs dates de mise en service qui s'étagent entre 1789 et 1793. Ces bâtiments anciens quand ils sont convenablement aménagés peuvent donner des résultats exemplaires. A titre d'illustration, c'est le cas de la maison d'arrêt d'Alençon ou bien de Vannes. Cette dernière aménagée dans un ancien couvent de 1570, offre, après les travaux nécessaires, un équipement sanitaire complet dans chaque cellule et bénéficie de l'état d'esprit qui peut exister dans une petite maison d'arrêt située en centre ville. Il en va de même de la maison d'arrêt d'Angoulême où des travaux importants ont eu lieu en 1990. Dans plus de la moitié des cas cependant, dans leur agencement actuel, ils sont fonctionnellement inadaptés aux régimes de détention. Dans des immeubles conçus en nef comme celui de Loos et utilisés comme centre de détention régional, le régime de portes ouvertes qui existe dans d'autres établissements de la même catégorie est impraticable, ce qui suscite des protestations. Un grand nombre d'installations, tout particulièrement les cuisines comme cela a pu être constaté lors des visites d'établissements, sont rarement conformes aux normes techniques et sanitaires. Seuls 55 établissements construits ou entièrement rénovés depuis 1968 satisfont aux normes actuelles de détention. Ils représentent la moitié de la capacité totale du parc. De grands établissements, en raison de l'importance de leur capacité d'accueil posent un problème majeur. Au 1er janvier 2 000, 3 300 détenus étaient accueillis à Fleury-Mérogis, 1 200 à Paris La Santé, 1 800 à Fresnes, 1 500 aux Baumettes, 1 300 à Loos. Un programme de réhabilitation lourde de ces établissements a été décidé. Toutefois, certaines décisions semblent remises en cause. Ainsi, les travaux de réhabilitation qui devaient être entrepris dès cette année à La Santé, à Paris, sont stoppés dans l'attente d'une décision sur le sort de cet établissement. M. Georges VIN, directeur des Baumettes a souligné que : « l'établissement souffrait d'un problème évident d'obsolescence des structures, puisque les conditions d'hébergement de la plupart des quartiers étaient extrêmement dégradées, en tout cas loin des normes actuelles et très éloignées de normes arrêtées pour le programme 13 000 ou prévues pour le plan 4 000. D'ailleurs, l'établissement à l'instar de cinq autres établissements importants, fait partie du plan de restructuration décidée par Mme la Garde des sceaux. Le programme, devant débuter en 2001 pour s'étendre sur six à sept ans, doit rénover l'ensemble du site. Il mobilisera des financements pluriannuels très lourds, afin de remettre aux normes tant les conditions d'hébergement des détenus que les conditions de travail des personnels, éloignées de ce que l'on est en droit d'attendre ou de ce qui existe dans des établissements beaucoup plus récents... Aujourd'hui, il y a 1 500 détenus pour une capacité théorique de 1 040 places. La majorité des cellules étant de 9,5 m2, il ne devrait y être incarcéré qu'un seul détenu. Malheureusement, l'état très dégradé de certains secteurs d'hébergement et le nombre de détenus nous conduisent à placer majoritairement des détenus en double dans des cellules. Il reste une trentaine de cellules triplées ; c'est peu et concerne le secteur spécifique des prévenus ou condamnés pour des infractions liées aux m_urs. » L'état des prisons de Lyon (St Paul et St Joseph) et de celle de Nice a conduit la garde des sceaux à annoncer leur remplacement et à inscrire les premiers crédits d'étude dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000. Sept établissements extrêmement vétustes doivent être fermés, leur remplacement devant intervenir à l'horizon 2002 - 2003 : les maisons d'arrêt de Meaux, de Melun, d'Avignon, de Toulouse, de Toulon, de Saint-Denis de la Réunion et le centre de détention de Liancourt. La grande misère des locaux de détention de ce dernier établissement doit être soulignée, d'autant que certaines parties ont dû en être fermées à la suite de la mutinerie de novembre 1998. Cette liste d'établissements, dont la fermeture est projetée, est loin de contenir tous les établissements qui devraient être fermés. Ainsi, la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan est dans un état tel que sa fermeture apparaît comme la seule solution viable. En effet, le programme des travaux indispensables s'élève à plus de 7,5 millions de francs, d'où la conclusion émise par la députée qui en a effectué la visite : « d'un avis général et de façon évidente pour toute personne qui entre dans ce lieu, il n'existe qu'une seule solution aux conditions déplorables de travail pour le personnel et de détention pour les prévenus : la fermeture de ce lieu. » De multiples autres constatations du même ordre ont été opérées par les membres de la commission d'enquête : - conditions d'accueil inacceptables des détenus masculins à la maison d'arrêt de Nancy où existent encore des dortoirs de 16 places dans lesquels les détenus s'isolent par des serviettes de bain. - inadaptation des locaux de la maison d'arrêt de Compiègne, humides et détériorés, où existent des cellules surpeuplées avec jusqu'à onze lits et une surface moyenne de 3,8 m² par détenu ! - importance des travaux nécessaires à Auxerre (chauffage, murs d'enceintes) - vétusté particulièrement marqué du quartier de semi-liberté de Belfort - vétusté de la maison d'arrêt de Chartres dotée de cellules exiguës et surpeuplées où les travaux en cours ne permettront qu'un encloisonnement « partiel » des WC ! - dégradation et vétusté extrême des établissements de Loos : la maison d'arrêt, dont les locaux sont dans un état déplorable et insalubre n'a pas fait l'objet de travaux entre 1960 et 1996. La construction d'une nouvelle maison d'arrêt (Sequedin) doit « désengorger » et permettre d'effectuer les travaux de réhabilitation prévus. Ce projet n'a d'ailleurs pas que des répercussions positives car dans l'attente de la restructuration, les aménagements indispensables sont bloqués. Par exemple, quelques cellules disciplinaires du centre de détention ont été refaites, sans crédits spécifiques, pour y installer des sanitaires. Les autres cellules de ce quartier n'en sont pas dotées. Dans le centre de détention d'Oermingen, à l'exception du bâtiment de 40 places construit en 1986, aucun des autres immeubles ne répond aux normes de sécurité et de confort actuellement en cours en détention : 90 % des installations électriques sont d'origine (1938), l'absence de sanitaires individuels dans 105 cellules condamnent 120 détenus à faire usage de seaux hygiéniques ! Il en va de même au centre de détention d'Eysses dont le bâtiment central composé de trois étages avec des coursives à l'ancienne comporte des cellules sans toilette avec une douche pour 50 détenus ! Selon le parlementaire appelé à visiter cet établissement, « 70 des 252 cellules de ce centre de détention sont dans un état innommable. » Les conditions de détention qui ont été constatées dans la maison d'arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe, ont conduit les membres de la Commission d'enquête qui s'y sont rendu à saisir sans attendre le garde des sceaux afin d'attirer son attention sur l'urgence qu'il y a à porter remède à des conditions d'enfermement proprement inhumaines. Les détenus, en l'absence totale d'activité sont confinés 20 heures par jour, dans des cellules très mal aérées, sans aucune possibilité de s'asseoir ou de s'attabler. Les dortoirs peuvent comprendre jusqu'à 12 lits superposés, les cours de promenade y sont exiguës, se réduisant pour l'une d'elle à un sombre corridor. Le fonctionnement de l'unité de soins y est également alarmant. Certains établissements identifiés par les directions régionales comme étant particulièrement vétustes ont été retenus comme devant faire l'objet d'un schéma directeur de rénovation pour mettre en _uvre un programme pluriannuel en fonction des études de faisabilité. Cette liste n'épuise pas celle des établissements vétustes ni d'ailleurs ne la recoupe entièrement. Etablissements devant faire l'objet d'un schéma directeur de rénovation
b) Des locaux très dégradés en raison du manque d'entretien Lorsque des locaux, par nature utilisés 24 heures sur 24, tout au long de l'année, accueillent un nombre de détenus bien supérieur à leur capacité, leur usure sera vite considérable. Ceci explique, pour une part, que l'état de dégradation constatée n'épargne pas des établissements relativement récents. La maison d'arrêt de Bois-d'Arcy construite en 1980 qui connaît des problèmes de maintenance très importants, a accueilli pendant les 10 premières années de son fonctionnement environ 1 500 détenus alors que sa capacité n'est que de 550 places. A titre symptomatique, il a été relevé que le bâti de Valenciennes (MA), construite en 1964, sur le modèle de Fleury-Mérogis, est déjà très dégradé ; il en va de même à Metz-Queuleu (MA), mise en service en 1979, pour le second _uvre (carrelages des couloirs, douches...) Il s'y ajoute les dégradations causées par des mouvements de détenus : 44 établissements ont connu de tels mouvements de révolte depuis 1990 (coût de réparation : 167 MF). Des destructions ont eu lieu en juillet 1999, au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly en Guyane. Ce centre, en l'attente des travaux, n'est encore utilisé qu'à la moitié de sa capacité. Il en résulte un taux de surpopulation très élevé. La cause principale de ce bilan réside dans le fait que les crédits d'entretien n'ont jamais été d'un montant suffisant pour faire face aux besoins, d'autant qu'aucun programme de maintien à niveau des immeubles n'a été mis en _uvre de 1940 à 1964. Le faible montant des crédits obtenus pour l'entretien des bâtiments est constant. En 1998, les crédits de fonctionnement consacrés à la maintenance représentaient 57 F par m2 dans le parc classique et 120 F par m2 dans les établissements du parc 13 000 gérés en gestion publique (3). Les crédits du parc classique sont essentiellement consacrés à une maintenance corrective ; ceux du parc 13 000 pour 60 % à une maintenance préventive. Selon l'estimation de l'administration pénitentiaire, le déficit de maintenance peut être évalué à 140 millions de francs par an, c'est à dire 2 milliards de francs pour les quinze dernières années. Cette pénurie budgétaire est aggravée par les insuffisances criantes en personnels techniques chargés de l'entretien et qui encadrent les détenus effectuant des travaux de maintenance dans le cadre du service général. A Bois-d'Arcy (près de 700 détenus), 5 personnels techniques seulement assurent la maintenance et encadrent le service général. Ce sous-effectif chronique est général : pour l'ensemble des établissements, en 1998 comme en 1999, le nombre des effectifs budgétaires des personnels techniques était de 675 : 189 professeurs techniques et directeurs de travaux et 486 chefs de travaux. Il en résulte une dégradation rapide des structures et des installations qui rend finalement nécessaire de gros travaux d'entretien à une fréquence anormalement élevée. En fin de compte, les dépenses de remplacement et de reconstruction génèrent des coûts qu'un entretien régulier aurait pu éviter. L'exemple de la prison de Fleury-Mérogis est à cet égard édifiant. Mis en service en mai 1968, cet établissement est dans un état tel que le montant des travaux de mise aux normes a été évalué à 1,6 milliard de francs, ce qui représente un coût de rénovation par cellule bien supérieur à celui d'une construction neuve ! L'importance des crédits nécessaires contraint pour l'instant les responsables de l'établissement à parer au plus pressé et à renoncer à utiliser certaines parties de la prison. Les dépenses d'équipement consacrées à la sauvegarde immobilière (clos, couvert et mise aux normes des installations) se situent depuis 3 ans entre 100 et 120 MF, soit un peu plus de 10 % du budget d'équipement. Pour autant, les équipes de direction des établissements ne baissent pas les bras. Avec peu de moyens, sur leurs crédits de fonctionnement et avec l'aide de la main-d'_uvre pénale, la volonté de faire face aux besoins les plus urgents et de procéder aux rénovations indispensables est réelle et les résultats, là où ces travaux sont menés, sont significatifs. c) Des établissements récents qui n'excluent pas des problèmes de conception. Les établissements du programme 13 000 ont été un facteur important d'évolution de l'administration pénitentiaire. Ils encourent cependant une critique majeure qui est liée à leur implantation. La « localisation champêtre » (4) de la plupart des sites fait l'objet de critiques concordantes tant de la part des personnels qui y restent en poste peu de temps car ils se heurtent à des problèmes de logement et d'activités des conjoints, que des détenus. Tout est complexe : visites des familles, coût des transports pour les permissions de sortie, difficulté d'organisation des activités socio-éducatives ou de travail faute d'intervenants, urgences médicales... Se rendre de la gare la plus proche au centre de détention de Joux-la-Ville ou de Villenauxe-la-Grande, suppose de prendre un taxi qui se révèle, compte tenu de la distance, d'un coût prohibitif. La localisation des établissements est un critère essentiel de leur qualité. Elle conditionne une bonne part de la vie de la prison mais aussi la conception qu'en a l'opinion. L'implantation en ville peut générer des problèmes de voisinage ou limiter la surface des locaux disponibles pour l'organisation d'activités ou du travail, pour l'exercice des activités sportives... Elle est cependant extrêmement précieuse pour les personnels comme pour les détenus. Elle marque symboliquement l'intégration dans la cité qui ne peut aussi facilement en détourner son regard. Ce facteur doit être pris en compte dans les implantations des nouveaux sites afin d'éviter ce qui s'apparente à une « relégation aux champs » s'ajoutant à la privation de liberté. Des difficultés de fonctionnement surgissent également lorsque les bâtiments sont affectés à une autre catégorie d'établissements que celle pour laquelle ils ont été conçus. Les réaffectations en cours de construction sont une des raisons du dépassement des coûts initiaux de construction du programme 13 000 (5). L'établissement de Grasse mis en service en 1992 a été transformé en maison d'arrêt alors qu'initialement il devait être un centre de détention pour courtes peines. Les conditions architecturales ne permettent pas, par exemple, d'interdire aux détenus de communiquer entre eux. Cela a été également le cas de Bois-d'Arcy, construit comme un centre de détention et utilisé dès son ouverture comme une maison d'arrêt. Il en résulte un coût de fonctionnement (en termes de personnel) extrêmement élevé pour régler les circulations au sein de l'établissement. Parfois la structure elle-même n'a pas été conçue d'une façon appropriée à son usage. La maison d'arrêt d'Epinal a été construite en 1998. L'architecte a voulu créer une zone de relations sociales pour l'ensemble des détenus. Les équipements collectifs sont regroupés autour de cet espace aménagé en lieu de convivialité. « L'inconvénient de cette organisation était que tout s'ouvre entièrement sur cet espace et plus aucun fonctionnement sécuritaire ne pouvait avoir lieu. Parce qu'on est en maison d'arrêt - ce qui constitue un régime particulier que j'ignorais à l'époque - chaque détenu en salle de classe était enfermé dans la salle de classe avec son enseignant pour qu'il ne puisse pas sortir ensuite dans l'espace collectif. Tous les recoins gênaient le contrôle de cet espace collectif. Cet espace collectif - je n'y suis pas retourné depuis - doit mal être utilisé du fait de ces inconvénients liés à la sûreté... Mais étant donné que je faisais ces propositions par rapport à un cahier des charges, j'ai apporté des idées nouvelles. Le ministère n'avait pas de réflexion à ce sujet. Je n'ai pas eu en face de moi un utilisateur pour me dire ce qui était possible ou non. Ils étaient intéressés par l'idée, par le concept, mais ils n'appréhendaient pas les limites de la fonctionnalité. » (M. Guy Autran, architecte) L'innovation architecturale et les nécessités de la sécurité se heurtent de front quand il s'agit de prison. La marge de man_uvre du concepteur est extrêmement étroite et les équipements ne sont pas toujours utilisés comme prévu, avec les conséquences qui en résultent pour la vie en détention. Le terrain de football du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) n'a jamais été utilisé. L'implantation initiale des miradors a dû être modifiée pour des raisons liées au sous-sol et ce terrain est hors du champ de vision. L'établissement de Remire-Montjoly en Guyane est conçu sous la forme de petites unités de vie ouvrant directement sur une cour de promenade. Les surveillants regrettent que l'absence de séparation rende, en réalité, la fouille des cellules impossible et le contrôle des incidents difficiles. L'escalade des toits des bâtiments donnant sur le terrain de sport ne posant pas de difficultés compte tenu de leur faible hauteur, conduit là aussi, à ne pas utiliser cet équipement sportif. d) Des coûts finalement considérables Pour faire face à cette situation, deux programmes de réhabilitation-restructuration ont été prévus par l'actuel garde des sceaux : - la réhabilitation des 5 plus grandes maisons d'arrêt (6) dont le coût est estimé à 3,4 milliards de francs. 50 millions de francs ont été inscrits dans la loi de finances pour 2000 afin de financer la suite des études et les premiers travaux urgents. - un programme de rénovation du reste du parc classique visant à remettre aux normes techniques le patrimoine immobilier et à réaliser des aménagements destinés à garantir l'hygiène, la sécurité et la dignité des conditions de détention. Son coût a été estimé à 3,2 milliards de francs par un cabinet d'audit. On ne peut manquer de s'interroger sur ce montant comparé au 1,6 milliard nécessaire à la rénovation de la seule prison de Fleury-Mérogis (Cf. supra). Cette évaluation ne concerne pas les 5 grandes maisons d'arrêt, ni les établissements du programme 13 000, ni l'Outre-mer ; il n'inclut donc pas la rénovation ou la construction d'un nouvel établissement à Basse-Terre. 15 établissements ont déjà été ciblés pour pouvoir procéder à des travaux urgents (Cf. tableau supra) et une enveloppe de 70 millions de francs est inscrite au budget d'équipement pour 2000. A ce rythme, il faudrait des dizaines d'années pour procéder à la rénovation du parc. Un guide technique et fonctionnel est en cours de mise au point pour permettre aux directions régionales de mener une pré-étude de faisabilité de ce programme. Il s'y ajoute un programme de construction de 10 nouveaux établissements qui permettront la fermeture du Centre de détention de Liancourt et des maisons d'arrêt d'Avignon, de Meaux, de Melun, de Toulouse et de Toulon. S'y ajoute la reconstruction de la maison d'arrêt de Saint-Denis. Il a également été annoncé que les prisons de Lyon et Nice seraient fermées. Six établissements doivent être livrés en 2002 - 2003 : - MA de 645 places dans le département du Nord sur le territoire de la commune de Sequedin (Lille) - CP de 610 places dans le département du Vaucluse sur le territoire de la commune du Pontet (Avignon) - MA de 605 places dans le département de la Haute-Garonne sur le territoire de la commune de Seysses (Toulouse) - CP de 605 places dans le département du Var sur le territoire de la commune de La Farlède (Toulon) - CP de 600 places dans le département de l'Oise sur le territoire de la commune de Liancourt - MA de 605 places dans le département de Seine-et-Marne sur le territoire de la commune de Choconin Neufmontiers (Meaux) La construction de 4 autres établissements a été programmée : - Un établissement dans le département de la Réunion - Un établissement dans le département du Rhône en remplacement des prisons de Lyon, - Un établissement dans le département des Alpes-Maritimes en remplacement de la maison d'arrêt de Nice L'implantation du 4ème établissement reste à déterminer (entre les régions de l'Ouest, du Nord et la région parisienne). A ce jour, la capacité de ces 4 établissements n'est pas définie. Ce programme de construction appelle deux remarques. Tout d'abord, les visites des établissements pénitentiaires effectuées par les membres de la Commission ont permis de constater le consensus existant sur l'importance de la dimension humaine des établissements. De la qualité des relations que les personnels entretiennent avec les détenus découlent toute la vie en détention et les perspectives à la sortie. Cela suppose un encadrement suffisant mais aussi des équipes qui ne soient pas trop nombreuses et qui soient stabilisées par secteur de détention pour que ce lien puisse ce créer. La grande taille de l'établissement est un obstacle majeur. Au regard de cet impératif, la construction d'établissements de 600 places (même divisés en quartiers de 200) apparaît discutable. Ceci a été vigoureusement souligné par les syndicats pénitentiaires lors de leur audition et notamment par l'UFAP : « Les établissements de 600 places que l'on est en train de construire, et qui comporteront différents régimes de détention, ne devraient pas exister : ceux à qui l'on appliquera le régime de la maison d'arrêt verront les détenus du centre de détention circuler librement, c'est insupportable ! Il s'agit là de sujets graves, sur lesquels nous ne sommes pas consultés. On nous a simplement présenté le plan retenu, avec interdiction de poser des questions. Or nous sommes favorables aux petites structures, au service public de proximité ; on en parle pour la poste, mais pas pour l'administration pénitentiaire ! Or c'est de cette façon que la prison sera mieux acceptée ». (Jean-Luc Aubin) L'association des personnels à la conception des établissements permettrait, sans doute, de mieux exprimer cette préoccupation et d'éviter les erreurs déjà évoquées. En second lieu, des travaux urgents sont nécessaires. Des fermetures d'établissements et des restructurations lourdes sont indispensables si l'on veut offrir sur l'ensemble du territoire des conditions matérielles d'enfermement dignes d'une démocratie. La réalisation des programmes dépendra des crédits budgétaires obtenus. Ceux-ci doivent être affirmés comme prioritaires. Pour autant, il est apparu à la Commission que la décision de construire de nouveaux établissements et par-là des places supplémentaires de détention ne devait être prise qu'après une réflexion approfondie sur la place et la mission de la prison dans l'arsenal répressif et non en fonction d'un simple calcul arithmétique basé sur le nombre actuel de détenus et de places disponibles. Les crédits que l'on y consacre viennent nécessairement mordre sur la conduite d'autres actions en termes de personnels, de formation, d'insertion et de suivi des personnes incarcérées. L'adoption d'une loi pénitentiaire définissant les grandes orientations est un préalable au lancement de constructions nouvelles. La Commission tient à affirmer que les travaux indispensables doivent avoir lieu rapidement et que les crédits budgétaires doivent être inscrits, mais que, parallèlement, la maîtrise des flux d'incarcération est une priorité absolue, si l'on veut éviter que l'offre de places nouvelles, au lieu de servir à désengorger les prisons surpeuplées, ne conduise à une nouvelle inflation du nombre de personnes incarcérées. Il manque, compte tenu du nombre actuel de détenus, 12 500 places pour satisfaire à la norme d'encellulement individuel. La construction de ces places coûterait 6,25 milliards de francs. Ce chiffre parle de lui-même lorsque l'on sait que le budget pénitentiaire est de 7,5 milliards de francs dans la loi de finances pour 2000. 2.- Des conditions de détention inégalitaires La première des inégalités dans la vie en détention provient de la différence de traitement selon les types d'établissements : maison d'arrêt ou établissement pour peine. Il s'y ajoute la grande variété des conditions d'accueil dans les établissements. a) L'hétérogénéité des établissements Etre incarcéré à Fresnes, à Fleury-Mérogis ou bien dans une petite maison d'arrêt, en centre ville, telle celle de Bourg-en-Bresse (63 détenus), de Gap (27 détenus), de Vesoul (48 détenus) ou de Montbéliard (40 détenus) n'offre, au regard des conditions de détention, de l'organisation des activités, de l'esprit de l'établissement que peu de points communs. Les métiers du personnel pénitentiaire n'y sont pas non plus les mêmes, comme il n'est pas le même dans les établissements du programme 13 000. ▪ des établissements de taille très variable 71 établissements pénitentiaires ont une capacité inférieure à 100 détenus, alors que les cinq plus grandes maisons d'arrêt accueillent 18,6 % d'entre eux. Comme cela a déjà été dit, personnels et détenus s'attachent à louer le fonctionnement des établissements, de taille moyenne, situés en centre ville. Cela a pu être constamment vérifié au cours des visites effectuées et il faut y insister. La qualité des relations qui se nouent dans ces établissements autorise leur bon fonctionnement, même quand ils connaissent des conditions difficiles en termes de confort, de locaux ou d'installation. On peut tout de même déplorer que l'hébergement en dortoirs soit encore pratiqué : Colmar, Alençon (jusqu'à 15 détenus), Troyes, Belfort, Lure, Nancy (dortoirs de 6 à 16), Basse-Terre, Mont-de-Marsan... et que, bien souvent, la cuisine soit entièrement assurée par les détenus et qu'en l'absence du matériel nécessaire, les plats soient servis froids comme à Chaumont par exemple. Les petites maisons d'arrêt présentent aussi souvent l'inconvénient d'offrir des activités en nombre très limité. Etant généralement situées en centre ville, elles ne disposent pas toujours de locaux, de cours de promenade ou d'équipements sportifs suffisants. Par exemple, à Sarreguemines (maison d'arrêt), aucune activité sportive réellement organisée n'est possible : la cour (683 m²) sert en même temps pour le sport et la promenade. La petite salle polyvalente est utilisée pour les activités socio-éducatives, les cultes, les réunions diverses, la musculation et le tennis de table. Mais, dans un petit établissement, tout le monde se connaît et la résolution des problèmes est immédiate. La vie en détention et le métier de surveillant sont totalement différents quant, sur un étage de détention, un seul surveillant est en charge de 100 détenus comme c'est le cas dans certains grands établissements. Aux Baumettes, un seul surveillant peut couvrir deux ailes de détention, ce qui représente, sur une longueur de 200 mètres, 130 ou 150 détenus à gérer. Ils sont aussi différents dans les établissements les plus modernes. Les prisons de Lyon sont certes surpeuplées et extrêmement vétustes. Mais les détenus ne souhaitent pas être transférés à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, occupée à 89 %, pour des raisons liées à son implantation et à son mode de fonctionnement, mais aussi à sa capacité à mieux assurer la surveillance des détenus comme cela a déjà été noté. Les conditions d'hébergement et l'organisation du travail du personnel ont aussi des répercussions sur la vie matérielle en détention. Le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 a prévu l'accès aux douches trois fois par semaine. Dans certains établissements (généralement des établissements pour peine), l'accès aux douches ne fait l'objet d'aucune limitation, dans d'autres, comme à la maison d'arrêt de Rennes, cette règle de trois douches hebdomadaires reste inappliquée, notamment pour des raisons de production d'eau chaude. Selon l'administration pénitentiaire, pour y parvenir, des aménagements de structures sont nécessaires dans 20 % du parc pénitentiaire. ▪ des choix technologiques contestables Il faut aussi insister sur les choix technologiques en matière de sécurité qui ont été opérés dans le cadre du « programme 13 000 ». En effet, ils ont profondément influé sur le type de relations humaines existant dans ces établissements. La mise en place d'un contrôle électronique des détenus a sédentarisé les agents dans leur poste de contrôle diminuant ainsi leurs contacts avec la population pénale. Cette évolution n'a pas été vécue de façon positive. « Bien entendu, un recrutement a eu lieu, notamment dans le cadre du plan 13 000, mais en même temps, le personnel de surveillance posté aux grilles ou aux portes a été remplacé par des moyens électroniques - le contact humain entre les détenus et les surveillants a ainsi été coupé. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le nombre de suicides est moins élevé dans les établissements anciens - notamment à la Santé - où les surveillants aux grilles et aux portes sont encore en poste. Ces établissements sont plus humains, même si leur vétusté est tout à fait déplorable. » (M. Jean-Luc Aubin - Union Fédérale Autonome Pénitentiaire). A cette organisation du travail, s'ajoute le peu de personnel avec lesquels les établissements récents fonctionnent et les conséquences que cela peut avoir comme l'a souligné Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire : « Les normes en matière de personnel pour les établissements récents correspondent à l'accomplissement d'un certain nombre de fonctions. Dans la mesure où il s'agit d'établissements conçus avec une grande rationalité, ils sont globalement économes en termes de personnels, mais avec des conséquences, par exemple, pour les surveillances des cours de promenade. Contrairement aux établissements d'autrefois, il s'agit de grandes cours pour lesquelles la surveillance est prévue, soit par une échauguette, soit par un mirador, et de fait, il n'y a pas de surveillants dans la cour de promenade. Lorsque cent personnes sont sur une telle cour, on ne peut y envoyer une seule personne, même si le terrain est surveillé de l'extérieur, car elle serait aussitôt agressée. On serait obligé d'envoyer plusieurs surveillants. Il s'y reproduit des phénomènes de terrains vagues ou de cours d'immeubles de banlieue. Si nous voulons lutter contre de tels phénomènes, qui entraînent de la violence et des phénomènes de caïdat, il faut grossir les effectifs, en nombre significatif, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent compte tenu de nos difficultés en personnels. » Cette remarque est à ajouter aux réflexions qui ont été faites précédemment sur le programme de construction. ▪ des règles de vie disparates Il a été constaté à de multiples reprises que des éléments de la vie quotidienne en détention pouvaient varier considérablement d'un établissement pénitentiaire à l'autre sans être directement induits par le type d'établissement (maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale). Il en va ainsi du téléphone : conversations écoutées et enregistrées à Clairvaux, écoutes ponctuelles avec contrôle des numéros appelés au centre de détention de Caen, accès libre et non limité au téléphone au centre de détention de Val-de-Reuil. Dans ce dernier établissement, les cartes téléphoniques sont devenues, du fait de cette pratique, une véritable « monnaie » parallèle qui suscitent des vocations de collectionneurs. Cette disparité se retrouve dans les appareils autorisés qui varient d'un établissement à l'autre. Ceci suscite des conflits et génère un sentiment d'arbitraire lors des transferts de détenus. Par exemple, une chaîne Hi-Fi achetée dans un établissement ne pourra être conservée à l'arrivée dans un autre. Il en va de même quant aux tarifs applicables aux locations de téléviseurs : règles de gratuité différentes (service général, indigents) et tarifs variables qui peuvent atteindre 250 francs mensuels (Melun), alors qu'à Colmar 185 francs mensuels permettent de louer téléviseur et réfrigérateur. Ceci renvoie d'ailleurs à la question de la transparence de la gestion des associations socio-culturelles et sportives. Des différences existent aussi dans les tarifs des cantines. Ils ont été dénoncés comme prohibitifs dans certains établissements « 13 000 » par les détenus, mais aussi par les surveillants. Le rapport de gestion de l'administration pénitentiaire fait plutôt apparaître que le prix du « panier du détenu » (sélection d'articles les plus fréquemment achetés) est pourtant légèrement inférieur dans ces derniers. Il est vrai que le choix d'un fournisseur de proximité ne permet pas toujours de pratiquer les prix les meilleurs. Un groupe de travail a été constitué sur le fonctionnement des cantines afin de formuler des propositions sur leur organisation et leur réglementation, en particulier en liaison avec les règles de la comptabilité publique. b) La fiction des régimes de détention Le premier paradoxe de la vie en prison tient au fait que le régime de détention le plus strict s'applique aux prévenus, donc aux personnes incarcérées qui sont présumées innocentes. ▪ Le régime applicable aux prévenus Il existe, en effet, une très forte distorsion entre la situation des condamnés exécutant leur peine dans un centre de détention et celle des prévenus, en maison d'arrêt, à la fois en termes de conditions matérielles et de règles applicables. Les maisons d'arrêt, comme cela a été dit, offrent des conditions d'accueil bien moins bonnes que les établissements pour peine. Le régime de détention y est en outre plus sévère puisqu'il repose sur le principe de l'encellulement, alors que les circulations sont beaucoup plus libres dans les autres établissements, surtout quand s'y applique le régime « portes ouvertes. » L'article 716, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale dispose que : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. » Cet article a pour fondement essentiel la présomption d'innocence qui implique que le détenu provisoire ne se voit pas imposer des contraintes telles que la promiscuité. Il est lié aussi au fait que le magistrat instructeur peut exiger que, pour les nécessités de l'instruction, le détenu soit isolé des autres. Or cette règle régit le fonctionnement de l'établissement, alors même que sa raison d'être n'est pas respectée puisque les détenus en maison d'arrêt sont rarement seuls en cellule. En outre, la règle n'est pas respectée partout : ainsi, la maison d'arrêt de Borgo en Corse a connu une période où les cellules étaient ouvertes de 7 heures du matin à 5 heures du soir et les détenus y circulaient librement. Les prisonniers bénéficiaient ainsi, à l'intérieur de la maison d'arrêt, d'une certaine liberté pendant la journée. Un retour au droit commun a eu lieu à la suite d'une évasion. Il suscite des protestations de la population locale ; des organisations comme la ligue des droits de l'homme se sont mobilisées pour obtenir la réouverture des cellules. Ce mouvement conduit à s'interroger sur le bien-fondé des règles qui s'appliquent en maison d'arrêt. Les détenus provisoires ont le droit de recevoir des visites et peuvent correspondre, par écrit, librement avec toute personne de leur choix. Leur courrier peut être communiqué, sur sa demande, au magistrat instructeur. Certaines correspondances sont couvertes par le secret. Par contre, ils ne peuvent bénéficier de permissions de sortie et ils n'ont pas le droit de téléphoner. Ces dispositions, qui peuvent parfois mais pas dans tous les cas, être justifiées par les nécessités de l'instruction, deviennent problématiques quand la détention provisoire, compte tenu des délais de jugement, dure plusieurs années. La plupart des Etats européens autorisent l'accès au téléphone pour les prévenus, certains imposant certaines restrictions (par exemple : il existe un délai impératif de 5 jours d'attente en Belgique, les appels sont limités à des motifs urgents et spéciaux en Finlande, l'autorisation du juge d'instruction en Pologne ou au Luxembourg est requise). Après sa visite en France, en octobre 1995, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a demandé à la France de reconsidérer l'interdiction généralisée de l'accès au téléphone pour les prévenus. Le gouvernement avait alors indiqué qu'il n'envisageait pas de réforme sur cette question, liée aux exigences de l'instruction judiciaire et aux causes du placement en détention provisoire. Cette réforme de l'accès au téléphone doit être sérieusement envisagée, sachant quelle soulève la question préalable des modalités de contrôle par le juge d'instruction et celle de sa faisabilité matérielle. Le deuxième point qui soulève des difficultés pratiques est celui du régime des autorisations de sortie sous escorte qui permet d'assister à des événements familiaux, heureux ou graves. L'Association française des magistrats chargés de l'instruction préconise son assouplissement : « Il existe une permission de sortie sous escorte, mais, là encore, c'est une démarche très lourde à organiser et c'est, finalement, très mal perçu de l'extérieur. Il m'est arrivé d'en organiser en cas de décès, pour qu'un détenu puisse assister à des obsèques ou rendre visite à un parent malade, mais la procédure est d'une telle lourdeur que nous ne le faisons pas. Cela peut avoir des répercussions importantes sur le prévenu qui aurait voulu participer encore un peu à sa vie de famille, ce qui est une préoccupation tout à fait normale. Je pense que nous pourrions réfléchir à faciliter ce type de mesures. » (Mme Sophie-Hélène Château) Plus généralement, une réflexion sur le régime des prévenus est indispensable. ▪ Le cas des condamnés exécutant leur peine en maison d'arrêt Les condamnés à de courtes incarcérations (de moins d'un an) exécutent leur peine en maison d'arrêt. Cela est aussi le cas des condamnés à des peines plus longues qui, pour les raisons diverses déjà évoquées (nombre de places limité en établissement pour peine, longueur des procédures d'affectation), sont maintenus dans ces établissements. Pour des raisons tout à fait contingentes, ils vont y exécuter une partie, parfois plusieurs années, de leur condamnation. Ces condamnés sont soumis au régime de l'établissement, donc au régime maison d'arrêt. L'inégalité, sans fondement, dans l'exécution de la peine qui en résulte est une injustice criante qui est très mal ressentie. Ils bénéficieraient, dans l'établissement où ils devraient être affectés, d'un régime plus souple et de structures plus développées en matière d'actions socio-éducatives et d'insertion. Pour en revenir au seul usage du téléphone, aucune mesure n'est prévue pour son usage par les condamnés en maison d'arrêt. Il est vrai qu'une évolution en ce domaine est freinée par l'éternel problème des maisons d'arrêt, celui de leur surencombrement qui conduit à ce que prévenus et condamnés ne soient pas incarcérés séparément. Dès lors, l'administration pénitentiaire invoque le fait que cet accès pourrait créer des tensions. Une réflexion globale sur cette question est donc indispensable. Cette contrainte ne saurait, en tout cas, être soulevée en ce qui concerne les permissions de sortie. Les condamnés, exécutant leur peine en maison d'arrêt, ne bénéficient pas des dispositions de l'article D 146 du code de procédure pénale. Cet article permet aux condamnés n'ayant plus que trois ans de peine à exécuter, de bénéficier, de permissions de sortie pour événement familial grave dès l'exécution du tiers de leur peine (au lieu de la moitié). Cette possibilité n'est ouverte qu'en centre de détention et ne s'applique pas en maison d'arrêt sans que l'on voie très bien quel obstacle pourrait s'y opposer, le juge d'application des peines restant de toute façon maître de la décision. A tout le moins, il devrait être permis aux condamnés exécutant leur peine en maison d'arrêt, de bénéficier des permissions de sortie dans les mêmes conditions que s'ils étaient en centre de détention. ▪ Le régime de détention atypique de Casabianda Situé au bord de la mer sur la côte orientale de la Corse, le centre de détention de Casabianda qui accueillait, au 1er janvier 2000, 210 détenus, tous condamnés pour délinquance sexuelle, dont certains à de longues peines, ne ressemble absolument pas, aux dires des membres de la commission qui l'ont visité, à l'idée que l'on se fait d'une prison : pas d'enceinte, cellules ouvertes, pavillon pour accueillir les couples dans la journée. Les détenus y travaillent à des travaux agricoles et sont correctement rémunérés. Il n'y a que peu d'incidents, pas de violence, pas de caïdat, pas d'évasion ; la menace d'être transféré dans un autre centre de détention semble très dissuasive ce qui illustre bien le caractère inégalitaire de la détention, selon l'établissement où l'on se trouve incarcéré. C.- LES MUTATIONS DE LA POPULATION PÉNALE. La prison doit gérer vingt ans de crise de la société : Elle « apparaît désormais comme le seul lieu d'enfermement, elle est redevenue l'hôpital général d'antan où l'on retrouve pêle-mêle tous les exclus de la société. » déclarait devant la commission M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris. 65 % des entrants étaient sans activité à l'extérieur, parmi lesquels, seuls 28 % se trouvaient en situation de chômage indemnisé. Un sur cinq était illettré. En 1997(7), 15 % des entrants déclaraient être sans abri ou ne disposaient que d'un domicile précaire, 5,5 % seulement bénéficiaient de l'aide médicale et 17,5 % déclaraient ne pas avoir de couverture sociale. S'y ajoutent des conduites sanitaires à risque : consommation excessive d'alcool (30 %), usage de drogues et traitements médicamenteux. Ces difficultés ne disparaissent pas une fois la porte de la prison franchie. Et il faut reconnaître que la mission que l'on fait assumer par l'administration pénitentiaire et ses personnels est très difficile puisqu'il faudrait que la prison réussisse là où tous les dispositifs d'intégration ont échoué. Ceci est accentué par le fait que la population pénale a connu, en quelques années, des évolutions considérables. Il en résulte une réflexion indispensable sur l'adaptation de la prise en charge, l'évolution des métiers et le sens de la mission de l'administration pénitentiaire, qui doit déboucher sur une réflexion sur l'enfermement, encore trop conçu comme la seule réponse à la délinquance. a) les « délinquants sexuels » En 1999, pour la première fois, le viol et les agressions sexuelles sont la première cause d'incarcération des condamnés. 7 500 condamnés pour viol ou agression sexuelle (sur mineur ou adulte et exhibitions sexuelles) étaient incarcérés au 1er janvier 2000, soit 22,5 % des condamnés, alors qu'ils n'en représentaient que 6 % il y a 20 ans. Ces détenus qui ne sont pas des marginaux, entendus comme ceux qui auraient choisi et accepté une vie en dehors des règles de la société, sont vites repérés, car tout se sait en prison et ils subissent la loi hiérarchique du système carcéral. Même si une distinction, en leur sein, est opérée entre les auteurs de crimes sur enfants et les autres, il est constant que l'attitude des codétenus à leur égard est faite d'opprobre, de vexation et d'exploitation. « Dans les faits, ce sont eux qui ont perdu le maximum de contact familial, professionnel, social, religieux ou culturel et ces détenus modèles sont en fait, écrasés par un mépris quasi-généralisé et par une immense réprobation interne et externe à l'établissement. Ces détenus modèles sont en fait des personnalités gravement atteintes et c'est chez eux que se recrute le plus grand nombre de candidats au suicide. » 8 Il semblerait toutefois que les auteurs de viols collectifs, crimes souvent commis par des mineurs ou jeunes majeurs, ne subissent pas le même opprobre. Les condamnés sont de préférence incarcérés dans trois établissements pour peine : les centres de détention de Caen, Mauzac et Casabianda. Dans les autres établissements, notamment dans les maisons d'arrêt, ils sont soit isolés, à des degrés divers, du reste de la détention, soit mêlés aux autres prisonniers. Leur incarcération, ensemble et à l'écart, leur rend alors beaucoup plus difficile l'accès aux activités, au travail pénal, aux promenades... A Bourg-en-Bresse, par exemple, qui pratique un isolement strict, un atelier de travail est en train d'être aménagé pour eux. A Fleury-Mérogis, grâce à une surveillance particulière, l'accès aux ateliers peut être possible. La situation des délinquants sexuels renvoie au problème des longues peines, du vieillissement de la population pénale et de la prise en charge qu'elle requiert quand à l'âge vient s'ajouter la dépendance. (Cf. IV) En 1997, une étude réalisée par la direction générale de la santé sur l'état de santé des personnes entrant en prison fait apparaître que : 32 % des entrants déclarent une utilisation prolongée et régulière d'au moins une drogue (produits illicites et médicaments utilisés de façon toxicomaniaque) dans l'année précédant l'incarcération : 25,6 % de cannabis, 14 % d'héroïne, 9 % de cocaïne ou de crac, 9% de médicaments détournés et 3,4 % d'autres produits (solvants ou drogues de synthèse). Le total est supérieur à 32 % car, dans 14 %, il s'agit de polyconsommation. Dans les grandes maisons d'arrêt situées dans des régions à forte densité urbaine (Nord-Pas de Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile de France), ce taux peut atteindre 40%. Quant à l'alcoolodépendance, son ampleur est très mal connue alors même qu'un grand nombre de délits sont commis sous l'emprise d'un état alcoolique. Mme Maestracci, Présidente de la MILDT, a indiqué que seuls deux établissements pénitentiaires disposaient de consultations spécialisées. Cette très forte présence des toxicomanes au sein de la population pénale est évidemment liée au taux d'incarcération pour trafic de stupéfiants (14,7 % des condamnations). Elle a des conséquences très lourdes sur la prise en charge et sur la vie en détention. Les drogues circulent en prison et l'attitude de l'administration pénitentiaire face à leur usage, faite soit de tolérance, soit de répression, parfois des deux à la fois, mériterait au moins d'être clarifiée. « Une enquête a été menée auprès des « injecteurs actifs », essentiellement des injecteurs d'opiacés mais qui peuvent être injecteurs d'autres produits. 13 % des injecteurs actifs au cours des douze mois précédant l'incarcération disent s'être injectés des produits en prison pendant les trois premiers mois de l'incarcération. La moitié de ces personnes l'ont fait en se partageant les seringues. Or les seringues propres ne sont pas disponibles en prison dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur. » Une autre enquête de l'INSERM porte sur la population qui fréquente les structures de réduction des risques : boutiques, programmes d'échange de seringue. Il ressort que, dans cette population, très en difficultés, très exclue et qui a fait beaucoup de prison, 6 % des usagers ont eu une initiation en prison. Ce chiffre, a paru tout de même extrêmement important. Il s'agit toutefois d'une enquête limitée. » (Mme Nicole Maestracci). Dans la mesure où le simple usage de stupéfiants est passible d'une peine d'incarcération d'un an, où peut se situer, dans ces conditions, le sens même de la sanction ? c) les détenus présentant des troubles psychiatriques 10 % des entrants en prison déclarent avoir eu un suivi psychiatrique et la proportion de ceux qui déclaraient à l'arrivée un traitement par antidépresseurs ou neuroleptiques est nettement plus élevée que dans la population générale. Ce chiffre reflète mal la complexité du problème auquel le personnel pénitentiaire est confronté de manière abrupte et sans réelle formation. En effet, à la fois objets et sujets de violence, les difficultés que suscitent et que rencontrent ces détenus sont dans tous les établissements un leitmotiv permanent. Il faut ajouter aux 10 % précités tant les personnes incarcérées qui n'avaient pas été soignées malgré leurs troubles, que celles dont les troubles sont apparus pendant la détention ou préexistaient mais sous une forme légère n'ayant pas nécessité de soins. Et il n'est pas rare que les médecins, lors des visites dans les établissements, indiquent qu'environ 30 % des détenus avaient des antécédents psychiatriques et que la moitié d'entre eux ont des troubles psychologiques. En fait, on retrouve en prison toute la gamme des inadaptations sociales allant jusqu'au trouble psychiatrique le plus prononcé. Dans ce dernier cas, l'incarcération résulte du fait qu'à l'issue de l'expertise psychiatrique, de moins en moins de personnes sont déclarées irresponsables au moment des faits. Accusés jugés irresponsables au moment des faits/nombre d'inculpés ou mis en
Cette série statistique courte 9 permet de constater que le nombre d'irresponsabilités est extrêmement faible et toujours en baisse régulière. Pour M. Jean-Baptiste Parlos (Association française des magistrats chargés de l'instruction) : « Les psychiatres estiment qu'il reste toujours une once de libre arbitre dans l'individu, qu'il est très rare qu'une personne soit hors de sa raison, ou soit atteinte de troubles ayant totalement aboli son discernement. N'étant pas psychiatres, nous sommes subordonnés à leur avis. Dès l'instant où ils nous indiquent que la personne en question a une responsabilité pénale ou que sa responsabilité pénale n'est pas abolie par les troubles dont elle est atteinte, nous n'avons pas les moyens de dire le contraire. C'est souvent le cas dans les affaires graves de violence, dans les affaires criminelles. La personne est en détention, ce qui explique que des personnes en détention ont des troubles graves de la personnalité, troubles jugés graves par l'expert, mais insuffisamment graves pour considérer que son discernement ait été totalement aboli au moment des faits. » Tout un courant de la psychiatrie considère qu'il est thérapeutique de responsabiliser les patients souffrant de troubles mentaux. « En pratique, on trouve soit des gens en comparution immédiate qui sont complètement fous et qui auraient manifestement dû faire l'objet d'une expertise assortie d'un report de la comparution immédiate, soit des gens qui sont passés en correctionnelle sans expertise puisqu'elle n'est pas obligatoire, soit des gens qui sont passés en cour d'assises, qui ont été expertisés et pour lesquels les experts estiment que « la prison va leur redonner le sens moral ». Je l'ai lu à maintes reprises. Ces gens-là ne connaissent pas la vie quotidienne en prison. Je veux bien admettre qu'un psychotique puisse être soigné dans un SMPR 10, mais quand il se retrouve en établissement pour peine où sont dispensés très peu de soins psychiatriques au long cours, il est stigmatisé comme « le fou du village ». Tenu entièrement à l'écart, il est incapable de s'insérer dans les dispositifs de réinsertion, de travail, qui existent dans un établissement pour peine. » (Docteur Betty Brahmy, responsable du SMPR de Fleury-Mérogis) Il est vrai qu'en distinguant « l'abolition du discernement » de « l'altération du discernement », les nouvelles dispositions de l'article 122-1 du code pénal ont ouvert la voie aux experts pour retenir plutôt « l'altération » dans des cas de psychoses avérées, ce qui a pour conséquence de réduire d'autant les non-lieux pour irresponsabilité. Il s'y ajoute l'effet des conditions dans lesquelles sont effectuées les expertises. Parfois rapides, et, en tout cas, mal rémunérées, ces expertises sont effectuées par des psychiatres qui, dans leur majorité, ne connaissent pas la vie carcérale. Enfin, comme l'a soulevé le Docteur Betty Brahmy : « Ces experts sont souvent des psychiatres de secteur qui savent que s'ils prononcent l'irresponsabilité pénale au titre de l'article 122-1, la personne qu'ils ont en face d'eux se retrouvera à l'hôpital psychiatrique de leur département. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure 11, ils n'ont pas forcément envie d'avoir beaucoup de ces gens-là dans leur hôpital. Pour un patient qui relève de l'article 122-1, il n'y a pas de mesure de justice. Il est placé d'office en hôpital psychiatrique. Ils se sentent tout à fait démunis. Ils savent également que le patient restera très longtemps, puisqu'il faudra encore deux experts pour autoriser la levée de la mesure. J'ai eu affaire récemment à un responsable de service qui m'a dit : « Je n'ai que quinze lits, si l'un d'entre eux est occupé pendant deux ou trois ans, cela bloquera le système. » En outre, les personnes présentant des troubles psychiatriques sont souvent plus lourdement condamnées que les autres parce que, comme l'ont observé les représentants de l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, les jurés sont effrayés par des attitudes qu'ils ne comprennent pas. Au bout du compte, on confère ainsi à la prison une vocation asilaire que l'hôpital psychiatrique n'a plus. Cela retentit sur la qualité de la prise en charge comme sur la vie des personnels ainsi que sur celle des autres détenus, face à des personnes aux réactions parfois imprévisibles. Le nombre des mineurs incarcérés s'accroît un peu plus chaque année.
714 mineurs étaient en détention au 1er janvier 1999. Ce chiffre oscille au long de l'année entre 700 et 1 000 mais surtout si l'on raisonne, en flux, c'est en réalité 4 326 incarcérations de mineurs qui ont eu lieu en 1999, à 90 % au titre de la détention provisoire. Ce chiffre est près du double de celui du début des années 90 où, à la suite de réformes législatives 12, l'incarcération de mineurs avait fortement diminué, mouvement qui s'est poursuivi jusqu'en 1996. Les motifs des 4 326 incarcérations se répartissent de la façon suivante : 710 crimes, 3 616 délits (58 % consistant dans des atteintes aux biens). Cette évolution s'explique, selon Mme Sylvie Perdriolle, directrice de la protection de la jeunesse, par : « D'une part, l'augmentation forte des faits de délinquance commis par des mineurs constatés par les services de police et de gendarmerie depuis le début des années 1990. Le nombre des mineurs mis en cause est passé de 110 000 mineurs en 1994 à 170 000 en 1999. L'évolution est nette, même s'il faut noter une stabilité des mineurs mis en cause en 1999 par rapport à 1998. Le développement de la politique conduite par les parquets de traitement en temps réel des infractions commise par les mineurs, ainsi que recommandé par la circulaire du 15 juillet 1998 de Mme Guigou, garde des sceaux, adressée aux parquets a pris une réelle importance. Ainsi plus de 12 500 mineurs ont-ils été convoqués par les parquets pour un rappel à la loi ou une mesure de réparation en amont de la saisine des tribunaux. Dans toutes les juridictions pour mineurs, ont été mises en place des permanences de tribunaux pour enfants pour convoquer les mineurs dans les dix jours qui suivent leur arrestation. Le plus grand nombre de présentations de mineurs entraîne nécessairement un plus grand nombre de décisions concernant les mineurs qui réitèrent de nombreux faits de délinquance. Par ailleurs, il faut souligner la croissance des faits d'infraction contre les personnes et l'aggravation des infractions commises par les mineurs : vols avec violence ou viols. Selon une étude récente de l'administration pénitentiaire sur la population pénale, ces faits représentaient 13 % des mises en détention en 1985. Ils ont représenté près de 30 % de mises en détention en 1999. Cette évolution est certainement l'une des raisons de l'augmentation des mises en incarcération des mineurs. » L'administration pénitentiaire se trouve très désemparée en face de ces adolescents qui ont un comportement exacerbé en détention, qui ont leurs rites, leurs codes et qui reconstituent à l'intérieur des phénomènes de bandes. En 1998, l'amélioration des conditions de détention des mineurs a été une des priorités de la garde des sceaux. Il a pu être constaté que des avancées concrètes ont eu lieu. Tant la constitution de petites unités d'une vingtaine de mineurs, que l'encadrement renforcé et la stabilisation des surveillants - tous volontaires - dans ces unités, sont vécus comme positifs. La révision de la carte pénitentiaire des établissements habilités à recevoir des mineurs devrait toutefois être rapidement achevée. Car des quartiers mineurs connaissent une surpopulation importante. Or les résultats qui ont pu être obtenus sont tributaires de l'effectif. Dès lors qu'il dépasse la capacité d'accueil, le dispositif est déséquilibré et la prise en charge dégradée. Sur les 60 établissements qui accueillaient en janvier 2000 des mineurs, 16 connaissent un taux d'occupation du quartier mineurs supérieur à 100 : 466 % à Toulon..., 233 % à Valenciennes, 180 % à Epinal, Perpignan, Metz, Chambéry, Limoges. La révision de la carte conditionne également l'aménagement concret des quartiers et notamment la mise en place d'équipements spécifiques. Les mineurs, dans beaucoup d'établissements, ne sont pas effectivement séparés des majeurs. Le « quartier » mineur de la maison d'arrêt de Moulins n'a pas d'existence réelle. Il est constitué de cellules pour adultes affectées aux mineurs. Le quartier mineurs de la maison d'arrêt de Varces ne répond pas aux besoins fonctionnels de prise en charge. Il comporte neuf cellules et accueillait, lors de la visite, 18 mineurs, sachant que les cellules ont une surface inférieure à 9 m² ! L'ensemble des membres de la commission considère que l'incarcération des mineurs doit rester l'exception, comme le prévoit l'ordonnance de 1945. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne doit pas y avoir de sanction, mais le rappel à la loi doit s'exercer autrement que par une incarcération qui ne fait que transformer de jeunes délinquants en « caïds » parce qu'ils ont fait de la prison. Des prises en charge autres que carcérales doivent être prioritaires (Cf. V). 2) Les conséquences quotidiennes La prison est un monde de violences, violence de la population incarcérée et violence de l'enfermement, un monde de rapport de forces entre les détenus et aussi avec les personnels qui y sont constamment confrontés. Le rôle d'observation des surveillants est fondamental, tant la loi du silence règne en prison. Les victimes d'abus, de racket ou d'humiliations sont peu enclines à venir le déclarer. Il vaut mieux ne rien dire et donner l'impression d'être sûr de soi, sinon la voie est ouverte aux brimades, au racket, aux menaces, aux règlements de compte. Ceci explique que les incidents relevés par l'administration ne reflètent que très partiellement la réalité. Ils n'en sont que des indicateurs. ▪ En 1999, les rapports d'incidents enregistrés par le bureau de gestion de la détention relèvent 278 agressions contre le personnel (dont 164 ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à 15 jours). Les rapports d'agressions sont en augmentation (215 en 1997). Leur analyse fait apparaître une fréquence plus grande des agressions dues à des problèmes psychologiques ou comportementaux et une nette sur-représentation des condamnés parmi les agresseurs, notamment les condamnés à des peines de 10 ans et plus. Ceci appelle une réflexion sur les longues peines sur lesquelles nous reviendrons. Les détenus, sans espoir d'être libérés à moyen terme et sans crainte réelle de voir leur peine alourdie n'ont « plus rien à perdre ». Les phénomènes de violence sont bien entendu exacerbés par le manque d'effectifs et les postes non pourvus. « Il y a d'ailleurs très peu d'agents affectés à la surveillance ou à la gestion des détenus. Enormément de postes sont des postes fixes, d'autres sont annexes, et un seul agent gère l'ensemble des détenus à un étage. Or au bout de six heures, cet agent est usé, fatigué de sa journée. Nous nous sommes d'ailleurs rendu compte - une étude a été menée dans un établissement où les journées ont été allongées à 12 heures pour certains postes - que les agressions et les incidents se produisaient en fin de service. En effet, en fin de service, le surveillant est moins accessible et a du mal à répondre aux détenus ; or la moindre « mauvaise réponse » peut engendrer une agression, un incident. » (Jean-Luc Aubin, UFAP). Ces situations de crise génèrent d'autres violences comme en témoignent les incendies volontaires, principalement dans les quartiers disciplinaires. Par exemple, la maison d'arrêt de Grenoble a connu à neuf reprises ce type d'incidents au cours de l'année passée. ▪ Près de 40 000 procédures disciplinaires ont eu lieu en 1999 sanctionnant les fautes suivantes :
Elles ont donné lieu à 27 500 placements en cellule disciplinaire et dans 12 600 cas à une sanction de parloir avec séparation. Le placement en cellule disciplinaire est la sanction majoritairement prononcée. Il est donc essentiel, d'abord que les cellules disciplinaires offrent des conditions d'hébergement correctes. Des progrès ont été faits dans l'aménagement de ces quartiers. C'est toutefois loin d'être partout le cas. A Rennes par exemple, les cellules disciplinaires sont de véritables culs de basse-fosse aux dires même du directeur. A Fleury-Mérogis, elles n'ont aucune ouverture sur l'extérieur : seul existe un éclairage « naturel » par une vitre au plafond du sas d'entrée qui ne s'ouvre pas. Comme dans d'autres endroits, le point d'eau est situé au-dessus des toilettes. A Gradignan, elles manquent totalement de lumière au point qu'il est impossible de lire le soir et difficile durant la journée. Les cours de promenade réservées aux détenus placés en quartier disciplinaire sont également, la plupart du temps, extrêmement exiguës et sordides. Le rapport du Comité national d'évaluation du programme de prévention du suicide en milieu carcéral le constate : « Les locaux présentent une très importante hétérogénéité. Si certains établissements de conception ancienne ont pu, totalement ou partiellement, se conformer à la réglementation en vigueur, il est à noter que d'autres établissements restent très en deçà des objectifs. Ainsi, tel établissement récent présente des cellules propres, bien éclairées, régulièrement repeintes, avec un coin WC-lavabo préservant un peu d'intimité. Tandis qu'un autre a dû se contenter, comme seul « progrès » majeur, de l'installation d'une arrivée d'eau courante dans les cellules. Cet établissement n'ayant d'ailleurs fait que mettre son quartier disciplinaire au niveau du reste de la détention présentant un extrême état de vétusté... Il existe enfin des quartiers disciplinaires sans lumière naturelle, sans aération directe, sans table ni chaise. La réglementation relative aux douches et promenades est respectée même si l'état sanitaire peut parfois laisser à désirer. » Des normes ont été prises pour ces cellules dans le cadre de la prévention du suicide. Elles doivent être appliquées. Ensuite, dans l'intérêt de la personne poursuivie et aussi dans l'intérêt même de celui qui la prononce, car une sanction légitime suppose que le sentiment d'arbitraire en soit écarté, on ne peut que se féliciter que la question de l'assistance du détenu dans cette procédure ait été posée (Cf III). Enfin, le régime disciplinaire français étant, par sa durée, l'un des plus stricts d'Europe (avec un maximum de placement au quartier disciplinaire de 45 jours), il convient de s'interroger sur les conditions d'isolement qu'il induit. Pour les psychiatres, comme pour les visiteurs de prison qui le réclament, un minimum de liens avec l'extérieur devrait pouvoir être préservé. « Le rapport d'évaluation sur la prévention du suicide en prison avait formulé des recommandations en 1998 mais ce rapport n'a pas été publié. Les directives proposées en mars 1999 n'ont donné lieu à aucune suite précise, mais il était notamment indiqué qu'il fallait maintenir les parloirs pendant la détention en quartier disciplinaire, qu'il importait de maintenir les liens avec l'extérieur, d'au moins pouvoir parler avec sa famille, que celle-ci ne soit aussi punie, d'une certaine manière, par le quartier disciplinaire. De plus, beaucoup d'illettrés se retrouvent dans cette situation. Il convient aussi de maintenir des repères dans le temps et dans l'espace. Le maintien de récepteurs de radio en quartier disciplinaire semblerait aujourd'hui une adaptation moderne. Ne tolérer, comme c'est actuellement le cas, que quelques lectures, provoque chez les illettrés un isolement sensoriel beaucoup trop important. Quelques mesures relativement simples permettraient d'humaniser le quartier disciplinaire. » (Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) De surcroît, la privation de visite est une conséquence du placement en cellule disciplinaire, alors qu'elle ne peut être prononcée en tant que sanction disciplinaire. Seule est possible la suppression du parloir sans séparation, lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite (Art. D.251-1 du code de procédure pénale). Le maintien d'un nombre minimal de visites lors du placement en quartier disciplinaire doit être possible. Il convient donc de revoir les règles régissant le quartier disciplinaire et notamment celles concernant la procédure qui s'y applique. 13 ▪ La mise à l'isolement ne constitue pas, en droit, une sanction disciplinaire. Les détenus placés à l'isolement bénéficient en principe du régime de détention ordinaire, si ce n'est qu'ils n'ont pas de contact avec les autres détenus. Un détenu peut être placé à l'isolement, soit à la demande du juge d'instruction s'il s'agit d'un prévenu, soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, c'est-à-dire pour assurer la propre protection de l'intéressé ou préserver l'intégrité de ses codétenus. Il a pu être constaté que les pratiques dans l'utilisation de cette mesure étaient très variables, bien que l'encadrement de la procédure de mise à l'isolement ait été renforcé. Il est d'ailleurs à noter que cette disposition pose de considérables problèmes de fonctionnement dans les établissements qui ne disposent pas d'un quartier d'isolement. Dans les faits, les conséquences du placement à l'isolement sont lourdes en termes d'accès aux équipements et aux activités et la solitude prolongée a des effets psychologiques importants. Au 1er mars 2000, 57 détenus étaient placés à l'isolement depuis plus d'un an. « Dans les maisons centrales, se pose aussi le problème de l'isolement prolongé. On voit de plus en plus des gens rester très longtemps - plusieurs mois, voire plusieurs années - à l'isolement, avec une raréfaction des sensations, des perceptions, des stimulations, qui suppose pour survivre des capacités internes que seuls possèdent quelques détenus, qui finissent par être connus parce qu'ils deviennent professeur d'histoire. Pour la plupart des autres détenus, l'isolement prolongé rend complètement fou. La mort psychique qui en résulte est un phénomène très inquiétant. D'autant que, comme ils se comportent très mal, ils passent du quartier d'isolement au quartier disciplinaire et ainsi de suite. Il est terrifiant de voir ainsi abandonnés entre le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire des gens qui n'ont plus d'avocat - en maison centrale, la plupart du temps, l'avocat commis d'office disparaît - qui viennent des confetti de l'empire, de Tahiti ou de la Guadeloupe, à six mille ou vingt mille kilomètres de leur famille. Il conviendrait de prévoir des règles plus précises afin que ce qui se passe dans le quartier d'isolement soit connu de l'extérieur et contrôlé, de même que les hôpitaux psychiatriques sont contrôlés depuis longtemps, notamment depuis la loi de 1990, par des commissions qui viennent voir les gens et les entendre. Les certificats médicaux que nous établissons constituent des avis qui ne sont pas toujours suivis. » (Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) II.- AFFIRMER L'IDENTITÉ DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE A.- UNE ADMINISTRATION DÉSORIENTÉE 1) La question cruciale des effectifs a) Le constat : l'éternelle pénurie des effectifs Lors des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires, les membres de la commission d'enquête se sont attachés à rencontrer les surveillants et notamment les représentants locaux des syndicats représentatifs. Ces syndicats ont par ailleurs tous été entendus en auditions non ouvertes à la presse par la commission d'enquête. Le sentiment profond qui se dégage de ces entretiens est qu'il ne peut y avoir d'évolution du système pénitentiaire sans adhésion du personnel, et notamment du personnel surveillant : « Il n'est pas possible de faire progresser la condition carcérale si on ne fait pas progresser simultanément la condition des personnels et celle des détenus. Les personnels vivent durement leur condition et c'est un travail dont la société ne reconnaît pas les mérites. C'est là une donnée clef. Lorsque l'on veut faire progresser la condition des prisons, il faut simultanément améliorer la condition des uns et des autres. Pas une des mesures - que j'ai prises après force concertation et moult difficultés et une résistance considérable - ne le fut sans que, conjointement, ne soient améliorées la condition des personnels et celle des détenus. Il s'agit d'une réalité profonde. Le sort du personnel de surveillance est indissociable de celui des détenus et on ne peut, dans le cadre d'une commission d'enquête, écarter cette exigence » (M. Robert Badinter). « J'ai noté avec grand plaisir que, dans le cadre de la mission que vous vous êtes impartie, figure l'appréciation du statut des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Il faut bien être conscient que rien ne peut être réformé dans les prisons qui ne rencontre l'adhésion du personnel pénitentiaire. L'expérience montre que l'on peut coucher sur le papier toutes les réformes aussi belles soient-elles, il n'est pas possible de les mettre en _uvre si les fonctionnaires pénitentiaires n'y adhèrent pas pleinement. » (M. Ivan Zakine, représentant le comité européen pour la prévention de la torture) Actuellement, la revendication essentielle, au niveau local notamment, ne porte pas sur des questions indemnitaires ou statutaires mais sur le problème du manque d'effectifs. ▪ les effectifs totaux Au 1er janvier 2000, l'administration pénitentiaire emploie en effectifs réels 25 121 personnes, dont 20 041 au titre de la surveillance des établissements. La différence entre effectifs budgétaires et effectifs réels est la suivante :
Le personnel de l'administration pénitentiaire représente 41 % des effectifs du ministère de la justice. Les vacances de poste constatées au 1er janvier 2000 résultent pour la plus grande partie de créations d'emplois correspondant à la loi de finances 2000, lesquelles ont creusé le nombre de vacances de manière mécanique. En outre, à l'intérieur de certains corps, des recrutements étaient en cours ou venaient tout juste de s'achever à cette date. Il faut dès lors relativiser le nombre de vacances de poste comptabilisé dans le tableau ci-dessus. ▪ les effectifs du personnel surveillant La question de la vacance de postes prend, dans l'administration pénitentiaire, un relief particulier compte tenu des spécificités que revêt ce service public. Les missions de garde et sécurité, qui lui sont notamment assignées par la loi du 22 juin 1987, imposent en effet un fonctionnement permanent des établissements 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Toute tension sur les effectifs se répercute obligatoirement sur les conditions de travail des agents en poste. Dans ce contexte, les réformes intervenues, notamment pour améliorer le régime des retraites ont considérablement pesé sur le climat social : l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire a accordé au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire un régime dérogatoire de retraite identique à celui dont bénéficie le personnel de police depuis 1957 et caractérisé par l'octroi de la bonification dite du cinquième. La bonification du cinquième est une mesure destinée à compenser l'abaissement de la limite d'âge tenant ainsi compte de la pénibilité de l'accomplissement de la mission de sécurité des personnels de surveillance. Au 1er janvier 2000, la limite d'âge des personnels de surveillance a été abaissée à 55 ans ; la bonification d'annuités est octroyée à raison d'une annuité par cinq ans de service effectif passé dans le corps du personnel de surveillance, nul ne pouvant se voir accorder plus de cinq annuités au titre de la bonification. Malgré la mise en place d'un dispositif de transition entre 1996 et 1999 ayant pour objet de limiter le nombre de départs en retraite, il semble que l'administration pénitentiaire ait mal évalué les effets de cette nouvelle disposition. Les départs à la retraite, toutes catégories confondues, se sont élevés à 388 en 1997 ; ils sont de 515 en 1998. Compte tenu de la pyramide des âges du personnel surveillant, le mouvement devrait s'amplifier dans les années à venir. Il faut ajouter que les régions pénitentiaires sont inégalement touchées ; l'Ile-de-France, qui accueille traditionnellement les jeunes surveillants, semble moins concernée que la région de Toulouse et de Bordeaux. La féminisation du personnel surveillant nécessite également de s'engager dans une réflexion sur ses conséquences à long terme en matière d'effectifs : aujourd'hui, le taux de féminisation du corps des personnels de surveillance est de 7,7 % ; ce taux comptabilise les personnels féminins aussi bien en quartiers hommes qu'en quartiers femmes. Si l'on ne considère que les quartiers hommes, le taux de féminisation est de 5,6 %. La féminisation du corps est très bien acceptée, que ce soit par les directeurs d'établissements ou par les syndicats de surveillants. Il semble acquis que la présence de surveillantes a pour effet d'apaiser le climat de la détention et de changer les rapports de force entre personnel surveillant. La féminisation est donc un apport très positif dont il faut se féliciter ; elle semble impliquer, pour les organisations syndicales rencontrées, de nouvelles contraintes que l'administration centrale doit prendre en compte dans la gestion des effectifs ; en terme de postes de travail, certaines tâches, essentiellement les fouilles à corps, ne paraissent pas pouvoir être effectuées par des femmes. En terme d'organigramme, il s'agit également de prendre en compte le « taux compensatoire pour les besoins de service ». Le TCBS est censé refléter les besoins en personnel en prenant en compte le taux moyen d'absence, quelle que soit la cause de la vacance de poste. Ce TCBS a été fixé à 30 % pour les surveillantes en quartier femmes et 16 % en quartier hommes. Or ce taux de 16 % n'a pas fait l'objet d'une réévaluation, alors même que l'on compte un nombre croissant de femmes en détention hommes. La validité de ces arguments mériterait néanmoins une analyse plus approfondie ; fixé en concertation avec les organisations syndicales, il n'est pas sûr que le TCBS reflète la réalité et semble davantage traduire un rapport de force entre syndicats et administration. La différence des taux entre surveillants et surveillantes mériterait d'être revue car il ne paraît pas correspondre au taux d'absentéisme constaté. Quoi qu'il en soit, l'inadéquation du TCBS a été invoquée à maintes reprises au cours des visites effectuées. Il faut être conscient qu'il pourrait susciter, à terme, une certaine tension sociale et de nouvelles revendications. ▪ les effectifs techniques et administratifs Les visites effectuées dans les établissements pénitentiaires ont permis de constater sur place la grande misère des corps techniques et administratifs ; il n'y a souvent pour entretenir un bâtiment comptant 1 000 détenus que deux ou trois personnels chargés de la maintenance. A la maison d'arrêt de Basse-Terre, qui se trouve dans un état particulièrement vétuste, un seul agent technique est prévu dans l'organigramme. On compte le plus souvent sur les bonnes volontés, le parcours professionnel de certains détenus ou tout simplement le « système D » pour entretenir des bâtiments soumis pourtant à des conditions d'utilisation difficiles. S'agissant du personnel administratif, la carence des effectifs s'explique, selon l'administration pénitentiaire, par l'histoire et la culture ; dans sa réponse aux observations de la Cour des comptes, publiée dans le rapport public particulier de décembre 1999 relatif à la fonction publique de l'Etat, l'administration pénitentiaire précise que « la pression sociale a souvent abouti à la création d'emplois de surveillance plutôt qu'administratifs. C'est pourquoi, malgré le plan de réintégration en détention des personnels de surveillance, mené depuis 1993, certains d'entre eux occupent toujours, de manière indue, des postes administratifs ou techniques. Ce dysfonctionnement est dû à l'insuffisance du nombre des emplois budgétaires administratifs et techniques ». « Lorsque des emplois sont créés, c'est le plus souvent dans les corps de catégorie C. Or la gestion des établissements, comme celle des directions régionales, nécessite non seulement des emplois administratifs plus nombreux, mais aussi des emplois plus qualifiés (catégories A et B). » ▪ les équipes dirigeantes Il faut compter dans cette catégorie à la fois le personnel de direction et les chefs de service pénitentiaire, de catégorie B, qui exercent les fonctions de chef d'établissement dans des petites maisons d'arrêt d'une capacité théorique de moins de 200 places. Le rapport de la Cour des comptes publié en décembre 1999 constate que, bien que le taux de vacance sur les emplois budgétaires paraisse extrêmement faible, des vacances fonctionnelles prolongées sont simultanément constatées ; la Cour des comptes attribuait ce paradoxe à la gestion du corps des chefs d'établissement par l'administration centrale et notamment l'utilisation de sanctions « officieuses » consistant, en l'absence d'une position hors cadre similaire à celle du corps préfectoral, à recourir à des affectations dans des emplois de chargés de mission en direction régionale ou dans des emplois d'administration centrale sans contenu bien défini. En des termes plus nets, il est certain que ces « mises au placard » entraînent de grosses difficultés dans la gestion des corps de directeurs, encore renforcées par des départs nombreux vers les carrières de la magistrature ou du corps préfectoral. Les chiffres fournis par l'administration pénitentiaire font état, en 1999, de douze établissements ayant connu une vacance de poste de chef d'établissement s'échelonnant de quinze jours à six mois (cette dernière durée ayant été constatée pour la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan). Ces chiffres ne traduisent pas cependant les vacances dans les équipes d'encadrement, ainsi que, plus généralement, le sous-encadrement général des établissements pénitentiaires. Les normes actuellement fixées par l'administration pénitentiaire sont, pour les établissements récents, de deux personnels d'encadrement pour un établissement de 400 places et de trois pour un établissement de 600 places. On constate aujourd'hui que de nombreuses maisons d'arrêt plus anciennes, qui accueillent entre 200 et 350 détenus ne compte qu'un seul personnel de direction. b) L'insuffisance des réponses de l'administration centrale ▪ un effort budgétaire pourtant conséquent La Cour des comptes affirme dans son dernier rapport que la direction de l'administration pénitentiaire a fait l'objet d'un traitement favorable lors des lois de finances successives par rapport à la plupart des autres services de l'Etat ; il faut effectivement reconnaître que l'augmentation des emplois depuis dix ans est continue. Cette augmentation a principalement concerné le personnel de surveillance, qui a représenté près de 80 % des créations d'emplois budgétaires dans la période 1990-1998. Les personnels techniques ont également connu une augmentation très sensible de leurs effectifs (+ 37 %) sur une population de départ il est vrai très faible. L'administration pénitentiaire a fait face aux nombreux départs en retraite en obtenant, par deux fois en 1998 et 1999, la création de postes de surveillants en surnombre par rapport aux postes budgétaires prévus. Ces créations en surnombre sont de l'ordre de 400 élèves surveillants en 1998 et de 507 en 1999. La demande a été reconduite en 2000. Pour l'année 2000, l'effort en matière de recrutement de personnel surveillant a permis de porter à plus de 1 300 le nombre de surveillants stagiaires sortant de formation et à 1 600 le nombre d'entrants en formation initiale. A titre comparatif, en 1999, ce sont 975 stagiaires qui sont sortis en formation et 983 qui y sont entrés. Il faut néanmoins ajouter que les effets de ces recrutements massifs mettent un certain temps à se faire ressentir dans les organigrammes des établissements, compte tenu du retard considérable pris dans le passé et de l'allongement de la durée de formation passée de quatre à huit mois, des élèves surveillants. ▪ des essais de prospective à long terme Afin de mieux gérer ses effectifs, l'administration pénitentiaire s'est dotée depuis janvier 1999 d'un tableau prévisionnel d'effectifs de personnel de surveillance par établissement. Ce tableau permet de donner des indications sur les entrées et sorties prévisibles des effectifs sur les douze mois à venir. Elaboré conjointement par l'administration centrale et les directions régionales, il se limite pour l'instant aux effectifs surveillants mais devrait être prochainement complété par un travail similaire sur les autres corps. En outre, l'administration centrale, passée la surprise des « comportements individuels inattendus à la suite de la bonification de l'octroi du cinquième », pour reprendre sa propre expression, a estimé également nécessaire d'anticiper plus finement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors, les départs en retraite : la directrice de l'administration pénitentiaire a ainsi écrit en septembre 1999 aux 3 400 agents âgés d'au moins 49 ans qui n'avaient pas déposé une demande de retraite, afin de connaître leurs intentions. De plus l'administration met en place une application informatique, baptisée GEREHMI (gestion des ressources humaines du ministère de la Justice) chargée de remplacer la base informatique GP (gestion personnel) devenue obsolète ; disponible en 2002, cette base est censée permettre, au niveau central, une meilleure évaluation des besoins. La recherche d'une évaluation prospective des ressources humaines a également porté sur les carrières des personnels de catégorie A et notamment des directeurs d'établissement. Cependant, là encore, les efforts entrepris paraissent insuffisants compte tenu des attentes locales ; la gestion des effectifs constitue, il est utile de le rappeler, un thème récurrent des revendications rencontrées lors des visites. ▪ un raisonnement sur des organigrammes obsolètes Il est difficile d'appréhender l'ampleur de la question des effectifs en ne raisonnant que sur les statistiques des vacances de poste fournies par l'administration pénitentiaire. En effet, ces vacances de postes sont calculées en fonction de postes prévus dans des organigrammes qui ne correspondent pas à la réalité. Ce sont d'abord pour la plupart des organigrammes obsolètes : « Une inadéquation certaines se fait jour entre les missions confiées au personnel pénitentiaire et les moyens mis à sa disposition. Ces missions s'effectuent sans effectifs supplémentaires. L'organigramme, à Privas, date de 1988 et il était, déjà à cette date, obsolète » (M. Jean-Claude Lopez, directeur de la maison d'arrêt de Privas) Etablis dans les années quatre-vingts, ces organigrammes ne correspondent ni à l'évolution des missions attribuées à la prison, ni aux changements constatés de la population pénale et à son accroissement ; ils n'intègrent pas non plus les personnels administratifs et techniques. Les conséquences de cette pénurie d'effectifs sont nombreuses ; elles alourdissent considérablement le climat social, rendent le travail des surveillants pénible et se révèlent finalement financièrement coûteuses. c) Les conséquences de la pénurie d'effectifs : un service pénitentiaire désorganisé ▪ des conditions de travail pour le personnel rendues pénibles C'est là bien évidemment la première des conséquences du sous-effectif : les rythmes de travail imposés par les conditions de détention, aggravées par le phénomène de surpopulation et de changements structurels de la population pénale, rendent le travail de personnel pénitentiaire et notamment le métier de surveillant, pénibles. Les surveillants n'ont pas, face à ce sous-effectif, le sentiment de remplir correctement leur mission ; selon leur expression, « ils font tourner », gèrent au quotidien une surpopulation endémique, sans avoir le temps d'élaborer avec les détenus une relation suivie d'observation et d'écoute. « Dans les grands établissements, on compte, à un moment donné, un surveillant pour cent détenus. Aux Baumettes, un seul surveillant peut même couvrir deux ailes. Cela représente, sur une longueur de 200 mètres, 130 ou 150 détenus à gérer » (M. Georges Vin, directeur des Baumettes). Les rythmes de travail, en termes de charges journalières, de permanences de nuit ou de congés sont difficiles à assumer : il en résulte une aggravation des taux d'absentéisme, déplorée à peu près unanimement dans tous les établissements pénitentiaires, avec toutefois une nette prépondérance dans les maisons d'arrêt surpeuplées. En cinq ans, le taux d'absence global des personnels de surveillance a augmenté de 2 %, les rubriques cumulées maladies, accidents du travail et longues maladies représentent 23,91 jours d'absence par agent en 1998, contre 21,22 jours en 1997. De plus, l'absentéisme oblige les directeurs d'établissement à procéder à des rappels de surveillants de permanence, ce qui contribue à alourdir à son tour les rythmes de travail du personnel rappelé. Dès lors, il apparaît que l'absentéisme est un phénomène qui s'auto-entretient et dont on ne peut casser la dynamique qu'en améliorant de manière très nette les conditions de travail. Le rappel des surveillants de permanence oblige de plus l'administration pénitentiaire à procéder à la rémunération d'heures supplémentaires conséquentes, dont le coût très important a été à juste titre dénoncé par la Cour des Comptes. ▪ des conséquences graves pour la sécurité L'administration pénitentiaire a souvent eu tendance, pour relativiser le sous-effectif, à raisonner en taux d'encadrement global et à comparer ce taux avec celui de nos voisins européens : « La France ne compte qu'un surveillant pour 2,6 détenus au 1er janvier 2000, alors que le nombre de surveillants est plus élevé que jamais et que celui des détenus baisse. Or la moyenne de détenus par surveillants constatée dans l'Union européenne est inférieure, sauf en Grèce, au Portugal et au Luxembourg. En 1996, dernière année sur laquelle nous disposons de statistiques comparatives, le ratio était de 2,3 détenus par surveillant au Royaume-Uni, 1,7 aux Pays-Bas et 1,3 au Danemark » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire). Cette présentation, qui consiste à diviser simplement le nombre de détenus par celui des surveillants, ne traduit qu'imparfaitement la réalité ; C'est, compte tenu des roulements d'équipes, à un instant donné, que le décompte doit être fait; seul ce décompte permet d'appréhender la faiblesse des effectifs et la vulnérabilité du surveillant isolé sur un étage d'une détention. Le sous-effectif, qu'il résulte d'un organigramme sous évalué ou d'un taux d'absentéisme important, conduit les chefs d'établissement à « découvrir » des postes en arrêtant provisoirement de les pourvoir. Les visites d'établissements ont permis de constater les difficultés qui résultaient de cette gestion des effectifs : le personnel, les chefs d'établissement sont constamment dans une logique de gestion « sur le fil », à la merci de l'incident ou de l'agression. Le service de nuit, notamment dans les petits établissements, n'est parfois effectué que par deux agents au lieu des trois comme prévu dans un protocole d'accord entre administration et syndicats. Ce service de nuit s'effectue également sans gradé de service présent dans l'établissement, alors même que les clés sont détenues par le gradé : « Dans 90 % des établissements, il n'y a pas de gradé de nuit mais un gradé de permanence à domicile. Nous devons donc l'appeler chez lui pour qu'il vienne ouvrir la cellule. Il est encore plus incroyable qu'il n'y ait pas de surveillante de nuit dans les 73 quartiers de femmes. Elles sont d'astreinte à domicile. S'il y a un problème en cellule, la détenue appelle par un interphone le surveillant homme, qui téléphone à son gradé de permanence, qui à son tour, téléphone à la surveillante pour qu'elle se rende dans son établissement ! » (M. Serge Alberny, Syndicat national pénitentiaire FO des personnels de surveillance) Le sous-effectif conduit également à renoncer à tout un ensemble de tâches pourtant essentielles à la sécurité : les fouilles des cellules ne sont faites qu'épisodiquement, voire jamais, les passages dans les chemins de ronde ne sont plus pratiqués régulièrement. Il s'ensuit de façon très claire un sentiment d'insécurité croissant chez le personnel ; ce sentiment se conjugue avec celui de ne pas assurer efficacement la mission d'insertion qui lui est dévolue. ▪ une capacité d'écoute rendue difficile Il s'agit ici, une nouvelle fois, d'affirmer que le sous-effectif en personnel est un obstacle à toute évolution de la prison vers une mission d'insertion. Aucune réforme ne peut être valablement menée sans dégager auparavant les moyens budgétaires et humains adéquats. Dans des conditions de sous-effectif, il ne peut y avoir une écoute suffisante et une observation attentive des détenus. Les personnels, et bien entendu en premier lieu les surveillants, ont le sentiment qu'un grand nombre de réformes ont été initiées ces dernières années sans l'accompagnement adéquat en terme d'effectifs : l'autorisation d'une troisième douche par semaine, la nouvelle procédure disciplinaire ou le projet d'exécution de la peine ont été annoncés mais butent le plus souvent sur les moyens humains. C'est donc l'ensemble des conditions de détention qui souffre de cette pénurie : les postes « découverts » sont en priorité pris sur ce qui est considéré comme accessoire au regard des missions de la prison, à savoir sa mission d'insertion. ▪ des conséquences sur la formation Le sous effectif rend bien évidemment très difficiles les actions de formation du personnel ; il est en effet quasiment impossible de dégager un effectif suffisant permettant à un agent de partir en journées de formation. Il faut d'ailleurs se féliciter à ce sujet de l'expérience menée dans plusieurs directions régionales de mise en place d'équipes d'intérim, permettant le remplacement des agents dans leurs postes pendant leur durée de formation. Il conviendrait bien évidemment de généraliser cette procédure. A l'heure actuelle, comme l'a indiqué M. Patrick Mounaud, directeur de l'ENAP, le surveillant n'a une chance raisonnable d'obtenir une formation de quelques jours que tous les huit ou dix ans. Le sous-effectif a également des conséquences sur la formation initiale du personnel surveillant ; cette formation comprend actuellement quatre mois de stage et quatre mois d'enseignement à l'ENAP. La pénurie de personnel conduit à remplacer dans les organigrammes les effectifs absents par les élèves surveillants. Il ne s'agit donc plus qu'en théorie de stage ; placés directement en détention, exerçant les mêmes tâches que les surveillants, les élèves surveillants voient dès lors leur formation initiale quelque peu sacrifiée : « On forme un gardien de la paix en un an et un surveillant pénitentiaire en huit mois. Il faut de plus soustraire de ces huit mois les quatre mois de stage pratique qui, actuellement, ne revêtent pas un caractère de formation mais sont une mise en situation professionnelle immédiate pour pallier le manque d'agents. Au centre de détention de Caen, des stagiaires de 21 ou 22 ans, censés effectuer un stage de formation, comblent en réalité le déficit en personnel ».(M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre de détention de Caen). ▪ l'ensemble de l'organigramme désorganisé La pénurie de personnel est bien évidemment d'abord une question de pénurie du personnel surveillant ; cependant, cette pénurie, on l'a vu, touche toutes les catégories de personnel pénitentiaire, avec des répercussions importantes sur la vie des établissements. Les vacances de postes d'encadrement ont pu être constatées sur l'ensemble des visites ; ainsi, par exemple, à Fontenay le Comte, le poste de directeur d'établissement est en souffrance depuis le départ du directeur en congé maladie. Aucun poste de sous-directeur n'est prévu ; la fonction est donc assurée depuis de longs mois par un chef de service pénitentiaire, lui-même en instance de départ à la retraite. Val-de-Reuil, centre de détention qui compte plus de 700 détenus, est dirigé par un directeur et un stagiaire, alors que quatre postes sont normalement prévus. Mme Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire, a rappelé devant la commission d'enquête les problèmes posés par la gestion du corps des directeurs : « Un départ [du poste de directeur] provoque donc des mouvements trop rapides. Vous avez cité Bois-d'Arcy ; il en va de même de la Santé qui a vu défiler rapidement de nombreux directeurs. C'est un vrai problème, compte tenu du poids des directeurs dans le mode de gestion actuelle qui n'est pas organisé, sauf exception, en équipe de direction, mais véritablement autour du directeur selon un dispositif très hiérarchisé ». La pénurie d'effectifs techniques a des conséquences directes sur l'entretien des bâtiments et la vie quotidienne des établissements. En l'absence de personnel, on fait appel aux bonnes volontés, aux talents des uns ou des autres, surveillants ou détenus. Et en l'absence de talents, on improvise : à Privas, comme d'ailleurs dans de nombreux petits établissements, aucun personnel technique n'est affecté à la cuisine ; les détenus du service général se trouvent dès lors seuls pour préparer les repas. La qualité de la nourriture dépend donc des talents culinaires des détenus classés... Concluons, pour finir, sur l'indigence des effectifs des conseillers d'insertion et de probation ; la norme retenue par l'administration pénitentiaire est de un travailleur social pour cent détenus en milieu fermé et un travailleur social pour soixante-dix personnes sous main de justice en milieu ouvert. Il faut ajouter que ces normes ne sont pas toujours respectées : « Ce quota est rarement respecté en particulier dans les grandes prisons. A Fleury-Mérogis, par exemple, où les problèmes sont multipliés, il devait normalement y avoir une soixantaine de travailleurs sociaux. Depuis quinze ans, seulement quarante agents y sont affectés, c'est-à-dire qu'il en manque vingt en permanence. » (M. Paul Pelegrin, conseiller d'insertion et de probation, délégué de l'Union syndicale pénitentiaire) A titre de comparaison, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse retient le chiffre de un éducateur pour un jeune dans les unités d'éducation renforcée. Ces normes parlent d'elles-mêmes et permettent de mieux appréhender la portion congrue qui est réservée à la mission d'insertion en prison. Il convient de faire porter un effort décisif sur les moyens budgétaires impartis aux ressources humaines ; l'administration pénitentiaire ne doit pas se contenter de raisonner sur la gestion des organigrammes existants ; elle doit faire valoir les impératifs qui s'attachent à la sécurité et à l'insertion. Il est également indispensable de procéder à une véritable déconcentration de la gestion des ressources humaines au niveau des directions régionales : seule cette déconcentration permettra, établissement par établissement, d'évaluer au mieux les besoins en personnel. 2) Des surveillants en quête de reconnaissance a) Un métier qui a subi de profondes évolutions Les visites des établissements pénitentiaires ont permis d'apprécier le dévouement et la qualité du personnel surveillant ; il ne s'agit pas, en disant cela, d'une vaine formule de circonstance destinée à rassurer une profession en proie au doute. Les qualités professionnelles des surveillants ont été unanimement saluées et reconnues par les membres de la commission d'enquête. Les visites des établissements ont permis de constater leurs conditions de travail difficiles. Il faut rappeler en effet que les conditions de détention décrites dans la première partie de ce rapport constituent également le cadre de vie du personnel pénitentiaire et plus particulièrement des surveillants qui subissent eux aussi la vétusté, la dégradation des locaux, les tensions liées à la surpopulation. La conviction profonde du rapporteur est que l'administration pénitentiaire dispose d'un personnel de qualité, qui a envie que les choses changent et est ouvert au dialogue. L'accueil des parlementaires dans les établissements pénitentiaires témoigne de l'attente des personnels : les rencontres avec les sections syndicales ou les surveillants sur leur poste de travail ont certes permis l'expression de revendications catégorielles, portant d'ailleurs essentiellement et légitimement sur des questions de sous-effectif. Mais elles ont surtout été l'occasion d'exprimer, avec beaucoup d'expérience, une véritable réflexion sur le service public, le rôle de l'enfermement et la condition du détenu. Il y a là, au niveau local, une réelle force de propositions, qui ne se répercute pas si facilement dans le dialogue social, à l'échelon central. Les entretiens avec les surveillants ont permis de constater que le moral des fonctionnaires pénitentiaires est très bas. Ils vivent mal les campagnes de presse en cours sur les prisons, non pas parce qu'ils cautionnent les dysfonctionnements qui peuvent exister dans l'institution pénitentiaire, mais parce qu'ils dénoncent ces dysfonctionnements depuis longtemps sans avoir l'impression d'avoir été écoutés. L'ouvrage de Mme Véronique Vasseur a ainsi été mal perçu par une profession qui a désormais le sentiment que la parole d'un médecin, aussi approximative soit-elle, vaut davantage que celle d'un surveillant. Ce malaise renvoie également au devoir de réserve imposé par le statut spécial, qui est de plus en plus mal vécu et contesté. La campagne médiatique a également été vécue comme une profonde injustice par l'immense majorité des surveillants qui fait bien son travail, avec humanité et conscience professionnelle : les surveillants souffrent de l'opprobre jeté sur l'ensemble d'une profession du fait de comportements délictueux condamnables de quelques individus. Ils réclament d'ailleurs une totale transparence afin de faire cesser définitivement le soupçon. Il convient à ce sujet de relativiser les chiffres : en 1999, 268 agents ont été sanctionnés, ce qui, ramené aux 25 000 agents de l'administration pénitentiaire, paraît fort peu. Un grand sentiment de découragement se fait jour, comme le confirme le témoignage de M. Philippe Maître, magistrat, chef de l'Inspection des services pénitentiaires : « J'ai été étonné de voir des personnels qui, habituellement, ont une vision très mesurée des choses, arbitrant bien entre le reproche fondé et l'injustice, basculer dans le camp des découragés et dire qu'ils sont des parias. » Ce sentiment d'injustice est d'autant plus profondément ressenti que le personnel surveillant a connu ces dernières années une évolution très importante de ses conditions de travail, évolution qui s'est faite sans trop de heurts grâce, justement, au professionnalisme des surveillants. En un peu plus de vingt ans, les conditions de vie en détention ont été complètement bouleversées : la suppression des séparations dans les parloirs, l'introduction de la télévision, la fin de l'obligation au travail sont autant de réformes qui ont changé profondément le travail du personnel surveillant. Le surencombrement des maisons d'arrêt, sur lequel nous ne reviendrons pas, ainsi que l'évolution de la population pénale, avec l'accroissement de détenus toxicomanes, de jeunes dépourvus de repères, de personnalités ayant un profil psychiatrique, ont également demandé des efforts d'adaptation considérables. Il serait hâtif et erroné de présenter dès lors le surveillant comme un nostalgique des conditions de détention telles qu'elles pouvaient exister dans les années 70, proches d'un régime militaire avec obligation de porter le costume pénitentiaire et la punition au pain sec et à l'eau. Il est nécessaire d'être conscient de la réelle capacité d'adaptation dont a fait preuve le personnel pénitentiaire, d'autant que, le plus souvent, les moyens budgétaires n'ont pas suivi. De plus, la formation des personnels n'a pas pris réellement en compte l'évolution considérable des missions. « Les surveillants ont l'impression qu'on ne les crédite pas des efforts extraordinaires qu'ils ont consentis depuis une vingtaine d'années. Celles et ceux qui connaissaient les détentions il y a une vingtaine d'années me comprennent. Il suffit de visiter une prison, ne serait-ce que quelques heures, même les pires, pour s'apercevoir que l'on a rattrapé des dizaines d'années de retard accumulé. Je n'appartiens pas à cette administration et je vais prochainement la quitter ; cela me permet de dire que peu d'administrations se sont autant réformées avec autant d'efforts demandés au personnel de l'administration pénitentiaire. » (M. Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) L'évolution de ces missions imparties à l'administration pénitentiaire a coïncidé avec une évolution du recrutement : « Il convient encore de considérer la forte évolution du profil des élèves recrutés dans tous les corps. Les personnels de surveillance sont recrutés au niveau du brevet des collèges. Actuellement, ceux que nous recevons ont, en moyenne, un niveau bac + 1 ; 85 % ont le bac et 35 % ont un niveau supérieur au DEUG. » (M. Patrick Mounaud, directeur de l'ENAP) Cette évolution du recrutement a changé le métier pénitentiaire : les surveillants nouvellement recrutés insistent davantage sur les facultés d'écoute qu'ils doivent développer avec les détenus ; ils paraissent davantage sensibilisés à la mission d'insertion : « En maison d'arrêt, le temps de parole est largement insuffisant ; nous sommes confrontés à une surpopulation chronique, et le surveillant, qui est là pour exécuter un certain nombre de tâches matérielles, n'a pas le temps d'engager un réel dialogue avec les détenus. Dialogue qui, d'ailleurs, a longtemps été interdit par l'administration pénitentiaire. Certains gradés suspectaient les surveillants qui passaient trop de temps à discuter avec les détenus de compromission. Heureusement, la nouvelle génération change. Mais je siège au conseil de discipline des personnels, et je peux vous citer l'exemple d'un surveillant qui a été sanctionné pour avoir joué aux échecs avec un détenu. Or il me semble que répondre aux questions des détenus - qui sont des personnes humaines - fait partie de notre fonction. Pendant de longues années, il nous était interdit de discuter avec les détenus. Le détenu était considéré comme un mauvais sujet qui devait être écarté de la société et que l'on devait se contenter de garder. La maison d'arrêt de Fresnes reflète encore cette mentalité : les détenus sortent en promenade en rang, les mains dans le dos, et n'ont pas le droit de discuter. » (M. Jean-Luc Aubin, secrétaire général de l'UFAP) Le surveillant est en effet l'interlocuteur direct, permanent du détenu, alors même que, compte tenu notamment de la politique de décloisonnement, la majorité des décisions qui concernent le détenu lui échappe ; le retard dans la distribution des courriers, les plats qui arrivent froids, le rendez-vous chez le médecin qui se fait attendre, les résultats d'analyses qui ne sont pas communiqués, la permission de sortie refusée par le juge de l'application des peines... Autant de récriminations et de revendications pour lesquelles le surveillant est en première ligne, sans rien pouvoir faire d'autre généralement que de répercuter les demandes et les réitérer si besoin est, à l'échelon hiérarchique supérieur. En détention, le décalage est évident entre le surveillant et le détenu, qui n'appréhende pas le temps de la même manière ; le détenu est constamment en attente et dans une situation de demandeur. Il semble que cette gestion de la frustration par les détenus soit plus difficile qu'auparavant et qu'elle suscite d'avantage de tension ; cette situation semble être le résultat d'une conception différente des relations entre surveillants et détenus, davantage axée sur le dialogue que sur la discipline : « Cela apparaît au travers des réactions aux violences dont sont victimes les surveillants. D'aucuns « s'amusent » de voir qu'un surveillant qui reçoit une gifle prend un arrêt maladie et est traumatisé psychologiquement, peut-être pas tant d'ailleurs d'une gifle que d'un crachat. Dernièrement, dans une émission sur les policiers en difficulté, on évoquait l'impact psychologique de se faire cracher dessus. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, les surveillants résistaient psychologiquement mieux, peut-être parce que la façon de réprimer ce type d'agissements était plus directe. Aujourd'hui, en raison de l'idée qu'ils se font de leur mission, ils ne supportent plus ce genre de contraintes et ont beaucoup de mal à être confrontés au risque. L'évolution du nombre des déments en détention augmente très sensiblement le niveau de risque. Il n'y a plus de règles en prison, du moins, celles que les détenus et le personnel de surveillance respectaient de façon générale il y a quelques années. » (M. Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) Il en résulte pour les surveillants et, à titre principal, les jeunes surveillants, une grande frustration dans la façon d'appréhender leur métier ; refusant de n'être que de simples porte-clés, ils préfèrent gérer la détention par l'instauration du dialogue et de rapports établis sur la responsabilité de chacun. Ce souhait se heurte cependant rapidement aux conditions matérielles de la détention, à l'attitude de plus en plus agressive des détenus et à l'incompréhension de certains collègues plus anciens. Le manque de soutien hiérarchique ainsi que l'absence d'un cadre de travail pertinent ne font qu'accroître la démotivation. b) Un isolement de plus en plus mal vécu L'isolement des surveillants dans l'accomplissement de leurs missions est un véritable leitmotiv. Il s'agit d'abord véritablement d'un isolement géographique qui frappe lors des visites d'établissements pénitentiaires. La solitude du surveillant, enfermé dans un mirador, fait partie du quotidien de la vie pénitentiaire depuis de longues années. Mais il s'agit aussi d'une solitude vécue dans les ateliers, où le surveillant est seul pour garder parfois plus de cinq ateliers, dans les coursives ou les cours de promenade. Il y a, pour expliquer cette solitude, bien évidemment une question de sous-effectif ; mais tout visiteur peu habitué à la prison s'étonne à juste titre que le calme, dans un bâtiment de détention, repose en définitive sur la présence et la compétence d'un seul agent. Cet isolement a eu, de plus, tendance à s'accroître avec la construction des établissements récents, dans lesquels, pour des raisons de sécurité et de coût, le facteur humain a été en partie remplacé par le facteur technique (Cf. supra). ▪ Cette solitude est aussi vécue comme une solitude hiérarchique, avec, au plus haut niveau, le sentiment de ne pas être suffisamment compris et défendu par leur ministre. « Le personnel pénitentiaire souffre énormément des attaques, dont la presse se fait l'écho, émanant d'organisations professionnelles quelles qu'elles soient. Par exemple, on a entendu sur une chaîne de télévision, il y a peu de temps, des avocats traiter les surveillants d'assassins. Je trouve déplorable que notre ministère de tutelle ne réagisse pas devant de tels propos. C'est au ministre de tutelle qu'il revient de défendre les fonctionnaires de son ministère quand ils sont mis en cause, surtout de cette manière. Ce sont des attaques sans fondement, diffamatoires et, parce qu'émanant d'un avocat qui rentre dans la prison, extrêmement graves. Le personnel pénitentiaire vit très mal le fait de ne pas être défendu par sa propre hiérarchie. Il est évident dans ce contexte, que lorsque le ministre demande au personnel pénitentiaire d'appliquer les mesures qu'il vient de décider, le terrain d'exécution de la mesure n'est pas du tout fertile. Le personnel n'est pas prêt à faire des efforts lorsqu'ils sont demandés par une hiérarchie qui devrait le défendre, mais ne le fait pas. Ce comportement est très mal perçu par le personnel et crée une ambiance détestable. » (M. Yannick Gaillard, membre de l'Union syndicale pénitentiaire). ▪ Cette solitude est également une solitude ressentie vis-à-vis de l'encadrement : on l'a vu, le surveillant est en constant face-à-face avec le détenu, alors que le directeur passe, au mieux, une fois par jour dans les quartiers de détention. C'est au surveillant de gérer le quotidien des tensions, des agressions, sans que la pénibilité de cette tâche ne soit réellement reconnue : « Les détenus ne veulent subir aucune contrainte en détention, sinon ils vont à l'affrontement. Dès lors qu'il y a affrontement et pour apaiser la détention, la direction préfère changer un agent de poste, voire le mettre dans un mirador, ou encore carrément le mettre dans un poste protégé. » (M. Norbert Claude, secrétaire général de l'Union syndicale pénitentiaire) Sans même évoquer ces incidents, il semble évident que les compétences des surveillants, dans leur travail d'écoute et d'observation, ne sont pas suffisamment utilisées ou mises en valeur : « Si les surveillants restent trop attachés actuellement à des questions d'horaires ou d'emplois du temps, cela est lié au fait qu'ils sont complètement instrumentalisés et qu'ils ne peuvent prendre aucune initiative. Or ces initiatives et ce travail seraient complémentaires de celui des conseillers d'insertion et de probation dans la mesure où ils pourraient s'intéresser à la situation des détenus et participer à la résolution d'un grand nombre de problèmes posés par l'incarcération. » (M. Michel Pouponnot, membre de l'Union générale des syndicats pénitentiaires CGT) Ainsi, rares sont les établissements où les carnets d'observation, sur lesquels les surveillants inscrivent tout ce qui a trait à la vie en détention, continuent d'être tenus : « Dans beaucoup d'établissements, les surveillants tiennent des carnets d'observation, que les procureurs ont le droit de consulter. Certains se les font systématiquement communiquer, les lisent, alors que d'autres ne les réclament pas. Dans certains établissements, les carnets d'observation sont tombés en désuétude parce que si le chef d'établissement ou sa hiérarchie intermédiaire ne les exploite pas et si, par ailleurs, les procureurs ne les demandent pas, le personnel ne ressent plus la nécessité de les tenir. Quand l'inspection des services pénitentiaires se rend en établissement, elle se fait automatiquement communiquer les carnets d'observations des surveillants et les suites qui ont pu être données aux observations, mais leur tenue est très inégale selon les établissements. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) C'est pourtant là, dans cette capacité d'observation, que se situent les conditions d'une revalorisation du métier pénitentiaire, en même temps qu'un facteur d'apaisement de la détention. Le projet d'exécution des peines, qui permet de réfléchir sur la durée de détention propre à chaque détenu, est un début de réponse qui permet également de mieux impliquer le surveillant. La mise en _uvre d'un véritable travail en équipe doit également être considérée comme une nécessité. Cette question sera abordée ultérieurement. ▪ L'isolement professionnel est également un isolement psychologique, alors même que les conditions de travail sont pénibles et génératrices d'angoisse : « En tant que psychiatre, j'évoquerai ensuite, au risque de vous surprendre, l'absence de travail de la part de tous ceux qui vivent en milieu pénitentiaire, notamment les directeurs, les gradés, les personnels de surveillance, sur la culpabilité ressentie par un adulte à enfermer quelqu'un. J'enseigne à l'école nationale de l'administration pénitentiaire depuis onze ans, je sais que ce travail n'est pas fait. Certes, il y a la caution de la décision d'un magistrat ; l'arrestation par les policiers est un acte ponctuel, les magistrats interviennent dans le procès pénal en bonne et due forme, mais après il y a des gens qui pendant cinq ans, dix ans, six mois sont chargés d'enfermer leur prochain. Or ce travail-là me semble totalement évacué. Il n'y a pas de formation à l'école et par la suite, il n'y a jamais de débat sur ce que représente pour un homme le fait d'enfermer un autre homme ou pour une femme d'enfermer une autre femme. Cela me semble être à l'origine de toute la difficulté des métiers des personnels de surveillance. De plus, se pose la question de l'absence de la parole dans la culture pénitentiaire. Quand il se passe quelque chose de difficile dans un service hospitalier, on en parle. Comme dans beaucoup d'institutions, on organise une réunion de services, un briefing. Dans l'administration pénitentiaire, cela n'a pas lieu. Par exemple, après une pendaison, un surveillant dépend le détenu, rédige un rapport sur les circonstances et c'est tout. Ensuite, on n'en parle pas. Cela n'est pas prévu. Ce travail sur la culpabilité d'enfermer les autres est très important et concerne les personnels de direction comme ceux de la base. » (Docteur Betty Brahmy, chef du SMPR de Fleury-Mérogis) La carence de l'accompagnement psychologique a souvent été dénoncée ; il n'y a effectivement qu'un psychologue par direction régionale ce qui apparaît nettement insuffisant. La création de lieux d'écoute, hors hiérarchie, permettant aux personnels témoins ou victimes d'événements graves, tels qu'agression ou suicide, de s'exprimer, serait souhaitable. ▪ Il ne faut pas s'étonner, face à cet isolement profondément ressenti par l'ensemble des surveillants, que la question des passerelles vers d'autres professions ait été maintes fois évoquée. Les perspectives de carrière des surveillants apparaissent effectivement peu motivantes : « Notre carrière est effectivement rapidement bouchée : j'ai 35 ans, je suis premier surveillant, au mois d'août je serai en fin de carrière. Il y a de quoi être découragé ! Nous recrutons des jeunes diplômés - qui possèdent parfois un bac + 2, + 3, voire + 4 ou + 5 - qui ont envie de faire carrière dans l'administration pénitentiaire pour accompagner les détenus et être utiles à la société. Or le système administratif les décourage ; ils sont broyés dans la masse, par des notes, des appréciations données par des anciens qui ne comprennent pas la nouvelle génération de surveillants - qui a beaucoup plus de contacts avec les détenus. » (M. Jean-Luc Aubin, secrétaire général de l'UFAP) L'ensemble de la profession réclame donc davantage de perméabilité entre les fonctions, et notamment entre le milieu fermé et le milieu ouvert. « Il faut également réfléchir à décloisonner l'administration pénitentiaire vers le milieu ouvert, vers les SPIP - services pénitentiaires d'insertion et de probation - car le personnel pénitentiaire pourrait se charger du contrôle extérieur, sans pour autant investir le corps des socio-éducatifs. Il suffit de regarder le nombre de personnels pénitentiaires qui quittent la profession pour se rendre compte qu'il y a un malaise. » (M. Jean-Luc Aubin, secrétaire général de l'UFAP) « Les centres pour peines aménagées permettraient aux personnels pénitentiaires de jouer un rôle de tuteur pour guider le détenu vers l'extérieur. Nous proposons, en effet, que nos missions aillent au-delà du milieu fermé car nous connaissons parfaitement les détenus et parce que cela permettrait de porter remède à la frustration des personnels pénitentiaires. Les travailleurs sociaux ne peuvent, ni ne souhaitent, être les seuls à faire respecter le contrat en dehors de la prison. Ils ne souhaitent pas non plus s'occuper du bracelet électronique. Ils sont d'accord pour exercer un accompagnement social mais ne souhaitent pas aller au-delà. La réinsertion et la sécurité vont de pair. On refuse au personnel pénitentiaire une participation à ces missions. Il en résulte des frustrations. » (M. Serge Alberny, secrétaire général du syndicat national FO des personnels de surveillance). Le décloisonnement mérite d'être étudié avec attention : il permettrait, en premier lieu, très certainement de crédibiliser aux yeux des magistrats, les solutions en milieu ouvert, alternatives à la détention. Il serait de plus le préalable à une mise en place d'un régime progressif, permettant de procéder à la libération du détenu par paliers successifs, avec des régimes de détention de plus en plus souples à l'instar de ce qui se pratique au Canada. Enfin, il responsabiliserait davantage le surveillant dans le processus d'insertion : « Ces derniers, qui doivent garder les détenus, doivent aussi participer à leur réinsertion et devraient pouvoir connaître la situation du détenu une fois qu'il a recouvré la liberté. Notre travail est intéressant, nous sommes chargés d'établir des relations humaines avec les personnes incarcérées, mais nous ne sommes pas tenus informés des suites une fois ces personnes libérées. Dès lors, nous avons l'impression de travailler non pas avec des hommes mais sur un produit. » (M. Serge Alberny, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire FO des personnels de surveillance) Plus généralement, il est important de réfléchir à la mise en place de passerelles entre l'administration pénitentiaire et les autres administrations : l'expérience professionnelle qui caractérise les surveillants, avec la connaissance qu'ils ont de la délinquance, de la pratique et de la gestion de la détention, devrait être valorisée et mieux utilisée. c) L'absence d'un cadre normatif adéquat Le désarroi des surveillants est d'autant plus grand qu'ils ne disposent pas d'un cadre normatif incontestable pouvant servir de référence quotidienne à leur exercice professionnel. Ils se trouvent dès lors constamment contraints de gérer le conflit entre l'application des normes et les réalités quotidiennes de la détention : « Nous craignons qu'il y ait un décalage entre la norme et la réalité. Toutes les lois ne peuvent pas s'appliquer à la Santé, du fait de l'insalubrité de l'établissement ; la loi Evin sur le tabac, par exemple, ne peut pas être appliquée dans les établissements pénitentiaires - qui sont pourtant des établissements publics -, et les détenus non-fumeurs côtoient donc les fumeurs. Or un détenu qui aura connaissance de cette loi - et donc de ses droits - pourra exiger son application ; l'administration pénitentiaire sera sanctionnée et par conséquent le surveillant concerné également. Un grand nombre de nos collègues sont déjà poursuivis pour non-application de règlements suite à des plaintes de détenus. Or nous ne les supportons plus. Nous souhaitons que soit établie une présomption d'innocence ; il faut que l'on reconnaisse que le personnel pénitentiaire ne peut pas appliquer la législation du fait de la vétusté des établissements. Ce manque de moyens ne permet pas à la norme de s'appliquer. Quand un détenu arrive à la Santé, le surveillant, qui est le seul à prendre des décisions puisqu'il y a un manque de gradés important dans les établissements, affecte le détenu où il peut, en essayant de tenir compte de ses affinités, de son origine raciale, etc. » (M. Jean-Luc Aubin, secrétaire général de l'UFAP) Les surveillants se trouvent ainsi démunis de repères face à des pratiques essentielles de leur métier ; la frontière entre ce qui relève de leurs obligations professionnelles et ce qui paraît être, aux yeux de l'opinion publique, un abus de position dominante est souvent ténue : « La réalité des règles est une des questions importantes. Certaines règles ne sont en réalité pas applicables ou alors dans des conditions extrêmement difficiles. Cela pose un problème quotidien aux personnels pénitentiaires : soit, ils appliquent la règle et il y a des incidents ; soit, ils ne l'appliquent pas, et ils ont ou auraient affaire à l'inspection. Le type même de cette règle est la fouille intégrale. Telle qu'elle est enseignée et pratiquée, elle est, sur un plan strictement moral, évidemment dégradante. Elle consiste à être nu, à s'agenouiller, à tousser, à subir des inspections extrêmement minutieuses, ce qui, vous l'imaginez, n'est absolument pas agréable. Les détenus protestent, créent des incidents et les surveillants, plus ou moins démunis, reculent progressivement. Je ne suis pas sûr - disant cela, vous me comprendrez à demi-mot - que ces fouilles soient systématiquement réalisées comme elles le devraient. Faut-il un jour prendre le risque de les supprimer au prix de la sécurité des surveillants ou faut-il les valider, les encadrer très strictement et les faire subir aux détenus ? C'est un point de vue qui dépasse très largement le personnel pénitentiaire, c'est presque un point de vue de société :continue-t-on à tolérer de telles pratiques ou y oblige-t-on ? Il en va de cette règle comme d'un grand nombre de règles de sécurité. » (M. Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) Les personnels pénitentiaires réclament donc un cadre référentiel pratique qui permettrait de mieux gérer leurs droits et devoirs ; le statut spécial mis en place par l'ordonnance du 6 avril 1958, précisé par le décret du 21 novembre 1966, n'apparaît pas être un cadre pertinent à cet effet ; ce statut qui, en contrepartie d'obligations et sujétions spécifiques, accorde des droits et avantages, paraît beaucoup trop général pour l'exercice d'une pratique quotidienne. Il est de plus fortement contesté, notamment en raison de l'interdiction du droit de grève et du renforcement du devoir de réserve qu'il instaure. Consciente de la nécessité de mieux encadrer le personnel surveillant dans ses missions quotidiennes, l'administration pénitentiaire a procédé à une véritable réflexion sur la carrière de surveillant ; elle s'est d'abord dotée d'un référentiel des métiers et de la formation qui va permettre une clarification des missions de chaque agent. Ce référentiel permet en théorie de mieux décrire les emplois et leurs contributions aux missions de service public et de mettre en place la gestion prévisionnelle qualitative et quantitative des ressources humaines. La mise en pratique de ce référentiel paraît cependant beaucoup plus incertaine : fourni aux établissements sans méthodologie pour son usage, cet outil reste pour l'instant encore totalement sous-utilisé. Avec plus de succès, l'administration a rédigé ou procédé à la mise à jour d'un mémento sur les droits et obligations des personnels pénitentiaires ainsi qu'un mémento du surveillant. Le premier reprend, sous forme de rubriques thématiques, la réglementation générale applicable à tous les fonctionnaires et celle, spécifique, qui découle du statut spécial. Le second rappelle les bases fondamentales de la réglementation pénitentiaire et vise à aider le surveillant à mieux remplir ses fonctions de sécurité et d'observation. Il lui permet ainsi de répondre aux questions les plus courantes des détenus. Parallèlement à ces aspects pratiques, l'administration s'est également livrée, en concertation avec les syndicats, à une réflexion sur la déontologie du métier de fonctionnaire pénitentiaire. Un projet de code de déontologie pénitentiaire est actuellement à l'étude ; déjà présenté à la commission consultative des droits de l'homme, il sera bientôt soumis pour examen au Conseil d'Etat. Ce projet semble toutefois contesté, non pas tant sur le fond des principes qu'il énonce, mais sur son caractère directement applicable en détention ; trop général, il se résumerait davantage à une succession de bonnes résolutions qu'à un manuel pratique. Enfin, il faut se féliciter que la loi portant création d'une commission nationale de déontologie de la sécurité ait finalement inclus, dans son champ de compétences, le personnel pénitentiaire ; la commission est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie dans les services et organismes, aussi bien publics que privés, exerçant des activités de sécurité en France. Le personnel pénitentiaire était, dans le projet du gouvernement, exclu du contrôle de cette commission ; les syndicats rencontrés se sont tous félicités que, finalement, les agents pénitentiaires aient été reconnus, à parité avec les forces de police, comme exerçant une fonction de sécurité. La réflexion sur le métier de surveillant doit être poursuivie en impliquant l'ensemble des intervenants de l'administration pénitentiaire. Surtout, leur action doit pouvoir s'appuyer sur une définition précise de ce que doivent être les missions de l'administration pénitentiaire et s'accompagner également, de façon plus large, d'une réflexion sur le sens de la peine. Cette réflexion a également été un thème de travail de la commission d'enquête : nous aurons l'occasion d'y revenir. Face à l'enjeu que constitue la transformation des métiers, de véritables plans de formation et d'accompagnement des personnels doivent être mis en place. Ils sont la condition d'une bonne compréhension et de la bonne mise en _uvre des réformes. 3) Le rôle de l'encadrement à redéfinir On peut souligner d'emblée que les membres de la commission ont été frappés par la qualité de certains des directeurs d'établissement rencontrés au cours des visites. Lors de son audition devant la commission. Jacques Lerouge notait également : « J'ai travaillé dans trente-sept établissements pénitentiaires, j'ai trente-cinq ans de recul. J'ai donc connu à leur début une grosse partie des personnels d'encadrement de l'administration pénitentiaire. La chance de cette administration, c'est d'avoir en son sein une poignée de femmes et d'hommes passionnés par leur travail. Sinon, il y a belle lurette que tout aurait explosé. » L'accueil des parlementaires dans les établissements pénitentiaires a révélé une grande attente de la part des directeurs d'établissement, désireux de faire connaître leur métier et de rompre un isolement souvent pesant, compte tenu de leurs responsabilités : « Se demander quelle est la journée d'un directeur de prison, n'est pas la bonne question, car nous vivons au rythme de la prison 24 heures sur 24. Ce qui me frappe, après 20 ans de carrière, c'est de voir à quel point les personnels, les détenus, les autorités extérieures - et même nos familles - identifient le directeur à la prison elle-même. Nous vivons depuis quelque temps en dehors des murs, mais tellement près que finalement cela n'a rien changé. Peut-être est-ce une nécessité. Il n'y a pas de rupture entre notre vie professionnelle et notre vie privée. L'institution est pesante et nous le ressentons ainsi. Avant hier encore, un surveillant m'a téléphoné à mon domicile à 23 heures pour me parler de ses problèmes familiaux et de son divorce. Le directeur de prison peut être comparé à un commandant de navire : non seulement il ordonne l'exécution des tâches et fait appliquer la réglementation, mais il doit être présent à chaque coup dur, car on se tournera vers lui et il est le responsable. C'est ce qui fait la difficulté, mais aussi l'intérêt du métier. C'est sur le directeur que va peser l'entière responsabilité d'une décision ou d'une erreur. Au quotidien, un directeur de prison est entouré d'adjoints, de personnel d'encadrement qui vont se charger de toute une partie du travail. Le personnel est de mieux en mieux recruté, formé et plus performant, ce qui nous facilite la tâche. Néanmoins, cette responsabilité quotidienne est lourde, car nous ne connaissons jamais de rupture avec l'institution - combien de fois avons-nous été rappelés pendant nos congés ! » (M. Pierre Raffin, membre du syndicat national FO des personnels de direction) L'image du commandant de navire a souvent été utilisée lors des visites pour illustrer la fonction de directeur d'établissement ; elle traduit à la fois les responsabilités assignées au directeur ainsi que la solitude dans laquelle ils les exercent. Les responsabilités sont d'abord liées à la mission de garde assignée aux établissements pénitentiaires ; l'article D.265 du code de procédure pénale précise à cet effet que le chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité ; « A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel. » La sécurité est donc la première des préoccupations des directeurs ; concrètement, le rôle du chef d'établissement est d'abord une fonction de contrôle et de vérification afin de s'assurer que les textes et les consignes sont bien appliqués. Mais la fonction ne saurait se limiter au contrôle ; le directeur a également un rôle d'animation d'équipe, comme l'a souligné M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre de détention de Caen : « Mais il nous incombe surtout une fonction d'animation. A mon sens, le directeur d'une prison est quelqu'un qui doit avoir une grande capacité à animer et à laisser vivre professionnellement les personnels en leur donnant une réelle autonomie, quelle que soit la taille de l'établissement car cette mission peut s'exercer selon des modalités très différentes. » L'équilibre entre le contrôle et l'animation est difficile à établir ; la personnalité du directeur, comme ont pu le montrer les rencontres effectuées dans les établissements, paraît déterminante à cet égard : le climat d'une détention repose en effet beaucoup sur ses méthodes de travail, sa faculté à répartir sa charge de travail entre la gestion du personnel et l'écoute des détenus. Le système actuel est en effet très hiérarchisé et beaucoup de questions liées au quotidien de la détention ne semblent pouvoir être réglées que par le directeur. C'est au directeur qu'il revient en définitive de fixer les normes de la détention, les règles de discipline et leur marge de tolérance. Il en résulte - cela a déjà été dit - une grande diversité dans la gestion des établissements, qui s'appuie sur l'absence d'une norme de gestion claire et incontestable. Ce qui est permis, toléré dans un établissement par un directeur ne le sera pas dans un autre ; la consommation de drogue ou les relations intimes au parloir sont à cet égard des exemples frappants de la marge de man_uvre du directeur. Il ne s'agit pas, en disant cela, d'affirmer que des directeurs autorisent ouvertement la consommation de drogue ou les relations sexuelles ; il s'agit simplement de constater que certains directeurs font de la répression de ces comportements une priorité et d'autres non. Plus généralement, « la prison reflète la personnalité de son patron. Si vous faites quelque chose une année et que le patron change, dans la plupart des cas tout est à refaire. » (M. Jacques Lerouge) La diversité des modes de gestion peut être très perturbante pour les surveillants comme pour les détenus ; elle est d'autant plus accentuée qu'il existe un fort turn-over des personnels de direction. La stabilisation des équipes dirigeantes devrait pourtant être une priorité, afin de pouvoir apporter un minimum de continuité dans la gestion des équipes et le partenariat avec les intervenants extérieurs. Les responsabilités qui s'attachent à la fonction du directeur sont donc impressionnantes et ont de plus tendance à s'alourdir au détriment des relations que le chef d'établissement doit entretenir avec les détenus, ce que les directeurs reçus par la commission ont déploré : « J'ai le sentiment qu'assurant les fonctions de sous-directrice, je disposais de plus de temps à consacrer à la détention qu'aujourd'hui en qualité de chef d'établissement. Je le vis comme une frustration compte tenu d'un emploi du temps de plus en plus encombré par des tracas administratifs, des réunions ou des problèmes, parfois éloignés de la vie quotidienne en détention. » (Mme Valérie Decroix, directrice de la centrale d'Ensisheim) Il serait néanmoins erroné de présenter le directeur comme tout puissant dans son établissement. La gestion au quotidien d'un établissement est le résultat de compromis entre demandes du personnel surveillant, les revendications des détenus et la puissance tutélaire de la direction régionale. « La profession subit aujourd'hui tellement de pressions qu'elle s'autocensure. Nous faisons un métier dans lequel le prosélytisme syndical de la base est relativement fort et écouté. La CGT, FO et l'UFAP sont des syndicats forts et souvent le directeur est seul. Il doit faire machine arrière face aux intérêts politiques qui nous sont imposés. Notre crédibilité en est souvent affectée. » (M. Michel Beuzon, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire FO des personnels de direction) Lors des visites d'établissements, beaucoup de directeurs se sont plaints de la toute puissance des syndicats dans leur établissement et de leur résistance à tout changement dans l'organisation du travail. De même, les relations des directeurs avec leur hiérarchie régionale ne sont pas toujours faciles, comme l'a exposé M. Jean-Louis Daumas : « Les relations avec la hiérarchie régionale vont du pire au meilleur. Je dois dire que j'ai surtout connu le pire, c'est-à-dire un contrôle pesant, tatillon, par des personnes qui furent souvent de bons chefs d'établissements, mais qui n'ont absolument pas les qualités requises pour être des « managers » régionaux, c'est-à-dire des personnes qui mettent en _uvre des politiques publiques à un échelon déconcentré régional. J'ai rarement connu le meilleur et souvent le pire, sous forme de pressions, par exemple, lorsque l'on est confronté à l'événement. C'est peu le cas actuellement à Caen, mais j'y ai été confronté lorsque j'ai dirigé une maison d'arrêt urbaine terrible, celle de Loos-lèz-Lille :le pire est le rôle éminemment réactif de l'échelon régional dès lors que le drame se produit en prison. On presse alors l'établissement pour se dédouaner auprès de l'administration centrale. J'en garde un assez mauvais souvenir. » L'administration pénitentiaire semble consciente de ces difficultés, même si sa directrice, en affirmant devant la commission d'enquête qu'elle manquait de directeurs de qualité, n'a pas contribué à redonner confiance en soi à la profession. L'administration a ainsi mis en place une réflexion sur la prospective du métier de chef d'établissement et sur l'organisation des équipes de direction, avec notamment la création d'une fonction systématique de gestion des ressources humaines ; elle lance également une expérience de « coaching » des chefs d'établissement par un tiers pour remédier à leur isolement. L'administration a, dans le même mouvement, cherché à améliorer la condition des chefs de service pénitentiaire : ce corps de catégorie B, créé en 1993, occupe des fonctions d'encadrement en détention, consistant à diriger l'équipe des premiers surveillants et surveillants, des fonctions de chef de détention, dans lesquelles ils se voient confier la responsabilité de l'activité, stricto sensu, des fonctions d'adjoint au chef d'établissement et des fonctions de chefs d'établissement dans les petits établissements de moins de 200 places. Malgré ces responsabilités importantes, il existe un décalage entre les moyens accordés aux directeurs d'établissement et ceux accordés aux chefs de service pénitentiaire dans l'accomplissement de leurs missions : « Les chefs de service pénitentiaire de première classe et les chefs de service en général - auparavant surveillants-chefs et chefs de maisons d'arrêt - constituent l'une des catégories les plus dévalorisées. Ces chefs de service, issus du personnel de surveillance, dirigent des établissements pénitentiaires. Un chef de service de première classe peut diriger un établissement comptant un maximum de deux cents places, ce qui peut signifier trois cent cinquante ou quatre cents détenus. Il le dirige avec des moyens largement inférieurs à ceux d'un personnel de direction qui est entouré d'un staff, comprenant un économe, un greffier, un ou plusieurs adjoints. Le chef de service pénitentiaire a les mêmes responsabilités qu'un directeur et un déroulement de carrière qui est celui d'un fonctionnaire de catégorie B, ce qui ne correspond pas du tout aux responsabilités exercées. C'est la catégorie sur laquelle il faudrait faire porter les efforts car la majorité des établissements pénitentiaires sont dirigés par des chefs de service pénitentiaire issus du personnel de surveillance. » (M. Désiré Derensy, membre de l'Union générale des syndicats pénitentiaires CGT) La première mesure a été de renforcer les effectifs d'encadrement dans les petits établissements ; l'évaluation des besoins a fait état, pour créer dans chaque établissement une équipe de direction composée de deux personnels, d'un manque d'effectifs évalués à trente agents. Vingt emplois ont été pourvus par la loi de finances pour 2000 ; dix seront demandés pour le projet de loi de finances 2001. Une réforme du statut de chef de service pénitentiaire est également en cours afin de mieux prendre en considération le rôle d'encadrement essentiel qu'ils jouent dans les établissements pénitentiaires. Passant par une revalorisation du traitement, le coût de la réforme est estimé à 27,6 millions de francs, avec une provision d'un million de francs inscrite en loi de finances pour 2000. Au-delà de ces réformes ponctuelles, il conviendrait de procéder à une réflexion plus générale sur le métier de directeur d'établissement et sur les modalités de gestion des établissements pénitentiaires. Le rapport remis par la commission présidée par M. Guy Canivet au garde des sceaux soulevait la question d'une responsabilisation accrue des directeurs d'établissement en contrepartie d'un développement des procédures de contrôle. Les directeurs ont, on vient de le voir, un rôle fondamental d'impulsion et de mobilisation dans leur établissement. Il leur revient de réfléchir au développement d'une gestion plus collective de la détention reposant sur une implication accrue du personnel surveillant : « On a d'ailleurs fait croire aux surveillants que le métier qu'ils allaient faire n'est pas celui qu'ils font, en leur parlant d'observation, de participation au traitement des détenus, etc. C'est pourquoi nous disons qu'un changement est nécessaire. Il faut une équipe de travail constituée d'un travailleur social et d'un gradé qui encadre une équipe de surveillants qui sera en charge d'une partie de la détention. Pourquoi, dans les établissements qui sont ouverts, où les détenus peuvent librement se déplacer, avoir un surveillant à chaque étage ? Il vaudrait mieux mettre en place une équipe qui étudie si tel détenu peut passer à la phase supérieure, et qui puisse intervenir ensemble quand un problème surgit. Il y a souvent des accidents, parce que le surveillant intervient seul. Le fait de travailler en équipe, non seulement d'étudier un dossier mais aussi d'échanger des informations, serait un progrès considérable. Pour préparer les commissions d'application des peines, on demande l'avis du gradé qui recueille des fiches, remplies ou non, forme son opinion et propose tel ou tel pour la réduction de peine. Le service social fait la même chose de son côté. Le chef d'établissement propose et le juge décide. Si les quatre intervenants ont des avis divergents, le gradé va trancher de façon subjective selon ses propres critères, sans qu'aucune discussion n'ait été possible. Il est indispensable de travailler en équipe dans les établissements pénitentiaires. Il faut valoriser le travail des personnels de surveillance et non pas que ces personnels soient uniquement là pour faire de l'hôtellerie et régler les incidents. Il faut prendre l'avis de l'équipe de surveillants et qu'elle soit informée des suites. Si un rapport disciplinaire a été dressé, il faut lui indiquer ce qu'il est advenu et pourquoi. A quoi peut servir aujourd'hui qu'un surveillant siège au sein de la commission d'application des peines ? Il n'est qu'un alibi. Il ne connaît pas tous les détenus, et l'avis qu'il peut avoir, en fonction du dossier, n'est pas un avis fondé. Il vaudrait mieux disposer de l'avis de l'équipe de surveillants, rapporté par le gradé. En appliquant cette manière de travailler, les choses pourraient se passer complètement différemment. Les surveillants se sentiraient sécurisés et interviendraient dans leur travail. Pourquoi ne pas tenir une réunion de trente minutes, chaque jour, pour faire le point ? Dans la situation actuelle, on pourrait remplacer le surveillant par un robot. » (M. Désiré Derensy, membre de l'union générale des syndicats pénitentiaires CGT) De telles méthodes de travail sont déjà mises en place dans certains établissements ; le projet d'exécution des peines, avec le suivi des détenus par une équipe surveillante constitue un début de responsabilisation de l'ensemble des intervenants en prison. Cette réflexion doit s'accompagner d'une réflexion plus large sur la communication de l'information entre les différents niveaux d'administration et sur la gestion globale. B.─ UN CADRE DE GESTION À RÉORGANISER Une administration opaque, ne sachant pas communiquer, toujours à la remorque des autres administrations de l'Etat et en particulier de celles mettant en _uvre les politiques de sécurité publique... le discours sur l'administration pénitentiaire est souvent stigmatisant voire misérabiliste. Il s'agit pourtant d'une administration qui a connu des évolutions considérables en quelques années. Celles-ci ne sont pas achevées. Il est vrai que les cloisonnements sont nombreux et la communication difficile à faire entrer dans les m_urs. « Les personnels pénitentiaires se plaignent à juste titre de la mauvaise diffusion de l'information et de l'insuffisance de la concertation. En outre, l'opacité de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de l'extérieur est une des causes de la difficulté pour cette institution d'être reconnue à sa juste place par la société. Il ne sert à rien de se plaindre des médias. Tant qu'une institution ne fait que réagir à la demande, le plus souvent à la suite d'incidents, elle ne peut évidemment faire passer aucun message valorisant pour elle-même et ses personnels. Une institution comme l'administration pénitentiaire se doit de produire une communication positive régulière. Ce sera la seule façon de changer progressivement son image. » Ce constat dressé par M. Gilbert Bonnemaison en 1989 reste largement valide. a) Les cloisonnements de l'administration Coexistent, au sein de l'administration pénitentiaire, différentes entités : entité centrale, entités régionales et locales, qui ne marchent pas forcément d'un même pas. Il en résulte un décalage, très fortement ressenti, entre les politiques définies par l'administration centrale et leur application sur le terrain. « Ce décalage va croissant. En effet, on constate un fossé de plus en plus large entre les différents niveaux d'administration, aussi bien sur le fond - la philosophie des réformes, le sens que l'on veut donner à la peine et à la prison - que sur la forme - la méthode, la manière technocratique de les présenter - en oubliant d'ailleurs souvent le corps des surveillants, qui constitue pourtant le personnel le plus important parce que le plus nombreux et situé véritablement au c_ur de la détention, ainsi que les moyens humains nécessaires à la mise en _uvre des réformes. L'administration centrale semble éloignée du terrain qu'elle ne connaît pas forcément bien ; les directions régionales sont si grandes qu'elles ne peuvent parvenir à impulser toutes les réformes et souvent se cantonnent à jouer un rôle de « petit télégraphiste » ou de boîte aux lettres pour la transmission des directives vers les établissements ; enfin, les établissements où les équipes de direction, quand elles sont au complet et qu'il existe une notion d'équipe de direction, ce qui est rarissime, doivent, le plus souvent, gérer toutes les réformes, parfois contradictoires, sans que soient donnés véritablement des contrats d'objectifs à atteindre. » (M. Louis Leblay, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, CFDT-justice) Ce constat pose la question de l'organisation administrative et des modes de gestion des établissements (Cf. 2) Il traduit aussi l'absence de prise en compte du vécu professionnel de ceux qui, à toutes les étapes de la hiérarchie, font, tous les jours, fonctionner les établissements. « Notre vécu professionnel n'est, à aucun moment, hormis en tant que syndicaliste, pris en compte. C'est un véritable problème au vu de la comparaison que l'on peut faire avec d'autres institutions ou ministères. Ce vécu professionnel est aussi un vécu de citoyen, au c_ur de la conception qu'on se fait de la vie. En effet, lorsqu'on est confronté au phénomène de l'incarcération, des prisons et des libertés, on est forcément confronté à l'essentiel de ce qui fait la vie. » (M. Pierre Duflot, adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille et membre du syndicat CFDT-justice) L'intérêt qu'il y aurait à mutualiser les multiples expériences développées par les établissements (organisation de l'accueil des détenus, points d'accès au droit, soutien au personnel après le suicide d'un détenu...) est apparu avec constance dans les contacts établis lors des visites d'établissement. Le désir de connaître et de profiter des innovations est réel, la somme des expériences accumulées est considérable. Ce capital n'est pas exploité comme il le devrait. La non-association des personnels à la conception des nouveaux établissements est à ce titre symptomatique. Pas plus que le personnel médical pour les unités de consultation installées dans les établissements, les surveillants et leur hiérarchie n'ont leur mot à dire, au-delà des consultations des syndicats représentatifs. Il n'est pas inutile de rappeler que le rapport Bonnemaison préconisait, avant chaque projet de restructuration ou de construction neuve, la mise en place, au niveau local, d'un groupe consultatif ad hoc rassemblant des personnels de tous corps et de tous grades, chargés de donner un avis sur les projets, de suivre l'évolution des chantiers et de remettre un rapport final après l'achèvement des travaux. « Cela évitera peut-être à terme les défauts majeurs que l'on constate encore aujourd'hui dans la réalisation des établissements neufs ou dans les travaux d'adaptation. » L'administration centrale fonctionne, au contraire, par des procédures très formelles de remontée de l'information, procédures très centrées d'ailleurs sur les problèmes de sécurité ou d'équipement. Aux demandes d'éléments d'information sur les établissements pénitentiaires formulées par les parlementaires, dans l'objectif de disposer d'un dossier établissement par établissement, des fiches signalétiques par établissement 14 ont été envoyées à la commission. La directrice de l'administration pénitentiaire a indiqué que, au-delà de ces fiches, « ...pour beaucoup d'établissements, nous disposons d'un dossier technique, il s'agit de dossiers de travail, énormes et non synthétiques. Nous disposons de dossiers synthétiques seulement pour certains établissements. En général, ils se trouvent plutôt dans les directions régionales, qui gèrent les crédits de gros entretien des établissements. Une base de données est en cours de constitution à la délégation générale pour le programme pluriannuel d'équipement du ministère de la Justice, qui construit à la fois les établissements pénitentiaires neufs et les tribunaux, pour constituer une base de données des établissements neufs. Nous avons une base de données très technique et sophistiquée. Les établissements anciens n'y figurent pas encore. » La procédure de remontée des informations relatives aux incidents reflète assez bien le fonctionnement fortement hiérarchisé de cette administration, à la fois peu informée et tatillonne. « La gestion des incidents relève en premier lieu de la responsabilité du chef d'établissement. [...] Pour la remontée des informations, en revanche, la prégnance de la hiérarchie est plus forte :tout incident donne lieu à une remontée d'informations vers la direction régionale qui, elle-même, transmet à la direction centrale. La remontée n'est immédiate vers l'administration centrale que pour les incidents les plus graves. Nous avons fixé par écrit une procédure de remontée de l'information, que je pourrai vous adresser, pour les incidents sur lesquels nous voulons être informés rapidement. Personnellement, j'interviens peu sur les incidents. Je sais que certains de mes prédécesseurs intervenaient davantage sur la gestion directe de l'incident au moment même où il se produisait alors que j'estime que nous sommes loin et donc moins bien placés pour agir. Au surplus, il faut responsabiliser l'échelon de proximité qui a en main l'ensemble des données pour agir. En revanche, j'analyse les incidents importants et lorsque j'estime que l'un d'entre eux traduit un dysfonctionnement, je demande un compte-rendu plus détaillé et, le cas échéant, j'envoie l'inspection de l'administration pénitentiaire. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) Le manque d'information est manifeste lorsque l'on parle d'évaluation des actions. La carence la plus critiquable concerne l'absence d'évaluation récente de la récidive par le ministère de la Justice. La dernière étude sur ce sujet porte sur les sortants de prison de 1982 - il y a donc vingt ans - initialement condamnés à trois ans et plus. Un examen a été effectué ultérieurement, en 1988, sur le casier judiciaire 15. Comment, dans ces conditions, élaborer des outils d'insertion, fixer des modalités de prise en charge, mobiliser les personnels qui se plaignent tous de l'absence de retour d'information sur les personnes dont ils ont eu la charge, une fois celles-ci libérées ? Ils investissent finalement à fonds perdus, sans savoir ce qu'il advient des actions qu'on leur demande d'entreprendre. De même, l'analyse du bilan des établissements du programme 13 000 apparaît aussi parcellaire, alors que paradoxalement, des indicateurs ont été élaborés pour suivre les marchés de fonctionnement et que la connaissance qu'a l'administration de ces établissements est plutôt meilleure que celle qu'elle peut avoir du parc classique. Seules existent deux études réalisées dans la perspective du renouvellement des contrats de fonctionnement : l'une portant sur les aspects immobiliers et de gestion, l'autre sur l'organisation du système de soins. Dans le cadre de la réorganisation de l'administration centrale à laquelle il vient d'être procédé, un nouveau bureau a été créé au sein de la sous-direction de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés : chargé du contrôle de gestion et du suivi des politiques afin d'évaluer les dossiers budgétaires de l'année pour chaque direction régionale, il pourra également effectuer des audits sur les établissements ou sur des dossiers transversaux. Cette réorganisation devrait permettre un meilleur suivi. Au moins sur les deux points évoqués, la récidive et les établissements 13 000, la nécessité d'évaluations poussées et régulières est incontournable. b) Des relations conflictuelles avec l'extérieur Il faut, au préalable, souligner que démentant la critique traditionnelle d'opacité de l'administration pénitentiaire, les personnels, les chefs d'établissement, les syndicats ont parfaitement compris et soutenu l'enjeu que constituaient pour leur métier et pour la prison, les travaux de la commission d'enquête. Pas une fois, un député n'a rencontré d'obstacles dans les visites auxquelles il a procédé. Au contraire, elles ont été une occasion précieuse de contact, d'analyse des difficultés et de recueil des propositions. On peut toutefois s'étonner que l'administration centrale ait jugé bon de faire transiter par son intermédiaire le questionnaire écrit adressé aux chefs d'établissement et parfois, comme cela a été relevé, ici ou là, de demander la rectification de certaines mentions. Sans doute, ne faut-il y voir que le symptôme d'un long passé de repli sur soi et de méfiance ... L'enjeu d'une relation normalisée avec l'extérieur est clair. L'article 53 de la recommandation du Conseil de l'Europe sur les nouvelles règles pénitentiaires précise que : « L'administration pénitentiaire doit estimer que l'une de ses tâches majeures est de tenir l'opinion publique constamment informée du rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son personnel, de manière à mieux faire comprendre au public l'importance de leur contribution à la société. » L'administration pénitentiaire française se situe très en retrait de cet objectif, dont la nécessité est par ailleurs affichée. Cet état de fait est manifeste au vu des outils de communication dont elle dispose. « Nous disposons d'un service de relations extérieures, le service de communication et de relations internationales, qui travaille en liaison étroite avec le service d'information et de communication de l'ensemble du ministère. C'est un tout petit service qui, paradoxalement, compte peu de spécialistes en communication mais essentiellement des personnes performantes sur les supports, c'est-à-dire pour la réalisation de documents, moins sur leur contenu. C'est l'une de mes préoccupations et je suis actuellement en train de modifier le service de la communication. Ce n'est pas la première chose que j'ai faite en arrivant, mais cela me semble absolument nécessaire. Certes, nous disposons de bons documents, mais cela ne suffit pas pour bien communiquer. Dans les régions, il existe un petit service chargé de la communication, dont l'efficacité est très variable selon les régions. Au niveau des établissements, personne n'est spécifiquement chargé de la communication. C'est l'un des problèmes de l'organisation des équipes de direction et plus généralement de la gestion des établissements. Il est souhaitable, qu'au sein de chaque établissement, une personne soit spécifiquement chargée de la communication. C'est le cas dans les très gros établissements de la région parisienne, mais pas dans la plupart des établissements. Notre communication repose essentiellement sur les talents individuels des personnes. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) L'administration pénitentiaire pèche particulièrement dans ses relations avec les familles de détenus. Dès lors que se produit une crise, la difficulté de communication va être exacerbée. Le message passe souvent mal, que ce soit l'information relative à l'incarcération elle-même ou bien celle sur l'état de santé du détenu par exemple, et ceci est très mal vécu par les proches déjà confrontés à la séparation, à la perte éventuelle d'un revenu... Les familles ne sont pas toujours informées de la mise en détention. Le même problème existe pour les transferts. Et quand il y a eu un décès en prison, bien souvent c'est face à un mur, « mur de justice et d'injustice » que les proches ont le sentiment d'être placés. « J'ai perdu mon petit frère qui était mineur. Il a été placé au mitard pour une peine de vingt jours, ce qui est inadmissible s'agissant d'un gosse de dix-sept ans. Bien que l'essentiel ne soit pas là, ces enfants sont entrés en prison pour des délits mineurs, même s'ils n'en restent pas moins des délits. Ils sont là pour payer, à aucun moment pour se retrouver victimes. Notre famille était déjà victime par le simple fait d'être pour la première fois confrontée à la prison : aucun membre de ma famille ni aucun de mes proches n'a connu le milieu carcéral. En ce sens, nous étions déjà en quelque sorte victimes. En aucun cas, nous n'imaginions avoir à faire face à un décès, d'autant qu'un mineur de dix-sept ans n'a rien à faire dans un quartier disciplinaire. » [...] En cas de suicide en prison et dès lors que la personne ne décède pas, qu'elle est transportée aux urgences, en réanimation, il y a systématiquement des policiers devant l'entrée - c'est un petit peu le monde à l'envers : ce sont des CRS. Ils prennent sur eux de laisser passer certains membres de la famille, à savoir les frères et s_urs. Parfois, au prétexte qu'ils n'ont pas de permis de visite, ils n'ont pas accès au lit. Alors que les médecins sont catégoriques sur la mort prochaine, l'entrée dans la chambre est soumise au bon vouloir des CRS. Ils nous expliquent bien qu'ils n'ont pas le droit de nous laisser entrer. Que je sache, le directeur a le pouvoir de lever l'écrou ou d'accorder les permis de visite. Dans mon cas particulier, le directeur de la prison a refusé des permis de visite aux frères et s_urs, ce qui peut engendrer de la paranoïa et quelque virulence dans nos propos, comme vous l'avez constaté. Il conviendrait que les procédures soient respectées avant de chercher à les modifier. » (M. Akim Bouafia, association de familles en lutte contre l'insécurité et les décès en détention - FLIDD) Il est clair qu'en ce domaine, les silences sont très mal perçus et l'administration pénitentiaire a un important effort à faire pour que le manque de transparence ne génère pas la suspicion. Le bilan des progrès de la concertation est très contrasté. Au niveau des établissements, en particulier, ses résultats sont très inégaux. Or nombre de revendications nationales résultent en fait de tensions non résolues au plan local. Des progrès ont été accomplis en termes d'outils de concertation. En 1991, ont été créés les comités techniques paritaires (CTP) déconcentrés au niveau des régions, qui ont d'ailleurs connu des débuts difficiles. Depuis 1992, des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux (par établissement) se mettent progressivement en place. Les plus gros établissements ont d'abord été concernés (13 établissements de plus de 300 agents). L'extension aux établissements de plus de 50 agents a été décidée par un arrêté de 1998. Celle-ci est en train de s'opérer. A la fin de l'année, 94 établissements d'au moins 50 agents en seront dotés. Elle suppose toutefois que les mesures d'accompagnement - emplois ACMO (agents chargés de la mise en _uvre), aménagements de locaux, formation du personnel - soient effectives. Par contre, le devenir des conseils d'établissements - organes de concertation non paritaires et dépourvus de droit de vote - a été remis en cause. Ces conseils avaient été créés dans l'objectif d'instaurer un dialogue social hors des normes institutionnelles classiques, dans le but de prévenir et d'apaiser les conflits sociaux potentiels au plus près du terrain. La prévention des conflits est apparue d'autant plus nécessaire que la cessation collective du travail est prohibée, en application du statut spécial. Un arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1999 a annulé ce dispositif pour défaut de base légale. Ces instances avaient soulevé des hostilités syndicales et le poids syndical est un élément incontournable de l'administration pénitentiaire. La demande réside dans la mise en place de véritables comités techniques paritaires locaux. Les conseils d'établissement présentaient, à tout le moins, le mérite de susciter, à période régulière, l'instauration du dialogue dans l'ensemble des établissements, donc de l'améliorer là où celui-ci faisait particulièrement défaut et de le détacher de l'événement ailleurs. L'objectif demeure pertinent. La concertation doit pouvoir reposer sur un support légal, quelle qu'en soit la forme, pour servir d'outil au dialogue sur l'organisation et le fonctionnement des services, les aménagements des locaux, les conditions de travail, la formation... et parvenir, à terme, à des évolutions réelles en matière d'organisation du travail. a) Des directions régionales impuissantes Le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse), à chacune desquelles correspond une direction régionale. Il s'y ajoute une mission de l'Outre-mer dont l'éloignement est vivement ressenti, puisque son siège est implanté à Juvisy. Malgré l'augmentation de la population pénale, celle des personnels pénitentiaires et la multiplication des partenaires, les directions régionales ne sont toujours qu'au nombre de neuf. Les ressorts des directions régionales n'ont pas changé, chaque région pénitentiaire recouvre plusieurs régions administratives. Elles sont aujourd'hui dans l'incapacité de remplir leur rôle. « Ce sont par ailleurs les dernières administrations régionales à assurer à la fois la représentation, l'animation, le contrôle, mais également la gestion des structures locales. Je rappelle que les factures d'épicerie des maisons d'arrêt de Montargis, Tours ou Blois sont traitées à la direction régionale !... A Paris, la direction régionale gère en direct 25 établissements, 14 SPIP 16, et si l'on ajoute la dizaine de cadres travaillant à la direction régionale, cela fait au total une cinquantaine d'interlocuteurs directs. Les partenaires, au surplus, souhaitent toujours rencontrer le directeur régional. Ainsi en 1987, à Lille, je passais dans chaque établissement trois fois par an pour des visites qui duraient la journée. Aujourd'hui, à Paris, je ne passe plus qu'une fois dans chaque établissement. » (M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris) En effet, les directions régionales gèrent entièrement les crédits des établissements pénitentiaires à budget non autonome (123 établissements sur 186), les projets étant soumis à contrôle et autorisation du directeur régional. Outre la déresponsabilisation des chefs d'établissements et la lourdeur comptable qui en découle, compte tenu des effectifs réduits des directions régionales, cette tâche s'effectue nécessairement au détriment des autres. Chaque direction régionale dispose de 100 à 120 personnes, environ, y compris les équipes informatique. Or : « Les directions régionales ont un rôle important dans l'impulsion et la mise en _uvre des réformes... Leur dimension et les insuffisances observées parfois dans les organigrammes font qu'elles ne peuvent pas forcément remplir toutes les missions qui leur sont dévolues. » (M. Louis Leblay, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, CFDT-justice) Outre le fait que la taille des régions pénitentiaires est excessive, leur découpage géographique ne correspond à aucun autre : « Que ce soit l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse ou le service judiciaire, chacune de ces directions a un découpage géographique spécifique, ces trois découpages géographiques étant eux-mêmes différents du découpage administratif. Ceci fait que nous avons quatre découpages géographiques qui se superposent. » (Mme Frédérique Barrault, secrétaire générale adjointe du syndicat CFDT-justice) Un redécoupage et une démultiplication des régions pénitentiaires apparaissent donc comme une étape indispensable. Il ne faudrait pas cependant que cette réforme soit bloquée par le projet de refonte de la carte judiciaire, véritable serpent de mer. La capacité d'action des directions régionales dépend aussi des pouvoirs que l'on veut bien leur confier. L'administration pénitentiaire a engagé un mouvement de déconcentration qui ne fait que renforcer l'enjeu du découpage régional si l'on veut qu'il soit efficace. b) Une déconcentration qui marque le pas Depuis 1990, la direction de l'administration pénitentiaire s'est engagée dans une action de déconcentration progressive en matière budgétaire, puis en matière de gestion (gestion des ressources humaines, de la formation continue et du dialogue social). Ce mouvement est aujourd'hui interrompu alors que la réorganisation de l'administration centrale opérée en 1998, fait en principe de la direction régionale l'échelon relais sur l'ensemble des questions d'ordre opérationnel et de gestion. « S'agissant de la déconcentration, l'administration pénitentiaire a opéré une pause en 1999 et la poursuivra en 2000. Il est en effet difficile de mener plusieurs réformes de structures ou d'organisation en même temps, sauf à courir à l'échec. Nous avons réformé l'administration centrale en 1998, créé en 1999 les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Nous aurons, en 2000, à négocier sur les 35 heures et l'organisation du travail. Nous ne pouvons pas, en même temps, engager une nouvelle étape de déconcentration. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) En fait, pour les directeurs d'établissements : « On a déconcentré aux directions régionales un certain nombre de problèmes plutôt que de leur donner un véritable pouvoir décentralisé. Les directions régionales sont un intermédiaire obligé, mais n'ont pas les moyens de répondre concrètement à notre attente, notamment en matière de gestion des effectifs. Elles ne peuvent que jouer le rôle de courroie de transmission et de mise en exergue de nos problèmes. » (M. Georges Vin, directeur des Baumettes) Comme le souligne le syndicat CFDT-justice : « Les directions régionales n'agissent qu'à la marge, en termes financiers et de moyens humains. Il faudrait une véritable vision régionale d'équipe, tant pour les établissements que pour l'administration centrale ou régionale, afin d'impulser un certain nombre de réflexions. Venant de terminer six mois d'intérim, il me semble que c'est une réelle vision de l'organisation de l'ensemble des établissements qu'il faut impulser à ces niveaux hiérarchiques. Sinon, on se heurte à des blocages, individuels ou collectifs, et on n'avance pas sur la mise en place de l'ensemble des politiques. » (M. Pierre Duflot) La question de la poursuite de la déconcentration, au regard des moyens humains, est clairement posée. La gestion de la région pénitentiaire de Lille qui recouvre deux régions administratives, quatre cours d'appel, quatorze départements et compte 6 200 fonctionnaires et 11 000 détenus, repose sur une dizaine de personnels de catégorie A. Le même problème se pose pour la déconcentration au niveau des établissements. A ce propos, souligne le rapport de gestion 1998 de l'administration pénitentiaire, « L'imprécision des tableaux relatifs au paiement des indemnités pour les personnels occupés à cette tâche, ne permet pas encore d'identifier le coût en moyens humains de la déconcentration. » Son fonctionnement concret est en réalité éminemment dépendant des moyens des directions, mais aussi de la conception qu'elles ont de leur mission. Celle-ci est laissée aux appréciations locales. La directrice de l'administration pénitentiaire le reconnaît d'ailleurs : « Nous avons déconcentré aux directeurs régionaux, non seulement des pouvoirs de gestion et d'affectation, mais aussi l'animation des chefs d'établissement. La pratique des directeurs régionaux varie : certains laissent leurs chefs d'établissement très autonomes contrairement à d'autres. Cela ne dépend pas uniquement de la qualité intrinsèque de tel ou tel chef d'établissement, mais surtout du mode de gestion des directeurs régionaux. Certains sont plutôt des gestionnaires et donc interviennent peu sur la détention ; d'autres, au contraire, sont moins administratifs et interviennent très fortement auprès de leurs chefs d'établissement. » Confier aux directions régionales une véritable mission d'animation, de conseil et de contrôle plutôt que de gestion suppose aussi une évolution des modes de fonctionnement des établissements. c) Une condition préalable : des établissements autonomes porteurs d'un projet ▪ Le projet d'établissement permet de réunir les volontés et les compétences autours d'objectifs affichés et régulièrement évalués. La définition d'un tel projet d'établissement, servant de support aux établissements pour asseoir leurs missions, définir leurs objectifs en permettant l'association des personnels fait encore largement défaut. Le rapport remis par M. Guy Canivet à la garde des sceaux sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires en a souligné la nécessité : « Par ailleurs, les directeurs d'établissement doivent être en mesure d'élaborer et de conduire les politiques sur l'exécution desquelles ils seront contrôlés, de fixer aux personnels les objectifs à atteindre et, à cette fin, de nouer un dialogue social au niveau de l'établissement dans le cadre de projets de service, susceptibles de mobiliser les énergies et porteurs de la plus grande transparence utile au contrôle. » Actuellement, la remise d'une simple lettre de mission fixant des objectifs lorsqu'un directeur est affecté dans un établissement, n'est même pas effectuée par toutes les directions régionales. Au lieu de se fonder sur un projet, les critères d'évaluation de l'activité des chefs d'établissement restent essentiellement centrés sur des impératifs de sécurité. Il n'y a pas réellement d'évaluation, par rapport à des objectifs d'insertion, de mise en place d'activités... alors que justement leur organisation suppose « une prise de risque » qui donnera lieu à sanction le cas échéant. Des progrès sont toutefois mis en avant. « En ce qui concerne les projets d'établissement, la situation s'est considérablement améliorée. Tous les ans, nous pouvons formuler un certain nombre de demandes par l'intermédiaire des programmes régionaux, mais aussi des budgets complémentaires qui constituent un plus par rapport au budget de fonctionnement. C'est par ce biais que nous pouvons faire porter l'accent sur des actions de prévention de la santé, sur des dispositifs de formation professionnelle ou bien visant à une meilleure hygiène. C'est ainsi que nous pouvons avoir une action personnelle, localisée et individualisée. » (M. Georges Vin, directeur des Baumettes) Cependant, une nouvelle fois, les situations régionales sont très variables. « La répartition sur la base du critère des journées de détention n'est pas satisfaisante. Mais il existe, selon l'échelon régional avec lequel on travaille, une possibilité de négociation et de contractualisation sur des projets. Là aussi, le pire et le meilleur se côtoient. Soit la règle mathématique absurde de la « journée de détention » prévaut et empêche toute marge de man_uvre. Soit la possibilité d'une conférence budgétaire régionale est ouverte, qui donne lieu à la présentation d'un projet et à une négociation avec le directeur régional avec explication du projet. C'est une bonne chose. » (M. Jean-Louis Daumas, directeur du centre de détention de Caen) ▪ Monsieur Gilbert Bonnemaison préconisait, en 1989, la création d'établissements autonomes. « L'importance des tâches d'intendance assumées par les établissements pénitentiaires (alimentation et entretien des détenus, mais aussi maintenance du parc immobilier), la diversité des missions qu'ils assurent en vue, notamment, de l'insertion des personnes incarcérées (liaisons avec le privé pour le travail, action conjuguées avec d'autres administrations de l'Etat et des collectivités locales dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de la culture...), les contraintes liées à la gestion des biens et ressources pécuniaires des détenus et l'imbrication de ressources publiques et privées dans les flux de trésorerie, constituent autant d'éléments justifiant une réelle autonomie de gestion. » (Rapport sur la modernisation du service public pénitentiaire) La loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire a fourni le moyen d'une véritable déconcentration en permettant que les établissements pénitentiaires soient érigés en établissements publics administratifs nationaux. Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie comptable, ils seraient dirigés par un conseil d'administration. Cette possibilité n'a jamais été utilisée. L'administration pénitentiaire considère que la structure d'établissement public serait trop lourde pour la plupart des établissements auxquels elle n'apporterait pas d'amélioration mais entraînerait des charges administratives supplémentaires. Le choix a été fait de développer des modes de gestion plus autonomes, dans le cadre des structures actuelles. Les établissements dénommés « autonomes » peuvent bénéficier d'une plus grande autonomie comptable et de la possibilité de globaliser les dépenses. Seul aujourd'hui, un tiers des établissements bénéficie de ce statut (63 établissements parmi les plus grands). Les établissements à budget non autonome, comme le soulignait M. Gilbert Bonnemaison, ne maîtrisent aucun moyen d'action, ni en termes de fonctionnement ni d'équipement. « La lourdeur comptable qui en résulte confine à l'absurde, dans la mesure où elle est largement incomprise de ceux qui l'utilisent et où elle induit des lenteurs dommageables dans la mise en place des crédits. » Il est vrai que cela suppose que des postes d'agents comptables soient créés et effectivement pourvus ! Mais les chefs d'établissement doivent pouvoir être dotés d'une marge de man_uvre assortie des contrôles nécessaires. D'ailleurs, le rapport remis par M. Guy Canivet en souligne la nécessité : « Il est à craindre que le contrôle extérieur ne puisse avoir l'efficacité recherchée, en l'état des moyens budgétaires, de la gestion mise en _uvre et de la faible latitude laissée aux responsables d'établissements. » ▪ Il est, en tout cas, un objectif qu'une simple déconcentration comptable ne saurait remplir, c'est celui de l'indispensable association de ceux qui, extérieurs à la prison, doivent pourtant en tenir compte dans leur action. L'opacité, éternellement dénoncée, de la prison peut se lire à front renversé. Les difficultés de mobilisation par les établissements pénitentiaires de ceux qui sont leurs partenaires naturels sont quotidiennes, la prison n'étant presque jamais une priorité de l'action de ces derniers. L'exercice formel de la commission de surveillance, malgré son élargissement à de nouveaux intervenants (gendarmerie, directions départementales de la jeunesse et des sports, de la sécurité publique et le cas échéant de la protection judiciaire de la jeunesse) ne saurait remplir ce rôle. La mise en place d'établissements publics offrirait la possibilité de réunir dans un conseil d'administration les responsables d'autres administrations de l'Etat, les magistrats, les représentants des personnels, les élus locaux... Les enjeux sont là : institutionnaliser le dialogue avec les personnels, donner des marges de man_uvre financières, responsabiliser les équipes et faire participer des personnes extérieures à la gestion des établissements. La question de la transformation des établissements pénitentiaires en établissements publics doit être reposée, en concertation avec les personnels. La définition de véritables projets d'établissement est, en tout état de cause, un préalable indispensable à la remobilisation autour d'objectifs définis en concertation. III.- REPENSER LA PLACE ET LA MISSION DE LA PRISON A.- L'EXIGENCE D'UNE RÉFLEXION SUR L'INCARCÉRATION Le sens à donner à la peine, à ce qu'on voudrait qu'elle soit, se trouve au c_ur de la problématique sur l'univers pénitentiaire ; c'est cette question, et la réponse qu'on lui apporte, qui va déterminer le regard du citoyen sur la prison, le regard du détenu sur son temps de détention et le regard du personnel pénitentiaire sur les missions qui lui incombent. Il faut préciser en premier lieu que la sanction et l'enfermement sont deux notions qui ne se recouvrent pas: il peut y avoir sanction sans enfermement avec le prononcé d'amendes ou de mesures alternatives à l'incarcération et également, avec l'exemple de la détention provisoire, enfermement sans le prononcé de sanction. En s'interrogeant sur la signification de l'enfermement, on ne cherche pas à dénigrer le rôle de la sanction, indispensable à la recherche de la cohésion sociale ; il s'agit plutôt de s'interroger sur la place de l'enfermement dans l'échelle actuelle des sanctions en rendant plus crédibles aux yeux des citoyens, des magistrats et également du législateur les peines si improprement appelées « peines de substitution ». Au-delà de cette précision, il s'agit de savoir ce que l'on attend du prononcé d'une peine afin de pouvoir justifier de l'enfermement. La question fondamentale qui se pose lorsque l'on réfléchit au sens de la peine est de savoir si l'on doit punir un acte ou une personne. De la réponse qui sera donnée, dépend la question de l'utilité de la prison et du temps de la détention car punir un acte implique que l'on sanctionne le fait par l'expiation ou la rétribution. Ce rétributivisme classique, prôné notamment par Kant 17, exige en définitive, dans un raisonnement rigoureux, la réhabilitation de la loi du talion et la peine de mort. Punir un homme, c'est considérer qu'on peut le corriger, le normaliser ou le réinsérer ; c'est également considérer, vis-à-vis du monde extérieur, qu'il faut dissuader les éventuels criminels et protéger la société. Les deux conceptions s'opposent radicalement dans leur rapport au temps, alors même que celui-ci est une donnée fondamentale lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'institution carcérale. Les partisans de la punition de l'acte considèrent celui-ci comme absolument déterminant. Dans la gestion du temps de la détention, la recherche d'une juste mesure entre l'acte et la peine conditionne le temps de la sanction. Le temps de la sanction écoulé, l'individu aura réglé ses dettes envers la société. En revanche, les partisans de la punition de l'homme considèrent l'acte délictueux ou criminel comme un fait échu sur lequel on ne peut et on ne doit pas revenir. La sanction doit être résolument tournée vers l'avenir. La question essentielle n'est plus de punir, mais de sanctionner pour que le criminel ne recommence pas. Ces deux conceptions rejoignent finalement les termes de la controverse entre Tocqueville 18 et Lucas 19 partis étudier le système pénitentiaire américain au XIXème siècle : pour Tocqueville, la transformation des individus n'est qu'un objectif secondaire face à la souffrance qui doit être infligée dans une perspective rétributiviste et dissuasive. Pour Lucas, l'amendement de l'individu doit être le principe d'un enfermement fondé sur une discipline rigoureuse qui récompense les progrès et la bonne conduite. Le problème que pose le sens de la peine est qu'elle a toujours combiné les deux conceptions de la punition. Aucune peine n'est prononcée dans l'indifférence du fait criminel ; aucune peine n'est appliquée sans une visée téléologique d'amendement et de récidive. La peine est un concept complexe qui échappe à toute classification systématique. Tout au plus est-il possible de distinguer une philosophie dominante dans un système pénal. Ainsi, le système en vigueur dans de nombreux états américains est visiblement fondé sur une conception de punition de l'acte sans considération de l'individu. Outre la peine de mort qui constitue le sommet d'une telle conception, des juridictions pénales disposent également de « guidelines » qui codifient très précisément les sanctions, et instituent une tarification très rigoureuse dont il est extrêmement difficile de s'écarter. La personnalité de l'auteur de l'infraction, son contexte familial, le contexte social, économique et culturel ne sont absolument pas, ou très peu pris en compte. A l'opposé, la réforme de la politique pénale, dite réforme « Amor » mise en place en France en 1945 prônait la nécessité pour la peine de participer à la « réformation » du délinquant. Elle affirme ainsi dans son premier principe que « la peine privative de liberté a pour but essentiel l'amendement et le reclassement du condamné ». C'est en réadaptant l'individu que l'on assure la protection de la société et que l'on prévient la récidive. Le Canada a clairement opté pour cette conception. L'article 3 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de 1992, définit ainsi la mission du système correctionnel (le terme est d'ailleurs significatif comparé à notre système dit « pénitentiaire ») : « Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés, dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. » Le système français actuel n'a pas véritablement tranché en faveur de l'une ou l'autre conception ; il faut déplorer que le débat sur le sens de la peine ne soit pas un enjeu du débat politique. L'administration pénitentiaire se trouve dès lors obligée de gérer un système sans pouvoir s'appuyer sur une véritable définition de ses missions. b) la peine, moyen de réparation pour les victimes et de protection de la société Il s'agit ici de réaffirmer la mission de la prison comme moyen de neutraliser le délinquant. Il y a vis-à-vis de la victime un devoir de réparation et vis-à-vis de la société un devoir de protection. La réflexion sur la prison doit nécessairement prendre en compte ces deux missions et ne jamais oublier l'impératif de sécurité qui s'y attache. La dangerosité est une réalité du monde carcéral et les visites des membres de la commission d'enquête dans les établissements pénitentiaires ont permis d'appréhender le climat parfois pesant, tendu de la détention. Un excès d'angélisme serait aussitôt taxé de laxisme ; mal comprise par l'opinion, cette attitude ne pourrait de plus que rendre la mission de l'administration pénitentiaire plus difficile encore. La prise en compte de la douleur des victimes ou des familles des victimes doit être prioritaire dans la réflexion sur la sanction et dans les décisions des magistrats. Elles doivent être informées des décisions prises par le juge d'application des peines à l'égard de l'auteur de l'infraction. Il serait également erroné de faire du détenu une victime, victime de sa condition sociale, victime de sa détention. Si l'on veut responsabiliser le délinquant pour le préparer à sa future réinsertion, il faut nécessairement le placer lui-même en position d'assumer sa propre responsabilité vis-à-vis de son acte. Faire du détenu une victime ne peut qu'obérer sa capacité à s'amender. c) Le sens de la peine, enjeu fondamental du débat démocratique et politique Au-delà de l'impératif de neutralisation, il faut être conscient que la question du sens de la peine et des réponses qu'on lui apporte traduisent les valeurs fondamentales d'une société. Dès lors, cette question ne doit pas uniquement se penser en termes de réponse à apporter à la victime ou de sanction du condamné ; elle doit intégrer l'ensemble du corps social en reflétant un consensus minimal. Qu'en est-il aujourd'hui du sens de la peine dans l'opinion publique ? L'opinion paraît en appeler aujourd'hui à des sanctions toujours plus sévères, à la fois contre les « incivilités » quotidiennes et contre les « délinquants sexuels » considérés comme les auteurs des infractions les plus monstrueuses. Les dispositions législatives traduisent cette demande de fermeté en instaurant des peines toujours plus longues et des périodes de sûreté pendant lesquelles il ne peut y avoir d'aménagement de peine, pouvant aller jusqu'à trente ans. En l'occurrence, le législateur n'a fait qu'adapter les textes à une demande de sécurité accrue de l'opinion publique dans un contexte de crise économique et sociale. Comme l'a observé M. Robert Badinter lors de son audition durant la commission d'enquête : « La question de la responsabilité du législateur dans l'allongement des peines ne peut être mise en cause pour les raisons que je viens d'évoquer : alors qu'en décembre 1981, nous nous situions à un étiage d'environ 29 000 détenus, en 1986 il était passé à 41 000. A l'époque, le nouveau code pénal n'était pas encore voté. J'ai présidé le comité qui l'a élaboré ; le projet fut déposé en janvier 1986 ; il a été élaboré au cours de la législature entre 1990 et 1992 pour entrer en vigueur en 1993. Il serait donc singulier d'attribuer au code pénal les phénomènes d'inflation dans les prisons auxquels nous avons assisté sans discontinuer [...] » « Que ce soit du côté des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises, la durée des peines prononcées n'a cessé de s'allonger. Cela ne signifie pas que le plafond est toujours atteint, mais qu'une tension sociale appelle à la répression, caractéristique d'époques de crise économique. J'évoquais le fait que le nombre le plus bas de détenus se situait immédiatement après la guerre de 1914. Entre 1904 et 1912, la France se porte extrêmement bien et les mécanismes d'insertion sociale et d'intégration fonctionnent que ce soit les associations sportives, les syndicats, les associations d'aide aux étrangers ou les mouvements religieux. La famille est une institution encore très forte et je n'ai pas besoin de préciser ce qu'est l'armée républicaine ! C'est un élément insuffisamment pris en compte, mais qui joue en termes de prévention. Ce n'est pas dans les textes que vous trouverez la raison de l'inflation carcérale, mais dans la pratique. » Cette demande de sécurité a conduit à placer la neutralisation du délinquant, pendant une période de plus en plus longue, comme mission prioritaire de l'administration pénitentiaire. Elle ne fait de la mission de réinsertion ou d'amendement qu'une question secondaire ; dès lors, le problème de la détention et de l'utilisation du temps de la détention n'est pas analysé ; de là s'ensuit l'idée que la prison est faite pour souffrir et qu'un prisonnier ne peut être mieux traité que n'importe quel individu vivant à l'extérieur. L'analyse de M. Robert Badinter devant la commission d'enquête est tout à fait éclairante sur le sujet : « J'en arrive à ce qui domine, à mon sens, le problème. Une loi d'airain pèse sur la prison. Je l'ai appelée « loi d'airain », car je ne l'ai jamais vue démentie : vous ne pouvez pas, dans une société démocratique déterminée - je ne parle pas des prisons totalitaires, car l'idée même de respect de la dignité humaine n'existe pas - porter le niveau de la prison au-dessus du niveau de vie du travailleur le moins bien payé de cette société. Le corps social ne supporte pas que les détenus vivent mieux que la catégorie sociale la plus défavorisée de la société. En effectuant des voyages pénitentiaires, on constate que les pays où l'on trouve des prisons décentes sont des pays du nord de l'Europe, avec une très forte conscience sociale et un niveau d'égalité sociale très poussé, où les garanties données aux catégories sociales les moins favorisées de la société sont très élevées. Ce n'est pas sans raison si les meilleures prisons d'Europe se situent en Suède, en Hollande ou en Norvège : la loi d'airain fixe le niveau très au-dessus du nôtre ... » « Dans la société française - et en général dans toutes les sociétés marquées par une empreinte profonde du catholicisme - prévaut l'idée que la prison est un lieu fait pour souffrir. Durkheim a écrit des pages admirables sur la peine il y a un siècle ; depuis, rien n'a été fait de mieux sur la peine que l'analyse de Durkheim 20. Le crime, le délit grave, le délit tout court engendrent une réaction sociale, laquelle pour s'apaiser appelle une sorte de compensation sous la forme d'une souffrance de celui que l'on identifie comme l'auteur du trouble apporté à la collectivité. Une liaison s'est opérée entre prison et souffrance, car la prison est une peine et que la peine signifie douleur. Quand j'entends de grandes autorités déclarer que la prison n'est que la privation de liberté, je souris toujours intérieurement : d'une façon non dite mais ressentie, il en va différemment. La prison est un lieu de peine, ce n'est pas qu'un lieu de privation de liberté. Je rappelle ces réactions qui surgissent lors de grands progrès carcéraux : « Il n'y en a que pour eux », le quatre étoiles, la télévision et le reste ! La pédagogie a un rôle important mais elle est difficile à faire entendre. Il y a des périodes favorables et des périodes défavorables : périodes favorables quand survient, comme maintenant, une prise de conscience de la réalité des prisons. Ces périodes cessent par le jeu des circonstances ; que survienne une prise d'otage, qu'un gardien soit, hélas victime d'un grave attentat dans une prison et aussitôt le climat change. Il existe donc des moments pendant lesquels on peut agir. Je pense que nous sommes à l'un de ces moments, mais qu'il est à la merci d'un incident qui peut survenir à tout instant, car la prison est un monde de violence, d'épreuve de forces ; tout peut y advenir à tout moment ; c'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté de la gestion des prisons par les services de l'administration pénitentiaire. » Or l'abolition de la peine de mort en 1981 impose que l'on réfléchisse à la façon de punir les crimes les plus odieux et à ce que l'on attend de la prison. Priver quelqu'un de liberté à perpétuité, c'est le faire mourir lentement ; l'opposition de principe à la peine de mort implique au contraire que la société envisage à terme la réintégration de ceux qui semblent définitivement exclus par l'atrocité ou la répétition de leurs crimes. « L'abolition de la peine de mort et les débats de qualité qui eurent lieu à l'époque ne permettent plus aujourd'hui de débattre des peines alternatives à la peine de mort. La mise en place de peines de sûreté pour les peines à temps prononcées depuis ou pour les réclusions criminelles à perpétuité n'a donné lieu qu'à très peu de réflexions. Il en a été singulièrement de même pour la mise en place d'une peine qui me paraît irréaliste : la peine incompressible de trente ans. A Ensisheim, cinq détenus sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de périodes de sûreté de trente ans. Je ne sais comment gérer ce désespoir ni comment les condamnés arrivent à survivre avec cette absence de perspective. Cet arsenal répressif mis en place vise, en réalité, plus ou moins une exclusion définitive. Ceci est suffisamment grave pour rendre nécessaire, à nouveau, une analyse des possibilités de faire valoir une évolution du comportement d'une personne condamnée, pour que cela puisse influer sur la perspective d'un projet de sortie et de l'accompagnement nécessaire. » (Mme Valérie Decroix, directrice de la maison centrale d'Ensisheim) L'abolition de la peine de mort doit dès lors se traduire par une conception exigeante de la société envers le système pénitentiaire. Il serait profondément hypocrite d'abolir la peine de mort sans changer les conditions de détention, sans envisager la réintégration sociale et sans accepter aussi les risques sociaux que suppose cette réintégration. Envoyer quelqu'un en prison est encore trop souvent perçu comme l'unique moyen de soulager la victime et d'apaiser le corps social. Tout se passe comme si l'on ne voulait pas savoir ce qui adviendra après, après la phase du procès, après la condamnation. La prison est conçue non pas comme un lieu où l'on va amender le délinquant, voire le guérir, mais comme un trou noir où l'on s'en débarrasse, un moment de non-vie. On rejoint ici actuellement la conception de la peine comme sanction d'un fait et non d'une personne. La prison permet de reléguer le délinquant et elle occupe à cet égard dans l'imaginaire collectif les mêmes fonctions que la peine de galères sous l'Ancien régime ou de transportation au XIXème siècle : on ne sait pas le réintégrer. M. Nicolas Frize, responsable de la commission prison de la Ligue des droits de l'Homme, a posé la question en ces termes devant la commission d'enquête : « Indépendamment de son aspect symbolique, il faut s'interroger sur le sens de cette durée. Quel est le sens de la peine ? Je propose de mener une action positive pendant une durée plus courte. Si on ne fait rien faire aux détenus et si on les « casse », il faut recourir à des peines de quarante ans. Je me demande même si on ne devrait pas alors les laisser en prison toute leur vie, car il serait préférable qu'ils ne sortent pas. Mais si on entreprend une action positive, la détention peut être plus courte. Il faudrait d'ailleurs que les peines soient plus courtes, car plus elles durent et plus ce que l'on fait de bien se détruit de lui-même, par la déstructuration de l'individu. Je vous renvoie à des études réalisées par des psychanalystes qui indiquent qu'après onze ans de détention, les séquelles sont irréversibles. Je pense profondément qu'il faut cesser de condamner à de longues peines sans contenu. Il faut donner du contenu à la peine et en diminuer la durée. M. Renaud Donnedieu de Vabres : Pensez-vous que l'on peut être suffisamment optimiste sur la qualité de votre travail, que je ne remets évidemment pas en cause, pour que l'on puisse entrer dans cette logique de raccourcissement de certaines peines lorsqu'il s'agit de cas particulièrement graves ? M. Nicolas Frize : Lorsqu'une personne reste vingt ans en prison, on peut penser que pendant ce laps de temps la société est protégée quitte à ce que la personne, soit détruite. Mais cette personne sortira. Indépendamment de l'indignité dont vous êtes l'auteur en la détruisant, il faut savoir que cette personne, lorsqu'elle sort, est très hautement déconstruite et qu'alors la société court des risques très importants. Que faut-il faire dans les prisons pour qu'elles nous garantissent, d'autant qu'elles coûtent fort cher, des résultats tangibles en matière de restructuration et de réparation des personnes ? On constatera, alors, que l'on n'a pas besoin de longues peines d'autant que l'action engagée sera contradictoire avec la destruction que celle-ci entraîne. » M. Ivan Zakine, membre du Comité européen pour la prévention de la torture a resitué cette exigence de réintégration du condamné, et des conséquences qu'elle implique pour les conditions de détention, dans sa perspective historique : « La prison est une notion relativement moderne dans notre société. En effet, c'est la révolution de 1789 qui a fait de la prison un mode d'exécution des peines ; elle ne servait auparavant qu'à la détention provisoire et à la rétention des dettiers, c'est-à-dire ceux qui ne payaient pas leurs dettes. A partir de ce moment-là, une nation, une société a l'obligation de respecter un minimum de règles à l'égard de l'homme ou la femme placé en prison, puisque, par hypothèse, on a décidé que ces personnes réintégreraient au bout d'un certain temps la communauté nationale, ce qui n'était pas la conception de la transportation. Il faut réaliser qu'une telle décision a un coût ; une prison et des places de prison sont plus coûteuses qu'un banc sur une galère qui vogue sur l'océan ou, comme on disait à l'époque « un hamac en Nouvelle-Calédonie ». Définir le sens de la peine, réfléchir à ce que l'on veut que soit la prison implique un effort de pédagogie ; il semble nécessaire dans cette optique que le débat démocratique puisse avoir lieu, loin de toutes contingences liées à telle ou telle affaire et dépouillé de toute démagogie. Il faut dans ce contexte que le Parlement se saisisse du sujet ; comme on le verra, l'administration pénitentiaire est aujourd'hui régie par le décret, la circulaire et les notes de service. Il est indispensable que la politique réinvestisse le champ du sens de la peine et des missions attribuées à la prison. Faute de quoi, la technique et l'administratif se substitueront au débat démocratique et relégueront la question de la prison à des impératifs de coût et de gestion. d) Le sens de la peine, enjeu fondamental pour le détenu La question du sens de la peine est absolument fondamentale pour le détenu. Les visites effectuées par les membres des commissions d'enquête dans les maisons centrales ou les centres de détention nationaux ont permis de constater le désarroi face à la longueur des peines. Il est indispensable que le détenu comprenne pourquoi il est là ; sans la réponse à cette question, il ne peut envisager d'amendement et encore moins de réinsertion. Ce qui fait qu'un condamné s'engage vraiment dans une réflexion sur le rapport à la loi dépend de conditions multiples et complexes. En premier lieu, il ne peut y avoir d'adhésion à la peine que s'il y a eu adhésion au procès. Comme l'a dit Me Teitgen, bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris : « Il faut également comprendre que l'exemplarité de la peine, c'est aussi l'exemplarité du procès. Si aujourd'hui vous allez dans les juridictions correctionnelles parisiennes, vous constaterez qu'il n'y a plus d'exemplarité du procès et qu'il ne peut plus y en avoir. Les rôles sont surchargés ; le rôle de la 23e chambre - qui est une juridiction de comparution immédiate - compte une soixantaine d'affaires par jour. Une juridiction correctionnelle de droit commun va traiter dix ou quinze affaires par jour ; en conséquence la personne qui comparaît devant le juge vit son procès comme quelque chose d'assez banal ; la procédure va très vite et cela devient incompréhensible pour la personne poursuivie. On se rend compte, finalement, qu'il y a peu d'exemplarité du procès parce qu'il y a une banalisation, les magistrats n'ayant pas le temps d'organiser un procès qui constituerait un rappel à la loi. » S'il n'y a pas exemplarité du procès, la sanction risque d'être mal comprise et être perçue comme arbitraire. Cette conception de la peine implique également que soit limitée au maximum la détention provisoire. Celle-ci ne peut en aucun cas préparer le détenu à la réinsertion et à l'amendement. Dans une situation d'attente, le prévenu ne peut rien reconstruire. C'est ce qu'a observé M. Nicolas Frize dans son intervention : « La situation des prévenus est ingérable, en ce sens qu'une personne exécute de fait une peine qui n'a pas été prononcée. Elle ne comprend donc plus ce qu'est la peine, mais elle est exposée comme victime. En attente d'être jugée, elle est déjà victime. Dès lors, elle est incapable d'assurer la responsabilité de son délit, d'accompagner l'instruction, c'est-à-dire d'adopter une position constructive avec le juge dans la découverte de la vérité. Elle est incapable d'assumer son acte, car elle est mise en opposition frontale et violente avec l'institution. Parce qu'elle est déjà considérée comme coupable, mais surtout, parce qu'elle n'est pas encore coupable, elle est victime. Avec les prévenus, il est impossible de gérer la peine ni de rien entreprendre, d'autant que les inscriptions scolaires, les formations professionnelles ou le travail ne sont pas possibles, puisque les détenus sont en situation d'attente et se rendent régulièrement à l'instruction. Tout ce que la prison génère comme ruptures est pour eux injuste et rien, par conséquent, ne peut se construire. Dès lors qu'ils sont condamnés, même pour de courtes peines, on peut dans les maisons d'arrêt, entreprendre quelque chose, car la peine a du sens. Elle a été prononcée et elle s'applique. » La question du rapport à la peine et de sa signification pour le condamné se pose également dans le cas de courtes peines. Effectuées dans des maisons d'arrêt trop souvent surpeuplées, dans des conditions de détention insupportables, ces peines ne peuvent être perçues comme un véritable rappel à la loi. Elles sont au contraire souvent vécues par une population jeune, déshéritée et entrée dans un cycle de délinquance, comme la confirmation et l'aboutissement d'un processus définitif d'exclusion de la société. Elles cassent le délinquant sans lui donner les clés de sa réinsertion. A la question de l'utilité des peines inférieures à six mois, M. Francis Teitgen a répondu de manière très symptomatique qu'elles servaient d'abord à rassurer la société ! Il a ajouté à ce sujet : « Les courtes peines d'emprisonnement n'ont aucun sens ; il n'y a pas de mécanisme de réinsertion possible dans des délais aussi courts, pas de pédagogie possible, pas de formation professionnelle possible. Par conséquent, ces courtes peines sont totalement inutiles. » Enfin, et surtout, les conditions d'adhésion du condamné au système carcéral, conditions indispensables à une future réinsertion, ne sont remplies que si les conditions de détention sont dignes d'un état démocratique et conformes à un Etat de droit. Il ne peut être exigé du détenu de respecter à sa sortie les règles de la société, si le fonctionnement de l'institution carcérale n'a pas lui-même respecté le détenu en tant que sujet de droit. « Il faut convenir que, dès lors que la privation de liberté est un mode de sanction d'une infraction, il appartient à la nation d'améliorer les conditions de vie des détenus... Je dis qu'à tout le moins les conditions matérielles de vie dans la prison doivent être telles que celui qui en sortira inéluctablement, puisque telle est l'option prise, ne soit pas un révolté contre la société ; il ne faut pas que celui qui a connu la prison veuille faire payer le temps qu'il y a passé, au motif qu'il y a subi des conditions de vie indignes d'une société évoluée comme la nôtre. » (M. Ivan Zakine) Pour réaliser cet objectif d'adhésion du condamné au système pénitentiaire, une définition claire des missions de l'administration pénitentiaire s'avère déterminante. e) les missions de l'administration pénitentiaire C'est la définition du sens de la peine et sa conception par l'opinion publique qui circonscrivent les missions de l'administration pénitentiaire. Le désarroi exprimé par le personnel de surveillance lors des visites d'établissements pénitentiaires traduit un manque de visibilité dans la définition de ces missions. Ce personnel souffre d'une perception de la prison conçue désormais comme un lieu de relégation, lieu d'accueil ultime d'une population de plus en plus en rupture avec les règles de la société. La prison comme l'aboutissement d'échecs successifs d'institutions comme la famille, l'éducation ou l'hôpital, est une réalité ; elle ne doit pas cependant être uniquement assimilée à ces échecs, faute de quoi elle ne peut que susciter le découragement. C'est pourquoi il est nécessaire de redéfinir par la loi les missions dévolues à l'administration pénitentiaire. La loi du 22 juin 1987 a fait une première tentative en énonçant, dans son article 1er, que « le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sanctions pénales et au maintien de la sécurité publique ; il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ; il est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines. » Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 20 janvier 1994, a précisé la hiérarchie de ces missions : « l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. » Alors qu'il existe en matière de sécurité une obligation de résultat, il ne semble y avoir qu'une obligation de moyens (« préparer l'éventuelle réinsertion ») pour la réinsertion. En fait, la dichotomie entre mission de sécurité et mission d'insertion est beaucoup plus factice qu'il n'y paraît ; la garde du détenu sans l'objectif de le réinsérer induit la récidive. Il faut dès lors redéfinir les missions de l'administration pénitentiaire pour lier de manière indissociable garde et insertion. Ce constat est partagé par l'ensemble des institutions et personnes intervenant en milieu pénitentiaire. Reste, bien entendu, à la suite de la définition de ces missions, la question des moyens. 2.- La place de la prison dans la cité La réflexion sur la place de la prison dans la cité est bien évidemment une suite logique de la réflexion sur le sens de la peine ; si l'on veut parier sur une réintégration à plus ou moins long terme du détenu dans la société, il est indispensable de maintenir les liens entre l'intérieur et l'extérieur. « Les liens sont le moyen de garantir que la personne est immobile physiquement, mais cela ne doit pas se traduire par une immobilité affective, psychologique, économique, matérielle, intellectuelle ». (Nicolas Frize) a) la place de la prison dans la ville Il s'agit en premier lieu d'assurer une continuité territoriale et géographique : comme l'a observé Me Teitgen, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris « La prison de la Santé, qui est l'une des rares prisons construites en ville, est une prison depuis laquelle les détenus entendent les bruits de la ville, tels que par exemple les coups de klaxon ; ils ont donc le sentiment d'être dans la ville et non pas à l'écart de tout. Ce n'est pas le cas pour ces prisons construites dans les années 70 - comme Fleury-Mérogis - loin des villes ; les détenus ont là un sentiment d'enfermement dans tous les sens du terme, et d'enfermement dans l'enfermement. » [...] Pour ma part, je considère qu'il est extrêmement important que des prisons soient construites en ville - et la Santé est au c_ur de la ville. L'existence d'une prison en ville permet aux citoyens de ne pas occulter le phénomène de la prison. Par ailleurs, cela facilite les visites des familles. Votre commission doit impérativement aller à Denfert-Rochereau les jours où les familles des détenus prennent les autobus de l'administration pénitentiaire pour se rendre à Fleury-Mérogis - sachant que nombre d'entre elles viennent de banlieues ! Certaines d'entre elles sont obligées de prendre leur journée pour une seule heure de visite ! C'est la raison pour laquelle j'estime que les prisons en ville sont importantes, et qu'il serait bon que nous arrivions à conserver la Santé à Paris, même si cela nécessite des travaux importants. Rejeter les prisons hors de la ville, c'est faire perdre à nos concitoyens la conscience de l'existence même du monde carcéral. » Les visites d'établissements tels que celui de Joux-la-Ville ont confirmé cette impression : la construction d'établissements en pleine campagne est un véritable désastre. Elle a certes présenté des avantages en termes de coût du terrain. Elle conforte également l'opinion publique dans sa volonté de nier l'univers carcéral et de reléguer la prison dans un no man's land quelque peu réconfortant. Elle offre également des avantages certains en termes de sécurité : les visites d'établissements à Rennes ou Loos ont ainsi montré que la proximité voisine de la rue se traduit par l'envoi de paquets aux contenus divers (drogues, téléphones portables...) qui suscitent des inquiétudes réelles et justifiées de la part des surveillants. Il n'en reste pas moins, malgré ces inconvénients indéniables, que maintenir la prison dans la ville doit demeurer un impératif. Sans la proximité de la ville, c'est toute la politique de réinsertion, d'emploi, de maintien des liens familiaux qui est réduite à néant. Comment amener les entreprises à donner du travail lorsque le coût du transport du matériel et de la production annihile les avantages financiers qu'elles peuvent retirer du travail en prison ? Comment persuader les familles de maintenir leur visite lorsqu'une visite d'une heure et demie exige de se libérer une journée entière et requiert des moyens financiers permettant de payer un taxi pour une distance de cent kilomètres ? Comment convaincre les étudiants du GENEPI, notamment en période d'examen, de venir passer une journée ? A cet égard, le sort de la prison de La Santé devrait être rapidement tranché dans le sens du maintien de cet établissement pénitentiaire - le dernier et le seul - à Paris. La prison à la campagne confirme l'exclusion dans l'exclusion. Ajoutons pour finir qu'elle n'offre même pas les garanties que l'on serait en droit d'attendre en matière de sécurité :la visite de Joux-la-Ville a ainsi confirmé que la situation excentrée de la prison n'empêchait pas toutes sortes de trafics avec l'extérieur. De même Clairvaux, centrale construite hors du monde puisque sur l'emplacement de l'ancienne abbaye, a connu dans le passé les problèmes de sécurité aux conséquences dramatiques auxquels l'isolement et les conditions de vie qu'il implique n'étaient sans doute pas totalement étrangers. La famille du détenu ne doit pas être traitée comme si elle était responsable au même titre que lui de l'infraction commise, comme c'était le cas dans la justice d'ancien régime. Or les courriers reçus par la commission montrent que, parfois, les familles ne sont pas traitées convenablement par les responsables de l'administration pénitentiaire alors même que la famille subit de toutes façons les effets de l'incarcération. Les conséquences dommageables de l'incarcération pour ses membres sont certes difficiles à éviter. Elles n'en sont pas moins choquantes, surtout lorsqu'il s'agit de prévenus. Par ailleurs, le maintien des liens familiaux constitue une donnée essentielle pour la future réinsertion des condamnés. Ce maintien se heurte néanmoins à des obstacles matériels souvent démesurés pour des familles défavorisées. Le premier de ces obstacles est l'éloignement du détenu ; selon l'article D.53 du code de procédure pénale, l'affectation dans une maison d'arrêt dépend du ressort du siège de la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle le prévenu est appelé à comparaître. Cette situation obéit bien évidemment à des contraintes liées à l'instruction de l'affaire, l'autorité judiciaire pouvant demander l'extraction du prévenu chaque fois qu'elle l'estime utile. Il faut néanmoins s'interroger sur les conséquences psychologiques qu'une telle disposition implique pour le prévenu. La mission effectuée par la commission d'enquête dans les départements d'outre-mer a ainsi eu l'occasion de constater l'état de dénuement total dans lequel se trouvaient certains métropolitains, notamment des femmes, arrêtés en Guyane ou aux Antilles pour des affaires liées à des trafics de stupéfiants. La rupture totale de liens familiaux provoquée par l'éloignement constitue, particulièrement dans le cas de femmes ayant des enfants, un véritable traumatisme. Ce dernier est d'autant plus aggravé que les prévenus ou les condamnés, dans les maisons d'arrêt, n'ont pas le droit de téléphoner. Un remède pourrait être trouvé dans le recours aux nouvelles technologies, à l'image de ce qui se passe au Canada, où des salles de vidéoconférences existent dans certains établissements. L'éloignement des départements et territoires d'outre-mer représente bien évidemment un cas de figure très particulier. Il n'en reste pas moins que la demande de transfert pour rapprochements familiaux est un leitmotiv formulé de façon lancinante dans toutes les visites des maisons d'arrêt. Le cas des établissements pour peine est plus particulier : s'ajoute au problème de l'éloignement, la question de la durée de détention. Il semble exister de la part des détenus condamnés à de longues peines un certain fatalisme sur le sujet, conscients qu'on ne peut demander à une famille d'affronter l'univers pénitentiaire pendant vingt ans pour des visites qui exigent souvent de mobiliser une journée et requièrent des moyens importants. Là encore, la question de l'éloignement de l'établissement est une donnée essentielle ; elle se pose avec une acuité particulière pour les femmes, aucun établissement ne se situant au sud de la Loire. La réponse de l'administration pénitentiaire face à cet impératif de maintien des liens familiaux paraît, à bien des égards, peu satisfaisante. La pratique des parloirs illustre la méconnaissance des contraintes que l'on impose aux familles. Ainsi, de nombreux établissements limitent de façon quelque peu drastique les horaires accordés aux parloirs. Disposer d'une heure trente avec le détenu pour un déplacement qui a nécessité de mobiliser une journée peut paraître frustrant. Le temps d'une heure trente n'est qu'indicatif ; la pratique diffère selon les établissements, ce qui prouve d'ailleurs que l'administration centrale n'a pas jugé essentiel cet aspect de la condition de vie du détenu et n'a pas donné de consignes claires à ce sujet. Il semble pourtant indispensable de réglementer les modalités de visite des familles, en tenant compte à la fois des contraintes familiales et des disponibilités de l'établissement, afin d'apaiser les tensions qui naissent de part et d'autre à la suite de dépassements d'horaires. Un système qui modulerait ces horaires en fonction de l'éloignement de la famille pourrait être ainsi envisagé. La même nécessité de réglementation exige que l'on aborde la question des relations sexuelles au parloir. L'administration centrale fait preuve en l'occurrence d'une grande hypocrisie en se réfugiant derrière le projet d'unités de visite familiale pour régler le problème. En l'absence de règles claires sur le sujet, les pratiques, là encore, diffèrent ; il semblerait ainsi que les relations sexuelles soient tolérées dans un établissement comme Clairvaux ; elles sont signalées et stoppées au centre de détention de Caen ; elles sont sanctionnées à Val-de-Reuil. Là encore, la solution choisie procède plus du poids de la coutume, d'une politique du directeur, que d'une véritable réflexion sur la sexualité en prison. Il faut pourtant savoir que ces relations, lorsqu'elles ont lieu, se déroulent dans des conditions indignes, avec des aménagements rudimentaires qui placent le couple, les familles présentes et leurs enfants, les surveillants, dans une situation extrêmement gênante. Les directeurs d'établissements réclament à ce sujet des directives claires. Le développement des unités de visite familiale constitue un début de réponse ; il s'agit de permettre aux détenus condamnés à de longues peines et ne bénéficiant pas de permissions de sortie, de recevoir pendant plusieurs heures les membres de leur famille dans des conditions d'intimité satisfaisantes. Seraient ainsi créés des espaces dans l'enceinte pénitentiaire, sans surveillance à l'intérieur même de ces espaces, permettant à la famille dont l'un des membres est incarcéré de vivre pendant un certain temps, toutes les dimensions de la vie familiale. Les détenus concernés et rencontrés lors de visites sont très attentifs à la mise en place de cette expérience pour laquelle trois sites ont déjà été choisis (maison centrale de Poissy, maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, centre pénitentiaire pour femmes de Rennes). Ils insistent à chaque fois pour que ces unités de visite familiale ne soient pas réduites, dans leur perception par l'extérieur, à une dimension uniquement sexuelle. Ils souhaitent au contraire que ce projet soit conçu comme un moyen de retrouver un noyau familial. Les syndicats rencontrés, tant au niveau national que lors des visites des établissements, ont montré leur réticence devant une telle expérience. Seule la CGT a émis un avis favorable, sous réserve que l'on ait utilisé, avant et en même temps, toutes les possibilités qui existent en terme de permissions de sortie et d'aménagements de peines. Il existe des unités de visite familiale au Canada et la délégation de la commission qui s'est rendue dans ce pays en a visité. Leur utilisation, également limitée aux détenus qui n'ont pas de permission de sortie, ne semble pas soulever de problèmes majeurs. Les personnels de surveillance qui ont été rencontrés, très réticents à leur mise en _uvre, ont reconnu que ces structures permettaient une amélioration du comportement des détenus qui en bénéficient. Il est vrai que la mise en _uvre du dispositif exigera de la part des surveillants l'accomplissement de nouvelles tâches, telles que les prises de rendez-vous téléphoniques, la gestion du planning d'utilisation, l'accueil, le contrôle de l'identité des visiteurs à l'arrivée et au départ de l'établissement, ainsi que la mise en place d'une surveillance spécifique. Au-delà de ces nouvelles tâches, il semblerait que ce qui suscite la réticence soit davantage lié à une vision fantasmatique des relations sexuelles au sein des unités de visite familiales ; les surveillants craignent en effet d'avoir à cautionner des relations qui ne soient pas exclusivement liées au maintien des liens familiaux. La réussite de l'expérience repose dès lors sur des directives très précises de l'administration centrale sur les personnes autorisées à être accueillies dans les unités de visite familiale. Ajoutons pour conclure que ces unités, qui s'adresseraient à des détenus condamnés à de longues peines ne bénéficiant d'aucune permission de sortie, ne concernent en définitive qu'un nombre extrêmement réduit de détenus. Les unités de visite familiale ne sauraient donc être une solution pour l'ensemble de la population pénale ; c'est davantage vers un aménagement et une réactivation des permissions de sortie qu'il s'agit de s'orienter. La famille est un vecteur essentiel d'intégration et une marche supplémentaire vers l'insertion. Il est indispensable également qu'elle soit considérée comme un interlocuteur pertinent de l'administration pénitentiaire. Il est indéniable que les établissements pénitentiaires s'appuient de plus en plus sur la famille pour prendre en charge des situations caractérisées d'indigence ou pour régler nombre de tâches matérielles qu'ils ne peuvent assumer faute de moyens. Cette « utilisation » des liens familiaux doit nécessairement s'accompagner d'une reconnaissance mutuelle ; l'aménagement des heures et jours de parloirs constitue une première démarche. Les capacités d'écoute et l'amélioration de l'accueil, qui passe notamment par une réfection des locaux destinés à recevoir les familles doivent également devenir une priorité. A ce sujet, les visites d'établissement, tels qu'Ensisheim, Troyes, Villenauxe, Fontenay ou Limoges ont montré les conditions d'accueil déplorables réservées aux familles. c) la politique de décloisonnement L'exigence d'un autre regard sur l'incarcération doit aussi conduire à reconnaître que le détenu est un citoyen, qu'il est certes privé de sa liberté, mais qu'il reste un sujet de droit. La politique de décloisonnement a pour objectif d'offrir aux détenus des prestations équivalentes à ce qu'elles seraient en milieu libre dans les domaines tels que la santé, l'enseignement, la formation ou la culture. La justice ne pouvant assurer seule ces prestations, la politique de décloisonnement consiste à mobiliser d'autres institutions. Cette mobilisation permet d'entretenir ou de susciter le sentiment d'appartenance à un groupe social, en sortant le détenu de son statut d'exclu. En ce sens, elle constitue véritablement une ouverture de la prison vers l'extérieur. Mais la politique de décloisonnement traduit également l'exigence d'une manifestation de solidarité envers le monde carcéral ; elle est en ce sens indubitablement un regard extérieur posé sur la prison. Le livre de Mme Véronique Vasseur représente un témoignage tout à fait concluant de ce regard citoyen institué par la politique du décloisonnement. Le décloisonnement a connu ses prémices en 1945 avec l'entrée en détention d'instituteurs de l'Education Nationale ; elle s'est poursuivie par le transfert aux ministères et institutions de référence du contrôle des prestations dispensées en milieu pénitentiaire : inspection du travail dans les ateliers et inspection académique dans les classes ; la loi du 22 juin 1987, en déléguant certaines fonctions dévolues à l'administration pénitentiaire à des entreprises privées, a permis une confrontation de la culture d'entreprise avec celle du service public ; il en est résulté une véritable mutation culturelle qui a permis aux établissements pénitentiaires de s'ouvrir vers l'extérieur. La politique de décloisonnement a également été marquée dans le domaine culturel par un partenariat du ministère de la Justice et du ministère de la Culture pour généraliser la création de bibliothèques en accès direct dans la prison. Enfin, aboutissement ultime de ce décloisonnement, la loi du 18 janvier 1994 institue le principe selon lequel les personnes détenues voient leurs soins assurés par le service public hospitalier et ont accès à une politique de prévention sanitaire de droit commun. A chaque fois, c'est le regard des institutions, du citoyen sur l'univers carcéral qui change ; à chaque fois, c'est le détenu qui se sent plus intégré au corps social. Les visites dans les établissements pénitentiaires ont permis de constater sur place que la mise en _uvre de cette solidarité était parfois délicate ; les directeurs d'établissements ont souvent fait part aux membres de la commission d'enquête de leurs difficultés à mobiliser les partenaires extérieurs, qu'ils soient publics et privés. Les partenariats avec les conseils généraux ou l'ANPE restent encore très timides ; les médecins hésitent à se déplacer et parfois même, comme cela a été vu à Clairvaux, refusent de venir. L'implication des collectivités locales est aussi inégale. Or l'aménagement de locaux pour l'accueil des familles, par exemple, en dépend le plus souvent. La prison renvoie trop souvent à une réalité que l'on veut ignorer ; il faudrait pourtant comprendre qu'elle est l'affaire de tous, qu'elle peut concerner chacun d'entre nous. d) l'apport essentiel du bénévolat Les associations génèrent du lien social et concourent à leur façon à l'intérêt général. Elles sont un témoignage auprès des personnes incarcérées de la présence de la société civile et ont également le souci de faire connaître la prison dans la société. L'Association nationale des visiteurs de prison, le GENEPI, la FARAPEJ (Fédération des associations réflexion, action, prison et justice), la FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale), le courrier de Bovet, la Croix-Rouge, le Secours Catholique et l'Armée du Salut sont autant d'associations au niveau national qui mènent des actions en faveur de la lutte contre l'illettrisme ou l'indigence, qui visitent régulièrement des prisons et qui aident à la préparation à la sortie. Il existe également des associations exerçant au niveau local qui se spécialisent plus spécifiquement dans l'accueil des familles en attente de parloirs. L'intervention de ces associations est tout à fait essentielle ; elles interviennent sur des terrains où l'administration pénitentiaire, faute de moyens, ne peut plus assumer ses responsabilités. La tendance à se décharger sur les milieux associatifs, moyennant éventuellement une aide budgétaire, est en effet très nette ; cette tendance a été dénoncée, notamment par l'Association nationale des visiteurs de prison, qui entend rester une association ne s'inscrivant pas dans un champ de compétence particulier. « Il n'y a pas suffisamment de visiteurs. On peut répondre qu'il y a un engouement et beaucoup de demandes, mais les agréments ne sont pas accordés comme il se devrait. Certes, faire des allers et venues, accompagner des détenus aux parloirs est une charge. Réfléchir à qui l'on va confier tel détenu prend du temps. La tendance aujourd'hui est que les services utilisent ces compétences particulières, c'est-à-dire que se dessine une volonté d'instrumentaliser les personnes qui viennent en détention. Or nous sommes des intervenants particuliers et nous tenons au fait même que nous n'avons pas de compétences particulières. Il y a là quelque chose qui devrait être repensé. Nous sommes formés à l'écoute pour être au plus près des besoins des détenus et les accompagner. L'association peut et doit offrir toutes sortes de services, même si on ne le fait pas toujours très bien. Nous ne rencontrons qu'un dixième de la population carcérale. Lorsque l'on voit des lieux comme Saint-Maur, on se dit que les visites devraient être absolument obligatoires dans les maisons pour peines. Ce sont des lieux qui devraient connaître une abondance de visiteurs. Nous sommes des gens qui avons traversé des épreuves et qui les avons surmontées. Nous sommes des personnes « lambda », nous ne demandons rien aux détenus. Il est important qu'ils rencontrent des personnes qui viennent juste pour eux, gratuitement ». (Mme Chantal Cretaz, présidente de l'ANVP) Malgré le fait qu'elles se voient confier un domaine d'intervention toujours plus étendu, les associations ont encore des difficultés pour intervenir dans les établissements pénitentiaires ; les horaires de la journée de détention et l'emploi du temps de la semaine carcérale se prêtent mal à l'intervention de membres d'associations issus du monde du travail ou du monde étudiant. « Il faut que la vie de l'établissement offre des horaires où nous puissions intervenir. Il est normal que les détenus puissent aller à l'école et suivre des formations. Il serait tout aussi normal que l'on facilite au maximum les rencontres avec les citoyens que nous sommes à des horaires qui pourraient être un peu mieux aménagés qu'ils ne le sont. Nous nous battons pour que les établissements soient ouverts le samedi matin aux visiteurs de prison, afin que les personnes issues du monde du travail puissent entrer en prison et témoigner de ce qu'est la réalité sociale ». (ANVP) « Nous demandons également que la journée de détention soit allongée, car, travaillant, nous pourrions rencontrer les détenus en soirée. A signaler que nous sommes empêchés de rencontrer les détenus en centre de semi-liberté car ils ne sont pas présents dans la journée, alors qu'ils auraient besoin d'avoir des contacts avec des personnes comme nous ». (présidente de l'ANVP) Or il est tout à fait fondamental que ces associations restent un reflet le plus fidèle possible de la société civile. L'aménagement des horaires de visite pour ces associations doit être une priorité de l'administration pénitentiaire. Il faut également citer dans une conception bien évidemment beaucoup plus large que le bénévolat, le dévouement attentif des aumôniers ; il paraît étonnant à cet égard que l'existence des aumôniers ne soit mentionnée dans le code de procédure pénale qu'au chapitre des actions de préparation à la réinsertion des détenus. L'assistance spirituelle va bien au-delà de cette mission, certes indispensable, de réinsertion et une reconnaissance plus claire de la liberté religieuse, dégagée de toute finalité matérielle, serait souhaitable. Il paraît également indispensable d'affirmer l'égalité de toutes les religions ; il semblerait en effet, sans que ces affirmations aient pu être véritablement étayées, que les musulmans aient davantage de difficultés pour pratiquer leur religion. e) le développement des médiations citoyennes L'idée, inspirée du système en vigueur au Pays de Galles et en Angleterre, a été développée dans le rapport de la commission présidée par M. Guy Canivet, Premier Président de la cour de cassation, sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Les délégués du médiateur des prisons auraient pour mission d'effectuer des visites d'établissements pénitentiaires et de rencontrer des détenus ou des membres du personnel pénitentiaire. Citoyens ordinaires, ils disposeraient pour accomplir leur tâche du pouvoir de se déplacer librement dans la prison grâce à la remise d'un trousseau de clés qui leur serait propre. Ils recevraient les requêtes orales ou écrites des détenus et pourraient décider de les traiter avec l'aide de la direction ou de les transmettre au médiateur des prisons, organe supérieur de contrôle. Toute initiative qui permet de mieux impliquer le citoyen dans l'appréhension de l'univers carcéral, tout en permettant d'apaiser les rapports de force entre personnel pénitentiaire et détenus mérite d'être étudiée avec soin. Elle ne va pas non plus sans soulever de difficultés concernant notamment le choix des personnes désignées comme médiateurs ou la garantie de leur sécurité. B.─ L'EXIGENCE DU DROIT EN PRISON Le rapport remis par M. Guy Canivet, premier président de la cour de cassation, au garde des sceaux relatif à l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, fait le constat du foisonnement des règles applicables en prisons ; cette prolifération induit pour le personnel pénitentiaire, les surveillants ou les détenus, une méconnaissance du droit et, de façon plus générale, une ineffectivité du droit. Il importe ici d'évoquer en premier lieu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose, dans son article 9, que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour l'arrêter doit être sévèrement punie par la loi ». L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 attribue de même au pouvoir législatif une compétence d'attribution en ce qui concerne « la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, et la procédure pénale. » Par ailleurs, comme dans d'autres domaines, la France est désormais tenue de se soumettre à des normes internationales : la Déclaration universelle des Nations Unies de 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne de Strasbourg de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, les règles pénitentiaires européennes révisées en 1987, les Conventions de transfèrements de condamnés de nationalité étrangère, ainsi que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que tout détenu peut saisir individuellement. Les règles pénitentiaires européennes, qui ont fait l'objet d'une recommandation R 87-3 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 12 février 1987, n'ont pas de caractère contraignant ; elles ne sont pas pour autant sans influence dans la mesure où elles peuvent en premier lieu servir de référence à un recours porté devant la Commission européenne des droits de l'homme ; de plus, s'agissant du principe du respect de la dignité humaine en détention, de l'intégration du détenu ou des conditions de vie en détention, ces règles exercent également une véritable pression sur l'administration pénitentiaire française. Outre ces normes de source internationale, la prison est régie par l'ensemble du corpus législatif. La loi, quelle qu'elle soit, s'applique en prison sauf disposition contraire prévue par la loi ; il s'agit là d'une évidence qu'il semble pourtant nécessaire de rappeler. Il est vrai qu'un grand nombre de lois sont difficilement applicables dans les établissements pénitentiaires et la perception des contraintes liées à l'univers carcéral est souvent méconnue du législateur. L'administration pénitentiaire a, de son côté, tendance à ne considérer comme applicables que les lois spécifiquement destinées à régir l'institution pénitentiaire ; celles-ci, par rapport aux décrets et circulaires, sont du reste fort peu nombreuses et n'ont pas toujours fait l'objet d'une codification dans le code de procédure pénale. Des lois de portée plus générale sont totalement ignorées ; l'application de la loi régissant l'interdiction de fumer dans les établissements publics reste totalement inopérante ; plus récemment, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations semble également connaître des difficultés d'interprétation. Cette loi comporte des implications très concrètes, telles que l'obligation faite à l'administration d'accuser réception ou le droit d'obtenir une procédure contradictoire, avec éventuellement le conseil de son choix en cas de décision individuelle défavorable. Elle oblige également l'administration à prévoir un accès simple au droit par une mise à disposition claire des textes. Les travaux préparatoires sont pourtant éloquents quant à la volonté du législateur de voir la loi appliquée par toutes les autorités administratives et notamment les établissements pénitentiaires. L'administration pénitentiaire paraît en revanche considérer qu'une telle loi ne trouve à s'appliquer que lorsqu'aucune disposition antérieure ne prévoit des procédures analogues. La loi du 12 avril 2000 viendrait en quelque sorte compléter d'éventuelles lacunes dans la procédure administrative ; en aucun cas, elle ne pourrait se substituer à des procédures existantes. Cette interprétation est révélatrice de la conception du droit en prison, qui privilégie les règles spécifiques, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie des normes, décret, circulaire ou règlement intérieur sur l'application de la règle générale. Or comme on l'a dit, la règle spécifique de valeur législative est rare ; l'ensemble du droit de la prison est régi par des normes « d'une qualité discutable » pour reprendre l'expression du Président Canivet : décrets, circulaires, règlements intérieurs constituent un ensemble normatif dense et confus. La liste des circulaires applicables dans les établissements pénitentiaires transmise à la commission d'enquête constitue, à cet égard, un témoignage impressionnant de la complexité de l'ordonnancement juridique. Il faut ajouter à cela l'existence dans chaque établissement d'un règlement intérieur ; ayant pour objet d'informer les détenus de leurs obligations et de leurs droits, et d'aider le personnel dans la mise en _uvre des règles applicables, le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement en liaison avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour tous les domaines relevant de la compétence de ce service. Il est communiqué au juge de l'application des peines pour avis puis transmis au directeur régional, avant d'être communiqué à la commission de surveillance. Situé au bas de la pyramide de la hiérarchie des normes, le poids des us et coutumes apparaît très prégnant, même si les contours de ce corpus normatif sont extrêmement difficiles à cerner. Les traditions s'analyseraient plutôt sociologiquement comme une étude de rapports de force triangulaires entre détenus, surveillants et direction, constitués d'acquis obtenus par l'un ou l'autre de ces groupes sur lesquels il semble très difficile de revenir. b) une hiérarchie des normes non respectée Le foisonnement des normes applicables en prison serait acceptable s'il pouvait exister entre elles une véritable hiérarchie. Il s'avère au contraire qu'un nombre très important de contraintes, touchant à des libertés aussi essentielles que le droit à la vie privée ou le droit d'expression, sont régies par des dispositions réglementaires ou par la voie de circulaires. Il en est ainsi par exemple du contrôle des correspondances, de la réglementation de la fouille des détenus, de l'utilisation d'armes à feu ou de la mise en _uvre du droit de la défense dans les sanctions disciplinaires. Il est pourtant absolument indispensable de recourir à une loi pénitentiaire pour régir des questions aussi essentielles que celles-ci. Deux raisons à cela : on ne peut imaginer qu'il y ait deux qualités de normes selon qu'il s'agit d'un citoyen libre ou d'un citoyen détenu. La garantie des droits est la même, le détenu n'étant privé que de sa liberté d'aller et venir. Il ne faut pas non plus laisser l'administration pénitentiaire régir seule de telles atteintes à la liberté ; un débat public s'impose, et c'est dans le débat que peuvent être discutées des limitations. Certaines limitations pourraient s'avérer finalement non nécessaires. La question notamment de l'accès au téléphone pour les prévenus et les condamnés en maison d'arrêt mérite d'être posée. Ce n'est pas à l'administration pénitentiaire d'y répondre même s'il est indispensable qu'elle soit associée à la réflexion. Une conception gestionnaire des atteintes aux libertés est dangereuse ; on a trop longtemps laissé la gestion de la détention dans le règne de la circulaire et de la gestion administrative. Il est temps de substituer le débat politique à la technique. c) diversité des règles et diversité des régimes Il serait hâtif de déduire de la surabondance des règles qu'il existe une rigidité, un cadre identique de gestion de tous les établissements. L'expérience prouve au contraire que le foisonnement des règles se traduit paradoxalement par une extrême diversité des régimes de gestion des établissements. Les textes, notamment les circulaires, apparaissent souvent soit trop imprécis, soit trop restrictifs et, dans tous les cas, inadaptés aux spécificités de chaque établissement qui tiennent notamment à l'architecture, à la population pénale ou au poids des traditions. Chaque établissement a donc tendance à contourner les règles ou les interpréter. Il en résulte des régimes de détention extrêmement variables selon les établissements. Les visites des établissements pénitentiaires ont ainsi fait apparaître que les règles différaient totalement dans des domaines qui touchent de près la vie quotidienne des détenus. Il en est ainsi des durées de parloir qui peuvent varier de une heure à une durée illimitée ; de la pratique des fouilles qui se font avant et après chaque parloir, certains établissements pratiquant la fouille par palpation avant le parloir et d'autres la fouille à corps ; de l'accès au téléphone qui peut se faire sans limitation de durée par le biais de carte téléphonique et sans surveillance ou qui peut au contraire être très réglementé avec des conversations enregistrées ; de l'ouverture du courrier qui peut présenter un caractère systématique ou être simplement ouvert par sondage. Dans tous ces domaines, toutes les pratiques ont été rencontrées. Il est vrai que la diversité des règles est souvent présentée comme la capacité de l'administration pénitentiaire à s'adapter à des contraintes fortes, spécifiques à chaque établissement et inhérentes à la vie carcérale. Il faut reconnaître, compte tenu de ce cadre contraignant, que l'édiction d'un règlement intérieur type se traduirait par une rigidité excessive. Cependant, s'agissant de questions aussi fondamentales pour le détenu, il serait préférable d'ouvrir une réflexion sur l'édiction d'un règlement intérieur type, non pas commun à tous les établissements, mais adapté à chaque régime de détention. Une réflexion sur le sujet a été amorcée puis interrompue à l'administration centrale ; elle est appelée de ses v_ux par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et reprise dans les propositions de la commission présidée par M. Guy Canivet. 2) Un difficile accès au droit a) l'ignorance des règles par les détenus Il est difficile de demander à la prison de jouer un rôle de rappel à la loi quand on ne sait pas quelle est la loi qui s'applique. Le détenu subit ainsi la prolifération des règles comme un carcan oppressif et non comme une garantie contre l'arbitraire. Il est à la fois ignorant des lois extérieures et des règles internes. Le moins que l'on puisse dire est que cet accès au droit est méconnu, quand il n'est pas totalement ignoré, dans la définition des missions de l'administration pénitentiaire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affichée systématiquement paraît de portée beaucoup trop générale pour avoir des répercussions concrètes sur la vie en détention. La multiplication des affiches sur le passage à l'Euro prend également une résonance surréaliste dans cet univers clos : si l'on est informé sur la gestion de son compte en banque en Euros, on ne connaît rien du régime de détention, des règles imposées par le règlement intérieur. Celui-ci est théoriquement disponible à la bibliothèque. Un extrait en est fourni à l'arrivée L'expérience des visites a montré que bien souvent cependant ce règlement intérieur est tout à fait inutilisable. Quasiment toujours obsolète, et toujours annoncé comme étant en cours de refonte, le règlement intérieur n'a donc pas l'incontestabilité qu'il devrait avoir ; la règle est dès lors vécue par le détenu comme subjective, liée au surveillant. Deux expériences menées à la Santé et à Fleury-Mérogis cherchent à faire du détenu un véritable sujet de droit ; à la Santé, une permanence d'avocats volontaires a été mise en place sur proposition de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le seul travail sera d'écouter et de conseiller les détenus au sujet de leurs droits : « Cette initiative a reçu, de la part du barreau, un bon accueil. Elle répond à une situation que vous allez certainement constater, à savoir l'incompréhension totale des détenus en ce qui concerne leurs propres droits. Ils n'ont en effet aucune possibilité d'en parler avec leur avocat défenseur, la totalité du temps passé avec le défenseur étant exclusivement consacrée à la défense pénale. Nous avons donc le sentiment d'un vide juridique, d'un vide de conseil, d'un vide d'accueil et d'informations, les détenus se trouvant dans l'incapacité de comprendre leurs droits et, par conséquent, de les exercer. Cette permanence sera tenue par des avocats volontaires que nous sommes en train de former spécialement au droit de la détention, qui se révèle être un droit extraordinairement compliqué. En effet, le droit des détenus est un droit transversal. Un certain nombre de dispositions se trouvent ans le code de procédure pénale, mais il existe également des procédures administratives assez complexes. Il faut ajouter les questions de réinsertion qui tournent autour du droit au logement, du droit civil, du droit de la famille, et, pour nombre d'entre eux, du droit des étrangers. Le programme de formation pour ces avocats est déjà mis en place. Par ailleurs, nos règles déontologiques seront, bien entendu, un peu particulières - et je les soumettrai au Conseil de l'ordre dans les jours qui viennent -, puisque ces avocats de permanence devront respecter la règle de l'anonymat, une interdiction de suite des dossiers, ainsi qu'un certain nombre de règles spécifiques tenant au fait qu'ils exercent cette fonction nouvelle au sein des prisons. » (Maître Francis Teitgen) A Fleury-Mérogis, un point d'accès au droit, tenu par des emplois-jeunes permet également aux détenus de faire le point sur leurs droits et de mieux appréhender leur détention. Le non-respect de la hiérarchie des normes dans le droit régissant la prison n'est pas qu'un sujet théorique pour étudiants en droit ; sont ainsi prévues, par le biais de décrets ou circulaires, des interdictions fondamentales qui vont bien au-delà de la privation de la liberté d'aller et venir. Chaque autorisation, chaque droit accordé est assorti de précautions, de limitations, de conditions qui en affaiblissent considérablement la portée. Ces restrictions ont toutes pour justification les impératifs liés à la sécurité ; pour exemple, la partie réglementaire du code de procédure pénale permet au directeur d'établissement de refuser un permis de visite ou d'imposer le dispositif de parloir avec séparation ; un surveillant peut mettre fin à un entretien au parloir ; un directeur d'établissement peut décider de « déclasser » un détenu qui travaille ou tout simplement prendre la décision de ne pas le classer. Bien au-delà des prescriptions du code de procédure pénale, c'est l'ensemble de la vie en détention qui est régi par des droits incertains, des autorisations conditionnelles pouvant être remises en cause à tout moment. Même s'il faut garder à l'esprit les contraintes imposées par la sécurité, force est de reconnaître que le droit de la prison est toujours fondé sur une logique de récompense et de punition. Cette logique illustre les véritables rapports de force entre détenus et personnel pénitentiaire ; elle ne paraît pas cependant, comme nous le verrons ultérieurement, favoriser une démarche de responsabilisation du détenu, et ce d'autant plus qu'il n'a pas accès aux voies de la contestation de ces règles. c) des règles insusceptibles de recours La prison est souvent présentée comme une zone de non-droit ; c'est inexact : le droit existe en prison et il y a même surabondance de droits. Le problème est que rien n'est assuré pour permettre la garantie de ces droits. Certes, le détenu a la possibilité de saisir les autorités administratives indépendantes, telles que la Commission d'accès aux documents administratifs ou le Médiateur de la République ; il peut également être entendu seul par le juge et écrire sans contrôle ni restriction à certaines autorités judiciaires, administratives ou politiques. Le droit de demander l'annulation de décisions qui relèvent d'une autorité administrative par le biais du recours pour excès de pouvoir est également reconnu au détenu en vertu des principes généraux du droit. Cependant, ces droits sont très spécifiques et ne peuvent concerner qu'une décision particulière de l'administration ; ils ne portent pas sur l'ensemble de la détention : il n'existe pas à cet effet, comme au Canada, de droit concernant l'expression collective des détenus. Les comités de détenus au Canada Au canada, la loi sur le système correctionnel précise, dans son article 73, que « les détenus doivent avoir, à l'intérieur du pénitencier, la possibilité de s'associer ou de participer à des réunions pacifiques. » L'article 74 de cette loi indique également que le service correctionnel « doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité. » En application de ces dispositions, il existe des comités de détenus dans tous les établissements qui sont invités à donner régulièrement leur avis sur les questions touchant à la détention telles que l'emploi, les rémunérations, la politique antitabac, etc. Ils servent de lien entre la direction et la population carcérale. Par ailleurs, le droit de saisine du juge administratif se heurte rapidement à la longueur des procédures pré-contentieuses ou contentieuses, qui rend finalement totalement inopérante la décision finale. En matière de contentieux administratif, les droits des détenus se trouvent également fortement remis en cause par la position tout à fait exceptionnelle qu'occupe la prison dans la jurisprudence du juge administratif. Ce dernier a ainsi contribué, en définissant les mesures d'ordre intérieur, insusceptibles de recours, à rejeter la prison dans le règne de l'arbitraire. Les mesures d'ordre intérieur se définissent à l'aide de trois critères cumulatifs : elles sont dépourvues d'effet juridique à l'égard des personnes auxquelles elles s'appliquent, purement internes au service et discrétionnaires. L'irrecevabilité du recours contre les mesures d'ordre intérieur en matière pénitentiaire est « jugée indispensable au fonctionnement de la prison, car destinée à faire obstacle au développement d'un contentieux susceptible de compromettre l'exécution d'une situation pénale, dans laquelle il est particulièrement souhaitable de garantir le maintien de l'ordre et la cohésion interne. » (Tribunal administratif de Strasbourg, arrêt Théron du 2 juillet 1991) Si la notion de mesure d'ordre intérieur est le plus souvent retenue pour des décisions individuelles, elle a parfois été appliquée à des actes réglementaires généraux. (CE, Winterstein, 12 novembre 1986) Sont ainsi considérées comme des mesures d'ordre intérieur, les décisions de transfert et d'affectation (CE, 8 décembre 1967, Kayanakis), le fichage d'un détenu comme détenu dangereux (CE, 12 novembre 1986, Winterstein), l'interdiction faite au détenu de porter des gants en détention (CE, 10 janvier 1986, Rougetet), le placement d'un détenu dans un quartier de plus haute sécurité (CE, 27 janvier 1984, Caillol), le refus de faire bénéficier le détenu du régime applicable aux détenus politiques (CE, 1er mars 1939, Troncaso) ou la soumission du détenu au régime cellulaire (CE, 8 décembre 1967, Kayanakis). Surtout, il importe de souligner que la décision de mise à l'isolement (sur le fondement de l'article D.283-1 du code de procédure pénale) est toujours qualifiée par la jurisprudence de mesure d'ordre intérieur. Le Conseil d'Etat considère en effet que ce type d'isolement n'aggrave pas les conditions de détention et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 28 février 1996, Fauqueux). Cette vision de la prison, et plus particulièrement de l'isolement relève d'une méconnaissance totale de la vie pénitentiaire : les conséquences désocialisantes et psychiquement déstructurantes d'une décision de mise à l'isolement ont été à la fois dénoncées par tous les intervenants de l'administration pénitentiaire et constatées lors des visites. L'impunité dont jouit l'administration dans la décision de recourir à l'isolement est scandaleuse ; ajoutons qu'elle est même mal ressentie par l'administration elle-même. Il ne s'agit pas de contester la procédure d'isolement en tant que telle mais bien de prévoir des recours pour la contester. Il est urgent que le législateur se saisisse du sujet et aménage des procédures contentieuses adéquates. Il faut cependant préciser, pour s'en féliciter, que le champ des mesures d'ordre intérieur a tendance à se réduire, notamment avec le contentieux des mesures d'ordre disciplinaire. Jusqu'alors en effet, selon une jurisprudence traditionnelle (arrêt Bruneaux, CE, 28 juillet 1932, à propos d'une punition de cellule), lorsqu'il avait à connaître d'un recours dirigé contre une sanction disciplinaire, le juge administratif le déclarait irrecevable, car dirigé contre « une mesure d'ordre intérieur prise à l'égard d'un détenu par l'administration pénitentiaire ». « Destinées à assurer la discipline dans les établissements pénitentiaires » (arrêt Comité d'action des prisonniers et autres, CE du 4 mai 1979), les sanctions disciplinaires étaient considérées comme n'affectant pas le statut même des détenus. Malgré ces critiques, cette jurisprudence s'est longtemps maintenue (arrêt Théron, CE, 14 février 1992). Elle devait toutefois être reconsidérée à la lumière de la jurisprudence européenne relative notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire Marie, le Conseil d'Etat a jugé qu'« eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ». L'incidence de la sanction sur le régime des réductions de peines est un élément déterminant en l'espèce, puisque la haute juridiction relève notamment qu'en application de l'article 721 du code de procédure pénale des réductions de peines peuvent être accordées aux condamnés détenus en exécution de peines privatives de libertés « s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite » et que les réductions de peine ainsi octroyées peuvent être rapportées « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention » (conclusions du commissaire du gouvernement P. Frydmann, in RFDA, 1995 p. 353). A la suite de ce revirement de jurisprudence, le décret n° 96-287 du 2 avril 1996 a réformé l'ensemble de la matière disciplinaire en considération des principes contenus dans la recommandation R(87) 3 du Conseil de l'Europe sur les règles pénitentiaires européennes et tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il faut se féliciter de l'avancée de ces droits, il est cependant nécessaire là encore d'en relativiser la portée : l'encombrement des juridictions administratives ne permet d'obtenir l'annulation de la décision que plusieurs années après. Le détenu a bien souvent été libéré depuis lors et n'obtient qu'une décision purement symbolique même si, dans le cas de l'annulation d'une sanction, la responsabilité de l'Etat peut être engagée et justifier l'allocation de dommages-intérêts. L'annulation de la sanction ne permet pas cependant de l'effacer du dossier du détenu, alors même que cette sanction a pu être prise en compte dans les décisions du juge de l'application des peines. Il semble indispensable d'étudier, au sujet du droit en prison, les recommandations faites par la commission Canivet qui préconise un aménagement des procédures d'urgence devant le juge administratif, rendant ainsi effectifs et utiles les recours du détenu. La proposition d'une loi pénitentiaire revêt là encore toute sa pertinence ; c'est en effet au législateur que devrait revenir la responsabilité de déterminer les décisions faisant grief et susceptibles de recours. Pour conclure sur les décisions insusceptibles de recours, il convient de dire un mot sur celles prises par le juge d'application des peines ; considérées comme des mesures d'administration judiciaire, celles-ci n'étaient pas susceptibles de recours. La loi sur la présomption d'innocence, suivant en cela la recommandation du rapport de la commission présidée par M. Daniel Farge, a prévu que dorénavant, les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les fractionnements et suspensions de peines, les permissions de sortie, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique seront accordés, refusés ou révoqués par une décision motivée du juge de l'application des peines, susceptible d'appel de la part du condamné, du Procureur de la République et du Procureur général. 3) Des garanties insuffisantes en matière de sanctions disciplinaires Deux éléments sont à prendre en compte à ce sujet :la conception restrictive de la sanction par l'administration pénitentiaire ne permet d'appliquer la procédure prévue en matière disciplinaire qu'à un nombre réduit de décisions ; la procédure même prévue en matière disciplinaire comporte de graves lacunes en matière de droits de la défense. S'agissant de la conception restrictive de la sanction, il faut rappeler que le droit de la prison est un droit conditionnel ; comme cela a déjà été dit, de nombreuses décisions peuvent ainsi être prises par la direction au nom d'un impératif de sécurité, et vécues comme des sanctions par les détenus. Parmi ces décisions, les mises à l'isolement ou les transferts imposés d'établissement exigeraient sans nul doute de meilleures garanties dans l'information et le droit de réponse du détenu. S'agissant de la procédure même de la sanction disciplinaire, il faut en premier lieu reconnaître que la discipline, et la sanction qui accompagne cette discipline sont indispensables à la bonne marche d'un établissement pénitentiaire : « On ne peut faire l'économie, en prison, d'un lieu disciplinaire. Il ne faut pas avoir des prisons une vision angélique : c'est un lieu de tension, de violence et d'affrontement où la loi du plus fort, parce qu'il s'agit d'un lieu cloisonné avec des jeunes hommes, est menaçante à tous moments. Il faut donc qu'il y existe un système disciplinaire. » (Robert Badinter) Convaincu de l'utilité de la sanction disciplinaire, il faut dès lors plaider pour un aménagement des procédures. Le décret du 2 avril 1996 a, en l'occurrence, permis des avancées essentielles. A ainsi pu être instituée, en premier lieu une échelle des peines en fonction de la gravité de la sanction. Une procédure devant la commission de discipline a également été instaurée, permettant au détenu d'obtenir un délai minimum de trois heures avant son audience afin de préparer sa défense. Bien qu'ayant été considérablement améliorée, cette procédure souffre encore de graves manquements en matière de garantie des droits de la défense, de respect d'un procès équitable et d'indépendance et d'impartialité de l'instance disciplinaire. Comme l'a rappelé le Président Canivet dans son rapport, « l'autorité de poursuite est en même temps celle qui décide de la sanction, au mépris de la séparation des fonctions. De même, la commission est composée de deux assesseurs, avec voix consultative, désignés par le directeur président, sous l'autorité hiérarchique duquel ils sont placés. Plus encore, l'exercice des droits de la défense apparaît méconnu, tant par l'absence de défenseur que par le délai trop court laissé au détenu pour la préparation de sa défense et par la non-consultation du dossier, alors que le respect des droits de la défense est un principe à valeur constitutionnelle. » La présence d'un avocat assistant le détenu lors de la commission de discipline, le « prétoire » dans le langage pénitentiaire, a été une question vivement discutée par la commission d'enquête. Elle pose en effet le problème de l'égalité des détenus en matière de sanction, les plus démunis ne pouvant obtenir les mêmes garanties que les détenus assistés d'un avocat. Elle devrait donc se traduire par un accroissement conséquent de l'aide juridictionnelle, afin de pouvoir désigner des avocats commis d'office. La présence de l'avocat au prétoire suscite également de vives inquiétudes chez les surveillants qui craignent une procédure inéquitable plaçant le surveillant ayant vécu l'incident dans une situation plus défavorable que le détenu. La solution pourrait résider dans l'institution de médiateurs indépendants et neutres qui examineraient en toute impartialité les dossiers de sanction. Le débat entre avocat ou médiateur semble toutefois être dépassé par l'adoption de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'article 24 de la loi dispose en effet que toute personne ayant fait l'objet d'une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 - à savoir une décision individuelle défavorable - peut demander à présenter des observations écrites ou orales ; elle peut également se faire assister du conseil de son choix. La loi du 12 avril 2000 s'applique à toutes les autorités administratives, y compris les établissements pénitentiaires ; le rapport de Mme Ledoux, députée, lors de la première lecture du texte, est très explicite sur ce champ d'application. Appliqué aux prisons, l'article 24 permet donc l'assistance du détenu en commission de discipline par un conseil de son choix, quel qu'il soit, détenu, avocat, interprète ou autre intervenant. L'administration pénitentiaire paraît contester cette interprétation au motif qu'il existe déjà dans le code de procédure pénale des procédures contradictoires. Celles-ci sont effectivement prévues, mais par voie réglementaire ; on saisit mal, de plus, comment une norme antérieure, qu'elle soit de niveau équivalent ou a fortiori inférieur, pourrait être invoquée pour justifier l'inapplicabilité d'une norme postérieure. S'il faut se féliciter de cette avancée du droit, on peut regretter néanmoins qu'une réforme de telle ampleur n'ait été faite que par le biais d'une loi de portée très générale, et sans qu'à aucun moment la question des établissements pénitentiaires n'ait été clairement soulevée à l'occasion des débats. Il n'est pas question ici de plaider pour que des lois spécifiques soient votées pour les établissements pénitentiaires ; il faut tout au contraire se féliciter qu'un apport aussi fondamental soit adopté dans une loi concernant l'ensemble des citoyens ; il aurait peut-être cependant été souhaitable que l'administration pénitentiaire soit davantage impliquée dans cette réforme. Mise devant le fait accompli, elle ne peut accepter que de mauvaise grâce une réforme qui aurait effectivement nécessité davantage de consultations. Ajoutons pour conclure que les visites effectuées dans les établissements pénitentiaires ont permis de montrer un consensus des directeurs d'établissement pour une procédure disciplinaire plus respectueuse des droits des détenus. Certains directeurs ont même plaidé pour être déchargés de l'ensemble du contentieux disciplinaire, qui serait désormais confié à l'autorité judiciaire. C.─ L'EXIGENCE D'UN CONTRÔLE DU MILIEU CARCÉRAL 1) La multiplicité des contrôles Les pouvoirs confiés à l'administration pénitentiaire constituent le terme ultime de ce qui peut exister en matière de contrainte étatique. Les atteintes graves aux libertés individuelles impliquées par cette contrainte exigent plus qu'ailleurs la mise en place de contrôles vigilants. Sans contrôle, il ne peut y avoir de garantie des droits. Un rapide descriptif des contrôles mis en place, qu'ils soient confiés à un service d'inspection interne à l'administration ou à un organe extérieur à celle-ci, semble témoigner de la volonté de transparence de l'administration pénitentiaire. Les inspections se distinguent des contrôles dans la mesure où elles sont le fait de l'autorité hiérarchique ou d'un organe spécialisé qui lui est soumis. Le garde des sceaux, la direction de l'administration pénitentiaire, les neuf directions régionales des services pénitentiaires et la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer assurent un contrôle hiérarchique sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. L'inspection générale des services judiciaires est également compétente, sur demande du garde des sceaux, pour effectuer des inspections d'établissement. Mais c'est surtout à l'Inspection des services pénitentiaires qu'incombe, aux termes de l'article D.229 du code de procédure pénale, la mission d'inspecter les établissements pénitentiaires. Elle comprend douze personnes dont un chef de service, qui est magistrat, membre de l'Inspection générale des services judiciaires, quatre inspecteurs, quatre fonctionnaires du personnel de surveillance qui constituent la brigade de sécurité pénitentiaire et trois personnels administratifs. M. Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires, a décrit les missions de l'Inspection des services pénitentiaires en ces termes : « L'Inspection des services pénitentiaires effectue à peu près, à elle seule, sans compter les missions de la brigade de sécurité pénitentiaire, et tout confondu, une cinquantaine de missions par an. Elles sont de trois ordres. Nous les regroupons, car certaines ne peuvent être classées dans une seule catégorie. Je distingue d'abord les contrôles de routine que nous effectuons à longueur d'année et qui consistent pour deux inspecteurs à visiter un établissement pénitentiaire en une ou deux journées au maximum, suivant la taille de l'établissement. Je parle de « routine » - le terme est un peu réducteur - parce qu'on ne voit pas nécessairement au cours de ces contrôles tout ce qui peut être détecté. La deuxième catégorie - les missions de contrôle général consistent à « peigner » un établissement du sommet à la base. Ces contrôles nécessitant un investissement en temps et en hommes beaucoup plus important, c'est toute l'inspection - cinq personnes - qui se rend sur place pour quatre ou huit jours ou bien qui y revient à plusieurs reprises. Le contrôle de routine comme le contrôle général s'opèrent à peu près selon les mêmes techniques : la visite de l'établissement, que tout un chacun peut conduire ; les constatations matérielles que l'on peut opérer grâce à la technicité des inspecteurs pénitentiaires ; ensuite et surtout, le contrôle des conditions de détention - celui qui est le plus difficile - qui est réalisé par des entretiens à la fois avec les membres du personnel, ce qui n'est pas aisé et qui ne va pas de soi lorsqu'une équipe d'inspection arrive dans un établissement pénitentiaire et avec les détenus. Ces contrôles se réalisent de jour comme de nuit, ils sont annoncés ou inopinés selon l'objectif recherché et selon les renseignements dont l'inspection dispose au préalable. Les missions sur événements constituent la troisième catégorie. Les événements les plus graves pour nous sont l'évasion, la prise d'otage et la mutinerie. En ce qui concerne les évasions, nous avons à nous déplacer en urgence plusieurs fois par an. Les missions sur événements peuvent se décliner en missions de renseignement du directeur de l'administration pénitentiaire et du cabinet du ministre, en une enquête de responsabilité lorsqu'il y a faute, enfin, en une enquête en vue d'un retour d'expérience afin d'analyser les points positifs et ceux où nous avons été mis en échec. Enfin, quatrième type de mission : les missions disciplinaires. L'inspection des services pénitentiaires reçoit un certain nombre de dénonciations adressées à la direction de l'administration pénitentiaire, qui font état de dysfonctionnements, qu'elles viennent de l'autorité administrative, de l'autorité judiciaire, de syndicats ou de détenus. Des enquêtes sont conduites selon des procédures qui peuvent éventuellement, sur décision du directeur, déboucher sur des procédures disciplinaires. Enfin, les missions d'expertise peuvent être de tous ordres. Il serait trop long de les énumérer. » Au cours de l'année 1998, l'inspection des services pénitentiaires a effectué 61 missions ayant entraîné 105 déplacements, y compris ceux de la brigade de sécurité pénitentiaire, dans les différents services déconcentrés. - 15 missions sur événements et incidents, - 2 missions de contrôle général, - 17 visites des services déconcentrés, dont 11 centres de semi-liberté autonomes, - 13 missions d'observation effectuées par la brigade de sécurité pénitentiaire, - 2 opérations de fouille générale, - 11 missions effectuées par le chef de l'inspection qui, assisté d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire de la sous-direction des personnes placées sous main de justice, s'est rendu au siège de chaque direction régionale ainsi qu'à la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pour présenter la circulaire du 1er juillet 1998 sur l'usage de la force et des armes en milieu pénitentiaire, - 1 mission d'évaluation au centre de détention de Montmédy concernant l'utilisation et la surveillance du terrain de sport situé hors de l'enceinte de l'établissement. Parallèlement, l'inspection a procédé au contrôle du fonctionnement de six maisons d'arrêt en mettant plus particulièrement l'accent sur celles n'ayant pas fait l'objet de visites de l'administration centrale dans un passé récent. De même, l'enquête administrative sur la maison d'arrêt de Beauvais a entraîné plusieurs déplacements sur site. Les centres de semi-liberté autonomes, soit onze établissements au total, ont fait l'objet d'un contrôle approfondi. Dans le cadre des quinze missions d'enquête sur événements et incidents, l'inspection a bien souvent été conduite, pour traiter ces diverses affaires, à élargir son champ d'investigation au contrôle du fonctionnement général des établissements concernés. La brigade de sécurité pénitentiaire, quant à elle, a conduit des missions d'observation dans treize établissements pénitentiaires pour lesquels elle a réalisé un audit complet en matière de sécurité. Cette unité a organisé et conduit deux fouilles générales d'établissements pénitentiaires à la maison centrale de Clairvaux et à la maison d'arrêt de la Seine Saint-Denis. Il faut ajouter à cette mission d'inspection spécifique les inspections diligentées par d'autres administrations que l'administration pénitentiaire : on peut notamment citer, en application de l'article D.231 du code de procédure pénale, les interventions de l'Inspection du travail, habilitée à contrôler le respect des conditions d'hygiène et de sécurité dans les lieux de travail des détenus, et l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), chargée de veiller aux conditions de prise en charge sanitaire des détenus. L'IGAS peut également être saisie de requêtes individuelles adressées directement par les détenus ou par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire. L'IGAS a réalisé en 1998 deux rapports portant sur les points suivants : - les conditions dans lesquelles s'est produit le décès d'un détenu de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à l'établissement public de santé national de Fresnes, - les circonstances qui ont entouré le décès d'un détenu à la maison d'arrêt de Rouen et le fonctionnement du service médico-psychologique régional (SMPR). Il faut également noter, au titre de ses actions, qu'elle a été saisie d'un nombre croissant de plaintes émanant de détenus et touchant à leur état de santé : au nombre de 323 en 1997, ces réclamations se sont élevées à 386 en 1998. Il serait incomplet de conclure sans mentionner le contrôle de la Cour des Comptes : le rapport public de 1999 comprend ainsi un bilan complet et pour le moins sévère de la gestion du personnel de l'administration pénitentiaire. Exercés par des autorités extérieures à l'administration proprement dite, ces contrôles sont réalisés par les autorités judiciaires ou relèvent d'une commission spécifique instituée par le code de procédure pénale, la Commission de surveillance. En application des articles D.176 à D.179 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires ont l'obligation de visiter régulièrement les établissements pénitentiaires de leur ressort et d'adresser des observations aux autorités compétentes pour y donner suite : - pour le juge d'application des peines, visite au moins une fois par mois, - pour le président de la chambre d'accusation, visite au moins une fois par trimestre des maisons d'arrêt de son ressort, - pour le juge d'instruction, visite aussi souvent qu'il l'estime utile de la maison d'arrêt de son ressort, - pour le juge des enfants, visite au moins une fois par mois de la maison d'arrêt pour y vérifier les conditions de détention des mineurs, - pour le procureur de la république, visite au moins une fois par trimestre des établissements de son ressort, - pour le procureur général, visite au moins une fois par an des établissements du ressort de la cour d'appel. Le juge de l'application des peines, le procureur général et le premier président de la cour d'appel ont également l'obligation d'adresser un rapport annuel au ministre de la justice sur le fonctionnement des établissements de leur ressort. Plus spécifiquement, en dehors de ces obligations de visite, le juge de l'application des peines a un rôle particulier dans le contrôle des conditions de vie en détention ; il participe à la commission de surveillance, a la possibilité d'entendre à tout moment un détenu ou de recevoir les observations des détenus isolés ou punis. Il est informé de tout incident grave relatif à un condamné, de toute mise ou prolongation de l'isolement d'un détenu ou de toute sanction disciplinaire. Il reçoit, dans le cadre de son contrôle, les rapports annuels du service médical et du service socio-éducatif. Enfin, il est consulté sur toutes les décisions d'affectation et sur le règlement intérieur de l'établissement. La Commission de surveillance est propre à chaque établissement pénitentiaire. Elle comprend, sous la présidence du préfet, jusqu'à vingt-quatre membres qui sont les autorités judiciaires et administratives locales (président du tribunal, procureur de la République, magistrats du tribunal, avocat, maire, représentants d'associations, DDASS...). La Commission se réunit au moins une fois par an ; elle entend le rapport du chef d'établissement et peut procéder à l'audition de toute personne et visiter l'établissement. Elle reçoit les requêtes des détenus et adresse un rapport au ministre de la justice avec ses critiques et propositions sur les conditions de détention. La multiplicité des contrôles ne signifie pas nécessairement qu'il y ait efficacité du contrôle. Il faut insister, comme constat préliminaire, sur le fait que les contrôles institués paraissent au contraire trop disséminés, parcellaires, pour constituer une véritable force de contrainte sur l'administration pénitentiaire. En second lieu, il semblerait que la dimension carcérale empêche tout contrôle rigoureux et objectif, tel qu'il pourrait se faire ailleurs ; s'agissant par exemple des contrôles spécifiques émanant d'administrations techniques, le président Guy Canivet a fait observer devant la commission d'enquête que « La démarche est faussée par le présupposé selon lequel en prison la réglementation ne s'applique pas comme ailleurs, donc, sans aucune raison objective, l'application des règlements est considérablement relativisée, réduite, parfois inexistante. Or il faudrait que ces contrôles techniques s'opèrent en prison comme ailleurs. » Or les visites effectuées dans les établissements pénitentiaires ont toutes permis de montrer combien le personnel, et notamment les directeurs d'établissements, souhaitaient le renforcement des contrôles et inspections. Ce souhait correspond d'abord à un besoin de faire cesser le soupçon qui règne sur le monde carcéral, en ouvrant la prison au monde civil. Les visites des membres de la commission d'enquête, le plus souvent inopinées ont été révélatrices à ce sujet ; la phrase « vous verrez, on n'a rien à cacher, vous pouvez demander à aller où bon vous semble » a ainsi été maintes fois entendue par les parlementaires. Ce besoin de contrôle correspond également à un besoin de conseil et d'assistance technique ; s'agissant notamment du respect de normes complexes ou d'une législation touchant au droit du travail ou de la santé, les directeurs d'établissement sont très attentifs aux observations faites par les inspecteurs, d'autant plus que leur responsabilité peut être engagée. « Les directeurs d'établissement ne peuvent, je le répète, qu'être d'accord avec la notion de contrôle, d'autant qu'ils sont de plus en plus mis devant leurs responsabilités pénales. Un directeur régional a été mis en examen au motif qu'un accident s'était produit dans les ateliers de Fresnes. Nous sommes demandeurs de contrôles et de conseils, ce qui nous permettra de réclamer des moyens et de mettre en place la réglementation. » (M. Patrick Wiart, directeur à l'ENAP, membre du Syndicat national pénitentiaire FO de surveillance) Les propositions qui vont suivre et qui visent à renforcer le contrôle exercé sur les établissements pénitentiaires ne procèdent donc pas d'une logique de soupçon mais bien d'un souci de bonne administration. a) redéfinir les moyens et les missions des inspections S'agissant des missions effectuées par l'Inspection des services pénitentiaires, l'efficacité de ce contrôle se heurte, aux yeux de ses contempteurs, à son statut de contrôle interne à l'administration pénitentiaire ; son objectivité, dans un contexte qui peut se révéler tendu, et qui demande une certaine confidentialité, est contestée. Sans nullement adhérer à ce soupçon ou remettre en cause la qualité de son travail, il est vrai que la crédibilité de l'inspection des services pénitentiaires gagnerait à davantage de transparence dans l'exercice de ses missions d'enquête et des conclusions auxquelles elle a abouti. « M. le Rapporteur :Ne pensez-vous pas qu'un rapport d'inspection ou les futurs rapports de la mission qui pourrait être mise en place à la suite des propositions de M. Canivet auraient un rôle beaucoup plus important s'ils étaient rendus publics ou du moins accessibles à un certain nombre d'autorités ? En effet, si nous avions connaissance de leur contenu, nous chercherions ensemble les réponses à ces questions. L'opacité qui entoure les rapports et les inspections - je ne sais si elle est voulue, recommandée ou si elle résulte des textes réglementaires - ne nous autorise pas à avoir une vision normale de l'administration pénitentiaire et de la vie en prison. « M. Philippe Maître : Monsieur le Rapporteur, j'en conviens tout à fait. A vrai dire, je m'interroge sur les motifs pour lesquels ces rapports ne pourraient pas connaître une plus grande diffusion. Je crois d'ailleurs que le motif principal ne porte pas sur le contenu et, si je puis dire, j'ouvre mon armoire à qui veut les lire. Il n'y a rien de secret, rien de scandaleux, en dehors de ce que nous avons pu constater et qui peut constituer en soi un scandale, mais il n'y a pas de mystères ou de choses que l'administration pénitentiaire voudrait cacher. Il n'en reste pas moins que la situation est ainsi ; même si nous avons l'impression, nous, membres de l'administration pénitentiaire, d'être transparents, nous ne le sommes point. Selon moi, ce qui s'oppose le plus à la transparence c'est le souci, légitime, de la direction de l'administration pénitentiaire de maintenir avec les personnels ou avec leurs représentants des relations de bonne qualité. Il n'est jamais agréable pour des personnes qui font bien leur travail - certes, le corporatisme, le sentiment de solidarité entrent en ligne de compte - de voir stigmatiser l'un des leurs et donner à penser, surtout au travers de la relation qui peut en être faite dans certains organes de presse, que le dysfonctionnement que l'on souligne est d'ordre général. Cela contribue à ajouter une couche supplémentaire d'opprobre sur des agents, qui, pour l'essentiel, exercent parfaitement bien leur métier et ont des sentiments très éloignés de ceux qu'on leur prête à tort. En disant cela, je suis d'une parfaite sincérité. » Cependant, davantage que la question des suites données aux missions de l'Inspection des services pénitentiaires, se pose la question de ses moyens. Les chiffres donnés à ce sujet traduisent toute l'ampleur du problème ; pour 295 structures déconcentrées à contrôler (186 établissements pénitentiaires, 100 services pénitentiaires d'insertion et de probation, et de façon théorique, 9 directions régionales), l'Inspection des services pénitentiaires dispose de cinq inspecteurs des services pénitentiaires. Compte tenu de ces effectifs étiques, il est bien évident que le contrôle effectué par l'Inspection des services pénitentiaires n'a qu'une ampleur limitée : « Je me suis fait communiquer la liste des établissements et la date à laquelle ils avaient reçu, non la dernière inspection, mais la visite d'un membre de l'administration centrale. En effet, à la suite d'une visite dans une grande maison d'arrêt du Nord, j'avais été surpris des remerciements empressés que m'avait adressés le directeur. La raison en était que cela faisait onze ans qu'il n'avait vu personne de l'administration centrale ! Mon exemple est un peu caricatural, n'en doutez point, mais des établissements - de moins en moins parce que nous nous y sommes attachés au cours des dernières années - ont été peu visités. Il s'agit généralement de petits établissements dont on ne parle pas. Si j'étais méchant, je dirais que ceux dont on ne parle pas sont ceux qui sont mal desservis par l'avion ou le train. Quand on procède à une évaluation, le temps étant compté et les horaires de travail limités, on va au plus significatif, au plus connu et on néglige parfois une petite maison d'arrêt qui mériterait tout autant l'attention car il peut s'y produire des faits critiquables. Cela s'inscrit dans la droite ligne de ma demande de renforcement des effectifs. » (Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) Il est dès lors indispensable, si l'on veut un contrôle interne digne de ce nom et susceptible d'avoir une réelle efficacité, de renforcer les effectifs de l'Inspection des services pénitentiaires. Une telle mesure contribuerait sans nul doute à donner plus de crédit à une politique de transparence revendiquée par l'administration pénitentiaire. Sans méconnaître les difficultés d'un accroissement des effectifs, M. Philippe Maître faisait l'analyse suivante : « A la question de savoir s'il faut accroître les effectifs de l'inspection des services pénitentiaires, la réponse est oui, dans une proportion raisonnable ; [...] L'idéal vers lequel il faut tendre, mais qui nécessitera plusieurs années, serait de disposer d'une dizaine d'inspecteurs pénitentiaires afin d'instaurer trois ou quatre équipes qui tourneraient en permanence, ce qui ne serait pas extraordinaire. Beaucoup de choses restent à améliorer en termes de fréquence des inspections. Je pense qu'il faudrait également un magistrat supplémentaire, parce que les pénitentiaires ont une spécificité en matière de recherche des faits. La conduite des procédures, surtout si elles doivent déboucher sur des procédures disciplinaires est en principe, du ressort des magistrats. Il conviendra donc de renforcer la capacité en magistrats et en fonctionnaires pénitentiaires. On peut songer - Mme Viallet m'en a parlé - à s'adjoindre des hauts fonctionnaires d'autres corps comme, par exemple, de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, afin d'accroître ou de développer une capacité d'inspection dans un domaine qui nous est totalement étranger, celui de la comptabilité, alors que se font jour des dérives hautement condamnables et critiquables. » Sur la teneur même de la mission effectuée par l'Inspection des services pénitentiaires, la coordination de ses contrôles avec les enquêtes menées par les autorités judiciaires paraît source de difficultés. « L'un des grands problèmes que rencontre l'inspection réside dans l'articulation de ses missions avec celles des autorités judiciaires, même si ce fait n'est pas spécifique à l'administration pénitentiaire. Un dysfonctionnement qui se produit dans une prison peut être purement pénitentiaire : on a laissé une porte ouverte ou oublié une mesure de sécurité. D'autres dysfonctionnements sont des faits de droit commun qui se sont produits dans une prison : par exemple, un surveillant reçoit un coup de couteau et réplique par un autre coup de couteau. Une instruction est alors ouverte. L'inspection pénitentiaire envoyée sur place est confrontée à une affaire extrêmement compliquée : il y a quatre témoins du personnel de surveillance, il y a du sang de provenance différente dans la cellule et des détenus, depuis la coursive, ont aperçu une partie de la scène. Une information est ouverte. Les inspections administratives se trouvent dans une situation très difficile. D'abord, en raison de l'interférence entre les officiers de police judiciaire présents, missionnés par les magistrats, et l'inspection administrative. J'ai toujours laissé la priorité à la justice pour savoir qui entendra le premier, ce qui revêt d'ailleurs une certaine importance, puisqu'une audition ne se fait qu'une fois. Cela a conduit à un certain nombre de déconvenues. Deux ou trois fois, l'inspection administrative étant passée avant les officiers de police judiciaire, certains magistrats en ont conçu une forte mauvaise humeur au motif que nous aurions déstabilisé l'enquête judiciaire, ce qui, bien évidemment, n'était pas notre intention. Dans la mesure où elle n'a pas compétence pour ordonner une analyse de sang, pour organiser des confrontations ni pour entendre des personnes à l'extérieur des prisons, alors qu'il arrive que des faits graves aient eu un témoin extérieur et ne peut non plus se déplacer pour l'entendre, très rapidement, l'inspection administrative est bloquée. Reste enfin - c'est un sujet qui dépasse de très loin notre sujet d'aujourd'hui - la question de l'accès des inspections administratives aux dossiers. On est là dans une situation qui est véritablement difficile à comprendre. Dans certains cas, on me donne la copie de la procédure de police à titre officiel, d'autres fois à titre officieux, avec le droit de m'en servir ou bien sans ce droit. Parfois on me la refuse ou on me la transmet par l'intermédiaire du garde des sceaux. A chaque fois la décision prise s'appuie sur une interprétation de la règle selon laquelle les enquêtes et les instructions sont secrètes. Cette règle n'a pas été respectée très longtemps mais la pratique emporte un risque important pour le magistrat et pour les inspecteurs qui peuvent se voir accuser de recel, de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, pour avoir voulu faire correctement leur métier et tenter de s'inspirer des procédures judiciaires qui sont, dans bon nombre de cas, bien mieux nourries et plus efficaces que celles dont dispose une inspection administrative pour conduire une enquête. » (Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) Il convient donc de clarifier les missions de l'Inspection des services pénitentiaires en déterminant précisément les modalités de coopération avec l'autorité judiciaire. Cette coopération doit également être mieux articulée avec les autres inspections techniques : « Le suivi médical des détenus n'incombe plus à l'administration pénitentiaire depuis que le service médical n'est plus de sa responsabilité mais incombe entièrement au ministère de la Santé. Cela pose le problème de l'articulation des inspections, quand des dysfonctionnements se produisent à la limite du service médical et du service pénitentiaire. Un détenu a-t-il été secouru assez rapidement ? A quel moment a-t-il appelé ? Nous avons compétence pour enquêter sur la partie pénitentiaire, l'IGAS sur la partie médicale. L'articulation des deux inspections, qui, pour l'heure, s'entendent très bien, mériterait peut-être d'être mieux définie ou du moins d'être officiellement prévue. » (Philippe Maître, chef de l'Inspection des services pénitentiaires) b) mettre fin à l'indifférence des magistrats pour la prison Les visites des établissements pénitentiaires, comme les auditions menées par la commission d'enquête, ont révélé l'éloignement des magistrats du monde carcéral, alors même que ceux-ci ont une responsabilité directe dans la décision d'incarcérer et dans les conditions de fonctionnement des établissements pénitentiaires. Il faut préciser, de manière certes anecdotique, que la création de commissions d'enquête parlementaires semble avoir suscité un nouvel engouement chez les magistrats, beaucoup d'entre eux ayant retrouvé le chemin de la prison juste avant les visites des parlementaires... L'explication de ce désintérêt manifeste réside en premier lieu dans l'absence d'une mission spécifique de contrôle confiée par les textes aux magistrats, en second lieu dans l'absence de moyens matériels permettant aux magistrats de s'intéresser au monde pénitentiaire. Les fonctions et les attributions des magistrats concernant les établissements pénitentiaires se limitent, dans les textes, à un pouvoir de visite, assorti éventuellement de l'obligation de rédiger un rapport au garde des sceaux. Aucun pouvoir contraignant ne permet cependant d'assurer un suivi véritable des observations formulées. Même le juge de l'application des peines, qui est le plus impliqué dans la vie quotidienne de l'établissement, n'a pas un rôle clairement défini en matière de contrôle : « Le juge de l'application des peines aurait pu se trouver, selon les souhaits de l'époque, investi d'une fonction générale de contrôle de l'administration pénitentiaire. Or on n'a jamais clairement pris parti et assigné au juge de l'application des peines une mission de contrôle général de la vie pénitentiaire. On ne l'a jamais dit et on ne lui a jamais donné les moyens de le faire. Ces juges s'intéressent à la prison, où ils se rendent pour présider les commissions d'application des peines et où ils sont investis d'une mission d'individualisation de la peine mais les pouvoirs qui leur ont été attribués aux termes de l'article D.176 du code de procédure pénale : vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés exécutent leur peine, ne leur permettent pas d'exercer un vrai contrôle sur le fonctionnement de la prison. S'il est vrai que les magistrats n'ont pas manifesté un intérêt suffisant pour les conditions de détention ou le fonctionnement des prisons - je ne dirai pas le contraire et ne cherche pas à les défendre au nom d'un corporatisme excessif - je souligne qu'il n'y a pas de position claire sur leur mission ni de pouvoirs suffisants pour l'exercice d'un contrôle effectif... On n'a jamais dit à une catégorie de juges qu'ils avaient un pouvoir général de contrôle des établissements pénitentiaires. (Guy Canivet, Premier Président de la cour de cassation) Les juges d'instruction dont la sensibilisation au monde pénitentiaire paraît essentielle si l'on veut espérer voir un jour le nombre de détentions provisoires diminuer, disposent également, en vertu de l'article D.177 du code de procédure pénale, du droit de visiter la maison d'arrêt et de voir les prévenus aussi souvent qu'ils le souhaitent. Cette disposition permet d'imposer aux magistrats une attention toute particulière aux personnes provisoirement détenues dans le cadre d'une information. Il semble néanmoins se dégager un constat unanime sur l'absence des juges d'instruction en détention Pour justifier leur absence, les juges d'instruction mettent en avant le fait que ce droit de visite prévu par les textes est ambigu et mal défini : « Vous pourriez me demander pourquoi nous ne leur rendons pas visite, car il est vrai que les juges d'instruction rencontrent très peu souvent, contrairement au juge de l'application des peines, leurs prévenus ? Mais ces visites présentent un caractère ambigu. Dès lors qu'une personne est mise en examen, on ne peut l'interroger qu'en présence de son avocat. Si l'on rend visite au prévenu, non pour évoquer le dossier mais ses conditions de détention, la situation sera très ambiguë, dans la mesure où le prévenu ne fait pas la différence entre les causes de sa détention et la détention elle-même ; il ne fera pas la distinction dans son discours et parlera inéluctablement du dossier, ce qui est pour nous impossible hors la présence de l'avocat, ce que le prévenu ne pourra comprendre. Nous ne rendons donc pas visite au prévenu bien souvent pour cette raison : pour ne pas nous trouver confrontés à des confidences, à des aveux, qui seraient recueillis dans des conditions qui ne seraient pas du tout légales ou bien qui pourraient être exploitées d'une façon peut-être logique, mais également abusive par la défense qui nous reprocherait d'avoir voulu faire pression pour obtenir des renseignements de la part du prévenu en son absence. Il est par conséquent difficile de rendre visite au prévenu en dehors d'un contexte d'interrogatoire. » (Mme Sophie-Hélène Château, représentant l'Association française des magistrats chargés de l'instruction) Il conviendrait donc, dans le cadre d'une loi pénitentiaire, de mieux définir les pouvoirs de contrôle des magistrats sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires, en attribuant notamment au juge d'application des peines un véritable pouvoir d'injonction. Il conviendrait également, dans une optique de sensibilisation des autorités judiciaires, d'accroître la formation des magistrats sur le monde pénitentiaire, cette formation se limitant pour l'instant, dans le cadre de l'Ecole nationale de la magistrature, à un stage de quelques semaines en détention. Toutefois, au-delà de la réformation des textes, il faut être conscient de la lourdeur de la tâche qui incombe aux magistrats, rendant ainsi leur mission de contrôle des établissements pénitentiaires extrêmement difficile à remplir. Ainsi, les juges de l'application des peines ne disposent ni des effectifs, ni des moyens indispensables à leur mission de contrôle : « 177 postes de juges de l'application des peines sont budgétés. Les juges de l'application des peines ont à la fois la charge du milieu fermé, c'est-à-dire de la détention et des aménagements de peine en détention, et de ce que l'on appelle « le milieu ouvert », c'est-à-dire le suivi des personnes condamnées à des sursis avec mise à l'épreuve ou à des travaux d'intérêt général ainsi que le suivi des alternatives à l'incarcération dans le cadre de la procédure prévue par l'article D.49-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, les juges de l'application des peines interviennent dans le cadre de la politique de la ville au travers des contrats locaux de sécurité et des conseils communaux de prévention de la délinquance. Ils participent en outre aux activités générales du tribunal et siègent en correctionnelle. Ceci permet d'apprécier l'ampleur de la tâche qui leur est confiée. [...] Les juges de l'application des peines sont en nombre très insuffisant compte tenu des fonctions dont ils ont la charge. Même ceux dont les postes sont budgétés participent à l'activité du tribunal, aux permanences, aux assises. Au tribunal du Val-de-Marne, nous sommes quatre juges de l'application des peines. Nous sommes en charge des détenus de Fresnes et du milieu ouvert dans un département qui compte quarante-trois communes, donc quarante-trois conseils communaux de prévention de la délinquance, vingt-deux contrats locaux de sécurité et trois mille personnes en milieu ouvert. Je siège à la commission d'indemnisation des victimes une fois par mois. A quatre, nous assurons une participation à six audiences correctionnelles par mois et aux assises une semaine par trimestre. Nous traitons de l'ensemble du milieu ouvert. 640 personnes condamnées à moins d'un an sont à convoquer pour étudier une possible alternative à l'incarcération. Il est évident que l'application des peines est minoritaire dans notre emploi du temps. Je ne dispose pas de secrétariat véritable, en tout cas pas pour le milieu fermé. Je n'ai manifestement pas le temps de répondre aux lettres des détenus, ni même celui d'entendre beaucoup de détenus. Dans notre charge de travail, le milieu fermé n'est jamais pris en compte. Telle est la réalité. » (Mme Marie-Suzanne Pierrard, présidente de l'Association nationale des juges de l'application des peines) Les juges d'instruction sont confrontés à la même charge de travail : « Je pense, en effet, qu'il faudrait que nous nous rendions plus souvent dans les maisons d'arrêt et dans les maisons centrales. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, les journées ne font que vingt-quatre heures. Au vu de la somme de travail qui nous est demandée, du nombre de dossiers dont nous sommes chargés, il nous est très difficile de dégager du temps pour nous rendre régulièrement dans les établissements pénitentiaires. Sans doute est-ce la seule explication que nous puissions vous donner, en étant tout à fait d'accord avec vous sur l'utilité de nous déplacer plus souvent pour visiter les maisons d'arrêt ou les centres de détention. Cela nous permettrait tout d'abord de rencontrer les gens, notamment les personnes qui exécutent notre mandat de dépôt. » (M. Jean-Baptiste Parlos, représentant l'Association française des magistrats chargés de l'instruction) La question des moyens mis à la disposition de la justice dépasse le cadre de cette commission d'enquête. Il faut néanmoins convenir que de l'adéquation de la réponse budgétaire dépend la solution d'un grand nombre de dysfonctionnements relatifs aux établissements pénitentiaires. c) redéfinir les missions de la commission de surveillance La commission de surveillance présidée par le préfet et composée d'autorités administratives et judiciaires locales semble unanimement décriée : « visites de château », « raout mondain », les termes utilisés indiquent effectivement les limites d'une telle réunion. S'il est vrai que les pouvoirs réels de la commission de surveillance peuvent être mis en doute, il semble toutefois hâtif de réclamer sa suppression ; la commission de surveillance permet, à n'en pas douter, l'existence d'un regard extérieur sur les prisons, différent de celui des magistrats ou des intervenants habituels de la prison. En outre, la qualité des rapports rédigés par les directeurs d'établissement dans le cadre de la préparation de la commission de surveillance témoigne d'une volonté certaine de communication et de transparence. Il serait dommage de casser une dynamique qui s'est réellement mise en place. Il faudrait néanmoins redéfinir les missions de cette commission de surveillance; la commission présidée par M. Guy Canivet a souhaité, dans cette optique, la rendre responsable de la mise en cohérence de l'ensemble des contrôles administratifs et techniques exercés sur l'établissement. 3) Instaurer un contrôle extérieur efficace La question du contrôle extérieur des prisons a été au centre des discussions de la commission d'enquête ; l'audition de M. Ivan Zakine, membre du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), a permis de réfléchir à ce que devrait être l'autorité impartiale chargée de vérifier les conditions de détention. Organe indépendant international, le CPT procède à des visites inopinées des lieux de contrainte et de détention dans tous les pays du Conseil de l'Europe. La réflexion sur le contrôle extérieur a également porté sur la responsabilité des politiques et du législateur en matière d'établissements pénitentiaires. Cette réflexion s'est trouvée concrétisée par l'adoption, à l'unanimité, d'un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann à la loi sur la présomption d'innocence, autorisant les députés et les sénateurs à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires. Il serait souhaitable que cette nouvelle forme de contrôle trouve sa prolongation dans l'instauration d'une mission de suivi permanent au sein de la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires était également le thème de réflexion de la commission présidée par M. Guy Canivet, premier président de la cour de cassation. « S'agissant des modalités du contrôle extérieur, notre groupe de travail en a distingué trois fonctions essentielles. La première est le contrôle strictement compris, c'est-à-dire la vérification ou l'inspection des prisons, sur le modèle pratiqué par le comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe et destiné à s'assurer, par des moyens appropriés et contraignants, que l'administration remplit correctement sa mission à l'égard des détenus et ne pratique à leur égard aucun traitement contraire à la dignité. Cette fonction serait assurée par un service de « contrôle général ». La deuxième est l'apaisement par la médiation, c'est-à-dire le traitement des requêtes individuelles des détenus contre l'administration et le règlement des litiges de la vie pénitentiaire. Il faut, pour décrisper la vie en prison, qu'existe un médiateur pénitentiaire pour traiter des conflits entre le détenu et l'administration et éviter les réactions de soumission ou de révolte. La troisième est une fonction d'observation : dans tous les grands systèmes pénitentiaires, il existe un regard extérieur sur la prison assuré par des personnes, mues par un esprit civique particulier, qui acceptent de participer à la vie pénitentiaire, de rencontrer des détenus en détention pour être, à l'extérieur, les garants du traitement digne et correct de ces détenus. Pour qu'un tel contrôle extérieur soit effectif, il doit être exercé, dans toutes ses modalités, par des organes indépendants de l'administration dotés de moyens et pouvoirs suffisants. Il convient, en outre, de mettre en cohérence l'ensemble de ces contrôles administratifs ou judiciaires existants, cohérence que nous proposons d'assurer de deux manières : au niveau national, en donnant au contrôleur général la mission de rassembler tous les contrôles techniques et de les évaluer afin de pousser les administrations à mieux exercer les missions spécifiques dont elles sont chargées en prison, au niveau local, en confrontant annuellement, au sein d'une commission d'établissement, le rapport d'activité du chef d'établissement avec tous les contrôles techniques réalisés localement, c'est-à-dire dresser un bilan et tirer les conséquences de l'action en prison de toutes les administrations extérieures : santé, éducation, travail, hygiène, etc. » (M. Guy Canivet, Premier Président de la cour de cassation) Le système proposé par la commission Canivet, qui attribue à un contrôleur général des prisons la fonction de vérification, à des médiateurs de prison, la fonction de médiation et à des délégués des médiateurs la fonction d'observation, apparaît quelque peu complexe ; à trop scinder de façon quelque peu artificielle les fonctions de contrôle, on risque d'aboutir à une dissémination qui nuit à une vision globale de l'administration pénitentiaire. La mise en place d'un contrôle extérieur paraît pour autant indispensable ; il faut absolument que puisse être contrôlé dans quelles conditions s'effectue un acte aussi grave que celui de priver quelqu'un de sa liberté. Cette exigence ne participe pas du tout d'une logique du soupçon qui règne actuellement à l'encontre de l'administration pénitentiaire. Elle doit être au contraire vécue comme le seul moyen de faire cesser le soupçon et de montrer, de façon impartiale et incontestable, que l'administration pénitentiaire remplit convenablement les missions qui lui sont assignées. Elle doit permettre de briser la loi du silence qui régit encore trop souvent les prisons. L'exemple canadien pourrait dans cette optique constituer un cadre de réflexion intéressant. La création d'un organisme indépendant chargé de traiter les plaintes des détenus remonte à 1973 et répondait à la demande formulée par une commission d'enquête. La loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, grande loi pénitentiaire entrée en vigueur en novembre 1992, comporte une troisième partie consacrée au contrôle des établissements pénitentiaires et précise le rôle, les pouvoirs et les responsabilités de « l'enquêteur correctionnel », ombudsman des détenus en établissements fédéraux, c'est-à-dire condamnés à une peine supérieure à deux ans. L'enquêteur correctionnel est indépendant du service correctionnel du Canada et est chargé d'étudier les plaintes formulées par les détenus et d'y répondre. Il peut également prendre lui-même l'initiative d'une enquête ou intervenir à la demande du ministre de tutelle du service correctionnel, le sollicitor general. L'enquêteur correctionnel est nommé en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il dispose d'une équipe de fonctionnaires assermentés. Les détenus peuvent saisir l'enquêteur correctionnel par téléphone en cas d'urgence. Est considérée comme une urgence une situation dans laquelle le détenu n'arrive pas à résoudre immédiatement un problème susceptible de lui occasionner des difficultés sérieuses ou une infraction aux droits du détenu. Hors urgence, le détenu doit saisir l'enquêteur par écrit. Pour mener une enquête, l'enquêteur correctionnel a accès à tous les renseignements et documents que possède le service correctionnel. Il peut entendre sous serment qui bon lui semble. A l'issue de l'enquête, l'enquêteur émet des recommandations à l'intention de l'administration pénitentiaire, mais n'a pas de pouvoir décisionnel. Il dépose chaque année un rapport au Parlement. Indépendamment des enquêtes faisant suite à une plainte, les enquêteurs rencontrent régulièrement des comités de détenus et font des visites annoncées dans les établissements à l'occasion desquelles les prisonniers peuvent demander à les rencontrer. En 1999, le Bureau de l'enquêteur a reçu 4 529 plaintes. Elles concernent tous les aspects de la détention : isolement, placement en cellule double, occupation des cellules, régime alimentaire, services de santé, accès aux visites familiales, accès aux programmes de réinsertion, violences, etc. Lors de son déplacement au Canada, la commission a été accompagnée, au cours de ses visites d'établissements fédéraux, par un responsable des services de l'enquêteur correctionnel et a pu constater que le personnel pénitentiaire admet parfaitement cette fonction qui bénéficie, il est vrai, d'une expérience de près de trente ans. La commission d'enquête s'est déclarée favorable à la création d'une seule instance, aux pouvoirs étendus qui pourrait prendre la forme d'une Délégation générale à la liberté individuelle chargée de contrôler tous les lieux d'enfermement. Dans notre pays, il existe en effet de multiples lieux de rétention, d'enfermement, de privation de liberté. Les plus importants ont pour rôle la sanction, le rappel à la loi, la préparation d'une enquête, une instruction judiciaire. Ces lieux concernent l'ensemble des établissements relevant de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les locaux de garde à vue dépendant du ministère de l'Intérieur (les commissariats), du ministère de la Défense (les compagnies ou brigades de gendarmerie). A ces lieux, on peut ajouter les espaces d'hospitalisation ou de soins réservés aux détenus et prévenus dans le système hospitalier. Ce ne sont pas les seuls lieux d'enfermement. On peut y ajouter les centres de rétention et de regroupement des étrangers susceptibles d'être expulsés, les locaux militaires de mise aux arrêts, les hôpitaux psychiatriques. La Délégation générale à la liberté individuelle devra assurer la transparence nécessaire dans un état de droit, sur le fonctionnement et les conditions d'utilisation des lieux d'enfermement, afin d'assurer les citoyens de leur juste utilité, d'éviter les abus, de rassurer les personnels et responsables de ces services sur leurs nécessaires missions. Elle ne pourra se substituer aux missions d'inspection des services dont disposent les différents ministères, tuteurs de ces lieux, ni aux commissions d'enquête parlementaires que pourraient décider le Sénat ou l'Assemblée nationale, ni aux commissions que le pouvoir exécutif mettrait en place pour envisager des propositions et solutions novatrices. Elle visitera, quand elle le voudra, tout ou partie des lieux d'enfermement, donnera son avis sur leur situation, sur les problèmes qu'ils pourraient engendrer. Elle enquêtera sur les incidents, accidents dont elle aurait connaissance. Pour ce faire, elle entendra qui elle jugera utile et pourra se faire remettre toutes les pièces, dossiers, rapports utiles à la bonne connaissance des faits. La Délégation générale à la liberté individuelle aura accès aux dossiers personnels des privés de liberté, hors leur dossier médical, mais elle pourra s'entretenir avec les médecins et le personnel médical. Elle pourra connaître des rapports médicaux en cas de maltraitance, de dénonciation de maltraitance, de maltraitance supposée, ainsi que des rapports d'enquêtes après les tentatives de suicides ou les suicides, y compris des rapports d'autopsie. La Délégation générale à la liberté individuelle pourra recevoir plaintes et dénonciations de tous citoyens ou associations reconnues. Les courriers adressés par les personnes privées de liberté bénéficieront de la confidentialité. La Délégation générale à la liberté individuelle fera rapport après chaque intervention ou visite. Elle établira un rapport d'activité qui comportera des propositions de correction des anomalies qu'elle aura constatées dans sa mission. Ce rapport sera adressé au Premier ministre et aux membres des assemblées parlementaires. La Délégation générale à la liberté individuelle sera rattachée au Premier ministre. Le délégué général, personnalité reconnue, sera nommé en conseil des ministres ainsi que les délégués régionaux, les délégués dans les territoires et départements d'outre-mer. Ceux-ci dépendront hiérarchiquement du délégué général. Ces fonctions seront limitées dans le temps et, en tout état de cause, ne pourront dépasser deux fois quatre ans. IV.- AMÉLIORER UNE PRISE EN CHARGE DÉFICIENTE A.- REPENSER UNE MISSION D'INSERTION TROP SOUVENT RELÉGUÉE AU SECOND PLAN 1) Les contraintes du cadre carcéral a) La prédominance des impératifs de sécurité La question de la prédominance des impératifs de sécurité renvoie aux missions assignées à la prison, et principalement à celle, primordiale, d'assurer la garde des personnes placées en détention. Les termes utilisés par la loi du 22 juin 1987 sont d'ailleurs très clairs dans la hiérarchisation des principes : l'administration pénitentiaire participe à la sécurité publique ; elle favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. La mission de garde est donc clairement conçue par les textes législatifs comme prioritaire ; cette priorité est liée objectivement à l'impératif de protection de la société par une neutralisation immédiate du délinquant. Il faut mettre au crédit de l'administration pénitentiaire que cette mission est bien remplie et que la prison répond à cet égard aux objectifs qui lui sont assignés : « La mission de sécurité est plutôt bien remplie, selon les statistiques, puisque l'on compte moins de vingt évasions par an ces dernières années. Ce chiffre est stable et donc rassurant, même s'il convient de l'améliorer encore. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) Le taux d'évasion pour 10 000 détenus en 1996 est de 6,2 pour la France ; ce taux atteint 18 en Allemagne, 25 en Angleterre et Pays de Galles, 23 en Autriche, 108 en Norvège, 120 en Suède et 347 au Danemark. L'Italie, avec 3,9 évasions pour 10 000 détenus, la Pologne (4,2), la Finlande (1,5) et l'Espagne (0,9), obtiennent des résultats en termes de sécurité meilleurs que la France. Affirmée par les textes, la prédominance de l'impératif de sécurité semble avoir été totalement intégrée et relever d'une véritable « culture pénitentiaire ». Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler les termes du discours de Jean Foyer, garde des sceaux, aux directeurs régionaux des services pénitentiaires en 1964 : « par-dessus tout, chaque agent de l'administration pénitentiaire doit se souvenir à tout instant que la mission primordiale de son administration est d'assurer la garde des détenus qui lui sont confiés par décision judiciaire. L'évasion est la plus grande faute du service pénitentiaire. Elle est facteur de démoralisation, elle est cause de scandale. Tous les agents de cette administration doivent être dans une véritable angoisse de l'évasion, appliquer le règlement, et tout le règlement, bien plus encore appliquer leur intelligence, leur générosité, leur zèle au renforcement de la sécurité. » Certes, beaucoup de chemin a été parcouru depuis. La prison des années 60 n'a plus grand chose à voir avec celle du XXIème siècle. Pour autant, la crainte de l'évasion et des désordres semble toujours primer toute considération, y compris, bien sûr, celle de l'insertion : « La difficulté vient du décalage formidable entre la théorie et la réalité du terrain. Il en résulte un gâchis extraordinaire des compétences. Quand les jeunes arrivent dans l'établissement, on leur dit d'oublier ce qu'ils ont appris en sciences humaines ou en psychologie. Le principal est que le détenu ne s'évade pas. De toute façon, le nouveau apprend très vite qu'il vaut mieux « dix pendus qu'un évadé ». La preuve en est qu'en cas d'évasion, le surveillant passe au conseil de discipline, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'un suicide a lieu. M. le Président : Ce que vous dites est terrible ! M. Désiré Derensy : C'est terrible, mais c'est la vérité. Il vaut mieux pour un surveillant un détenu qui se suicide ou qui tente de se suicider plutôt qu'un détenu qui s'évade, quelle que soit la dangerosité de l'un ou de l'autre. On comprend très vite ces choses. La règle est que le calme règne à l'étage, quitte à fermer les yeux. Il en résulte une certaine adaptation du règlement. » (M. Désiré Derensy, membre de l'union générale des syndicats pénitentiaires CGT) Il faut rappeler à cet effet que l'article D.265 du code de procédure pénale rend le directeur d'établissement disciplinairement responsable des incidents ou évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements. Quand on ajoute à cette disposition celle de l'article D.268 qui enjoint au directeur de prendre toute disposition en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs ou chemins de ronde, on perçoit les responsabilités qui incombent au personnel pénitentiaire. Il est difficile, pour un observateur extérieur, de déterminer exactement, dans un établissement, quel est le degré de contrainte exact impliqué par l'impératif sécuritaire et ce qui relève purement de la psychose de l'évasion. Il n'est en effet pas question de demander au personnel pénitentiaire de prendre le moindre risque sur le sujet, tant le regard de l'opinion publique est exigeant. Il ne s'agit pas dès lors de prôner toute forme de laxisme en la matière ; il s'agit simplement de constater que l'impératif de sécurité conditionne largement l'exercice de tous les autres droits, y compris celui d'obtenir des conditions décentes de réinsertion. Héritage historique et juridique, la culture sécuritaire correspond également à une évidence : la mission sécuritaire est une mission qui peut être évaluée et quantifiée ; elle répond à un « cahier des charges » précis auquel peut se référer le personnel pénitentiaire. La mission d'insertion relève d'objectifs beaucoup plus lointains sans qu'aucune norme n'ait jamais été édictée en la matière. La récidive est certes vécue au jour le jour par les surveillants qui voient souvent revenir à intervalles réguliers les mêmes délinquants. Elle n'est cependant pas directement vécue, faute d'objectifs aisément identifiables, comme un échec du système pénitentiaire dans son ensemble. « Il est curieux de voir comment la mission de garde est bien déclinée en gestes professionnels - fouille, tenue des effectifs, etc. - et de ce fait évaluée, alors que la mission de réinsertion ne l'a jamais été. » (M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris) Il semblerait dès lors qu'en l'absence d'évaluation claire des objectifs d'insertion, l'administration pénitentiaire se recentre sur cet impératif sécuritaire en alignant les régimes de détention sur des critères répondant à l'incarcération des détenus les plus dangereux ; ce recentrage résulte de l'impossibilité d'évaluer de manière approfondie la dangerosité des individus et d'en tirer les conséquences sur l'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires. Certes, la distinction entre établissements existe et l'affectation entre maison centrale et centre de détention national résulte théoriquement de critères liés à la dangerosité. En pratique, la distinction entre régimes n'est pas aussi évidente que cela ; en outre, elle ne s'applique qu'aux établissements pour peine. En maison d'arrêt, tous les détenus, qu'ils soient prévenus et donc présumés innocents, ou condamnés (en principe à de courtes peines) quelle que soit l'infraction commise ou supposée commise - vol de poule ou meurtres en série - sont soumis au régime d'incarcération le plus sévère, caractérisé par l'enfermement et des communications très réduites avec l'extérieur. L'expérience canadienne paraît une fois de plus éclairante : chaque détenu nouvellement incarcéré fait l'objet d'une observation attentive afin de procéder à une évaluation de ses capacités et d'apprécier sa dangerosité. Cette évaluation détermine l'affectation en établissement et conditionne également le parcours d'insertion qui sera effectué : la durée d'incarcération n'est donc pas conçue comme une neutralisation du délinquant pendant un temps déterminé, mais comme une démarche progressive vers la sortie. Trois niveaux de sécurité existent correspondant à des régimes de détention très différents : - Les établissements à sécurité maximale, au nombre de huit, sont principalement conçus de manière à empêcher les évasions. Ceux qui y sont détenus représentent 11 % de la population carcérale canadienne ; ils font l'objet d'une surveillance étroite. L'unité spéciale de détention qui concerne environ 70 détenus et que la délégation de la commission a visitée, est encore plus sécuritaire et est réservée aux délinquants très violents. - Les établissements à sécurité moyenne sont dotés d'un important dispositif de sécurité périmétrique mais à l'intérieur, les détenus sont plus libres de leurs mouvements. Ils abritent plus de la moitié des détenus (56,3 %). - Enfin, les établissements à sécurité minimale, qui concernent 22,8 % de la population incarcérée, ne comprennent pas de dispositif visible de sécurité périmétrique ni interne. Le classement du détenu est révisé périodiquement en fonction de son comportement. Il n'y a plus, dans ce système, véritablement d'antagonisme entre sécurité et insertion : les deux principes répondent à une même logique de prévention de la récidive. Le système français ne semble pas à même en l'occurrence de dépasser ce dilemme : « L'administration pénitentiaire et les juges de l'application des peines répondent à des logiques différentes. Elles peuvent se rencontrer comme s'affronter. La logique d'un directeur d'établissement est une logique d'ordre et de sécurité. Il ne veut pas de problèmes. Il a aussi des besoins propres et recourt aux « classés », les détenus qui travaillent au service général. La logique du juge de l'application des peines relève d'une logique d'individualisation. Le juge de l'application des peines peut estimer qu'une personne de caractère difficile et dont les relations avec les surveillants sont délicates - je prendrai l'exemple du jeune « beur » de banlieue qui a un rapport avec l'autorité ou au respect qu'on lui doit un peu difficile - a des potentialités de réinsertion si on l'aide vraiment. On peut donc se trouver face à des logiques complètement différentes. » (Mme Marie-Suzanne Pierrard, présidente de l'association nationale des juges de l'application des peines) Il importe pourtant de comprendre que les deux critères ne sont pas antagoniques mais complémentaires : on ne gère pas une détention en fonction du simple objectif de sécurité, avec comme risque de rendre explosive l'atmosphère des prisons. La politique d'insertion participe donc également à une mission de sécurité, en permettant au détenu de se réapproprier son avenir au lieu de gérer du mieux qu'il le peut la frustration de l'instant. Elle est d'autant plus nécessaire que, tôt ou tard, la plupart des détenus sortiront ; l'objectif sécuritaire bien compris ne concerne pas que le détenu incarcéré ; il implique que l'on s'intéresse aussi à ce qu'il deviendra une fois rendu à la société. b) Un cadre carcéral qui a pu apparaître comme antagonique avec l'objectif d'insertion Les visites des établissements ont souvent été l'occasion de constater combien l'objectif d'insertion paraissait extrêmement lointain, compte tenu du cadre même de l'univers pénitentiaire. L'article D.460 du code de procédure pénale rappelle pudiquement une évidence : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus. » La prison est en effet un monde où le détenu est totalement déresponsabilisé et infantilisé ; poursuivre une mission d'insertion dans ce cadre-là relève du défi dans la mesure où aucune démarche volontaire n'est demandée et rien, si ce n'est l'obéissance aux règles, n'est imposé. Le détenu est nourri à heures fixes ; il n'a plus, depuis la loi du 22 juin 1987, l'obligation de travailler et conformément au principe selon lequel l'enfermement, c'est la privation de la liberté et rien d'autre, il n'est soumis à aucune obligation contraignante : « Le constat de la déstructuration de la vie sociale est tout à fait réel. Les anciens pénitentiaires regrettent le temps où l'on obligeait les détenus à se lever à sept heures. On criait « fixe » quand un magistrat entrait dans une cellule, ce qui m'a toujours paru quelque peu dépassé, même il y a vingt ans. Le lit était fait au carré. Bref, l'encadrement était quelque peu militaire. L'évolution des idées a permis de l'éviter, à juste titre, sur un certain nombre de points. Cela dit, à l'heure actuelle, les visiteurs extérieurs ont parfois le sentiment inverse. On entre à neuf heures du matin dans des cellules doubles ou triples dans lesquelles deux ou trois détenus dorment et trouvent particulièrement indisposant cette intrusion à une heure aussi indue ! Les détenus peuvent refuser la promenade ou les activités. Cela participe de l'idée qui a été développée, à laquelle on peut ou non adhérer, selon laquelle la sanction réside uniquement dans la privation de liberté et que, pour le reste, le détenu doit avoir, dans une certaine mesure, les mêmes droits que ceux qu'il a à l'extérieur. Chez lui, il n'est pas obligé de se lever à sept heures le matin, ni de faire son lit, ni d'aller en promenade. En prison, il regarde la télévision vingt-quatre heures sur vingt-quatre. C'est un choix, mais qui ne relève pas seulement de l'administration pénitentiaire. » (M. Philippe Maître, chef de l'inspection des services pénitentiaires) Au nom des libertés individuelles, la tentation peut ainsi être grande pour les surveillants, les directeurs d'établissements, les travailleurs sociaux ou les médecins d'attendre la « demande », laissant ainsi de côté les détenus les plus fragiles ou les plus dangereux. Il faut également reconnaître que l'apathie engendrée par la condition carcérale peut arranger le personnel pénitentiaire. Le détenu qui ne demande rien est, par définition, un détenu qui ne pose pas de problème : « Il faudrait que la vie en prison puisse être la plus proche possible de la vie à l'extérieur et que les critères d'insertion soient les mêmes pour le travailleur social que pour l'administration pénitentiaire. Or on en est loin. Pour l'administration pénitentiaire, un bon détenu est un détenu qui ne fait pas de bruit, qui ne réclame rien, qui reste dans sa cellule. Dans ces conditions, sans rien faire d'autre, il bénéficiera du maximum de remises de peine, à savoir trois mois par an, trois mois supplémentaires au bout de la deuxième année et, régulièrement maintenant, pour calmer les tensions, trois mois de plus tous les 14 juillet. Cela tombe systématiquement, sans faire aucun effort. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soient de bons critères pour avoir des chances de s'insérer dans la société. Le détenu incarcéré doit garder son identité, il doit refuser d'entrer dans le moule de la machine, il doit exister. Dès que vous avez franchi la porte, que vous êtes devenu un matricule, vous n'existez plus, vous appartenez à la machine. C'est horrible. Aucun mot ne peut décrire cela. Quand vous vous retrouvez le soir enfermé, il n'y a plus de caïd, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des gens qui pleurent. » (M. Jacques Lerouge, responsable de l'association d'aide aux personnes en voie de réinsertion - APERI) Cette absence de contrainte est particulièrement frappante pour les mineurs et les jeunes adultes ; l'obligation scolaire est respectée en prison jusqu'à 16 ans. Au-delà, rien n'impose au jeune mineur une formation ou une scolarité. La prison ne permet donc pas à ces jeunes de se confronter à un cadre réellement structurant. Il faut envisager la responsabilisation du détenu comme une démarche essentielle de l'insertion : sans cette responsabilisation, la prison est rapidement perçue par le détenu comme un cadre sécurisant, rassurant, alors que le monde extérieur est hostile et générateur d'angoisse. Plusieurs établissements ont mis en avant la primauté de la responsabilisation en incitant les détenus à se confronter au monde extérieur : à la maison centrale de Poissy, des détenus travaillant dans le domaine de l'informatique ont envoyé des curriculum vitae aux entreprises afin de trouver de nouveaux concessionnaires. Au centre de détention de Caen, des détenus gèrent directement une association d'édition et d'imprimerie. Ces expériences, isolées, mobilisent un nombre important de bénévoles et exigent l'implication dynamique des surveillants et des équipes d'encadrement. Elles ne paraissent de plus réalisables que dans les établissements pour peines : les maisons d'arrêt ne répondent pas aux mêmes impératifs en matière d'insertion. Les maisons d'arrêt sont en effet caractérisées par un très important renouvellement de la population pénale. A titre d'exemple, en 1999, l'effectif de la maison d'arrêt de Nice, avec 1 426 entrées et 1 518 sorties, a été renouvelé près de 2,5 fois. La gestion du temps est donc totalement différente et il semble difficile de mettre en _uvre des actions sur le long terme. « Il est impossible de penser à un amendement des détenus dans les maisons d'arrêt. Je rappelle qu'elles sont conçues pour contenir des présumés innocents et que si l'on y travaille, on ne peut certainement pas y recevoir une formation professionnelle. En outre, ne devraient s'y trouver que des personnes condamnées à de courtes peines dans le cadre de comparutions immédiates. Si l'on est cinq mois ou six mois en prison, il est inutile d'essayer de procéder à une réinsertion professionnelle car le temps fait défaut. » (M. Robert Badinter) La responsabilisation du détenu signifie donc qu'il faut contraindre celui-ci à s'impliquer dans une démarche d'insertion. Mais cette contrainte ne peut être exigée que si l'administration pénitentiaire s'engage elle-même à offrir un cadre de détention le plus proche possible du cadre de vie extérieur. Actuellement, à la déresponsabilisation vient s'ajouter l'infantilisation. « La prison, même si elle s'est largement ouverte sur l'extérieur, même si interviennent de plus en plus d'équipes pluridisciplinaires d'autres administrations, restera toujours, par définition, un milieu artificiel. Le rythme de vie, pour ne parler que de lui, restera nécessairement très éloigné de celui de l'extérieur même si pour déstructurer le moins possible, nous nous efforçons de faire en sorte que la journée du détenu se rapproche au mieux de celle des personnes libres. Pour le week-end, il faut distinguer le samedi du dimanche ou des jours fériés en raison des parloirs. Mais, de manière générale, hormis les visites, le week-end est une période assez passive, pour ne pas dire morte. Il n'y a que peu d'activités, excepté sportives. La majorité du temps se passe en cellule et en cour de promenade pour des raisons essentiellement liées à un manque de moyens humains, puisque le taux de couverture du personnel, dont on sait déjà ce qu'il est en semaine, se trouve considérablement réduit le week-end. En maison d'arrêt, la journée du détenu s'arrête vers 17 heures 30. La distribution du repas s'effectue vers 18 heures et, à partir de 18 heures 15, il n'y a plus d'ouverture de cellules, hormis pour les interventions d'urgence ou en cas d'appels particuliers. En établissement pour peines, la journée est plus longue. Elle s'arrête néanmoins vers 19 heures au plus tard, puisque le service de nuit se met en place à 20 heures. Une réflexion avait été ouverte avec la création d'un groupe de travail sur le thème de la journée de détention. Que peut-on faire au cours d'une journée ? Ne faut-il pas diminuer le service de nuit pour que la fin de journée intervienne vers 22 heures ? Je considère que ce serait souhaitable dans un certain type d'établissements. » (M. Georges Vin, directeur du centre pénitentiaire des Baumettes) Cette journée de détention, extrêmement courte, est liée aux contraintes des horaires de travail des personnels. Elle ne correspond absolument pas à ce qui peut exister à l'extérieur et contribue donc encore davantage à désocialiser le détenu ; elle a également pour inconvénient de laisser de grandes plages horaires dépourvues d'activités : le soir, à partir de 18 heures, le week-end, l'été. Le dés_uvrement rend la journée particulièrement pénible à passer et devient vite source de tension. « La journée de détention est généralement de huit heures s'interrompant deux heures au moment du déjeuner. Cela signifie qu'entre le travail, la formation professionnelle, les activités sportives et de détente et les éventuelles consultations médicales, le détenu doit choisir. Soit il travaille, ce qui lui procure une rémunération, limitée d'ailleurs, car il ne peut travailler la journée entière, mais, dans ce cas, il ne peut être scolarisé et ne peut bénéficier des promenades. Inversement, si son choix se porte sur la formation professionnelle ou des études, il ne peut travailler. C'est là une première difficulté. La seconde difficulté engendrée par la brièveté de la journée de détention tient dans le fait que, dès dix-sept ou dix-huit heures, les détenus ne sortent plus de leur cellule et ce jusqu'à sept ou huit heures le matin. Cette durée, notamment l'été, apparaît extrêmement longue. Il en résulte des tensions qui nuisent à la sécurité et posent des problèmes quant à notre responsabilité en matière de réinsertion. La journée de détention est courte et nous souhaiterions renverser le système d'organisation en partant du « client » - ne soyez pas choqués du terme - en examinant les besoins que nous devons satisfaire pour sa réinsertion et pour couvrir ses différents besoins médicaux et déduire de ces besoins l'économie d'une journée de détention. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés auxquelles le personnel est confronté pour accomplir sa tâche, c'est le contraire qui se produit : c'est en fonction des contraintes qui pèsent sur le personnel que nous organisons la gestion de la détention, en conservant une organisation trop traditionnelle, héritée d'une époque où peu d'activités étaient organisées dans les établissements. Aussi, allons-nous lancer des travaux sur la nouvelle organisation du travail dans le cadre des négociations sur les 35 heures. C'est une occasion que nous souhaitons saisir pour tenter une amélioration de l'organisation et pour un meilleur service rendu, comme l'a annoncé récemment Mme la ministre aux organisations professionnelles. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) La réflexion sur la journée de détention doit dès lors s'intégrer dans le cadre d'une réflexion plus globale sur le passage aux 35 heures. Elle doit également nécessairement rejoindre la réflexion sur les moyens impartis aux actions d'insertion et le renversement des priorités entre sécurité et insertion. 2) Les moyens très insuffisants des services d'insertion Tout ce qui vient d'être dit sur la primauté de la mission de garde sur celle d'insertion se traduit de façon éclatante dans les moyens des services d'insertion et de probation. Sur un effectif budgétaire global de 25 700 emplois, l'administration pénitentiaire compte, au 1er janvier 2000, 20 250 personnels de surveillance et 2 100 personnels socio-éducatifs, hors vacances de postes, activité à temps partiel... Effectifs budgétaires et effectifs réels au 1er janvier 2000
Il y a donc 1 300 conseillers d'insertion et de probation et près de 500 assistantes sociales pour prendre en charge 135 000 personnes en milieu ouvert (ce qui représente près de 150 000 mesures), sachant qu'ils interviennent également dans les établissements pénitentiaires, c'est-à-dire, en principe, auprès de 50 000 détenus. De surcroît, ces chiffres déjà édifiants, reflètent mal la réalité en raison de la forte mobilité de la population pénale. « Actuellement, deux mille travailleurs sociaux, y compris les postes d'encadrement, interviennent auprès de quasiment 250 000 personnes par an. On parle d'un travailleur social qui suivrait, en moyenne, une centaine de dossiers. Ce chiffre, déjà énorme, est sous-évalué. Dans la maison d'arrêt où je travaille, nous sommes trois. Cela signifie que nous intervenons régulièrement auprès de cent vingt personnes. Mais en termes de flux, cela signifie que nous prenons en charge environ quatre cents personnes par an. On ne peut faire beaucoup plus que de répondre aux urgences et à la détresse. En milieu ouvert, le même problème se pose. [...] Il serait possible, pour un travailleur social, notamment en maison d'arrêt, d'intervenir de façon stable auprès de cent personnes. Toutefois, le problème est qu'il intervient constamment auprès de cent vingt personnes, voire plus, sans compter le fait que le flux est continuel. » (M. Michel Pouponnot, UGSP-CGT) Au regard de cette pénurie, les créations de postes opérées récemment sont effectivement bienvenues : 200 en 1998, 77 en 1999, 14 en 2000. Même si elles représentent un effort important compte tenu de la faible importance numérique de ce corps, elles ne changent pas fondamentalement le fait que ces services ne sont pas en mesure d'assumer leur mission. Quand, dans un établissement pénitentiaire, interviennent deux conseillers d'insertion et de probation et que celui qui est référent pour le quartier mineur est absent de façon prolongée, il en résulte une perturbation très grande du fonctionnement du service. L'exemple de la maison d'arrêt de Nice, en 1999, illustre les dysfonctionnements considérables qui résultent aussi de l'absence de personnel administratif dans ces services : plaintes des familles et des partenaires qui ne peuvent plus joindre téléphoniquement le service, surcroît de tâches administratives pour le personnel socio-éducatif... Cette pénurie fait apparaître la réforme des services pénitentiaires d'insertion et de probation, présentée comme une mutualisation des moyens du milieu ouvert et du milieu fermé, plutôt comme une mutualisation de leur insuffisance. L'insertion est le parent pauvre de l'administration pénitentiaire avec les conséquences qui en résultent pour les personnes concernées. Ceci, en outre, décrédibilise les mesures alternatives à la détention, dont le contrôle ne peut être assuré, freinant d'autant leur usage par les magistrats. Monsieur Daniel Farge, Président de la commission sur la libération conditionnelle, le souligne : « Il faut que les travailleurs sociaux ne suivent pas un nombre de dossiers ou un nombre démesuré de personnes. Les chiffres portés à ma connaissance jusqu'ici me paraissent incompatibles avec une plus grande efficacité de la libération conditionnelle. [...] La crédibilité de cette mesure tient à son exécution et au sérieux avec lequel les mesures de contrôle et d'assistance sont exercées. La commission a souhaité ardemment un renforcement des travailleurs sociaux à l'extérieur. » Un tel renforcement est notamment indispensable à la mise en _uvre des mesures récemment votées sur la libération conditionnelle. « La loi sur la présomption d'innocence que vous venez de voter a heureusement décidé la mise en _uvre d'une des propositions du rapport. Elle devrait rendre plus nombreuses les libérations conditionnelles et donc faire diminuer les récidives. Mais, je le répète, une condition préside à la réussite : que les agents du milieu ouvert soient en nombre suffisant pour s'en occuper utilement, efficacement. Personne d'autre ne peut le faire, notamment pas les policiers, dont ce n'est pas le travail. Si les personnels du milieu ouvert doivent continuer à devoir suivre quelque cent cinquante dossiers, les contrôles seront quasi-inexistants comme c'est déjà le cas actuellement. Les échecs se multiplieront, les médiatisations suivront, l'émotion populaire tout autant. » (M. Gilbert Bonnemaison) b) La mise en place des services pénitentiaires d'insertion et de probation La création d'un service d'insertion et de probation à compétence départementale, intervenant tant en milieu ouvert que fermé, est destinée à améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées sous main de justice et à mieux inscrire l'administration pénitentiaire dans les dispositifs d'action sociale de droit commun. L'unicité de service doit favoriser l'identification des besoins et l'harmonisation des modes d'intervention à l'égard des personnes faisant l'objet d'une peine alternative à l'incarcération, ce qui apparaît indispensable au vu de l'augmentation de leur nombre (le nombre de personnes suivies en milieu ouvert a augmenté de 25 % entre 1994 et 1998). Pour autant, l'administration pénitentiaire n'a pas de place reconnue dans la politique d'action sociale. Le « public-justice » fait peur et les services sociaux de droit commun tendent à se défausser sur les conseillers d'insertion et de probation qui n'ont pas les moyens d'assurer une véritable prise en charge sociale. Il est donc essentiel de définir des relations claires avec les partenaires intervenant en matière d'action sociale, c'est-à-dire les départements. « C'est une excellente réforme pour les départements de province de taille petite ou moyenne, où le représentant de l'administration pénitentiaire peut, auprès du préfet et sur un certain nombre de questions, jouer un rôle. Auparavant, parfois, nous n'en avions pas ; parfois, nous étions représentés par un directeur de probation ou un chef d'établissement. La formule pose toutefois des difficultés considérables sur les grands établissements parisiens où l'on constate des réticences des personnels qui craignent d'être envoyés indifféremment en milieu fermé ou ouvert. Dans la mesure où nous sommes obligés de reconstituer des entités en milieu ouvert et d'autres en milieu fermé, la réforme perd là quelque peu de sa chair. » (M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris) Dans des établissements, comme celui de Meaux, les conseillers d'insertion et de probation sont en charge des détenus issus d'une zone géographique, zone qui constitue leur ressort d'intervention en milieu ouvert. Ainsi, un suivi peut être assuré. Ce n'est pas le cas quand la répartition des détenus s'opère simplement par ordre alphabétique entre les conseillers d'insertion. La mise en place de la réforme a conduit à une redéfinition des rôles de chacun. Celle-ci ne va pas nécessairement sans « tiraillements ». Par exemple, à Loos, il est très vivement regretté que la fête des mères, seule fête collective et moment extrêmement précieux pour les détenues, n'ait pu, contrairement à l'habitude, être organisée au quartier de femmes. Elle suppose une forte « logistique » pour accompagner les enfants qui sont souvent placés en foyer qui n'a pas été organisée. Il faut noter que les conseillers d'insertion et de probation ont paru singulièrement absents des établissements pénitentiaires lors des visites. Ils n'ont pu que très rarement être rencontrés. Monsieur Louis Leblay, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, CFDT-justice, souligne d'ailleurs que : « On observe qu'avec la réforme récente des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ce sont encore les travailleurs sociaux que l'on enlève du milieu fermé. Alors que l'on veut mutualiser les milieux ouvert et fermé, il me semble au contraire que l'on enferme davantage le milieu fermé, à un point tel que certains progrès intervenus dans la reconnaissance entre les travailleurs sociaux et les surveillants sont en train de s'effilocher ou de se distendre. Il a fallu un certain temps pour qu'intervienne une reconnaissance mutuelle entre les travailleurs sociaux et les surveillants. On y était à peu près parvenu, et maintenant la tendance serait d'enlever les travailleurs sociaux des milieux fermés. De la sorte, ils risquent de nouveau d'être perçus par les personnels, non plus comme des collègues, mais simplement comme des intervenants extérieurs. » La responsabilité de l'insertion a, d'une certaine façon, été enlevée aux équipes dirigeantes des établissements. Il ne faudrait pas, en outre, qu'il en résulte un clivage encore plus grand entre des missions de garde dont sont chargés les surveillants et un rôle plus valorisant qui serait celui des autres intervenants. Cette réforme répond à une nécessité d'organisation administrative. Sa mise en place est encore récente et tous ses effets n'en sont pas encore connus. 3) Les actions socio-éducatives Les actions socio-éducatives menées dans les établissements pénitentiaires se caractérisent par leur multiplicité et leur extrême diversité. Il en ressort le sentiment qu'un grand nombre de possibilités sont offertes, que ce soit en termes d'enseignement, de formation, d'activités culturelles, de sport... mais que les pratiques et l'accès à ces activités sont extrêmement différents, d'abord en fonction des établissements, ensuite en fonction des détenus. a) Une très grande diversité des activités et de l'accès à celles-ci Une première différence fondamentale tient au type d'établissement : maison d'arrêt ou établissement pour peine. En maison d'arrêt, la brièveté du séjour qui est en principe la règle, rend difficile toute action de formation professionnelle. Ce constat est aggravé par la difficulté, déjà évoquée, qui résulte de l'ampleur des mouvements de détenus d'un établissement à l'autre. Paradoxalement, ce sont pourtant les condamnés aux plus courtes peines qui devraient le plus pouvoir bénéficier d'actions de réinsertion. Même si les généralisations sont difficiles, il est vrai que celles menées dans les maisons d'arrêt s'adressent plutôt à des condamnés, voire à des procédures criminelles au moins pour les formations d'une certaine durée, car on a l'assurance qu'ils vont rester un temps suffisant. Le régime de détention influe également sur l'organisation des activités. Elles seront plus faciles d'accès dans les établissements pour peine et notamment dans les centres de détention régionaux, les plus tournés vers la réinsertion. Le centre de détention régional de Saint-Sulpice est, de ce point de vue, un bon exemple de ce qu'un établissement de petite taille (84 détenus) peut réaliser, s'il est doté de moyens et de personnels adaptés (formation professionnelle, travail pénal, soutien psychologique, passage du permis de conduire y compris de la conduite, initiation informatique...). Ceci s'opère toutefois au prix d'une sévère « sélection » à l'entrée au regard des objectifs de l'établissement, ce qui contribue à sa sous-occupation (84 détenus pour 102 places). En tout cas, un régime ouvert dans ce type d'établissement offre des possibilités sans comparaison avec celui d'une maison d'arrêt où, pour des raisons liées à la durée de la condamnation ou aux procédures d'affectations et à leurs délais, des condamnés vont pourtant purger leur peine. Dans les établissements accueillant les plus longues peines, centres de détention nationaux ou maisons centrales, la problématique est encore différente. Elle s'inscrit dans celle de la gestion de la longue peine. Donc, même si l'on retrouve des constantes, dans la nature des enseignements notamment, ce qui est possible - ou a été commencé - dans un établissement ne sera plus possible dans un autre et le parcours entamé sera interrompu en cas de changement d'établissement. Les établissements implantés en zone rurale peuvent avoir du mal à faire venir des enseignants - c'est le cas à Clairvaux : un seul instituteur intervient, alors que le pourcentage d'illettrés est très important. En outre, son action est concentrée sur le centre de réinsertion, la maison centrale étant, de fait, secondaire. Aucun étudiant du GENEPI n'intervient non plus. C'est aussi le cas du centre pénitentiaire de Château-Thierry où aucun enseignant n'a accepté actuellement d'intervenir (6 heures de français et de mathématiques sont assurées sur des crédits du fonds d'action sociale). On retrouve aussi, sur cette question, les contraintes liées aux locaux, les salles de classe, les ateliers mais aussi les équipements sportifs, inégalement disponibles car des établissements sont très bien équipés alors que dans d'autres, les cours de promenade servent aussi de terrain de sport et les fonctions de moniteur de sport ne sont pas toujours assurées. Le sport, en détention, est pourtant un facteur essentiel d'équilibre. La vie en cellule, comme dans les maisons d'arrêt, sans accès à une salle d'étude, est peu propice au suivi d'une scolarité, en particulier quand la cellule est occupée par plusieurs détenus. De même, l'accès au matériel pédagogique est assuré de façon variable. Ils est en principe fourni par les établissements, sur leur budget, en fonction des demandes des formateurs. Mais les impératifs de sécurité avancés par l'administration empêchent souvent, là aussi en fonction des règles fixées par le directeur d'établissement, l'envoi de matériels pédagogiques par les associations de bénévoles. Cela peut constituer un vrai obstacle pour l'obtention par exemple d'une calculatrice par un détenu suivant une formation en comptabilité. Il devra l'acheter en cantine alors que certains équipements pourraient lui être fournis gratuitement. Enfin, s'y ajoute le problème de l'accès aux activités pour certaines catégories pénales : délinquants sexuels et indigents. Ces derniers, qui sont souvent ceux qui sont aussi confrontés aux problèmes d'illettrisme, auront à faire un choix immédiat entre se procurer des revenus grâce au travail pénal ou bien suivre une formation. « Je terminerai par le conflit entre l'enseignement, la formation et le travail. Les détenus économiquement les plus pauvres sont aussi les plus pauvres culturellement et scolairement. Ils ont donc besoin de travailler en prison pour accéder à un minimum de revenus pour cantiner. Quand il s'agit de faire le choix entre aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, ou travailler à l'atelier pour gagner de l'argent, le choix est vite fait ! Les illettrés, ceux ayant un faible niveau scolaire, vont immédiatement travailler et ne suivent pas les enseignements. Nous ne croyons plus vraiment à la réinsertion par le travail en prison. La réinsertion passe par la culture, par des minimums de base, savoir lire et écrire. Le pourcentage d'illettrés en prison est énorme. Il faut absolument orienter les moyens vers la réinsertion par l'enseignement, en d'autres termes que les détenus soient rémunérés pour se former. Même s'il s'agit d'une « carotte », il ne sera pas possible autrement d'assurer une mission de réinsertion en prison. [...] « La prison n'est pratiquement que contrainte. C'est pourquoi je ne suis pas prête à entendre l'administration pénitentiaire déclarer qu'elle ne peut contraindre les gens à se rendre en cours. Elle n'a qu'à les motiver d'une façon ou d'une autre. Le détenu étant dans une situation où il doit absolument travailler pour gagner un peu d'argent et où il ne peut se former, il convient de lui donner les moyens. » (Mme Cécile Rucklin, présidente du GENEPI) Des solutions doivent être trouvées pour permettre cet accès qui est prioritaire. Cela renvoie à l'organisation de la journée de détention, mais plus simplement aussi à celle du service général puisque l'administration pénitentiaire en a la maîtrise totale. Il serait indispensable de développer des solutions de type formation en alternance, dans le cadre du service général ou de prévoir une rémunération des formations, notamment celle de lutte contre l'illettrisme, par exemple en développant les bourses d'études pour les indigents. b) Le bilan global des activités de formation et d'enseignement ▪ Les formations professionnelles Environ 4 millions d'heures stagiaires ont été délivrées en 1999 au titre de la formation professionnelle. Elles ont concerné 22 000 stagiaires pour une moyenne de 187 heures. Ces actions de qualification et de préqualification couvrent, pour l'essentiel (63 %), trois secteurs professionnels : métier du bâtiment, métiers de l'électricité et de l'électronique, métiers de bouche. Les formations professionnelles peuvent se voir adresser des critiques relatives à leur adaptation aux besoins du marché, mais celles-ci ne sont pas d'une nature différente des problèmes de la formation professionnelle en général. Toutefois, on peut s'interroger sur la simple transposition de méthodes appliquées à l'extérieur sans réflexion sur leur adaptation à un public spécifique. Par contre, son exercice en milieu pénitentiaire a lieu dans un contexte particulier. Plus encore que l'accès à une formation, son inscription dans une « filière » est essentielle, particulièrement pour un condamné à une longue peine et a toute sa place dans une utilisation efficace du projet d'exécution de peine. Seule, une articulation avec la formation et sa pratique ensuite, soit dans le cadre du service général ou du travail en atelier, peut lui donner une valeur réelle et lui réserver un usage autre que celui de l'obtention de remises de peine qui est, en effet, bien souvent le moteur pour suivre une formation, quelle qu'elle soit, plus que la conduite réfléchie d'un parcours d'insertion. « J'ai mis en place des visites professionnelles :tous les mois, les détenus rencontrent des compositeurs, des ingénieurs du son, des acousticiens, des bruiteurs, des sonorisateurs de Radio France, de la FEMIS, de l'école de Vaugirard, de France 3... Ceux qui sont avec moi depuis sept ans, à raison de dix visites par an, connaissent soixante-dix personnes de leur métier. Je ne pense pas que beaucoup d'écoles de son à l'extérieur proposent un réseau de cette nature. Nous sommes en constante relation avec Radio France. Pour moi, apprendre un métier consiste à être en relation avec les gens de ce métier. La régie industrielle de l'administration pénitentiaire implantée à Saint-Maur a une activité de menuiserie. Elle n'a pas invité de sculpteurs, d'ébénistes ou de charpentiers. Les détenus confectionnent des tiroirs ou des cercueils. Sans savoir que l'on peut tomber amoureux du bois. Ils préparent leur CAP pour se faire bien voir du juge de l'application des peines. Ils n'imaginent pas que cette perche qu'on leur a tendue et qui, pour eux, est une sorte de jeu de cache-cache avec l'administration, pourrait être un lieu d'émancipation, d'éclosion sociale, esthétique, intellectuelle, affective et surtout un lieu d'investissement personnel et d'expression. » (M. Nicolas Frize, Ligue des droits de l'homme) La formation de tailleurs de pierre organisée à Clairvaux est une illustration frappante du dévoiement de la formation professionnelle : aucun des détenus la suivant n'envisage d'exercer cette activité à sa sortie ! Des expériences tout à fait positives mériteraient d'être encouragées. C'est le cas des chantiers d'insertion extérieurs montés dans certaines régions touchées par les tempêtes comme à Chaumont. En l'absence de financement spécifique, ces initiatives dépendent de partenariats locaux. Elles sont pourtant un instrument efficace pour associer phases de travail et formation théorique. Leur affecter des financements adéquats serait indispensable. ▪ L'enseignement La procédure de repérage de l'illettrisme à l'entrée des établissements a mis en évidence les très grandes difficultés auxquelles sont confrontés les entrants en maison d'arrêt : - 56 % sont sans diplômes, 81 % ne dépassent pas le niveau du CAP, - 42 % sont issus de filières courtes ou sont en échec scolaire - 19 % sont en situation d'illettrisme grave ou avéré au regard du bilan lecture, 14 autres % échouent au test du fait de difficultés moindres. L'administration pénitentiaire, avec l'aide de l'éducation nationale, met en place des enseignements dans les établissements. Ainsi, plus de 30 000 détenus ont été inscrits en cours d'année scolaire dans les différentes actions : - plus de 18 000 personnes ont suivi une formation de base relevant soit de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme (7 200), soit de la remise à niveau dans les domaines fondamentaux (10 800) ; 1 960 d'entre elles ont été reçues au certificat de formation générale, - plus de 12 000 détenus ont suivi des cours du secondaire et préparé des diplômes du brevet des collèges jusqu'au BTS : 189 brevets des collèges ont été délivrés en 1999, 241 CAP ou BEP, 56 DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires), 48 bac et 52 diplômes de l'enseignement supérieur. Actuellement, plus de 15 % des détenus participent en cours d'année scolaire à des activités d'enseignement. Un accent particulier doit être porté sur la lutte contre l'illettrisme, compte tenu du fort taux de personnes illettrées en prison. Outre l'hypothèque que ce handicap constitue dans la perspective d'une réinsertion, il constitue aussi une entrave dans la vie quotidienne en prison où toute demande doit être formulée par écrit. La première étape est le repérage. Celui-ci, initié en 1995, s'est étendu en 1999 à 146 établissements. Ce repérage présente également l'intérêt de susciter une demande de formation de la part des détenus grâce à la rencontre systématique de ceux ayant connu des échecs scolaires importants. Le bilan dressé par ce repérage, évoqué plus haut, justifie des moyens renforcés quantitativement et qualitativement, afin notamment que soient élaborés des outils pédagogiques adaptés. La lutte contre l'illettrisme doit pouvoir être intégrée dans la prise en charge globale des détenus. Il faut, enfin, insister sur le fait que le soutien aux associations de bénévoles est très important, notamment parce que celles-ci (comme AUXILIA qui assure des cours par correspondance) exercent leur activité tout au long de l'année et donc pendant la période d'été, période pendant laquelle les cours dispensés par l'éducation nationale s'arrêtent. L'administration pénitentiaire lui demande d'ailleurs de renforcer son effort pendant cette période. ▪ La scolarité des mineurs Les mineurs de 16 ans, sont comme à l'extérieur, soumis à l'obligation scolaire. 3 045 mineurs ont été scolarisés en prison en 1999. Les heures d'enseignement restent peu élevées, notamment parce que les enseignants sont contraints d'intervenir auprès de groupes très limités en nombre, voire de façon individuelle. A la rentrée scolaire de 1999, la moyenne nationale hebdomadaire a été portée, grâce à des moyens nouveaux, à neuf heures (au lieu de sept heures). « En prison comme ailleurs, les mineurs ont l'obligation de scolarité, mais les enseignants sont souvent débordés dès qu'il y a plus de cinq mineurs dans la classe. Ils ne prennent pas la peine de contraindre ceux qui ne veulent pas venir sous peine de compter des éléments très perturbateurs dans les classes qui viendraient gêner les rares mineurs motivés. C'est un fait extrêmement grave. Nous dressons ce constat, sans, toutefois, proposer de réponse, car nous sommes aussi désemparés que les surveillants et les travailleurs sociaux. Nous sommes confrontés à des situations et à des individus dont nous ne comprenons pas le fonctionnement... Très souvent, on nous demande d'intervenir dans les quartiers mineurs au prétexte que nous sommes jeunes et que nous pourrons lier plus facilement contact. Tel n'est pas notre objet. Le GENEPI intervient toujours en complémentarité des travailleurs sociaux et des enseignants. Alors que la scolarité est obligatoire jusqu'à seize ans, il y a trop peu d'enseignants pour faire suivre cette scolarité. On envoie donc des intervenants bénévoles, les génépistes. Dorénavant, nous refusons d'intervenir là où les professionnels n'interviennent pas. » (Mme Cécile Rucklin, présidente du GENEPI) L'obligation scolaire cesse à partir de 16 ans. Les mineurs de 16 à 18 ans refusent, bien souvent, de suivre des cours au prétexte que ceux-ci ne sont pas obligatoires. Devant ce constat, il convient de se demander s'il ne faudrait pas étendre l'obligation de suivre des cours, en détention, aux mineurs de 16 à 18 ans. La loi du 22 juin 1987 a dénoué le lien entre travail et peine en supprimant le caractère obligatoire du travail pour les condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. Elle lui a substitué ce que le Conseil économique et social avait appelé dans son rapport de 1987, intitulé « Travail et prison » 21, une « promesse aux contours imprécis ». En effet, l'article 720, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale dispose désormais : « Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent ». Le travail n'est plus conçu comme un outil de moralisation mais comme un outil de réinsertion et de préparation au retour des détenus dans la société. C'est ce que traduit l'article D.101, alinéa 2 du code de procédure pénale : « Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. » La réalité du travail carcéral apparaît bien éloignée de cette mission. Il est avant tout un instrument de gestion de la détention. Tout en procurant des revenus aux détenus, il permet principalement à la prison d'assurer sa mission de garde. Dans la plupart des cas, l'accès et le contenu du travail pénal ne permettent pas de l'envisager réellement comme préparatoire à une vie professionnelle. Plus fondamentalement les conditions de son exercice, en dehors des règles du droit du travail, le condamnent en tant qu'outil d'insertion. Les trois formes du travail pénal à l'intérieur des établissements : Le service général consiste dans l'exécution de missions liées au fonctionnement et à l'entretien du cadre de la vie carcérale. Il échappe à toute définition juridique traditionnelle. L'employeur est l'administration pénitentiaire elle-même. La Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), créée pour compenser l'insuffisance de la présence des entreprises en prison, emploie de la main-d'_uvre pénale pour les besoins d'équipements administratifs. L'administration pénitentiaire est l'employeur et fait travailler les détenus pour son propre compte. Par le travail en concession, la main-d'_uvre pénale est concédée à des entreprises qui font travailler les détenus pour leur compte, moyennant une redevance. Elles fournissent les matières premières, le matériel et l'encadrement technique. Il n'y a pas de contrat de travail entre le détenu et le concessionnaire, pas plus qu'entre le détenu et l'administration pénitentiaire a) Le décalage entre l'objectif de réinsertion et la réalité du travail pénitentiaire Au regard de l'objectif d'insertion qui lui est assigné, le travail en prison prête le flan à de nombreuses critiques. Il apparaît plus comme le moyen de procurer une occupation et des revenus aux détenus, que comme l'exercice d'une activité préparant à un avenir professionnel. En outre, cette possibilité d'exercer une activité professionnelle en détention n'existe pas pour tous les détenus et les conditions de son exercice sont très variables. ▪ L'accès au travail pénal : seule la moitié de la population carcérale travaille. Bien qu'en progression globale, l'accès à un travail pénal n'est pas possible pour tous les détenus qui le souhaitent et est très variable d'un établissement à l'autre. Détenus en situation de travail
Source : Administration pénitentiaire Il faut préciser que le taux d'occupation est une donnée qui ne prend pas en compte la durée du travail effectué. Compte tenu des mouvements de la population pénale et des fluctuations de l'activité des entreprises travaillant avec l'administration, celle-ci est très variable. Comme dans les autres domaines, les maisons d'arrêt sont dans une situation plus défavorable. Pour des raisons d'équipement et de mouvement des détenus, elles connaissent un taux d'occupation de 35,8 % contre 60 % en établissement pour peine. 14 maisons d'arrêt ont déclaré dans le questionnaire qui leur a été envoyé n'offrir aucune activité productive, mais seulement des postes au service général. A ces 14 établissements, il faut ajouter ceux de la Guadeloupe, de Guyane et de la Martinique où, en raison du taux de chômage que connaissent ces départements, les expériences tentant de fournir des activités de production aux détenus se sont heurtées à des oppositions telles qu'elles ont dues le plus souvent être abandonnées. Or la non-activité est doublement pénalisante. A l'absence de revenu du travail pendant la détention, s'ajoute le fait que les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite (article 720 du code de procédure pénale). L'accès au travail pénal pose également la question du choix des détenus admis à travailler appelé le « classement ». L'accès au travail n'est pas identique pour toutes les catégories de détenus. L'article D.105 du code de procédure pénale qui prévoit que les détenus classés au service général sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas de longues peines à subir, retentit également sur les pratiques suivies pour le travail en atelier. Cette mesure pénalise aujourd'hui les délinquants sexuels qui ne posent pourtant pas nécessairement de difficultés en détention. Il s'y ajoute éventuellement des problèmes de locaux de travail dans les établissements où ces détenus vivent totalement à l'écart des autres. Les problèmes d'accès aux ateliers existent aussi pour les femmes. Les critères dépendent des pratiques suivies par les établissements. Les indigents sont généralement prioritaires mais d'autres éléments liés au comportement du détenu et à sa dangerosité entrent aussi en compte Certains établissements, essentiellement des établissements pour peine, ont mis en place des commissions de classement qui réunissent des représentants de la direction et du service d'insertion, des responsables du travail pénal, des enseignants, parfois des psychologues qui formulent un avis sur l'accès au travail. Les commissions de classement permettent un travail en coopération et une approche plus centrée sur les besoins du détenu. Elles assurent une plus grande transparence dans les critères de choix, permettant de réduire le sentiment d'arbitraire qu'éprouvent les détenus à qui le classement a été refusé. La généralisation des commissions de classement apparaît souhaitable, comme l'affirmation du principe du classement prioritaire des indigents. Concomitamment, la recommandation posée par l'article D.105 du code de procédure pénale à l'encontre des condamnés à des longues peines devrait être supprimée. Compte tenu de ce bilan, on ne peut que se féliciter de l'évolution favorable que connaît le travail pénal depuis quelques années qui doit permettre à un plus grand nombre de détenus de travailler. En effet, le montant de la masse salariale distribuée a augmenté de 55,3 % depuis 1993 (pour atteindre 273 millions de F de rémunération brute distribuée en 1999) et le nombre de jours travaillés de 27,8 % sur la même période. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'administration génèrent une pénurie des emplois au service général dont le nombre a peu évolué, sur le long terme, alors que la population pénale connaissait un essor considérable. 5 000 détenus travaillaient au service général dans les années 1970, ils étaient environ 6 000 dans les années 1980. Leur nombre s'établit aux alentours de 6 800 détenus depuis les années 1990 et connaît une légère baisse depuis 1997. L'évolution positive est donc essentiellement due au développement du travail en concession. Il dépend, évidemment, du niveau général de l'activité économique et a bénéficié de la dynamique du Plan d'action pour la croissance et l'emploi (PACTE), initié en 1997 dans l'objectif d'un accroissement des emplois en production. Il reste que l'activité des entreprises, qui trouvent en prison une réponse à leur demande de flexibilité, est très fluctuante. Sur le millier d'entreprises avec laquelle l'administration pénitentiaire est annuellement en relation contractuelle, à peine 20 % ont une activité ininterrompue. Le développement de l'activité des établissements avec des sociétés de production spécialisées dans la sous-traitance est donc un enjeu de l'organisation du travail en détention. Ces partenaires (une cinquantaine de structures aujourd'hui qui génèrent presque la moitié des rémunérations versées au titre des activités de production) sont extrêmement précieux car ils réduisent les phénomènes de variation d'activité dans les ateliers en répartissant les plans de charge de leurs clients. Il est clair que le développement du travail en détention suit les évolutions de la conjoncture économique et se heurte, compte tenu de la nature non qualifiée de la plupart des tâches effectuées, à la concurrence internationale. Il est aussi freiné par des facteurs internes : localisation de l'établissement, en zone urbaine ou rurale, initiatives prises ou non en matière de prospection, faible niveau de qualification des détenus et lourds handicaps sociaux, grande mobilité de ceux-ci en maison d'arrêt, faiblesse du personnel d'encadrement, locaux pas toujours adaptés et ayant une capacité d'accueil limitée qui ne permet pas toujours de faire face à un surcroît d'activité inopiné. ▪ Des locaux diversement adaptés au travail pénal Les locaux dans lesquels le travail pénal est effectué sont de qualité très différente selon l'histoire de l'établissement. Lorsque ce local est une cellule, les conditions d'exercice de ce travail ne sont pas admissibles. Environ 90 % des établissements disposent de locaux pouvant accueillir des activités de production. La qualité de ces surfaces, en termes d'équipement, d'accessibilité et de respect des règles de conformité est très variable. Il en va de même de l'espace disponible par rapport aux besoins. En réalité, des espaces insuffisants et peu rationnels coexistent avec des locaux spacieux et bien équipés. En règle générale, les établissements pour peine sont mieux équipés au moins quantitativement. Dans les établissements anciens, notamment dans les petites maisons d'arrêt, les dispositions architecturales rendent bien souvent très difficile l'installation d'ateliers, ce qui conduit à aménager d'anciens dortoirs de désencombrement ou à réunir plusieurs cellules. Il en va différemment dans les établissements plus récents pour lesquels l'édification d'ateliers a été prévue dans les plans de construction. Dans 47 établissements pénitentiaires des travaux sont encore effectués en cellules, (22) ceci dans des proportions très variables. Soit le recours au travail en cellule est ponctuel pour faire face à une variation soudaine d'activité, soit il découle de l'insuffisance des surfaces d'ateliers, voire de leur inexistence. En cellule, les conditions élémentaires d'hygiène et de sécurité ne peuvent être remplies. La faisabilité et la rationalisation du travail sont fortement mises en cause. Quand la cellule encombrée de matériel est de surcroît occupée par plusieurs détenus, les conditions de vie sont inadmissibles. Effectué dans ces conditions, le travail est antinomique avec l'idée même de réinsertion. Il ne fait que renforcer la désorganisation de la vie en prison. Le détenu est privé du repère fort qui consiste à sortir de sa cellule, à heures fixes et pour une durée déterminée, pour effectuer un travail. Au contraire, les détenus travaillent souvent la nuit, notamment pour tenir les cadences. Or dans certains établissements, cette pratique est loin d'être marginale. Le travail en cellule à La Santé représente 70 % de la masse salariale globale issue du travail pénitentiaire, quatre sociétés concessionnaires fournissent du travail à 280 détenus en moyenne. En 1999, en l'absence d'ateliers, 720 détenus ont travaillé en cellule, à la maison d'arrêt de Meaux, 392 à la maison d'arrêt de Reims. ▪ Des activités très généralement non-qualifiantes Pour l'administration pénitentiaire, l'organisation dans les établissements pénitentiaires d'activités de travail en production répond à une double exigence : procurer une source de revenus aux détenus et leur permettre l'accès à une expérience de travail, si possible en acquérant un savoir-faire professionnel. Les activités de production effectuées en prison consistent, en général, dans des travaux de main-d'_uvre qui ne nécessitent pas de qualification et sont de peu de valeur pour la préparation d'un avenir professionnel. Le secteur du façonnage, notamment celui des arts graphiques et de la promotion, est le principal fournisseur d'emploi. S'y sont ajoutés des travaux à façon consistant dans des opérations d'assemblage ou de montage de sous-ensemble pour l'industrie. A titre d'illustration, les activités suivantes ont été relevées : - assemblage de classeurs, - remplissage de flacons de parfum, de produits désodorisants ou de produits cosmétiques, - collage de joints de caoutchouc, - triage et conditionnement de produits divers (primeurs, flexibles de douche, revues), - montage de petites voitures, d'accessoires automobiles... Des travaux plus qualifiés, et mieux rémunérés, sont aussi effectués : travaux de confection, conditionnement de prises et de télécommandes pour abonnement satellite, ainsi que des travaux pour lesquels toutes les opérations de la chaîne de fabrication sont réalisées : montage de luminaires, confection de coffrets et pochettes à bijoux Des initiatives de réalisation de tâches à haute technicité ont pu être expérimentées en liaison avec d'autres collectivités publiques. Il s'agit de la restauration d'éléments du patrimoine : numérisation d'archives photographiques et restauration d'archives sonores. Cela reste des expériences pilotes, caractère dont il faut se départir comme le souligne Nicolas Frize qui a mis en place à St-Maur et à Poissy la restauration des archives sonores de l'INA. Les chefs d'établissements invoquent souvent les difficultés d'emploi de la population pénale et la nécessité de fournir des activités qui puissent être effectuées sans qualification particulière. Il est aussi important que l'établissement offre une gamme d'activités allant de la simple main d'_uvre à des travaux plus élaborés (même si une nouvelle fois le contexte est différent en maison d'arrêt et en établissement pour peine). Il n'en reste pas moins que le développement d'activités qualifiantes conditionne l'objectif d'insertion. C'est l'une des tâches assignées au service de l'emploi pénitentiaire (SEP), rénové en 1998 et chargé de gérer le compte de commerce RIEP (23). Cet objectif risque cependant d'être freiné par les difficultés que connaît la Régie - tant en terme de chiffre d'affaires que d'emploi (Cf. tableau supra ). De l'aveu même de l'administration pénitentiaire, il reste encore beaucoup à faire pour consolider l'outil de production et de réinsertion que constituent les ateliers de la RIEP, recentrer leur activité sur les produits les plus appropriés, diversifier leurs marchés, pour renforcer à la fois l'autonomie des ateliers et leur contrôle au regard des objectifs de qualité et de délai, mais aussi des règles régissant les marchés publics et la comptabilité publique, pour définir et exercer une gestion des ressources humaines plus autonome et mieux adaptée à la fonction de production et de vente, tout en respectant le cadre du statut administratif. Une meilleure qualification du travail, conditionne aussi la possibilité de développer des procédures de certification des compétences ( validation des compétences acquises sur un poste de travail défini permettant la remise, à la libération, d'un document attestant de l'employabilité ). En 1999, une convention d'ingénierie a été conclue entre le responsable local de la formation des détenus du centre de détention de Val-de-Reuil et le GRETA Rouen BTP services, pour la conception d'une certification des compétences professionnelles acquises dans le cadre des activités professionnelles réalisées en concession. Le développement d'activités qualifiantes et la mise en place de procédure de certification des compétences en améliorant la cohérence des dispositifs d'insertion professionnelle, tant dans leurs aspects enseignement que travail et formation professionnelle, sont des impératifs incontournables. Une plus grande coopération avec les associations intermédiaires et les entreprises d'insertion et le développement des chantiers écoles devraient, dans la même perspective, être fortement soutenus par l'administration pénitentiaire. Enfin, la délivrance de certificats de travail, au nom de l'entreprise, comme le font certaines sociétés gérant le travail dans les établissements du programme 13 000, devrait être développée. b) un objectif de réinsertion compromis par la non-application du droit du travail Ecarter l'application du droit du travail en détention emporte de nombreuses conséquences négatives et a pour conséquence de faibles rémunérations. ▪ l'absence de contrat de travail L'article 720, alinéa 3 du code de procédure pénale dispose : « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. » Le détenu au travail est un travailleur sans contrat, sauf dans le cas de placement à l'extérieur ou de semi-liberté. Cette conception traditionnelle en droit pénitentiaire reposait sur l'idée selon laquelle le travail était un accessoire obligatoire de la peine. Que le donneur d'ordre soit l'administration ou que ce soit un concessionnaire, le détenu n'est pas partie à la convention qui détermine les conditions de la prestation dont il sera chargé. La première conséquence pratique est l'absence de relation contractuelle : conditions d'embauche, période d'essai, rupture de contrat de travail, chômage technique... et possibilité d'exercer un recours contre les conditions d'exercice de la prestation. Les possibilités d'expression collective et de représentation auprès de l'employeur sont aussi écartées. En conséquence, la Cour de cassation (Soc. 17 décembre 1996) a rejeté le pourvoi d'un détenu contestant la rémunération perçue pour un travail effectué pour le compte d'une entreprise concessionnaire. En revanche, il est fait application des règles applicables en matière de protection sociale. Les détenus sont affiliés dès l'incarcération aux assurances maladie et maternité du régime général, (article L 381-30 du Code de la sécurité sociale). Ceux exécutant un travail pénal (ou suivant un stage de formation professionnelle), sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ( article L 381-31 du Code de la sécurité sociale ). L'administration assure le paiement des cotisations dues par les détenus employés au service général. La législation de droit commun en matière d'hygiène et de sécurité s'applique également - (à l'exception des règles relatives aux commissions d'hygiène et de sécurité et à la médecine du travail). On est donc en présence d'un statut relativement contradictoire. En tout état de cause, l'absence de respect du droit du travail ruine la conception même du travail pénal comme outil d'insertion. L'action de M. Nicolas Frize, à Saint-Maur est, à cet égard, exemplaire : « A ces trois pôles - création, formation, travail - j'ai ajouté l'exigence du droit, c'est-à-dire que j'ai introduit le contrat de travail, contrairement aux dispositions de la loi, puisque le contrat est interdit en prison. Ce contrat de travail, qui n'a pas de valeur légale est signé entre le détenu et nous-mêmes puis validé par l'administration. J'ai créé un dispositif de congés payés et me suis substitué à la sécurité sociale pour assurer une couverture maladie. Autrement dit, j'ai introduit le droit. Non, pas parce que je suis à la Ligue des droits de l'homme, mais parce qu'indépendamment du fait que c'est un principe auquel l'on ne déroge pas, le droit a des vertus : conférer des droits aux détenus est souvent leur donner ce qu'ils n'ont jamais eu. » Pour l'administration pénitentiaire, la situation juridique du détenu fait obstacle à la possibilité d'une relation contractuelle, au sens du droit du travail. La contrainte de l'enfermement qui pèse sur le détenu, en exécution de la peine privative de liberté prononcée par l'autorité judiciaire, entrave la liberté de ce dernier à contracter selon le droit général des contrats défini par le code civil. La prévalence des règles de discipline et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires édictées aux articles D.241 à D.243 du code de procédure pénale sur la liberté de la personne incarcérée, empêcherait ce dernier de conclure librement un contrat de travail. Cette position montre bien que le rejet du contrat de travail se fonde sur des raisons de politique pénitentiaire. Consciente de la difficulté, l'administration pénitentiaire a l'objectif de développer un « support individuel d'engagement » sorte de substitut à un contrat de travail. Ce document serait conclu entre l'administration et le détenu et fixerait la nature des travaux, leur durée, celle de la période d'essai et la rémunération. Les conséquences sur les obligations de chacun des « contractants » restent à définir. On ne peut s'en contenter. L'introduction du droit du travail deviendra de toute façon incontournable et les obstacles juridiques doivent pouvoir être levés. Dans l'immédiat, l'administration pénitentiaire et l'entreprise devraient au moins être astreintes au respect des règles d'hygiène et de sécurité (commissions d'hygiène et de sécurité, médecine du travail). ▪ La non-application du droit du travail a pour conséquence la pratique d'un travail sous-rémunéré La question de la rémunération du travail pénal est complexe en raison de la grande hétérogénéité des activités, des différences des situations locales et de la multiplicité tant des activités que des entreprises concessionnaires. Il s'y ajoute le manque de suivi par l'administration pénitentiaire du nombre d'heures travaillées (sauf dans les établissements à gestion déléguée). Il est cependant évident que la rémunération du travail au service général est dérisoire. Les tarifs parlent d'eux-mêmes : Montants journaliers nets par classe à compter du 1er janvier 2000
Les différentes classes correspondent à l'exercice de fonctions plus ou moins qualifiées qui vont de la cuisine jusqu'à l'entretien. Cela signifie, sachant que la durée moyenne journalière de travail est de 6 h (24), un taux horaire moyen égal à 6,50 F et une rémunération mensuelle moyenne de 735 F. Ces rémunérations sont nettes de tout prélèvement, l'administration pénitentiaire prenant à sa charge les cotisations (salariales et patronales) des détenus classés au service général et ne leur prélevant pas de frais d'entretien. Par contre, elles ne sont pas en totalité immédiatement disponibles, « cantinables » selon le vocable pénitentiaire. Elles font l'objet, comme les autres revenus, du prélèvement de 20 % affecté pour moitié à l'indemnisation des victimes et pour moitié à la constitution du pécule de libération. Il est peu étonnant, dans ces conditions, que, malgré la plus grande liberté de mouvement qu'autorise l'exercice de cette activité, ces postes soient parfois difficilement pourvus. Le service général est financé en fonction de tarifs fixés de façon centralisée, sur les crédits budgétaires de fonctionnement attribués aux établissements. Les limites d'ordre budgétaire que connaît l'administration pénitentiaire génèrent cette situation comme elles génèrent la quasi-stagnation du nombre des postes au service général alors qu'il présente l'intérêt d'offrir au détenu un rôle, sur place, au service de tous les autres. Au minimum, et dès le prochain exercice budgétaire, une revalorisation conséquente du service général s'impose, sachant que son coût total pour 1999 a été de 110 millions de francs. Les activités productives sont de niveau très inégal mais globalement faiblement rémunérées : Rémunération mensuelle brute (1999)
Source : Administration pénitentiaire A ces chiffres correspond une rémunération journalière moyenne, toutes activités de production confondues, de 116,42 F (25). Ce chiffre connaît une évolution positive, il n'était que de 95,79 F en 1993. Il revient en 1999, pour 21 jours de travail, à un salaire moyen de 2 436 F. L'article D.103 du code de procédure pénale dispose que « les conditions de rémunération des détenus qui travaillent sous le régime de la concession, sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral ». Au vu des rémunérations moyennes, il est difficile d'admettre que le SMIC serve réellement de référence même s'il est toujours invoqué. L'administration pénitentiaire invoque les effets de la rémunération à la pièce qui est pratiquée à la fois par les concessionnaires, la RIEP et les groupements dans les établissements à gestion déléguée. Elle fait valoir que l'usage de la rémunération à la pièce est généralement à l'origine d'un niveau de rémunération modeste chez les détenus eu égard à l'absence de qualification des opérateurs, à la faiblesse de la productivité ainsi qu'au contexte pénitentiaire qui ne produit pas les mêmes effets en matière de performance que le travail en milieu libre. Toutefois, sous le régime du contrat de concession, dans certaines situations de travail en établissements pour peine, nécessitant un niveau de qualification plus élevé, le SMIC est parfois atteint, voire dépassé. Effectivement, la disparité des rémunérations est réelle, d'une activité à l'autre, d'un détenu à l'autre, voire pour un même détenu en fonction de la fluctuation de l'activité dans le temps. Les salaires moyens versés d'un établissement à l'autre s'étagent de 600 F à plus de 2 000 F. Les salaires maximums en atelier atteignent parfois, pour les activités les plus qualifiées, des montants de l'ordre de 10 000 F. Comme l'a souligné le Conseil économique et social (26) : « Le bénéfice tiré par les entreprises concessionnaires du travail en prison demeure inchiffrable et le niveau des rémunérations dépend d'une négociation commerciale, d'un contrôle technique par les cadences retenues pour fixer la rémunération horaire optimale dans le cas des rémunérations à la pièce, mais surtout, du rapport de forces administration/entreprises. Or dans ce rapport, l'administration occupe une position doublement faible : elle a un besoin urgent de procurer des tâches aux détenus, dont la qualité de travail est généralement faible. Elle se trouve donc contrainte d'accepter des prix bas, voire très faibles... ». Cette négociation est compliquée par le fait que l'administration pénitentiaire doit aussi tenir compte d'impératifs en termes de faisabilité des activités dans les locaux, de sécurité et de continuité de l'offre de travail et est confrontée à la difficulté de trouver des entreprises partenaires lorsque l'établissement est implanté en zone rurale. Il arrive que des entreprises fasse jouer la concurrence entre les établissements pour négocier au mieux leur prix de revient. La difficulté vient du fait que la motivation des entreprises concessionnaires réside essentiellement dans le caractère bon marché de la main d'_uvre carcérale. Mais celui-ci ne résulte pas que des conditions du marché. En effet, les entreprises bénéficient d'avantages lorsqu'elles travaillent avec l'administration pénitentiaire. De surcroît elles y trouvent une réponse à leur demande de flexibilité. Le contrat de concession permet de mettre à la disposition d'une entreprise privée de la main-d'_uvre employable à différents travaux de production dans des locaux situés à l'intérieur des établissements pénitentiaires. L'administration assume le rôle d'employeur, l'entreprise lui rembourse les rémunérations versées à la population pénale et le montant des charges sociales. Il en découle pour l'entreprise un certain nombre d'avantages directs ou indirects en termes de coût : La mise à disposition gracieuse de locaux constitue un avantage en nature non négligeable. A l'exception du remboursement des fluides (électricité et participation forfaitaire aux charges de chauffage et d'éclairage), aucune contribution de la part de l'entreprise ne vient compenser un certain nombre d'investissements et de prestations réalisées au profit de l'activité par l'administration. La non-application du droit du travail, à laquelle s'ajoutent des exonérations diminue le coût global. Il en résulte un régime de charges sociales avantageux : - absence de cotisations (patronales et salariales) aux ASSEDIC - non-paiement de la taxe d'apprentissage (0,5 %) - exonération de cotisations patronales au titre des allocations familiales - taux réduit des cotisations patronales à l'assurance maladie-maternité (4,2 % au lieu de 12,8 %). Le coût global des cotisations de sécurité sociale est abaissé de 41,6 % à 26,85 % :
S'y ajoutent : - l'absence de dispositions concernant l'emploi et le licenciement - l'absence de congés payés, de primes, de 13ème mois - et sur le plan fiscal, le non-assujettissement à la taxe professionnelle pour la fraction de l'assiette assise sur les salaires puisque les détenus ne sont pas comptabilisés comme des actifs de l'entreprise. Enfin, la pratique de ce qu'il convient d'appeler les « fausses concessions » permet à des entreprises de minorer leur coût de revient global en n'affectant pas à l'établissement pénitentiaire le personnel d'encadrement qui serait nécessaire. Cet encadrement est, de fait, assuré par du personnel de surveillance de l'établissement. Ces entreprises se placent, en réalité, dans la position d'un donneur d'ordre à son sous-traitant et se déchargent sur l'administration pénitentiaire de l'organisation de l'activité de production avec les conséquences qui en découlent pour cette dernière en termes de responsabilité. Les obligations formulées à l'égard des entreprises en matière d'encadrement de l'activité de production devrait être renforcées. Pour tenter de mieux contrôler l'exécution du travail pénal, l'administration pénitentiaire a étendu, en décembre 1998, l'indicateur contractuel dénommé SMAP (Salaire minimum de l'administration pénitentiaire) à tous les contrats de concession. Le SMAP a été à l'origine institué dans les marchés des établissements à gestion déléguée. Sa valeur au 1er janvier 2000 est de 17,55 F en maison d'arrêt et de 19,01 F en centre de détention. Conçu au départ comme un SMIC, à un taux inférieur, qui devait être respecté pour tout détenu, sauf motifs thérapeutiques ou d'adaptation à l'emploi, le SMAP est aujourd'hui vérifié, mensuellement, par atelier. Il est de fait devenu « un minimum collectif moyen ». En outre, les rémunérations versées sont affectées de certains prélèvements. Comme cela a été indiqué pour le service général, les revenus du travail font l'objet d'un prélèvement de 20 % : 10 % affectés à l'indemnisation des victimes et 10 % à la constitution du pécule de libération. Pour les revenus tirés d'une activité exercée en concession ou dans le cadre de la RIEP, s'y ajoute un deuxième prélèvement pour « frais d'entretien ». Ils sont d'un montant de 300 F mensuels et ne peuvent excéder 30 % de la rémunération nette. Ces frais d'entretien sont prélevés au profit du Trésor public, ils ne reviennent donc pas à l'établissement pénitentiaire, alors que leur justification initiale résidait dans la compensation des frais exposés par l'administration pour l'organisation du travail pénal. La perception de frais d'entretien par l'administration pénitentiaire apparaît comme une mesure sans réelle justification, injuste puisqu'elle ne s'applique qu'à certains détenus et désincitative à l'exercice d'un travail. Leur suppression s'impose. « Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions » (Art. D.478 du code de procédure pénale). Le retour à la vie libre est un moment d'autant plus critique que l'incarcération a été longue. Au-delà des actions à plus long terme qui peuvent être menées pendant la détention en matière de formation notamment, la préparation à ce moment nécessite que l'on puisse y consacrer les moyens nécessaires en hommes et en temps. a) L'aide administrative à la libération L'enquête sur les sortants de prison conduite par l'administration pénitentiaire en 1997 montre que les personnes libérées ont peu recours aux organismes d'aide à l'emploi, malgré une proportion de chômeurs importante (60 %). Moins du quart des sans-emploi sont inscrits à l'ANPE, moins de 20 % aux ASSEDIC (pour obtenir l'allocation d'insertion) (27) Le RMI a été sollicité par à peine 14 % des personnes sans-emploi pouvant y prétendre. « Il semblerait que ceci soit dû à un manque d'information » précise l'étude. L'obligation d'information sur les droits sociaux de nature à favoriser la réinsertion a d'ailleurs été réitérée par l'article 83 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions La préparation à la sortie, en liaison avec les insuffisances des effectifs de travailleurs sociaux, fait souvent l'objet de critiques, même si la difficulté du travail de ces derniers est accrue par le fait que la date de la sortie (en particulier en maison d'arrêt) n'est pas nécessairement connue à l'avance. L'administration pénitentiaire a élaboré un programme de dispositifs de préparation à la sortie de prison lorsque celle-ci peut être programmée. Son développement doit être achevé en l'an 2000. Selon les informations fournies par celle-ci, l'ensemble des maisons d'arrêt et certains centres de détention ont mis en place des dispositifs de préparation à la sortie. En maison d'arrêt, là où l'insertion relève souvent de la gageure, c'est bien sur la préparation à la sortie que l'accent peut être mis. Certains établissements ont mis en place des « plateaux techniques » qui permettent d'organiser une rencontre directe entre les détenus et les services extérieurs (ANPE, ASSEDIC, DASS...). Des dispositifs intéressants sont à souligner tels que le C.I.P.I. à Osny (Contact information pour l'insertion), guichet polyvalent auquel les détenus ont accès une fois par mois. D'autres établissements ont mis en place des modules de préparation, de courte durée, quelques mois avant la date de sortie, axés sur la recherche d'emploi et le bilan de compétence (Joux-la-Ville, Villenauxe, Oermingen...). Mais, le manque de personnel socio-éducatif constitue souvent un obstacle à la préparation de certaines démarches comme l'instruction d'un dossier de RMI avant la sortie de prison, contrairement au principe posé par la circulaire du 27 mars 1993 qui précise que la demande d'allocation doit être préparée et transmise à la caisse d'allocations familiales avant la sortie de l'établissement. Il est également prévu qu'un « circuit court » pourra être organisé par convention entre les préfectures, les caisses d'allocations familiales et les services instructeurs pour assurer le paiement d'une avance sur droits supposés. Selon la situation locale, cette procédure fonctionne plus ou moins bien. Il s'y ajoute d'ailleurs la complexité de la réglementation elle-même, réglementation qui s'adresse de surcroît à un public en difficulté. Les sortants de prison ont droit à l'allocation d'insertion (à l'exclusion de ceux ayant été condamnés à certaines peines comme le trafic de stupéfiants, les agressions contre un mineur ; exclusion sur le fondement desquelles on peut d'ailleurs s'interroger, la peine ayant été par hypothèse accomplie). Le RMI étant une allocation subsidiaire et différentielle, le demandeur doit au préalable faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles. Les sortants ayant droit à l'allocation d'insertion doivent donc faire deux demandes (une d'allocation d'insertion et une de RMI) et s'ils ne demandent pas l'allocation d'insertion, ils n'auront pas droit au RMI. Réserver le bénéfice de l'allocation d'insertion à ceux qui n'ont pas droit à un RMI différentiel (pour des raisons d'âge notamment) serait une mesure de simplification des démarches. En tout cas, toutes les dispositions devraient être prises pour que les démarches puissent être initiées depuis l'établissement pénitentiaire. b) Les aides matérielles aux sortants Un peu plus de 25 % des détenus sortent de prison en disposant de moins de 100 francs, 20 % disposant de moins de 50 francs (28). Bien que des différences existent selon l'établissement de sortie (maison d'arrêt ou établissement pour peine), dans leur grande majorité, les libérés sont confrontés à des difficultés matérielles. Ils sortent majoritairement sans emploi et avec peu d'argent. Les aides matérielles à la sortie pour les détenus démunis sont extrêmement variables d'un établissement à l'autre. A ces aides généralement centrées sur la délivrance d'un titre de transport, s'ajoutent, de façon variable, la remise de cartes de téléphone, de chèques-services, de tickets-restaurants, de sacs de sport... Certains établissements réfléchissent à la mise en place d'une aide (maison d'arrêt d'Albi) ou plus précisément d'un « kit sortant » (maison d'arrêt de Chartres), alors que d'autres le font déjà (la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand remet un kit comprenant 16 articles). Un programme pluriannuel a débuté en 1998, en direction des sortants les plus démunis, afin de leur fournir une aide d'urgence pour leurs besoins immédiats. Son montant a été de 5 millions de francs en 1999, délégués aux directions régionales des services pénitentiaires. Il est de 7 millions de francs en 2000. B.- POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 1) Des avancées notables dans la prise en charge médicale a) L'apport de la loi du 18 janvier 1994 Un point fait l'unanimité : la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a constitué une avancée substantielle dans la prise en charge médicale des personnes détenues. « La santé des détenus est un problème constant qui a fait des progrès considérables. Nous sommes arrivés avec des difficultés inouïes à mettre fin à ce que l'on a appelé « la médecine pénitentiaire », qui était une médecine de sous-hommes. Nous fûmes confrontés à des réactions corporatistes intenses. En 1983, nous avons rattaché les établissements pénitentiaires à l'inspection de l'administration de l'assistance publique. Le regard de cette inspection fut enfin posé sur la médecine carcérale et, de ce jour, tout fut rendu possible, avec des progrès successifs qui n'ont jamais cessé, car l'on a compris qu'il ne pouvait exister une médecine pratiquée pour tous et une médecine carcérale et un traitement carcéral des maladies. Il existe des maladies pénitentiaires, mais c'est autre chose. Devant la maladie, tout être humain doit être également traité. » (M. Robert Badinter) La loi de 1994 a confié au service public hospitalier la mission de dispenser les soins aux détenus en milieu pénitentiaire et a prévu l'affiliation de ceux-ci aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale. L'hôpital est également chargé de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. Après des débuts difficiles et un substantiel renforcement des moyens par la direction des hôpitaux en 1997 et 1998, cette donnée fait désormais partie intégrante de la vie de la prison. Il en a résulté une nouvelle conception de la mission de soins en prison : indépendance du corps soignant, respect de la relation entre le médecin traitant et son patient, continuité, en principe, des soins à la libération. Des locaux ont été aménagés : les unités de consultations de soins ambulatoires (UCSA) qui sont partout en place. Elles constituent, de fait, une sorte d'enclave, de l'extérieur à l'intérieur, et le contact ainsi permis aux détenus avec des personnes indépendantes de l'administration pénitentiaire n'est sans doute pas étranger à leur forte fréquentation. Il s'y ajoute un dispositif spécifique pour les soins psychiatriques : La prise en charge ambulatoire est assurée par l'équipe de secteur de psychiatrie locale (actuellement 125 secteurs interviennent en milieu pénitentiaire). En outre, 26 services médico-psychologiques régionaux (SMPR) ont été créés. Ce sont des implantations en détention, de services hospitaliers, destinées à assurer à la fois le suivi ambulatoire et l'hospitalisation volontaire. La lourdeur et la fréquence des pathologies psychiatriques dans la population pénale suscitent de vraies difficultés qui ne sont pas résolues (Cf. 2). Enfin, dans les établissements pénitentiaires du programme « 13 000 », l'organisation des soins aux détenus est confiée, par voie conventionnelle, à des groupements privés. Ces derniers assurent le recrutement des personnels de santé en fonction de leur cahier des charges. Le renouvellement de ces marchés a été décidé. Le nouveau cahier des charges renforce d'ailleurs les moyens des unités médicales en vacations de psychiatres et de psychologues en raison des insuffisances constatées en ce domaine. b) Des enjeux de santé publique On retrouve, en prison, les mêmes pathologies qu'à l'extérieur mais en plus grand nombre, notamment en raison du nombre important d'usagers de drogue par voie intraveineuse. ▪ Comme dans l'ensemble de la population, on note une baisse significative de la prévalence du VIH. En 1998, 1,56 % des détenus étaient recensés comme séropositifs au VIH (5,8 % en 1990) 29. Ce taux est cependant trois à quatre fois plus élevé que celui constaté dans la population globale équivalente. Le dépistage du VIH est systématiquement proposé à l'entrée en détention ; cependant, un effort serait nécessaire pour que ce dépistage donne lieu à une véritable consultation d'information personnalisée. Monsieur Pierre Pradier, auteur du rapport sur la gestion de la santé dans les établissements du programme 13 000, a souligné la bonne qualité de la prise en charge des personnes atteintes en prison. « La trithérapie pose un gros problème de servitude d'abord du malade pour s'y soumettre mais aussi de coût pour la société. En tout cas, elle est mise en _uvre de façon tout à fait convenable. Je n'ai pas vu un seul malade dans les 13 000 ni dans un établissement à gestion directe, qui ait été « abandonné » ou négligé. Les traitements sont de bonne qualité et la situation est relativement satisfaisante. » L'association Act-up a toutefois soulevé les difficultés concrètes auxquelles pouvaient se heurter les détenus pour suivre ces traitements en prison : « Lorsque l'on doit suivre un traitement aussi lourd que celui par les antirétroviraux, la promiscuité en détention et le fait de devoir prendre ses médicaments devant ses codétenus engendrent la peur de la stigmatisation. De plus, le rythme de la détention fait que, parfois, il faut choisir entre prendre son repas chaud ou ses médicaments, car ceux-ci doivent être pris à heure fixe. Enfin, les détenus malades du sida ne peuvent travailler à la fois pour des raisons de santé et par crainte de la stigmatisation, car ils sont obligés d'interrompre leur travail pour prendre les médicaments et ils sont alors déclassés. » (M. Serge Lastennet, Act-up Paris) ▪ Dans les prisons, comme à l'extérieur, la prévalence de l'hépatite C pose un problème majeur de santé publique. « Si l'on peut, sinon lever le pied, mais du moins être un peu moins inquiet pour ce qui est des problèmes du sida, en revanche l'hépatite C devient une véritable inquiétude. Actuellement dans les visites d'entrée, on ne fait pas cet examen sérologique sans que le malade en soit d'accord. Généralement, les malades sont d'accord et le plus souvent il n'y a pas de résistance majeure pour qu'ils acceptent cet examen. Le chiffre de séropositivité est supérieur à 20 % et même 28 % dans un certain nombre d'établissements. Lorsque l'on sait que, s'agissant de l'hépatite C, il s'écoule une période « silencieuse » d'environ une dizaine d'années entre l'apparition de la séropositivité et l'explosion de la maladie, on peut considérer que nous avons, dans nos prisons, une bombe à retardement. Il y a là véritablement motif à une grande inquiétude ! » (M. Pierre Pradier) L'étude sur la santé des entrants effectuée en 1997 indiquait des taux de séropositivité de 2,3 % pour le virus de l'hépatite B et de 4,4 % pour celui de l'hépatite C. Les données, déclaratives, sont sous-estimées car le dépistage de ces infections reste peu fréquent. A l'instar de ce qui se fait en milieu libre, il est recommandé de proposer le dépistage du virus de l'hépatite C à toute personne présentant des facteurs de risque (circulaire du 21 mai 1999). Celui-ci présente, en effet, en prison une importance particulière puisque 84 % des personnes séropositives au VHC sont des usagers de drogue par voie intraveineuse. Les effectifs de médecins sont proches des effectifs prévus dans les protocoles avec les hôpitaux après l'effort supplémentaire que les agences régionales d'hospitalisation y ont consacrés, à la suite de la première évaluation réalisée en 1997.
* ETP : équivalent temps plein Ainsi, l'effectif rémunéré des chirurgiens dentistes s'élève à 1,2 ETP pour 1 000 personnes détenues. Cet effectif rémunéré correspond à 95 % de l'effectif prévu et un effort certain a pu être noté en termes d'équipement des cabinets dentaires. S'agissant des effectifs rémunérés de médecins psychiatres, ils atteignaient 2,6 ETP pour 1 000 détenus. Ils correspondent à 92 % des effectifs prévus. L'effectif rémunéré de médecins spécialistes (hors psychiatres) correspondait à près de trois demi-journées d'activité mensuelle pour 1 000 détenus. Cependant, il a pu être constaté, dans des établissements pénitentiaires éloignés des centres urbains comme, par exemple, à Clairvaux, qu'il pouvait être difficile de trouver des médecins pour assurer les vacations, notamment des consultations spécialisées et, en tout cas, que cette situation entraînait un important « turn over » préjudiciable à la continuité des soins. Or l'absence de certains spécialistes dans les établissements renforce d'autant le nombre des extractions nécessaires. En outre, il a été jugé nécessaire de renforcer les moyens des unités médicales des établissements du programme « 13 000 » prévus par le cahier des charges à l'occasion de la procédure de renouvellement des marchés : renforcement de 20 à 50 % de la composition des équipes médicales, notamment pour les médecins généralistes, les psychiatres, les dentistes et les personnels infirmiers, afin que leur mode de fonctionnement et leurs effectifs soient comparables à ceux des UCSA. Le problème de la présence médicale se pose de façon particulièrement aiguë pour les urgences de nuit. Dans les établissements où il n'existe pas de médecin de permanence la nuit (la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy notamment, qui compte pourtant 750 détenus et a connu, en 1999, 200 urgences hors des heures d'ouverture du service médical), le recours au centre 15 est nécessaire. Il en résulte des difficultés importantes. La première, est pour le personnel pénitentiaire, de savoir s'il doit alerter ou non le service d'urgence. « A l'intérieur de la prison d'abord, les personnels de surveillance sont confrontés à des problèmes insolubles ! Je prends le cas d'un établissement de moyenne importance, dépourvu d'une permanence médicale et infirmière, laquelle existe dans les très grands établissements. Dans un des 150 établissements concernés, il est vingt-trois heures, le médecin est parti et un détenu se plaint de maux de ventre très douloureux. Que fait-on ? On va chercher le surveillant de nuit lequel peut être confronté à des gens qui ont une certaine habitude d'un peu simuler et d'un peu mentir. Il ne faut pas être angélique mais il ne s'agit pas non plus de conclure qu'ils sont constitutionnellement mauvais mais c'est la seule arme qu'ils ont. Le surveillant de nuit peut être d'un naturel anxieux et il appelle le médecin alors que le cas ne le mérite pas ! Ou bien il a un esprit sécuritaire ou plus punitif et il risque de connaître un épisode grave avec la perte du malade ! Il est confronté en tout cas à des responsabilités de santé pour lesquelles il est mal armé. Une suggestion avait été faite pour que la décision relève finalement du médical : un téléphone portable, porteur d'une seule ligne, en direction du SAMU de l'hôpital dont dépend l'établissement. Le surveillant passerait le médecin - régulateur dont le métier est de comprendre le sens d'un appel, d'analyser une situation et de prendre une décision médicale, libérant un personnel qui n'en peut mais. Il est vrai qu'un téléphone portable dans un établissement pénitentiaire est un instrument qui sent le soufre. Mais techniquement il est assez simple de ne prévoir qu'une ligne vers le SAMU. Des solutions peuvent être imaginées. La difficulté tient au fait que l'imagination n'est pas au pouvoir dans les établissements. » (M. Pierre Pradier) Ensuite, il arrive que les services de garde, refusent dans certains endroits, de se déplacer. Enfin, presque pour l'anecdote, s'il ne s'agissait d'une utilisation condamnable des deniers publics, on peut regretter que des établissements pénitentiaires disposent d'appareils de radiologie neufs qui restent inutilisés faute d'un manipulateur radio ou d'un médecin généraliste formé à leur utilisation. En conséquence de quoi, les détenus doivent se rendre à l'hôpital de rattachement pour effectuer ces examens avec toutes les difficultés qu'emportent les « extractions ». a) L'accès aux soins en milieu hospitalier Une difficulté majeure de l'organisation des soins réside dans l'accès aux soins en milieu hospitalier. La loi du 18 janvier 1994 comporte deux volets, l'un relatif aux soins dans les établissements pénitentiaires, l'autre à l'accès à l'hôpital tant pour les hospitalisations que pour les consultations externes qui repose sur l'élaboration d'un schéma national d'hospitalisation des détenus. Celui-ci n'a toujours pas vu le jour et son horizon apparaît encore lointain. L'objectif de ce schéma est d'améliorer les conditions d'hospitalisation, tout en rationalisant les moyens consacrés à la garde et à l'escorte des détenus. Les services médicaux se heurtent constamment, et partout, à ces deux problèmes qui suscitent des querelles incessantes entre l'administration pénitentiaire et les services de police ou de gendarmerie. « Les textes prévoient que les escortes pour consultation sont de la compétence de la pénitentiaire, excepté dans les petits établissements qui ne disposent pas du personnel et de l'équipement en véhicules nécessaires. Ces escortes sont alors de la compétence de la police ou de la gendarmerie. Ce qui a fonctionné correctement pendant un certain nombre d'années ne fonctionne plus parce que les hospitalisations sont de plus en plus nombreuses, dans la mesure où la médecine est de mieux en mieux implantée en détention. S'ajoute le problème de la garde que vous souligniez, qui revient à la police ou à la gendarmerie, mais qu'elles n'aiment guère assurer, car une telle fonction mobilise longtemps des effectifs élevés. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) « Faire sortir un malade, faire une « extraction » - quel terme ! - pour motifs de santé est un parcours du combattant. Il faut remonter la filière jusqu'au directeur de l'établissement, lequel entretient avec les forces de police, le commissariat ou la gendarmerie selon les cas, des rapports qui peuvent être plus ou moins bons. La gendarmerie traîne un peu les pieds, elle maugrée... mais elle y va ! La police ? Il arrive assez fréquemment qu'un responsable rétorque que tel n'est pas son métier, qu'il y a d'autres urgences... Ce sont des palabres sans fin ! Certaines situations sont alors très difficiles surtout quand il y a réellement urgence ! Il me semble que sur ce sujet, des textes précis, ne prêtant pas à interprétation locale, pour commodité personnelle ou autre, doivent voir le jour et donner sans équivoque la conduite à tenir. » (M. Pierre Pradier) Les consultations médicales en milieu hospitalier posent d'ailleurs aussi la question du respect du secret médical. « Il y a un tel cirque autour de la sécurité que le médecin de l'hôpital, qui n'est pas habitué - mais les médecins le sont de plus en plus - à recevoir quelqu'un entravé, menotté, entouré de surveillants, peut avoir peur et demander que le surveillant reste à l'intérieur de la pièce pendant la consultation ; il en résulte une violation du secret médical. » (Docteur Véronique Vasseur) Un arbitrage interministériel est intervenu lors du conseil de sécurité intérieure du 6 décembre 1999 qui doit se mettre en place à l'horizon 2002, répartissant la charge des escortes et de la garde. Il a été décidé que les services pénitentiaires assumeraient intégralement la charge des escortes des détenus aux consultations externes en milieu hospitalier, sauf s'agissant des détenus dangereux, alors qu'actuellement ils n'en assurent que 75 %. Pour assurer cette couverture, l'administration a évalué ses besoins à 415 emplois de personnels de surveillance supplémentaires. Trois emplois ont été créés en 1999 pour assurer les escortes et 33 en 2000 (il en manque donc encore 379). Les services pénitentiaires assureront également, dans les cas d'hospitalisation, la surveillance du malade détenu dans les unités hospitalières spécialisées interrégionales (UHSI) prévues par le schéma national. Il reviendra par contre aux forces de l'ordre d'assurer l'escorte depuis l'établissement vers l'unité d'hospitalisation, la garde externe (la porte d'entrée) et les accompagnements dans l'hôpital vers les plateaux techniques. Pour autant, tous les points de ce schéma, déjà complexe, ne sont pas réglés, en particulier celui des hospitalisations d'urgence, de nuit et de jour. Cette nouvelle répartition de la charge des escortes suppose aussi une mise en place effective des UHSI. « La solution réside à l'évidence dans la mise en _uvre prochaine du schéma national d'hospitalisation par la construction et la mise en service d'unités sécurisées au sein de centres hospitaliers universitaires. Aujourd'hui encore, les problèmes que pose ce projet ne semblent pas avoir été tous résolus : l'articulation interne de ces unités d'hospitalisation avec le plateau technique central, le statut et l'organe de rattachement des personnels de surveillance, le degré de coopération de la structure hospitalière restent encore « brumeuses » mais la décision de principe est prise et il faut aller vite. » (Rapport précité de M. Pierre Pradier) Le schéma national d'hospitalisation, qui ne concerne pas les hospitalisations psychiatriques, a été défini. Il est organisé autour de huit pôles répartis sur le territoire, qui assureront les hospitalisations programmées à partir de l'ensemble des établissements pénitentiaires, au sein des UHSI. Les hospitalisations d'urgence et celles de très courte durée (24 heures) se feront sur l'hôpital de proximité de l'établissement pénitentiaire. Les implantations des sept pôles (Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg), en plus de l'établissement public de sécurité de Fresnes (EPSNF) font l'objet d'une programmation qui s'intègre dans les schémas de restructuration des centres hospitaliers concernés. Compte tenu de l'importance des travaux nécessaires, l'administration pénitentiaire estime que la montée en charge de ce schéma national d'hospitalisation ne pourra guère débuter avant début 2003 et qu'il devrait être en place pour 2005. A ce jour, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense ont été saisis du projet d'arrêté interministériel créant ces UHSI. L'administration pénitentiaire indique que, sitôt la signature de cet arrêté, un groupe de travail interministériel sera constitué pour redéfinir dans ce cadre les nouvelles procédures de consultations externes et d'hospitalisations des personnes détenues. Ce groupe de travail aura aussi à rechercher les solutions possibles pour optimiser la situation actuelle en attente de l'ouverture des UHSI. L'accueil des détenus dans des centres hospitaliers répartis sur tout le territoire devrait mettre un terme à la situation actuelle qui impose d'envoyer à l'hôpital de Fresnes tout détenu nécessitant une hospitalisation de plus de quelques jours, quel que soit le lieu de sa détention. Or beaucoup de détenus rencontrés lors des visites ont exprimé leurs réticences à l'idée de devoir être hospitalisés à Fresnes car ce type de transfert les contraint généralement, une fois l'hospitalisation terminée, à être incarcérés dans une prison de la région parisienne, parfois plusieurs mois avant de pouvoir être reconduits dans l'établissement d'origine. Les transports de détenus sont en effet regroupés et sont, de ce fait, espacés dans le temps. Les détenus perdent ainsi, pendant de longs mois, les activités - travail, formation - qu'ils suivaient dans leur centre de détention. b) La prise en charge inégale de la toxicomanie ▪ La forte présence des détenus toxicomanes dans les établissements pénitentiaires a déjà été évoquée. Leur prise en charge soulève deux problèmes principaux : d'une part, l'inégalité d'accès aux traitements de substitution, d'autre part l'organisation et la coordination des soins. « Alors qu'une circulaire de la direction générale de la santé, déjà ancienne, invite les services médicaux à offrir aux détenus une offre de soins équivalente à celle de l'extérieur, nous nous sommes rendu compte que la substitution ne concerne qu'un détenu héroïnomane sur sept dans les établissements pénitentiaires alors qu'à l'extérieur elle concerne un héroïnomane sur trois. On s'est donc véritablement heurté davantage à une difficulté de caractère idéologique qu'à une difficulté de moyens. En effet, un certain nombre de médecins à l'intérieur des établissements pénitentiaires considèrent pour les raisons éthiques, morales, idéologiques que la substitution n'est pas une bonne chose pour les détenus qu'ils ont en charge. Ce débat à l'intérieur des établissements pénitentiaires entre médecins favorables et médecins non favorables aux traitements de substitution, a été très vif entre les médecins qui prenaient en charge les toxicomanes à l'extérieur. A l'extérieur, ce débat est désormais totalement pacifié parce que personne ne revendique les traitements de substitution comme seule réponse à la toxicomanie. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une aide considérable pour prendre en charge et conduire un toxicomane à une vie plus normale mais qu'évidemment cela ne peut pas être tout le traitement et que, notamment, l'accompagnement social et psychologique est fondamental. Il existe donc un déficit de prise en charge des héroïnomanes dans les établissements. Même si la situation s'améliore, elle est néanmoins encore préoccupante. » (Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT) De véritables situations de blocage peuvent exister dans les établissements où il n'y a qu'un seul psychiatre et que celui-ci refuse la délivrance de produits de substitution qui n'est pas effectuée par ailleurs par les médecins de l'UCSA. Il en résulte une vraie difficulté dans la mesure où les détenus n'ont, de fait, pas le choix de leur médecin traitant. Cela a été le cas à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy jusqu'à ce qu'un nouveau psychiatre assure les vacations. Or en plus de l'inégalité d'accès aux soins que le refus des traitements de substitution implique, leur nécessité a été rappelée par la présidente de la MILDT : « Il est absolument indispensable de permettre à tous les usagers de drogue de bénéficier des traitements de substitution à l'intérieur. Le sevrage peut être un traitement efficace. Néanmoins, avant que le traitement de substitution ne soit mis en _uvre, à peine 20 % des héroïnomanes arrivaient à s'en sortir avec le sevrage. Aujourd'hui, environ 70 000 personnes à l'extérieur sont sous traitement de substitution, sur un effectif proche de 150 000 héroïnomanes. Le résultat de cette situation est tout de même que l'on a une moins grande prévalence du VIH à l'extérieur, une baisse d'un certain type de délinquance. » Ces traitements de substitution posent un problème annexe qui est celui du trafic qu'ils engendrent. Celui-ci s'est développé avec l'usage du subutex qui, à la différence de la méthadone, n'est pas conditionné sous forme de fiole. Enfin, des problèmes sanitaires demeurent malgré la distribution systématique d'eau de Javel par l'administration pénitentiaire, pour désinfecter les seringues dans le cadre de la réduction des risques. ▪ La question de l'alcoolisme reste, elle, très sous-estimée et sa prise en charge très insuffisante. Environ un tiers des entrants en prison déclarent une consommation dite problématique selon les normes de l'OMS. De plus, il y a souvent recoupement entre les consommateurs de drogues et d'alcool. « Pour ce qui concerne l'alcool, le dispositif est totalement indigent. En effet, les questions d'alcool ont été extrêmement sous-estimées à l'intérieur des établissements pénitentiaires, comme à l'extérieur d'ailleurs, et aucune prise en charge spécifique n'a été organisée. En 1997, l'intervention des consultations spécialisées pour alcoolo-dépendants ne concernaient que deux établissements sur l'ensemble des établissements. Il n'y avait donc pas de consultation spécialisée concernant l'alcool alors qu'on sait par ailleurs qu'un grand nombre d'actes de délinquance sont commis sous l'emprise d'un état alcoolique, notamment des conduites en état alcoolique ou surtout des faits de violence, soit familiale, soit extra familiale. » (Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT) Il n'y a d'ailleurs pas de médecin-alcoologue dans les maisons centrales, à l'exception de celle de Poissy, au motif que le sevrage a eu lieu en maison d'arrêt alors que, bien souvent, ces personnes restent alcoolo-dépendantes pendant leur détention. Une méthodologie de repérage reconnue internationalement, qui est en train d'être élaborée, devrait permettre de mieux identifier les consommations problématiques, préalable essentiel à l'amélioration indispensable de la prise en charge de la dépendance alcoolique. ▪ Outre les inégalités relevées, la prise en charge des toxicomanies soulève également la question de son organisation et de son adaptation à l'évolution des toxicomanies. « On a affaire de plus en plus souvent à des polyconsommations qui associent plusieurs produits, des produits licites et des produits illicites, des médicaments, des produits de synthèse. Contrairement à ce qui se passait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, les éléments en notre possession démontrent qu'il y a de moins en moins ou presque plus d'usagers d'opiacés purs, c'est-à-dire des héroïnomanes qui entrent en prison avec souvent des faits de délinquance violente à leur actif. On observe au contraire une diversité des comportements de consommation et une population qui devient extrêmement hétérogène. Cette diversité et cette hétérogénéité rendent assez difficile la prise en charge et exigent une adaptation du dispositif, d'ailleurs à l'extérieur comme à l'intérieur. » (Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT) Il existe, dans les établissements pénitentiaires, des centres de soins aux toxicomanes (16 centres). Là où il n'y en a pas, les SMPR interviennent ou les UCSA. Dans 40 établissements, opèrent aussi des centres de soins extérieurs sous forme d'un protocole. « ... je dirai aujourd'hui que ce n'est pas une question de moyens parce que finalement, dans les établissements pénitentiaires, il y a plutôt parfois pléthore de services concernés par cette question plutôt que déficit. En présence d'une UCSA, d'un SMPR, d'une antenne toxicomanie, d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, plus deux ou trois associations qui interviennent de l'extérieur, la vraie question est celle de la coordination et de savoir qui fait quoi. Certaines situations sont même assez absurdes. Dans certains établissements, le psychiatre s'intéresse à tout ce qui concerne la tête, c'est-à-dire tous les médicaments psycho-actifs qui agissent sur le système nerveux central : les traitements de la tête sont de l'ordre de psychiatres. « En dessous de la tête », c'est le médecin de l'UCSA. Le service socio-éducatif, lui, s'occupe du social. On retrouve ainsi à l'intérieur de l'établissement toute une série de cloisonnements institutionnels, disciplinaires qu'on est en train de régler dans les prises en charge sanitaires et sociales à l'extérieur. Au fond, c'est comme si la prise en charge dans les établissements pénitentiaires avait pris cinq ou six ans de retard par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ce point est très préoccupant. En outre, les centres de soins aux toxicomanes sont restés beaucoup trop longtemps figés sur la prise en charge d'une seule population, celle des héroïnomanes injecteurs qui ne prennent qu'un seul produit, alors que se sont développées bien d'autres formes de consommation qu'ils n'ont pas vu venir et pour lesquelles ils n'ont pas développé de savoir-faire adapté. » (Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT) Pour y remédier : « Nous sommes en train de redéfinir entièrement les missions des antennes toxicomanie, à partir de l'expérience que nous avons dans les services hospitaliers de l'alcoologie de liaison ou de la toxicomanie de liaison. Au fond, ce dont on a besoin ce n'est pas d'un service spécialisé mais de deux ou trois personnes assez mobiles et assez compétentes qui permettent aux autres services de prendre en charge correctement cette population-là. Nous sommes donc plutôt en train de réorganiser le dispositif dans ce sens, en donnant la responsabilité à l'un des services (SMPR ou UCSA) de remplir cette mission de liaison qui n'est plus une mission de service spécialisé. L'idée est que l'on doit préparer la sortie, avec des objectifs évidemment sanitaires mais également sociaux, et que l'on ne peut pas « saucissonner » les détenus, comme on l'a fait par le passé. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau cahier des charges qui refond entièrement le dispositif en intégrant également la question de l'alcool. Il s'agit d'avoir une petite équipe qui soit capable de répondre à l'ensemble des questions posées par toutes les dépendances (drogues, alcool, médicaments.) » (Mme Nicole Maestracci, présidente de la MILDT) c) L'insuffisance de la prise en charge psychiatrique Un nombre croissant de personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques, à des degrés divers, sont incarcérées ou développent ces troubles en prison. Cela tient, notamment, à la fois à l'évolution des pratiques en matière d'expertise psychiatrique et à la diminution des capacités d'hospitalisation psychiatrique (Cf. I, évolution de la population pénale) « Il s'agit là d'une régression, d'un retour à une confusion des institutions et des fonctions sociales : placement dans un même lieu de malades mentaux et de délinquants, comme cela se faisait à La Bastille, par exemple, avant la distinction entre la prison républicaine et la psychiatrie moderne. Il ne faudrait pas que la présence des dispositifs de soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires en vienne à cautionner le retour à une fonction asilaire de la prison. » (M. Evry Archer, médecin psychiatre, association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) Ces patients très perturbés sont en grande difficulté dans les maisons d'arrêt ou les centres de détention. Ils posent aussi d'énormes problèmes au personnel de surveillance et aux autres détenus. La question de leur place en prison, pour les plus gravement atteints d'entre eux, a été soulevée par pratiquement tous les intervenants devant la commission d'enquête. Elle sera traitée plus loin (Cf. V, limiter les incarcérations). Se pose, de façon plus générale, la question à la fois de la prise en charge psychiatrique dans les établissements pénitentiaires et de son articulation avec les structures extérieures, dans la perspective d'un suivi post-pénal. ▪ Or la prise en charge psychiatrique n'est pas assurée partout comme elle le devrait. Interviennent dans les établissements pénitentiaires, soit des médecins psychiatres et une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d'un service médico-psychologique régional (SMPR) implanté dans l'établissement et qui peut assurer des hospitalisations volontaires, soit des médecins vacataires relevant du secteur de psychiatrie générale où est implanté l'établissement pénitentiaire. Dans le deuxième cas, le centre pénitentiaire est rattaché au SMPR d'un autre établissement vers lequel des transferts seront possibles pour l'hospitalisation volontaire. On observe, tout d'abord, que certains secteurs de psychiatrie ayant de nombreux postes vacants, ceci a des répercussions sur les interventions en milieu pénitentiaire en termes de suivi ambulatoire. Ce suivi est, en outre, difficilement assuré quand les médecins vacataires sont multiples et fréquemment renouvelés. « Le premier aspect est la disparité des moyens. Il existe en France vingt-six SMPR. Ils sont bien dotés, font du très bon travail dans les établissements où ils sont situés. Mais quand j'étais responsable du SMPR de Rouen et des établissements autour - la maison d'arrêt du Havre, la maison d'arrêt d'Evreux et le centre de détention de Val-de-Reuil -, j'avais 19 personnes pour 600 détenus, alors que l'établissement du Havre n'avait que deux heures de psychiatrie par semaine pour 200 détenus. La disparité est considérable ! Il convient toutefois de préciser que la loi de 1994, prévoyant notamment une amélioration du suivi psychiatrique, a été suivie d'effets suivant le bon vouloir des médecins chefs de psychiatrie. Dans certains cas, comme celui du Havre, il n'y avait pas un souhait très marqué de mettre en place beaucoup d'heures dans la maison d'arrêt, eu égard au manque de moyens dans le secteur lui-même. Le médecin chef du secteur de psychiatrie étant lui-même en grande difficulté pour gérer son secteur, il ne voyait pas l'utilité d'enlever encore des moyens supplémentaires sur le quotidien de son secteur pour les affecter à une maison d'arrêt. » (Docteur Betty Brahmy, responsable du SMPR de Fleury-Mérogis) Il existe vingt-six SMPR. Cinq d'entre eux n'ont toujours pas de lits d'hospitalisation, soit parce que les travaux ne sont pas terminés, soit parce que le personnel médical nécessaire n'est pas encore affecté, soit parce que les postes de personnel pénitentiaire que suppose l'organisation du SMPR ne sont pas encore pourvus. Il s'agit des SMPR de Bois-d'Arcy, de Châlons-en-Champagne, de Châteauroux, de Nice et de Rouen. Ces SMPR non encore pourvus de lits assurent les consultations et les traitements ambulatoires et sollicitent le SMPR de rattachement temporairement prévu pour les hospitalisations. Même si ce n'est pas un cas général, le SMPR de Lyon a un taux d'occupation qui ne lui permet pas de répondre aux hospitalisations d'urgence. Le programme initial prévoyait 32 lits à la création, mais il n'y a jamais eu que 24 lits pour des raisons qui tiennent aux locaux. Cette unité d'hospitalisation correspond à une zone d'intervention qui comprend 2 600 personnes détenues. Les besoins d'hospitalisation sont particulièrement importants du fait de la présence de personnes exécutant des longues peines à la maison centrale de Moulins, ainsi que de nombreuses petites maisons d'arrêt sur ce secteur. Il est arrivé que l'impossibilité d'hospitalisation sur l'un des SMPR de la région ait pour conséquence une hospitalisation d'office. D'autres SMPR ont plutôt des difficultés en termes de capacité de suivi ambulatoire et de consultations. C'est le cas, par exemple, du SMPR de Fresnes qui prend en charge un nombre important de détenus venant du Centre National d'Observation et qui sont en attente d'affectation en établissement pour peine. C'est le cas aussi du SMPR de Caen dont l'unité d'hospitalisation ouverte en février 2000 n'est pas occupée en totalité, et qui ne peut répondre à toutes les demandes de consultations, notamment du fait que 70 % des détenus affectés sur le centre de détention sont condamnés pour infraction sexuelle. Reste le cas de la Guyane. L'établissement de Remire a pour SMPR de rattachement celui de Ducos en Martinique. Ce rattachement n'est que fictif. En effet, le transfert d'un détenu de la Guyane à la Martinique entraînerait une rupture des liens familiaux, qui conduit les détenus à refuser l'hospitalisation. Lorsque le psychiatre estime l'hospitalisation nécessaire, il procède alors à une demande d'hospitalisation d'office. Cette situation n'est pas satisfaisante et la création d'un SMPR à Remire devrait intervenir très prochainement. Les lits existent depuis l'ouverture de l'établissement car la création de ce service était envisagée. Mais, à la suite de la grave émeute de juillet 1999, les mineurs occupent les locaux prévus pour le SMPR pendant les travaux de réfection (et les femmes ceux du centre de semi-liberté) Ces disparités posent un problème majeur pour l'application de la loi relative à la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles. « J'appelle votre attention sur ce point important, parce qu'il va nous causer des problèmes sérieux quant à l'application de la loi du 18 juin 1998 relative à la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles. Cette loi vise à inciter fortement les détenus à être suivis pendant leur incarcération. Encore faut-il que, lorsqu'ils écrivent pour demander à être suivis, il y ait la possibilité de les suivre. Je ne sais pas quel recours ils pourront introduire pour l'application des mesures d'aménagement de peine prévues dans cette loi en cas de refus de répondre à leur demande de soins faute de moyens. C'est un vrai problème de déni de justice dans la mesure où cette loi ne sera pas applicable dans quelques établissements. Je précise que ce n'est pas du tout le cas de Fleury-Mérogis. » (Mme Betty Brahmy, médecin psychiatre) Le renforcement des équipes de soins psychiatriques apparaît donc comme une nécessité. ▪ La possibilité de procéder à des hospitalisations d'office en hôpital psychiatrique se heurte à l'évolution de ces hôpitaux, qui mettent en avant leur ouverture pour justifier leur réticence à l'accueil de ces détenus, car ils ne sont pas équipés pour répondre au risque d'évasion. « Tous les psychiatres de SMPR ont beaucoup de difficulté à placer leurs patients en hôpital psychiatrique. En effet, ces établissements ont humanisé leurs services, les ont ouverts. Ils ont un personnel souvent moindre qu'il y a quelques années. Ils ont fermé un nombre de lits assez important. Ils ne souhaitent pas fermer un pavillon de vingt-cinq places pour un détenu. Je rappelle qu'en psychiatrie, il n'y a pas de garde statique de policiers, contrairement aux services de médecine, chirurgie et obstétrique. Par conséquent, l'équipe de psychiatrie a la charge non seulement des soins du patient, mais également de sa sécurité, ce qui les fait un peu réfléchir. Ils ont peur des conséquences. Quand il s'agit de quelqu'un qui encourt une peine d'un mois de prison, ils ne sont pas trop inquiets, mais quand le détenu est incarcéré pour des faits beaucoup plus graves, ils se sentent à juste titre très concernés par les questions de sécurité. » (Mme Betty Brahmy, médecin psychiatre) Il en résulte aussi que, bien souvent, ces hospitalisations ne sont pas d'une durée suffisante pour être efficaces, ce qui conduit parfois d'ailleurs à renoncer à les demander quand on sait que quelques jours plus tard le détenu sera de retour: « Le projet des psychiatres intervenant en milieu carcéral est bien sûr de soigner en prison, mais lorsque les symptômes de la maladie mentale l'exigent, les détenus doivent être hospitalisés sans leur consentement sous le régime de l'hospitalisation d'office. Ces hospitalisations se révèlent malheureusement toujours trop brèves et ont lieu dans des conditions de séjour souvent pires que celles de la détention. Pourtant, le maintien en prison de ces malades mentaux avérés ne cesse de poser de graves problèmes éthiques et techniques aux psychiatres exerçant en milieu carcéral. » (M. Evry Archer, médecin psychiatre) ▪ L'hospitalisation d'office avec orientation en unité pour malade difficile (UMD) soulève, elle aussi, des difficultés en termes de capacités d'accueil et de délais. Les délais d'hospitalisation en UMD sont longs, tant du fait de la procédure à suivre qui met en jeu des institutions de départements différents, que de leurs faibles capacités d'accueil et des difficultés à organiser un transfert sur un trajet le plus souvent long. Il existe quatre UMD pour l'ensemble du territoire, et celles-ci n'accueillent pas que des personnes détenues. En outre, le nombre de lits a été réduit depuis leur création. Dans la pratique, cette procédure pouvant s'avérer assez longue, le détenu est d'abord hospitalisé dans le service de psychiatrie de l'hôpital de rattachement, lequel est d'autant plus réservé pour le recevoir qu'une orientation en UMD est déjà prévue. En effet, dès lors, il devra garder en hospitalisation d'office le détenu souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui majore les risques d'évasion ou d'agression. L'unité de Cadillac a une capacité de 86 lits. Actuellement, le délai d'attente (notamment en raison de travaux) est d'environ un an. Dans les trois autres unités (Villejuif : 60 lits, Sarreguemines : 166 lits, Montfavet : 76 lits), les délais d'attente sont plus variables et permettent des hospitalisations en urgence. Il faut préciser que le placement en UMD ne peut constituer dans tous les cas une solution ; en effet, ces unités sont faites pour des malades (détenus ou non) présentant une dangerosité majeure et son utilisation extensive poserait des problèmes de principe et des problèmes budgétaires. ▪ Dernière difficulté : la continuité de la prise en charge. « Nous avons beaucoup de mal à mettre en place le suivi après l'incarcération, qui fait partie de nos missions et auquel nous tenons énormément. Nous avons la possibilité de suivre nos propres patients pendant un certain temps. C'est utile pour finir quelque chose qui a été commencé mais cela ne vaut en aucun cas pour des patients chroniques. Nous ne pouvons pas suivre un fou chronique à l'extérieur pendant des années. Il faut que le service de secteur compétent prenne la suite. Or nos collègues sont débordés, sont inquiets de l'étiquette ex-détenu. Cela se passe parfois bien, très souvent avec beaucoup de difficultés. » (Mme Betty Brahmy, médecin psychiatre) Dans la pratique, la plupart des SMPR, créés avant la réforme de 1994, avaient mis en place un dispositif de suivi post-pénal et continuent de les utiliser. Ceux qui n'en ont pas projettent d'en créer un (il s'agit des SMPR de Châlons-en-Champagne et Dijon). Les praticiens des SMPR estiment que ce dispositif est souvent indispensable en raison du lien thérapeutique fort qui s'est instauré par un suivi intensif. Il est donc nécessaire, selon eux, de ménager un temps de transition pour que le passage du relais au secteur géographiquement compétent puisse se faire. Dans l'ensemble, le suivi post-pénal s'exerce dans un cadre plus conforme aux exigences posées par la loi de 1994, puisque ces consultations ont lieu, pour l'essentiel, dans les locaux d'un centre médico-psychologique. Des difficultés peuvent cependant localement subsister. Le SMPR de Loos avait un lieu de suivi post-pénal dans un CMP à Haubourdin : ce CMP a été transformé en hôpital de jour et le SMPR ne peut plus y aller pour recevoir les détenus libérés. De ce fait, le SMPR n'a plus de lieu pour exercer ce suivi post-pénal et les entretiens ont lieu dans des conditions non satisfaisantes (bâtiment de l'accueil des familles, visites à domicile, voire entretien dans un véhicule sur le parking de la maison d'arrêt). On se suicide plus en France que chez nos voisins européens et on se suicide aussi plus dans les prisons françaises. Le taux de mort par suicide est de 22 pour 100 000 en « milieu libre ». Il est près de sept fois supérieur en milieu carcéral : 140 suicides pour 100 000 détenus.
Le nombre élevé des suicides est extrêmement préoccupant ; il l'est particulièrement en ce début d'année. « Le suicide est aussi un souci lancinant, sans doute l'un des plus graves défis auxquels est aujourd'hui confrontée l'administration pénitentiaire. L'augmentation de ces actes désespérés nous fait craindre des chiffres plus mauvais encore que l'année passée. L'an dernier, nous avions eu 125 suicides. On en dénombrait 56 au 1er juin 2000, soit 4 de plus qu'en 1999 à la même date. Cela représente onze suicides par mois, trois suicides par semaine. » (Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux) Monsieur Philippe Carrière, membre de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et membre du comité national de prévention du suicide en milieu carcéral, indiquait : « Il y a sept fois plus de suicides en milieu pénitentiaire que dans la population générale et ils se produisent généralement à des moments particuliers. J'ai d'ailleurs pris connaissance récemment des résultats d'une étude réalisée aux Etats-Unis, qui identifie les mêmes moments, c'est-à-dire : l'entrée et le choc de l'incarcération, certains motifs d'incarcération Les conditions du placement au quartier disciplinaire jouent aussi un rôle important. Des suicides se produisent lors de mises en prévention dans le quartier disciplinaire, c'est-à-dire avant même la commission de discipline intérieure. C'est un moment très difficile qui peut durer deux ou trois jours s'il y a un week-end. Il en résulte un très fort sentiment d'injustice chez le détenu qui est mis à l'isolement en quartier disciplinaire par les personnes avec lesquelles il vient d'avoir une altercation. Il a l'impression que l'administration pénitentiaire est là juge et partie et qu'il n'y a pas de tiers pour médiatiser et entendre ce qu'il avait à dire sur les raisons de sa colère. Lorsqu'elle ne peut plus s'exprimer autrement, la personne n'a plus qu'à s'auto-agresser. » Une étude récente montre que les personnes qui se sont donné la mort étaient en détention, dans près de la moitié des cas, depuis moins de six mois, 16 % depuis moins de quinze jours. Le suicide en début de détention concerne principalement les détenus primaires, les détenus âgés de moins de trente ans et les détenus pour crimes et délits sexuels. Une attention particulière doit donc être portée à l'accueil dans les établissements. L'expérience menée, en maison d'arrêt, à Fleury-Mérogis d'un « sas » d'une semaine pendant laquelle l'arrivant est en contact avec les différents services est, de ce point de vue notamment, très intéressante. En septembre 1997, un plan d'action a été mis en place constitué tout d'abord d'une série de mesures immédiates (circulaire de mai 1998) : - information de l'arrivant sur son parcours carcéral, - douche et remise de produits d'hygiène dès l'arrivée, - observation des détenus à risque, surtout la nuit, - rappel du caractère exceptionnel du placement en prévention au quartier disciplinaire et prise en charge individualisée, - actions auprès des familles, des codétenus et des personnels en cas de passage à l'acte. Dans le cadre de ce programme, onze sites pilotes ont été retenus qui devaient développer trois axes de travail : formalisation d'une procédure d'accueil personnalisée, prévention et suivi des détenus à risque, réorganisation des quartiers disciplinaires. Un comité national, composé des différentes catégories de personnels pénitentiaires et de personnels médicaux, a procédé à l'évaluation de ce programme. Ce comité a rendu ses conclusions en mai 1999. De manière générale, il a constaté la difficulté de mettre en _uvre les dispositifs proposés sur les sites pilotes. La formation et la sensibilisation des personnels ont particulièrement marqué le pas : « La sensibilisation du personnel à la thématique du suicide n'a été analysée ni comme un objectif à atteindre, ni comme une étape nécessaire à la mise en _uvre du programme. L'absence d'un formateur et le manque de disponibilité du personnel pour suivre la formation se sont révélés être des contraintes majeures pour l'organisation des actions de formation. Les demandes de formation n'ont peut-être pas pu s'exprimer en temps utile, en raison d'un non-dit très pesant sur le sujet ou n'ont pas été prises en considération par manque d'écoute. Le personnel s'est montré plus demandeur de formations analysées en terme de recettes pratiques plutôt qu'en terme d'analyse sur la question centrale du rapport à l'autre et plus précisément du respect de l'autre. » (Rapport du comité national d'évaluation du programme de prévention du suicide en milieu carcéral. février 1999) Les délais de réalisation ont été jugés insuffisants et les sites pilotes n'ont pu développer l'ensemble des thématiques. Même partielle, le comité a tout de même conclu que l'expérimentation avait démontré la pertinence des orientations retenues et a proposé de généraliser le dispositif. Ces directives n'ont encore donné lieu à aucune suite précise, notamment celles relatives au maintien des parloirs et de la radio au quartier disciplinaire (qui ont été évoquées dans la première partie). Madame la garde des sceaux a indiqué à la commission que : « Dans un tel contexte, les mesures que j'ai prescrites par circulaire du 29 mai 1998 doivent être complétées. Je viens de recevoir une étude faite par mes services à partir d'un examen de 244 suicides ces trois dernières années. Les conclusions qui s'en dégagent sur le profil du détenu susceptible de passer à l'acte et sur le moment du geste désespéré seront exploitées sans délai. J'ai donné pour instruction à mes services de s'informer sur les pratiques étrangères en la matière car en lisant des études comparatives, on s'aperçoit que tous les pays qui nous entourent connaissent des chiffres de suicides inférieurs aux nôtres. Une mission se rendra prochainement dans les Etats qui paraissent les plus avancés dans ce domaine. J'ai demandé aussi à mes services des actions plus immédiates : les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont régulièrement sensibilisés à ce problème par des réunions spécifiques qui se tiennent à l'administration pénitentiaire. » L'humanisation des quartiers disciplinaires, le maintien des parloirs et l'accès à la radio comme le préconise le comité d'évaluation sont des mesures qui pourraient être prises rapidement. C.- MIEUX ADAPTER LA PRISE EN CHARGE AUX PUBLICS La vision du prisonnier, généralement oisif, en tout cas logé, nourri et blanchi aux frais de l'administration pénitentiaire, est à mille lieues de la réalité de la pauvreté en prison - pauvreté souvent présente et généralement humiliante, car en prison le plus pauvre est le plus vulnérable et sa situation ne fait qu'aggraver la dureté de sa détention. Elle résulte inévitablement de la très grande précarité des personnes incarcérées : rappelons qu'en 1997 (30), 65 % des entrants étaient sans activité à l'extérieur, parmi lesquels, seuls 28 % se trouvaient en situation de chômage indemnisé. Un sur cinq était illettré. Est pauvre en prison, d'une pauvreté relative, spécifique au monde carcéral (31), celui qui doit se contenter du minimum fourni par l'administration, sans possibilité véritable d'autonomie, exposé à la dépendance à l'égard de ses codétenus, voire à l'exploitation par les plus « forts » d'entre eux.(Remplir un bon de cantine quand on ne sait ni lire, ni écrire suppose de faire appel à un codétenu qui se rémunérera, au besoin, sur les produits achetés...). En effet, au-delà de son aspect financier la pauvreté est culturelle, faite d'absence de formation, d'isolement social, parfois d'une santé précaire et donne, notamment à l'étranger ou au toxicomane des conditions de vie en prison qui peuvent mettre en jeu sa dignité. a) Le repérage et le suivi des situations d'indigence : L'administration pénitentiaire ne connaît que les « indigents ». La définition de l'indigence est elle-même laissée à l'appréciation de l'établissement, ce qui, en l'absence de critères fixés nationalement, est source d'inégalités. Selon le rapport du groupe de travail sur l'aide aux détenus indigents créé par l'administration pénitentiaire (32), la prise en compte d'un seuil de moins de 300 francs sur la part disponible du compte nominatif du détenu se généralise (sachant que le montant moyen d'achats en cantine varie de 15 à 30 francs par jour, ce seuil revient à estimer à 10 francs par jour le minimum nécessaire pour couvrir les besoins du détenu !). Les réponses au questionnaire adressé par la commission d'enquête aux directeurs d'établissements montrent, sans qu'une analyse exhaustive soit possible car ce montant n'est pas toujours indiqué, que des seuils de 200 francs, de 100 francs, voire de 50 francs, sont encore pratiqués. Le repérage des indigents est dans la quasi-totalité des cas effectué lors de l'audience arrivant. Pour le suivi, en cours de détention, toutes les situations sont possibles : suivi systématique par l'examen mensuel des comptes des détenus, réunion ou non d'une commission d'indigence, signalement par les personnels, les travailleurs sociaux et les intervenants extérieurs qui opèrent un suivi ponctuel (surtout dans les petits établissements) ou encore interventions à la demande du détenu. Dans certains établissements, en particulier ceux de la direction régionale de Paris, des commissions d'indigence ont été créées. Ces commissions permettent, sur la base d'un listing émis par les services comptables, de mettre en rapport les informations recueillies sur le détenu. Elles assurent une plus grande transparence des choix de l'administration pénitentiaire ainsi qu'un meilleur partenariat avec les associations qui participent à la lutte contre l'indigence. Il est important que les propositions de ce groupe de travail relatives à la fixation d'un seuil uniforme comme critère financier de l'indigence et à la généralisation des commissions d'indigence ne restent pas lettre morte. b) Les aides fournies aux indigents : La distribution d'un certain nombre de produits d'hygiène aux entrants, de sous-vêtements aux arrivants en maison d'arrêt, et leur renouvellement pour les indigents, bien que prévus par des prescriptions réglementaires, ne sont toujours pas assurés systématiquement et complètement. En 1998, environ 85 % des établissements ont distribué les trousses d'hygiène aux arrivants et les renouvellent aux détenus indigents conformément à l'obligation posée par l'article D.357 du code de procédure pénale. Ceci a conduit l'administration pénitentiaire à réitérer par directive ces obligations ainsi que celle relative au renouvellement systématique, donc à la gratuité, du savon et du papier hygiénique pour tous les détenus. Selon le secours catholique, depuis deux ans, des améliorations sont intervenues dans ce domaine. Au-delà de ces dispositions obligatoires, on relève l'octroi, de façon variable, d'aides matérielles. Il s'agit, le plus souvent, de matériel de correspondance et de vêtements. La télévision ou le lavage du linge peut être gratuit pour les indigents. Parfois des produits alimentaires de base leur sont remis, ainsi que du tabac. Ces actions sont conduites avec l'aide des associations socioculturelles et des organismes tels que le Secours catholique, la Croix rouge, l'association française des visiteurs de prison... Il s'y ajoute des aides financières qui posent plus spécifiquement la question du rôle de ces associations partenaires. Les arrivants démunis, puis en cours de détention, les indigents peuvent bénéficier d'aides financières ponctuelles. Dans certains établissements, des aides mensuelles sont également versées. Financées par les associations, elles sont de l'ordre d'environ 100 francs par mois. Le groupe d'étude précité a souligné : que « Sans remettre en cause le bien-fondé des actions qui peuvent être engagées par les associations, en liaison avec les établissements, on peut néanmoins observer parfois certaines dérives conduisant des associations à se substituer à l'administration, éventuellement défaillante, en particulier dans le domaine des aides matérielles. Une classification des rôles est donc nécessaire ». Cette question doit conduire à poser celle de la perception des minima sociaux en prison. La réglementation actuelle suspend le versement du RMI aux détenus qui en bénéficiaient avant leur incarcération, le premier jour du mois suivant la fin d'un délai de soixante jours. Les partenaires associatifs sont partagés sur cette question tant sur le principe que sur le montant de l'allocation. Le ministère de la Justice, quant à lui, a toujours privilégié, comme réponse à l'indigence, l'exercice d'un travail. Or ceci n'est pas sans soulever de difficultés, le dilemme « emploi ou formation » se posant en des termes particulièrement aigus pour les détenus dépourvus de toute aide extérieure qui sont confrontés à un besoin financier immédiat. Ils vont chercher, en premier lieu, à être « classés » pour pouvoir travailler ; parfois cela leur sera proposé, l'indigence étant souvent un critère prioritaire pour l'accès au travail. Dans le cadre des règles actuelles, l'accès prioritaire des indigents au travail devrait être généralisé à la condition que son organisation soit adaptée pour permettre l'accès à d'autres activités (Cf. supra : actions socio-éducatives), ce qui suppose une réorganisation de la journée de détention. A défaut, il conviendrait d'attribuer au détenu sans ressources une rémunération en liaison avec une formation. Les femmes sont peu nombreuses en prison. Elles ne représentent que 3,7 % de la population détenue. Souvent incarcérées dans de petites structures, leur situation devrait en être améliorée ; pourtant, leur assurer une prise en charge dans les mêmes conditions que les hommes se heurte à des difficultés. a) Les conditions d'accueil des femmes Malgré leur faible nombre, les femmes n'échappent pas nécessairement à la surpopulation. La capacité théorique du quartier femmes de la maison d'arrêt de Loos est de 56 places. Il accueille actuellement 82 femmes. Six naissances sont attendues dans ce quartier dans les mois qui viennent. A la naissance, la mère bénéficie d'une cellule aménagée pour vivre seule avec son bébé, ce qui contribue à accroître le taux d'occupation des autres cellules de la détention. Par ailleurs, en l'absence de structures spécifiques, les détenues mineures, à la différence des garçons, sont incarcérées avec des majeures. En raison de la règle de non-mixité posée par le code de procédure pénale, les femmes incarcérées dans de petits quartiers se trouvent souvent reléguées dans une partie de l'établissement qui leur interdit un accès égal à celui des hommes, aux différents équipements, aux activités, au travail et aux formations. Les femmes travaillent plus souvent que les hommes en cellule. Par exemple, le quartier femme de la maison d'arrêt de Chambéry n'a pas de salle de sport. La localisation de l'atelier réservé aux femmes et son difficile accès par les entreprises les prive de travail dans ce local. On retrouve ce même problème d'accès par les semi-remorques à la maison d'arrêt de Versailles. Dans la maison d'arrêt de Ducos, à la Martinique, les femmes, très isolées du reste de la détention, ne se voient pas offrir de réelles possibilités d'activités. Le GENEPI qui a particulièrement étudié la question des femmes en détention, souligne en outre que « les formations proposées aux femmes sont peu diversifiées et se cantonnent souvent aux rôles sociaux traditionnels avec des formations à la couture, à la cuisine... » Il souhaite que les offres de formation soient mieux adaptées aux demandes des détenues et, que dans la mesure du possible, des formations qualifiantes leur soient proposées. Le nombre limité d'établissements ou de quartiers accueillant des femmes conduit à ce qu'elles soient fréquemment incarcérées plus loin de leur famille que ne le sont les hommes. Ce problème se pose d'autant plus que les femmes incarcérées le sont souvent pour de graves infractions. (Au 1er janvier 2000, 40 % des femmes incarcérées étaient prévenues ou condamnées dans le cadre de procédures criminelles). Le centre pénitentiaire de Rennes a longtemps été le seul établissement pour peines pour femmes. Ceux de Bapaume et de Joux-la-Ville s'y sont ajoutés. Mais aucun établissement pour longues peines n'existe dans le sud de la France puisque le centre de détention régional (CDR) de Marseille, qui accueille des femmes ne comporte pas de condamnées à plus de 7 ans d'incarcération. Or plus la peine est longue et plus la préservation des liens avec la famille est précieuse et difficile d'autant qu'elle se pose en des termes encore plus délicats pour les femmes qui sont souvent très délaissées par leur entourage. Prévoir l'accueil des femmes détenues dans un ou plusieurs établissements du sud de la France serait une réelle nécessité. Quand elle aboutit à l'éclatement d'une famille, l'incarcération ne peut être une solution. La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence a pris ce souci en compte en interdisant la mise en détention provisoire « d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans et ayant chez elle son domicile habituel ». Cette disposition, en pratique concerne essentiellement les femmes et trouve à s'appliquer quand l'incarcération aboutirait au placement des enfants. b) Les enfants en détention avec leur mère Quiconque a pénétré dans une prison conviendra que cet endroit n'est pas fait pour un enfant. Or chaque année, une cinquantaine d'enfants, nés pendant l'incarcération de leur mère, ou l'ayant rejointe nourrisson, vivent en détention. L'enfant pourra rester avec sa mère jusqu'à l'âge de 18 mois, sauf décision de prolongation, ce qui reste exceptionnel. Une circulaire du 16 août 1999, faisant suite à une mission de l'IGAS qui datait de 1991 et aux réflexions du groupe de travail qui a suivi, a réparti les places d'accueil des mères avec leur enfant sur le territoire et a défini des conditions minimales d'accueil. Vingt-cinq établissements ayant une capacité d'accueil de 66 places sont aujourd'hui identifiés comme pouvant recevoir des enfants. Les conditions d'accueil sont les suivantes : - superficie de la cellule d'au moins 15 m², - eau chaude dans les cellules, - ouverture de la porte pendant la journée, - lieu permettant de confectionner les repas, - petit matériel de nursery, - accès à une cour de promenade en dehors de la présence des autres détenues. Il faut relever que figurent dans cette liste, pour des raisons de couverture du territoire, des établissements très vétustes, notamment les maisons d'arrêt de Loos, Nice, Toulouse... dont la fermeture est d'ailleurs décidée. La construction des nouveaux établissements pénitentiaires devra respecter les normes minimales fixées par la circulaire. Les conditions de vie en détention et l'échéance de la séparation rendent impératif d'établir ou de préserver le lien de l'enfant avec l'extérieur et de préparer, le cas échéant, sa séparation d'avec sa mère. Par des accords avec les municipalités, des places de crèches peuvent être attribuées à ces enfants. Au centre pénitentiaire de Rennes, des mères sortent au moins une fois par semaine pour se rendre dans une crèche avec leur enfant mais l'accès à une crèche n'est pas organisé partout. Il faut saluer l'initiative qui vient d'être prise, grâce à laquelle les femmes détenues, enceintes ou avec leur enfant, se voient reconnaître un droit à l'allocation de parent isolé (API) comme si elles étaient libres (circulaire du 31 décembre 1999). L'API pourra être accordée si la personne est isolée (veuve, divorcée,...), assume la prise en charge morale, affective, matérielle et financière de l'enfant qui séjourne dans l'établissement pénitentiaire et enfin, dispose de faibles ressources pendant la période d'incarcération. La limitation de leur incarcération doit cependant être prioritaire et les alternatives à l'incarcération utilisées dans toute la mesure du possible. L'âge moyen de la population pénale est de 34,2 ans. Depuis 1990, le nombre de détenus âgés d'au moins 60 ans a plus que triplé pour s'établir au 1er janvier 2000, à 1 564. Répartition des plus de 60 ans selon l'âge au 1er janvier 2000
Cette évolution est due à la fois à l'allongement des peines et au fait que les délinquants sexuels, eux-mêmes condamnés à de longues peines, peuvent être incarcérés longtemps après les faits et donc à un âge élevé. L'administration pénitentiaire n'a pas conduit d'étude sur le nombre de détenus âgés, en situation de dépendance. Il est prévu de réaliser, avec l'INSEE, une enquête « handicap, incapacités et dépendance », dont les résultats devraient être disponibles à partir de 2001. La plupart des établissements visités par les membres de la commission font état des difficultés que pose l'augmentation du nombre de détenus âgés ayant des problèmes de santé dus à l'âge. Des détenus ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne ont été rencontrés dans les établissements. Outre la question de leur sortie d'incarcération (Cf. V relatif à la maîtrise des incarcérations) celle de leur prise en charge en détention se pose de façon immédiate et ira croissant en raison du vieillissement de la population pénale. Par exemple, au centre de détention de Muret, 30 détenus ont plus de 70 ans, 4 détenus sont en fauteuil roulant, 2 sont placés sous assistance respiratoire. Face à cette situation, les personnels des établissements sont particulièrement démunis et les établissements totalement inadaptés pour la prise en charge de ce type de population. En général, il est fait appel au bon vouloir d'un codétenu, parfois rémunéré au titre du service général (et à un tarif plus élevé). Cette solution n'est pas satisfaisante. Une assistance par une aide-soignante, qui pourrait être prévue dans la convention avec l'hôpital de rattachement serait une solution plus adaptée. En tout état de cause, il convient de reconsidérer la question de l'incarcération et d'envisager une prise en charge dans un endroit plus adapté. (voir infra cinquième partie) V.- ALLER VERS L'INDISPENSABLE MAÎTRISE DE LA POPULATION PÉNALE La prison aujourd'hui, apparaît une sanction inadaptée à plusieurs types de délinquants : toxicomanes, étrangers, mineurs, malades mentaux. Il faut donc sortir d'un système de sanctions axé sur le tout carcéral et développer d'autres formes de rappel à la loi pour mieux assurer la sécurité en limitant la récidive. A.─ RETROUVER LA MAÎTRISE DES FLUX Au-delà de la question de savoir comment améliorer la prison et la prise en charge de la population carcérale, il est urgent de s'interroger sur la question de savoir qui l'on met en prison et pourquoi. Les responsabilités à ce sujet sont partagées : l'opinion publique attend des réponses fermes dans un contexte de crise économique et sociale ; le législateur est enclin à assortir chaque texte d'une nouvelle sanction pénale ; le juge se sent autorisé à prononcer les sanctions maximales du moment que le législateur les a prévues. La prison n'intervient qu'en fin de processus et en constitue l'aboutissement ultime. L'administration pénitentiaire subit la décision d'incarcération sans avoir eu, à aucun moment, la maîtrise du flux : « On ne conçoit plus une collectivité telle que celle-ci sans un certain nombre de normes. Comment pouvoir gérer véritablement sans savoir que, le soir, vont arriver vingt ou vingt-cinq détenus ou sans savoir le nombre de libérations ? Notre action doit s'inscrire à moyen et à long terme et, pour se faire, nous devons avoir une certaine maîtrise des flux. Aucune collectivité, que ce soit l'Education nationale pour les quotas et les classes, ou l'hôpital pour le nombre de lits, ne connaît cette situation. Pour notre part, nous sommes complètement soumis à cela. De ce fait, la gestion quotidienne est difficile. » (M. Pierre Duflot, adjoint au directeur régional des services pénitentiaires de Lille, membre du syndicat CFDT-justice) La seule réponse effectivement possible pour l'administration pénitentiaire, dans ce contexte, est d'accroître toujours plus le nombre de places dans les prisons. Il paraît urgent d'inverser le raisonnement en agissant en amont sur le processus qui a mené à la décision d'incarcération. C'est pourquoi il est nécessaire de se poser la question de savoir si la prison est toujours la réponse adéquate : les visites des établissements pénitentiaires ont en effet souvent été l'occasion de rencontrer des détenus pour lesquels le cadre carcéral ne parait absolument pas à même de favoriser la réflexion sur la sanction, de permettre l'amendement ou de préparer la réinsertion. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la présence de ces détenus dans les prisons : il ne s'agit pas de faire preuve de laxisme en la matière, mais plutôt de recentrer la prison sur ses vraies missions : La maîtrise des flux exige dès lors un moindre recours à l'incarcération, y compris dans le cadre de la détention provisoire, accompagné d'un développement crédible des alternatives à l'incarcération. La prison est finalement, souvent, le seul lieu d'accueil des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves. Les problèmes suscités par leur mise en détention ont déjà été évoqués ainsi que l'évolution de la psychiatrie qui conduit à déclarer de moins en moins de personnes irresponsables et à supprimer des services fermés (Cf. I, évolution de la population pénale). Monsieur Evry Archer, médecin psychiatre, souligne à ce propos l'attitude des psychiatres de secteur : « Les experts sont des psychiatres exerçant en psychiatrie générale dans les hôpitaux qui ne souhaitent pas forcément avoir dans leurs services des patients qui vont rester longtemps à l'hôpital et qui nécessitent une mobilisation importante. L'évolution de l'hôpital psychiatrique rend très difficile le séjour en milieu hospitalier des personnes qui présentent des troubles du comportement. Mais je crois surtout que les gens ont peur. On le constate notamment dans les tribunaux à propos de l'application de l'article 122-1, alinéa 2 du code pénal. Dans les cours d'assises, après le jugement, on entend des personnes dire que même les psychiatres ne veulent pas de ces personnes, ce qui explique l'aggravation des peines. » Ceci pose un double problème, d'abord celui de la qualité des expertises et de la décision d'incarcération elle-même ; ensuite, s'il y a incarcération, celui de la structure dans laquelle elle doit s'opérer pour tous ceux dont l'état, en raison de troubles psychiatriques, préexistants ou non à l'enfermement, est incompatible avec le maintien en détention (article D.398 du code de procédure pénale). ▪ Sur le premier point, il a été exposé devant la commission que : « Notre corps psychiatrique doit aussi s'interroger sur la qualité des expertises. N'importe quel psychiatre peut s'inscrire sur les listes de la cour d'appel et être expert sans une formation particulière, sans encadrement particulier. C'est une source de revenus complémentaires pour un certain nombre d'entre nous. La qualité des expertises n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on pourrait en attendre. Des expertises rapides de quelques dizaines de minutes existent malheureusement, mais il existe aussi des expertises très fouillées qui prennent plusieurs jours de travail pour une somme dérisoire. Une expertise est payée 1 250 francs, qu'elle ait demandé plusieurs jours de travail ou une demi-heure. Toutefois, de son côté, la justice devrait s'interroger sur le point de savoir quelles questions elle pose aux experts. Certaines, un peu toutes faites, ne sont pas nécessairement adaptées aux procès. Une de celles posées systématiquement est : « Le prévenu est-il accessible à une sanction pénale ? » Mais de quelle sanction s'agit-il ? Peut-on dire qu'une personne est accessible à une sanction pénale alors qu'il est possible qu'elle ne puisse pas supporter une réclusion criminelle à perpétuité ? D'autant que souvent, l'expert, qui n'a pas mis les pieds en prison ailleurs qu'au parloir, ignore ce qu'est la vie en milieu carcéral. » (M. Philippe Carrière, médecin psychiatre, association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) La conséquence en est la présence en prison de malades mentaux ou de psychopathes avérés qui n'y sont pas à leur place. Souvent incapables de s'adapter, ils parviennent même à susciter le rejet des équipes soignantes. La première réponse serait une intervention, en amont, de façon à faire en sorte que des personnes qui n'ont pas leur place en prison ne se retrouvent pas dans le système pénitentiaire. « Il faudrait sans doute qu'il puisse y avoir tout de même procès, tout de même reconnaissance de la souffrance de la victime. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu ni crime ni délit, comme on le considérait autrefois, il y a bien eu un crime ou un délit, une victime, mais cela ne devrait pas entraîner une incarcération. Il devrait y avoir condamnation mais dispense de peine, aménagement de peine, alternative aux peines, etc. Or aujourd'hui, s'il y a procès, il y a peine, et peine plus lourde encore pour les malades mentaux que pour les autres, parce que le sentiment de dangerosité est donné, en particulier, aux jurés. C'est une très mauvaise chose. » (M. Philippe Carrière, médecin psychiatre, association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) A ce propos, Pierre Pradier souligne la nécessité d'une plus grande connaissance, sinon collaboration, entre médecins et magistrats : « Des Etats généraux, ou du moins des rencontres entre les représentants de la discipline psychiatrique et ceux qui sont très directement en cause dans le déroulement du processus, c'est-à-dire les magistrats, seraient hautement souhaitables. Il est un élément auquel on ne pense jamais assez : les directeurs d'établissement n'ont absolument aucune maîtrise ni de leurs « stocks » ni de leurs flux ! Ils prennent qui on leur envoie et ce n'est pas à eux à décider quoi que ce soit ! Ce sont quand même les magistrats qui sont les « pourvoyeurs », lesquels ont, quand même, depuis quelques années également considérablement alourdi les peines : elles ont doublé en vingt ans sur des crimes ou des délits comparables. » ▪ Le deuxième point soulève la question de la création d'établissements spécialisés. Cette proposition a été formulée à de multiples reprises par des intervenants très divers, par les personnels pénitentiaires mais aussi par les médecins psychiatres. En effet, si l'évolution de la psychiatrie s'est faite dans le sens d'une plus grande humanisation bénéfique pour la plupart des malades concernés, elle ne permet plus de prendre en charge les patients les plus difficiles et ceux-ci ne peuvent correctement être accueillis, dans les conditions actuelles de détention existant dans les établissements pénitentiaires. « Les gens vivent pendant deux ans, trois ans, dix ans dans des conditions effroyables. Ensuite, la réinsertion est encore plus difficile. Pour quelqu'un qui a passé dix ans au fond d'une cellule sans sortir, sans relations sociales, la réinsertion est quasiment impossible. Quand la personne sortira à 40 ou 50 ans après dix ans de claustration, au sens psychiatrique et non pas d'enfermement, elle aura subi un enfermement double : la prison plus l'enfermement psychologique. Même si la direction des hôpitaux n'y est pas favorable, je pense que la création d'un établissement spécialisé pour les condamnés serait souhaitable. » (Betty Brahmy, médecin psychiatre) Le choix qui a été opéré de fermer les établissements spécialisés se révèle à terme et compte tenu de ces évolutions, peu approprié. La mise en place d'établissements spécialisés apparaît incontournable. Mme Betty Brahmy souligne toutefois : « ...qu'au ministère de la Santé, on n'y est pas du tout favorable. J'ai collaboré avec des responsables du ministère de la Santé à la préparation de la loi de 1994. L'établissement de Château-Thierry a été longtemps une maison centrale dite sanitaire, capable d'accueillir des psychopathes. Puisque les gens étaient formés, avaient l'habitude de ces patients un peu compliqués, que les structures s'y prêtaient, je pensais qu'il fallait en faire un établissement précisément pour ces patients-là. On m'a répondu que cela créerait une stigmatisation. » Au regard des inconvénients de la situation actuelle, l'objection de la stigmatisation apparaît quelque peu secondaire. Reste la question de la nature de ces établissements : établissements pénitentiaires, sanitaires ou à double tutelle. « L'une des solutions pourrait être de créer rapidement des unités hospitalières sectorielles ou intersectorielles sécurisées, fermées, accueillant sur le critère de la maladie mentale et du soin, dans des conditions matérielles et humaines satisfaisantes, des malades mentaux dont l'état mental le nécessite, sans que les critères pénaux priment sur l'indication thérapeutique. La création ou le maintien d'établissements pénitentiaires à caractère sanitaire poserait la question du sens de la peine et de la fonction sociale de la prison sans résoudre, bien au contraire, ni le problème des conditions de la prise en charge psychiatrique pendant la détention, ni celui de la prise en charge après la libération, ce dont témoignent les mesures d'hospitalisation décidées rapidement à la libération de ces personnes. » (M. Evry Archer, médecin psychiatre) Les établissements à double tutelle (comme celle qui s'exerce sur celui de Fresnes) constituent une autre possibilité. « On ne peut pas crier en prison. Vous visitez un hôpital psychiatrique, vous entendez des cris, les malades se déplacent. En prison, ce n'est pas possible et les gens souffrent ; les psychiatres le disent. Que faire ? Les Néerlandais ont résolu la question en ouvrant des établissements différents. Il nous faut des établissements à double tutelle comme l'hôpital de Fresnes, relevant à la fois du pénitentiaire et de la santé, doté d'un statut spécifique. Les psychiatres considèrent dorénavant que la sanction est structurante. L'article 64 du code pénal, devenu 128, n'est plus utilisé. Si la sanction est considérée comme nécessaire pour soigner, cela signifie que tout le monde arrive en prison. C'est là un problème grave qu'il faut résoudre par la construction d'établissements différents. » (M. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris) La question du type d'établissement le plus approprié pour accueillir les délinquants souffrant de graves troubles psychiatriques doit être tranchée, l'essentiel étant de mettre fin, d'une façon ou d'une autre, à la situation actuelle. L'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 pose le principe selon lequel « le mineur délinquant devra, en priorité, bénéficier de mesures de surveillance, de protection, d'assistance et d'éducation. Une condamnation pénale ne pourra être prononcée que lorsque la personnalité du mineur et les circonstances particulières exigeront d'écarter la mise en _uvre de ces mesures. » Il en résulte que, tant pendant l'instruction du dossier qu'après la condamnation, le juge doit prendre en priorité des mesures éducatives : liberté surveillée préjudicielle, placement en foyer, en unité éducative renforcée, en centre de placement immédiat ou dans une famille, contrôle judiciaire, mesures de réparation... En général, le juge incarcérera pour une période courte en pensant que cela peut être un moyen après que d'autres ont échoué. Mais il est vrai que l'on constate une aggravation de la délinquance des mineurs. En 1999, 16,5 % d'entre eux étaient incarcérées dans le cadre de procédures criminelles (crimes de sang : 1,9 % ; viols : 5,4 % ; vols criminels : 6,1 %). La majorité des infractions, cependant, est constituée d'atteintes aux biens (58,2 %). Se pose d'abord la question de la mise en détention provisoire qui constitue la majorité des mises en détention des mineurs (90,6 %). La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué qu'un réexamen du régime juridique applicable aux mineurs détenus était en cours. « La grande majorité des détentions des mineurs se réalise dans le cadre de la détention provisoire, dont le régime juridique diffère de celui de l'emprisonnement. L'aménagement des peines pour mineurs est donc très peu développé et nous réfléchissons à une nouvelle piste de travail permettant d'aménager le régime juridique en détention provisoire et de développer des possibilités d'aménagement des peines des mineurs. » Ensuite, l'obstacle majeur au prononcé de peines alternatives à l'incarcération et notamment de mesures éducatives, réside dans l'insuffisance des moyens consacrés à celles-ci. « Sur la question de la détention des mineurs, problème très compliqué, je dirai que si l'on pouvait l'exclure de façon quasiment systématique, nous en serions tout à fait heureux. La seule difficulté réside dans le fait que nous ne disposons pas des structures permettant l'accueil des mineurs en difficulté, ni l'accueil des mineurs délinquants, car placer les mineurs délinquants et récidivistes dans des foyers classiques met souvent en danger la situation du foyer. C'est pourquoi ont été créées les unités éducatives à encadrement renforcé, mais celles-ci restent en nombre insuffisant. J'ai récemment placé sous contrôle judiciaire un mineur et j'ai, dans le même temps, pris une ordonnance de placement provisoire dans un foyer. Au bout de dix jours, on m'a appelé pour me dire que le foyer était en train de fermer. J'ai demandé ce qu'il fallait que je fasse, ce à quoi les responsables du foyer m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de solution à me proposer. J'ai alors changé mon ordonnance de contrôle judiciaire et j'ai mis un terme à l'ordonnance de placement provisoire dans le foyer. J'ai envoyé l'intéressé chez sa mère, ce qui n'était pas forcément la meilleure solution, et cela n'a d'ailleurs pas manqué : il a commis d'autres infractions, qui m'ont conduit à révoquer son contrôle judiciaire, et donc finalement à le placer en détention provisoire. » (M. Jean-Baptiste Parlos, association française des magistrats chargés de l'instruction) Le manque d'éducateurs, en particulier, est patent : les moyens humains de la protection judiciaire de la jeunesse étaient les mêmes en 1997 qu'en 1983 malgré l'accroissement de la délinquance des mineurs et du nombre des mesures éducatives. Depuis 1997, la création de 1 000 emplois d'éducateurs a été décidée : 380 ont été effectivement créés, 300 autorisés en surnombre. Des créations de centres de placement immédiat sont aussi prévues pour répondre aux demandes des magistrats de placement en urgence. « Les centres de placement immédiat sont des structures accueillant une dizaine de mineurs, que nous allons spécialiser dans l'urgence. C'est un sujet difficile qui ne recueille pas toujours l'assentiment de l'ensemble des professionnels, mais il me semble déterminant, car, en l'absence de solution, le jour de la présentation du mineur, ce dernier peut faire l'objet d'une incarcération, faute d'alternative. Il est donc impératif que nous parvenions à construire mieux l'accueil d'urgence dans chacun des départements ; c'est un sujet complexe, non encore résolu dans tous les départements. C'est un objectif important pour les deux ou trois années à venir. » (Mme Sylvie Perdriolle, directrice de la PJJ) Cinquante centres doivent être créés d'ici 2001. En 1999, 14 centres ont été ouverts, par transformation de l'existant essentiellement. Pour 2000, neuf sites ont été retenus, dix autres seront également ouverts en septembre. En pratique, l'implantation de ces centres, qui n'accueillent chacun qu'une dizaine de mineurs, suscite des réticences. Comme pour les centres d'éducation renforcée, trouver un site d'implantation, alors même que les crédits budgétaires existent, peut s'avérer problématique. Les centres éducatifs renforcés accueillent, eux, de cinq à six mineurs délinquants, multirécidivistes ou très marginalisés. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a souligné l'intérêt de ce dispositif. « L'encadrement constant de 5 à 6 jeunes par 5 à 6 professionnels sur une durée de trois à six mois favorise réellement la réinsertion des jeunes. Grâce à un cadre d'activités très élaboré, ces jeunes arrivent à construire une autre relation avec les adultes. Il est vrai que le premier mois de séjour est souvent difficile et parsemé de situations de violence : cela s'améliore au bout de trois mois. Le retour constitue un passage délicat, mais plus des deux tiers de ces mineurs ont su retrouver une situation stabilisée et ont accédé à des dispositifs d'insertion. » On est très loin de ce taux d'encadrement d'un pour un dans les quartiers mineurs des établissements pénitentiaires ! Ces centres sont aussi en nombre tout à fait insuffisant. Le programme fixé par le gouvernement est d'atteindre cent structures d'ici à la fin 2001. A l'heure actuelle, 37 centres sont ouverts ou vont ouvrir, en principe d'ici l'été. La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué que 60 créations devraient avoir lieu, au total, d'ici la fin de l'année. Cela signifie 350 places. Ces mesures vont dans le bon sens. Eviter au maximum l'incarcération qui ne donnera pas lieu à une prise en charge de même niveau que dans les structures éducatives et peut, chez certains jeunes, « valoriser » un parcours de délinquance, est un objectif unanimement reconnu. Il suppose un renforcement significatif des structures éducatives spécifiques qui fournira les outils nécessaires aux magistrats et, au-delà, la mise en place d'une véritable coordination des multiples intervenants qui ont à traiter de la délinquance juvénile. Il est urgent qu'un débat ait lieu sur cette question et que des orientations claires soient définies. Une loi apportant des réponses spécifiques à la délinquance des mineurs apparaît prioritaire. Il n'est pas question, avec le problème du sort des étrangers en prison, de susciter de nouveau de vaines polémiques sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France mais de savoir à quoi sert la prison lorsque le détenu n'a pour seule perspective, après son séjour en prison, que l'expulsion vers son pays d'origine. ▪ Une étude de la direction de l'administration pénitentiaire en 1999 a permis de montrer que les étrangers représentent, en 1999, le quart des détenus en métropole contre 18 % en 1975. Entre 1975 et 1999, le nombre d'étrangers détenus est passé de 4 645 à 12 164, soit une augmentation de 162 % ; cette augmentation est presque deux fois plus importante que celle des détenus français, dont le nombre a cru de 91 % sur la même période. Parmi les types d'infraction caractérisant la délinquance étrangère, il en est une, spécifique, intrinsèque au fait même d'être étranger, qui concerne les délits à la police des étrangers ; à ces délits, sont d'ailleurs très souvent liés les délits pour faux et usage de faux documents administratifs. Les détenus incarcérés pour infraction à la police des étrangers représentent le quart des détenus étrangers en métropole. Entre 1984 et 1996, le nombre d'étrangers entrés pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers a cru de 330 %. Dans son étude, l'administration pénitentiaire relève que, quel que soit le motif de l'incarcération de l'étranger, « l'observation paraît confirmer l'idée d'un traitement pénal moins favorable à l'égard des étrangers, qui se retrouve dès le stade policier et qui s'explique pour partie par la question de la « garantie de représentation » devant les tribunaux, notamment pour les étrangers en situation irrégulière. » Ainsi, près de 90 % des étrangers sont entrés en prison au titre d'une détention provisoire, contre 73 % pour les Français. De plus, les étrangers prévenus sont écroués principalement dans le cadre d'une comparution immédiate (59 % contre 45 % chez les Français), cette procédure conduisant plus fréquemment que les autres à une décision. Même si la durée moyenne d'incarcération pour les étrangers condamnés uniquement pour délit à la police des étrangers est plus courte que celle des Français (4,7 mois contre près de 8 mois) ; seule une très faible partie d'entre eux bénéficie d'aménagements de peine (2 % ont été libérés à la suite d'une libération conditionnelle). Ces chiffres soulèvent deux interrogations ; la première a trait aux différences de traitement qui semblent exister entre nationaux et étrangers ; il n'est pas ici question de demander plus de clémence dans les affaires de crimes ou délits qui impliquent des étrangers, mais simplement de s'assurer qu'un même délit ou un même crime est puni dans les mêmes termes quelle que soit la nationalité de son auteur. La seconde, spécifique aux étrangers entrés illégalement sur le territoire français, porte sur l'utilité de placer en prison des personnes ayant commis une infraction qui se révèle être finalement une infraction de type administratif. Comme l'a souligné M. Robert Badinter devant la commission : « Il convient également de prendre en compte la présence très forte d'étrangers dans les maisons d'arrêt, qui est souvent la conséquence d'un dévoiement de l'utilisation de l'institution pénitentiaire qui devient une sorte de centre de rétention généralisé. Je me souviens d'avoir constaté avec stupéfaction - et j'y ai mis de l'ordre - que des préfets rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes pour faire garder sur le territoire des étrangers deux mois de plus, ce qui ajoutait à l'encombrement des maisons d'arrêt. [...] On a un peu trop transformé des politiques administratives en politiques répressives avec les conséquences qui en découlent pour les maisons d'arrêt. Il convient d'étudier cette question de très près. » Maître Francis Teitgen, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris partage la même analyse : « En réalité, les chiffres sont complexes, car l'on constate que ces très courtes peines concernent un grand nombre de personnes condamnées au terme de procédures de comparution immédiate ; pour certaines d'entre elles, il s'agit à la fois d'une peine de détention et d'une peine préparatoire en vue d'une expulsion du territoire français. Il y a là un dévoiement de la peine de prison qui consiste non pas à sanctionner, mais à garantir la présence de personnes de nationalité étrangère interdites de séjour - dans des hypothèses de violation d'interdiction de séjour ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; la peine est alors préparatoire à une expulsion du territoire de la République. Cela pose un problème d'identification de la peine et de réalité de la condamnation. » Pour ces personnes, incarcérées pour une infraction à la législation sur les étrangers, le temps de l'enfermement ne peut absolument pas être perçu comme une réflexion sur la faute. Il y a plutôt chez ces détenus le sentiment d'un pari tenté et perdu et pour lesquels la prison et l'enfermement n'ont aucune signification ; s'agissant des détenus étrangers ayant commis une infraction autre que les infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la perspective d'une expulsion dans le pays d'origine « casse » tout le processus d'insertion initié dans la prison. L'incarcération ne peut ainsi être assortie d'aucun projet de préparation à la sortie. « S'agissant de votre seconde question concernant la double peine, il est difficile de juger de telles situations. Ce qui est certain, c'est que pour un détenu qui sera expulsé dans son pays d'origine à sa sortie ou dans un pays dont il a la nationalité sans avoir aucun lien avec lui, la prison n'a aucune fonction de réinsertion ; et cela est désespérant. Or l'on sait qu'un très grand nombre de détenus purgent parfois de très longues peines avec pour seule issue la rupture avec tout ce qui constituait leur vie antérieure. » (Maître Francis Teitgen, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris) La prison apparaît au contraire, pour beaucoup d'étrangers qui étaient auparavant en situation précaire, comme un lieu qui offre des prestations auxquelles ils ne pouvaient accéder à l'extérieur : « Evidemment, les sans-papiers n'ayant ni sécurité sociale, ni papiers, ni argent pour acheter les médicaments, sont mieux soignés en prison qu'à l'extérieur. » (Docteur Véronique Vasseur, médecin chef à la prison de la Santé) Il s'agit pourtant de savoir ce que l'on veut que la prison signifie pour ces personnes ; il est dommage que le débat soit encore obscurci par des considérations politiques ou polémiques, alors même que les textes eux-mêmes consacrent l'idée selon laquelle le détenu étranger ne peut, en tout état de cause, s'impliquer dans une réflexion sur la peine : L'article 729-2 du code de procédure pénale prévoit en effet que les mesures de libération conditionnelle ne peuvent être instaurées sans le consentement du détenu, sauf pour les étrangers pour lesquels le consentement n'est pas requis. Il s'agit là d'une exception tout à fait notable à la philosophie de la libération conditionnelle, fondée sur l'insertion et la réadaptation sociale, exception qui n'a d'ailleurs pas manqué d'être contestée par la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Daniel Farge. « Cela pose la question de la nature même de la libération conditionnelle, qui n'est pas une réduction de peine. Elle suppose un effort personnel de réinsertion de la part du détenu. Le candidat à la libération conditionnelle doit proposer un projet de réinsertion. Il est extrêmement difficile de vérifier la qualité des projets dans les pays étrangers, même s'il existe des conventions internationales. [...] La commission, quant à elle, propose que le consentement soit requis désormais pour tous, y compris pour les étrangers, car cela s'inscrit dans la philosophie de la libération conditionnelle. Cela dit, nous trouverons peut-être une autre solution pour les étrangers. » (M. Daniel Farge, magistrat, président de la commission sur la libération conditionnelle). L'incarcération des détenus étrangers doit absolument faire l'objet d'une réflexion approfondie ; elle ne correspond pas en effet actuellement aux missions qui devraient être assignées à la prison. La question des conditions de l'enfermement se pose aussi dans les centres de rétention. Le contrôle exercé par la délégation générale à la liberté individuelle (Cf. III.C) s'étendra à ces centres. On a déjà eu l'occasion d'insister, dans ce rapport, sur les évolutions récentes de la population pénale, qui connaît une part croissante de toxicomanes. Les déficiences de la prise en charge en prison des phénomènes de dépendance ont également été évoquées. Il s'agit ici d'insister plutôt sur la désorganisation profonde qui résulte de la présence de toxicomanes en prison. Il faut être conscient que les toxicomanes en prison ont profondément modifié l'univers carcéral sans que l'on puisse avoir le sentiment que la prison ait une quelconque influence sur eux. La prison n'est pas un lieu où l'on guérit de la drogue ; penser que l'on va guérir de la drogue en mettant le toxicomane à l'abri des produits est une illusion. D'autant que « l'abri » est particulièrement limité. Tous les responsables des établissements pénitentiaires reconnaissent qu'il y a trafic de drogues à l'intérieur de la prison. « Mais la grande majorité des gens ne sortent pas de la drogue par la prison. En sortir vraiment nécessite une prise en mains de sa vie sur d'autres bases qui supposent une réinsertion sociale, un changement d'identité, un travail, un logement, etc. La prison est une parenthèse que certains toxicomanes supportent très bien car ils troquent leur dépendance à la drogue contre une dépendance à la prison. Ils sont contenus par cette « matriarche » qu'est la prison, alors que sortir de la drogue, c'est se confronter à un père-loi. La prison ne se présente pas du tout comme cela. On est mis en prison par la loi mais on y subit des règles, lesquelles changent d'ailleurs d'une prison à l'autre, ce qui montre leur relative indifférence au regard de la structuration psychique. En cela, la prison n'est pas un lieu thérapeutique. C'est un lieu où l'on ne survit que si l'on ment, si l'on cache une partie de soi-même pour pouvoir être soi-même dans son intimité, alors qu'il n'y a justement pas d'intimité. On ne sort donc pas de la drogue de cette façon-là. On se drogue quelques heures après être sorti de prison rien que pour éprouver que c'est toujours possible et que cela vous est toujours accessible. Ce sont parfois les dernières prises de drogue avant de changer de vie, mais je n'ai jamais vu sortir quelqu'un de prison guéri de la drogue. Le risque, c'est surtout de reprendre de la drogue en sortant de prison aux doses que l'on prenait avant et de faire une overdose. Cela se produit régulièrement. D'où l'importance de poursuivre les traitements de substitution en prison. Il y a encore un effort à faire puisque seul un toxicomane sur sept obtient un traitement de substitution en prison, contre un sur trois en ville. Bien entendu, parallèlement aux traitements de substitution, tout le dispositif psychologique et social doit être mis en _uvre. Il y a, là aussi, beaucoup de lacunes, notamment pour la réinsertion sociale, puisque l'on sort trop souvent de prison sans relais à l'extérieur, surtout si l'on est interdit de séjour dans son département. Dans certains tribunaux, c'est quasiment systématique, alors que toutes les bases sociales se trouvent dans le département d'origine. Il faut donc aller squatter ailleurs, le temps de se refaire des bases, et c'est naturellement dans la communauté des toxicomanes que l'on retrouve une place dans le département voisin. Il importe de comprendre que la prison n'est pas un lieu thérapeutique pour les toxicomanes. Cela peut éventuellement être une sanction du trafic de drogues, mais la grande majorité des toxicomanes n'a pas sa place en prison. » (M. Philippe Carrière, responsable du SMPR de Châteauroux, membre de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire) Compte tenu de l'importance de la récidive chez les toxicomanes, récidive induite par la reprise quasi-immédiate d'utilisation de stupéfiants, il faut s'interroger sur l'utilité de la prison comme cadre adéquat de rappel à la loi et de sanction. Dans cette optique, il semble pertinent de différencier les personnes incarcérées pour usage simple de celles condamnées pour usage et trafic. S'agissant des premières, il est bien évident, on l'a vu dans l'analyse des politiques de prise en charge, que la réponse par l'incarcération n'est pas adéquate. Cela étant dit, le nombre de personnes incarcérées pour ce motif paraît extrêmement faible. L'échange entre Mme Nicole Maestracci, Présidente de la MILDT et le Président de la commission d'enquête est éclairant sur la situation de ces détenus : « Une enquête de 1995 - que je vous ferai parvenir - montrait qu'il y avait environ 160 personnes, un jour donnée, qui étaient incarcérées pour simple usage. C'est un chiffre « de stock ». J'ai demandé à l'administration pénitentiaire de refaire la même évaluation aujourd'hui pour savoir si le chiffre a baissé ou pas. En principe, dans la circulaire qui a été adressée par Mme la garde des sceaux aux procureurs juste après le plan triennal du gouvernement, il est demandé aux procureurs d'éviter l'incarcération pour les simples usagers. Mais je ne jurerai pas qu'il n'en reste pas encore quelques-uns. M. le Président : « Sont-ils en préventive ou sont-ils condamnés ? Mme Nicole Maestracci : « Dans l'enquête, il y avait les deux catégories. Encore faut-il savoir qu'une infraction de simple usage ne fait pas l'objet d'une information. Il peut y avoir éventuellement une détention provisoire parce que l'audience de comparution immédiate a été reportée mais dans la plupart des cas il s'agissait de condamnés. » M. le Président : « Des condamnés à des peines de quelle durée ? Mme Nicole Maestracci : « A des peines de durée courte, de l'ordre de trois mois. » M. le Président : « Le temps de ressortir pires ! Mme Nicole Maestracci : « La peine encourue en France pour les simples usagers est d'un an d'emprisonnement. » Les personnes incarcérées pour trafic de stupéfiants sont beaucoup plus nombreuses puisqu'elles représentant 14,7 % de la population pénale. Toutes les personnes incarcérées pour trafic ne sont pas toxicomanes, mais il y a, dans la très grande majorité des cas, une corrélation étroite entre l'usage de drogues et le trafic. De plus, ce chiffre ne représente pas non plus l'ensemble de la population toxicomane puisqu'une grande partie des crimes et délits constatés peuvent être imputés à l'usage direct de drogues, en raison de la dépendance qu'elles induisent et du prix des produits. Il n'y a donc pas de réponse globale à apporter en matière d'incarcération des toxicomanes, compte tenu de la diversité des infractions perpétrées. Si l'on convient que la prison n'est pas la réponse à la toxicomanie, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès inverse en oubliant, voire en excusant le crime par l'existence de conduites addictives. Néanmoins, s'il y a bien un impératif de sanction, il convient de réfléchir d'abord à celle qui paraît la plus adéquate. Telle qu'elle existe actuellement, la sanction de l'enfermement induit la récidive. Plusieurs expériences ont été menées afin de réfléchir à des alternatives conçues à la fois comme une sanction et initiant une prise en charge de la dépendance. Une circulaire en date du 17 juin1999 sur les réponses judiciaires aux toxicomanes permet de faire le point sur la question et de citer quelques expérimentations réussies ; ainsi, par exemple, les mesures de travail d'intérêt général ont été adaptées selon des modalités spécifiques pour les toxicomanes, avec l'idée d'une progressivité dans l'exécution du travail qui intègre des mesures éducatives particulières et s'appuient sur un partenariat soutenu. Il est nécessaire en la matière de multiplier les expériences et d'utiliser tout l'arsenal des sanctions alternatives en les adaptant de manière pragmatique au public concerné. Il faut être conscient, en préconisant la solution des sanctions alternatives, que cette orientation ne paraît guère aller dans le sens de la politique pénale menée jusqu'à présent :alors qu'entre 1983 et 1993, le contentieux des stupéfiants enregistre un accroissement de 144 %, le rapport remis au garde des sceaux par la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Daniel Farge démontre que les condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants sont quasiment exclus des dispositifs de libération conditionnelle. Sans qu'il soit question d'analyser le bien-fondé de cette politique, qui répond là encore à une attente, il faut être conscient que ce choix de la fermeté ne prévient pas la récidive. A tout le moins, si l'on maintient cette orientation, faudrait-il s'interroger sur les mesures d'accompagnement à la sortie : si le toxicomane n'est pas préparé à sa sortie, et ne dispose pas notamment d'hébergement, la rechute et la récidive seront inéluctables : «100 % des toxicomanes qui sortent sans hébergement rechutent. Si l'on a pris en charge correctement un toxicomane en prison sans évoquer son hébergement et sa sortie, tout le travail sera annulé dans les vingt-quatre heures qui suivront. » (Mme Betty Brahmy, psychiatre, responsable du SMPR de Fleury-Mérogis) e) Les détenus malades ou âgés Le nombre croissant de détenus âgés a déjà été souligné ; 1 455 détenus à la fin de 1999 étaient âgés de plus de 60 ans et ce nombre a quasiment doublé en quatre ans. Cette recrudescence est liée notamment à l'accroissement des condamnations pour harcèlement sexuel, viol ou inceste. L'inadéquation de la prise en charge de ces détenus et de façon plus large, des détenus gravement malades ou dépendants, a également déjà été évoquée. La présence de ces personnes dans les établissements pénitentiaires pose très concrètement la question de la mort en prison. Les personnels surveillants, les autres détenus ne sont pas préparés à cette éventualité et rien n'est fait de façon très encadrée pour accompagner le détenu dans ses derniers instants. Mourir en prison, c'est affronter une solitude sans espoir ; c'est un constat d'échec et de gâchis pour les familles qui n'ont pu être présentes dans les derniers moments. L'ensemble des personnels pénitentiaires essaient, dans la mesure du possible, de transférer le malade à l'hôpital dans ses derniers jours ; se pose néanmoins, là encore, la question des escortes et la difficulté de mobiliser des forces de police ou de gendarmerie. L'attitude des médecins, qui trop souvent renvoient le malade en prison une fois l'alerte passée, aussi facilement que si celui-ci retournait chez lui, a également été maintes fois évoquée ; un cas particulier au centre de détention de Caen où le médecin a renvoyé le malade en prison où il est mort deux jours après, semble ainsi avoir particulièrement frappé les esprits des membres du personnel pénitentiaire. Il n'est pas digne de mourir en prison. La question du maintien en détention des détenus malades ou âgés se pose donc. La grâce médicale n'est accordée aujourd'hui que par le Président de la République. Cette mesure paraît cependant être proposée parcimonieusement et accordée encore plus prudemment ; en 1998, 27 dossiers ont été présentés au Président de la République et 14 grâces ont été accordées ; en 1999, 33 propositions pour 18 grâces prononcées. « La question de la grâce médicale est fondamentale. Jusqu'en 1996, en l'absence de traitement efficace, des malades du sida sont morts en prison ou une journée après leur libération. Nous en avons connu de nombreux au cours des dures années que furent celles de 1993 et de 1994. De nombreux détenus avaient formulé une demande de grâce médicale. Ils étaient tout près de mourir. Ils ont été libérés la veille ou l'avant-veille de leur décès, ont été transférés dans leur famille ou sont morts à l'hôpital voisin. Il convient d'envisager à nouveau la question de la grâce médicale en termes de recours, de constitution de dossiers et aussi en considérant les éléments présidant à la prise en compte de la grâce. Aujourd'hui encore, elle concerne des détenus dans un état grave. Des détenus se sont vu accorder la grâce médicale le lendemain du jour de leur mort. Aujourd'hui, la question se pose avec moins d'acuité s'agissant du sida, car les traitements sont plus efficaces et il y a donc moins de détenus très avancés dans la maladie. Il en reste néanmoins et cette question doit, à mon avis, être envisagée à nouveau. » (Mme Emmanuelle Cosse, présidente de l'association Act-up Paris) Il semble effectivement nécessaire de revoir les procédures de grâce médicale ; rien ne justifie que cette décision relève encore actuellement du Président de la République. La procédure devrait relever du juge de l'application des peines qui pourrait, pour prendre sa décision, s'appuyer sur des expertises médicales établissant que le détenu est atteint d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital. Cette procédure pourrait également concerner les détenus très âgés et dépendants, dont la présence en prison ne se justifie plus en terme de protection de la société. « En visitant certains établissements, notamment celui de Liancourt, j'ai été frappée de voir des détenus qui marchaient, appuyés sur un tripode. On m'a expliqué que certains nécessitaient une aide pour effectuer des actes de la vie personnelle. Il existe deux catégories de détenus : incarcérés assez âgés, certains purgent des peines encore couvertes par la période de sûreté ; d'autres non. La première, sauf à modifier la loi, ne peut faire l'objet d'une quelconque mesure d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. Dans l'absolu, lorsqu'une personne n'est qu'au début de la dépendance, seulement pour certains actes et non pas totalement, je considère qu'elle peut encore être dangereuse. En revanche, à partir d'un certain niveau de dépendance, la dangerosité devient très faible. Parmi les personnes âgées en détention, il en est beaucoup condamnées pour harcèlement sexuel, viol ou inceste. Il est clair qu'elles peuvent, malgré leur dépendance, être animées de certaines pulsions ou risquer des tentatives. Néanmoins, je pense qu'il arrive un âge où la dangerosité devrait être considérée de plus en plus faible. » (Mme Martine Viallet, directrice de l'administration pénitentiaire) 2) Développer et crédibiliser les solutions alternatives Le développement des solutions alternatives à l'incarcération doit absolument être considéré comme une priorité par le ministère de la Justice. C'est dans ce développement que réside incontestablement la solution au problème du surencombrement dans les maisons d'arrêt. Il faut bien entendu, pour cela, une véritable volonté politique, assortie des moyens budgétaires adéquats. Mais il importe également d'accomplir un effort pédagogique en direction de l'opinion publique : les solutions alternatives sont des sanctions au même titre que l'incarcération. Il ne s'agit pas, en effet, de faire accroire que la petite et moyenne délinquance, principalement concernées par ces mesures, restent impunies. Il faut, dès lors, insister sur le caractère profondément déstructurant des courts séjours en prison qui ne peuvent prévenir la récidive et qui, trop souvent même, l'induisent. Les peines alternatives - improprement d'ailleurs appelées alternatives comme si l'incarcération devait être la norme - développent au contraire une logique d'insertion tout à fait intéressante. L'éventail des mesures alternatives existantes permet d'adapter la sanction aux différents types de délinquance ; la progression de l'ensemble des mesures permet d'affirmer que celles-ci sont de plus en plus crédibles aux yeux des magistrats. Le sursis avec mise à l'épreuve a dépassé les 100 000 mesures depuis le 1er janvier 1998. Au 1er janvier 1999, il représente 76,1 % des peines alternatives prises en charge par les services d'insertion. Cette mesure reste la plus utilisée par les juridictions et touche une classe d'âge assez large. L'accompagnement de la personne dans le temps, sachant que la durée moyenne d'un sursis avec mise à l'épreuve a été, en 1998, de 22,8 mois (contre 23,2 mois en 1994), permet de mettre en place un travail partenarial. Les juridictions y ont recours plus particulièrement pour le cas d'abandon de famille, les atteintes aux m_urs, les coups et violences volontaires, le vol et le recel. Le travail d'intérêt général a également connu une forte progression. Entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1999, le nombre de condamnés à une peine de travail d'intérêt général a augmenté de 83,3 %. Depuis 1989, il a été multiplié par cinq. Cette progression importante du travail d'intérêt général, particulièrement forte depuis 1994, est sans doute due à l'effet conjugué de deux événements : l'entrée en vigueur du nouveau code pénal qui impose des conditions très rigoureuses à l'octroi du sursis simple et l'opération de communication menée à l'occasion du dixième anniversaire de cette peine. Cependant, en 1998, les mesures de travail d'intérêt général ont marqué le pas puisqu'elles n'ont augmenté que de 0,8 % contre 5 % en 1997 et représentent seulement 16,7 % des mesures de milieu ouvert. Deux contentieux représentent 80 % des condamnations au TIG : le vol-recel et la circulation routière. Une enquête menée en 1997 tend à démontrer une demande forte des magistrats à l'égard de l'exécution de la mesure et la mise en place d'un suivi qualitatif, lequel ne constitue pas toujours un objectif pour les partenaires administratifs ou associatifs ; les exigences accrues des magistrats expliqueraient la stagnation de cette peine. Les condamnés sont majoritairement affectés à des postes proposés par des collectivités territoriales et ne présentant généralement pas d'exigences particulières. Les condamnés ont un rôle de complément de main-d'_uvre mais ne se substituent pas à des postes de titulaires. Les collectivités les plus pourvoyeuses de postes sont les municipalités, dont les services techniques recrutent les condamnés pour l'entretien des bâtiments, des espaces verts, de la voirie et des travaux de peinture. Des postes administratifs sont aussi offerts. Beaucoup de municipalités, de toutes tendances politiques, se plaignent de la non-utilisation des postes offerts. Une étude devrait permettre de mesurer ce contre-effet. Le secteur associatif participe également à l'accueil des condamnés à un travail d'intérêt général. Il est cependant souvent confronté à des problèmes d'encadrement, faute de permanents suffisants. En revanche, le choix des postes est plus varié et permet à des condamnés d'intégrer des réseaux associatifs, les aidant quelquefois à élargir leur horizon relationnel. A défaut d'assurer l'insertion professionnelle des condamnés, le secteur associatif réussit assez souvent leur insertion sociale. La semi-liberté a progressé très légèrement jusqu'en 1997 (cette augmentation est variable selon les régions mais reste dans l'ensemble homogène). Durant l'année 1998, le taux de progression a été de 9,1 % par rapport à l'année précédente ce qui est très encourageant. Parce qu'elle offre un cadre d'exécution rigoureux, la semi-liberté est une mesure d'aménagement de peine adaptée à un public relativement limité. Elle nécessite néanmoins qu'un partenariat structuré et spécifique lui soit associé. Certains sites ont développé des projets permettant d'accompagner des détenus dans une démarche d'insertion, privilégiant la formation et l'emploi pour certains ou la prise en charge thérapeutique pour d'autres. Si les projets existent, ils sont encore peu nombreux. Il est vrai que l'utilisation de cette mesure fait appel à des structures pénitentiaires indépendantes (les centres de semi-liberté) ou à des quartiers spécifiques (maison d'arrêt, centres de détention), ne disposant pas toujours de l'encadrement nécessaire pour prendre en charge ce public. « Il y a aussi des outils que le parlement a accordés à l'administration pénitentiaire, mais qui sont restés inutilisés. Le programme pluriannuel pour la Justice, voté en 1995, avait prévu à la fois un objectif de construction de 1 200 places de semi-liberté et les crédits nécessaires à la réalisation de cet objectif. Peu de ces 1 200 places ont été effectivement créées. Seuls deux ou trois centres de semi-liberté ont été ouverts en France depuis 1995 et l'on en est resté là. La semi-liberté, qui permet à un détenu de sortir pour travailler et de rentrer dans l'établissement pénitentiaire quand son travail est terminé, est très intéressante. Or aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de la région parisienne, les centres de semi-liberté qui y existent sont implantés assez loin des lieux d'activité des détenus et sont fermés tous les week-ends, parce que l'administration pénitentiaire ne dispose pas du personnel suffisant pour procéder à une ouverture sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En conséquence de quoi, il faut trouver aux personnes en semi-liberté un hébergement pendant le week-end. La difficulté de trouver un tel hébergement pour une personne en parcours difficile est évidente, surtout à Paris. L'enjeu est de cet ordre. » (M. Pascal Faucher, membre de l'association nationale des juges de l'application des peines) La question des moyens apparaît dès lors prédominante ; l'essor des mesures alternatives exige en effet des moyens importants attribués aux services d'insertion, à qui l'on réserve encore trop souvent la partie congrue des crédits budgétaires. Le développement du recours aux emplois-jeunes dans ces services ne peut à cet égard qu'être conçu comme un palliatif provisoire préalable au recrutement de conseillers d'insertion. Le renforcement de l'encadrement devrait pouvoir crédibiliser ces solutions alternatives aux yeux des magistrats, qui paraissent encore trop réticents devant des solutions qu'ils estiment peu fiables sur le plan de la sécurité. Ainsi, les peines alternatives restent encore sous-utilisées : les centres de semi-liberté, au 1er janvier 1999, n'étaient remplis qu'à 71 % de leur capacité. Cette moyenne globale ne reflète pas cependant les difficultés locales existant dans certains CSL : le CSL de Gagny connaît ainsi une suroccupation de 160% ; le CSL de Toulouse dispose de 25 places qui sont toutes occupées et pour lesquelles le juge de l'application des peines doit gérer dans des conditions difficiles une longue liste d'attente. La présence de surveillants en milieu ouvert, préconisée par les syndicats de surveillants, permettrait très certainement de voir ces solutions progresser. Le développement des solutions alternatives passe également par un soutien accru du monde associatif, dont le rôle est essentiel dans l'encadrement du milieu ouvert ; la mission conduite dans les DOM a d'ailleurs pu constater la quasi-inexistence du recours aux solutions alternatives du fait de l'absence de relais partenarial consistant. Il faut cependant se garder de faire des solutions alternatives la réponse à la moindre infraction : afin de garder son efficacité, le système du milieu ouvert doit reposer sur l'individualisation de la peine et l'adaptation à la personnalité du condamné ; il s'accommode mal, quels que soient les moyens impartis, du traitement de masse. De plus, il ne faut pas que ce développement des mesures alternatives vienne empiéter sur la liberté, alors qu'elles sont censées se substituer à l'incarcération. Là encore, l'attitude des magistrats devant la montée en puissance du système sera déterminante. La même vigilance s'impose s'agissant de l'expérimentation du placement sous surveillance électronique. La loi du 19 décembre 1997 permet en effet d'offrir à des détenus ayant une peine ou un reliquat de peine inférieur à un an de l'effectuer en dehors de la prison avec un bracelet électronique. « Un autre point important est de savoir dans quel créneau se situera le bracelet électronique parce qu'en France, à la différence peut-être des pays qui l'ont implanté (et c'est une remarque qui nous est faite par un certain nombre de personnels), de nombreux dispositifs existent déjà à la fois dans le cadre du prononcé d'une peine (je pense notamment au sursis avec mise à l'épreuve qui implique un suivi social) et dans le cadre de l'exécution des peines, que ce soit le placement à l'extérieur, la semi-liberté, la libération conditionnelle et d'autres mesures auxquelles le bracelet électronique viendra s'ajouter. Si le bracelet électronique venait empiéter sur la liberté, nous constaterions dans ce cas-là un échec et ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons. Nous devons être extrêmement vigilants et veiller à bien définir le bracelet électronique comme une peine de substitution à un emprisonnement ferme et non comme une alternative à la libération conditionnelle ni surtout au placement à l'extérieur. Notre vigilance doit être extrêmement forte sur ce point. Deuxième point : les expériences étrangères nous montrent que ce système de bracelet électronique concerne généralement des publics très spécifiques. La Suède a assez bien développé le système mais de manière relativement modérée : 591 personnes ont été placées sous bracelet électronique en 1998 pour une population de 8,8 millions d'habitants. C'est un ratio dont nous avons à tenir compte. En Suède, 57 % de personnes sont condamnées pour conduite en état alcoolique. En France, les personnes condamnées pour conduite en état alcoolique (leur nombre est important) ne sont pas forcément incarcérées à l'intérieur d'établissements pénitentiaires. On retrouve ainsi le risque de toucher un public qui, pour l'instant, n'est pas incarcéré. J'insiste sur ce point. [...] Nous avons ce souci de veiller, d'une part, à une mise en place progressive, d'autre part, à bien cibler les publics et à ne pas mordre sur des publics qui ne rentreraient pas, en l'absence de bracelet électronique, en détention. » (M. Eric Lallement, sous-directeur de l'organisation du suivi social et du fonctionnement des services déconcentrés à la direction de l'administration pénitentiaire) La réussite du bracelet électronique repose donc sur la bonne appréhension du dispositif par les magistrats. Elle implique également un encadrement social important : « ...il est nécessaire de mettre en place un accompagnement social fort pour répondre au véritable souci de réinsertion et de prévention de la récidive. Un certain nombre de pays qui ont mis en place le bracelet électronique ont un travailleur social pour dix personnes placées sous bracelet électronique. Un suivi social extrêmement fort et développé est nécessaire pour répondre aux trois objectifs de la mise en place réaliste et pertinente du bracelet électronique, les trois objectifs étant de réduire le nombre d'incarcérations ou la durée d'incarcération et donc de permettre à nos établissements pénitentiaires d'avoir des espaces un peu plus larges pour ceux qui restent incarcérés. Il faut, en outre, éviter la récidive et prévenir. La réinsertion nécessite cet accompagnement social extrêmement fort. » (M. Eric Lallement, sous-directeur de l'organisation du suivi social et du fonctionnement des services déconcentrés à la direction de l'administration pénitentiaire) Cet accompagnement social devra notamment veiller à ce que des centres d'hébergement ou des associations soient à même d'accueillir des personnes sans domicile placées sous surveillance électronique. Faute de quoi, le bracelet électronique, qui exige un domicile fixe et une ligne téléphonique, se verra réservé à une « délinquance en col blanc » ; l'inéquité qui en résulterait entre les personnes assez aisées pour garantir un cadre d'accueil au dispositif électronique et les autres, condamnées faute de moyens suffisants à l'incarcération, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi. Sous ces réserves, le bracelet électronique est susceptible de jouer un rôle dans le désencombrement des maisons d'arrêt ; trois sites pilotes ont été préalablement choisis pour mener l'expérience, au regard du chiffre de surencombrement des maisons d'arrêt : « Sur un plan technique, le ministère de la Justice a donc, dans un premier temps, choisi d'expérimenter ce bracelet électronique sur trois sites. Ces sites ne sont pas encore choisis à la date d'aujourd'hui. Nous avons soumis à Mme la garde des sceaux une liste de onze sites qui répondent à la priorité devant être développée par le bracelet électronique qui est de réduire la surpopulation carcérale en évitant l'incarcération des personnes qui seraient condamnées à de courtes peines d'emprisonnement ou, au contraire, en aboutissant à une libération anticipée avec un contrôle par le biais du bracelet électronique d'une personne qui a été préalablement condamnée. On a donc défini les possibilités au regard de la surpopulation carcérale des établissements pénitentiaires après une consultation qui a été faite auprès de nos directions régionales. Nous avons défini ces onze sites à partir de là. Ils sont aujourd'hui soumis à la concertation sociale. Nous avons réuni les organisations professionnelles des personnels de surveillance, de direction et des travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire et ceux-ci doivent nous faire part de leurs observations d'ici une quinzaine de jours. Nous aurons aussi prochainement une réunion avec l'ensemble des juges d'application des peines, directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et chefs d'établissement de ces onze sites pour voir avec eux le degré de faisabilité sur ces onze sites et, à la suite de ces consultations, Mme la garde des sceaux sélectionnera les trois sites qui recevront cette expérimentation pour une durée que nous avons évaluée à neuf mois. » M. Eric Lallement, sous-directeur de l'organisation du suivi social et du fonctionnement des services déconcentrés à la direction de l'administration pénitentiaire) Finalement, le nombre de sites choisis s'élève à quatre qui sont : Lille, Aix-en-Provence, Agen et Grenoble. Les postes de surveillance seront situés en établissements pénitentiaires avec un poste à la maison d'arrêt de Loos, un à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, un à la maison d'arrêt d'Agen et un au centre de semi-liberté de Grenoble. La généralisation du système doit être conduite prudemment, et s'accompagner notamment d'un effort de pédagogie en direction du grand public. En l'absence de communication, le système peut, comme en Angleterre en 1989, aboutir à l'échec. 3) Limiter la détention provisoire La question de la place des prévenus en prison a déjà été longuement évoquée : on a insisté sur leur nombre (19 726 en 1999), l'inéquité de leur régime de détention, plus sévère que celui des condamnés alors qu'ils sont présumés innocents, et sur la difficulté qu'il y avait, tant qu'ils sont soumis au régime de détention provisoire, de promouvoir une action d'insertion. Il faut noter qu'au Canada, la liberté sous caution est la règle et que la détention provisoire n'est prononcée que dans 15 % des cas. La caution ne consiste pas obligatoirement en une somme d'argent, mais impose le respect de diverses obligations. Il faut dès lors initier une réflexion plus en amont, qui permettrait de limiter le placement en détention provisoire et de réduire sa durée. Le débat a été clairement posé lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et plusieurs réformes décisives ont pu être adoptées dans ce cadre : les conditions de placement en détention provisoire ont été revues et ne concernent plus majoritairement que les délits pour lesquels la peine encourue est supérieure à trois ans, contre deux auparavant. Les délais de la détention provisoire ont été réduits et ne peuvent plus dépasser, en matière correctionnelle, quatre mois lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans et un an dans les autres cas (contre six mois auparavant lorsque la peine était inférieure ou égale à cinq ans, deux ans lorsqu'elle était inférieure à dix ans et illimitée pour les peines supérieures à dix ans). En matière criminelle, le délai de droit commun est de deux ans pour les peines inférieures à vingt ans et trois ans dans les autres cas ; cette durée était auparavant illimitée, sous la seule réserve du respect d'un « délai raisonnable » imposé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La ministre de la Justice a indiqué, lors de son audition qu'une baisse de 4 à 5 000 détentions provisoires était escomptée de la mise en _uvre de ces mesures. Les délais d'audiencement des affaires ont également été fixés limitativement : six mois en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle. La détention provisoire se trouve également strictement encadrée dans le cas de parents élevant seuls leurs enfants. Le texte adopté, et sur lequel les parlementaires ont fait des propositions décisives, démontre que rien n'est inéluctable dans la décision de placer en détention et que toute initiative réformatrice ne bute pas inexorablement sur la question des moyens. Au-delà du texte adopté, la réflexion reste ouverte sur les responsabilités qui incombent à chacun dans la décision du placement en détention provisoire. Il y a d'abord, reconnaissons-le, une responsabilité du législateur, qui a eu pour souci de faire cesser le plus rapidement possible le trouble à l'ordre public causé par l'infraction. Interprété extensivement par les juges, ce critère de trouble à l'ordre public a désormais essentiellement pour objectif d'apaiser une opinion publique, relayée par les médias, qui exige souvent des mesures immédiates. « Concernant la première question relative à la pression de l'opinion publique et des enquêteurs sur la décision de placer en détention provisoire, je vous renvoie à la loi : la détention provisoire doit être l'unique moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public. C'est ce qui figure dans la loi. Si l'on veut supprimer ce critère, il faut le faire, mais il convient de savoir que nous prenons une décision sur la base des réquisitions du procureur de la République qui défend les intérêts de la société, donc les vôtres, et de la plaidoirie de la défense. Souvent, des réquisitions ne sont fondées que sur le trouble à l'ordre public, car tel est le critère figurant dans la loi. Son application a été limitée lors de dispositions récentes, mais, en tant que magistrats qui appliquons la loi, c'est là un critère que nous devons prendre en compte. En règle générale, il est extrêmement rare qu'une décision de placement en détention provisoire soit prise sur ce seul critère. Je ne puis m'engager au titre de mes collègues, mais c'est personnellement mon cas. Cela dit, il est bien évident qu'à partir du moment où la loi prévoit la mise en détention et si la détention provisoire est l'unique moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public, nous nous devons de prendre en considération le trouble à l'ordre public. [...] Il y a peu, à l'issue d'un débat contradictoire, je n'ai pas placé une personne en détention. On entend souvent dire que le débat contradictoire ne sert à rien. Ce n'est pas vrai ; il arrive ainsi que nous ne placions pas une personne à l'issue d'un débat contradictoire. Le lendemain, j'ai été appelé par la victime. Je me suis fait vertement tancer. Je lui ai expliqué les raisons de ma décision. Il s'agit là de notre rôle, notre responsabilité. » (M. Jean-Baptiste Parlos, représentant de l'association française des magistrats chargés de l'instruction) Il serait donc nécessaire de revoir les critères de placement en détention provisoire ; si l'objectif d'apaisement du trouble à l'ordre public répond à des motivations tout à fait respectables dans des cas très précis, il n'est pas souhaitable que ce critère soit dévoyé sous la pression de l'opinion publique. La décision de placement en détention provisoire peut également répondre à une attente des officiers de police judiciaire à l'issue d'une enquête qu'ils ont menée de bout en bout. « Pour ce qui est des policiers, je vous exposerai clairement ma pratique, dont je pense qu'elle est également celle d'un certain nombre de mes collègues. Lorsqu'ils identifient une personne comme étant l'auteur d'un délit, alors même que nous devons pour notre part la considérer, selon la loi, comme innocente, ils souhaiteraient que des mesures coercitives soient prises immédiatement. Dans les cas où nous ne prenons pas ces mesures, j'ai coutume de les appeler pour leur en expliquer les raisons. Rien n'est plus désagréable pour quelqu'un qui a accompli des actes d'enquête compliqués, qui s'est donné dans son enquête, d'apprendre par une autre voie une décision qu'on ne lui a pas expliquée. Je considère les policiers et les gendarmes comme mes collaborateurs et je leur explique pourquoi je ne prends pas une décision de détention provisoire. Il est vrai que cela « remue » parfois, mais nous assumons notre rôle de magistrats. » (M. Jean-Baptiste Parlos, représentant de l'association française des magistrats chargés de l'instruction) Surtout, le placement en détention provisoire semble de plus en plus être décidé par des juges d'instruction dans le seul objectif de conduire le prévenu à passer aux aveux. Il s'agit là d'un véritable dévoiement de la procédure de détention provisoire, dont il est difficile d'apprécier l'ampleur. « Sur la détention utilisée comme moyen de pression, je ne vous dirai pas que cela n'a jamais existé. Il faut quand même savoir que l'enquête pénale a changé de visage. L'aveu n'est plus la reine des preuves, notamment en matière financière. En matière financière, nous travaillons sur des documents, sur des comptes, sur des éléments papiers. Il en va de même dans les affaires de banditisme. On travaille aussi sur les tests d'ADN, les téléphones portables, plus souvent qu'auprès des personnes placées en garde à vue ou celles en détention provisoire qui ne disent rien ou contestent leur responsabilité pénale. Je ne vous dirai pas que cela n'a jamais existé, mais il serait totalement illusoire de fonder une enquête et une instruction sur une détention utilisée comme pression. » (M. Jean-Baptiste Parlos, représentant de l'association française des magistrats chargés de l'instruction) La loi sur la présomption d'innocence, qui institue un juge des libertés et de la détention, seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire, devrait permettre de mettre fin à ces pratiques. Il serait cependant hâtif de dénier toute utilité à la détention provisoire ; elle correspond, le plus souvent, à une réelle nécessité de l'enquête, qui est de s'assurer de la garantie de présentation des suspects. Des mesures alternatives existent, telles que le contrôle judiciaire, mais souffrent d'une absence de moyens. « ... actuellement, la seule mesure alternative est le contrôle judiciaire. Il serait bon de développer d'autres mesures alternatives. On a parlé du bracelet électronique, mais je ne suis pas certain que l'on en ait les moyens. En tout état de cause, il est certain que plus l'éventail des choix sera large, plus on limitera la détention provisoire. [...] S'agissant des moyens alternatifs, par exemple, en matière de contrôle judiciaire, je vous invite à relire l'article 138 du code de procédure pénale. C'est extraordinaire ! Vous avez l'impression que vous pouvez tout faire ! Le premier des moyens alternatifs serait de pouvoir assurer l'efficacité du contrôle judiciaire. Je cite un exemple : le contrôle judiciaire permet d'assigner une personne à résidence, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de chez elle, sauf pour se rendre à son travail ou pour les besoins de la vie courante. Je viens, dans le cadre d'un dossier, de placer quelqu'un sous contrôle judiciaire et de l'assigner à résidence en province, car je suis juge d'instruction à Paris. Je ne dispose d'aucun moyen de vérifier que cette obligation est respectée. Certes, j'ai appelé la brigade de gendarmerie locale en lui signalant que je lui avais envoyé copie de mon ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Je lui ai indiqué que la personne dépendait de son ressort et lui ai demandé si elle pouvait vérifier de temps à autre si mon contrôle judiciaire était exécuté. Le commandant de brigade, très gentiment, m'a répondu qu'il le ferait, mais il a également ajouté que lui et ses hommes étaient très chargés. Le premier point consiste donc à assurer l'efficacité de la mesure alternative. » (M. Jean-Baptiste Parlos, représentant de l'association française des magistrats chargés de l'instruction) La loi sur la présomption d'innocence a prévu qu'avec l'accord de l'intéressé, la détention provisoire pourrait être effectuée sous surveillance électronique. Cette mesure paraît réellement prometteuse pour peu que les moyens adéquats lui soient attribués. Il est également indispensable de réduire la durée de la détention provisoire ; rappelons que celle-ci est en moyenne de quatre mois pour les délits et d'un peu moins de deux ans pour les crimes ; la loi sur la présomption d'innocence a strictement encadré ces délais. Il reste encore à faire en sorte que le délai maximum prévu dans la loi récemment adoptée ne soit pas interprété comme une norme ; il y a bien évidemment, là encore, un problème de moyens, que ce soit dans la conduite de l'instruction ou dans l'audiencement des affaires. Il apparaît également une lacune dans le suivi des personnes une fois placées en détention provisoire. Le juge d'instruction n'est en effet pas informé de la façon dont se déroule cette détention ; or cette information apparaît essentielle, à la fois dans la décision de remise en liberté et dans l'efficacité de l'instruction. « Pendant le temps de la détention provisoire, rien n'est organisé pour préparer la sortie, car il est assez fréquent que l'on place en détention provisoire le temps de l'enquête, le temps d'entendre tous les témoins. Au bout de quatre mois, même si l'instruction n'est pas tout à fait terminée, les confrontations les plus importantes ont été faites et les investigations qui risquaient d'être polluées par des pressions sont achevées. Mais rien n'est prévu pour la sortie. En fait, aucun service éducatif, aucun service social de la maison d'arrêt ne s'occupe d'une préparation à la sortie, puisqu'il n'y a pas d'échanges et que l'on ignore le temps de la détention. Rien n'est prévu pour préparer un hébergement, car, parfois, un hébergement en province serait possible, hors contexte du lieu où se sont déroulés les faits. Je parle en tant que juge d'instruction parisien, mais si on est en province, on peut se placer dans le cadre d'un éloignement général. Si donc les faits ont eu lieu dans la ville où l'on est saisi et que la victime habite là, il est ennuyeux de remettre le prévenu en liberté avant le jugement. Si l'on pouvait prévoir un hébergement éloigné, nous autoriserions peut-être plus souvent une remise en liberté en cours d'instruction. Malheureusement, si l'avocat n'a pas travaillé avec la famille sur cette possibilité, il est très difficile pour le prévenu détenu d'entreprendre des démarches et ce, d'autant plus qu'aucun service social n'est chargé de le faire. Il y a là une petite faille. La détention provisoire pourrait être réduite si, en cours de détention, des recherches régulières étaient effectuées, ainsi que des contacts pris avec les familles pour trouver des solutions alternatives. C'est une possibilité qui peut être avancée. » ...] Je ferai également des propositions pour rendre la détention plus efficace pour l'instruction, car je ne pense pas que l'instruction ait à gagner à ce que le prévenu soit mal et se présente agressif ou dépressif aux interrogatoires. Il serait donc intéressant de disposer, entre la maison d'arrêt et le juge d'instruction, d'un outil d'échanges qui prendrait la forme d'un cahier ou d'une fiche de renseignements, d'une notice régulièrement réactualisée, qui permettrait d'être informé de l'adaptation du mis en examen en milieu carcéral, des conditions exactes de sa détention, de son isolement, des visites de sa famille, des événements importants de sa vie familiale. Il arrive que l'on prévoie un interrogatoire deux jours après l'annonce d'un décès, d'une maladie grave dans la famille ou d'une rupture conjugale faisant suite à la détention. Ce sont là de très mauvaises conditions pour un interrogatoire et qui sont inhumaines pour le prévenu. Il conviendrait donc que nous en soyons informés. De même, s'agissant de l'état de santé, sans que soit violé le secret médical, il serait utile que nous sachions si la personne est suivie régulièrement et si elle pose problème. Il serait également intéressant que nous soyons informés du suivi psychologique, ainsi que des démarches réelles en vue d'une désintoxication pour ce qui concerne les toxicomanes. » (Mme Sophie-Hélène Château, représentante de l'association française des magistrats chargés de l'instruction) Plus généralement, au-delà de la question de la détention provisoire, la connaissance de l'univers carcéral doit être une priorité fondamentale de la formation et des méthodes de travail des magistrats. Il est regrettable qu'il existe encore actuellement une telle césure entre l'administration judiciaire et l'administration pénitentiaire. Un réel effort de coopération doit être mené entre ces deux administrations qui dépendent du même ministère . 1) Développer la libération conditionnelle Au Canada, la libération conditionnelle est une modalité normale d'exécution de la peine fondée sur l'idée que la plupart des délinquants finissent par retourner dans la collectivité et que le meilleur moyen d'assurer la protection des citoyens est d'inciter le délinquant, tout au long de sa peine, à se réinsérer. L'une des valeurs fondamentale du Service Correctionnel du Canada (S.C.C.) est énoncée ainsi : « Nous reconnaissons que le délinquant a le potentiel de vivre en tant que citoyen respectueux des lois. » La période de détention est utilisée pour préparer le détenu à réintégrer la société. ▪ les programmes correctionnels Au terme du processus d'évaluation initiale réalisée dans les centres de réception, qui sert également à déterminer le niveau de sécurité dont relève le délinquant, est établi un plan correctionnel personnalisé axé sur la réinsertion du condamné. On exige ainsi des détenus qu'ils participent à des programmes adaptés aux difficultés de chacun et destinés à favoriser leur réinsertion. Programmes correctionnels
▪ libération conditionnelle Le système correctionnel canadien n'est pas fondé sur le tout carcéral opposé à la liberté complète, mais dispose d'une gradation des régimes de surveillance des délinquants allant de l'incarcération à la remise en liberté et comportant de nombreuses étapes intermédiaires, comme le montre le schéma suivant. 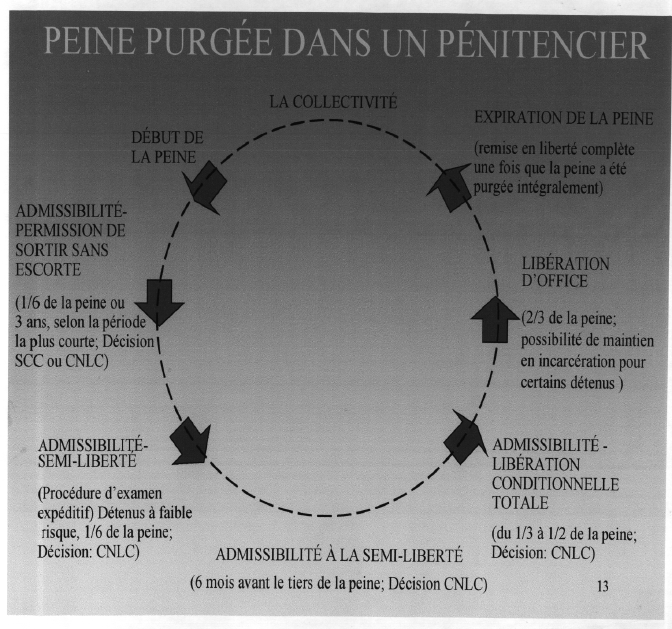 Permission de sortir : La permission de sortir, avec ou sans escorte, est habituellement le premier type de mise en liberté que peut obtenir Semi-liberté (SL) : La semi-liberté permet au délinquant de participer à des activités dans la collectivité afin de se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office. Le délinquant en semi-liberté doit retourner chaque soir à un établissement carcéral ou à un établissement de transition. Libération conditionnelle totale (LCT) : Elle permet au délinquant de purger le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. Libération d'office (LO) : Elle s'applique au détenu sous responsabilité fédérale qui a accompli les deux tiers de sa peine, à l'exception de ceux condamnés à perpétuité ou à une durée indéterminée. La progression théorique, si l'on prend l'exemple d'une condamnation à une peine de six ans est la suivante : 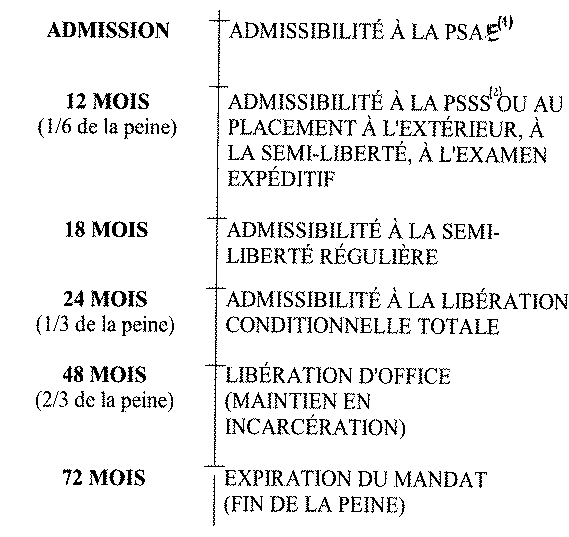 (1) Permission de sortie avec escorte (2) Permission de sortie sans escorte. Au total, la proportion de délinquants sous surveillance dans la communauté représentait 41 % du nombre total de délinquants, les 59 % restants étant incarcérés. ▪ un organe de décision indépendant : la commission nationale des libérations conditionnelles (C.N.L.C.) Les décisions relatives aux différents régimes de libération conditionnelle relèvent de la commission nationale des libérations conditionnelles, tribunal administratif placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. La commission est indépendante de l'administration pénitentiaire. Ses membres sont désignés par le conseil des ministres pour un mandat maximal de dix ans et sont inamovibles. Ils doivent être choisis « parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité. » La commission nationale des libérations conditionnelles a donc le pouvoir exclusif d'accorder ou de refuser, d'annuler ou de révoquer la libération conditionnelle et de maintenir en incarcération des délinquants concernés par la libération d'office lorsqu'il apparaît qu'ils sont susceptibles de commettre des infractions graves. 233 délinquants ont ainsi été maintenus en prison en 1998-1999. En cas de décision défavorable, le délinquant peut faire appel auprès de la section d'appel de la C.N.L.C. Le détenu bénéficiant d'une libération conditionnelle fait l'objet d'une surveillance consistant à le contrôler et à l'encadrer pour l'aider à se réinsérer. Le surveillant de liberté conditionnelle examine le dossier du délinquant, établit un calendrier de rencontres avec lui et lui donne des directives. Le surveillant peut entrer en contact avec la police et des services d'aide de la collectivité, et rendre visite à la famille du délinquant, à ses amis, à son employeur ou à d'autres personnes. Si le délinquant ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, il peut être réincarcéré. De fait, dans plus de la moitié des cas, la réincarcération des délinquants en liberté sous condition résulte non pas de la perpétration d'un nouveau crime, mais de la violation d'une condition. Le Canada s'est doté de moyens pour suivre et aider les délinquants non incarcérés. 71 bureaux de districts assurent leur surveillance. Il existe par ailleurs 175 centres résidentiels communautaires, administrés par des organismes privés qui fournissent un logement aux détenus en semi-liberté, en libération conditionnelle totale ou en libération d'office. Enfin, des centres correctionnels communautaires offrent des services de réhabilitation dans la communauté. D'une façon générale, la surveillance des délinquants en liberté sous condition relève du service correctionnel du Canada qui passe des contrats avec les gouvernements provinciaux, mais aussi des organismes non gouvernementaux comme l'Armée du Salut. ▪ les résultats obtenus Les tableaux ci-dessous donnent raison à Mme Renée Colette, première vice-présidente de la C.N.L.C., qui affirmait devant la délégation de la commission en visite au Canada « encadrer une personne de façon progressive avec la société, ça marche ! » 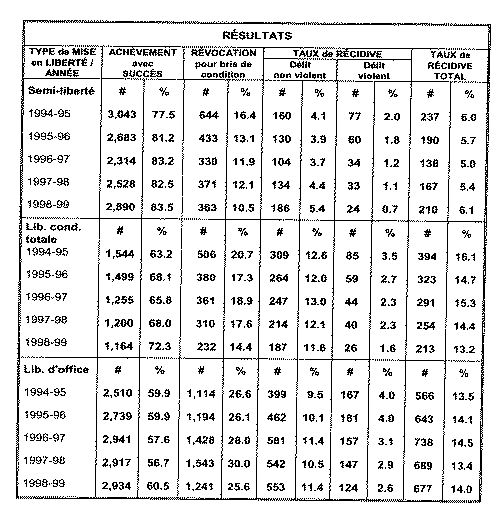 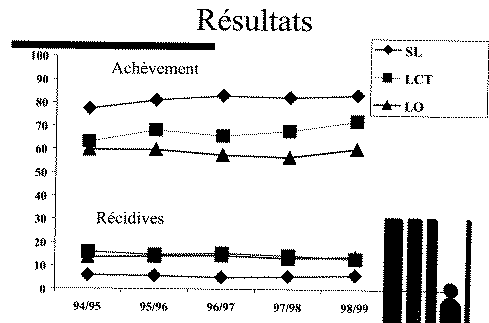 Madame Colette ajoutait : « Il est intéressant de se pencher sur la réussite à long terme. Des études ont porté sur les vingt ans qui ont suivi la libération conditionnelle. Il en ressort qu'une personne qui a pu profiter de la mise en liberté sous condition a un taux de réussite à long terme beaucoup plus élevé, de moitié supérieur, à celui qui n'a pas bénéficié d'une mise en liberté sous condition. » Elément supplémentaire à porter au crédit des libérations conditionnelles : le coût de la garde d'un délinquant dans la collectivité est très inférieur à celui qui existe en établissement. Coût annuel moyen pour la garde d'un délinquant
La libération conditionnelle a été introduite par une loi du 14 août 1885 ; elle est longtemps perçue comme un instrument d'apaisement de la détention et de gestion des capacités pénitentiaires. Les perspectives vont progressivement être modifiées par les lois de 1952 puis de 1972 qui axent la libération conditionnelle sur la capacité d'amendement du condamné, puis sur ses gages sérieux de réadaptation sociale. Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont énoncées par les articles 729 et 729-1 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 729, les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale et lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Les condamnés en état de récidive légale ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Quant aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ils peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'ils ont exécuté quinze années de détention. L'article 729-1 prévoit que, s'ils font preuve de bonne conduite, une réduction du temps d'épreuve de vingt jours ou d'un mois par année d'incarcération peut leur être accordée selon qu'ils se trouvent ou non en état de récidive. Les délais d'octroi peuvent se trouver prolongés par le jeu des périodes de sûreté fixées par l'article 132-23 du code pénal, qui interdisent, pendant leur durée, toute mesure d'aménagement de peine. La libération conditionnelle va cependant connaître un long dépérissement ; en 26 ans, le taux d'admission à la libération conditionnelle des condamnés relevant de la compétence des juges de l'application des peines est passé de 29,3 % en 1973 à 14 % en 1978 ; de même, en trente ans, le taux d'admission par rapport au nombre de dossiers relevant de la compétence du garde des sceaux a pratiquement diminué de moitié : de 1970 à 1999, ce taux est passé de 64,16 % à 30,5 %. Encore faut-il ajouter que seuls 9 à 10 % des détenus concernés, remplissant les conditions légales, ont été proposés par les juges de l'application des peines au garde des sceaux. Les causes de ce dépérissement ont été longuement exposées dans le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Daniel Farge : « la situation conjoncturelle n'a pas favorisé une procédure qui s'appuie sur le critère de gage sérieux de réadaptation sociale. L'évolution de la population pénale, caractérisée par l'accroissement des infractions sexuelles et l'incarcération croissante de cas relevant de la psychiatrie n'ont pas facilité la réactivation d'une procédure dans une société qui exige désormais un risque nul. » Les études menées par Annie Kensey et Pierre Tournier ont pourtant démontré les effets déterminants de la libération conditionnelle sur les taux de récidive. Ainsi, lorsque l'infraction initiale est un vol, catégorie qui présente le plus fort taux de nouveaux passages à l'acte, le taux de nouvelle infraction est de 75 % pour les condamnés qui ont été libérés en fin de peine et de 64,3 % pour les libérés conditionnels. Lorsque l'infraction initiale est un vol qualifié crime, le taux de nouvelle infraction est de 64,4 % pour les libérés en fin de peine contre 39,1 % pour les libérés conditionnels. Lorsque l'infraction initiale est qualifiée coups et blessures volontaires, le taux de nouvelle infraction est de 60,9 % pour les libérés en fin de peine et de 35,1 % pour les libérés conditionnels. L'adoption de la loi sur la présomption d'innocence a témoigné de la volonté unanime des parlementaires de réactiver la procédure de libération conditionnelle. Suivant les recommandations du rapport remis par M. Daniel Farge, les parlementaires ont décidé de retirer au garde des sceaux toute compétence en matière de libération conditionnelle : désormais, lorsque la peine privative de liberté prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou que la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines avec appel possible devant la chambre des appels correctionnels ; dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par une juridiction régionale de la libération conditionnelle, établie auprès de chaque cour d'appel et composée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour d'appel et de deux juges de l'application des peines ; les décisions de la juridiction régionale peuvent dans les dix jours faire l'objet d'un appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, composée du premier président de la cour de cassation ou d'un conseiller de la cour, de deux magistrats du siège de la cour, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. L'association des victimes, dans la décision d'octroi de la libération conditionnelle, apparaît tout à fait essentielle : la libération conditionnelle suppose en effet, non pas le pardon, mais l'apaisement de la douleur. La prise en compte du point de vue des victimes permettra également d'assortir la décision de libération conditionnelle d'un certain nombre de conditions probatoires susceptibles de mieux faire accepter la sortie de prison du délinquant par les victimes. Le dessaisissement du garde des sceaux constitue incontestablement une amélioration très notable de la procédure : - les délais d'examen des demandes, actuellement établis à cinq mois en moyenne et pouvant dépasser un an, vont être considérablement réduits. La longueur de la procédure constatée actuellement est très certainement un facteur de découragement pour les détenus qui hésitent à se lancer dans une démarche incertaine. - la décision d'une autorité politique dans l'exécution d'une peine prononcée par une autorité judiciaire n'était pas sans soulever des difficultés en termes d'équité du traitement. Le rapport de M. Daniel Farge fait le constat suivant : « La tentation est grande pour le garde des sceaux de méconnaître l'évolution favorable d'un condamné plutôt que de prendre le risque d'une libération anticipée qui ne serait pas comprise par l'opinion publique en cas de nouveau crime ou délit. » Une autre modification essentielle de la loi sur la présomption d'innocence a été de modifier les critères d'octroi de la libération conditionnelle ; les gages sérieux de réadaptation sociale, qui étaient l'unique critère d'appréciation retenu par la loi de 1972, ont été précisés de façon extensive par l'article 126 de la loi. Sont désormais éligibles à la libération conditionnelle, les détenus manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes. L'élargissement des critères d'octroi était en effet un impératif, tant les critères précédents de gages sérieux de réadaptation sociale semblaient restrictifs dans un contexte de crise économique et inadaptés à la réalité de la vie pénitentiaire. Il est encore trop tôt pour savoir si ces modifications législatives vont pouvoir susciter une véritable réactivation de la procédure de libération conditionnelle. Il faut pourtant être conscient qu'il s'agit d'une procédure absolument essentielle à la réinsertion. Elle peut être assortie de conditions draconiennes qui permettent de s'assurer de la conduite du détenu libéré ; elle instaure un sas de transition entre l'incarcération et la libération ; elle implique une démarche de responsabilisation du détenu qui crée ainsi les conditions favorables à sa réinsertion. La libération conditionnelle apparaît dès lors comme une réponse adéquate au traitement de la délinquance, à la condition que les moyens affectés au milieu ouvert soient suffisants. Il faut déplorer, à cet égard, que la loi sur la présomption d'innocence n'ait pas été l'occasion de réglementer les pratiques en matière de réduction de peine et de grâces collectives. Ces mesures accordées de façon quasi-automatique, sont à l'opposé du processus de responsabilisation impliqué par la libération conditionnelle. Les condamnés qui bénéficient de réductions de peine et de décrets de grâces collectives, renouvelés chaque année depuis 1991 et même maintenant bi-annuellement, ne perçoivent dès lors pas l'intérêt de se lancer dans une procédure lourde et qui se révélera contraignante. Ce point a été soulevé lors d'un échange entre le Président Laurent Fabius et M. Daniel Farge : M. Daniel Farge : « Il convient également de savoir - ce qui est très significatif, je crois, de l'état d'esprit qui règne actuellement dans les établissements pénitentiaires quant à la libération conditionnelle - que 20 % des détenus proposables ont refusé d'être proposés à la libération conditionnelle, ce qui est singulier. » M. le Président : « Pourquoi ? » M. Daniel Farge : « Parce que la libération conditionnelle est aujourd'hui considérée comme une sorte de faveur céleste. Elle s'apparente à une forme de grâce, au point que les gens n'y croient plus. En outre, le système des réductions de peine non individualisées est tel que les détenus, après avoir procédé à un calcul, préfèrent sortir totalement libres sans mesures de contrôle ni de surveillance. Il faut savoir que cette année certains détenus ont pu obtenir treize mois sur douze de réduction de peine. 95 % ou 98 % des détenus bénéficient, tous les ans, de trois mois de réduction pour bonne conduite. Les mesures exceptionnelles - deux mois de réduction - concernent en réalité 80 % des détenus. Il faut y ajouter deux mesures, dont sont exclus un certain nombre de condamnés, notamment les délinquants sexuels et les trafiquants de drogue : les grâces du 14 juillet qui vont de deux à quatre mois et celles de quatre mois qui ont été décidées à l'occasion de l'an 2000. Ces réductions de peine expliquent que le moment de la libération conditionnelle intervient beaucoup trop tard, beaucoup trop près de la date de sortie. » On comprend bien l'intérêt de ces mesures en termes de gestion de la population pénale dans le contexte de surencombrement des maisons d'arrêt. Il faut cependant être bien conscient que ces réductions de peine de caractère automatique viennent bien souvent bouleverser des projets de sortie qui étaient planifiés pour une date ultérieure. De plus, les dates de ces décrets de grâce collective, 14 juillet ou fin d'année, paraissent particulièrement inappropriées pour une préparation à la sortie réussie, d'autant plus que ce système conduit à des sorties massives au même moment. Il faut également être conscient, et les visites des établissements pour peine l'ont clairement montré, que, au-delà de la question de la récidive, la libération conditionnelle est essentielle à l'apaisement du climat en détention. Le refus d'octroi de libération conditionnelle depuis quasiment quatre ans a privé les détenus condamnés à de longues peines de tout motif d'espérance ; or les surveillants, les directeurs d'établissement ne peuvent pas gérer cette désespérance sur le long terme. Le découragement qui s'est installé crée les conditions d'une situation pour le moins explosive dans les établissements accueillant des condamnés à de longues peines. Il faut que les pouvoirs publics et les magistrats en soient conscients. L'opinion publique doit également être éclairée sur les conséquences qui seraient liées à une trop grande sévérité dans l'octroi des libérations conditionnelles. 2) Accueillir l'ancien délinquant dans le corps social Cette proposition rejoint la réflexion sur la place de la prison dans la cité et le regard de l'opinion publique sur le délinquant. Il ne peut y avoir réinsertion s'il y a une stigmatisation à perpétuité de l'ancien condamné. La réinsertion implique une démarche responsable du détenu libéré mais exige aussi un devoir de pardon de la part du corps social. C'est dans ce cadre-là que se pose la question de l'inscription des condamnations au casier judiciaire de l'ancien condamné. « Ensuite se pose le problème du casier judiciaire. L'administration de la République pourrait donner l'exemple en levant l'interdiction d'engager dans les administrations en qualité de fonctionnaires et à tous les postes administratifs des personnes inscrites au casier judiciaire. Si l'administration ne le fait pas, on ne peut attendre des entreprises qu'elles engagent des personnes dotées d'un casier judiciaire. [...] Sur le second point, je considère que si nous-mêmes, le service public étant la quintessence de la République, après nous être interposés entre une victime et un délinquant, après avoir arbitré leur différend de façon collective, après avoir trouvé au nom de tous, une modalité de réparation pour la victime et pour la personne, si alors nous ne pensons pas possible de faire entrer cette personne dans notre administration, nous sommes fous. Ou bien alors cela signifie que la réparation ne nous intéresse pas. » (M. Nicolas Frize, responsable de la commission prison de la ligue des droits de l'homme) Il faut effectivement réfléchir aux modalités d'effacement de l'inscription au casier judiciaire. La ministre de la Justice s'est en tout cas déclarée favorable à l'engagement d'une réflexion sur le thème : « En ce qui concerne le casier judiciaire, des procédures permettent aujourd'hui, y compris pour des personnes qui ont été condamnées à de longues peines - j'ai en tête le cas d'une personne qui a fait l'objet d'une libération conditionnelle à la suite d'une condamnation très grave - de demander par l'intermédiaire de l'avocat la radiation des condamnations du casier judiciaire. Peut-on assouplir ces procédures ? J'y serais assez favorable si c'était possible. Il faut voir dans quelles conditions. Voir quelqu'un qui a été libéré de prison, traîner son casier toute sa vie durant... Cela fait partie de la réinsertion que de faire en sorte de supprimer ce type de stigmatisation. » La réhabilitation au Canada : Le système pénal canadien prévoit une possibilité de réhabilitation pour tout condamné ayant purgé sa peine après un délai de trois ans pour un délit et de cinq ans pour un acte criminel. En 1998, 5 476 réhabilitations ont été accordées, 52 refusées. La réhabilitation consiste à sceller le casier judiciaire qui ne peut plus être révélé, notamment pour l'accès à la fonction publique fédérale. La réhabilitation n'efface pas la condamnation et est révoquée si son bénéficiaire est ultérieurement condamné pour un acte criminel. Les décisions de réhabilitation relèvent de la commission nationale des libérations conditionnelles. 3) Repenser le temps de l'incarcération Les risques de récidive sont étroitement liés à la manière dont auront été perçues par le détenu la durée de l'incarcération et sa responsabilisation face à l'acte commis. L'incarcération vécue comme un temps mort, une sanction arbitraire et mal comprise ne prépare pas la sortie dans des conditions favorables. Les actions d'insertion, sous la forme de travail pénal ou de formation professionnelle sont déterminantes ; longuement évoquées précédemment, il est inutile d'y revenir. Plus novatrices, les actions menées pour repenser la durée de l'incarcération méritent d'être développées. Le projet d'exécution des peines (PEP) mis en place en 1996 se veut une formalisation des étapes qui jalonnent le parcours pénitentiaire du condamné. Ce projet poursuit trois objectifs fondamentaux, qui sont d'impliquer le détenu dans le sens à donner à sa peine, d'améliorer l'individualisation administrative et judiciaire de la peine en proposant un cadre objectif, d'introduire un mode d'observation qui assure une meilleure connaissance du détenu pour accroître la sécurité des établissements et améliorer l'efficacité des actions visant à l'insertion. Il s'apparente donc au système canadien de plan correctionnel déjà évoqué. Dix sites pilotes ont été retenus : Mauzac, Tarascon, Joux-la-Ville, Loos, Moulins, Melun, Nantes, Muret, Toul et Ducos ; il s'agit à chaque fois de centres de détention, sauf Nantes et Ducos qui sont centres pénitentiaires. Dans le cadre du projet PEP, sont remplis des supports d'observation, sous forme de fiches, cahiers ou notes, renseignés par les surveillants. Ces supports font l'objet de synthèses par les personnels gradés ou le surveillant référent PEP, éventuellement aidé par un psychologue. La synthèse est intégrée au livret individuel du détenu mais n'a pas à être consultée ou communiquée au condamné. L'expérience menée dans les dix sites a démontré que le PEP favorisait la prise de conscience de leur responsabilité par les condamnés et se traduisait par un travail de réflexion sur la gravité des faits, une meilleure incitation aux soins et un accroissement des versements opérés au profit des parties civiles. Le PEP permettrait également un meilleur aménagement du temps de détention. Les parcours d'insertion sont mieux construits et les décisions d'orientation mieux préparées. Enfin, le PEP favoriserait une meilleure observation de la population pénale, plus objective et de meilleure qualité. Les personnels ont une plus grande connaissance des détenus. L'observation se fait dans la durée. La mise en _uvre du PEP a notamment amélioré la prévention des incidents. Il a permis également d'initier une dynamique de concertation entre surveillants. Les résultats tout à fait positifs dans les dix sites pilotes retenus plaident pour l'extension du système à l'ensemble des établissements pour peines. Néanmoins, là encore, la réussite du système bute devant l'indigence des moyens mis en _uvre. Au titre de la loi de finances pour 2000, c'est dix emplois qui ont ainsi été créés pour suivre l'expérience des PEP. La généralisation du projet d'exécution de la peine changerait pourtant radicalement la philosophie de l'incarcération, conçue comme une véritable démarche vers la sortie. L'exemple canadien est, à cet égard, une nouvelle fois probant. La réflexion sur la durée de l'incarcération doit également se pencher sur une conception dynamique de l'incarcération, définie en termes de paliers successifs, de plus en plus ouverts, jusqu'à la sortie finale. La mise en place des centres pour peines aménagées (CPA) parait être un début de réponse à cette logique de régime progressif ; les CPA implantés en centre ville, visent à améliorer la prise en charge des courtes et moyennes peines à moins d'un an de la libération. Tournés vers la réinsertion et un retour rapide des personnes en milieu libre, ces établissements offrent un régime basé sur un apprentissage progressif de l'autonomie et une responsabilisation des condamnés, afin d'élaborer un projet de sortie. Ces CPA sont caractérisés par une coopération entre travailleurs sociaux, partenaires extérieurs et équipes surveillantes ; ces dernières exercent une mission comparable à celle existant dans les quartiers mineurs, davantage tournée vers l'animation et le tutorat. La totalité du programme repose actuellement sur le réaménagement de deux établissements pénitentiaires classiques (Metz-Barrès et Les Baumettes) et la construction, dans un avenir plus ou moins proche, de dix centres. La progressivité des régimes d'incarcération était un élément essentiel de la réforme « Amor » initiée en 1945 ; l'objectif fut néanmoins abandonné à la suite des événements dramatiques vécus dans le milieu des années 70. L'apaisement du climat pénitentiaire plaide pour une réactivation de la réflexion sur le sujet. Seule la progressivité des régimes de détention, avec la construction d'établissements adéquats est à même de préparer des projets de sortie réussis et de réduire en conséquence les taux de récidive. C.─ INSTAURER LE NUMERUS CLAUSUS La proposition d'instaurer un numerus clausus fixant un nombre maximum de personnes incarcérées implique une révolution complète de la gestion de l'administration pénitentiaire ; il s'agit de ne plus considérer la capacité des établissements pénitentiaires comme infiniment adaptable et ajustable mais de l'imposer, au contraire, comme une constante invariable. Cette proposition n'a pas recueilli l'unanimité de la commission, le groupe RPR ayant fait connaître son opposition sur cette question. Il est vrai qu'elle exige ainsi un bouleversement de la pratique des magistrats, qui devront désormais intégrer, non plus uniquement les considérations sur le crime ou le délit, mais également les données sur les capacités pénitentiaires. Le taux d'incarcération est actuellement de 84,2 détenus pour 100 000 habitants (en métropole seule) ; il était en 1975 de 50 pour 100 000. Il faut s'interroger sur ce que signifient ces chiffres ; l'inflation carcérale est-elle la traduction de résultats probants en matière de lutte contre la criminalité ? les exemples étrangers démontrent si besoin était que toujours plus de prison ne dissuade pas le criminel : le taux d'incarcération constaté aux États-Unis, de l'ordre de 2 millions de détenus n'a pas ainsi contribué à juguler la violence de la société américaine (rappelons, comme repère, que le taux d'incarcération américain appliqué en France conduirait au chiffre de 400 000 détenus dans les prisons françaises) ; à l'inverse, la baisse sans précédent de la population pénale en Allemagne n'a pas eu pour conséquence une recrudescence de la criminalité. L'inflation carcérale ne doit plus être envisagée comme une fatalité qui répondrait à une exigence croissante de sécurité ; il faut faire savoir que cette logique exige toujours plus de crédits pour accroître les capacités d'accueil des établissements, sans que son efficacité soit réellement démontrée. Si chacun s'accorde pour dire que la surpopulation carcérale est insupportable, force est de constater la timidité des réflexions pour faire cesser cette dynamique sans fin. L'administration pénitentiaire se trouve ainsi contrainte de gérer les prisons par les effets des réductions de peine, des mesures de grâce ou d'amnistie. Cette régulation n'est pas satisfaisante dans la mesure où son automaticité nuit à l'individualisation de la peine ; les visites des établissements ont montré que les détenus considéraient désormais ces mesures comme un véritable dû. Cette pratique démontre de plus que l'on n'hésite pas à libérer, lorsque la pression carcérale s'en fait sentir, un nombre important de détenus sans que soient évaluées, à aucun moment, la personnalité du détenu et sa dangerosité (même si restent exclus des mesures de décrets de grâces les auteurs d'actes limitativement énumérés, tels que terrorisme, trafics de stupéfiants, crimes ou délits sur un mineur de moins de quinze ans). Un renversement de la logique s'impose : la gestion de la population pénale ne saurait se contenter de mesures ponctuelles, apportant un soulagement certes immédiat mais néanmoins temporaire. Il est nécessaire de raisonner en ayant une vision globale et prospective de la population pénale. Il faut avoir le courage de considérer que la capacité actuelle des établissements pénitentiaires constitue une limite indépassable s'imposant aux autorités judiciaires et pénitentiaires. Il reviendra aux magistrats la responsabilité de gérer cette limite en décidant d'incarcérer tel délinquant et, pour incarcérer ce délinquant, d'en libérer un autre. Beaucoup, parmi les personnes auditionnées par la commission d'enquête se sont déclarées favorables au numerus clausus ou ont du moins considéré qu'il s'agissait d'une piste de réflexion intéressante. Le premier président de la cour de cassation, Guy Canivet, répondait à la question du rapporteur sur le numerus clausus : « Peut-on introduire une nouvelle logique ? Je le crois. Il faudrait confronter localement les impératifs de gestion de l'administration pénitentiaire, les considérations d'ordre public, le niveau de la délinquance, les ressources en matière de peines de substitution et déterminer, en considération de l'ensemble de ces facteurs, les conditions pertinentes de la décision d'emprisonnement. C'est une approche qui n'existe pas mais qui mériterait d'être tentée. » Monsieur Gilbert Bonnemaison qui préconisait un tel système dans son rapport a renouvelé avec force cette proposition : « Je vous dirai en préambule ma conviction, forte hier, plus forte encore aujourd'hui, que vider les prisons de leur trop-plein et créer les moyens d'interdire la reproduction de celui-ci par le numerus clausus est le seul moyen de résoudre le problème des prisons. » La CFDT a également déclaré : « Notre fédération, depuis sa constitution en 1982, a essayé de mettre en exergue sa volonté de voir se réaliser le numerus clausus pour plusieurs raisons. En premier lieu, il s'agit de permettre une meilleure maîtrise des flux. » [...] [...] « En second lieu, si le numerus clausus est inscrit dans nos revendications, c'est parce que nous considérons que les magistrats doivent regarder véritablement la situation telle qu'elle est. » Monsieur Jean-Louis Daumas, directeur du centre de détention de Caen, énumérant ses réflexions sur la prison, a indiqué : « La première piste consiste à étudier toutes les voies législatives et réglementaires qui pourraient, dans ce pays, imposer enfin la règle du numerus clausus. » L'O.I.P. a également insisté sur l'intérêt du numerus clausus : « Le second élément d'une politique réductionniste tient dans le numerus clausus, c'est-à-dire une intolérance absolue au surencombrement des prisons. [...] « Pratiquée aux Pays-Bas ou en Finlande, la formule fonctionne très bien. En France, ce système présenterait beaucoup d'avantages dont celui d'instaurer une collaboration entre l'administration pénitentiaire et les magistrats qui, pour l'heure, travaillent séparément et s'ignorent superbement. » [...] « Dans le cas d'un numerus clausus, des clignotants préviennent lorsqu'on approche de la cote d'alerte d'occupation dans un établissement pénitentiaire. Dès lors, le directeur de la prison informe les magistrats du ressort qui sont ainsi incités à recourir à des dispositifs alternatifs à la détention, notamment au contrôle judiciaire, et qui sont invités à examiner toutes les situations en attente de décisions concernant les détenus incarcérés : les demandes de mise en liberté, les libérations conditionnelles, les détentions provisoires trop longues, etc. Les magistrats gardent la maîtrise de la mise en détention, mais les directeurs de prison sont en situation d'alerte et surtout de gérants responsables de leur établissement. Plusieurs directeurs de prison sont favorables à ce numerus clausus et tous les instruments de sa gestion existent. » Monsieur Robert Badinter a émis des réticences en considérant que le principe du numerus clausus irait à l'encontre de la liberté de juger. Il est indéniable que la solution préconisée va à l'encontre de la culture des magistrats, qui ne se sentent pas responsables de la surpopulation et peu concernés par le problème des capacités pénitentiaires. Le réflexe actuel dominant est encore, dans ce contexte, celui de la détention. Dans le système préconisé, chaque juge de la détention se verrait attribuer un nombre de places de prison dans son arrondissement ; il lui reviendrait alors de gérer ces places en fonction de l'état de ses enquêtes, du nombre d'affaires en cours, de leur évolution, en coopération directe avec l'administration pénitentiaire. Il est utile de rappeler que cette gestion de la population pénale n'est ni plus ni moins l'organisation évaluée et réfléchie d'une pratique fondée actuellement sur les grâces, les amnisties et les réductions de peine. Le bouleversement qu'implique un tel système est apprécié à sa juste valeur. Il faut néanmoins se persuader qu'en matière de procédure pénale, rien n'est inéluctable : la loi sur la présomption d'innocence a ainsi réussi à faire accepter l'idée qu'une détention provisoire ne pouvait durer indéfiniment en fonction de l'état d'avancement de l'instruction ; que les délais d'audiencement ne devaient plus non plus être l'obstacle toujours brandi pour justifier les délais de la détention, que l'encellulement individuel ne devait plus être un v_u pieux éternellement ressassé pour rester à l'état des bonnes intentions. Il faut, pour réussir cette réforme, une véritable volonté politique. Mme la garde des sceaux, lors de son audition par la commission d'enquête, a déclaré qu'elle n'était pas favorable au système : « Je ne pense pas que le numerus clausus, évoqué par Julien Dray, soit une solution. Il faut, à mon sens, avoir un programme suffisamment ambitieux mais cela demande des financements. J'en ai indiqué le chiffre : 13 milliards pour l'encellulement individuel des détenus que nous avons aujourd'hui, sachant que nous allons avoir une baisse mécanique de leur nombre grâce à la réforme de la détention provisoire. Je ne suis pas favorable au numerus clausus parce que je pense que cela pourrait générer des inégalités extrêmement fortes sur le territoire. Dans certains établissements, parce qu'il y aurait de la place, on mettrait les gens en prison. Puis, dans la région voisine, ce ne serait pas le cas parce qu'il n'y aurait pas de place ! Par ailleurs, cela pourrait générer des bizarreries dans la gestion des établissements. Enfin, j'estime qu'à partir du moment où la loi est votée par le parlement de la République et que des décisions judiciaires fixent un certain nombre de peines, aller à l'encontre, par une décision administrative, de la loi et de son application par les tribunaux, serait vraiment curieux. Je préfère donc que l'on s'y prenne autrement, mais nous poursuivons le même objectif : celui du sens et de l'individualisation de la peine et, bien entendu, lorsque les gens sont en prison, des conditions de détention dignes. » La réussite de cette réforme repose bien évidemment sur la conjonction de plusieurs facteurs : la diminution de la détention provisoire, le moindre recours à l'incarcération, avec des dispositions pénales adéquates, notamment pour les étrangers, les détenus dépendants, les cas psychiatriques ou les toxicomanes ; l'utilisation de tout l'éventail des mesures alternatives ; la construction d'établissements pénitentiaires permettant d'accueillir dignement les personnes incarcérées ; et surtout, la réforme de la carte pénitentiaire associée à une refonte de la carte judiciaire. Madame la garde des sceaux invoque les inégalités que le numerus clausus pourrait induire sur l'ensemble du territoire ; il ne faudrait pas effectivement qu'une telle réforme conduise à des disparités d'incarcération, selon que la région pénitentiaire dispose ou non de places. Il est donc indispensable de mener une réflexion sur la carte pénitentiaire afin que les régions pénitentiaires soient dotées des mêmes capacités d'accueil. Il paraît, de plus, curieux de repousser une réforme au motif des inégalités qu'elle serait susceptible de créer, quand on connaît les inégalités qui existent actuellement dans les conditions de détention. Il faut savoir entre deux maux choisir le moindre. Ajoutons qu'une telle réforme permettra de donner à la politique pénale une réelle visibilité en incitant les magistrats et les pouvoirs publics à définir des priorités dans la sanction des crimes et délits. Elle constituerait une puissante incitation à la mise en _uvre des réformes préconisées par ailleurs par le rapport. C'est donc par un appel à une véritable réflexion sur la réforme du système pénal actuel que se concluent ces cinq mois de commission d'enquête. La commission a été conduite, tout au long de ce rapport, à formuler un certain nombre de propositions, fruit des observations suscitées par les visites d'établissement et les auditions auxquelles elle a procédé qu'il convient ici de rappeler. Nécessité d'une loi pénitentiaire - Instaurer le débat sur la place de la prison dans la société ; définir le sens de la peine et énumérer les missions assignées à la prison - Définir les règles fondamentales du régime carcéral en encadrant précisément et strictement les atteintes aux libertés individuelles - Prévoir une programmation des moyens financiers nécessaires à l'application des réformes décidées - Inscrire dans une loi pénitentiaire les orientations spécifiques de la prise en charge des mineurs Etablissements pénitentiaires - Faire précéder la décision de construire de nouveaux établissements, et par-là des places supplémentaires de détention, d'une réflexion approfondie sur la place et la mission de la prison dans l'arsenal répressif, sans raisonner en fonction d'un seul calcul arithmétique basé sur le nombre actuel de détenus et de places disponibles. - Mobiliser de façon urgente les crédits nécessaires à la rénovation des cinq grandes maisons d'arrêt et au programme de réhabilitation du parc pénitentiaire - Préserver les implantations d'établissements existantes en ville - Privilégier les établissements de petite taille pour les constructions non encore engagées et porter une attention particulière aux localisations géographiques des nouveaux établissements - Associer les personnels pénitentiaires et les autres intervenants aux projets de construction des nouveaux établissements Administration et personnels pénitentiaires - Doter l'administration pénitentiaire des moyens humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions : équipes de direction, de surveillance, personnel administratifs et techniques ; réviser les organigrammes - Revoir le découpage des régions pénitentiaires et redéfinir le rôle des directions régionales pour leur confier une véritable mission d'animation, de conseil et de contrôle plutôt que de gestion - Responsabiliser les chefs d'établissements et les personnels autour d'un projet d'établissement et doter tous les établissements d'un mode de gestion autonome et de crédits affectés en fonction de ces projets - Redonner un support légal au dialogue social dans les établissements après la remise en cause des conseils d'établissements - Stabiliser les équipes d'encadrement afin de parvenir à une plus grande continuité dans la gestion de l'établissement - Créer une fonction de responsable des ressources humaines dans les établissements - Procéder à une réflexion sur le métier de surveillant et mettre en place de véritables plans de formation pour accompagner son évolution - Mettre en place des plans de formation continue des personnels dans chaque établissement et généraliser les équipes d'intérim pour rendre ces formations effectives - Recentrer, dans les établissements, la fonction des surveillants sur la détention en accroissant, en conséquence, les personnels administratifs et techniques - Faciliter les passages des personnels du milieu fermé vers le milieu ouvert où leur expérience professionnelle serait valorisée et mettre en place des passerelles vers d'autres administrations - Accroître la concertation au sein des équipes de surveillants pour l'observation des détenus - Développer les équipes pluridisciplinaires au sein des établissements et les échanges d'informations entre établissements - Augmenter le nombre de psychologues dans les directions régionales ; mettre en place des lieux d'accueil dans ces directions où les surveillants pourraient être écoutés, de façon anonyme Faire de la réinsertion une priorité - Remédier à la grave insuffisance des moyens des services d'insertion et de probation en travailleurs sociaux - Aller vers une véritable personnalisation de la peine plutôt qu'une gestion de la surpopulation pénale au moyen de grâces collectives et des réductions de peine accordées automatiquement ; réactiver à cet effet la procédure de libération conditionnelle - Revoir les règles applicables aux longues peines - Mettre en place, à l'image de l'expérience canadienne, une gestion du temps de l'incarcération en proposant des modules de formation au détenu - Généraliser à tous les établissements pour peine le projet d'exécution de la peine (PEP) - Instaurer une progressivité dans la détention avec des régimes de détention de plus en plus ouverts dans des établissements spécifiques, développer les centres pour peines aménagées afin d'aménager l'exécution des fins de peine - Revoir les règles relatives au casier judiciaire - Mettre en place de véritables outils d'évaluation des politiques menées et procéder aux études indispensables en matière de récidive Maîtrise des flux d'incarcération - Poser le principe d'un numerus clausus pour les incarcérations dans les maisons d'arrêt en développant la concertation avec les magistrats - Développer les alternatives à la détention, en les dotant des moyens nécessaires, pour restaurer leur crédibilité et renforcer la sécurité du milieu ouvert, condition pour que les magistrats y recourent - Revoir les critères de placement en détention provisoire en définissant plus strictement le critère de trouble à l'ordre public - Accélérer les procédures judiciaires pour limiter les durées des détentions provisoires - Mettre en _uvre le bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et à la condamnation - Privilégier les mesures alternatives pour les délinquants toxicomanes - Accélérer en les simplifiant les procédures d'affectation des détenus vers les établissements pour peines Vie en détention - Mettre en _uvre l'encellulement individuel - Réorganiser la journée de détention à l'occasion de la négociation sur les 35 heures et revoir les activités de la semaine et de l'année dans leur ensemble - Revoir le régime des prévenus et celui appliqué aux condamnés effectuant leur peine en maison d'arrêt (notamment l'accès au téléphone et les règles relatives aux autorisations de sortie) - Prendre en compte le vieillissement de la population pénale : aides soignantes pour les détenus dépendants, réexamen de la question des grâces médicales, possibilité de suspension de peine Développement du contrôle - Instaurer un suivi permanent des établissements pénitentiaires par une mission d'information interne à la commission des lois de l'Assemblée nationale. - Mise en place d'un contrôle externe permanent par la création d'une autorité indépendante dénommée délégation générale à la liberté individuelle - Développer les moyens octroyés à l'Inspection des services pénitentiaires ; formaliser les relations avec les autorités judiciaires et les autres inspections administratives - Restaurer les conditions d'un contrôle effectif des établissements pénitentiaires par les magistrats Discipline et isolement - Réaménager les quartiers disciplinaires et réviser le régime de détention (maintien des parloirs notamment) - Assister le détenu au prétoire ; réfléchir à une médiation impartiale ; dans le cas du choix d'un avocat, développer les procédures d'aide juridictionnelle - Limiter strictement par la loi les mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; réglementer dans cet objectif la procédure d'isolement - Mettre en place une procédure contentieuse d'urgence en cas de recours devant le tribunal administratif Santé - Mettre en place rapidement le schéma national d'hospitalisation et créer effectivement les unités hospitalières spécialisées afin d'améliorer l'hospitalisation des détenus et de régler notamment la question des escortes et des gardes statiques - Mener une réflexion sur l'appréciation de l'irresponsabilité et renforcer les moyens de la prise en charge psychiatrique - Créer des établissements spécialisés pour les détenus souffrant de troubles psychiatriques graves - Assurer une garde médicale de nuit dans tous les grands établissements Travail pénal et formation - Aller vers une application du droit du travail en prison - Généraliser les commissions de classement pour l'attribution du travail pénal - Revaloriser de façon significative les rémunérations du service général et supprimer la part retenue pour les frais d'entretien sur les rémunérations perçues au titre du travail en production - Promouvoir l'exercice d'activités qualifiantes et mettre en place des procédures de validation des acquis du travail effectué en détention - Garantir l'encadrement adéquat de l'activité de production par les entreprises concessionnaires - Développer les chantiers écoles Mineurs - Limiter au maximum leur incarcération au profit d'autres structures de prise en charge et de peines alternatives - Renforcer les structures spécifiques : centres de placement immédiat, centres d'éducation renforcée. - Accroître le nombre des heures d'enseignement dispensées et les obligations de formation pour les mineurs de plus de 16 ans Femmes - Aménager la carte des établissements pour peines accueillant des femmes - Permettre leur accès aux activités et au travail pénal comme les détenus hommes - Encourager la collaboration avec les services sociaux pour permettre l'accueil des enfants en détention avec leur mère dans des structures de garde collective Indigence - Généraliser les commissions d'indigence pour un meilleur repérage et un suivi - Fixer un critère financier uniforme - Permettre l'accès à la formation (en particulier aux actions de lutte contre l'illettrisme) pour les personnes en situation d'indigence en leur assurant une rémunération Familles - Créer des locaux d'accueil des familles là où il n'en existe pas, en particulier dans les établissements éloignés et procéder aux réfections nécessaires - Préserver les liens familiaux en aménageant les heures et les jours de parloir pour tenir compte notamment de l'éloignement de la famille et en réactivant les permissions de sortie ; mettre en place les unités de vie familiales pour les condamnés à de longues peines ne bénéficiant pas de permission de sortie - Améliorer l'information des familles sur la mise en détention et l'accueil en cas de suicide d'un de ses membres en prison La Commission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 27 juin 2000 et l'a adopté à l'unanimité. Elle a ensuite décidé qu'il serait remis à M. le Président de l'Assemblée nationale afin d'être imprimé et distribué, conformément aux dispositions de l'article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale. * * *
EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT Durant près de quatre mois, trente députés, membres de la commission d'enquête sur les prisons se sont rendus dans les cent quatre-vingt-sept établissements pénitentiaires français afin de juger sur place de la situation, tant des conditions de l'incarcération, que du fonctionnement de l'administration pénitentiaire. En parallèle et en complément, la commission a procédé à différentes auditions, qu'il s'agisse des représentants de l'administration, mais également des différents intervenants extérieurs. Devant une réalité carcérale méconnue et parfois rejetée, différents constats s'imposent immédiatement. Tout d'abord, il y a la réalité d'une surpopulation pénale, insupportable dans ses conséquences, des règles de vie indignes pour les détenus et des conditions de travail difficiles, voire dangereuses pour le personnel de surveillance. A cela, s'ajoute un cadre pénitentiaire disparate et inadapté, où coexistent des établissements anciens et vétustes, dégradés par manque d'entretien, et des établissements récents, parfois mal conçus, mais qui tous induisent de toute façon des coûts financiers extrêmement démesurés et des conditions de détention inégalitaires. Nous avons tous constaté l'hétérogénéité des établissements aux choix technologiques souvent contestables, aux règles de vie disparates et une forte mutation de la population pénale : délinquants sexuels, toxicomanes, détenus présentant des troubles psychiques et mineurs. Face à cette situation critique sur le plan matériel et sur le plan humain, le rapport de la commission constate que l'administration pénitentiaire, parent pauvre du ministère de la Justice, est désorientée. Son problème essentiel réside dans la pénurie récurrente des effectifs, à la fois dans sa globalité, mais naturellement et surtout pour les personnels de surveillance. Enfin, la carence du pouvoir judiciaire dans sa mission de contrôle des établissements, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de l'administration centrale à apporter des réponses adaptées et qui travaille avec des méthodes de fonctionnement dépassées, contribuent très largement à désorganiser le service pénitentiaire qui peut apparaître alors livré à lui-même. Il doit pourtant faire face, souvent sans formation adaptée et sans moyens, à une population carcérale ou très jeune, ou très âgée, composée de délinquants sexuels (plus du tiers des détenus), de toxicomanes, de détenus ayant des pathologies psychiatriques. La commission a particulièrement noté que, face au malaise des surveillants qui attendent légitimement la reconnaissance de la société, le cadre de gestion actuel était totalement inadapté. Devant un tel constat d'échec pour la politique carcérale, pour la gestion des moyens humains et matériels, le gouvernement de Lionel Jospin affirmait dès juin 1997 sa priorité budgétaire en faveur du ministère de la Justice. En 1998, le ministère, sous la conduite d'Elisabeth Guigou, se fixait quatre objectifs prioritaires : la réforme des conditions de la détention en amont (détention provisoire) et en aval (insertion, probation et libération conditionnelle), l'amélioration de la prise en charge des détenus, la prise en compte de l'évolution des missions des personnels, la mobilisation de moyens nouveaux pour moderniser l'institution (création de postes, plan de construction et de rénovation des établissements). Aujourd'hui, dans le monde carcéral, pour lequel le terme de l'exclusion n'est plus ignoré et qui vient de faire l'objet d'un large débat national également, la commission propose unanimement d'aller bien au-delà d'une simple amélioration des conditions de vie dans les prisons. Elle indique les orientations majeures d'une grande loi à venir afin de repenser la place et la mission de la prison dans la société, en améliorant notamment la prise en charge actuellement déficiente dans le domaine de l'insertion, des actions socio-éducatives, du travail en prison, des aides à la sortie, en amplifiant l'amélioration du suivi médical, en s'adaptant aux différents publics accueillis, sans oublier de tenir compte de la douleur des victimes, des familles des victimes qui pourraient être associées aux réflexions sur les modalités d'exécution des peines. En parallèle, il convient de faire de l'administration pénitentiaire qui remplit, nous l'avons constaté, une « mission impossible », une administration moderne tant dans son fonctionnement que dans ses méthodes de gestion des personnels (formation, revalorisation, notamment) et l'utilisation des moyens budgétaires. Ce bilan, certes sans concession, mais hélas fidèle à la triste réalité constatée, auquel aboutissent les travaux de cette commission d'enquête, doit permettre au gouvernement, non seulement d'apporter des réponses immédiates aux dysfonctionnements constatés, mais surtout, jette les bases d'une indispensable loi réformant la détention dans sa globalité, que la ministre de la Justice, garde des sceaux, a jugé nécessaire lors de son audition par la commission, le 8 juin dernier. La prise de conscience étant réalisée et les conditions d'un véritable changement réunies, le groupe Socialiste a approuvé ce rapport.
EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT Le constat des difficultés actuelles du système pénitentiaire en France est largement partagé. De nombreux établissements et notamment des maisons d'arrêt subissent une surpopulation extrêmement importante. Cette surpopulation entraîne des conditions de travail des personnels de surveillance extrêmement difficiles ; ces conditions sont aggravées par le fait que le nombre des personnels affectés correspond rarement aux effectifs théoriquement nécessaires ; de plus les surveillants nommés doivent combler les déficits très lourds en personnels administratifs et en personnels techniques. Enfin, les personnels en maladie longue durée ou en cours de promotion ne sont remplacés qu'après de longs mois de vacances de poste. Un grand nombre d'établissements sont inadaptés ou vétustes ; il est inadmissible de laisser fonctionner des établissements d'avant 1914 non-réhabilités qui sont complètement inadaptés aux conditions de détention actuelles. Cette situation rend les conditions de détention des détenus difficiles et peut expliquer certaines difficultés ou certains troubles dans un grand nombre d'établissements voire une partie des suicides. Il faut rendre hommage au programme « 15 000 places » lancé par Jacques Chirac et Albin Chalandon. Ce programme réduit à 13 000 a constitué un ballon d'oxygène indispensable pour le système pénitentiaire. La prise en charge médicale, régie comme dans tous les établissements par la loi Méhaignerie de 1994, y est d'ailleurs de bonne qualité. Enfin, les moyens consacrés à la réinsertion sont extrêmement insuffisants. La Commission d'enquête a effectué un travail considérable pour rassembler les différents éléments de ce constat. Les commissaires RPR ont largement participé à ce travail, l'approuvant très largement. De nombreuses propositions figurent dans le rapport, les commissaires RPR ont une opinion largement divergente sur plusieurs d'entre elles. En ce qui concerne l'aménagement des peines, nous défendons l'idée que l'écoute et la protection des victimes doivent être au centre de toute réflexion. Les parties civiles doivent pouvoir être entendues à tout moment. Nous souhaitons que soient privilégiées toutes les formes de sanction alternatives à la détention : réparation, travaux d'intérêt général, développement des centres de semi-liberté, bracelet électronique dont la mise en place a été fortement retardée par Elisabeth Guigou. Nous souhaitons également que l'objectif de la réinsertion des condamnés et de la non récidive soit au centre de la politique pénitentiaire. Nous refusons en conséquence cette idée d'un quota de places de prison disponible pour chaque juge ou chaque arrondissement. Un prévenu commettant un délit dans un secteur de forte délinquance, serait-il immédiatement libéré alors que le même acte commis à 50 kilomètres de là entraînerait l'incarcération ? Nous considérons enfin qu'une grande loi pénitentiaire devrait être présentée sans délai par le gouvernement, permettant de programmer sur cinq ans les moyens à mettre en _uvre pour remettre en état nos établissements pénitentiaires et les localiser correctement, ainsi que pour mettre en place les effectifs nécessaires tant au niveau de la détention que de la réinsertion. Enfin, nous constatons avec satisfaction qu'une unanimité semble se faire sur les mesures engagées par Jacques Toubon en 1996 ; il est dommage que le programme d'Unité à Encadrement Educatif Renforcé lancé par notre majorité ait subi et subisse encore tant de retard. En conclusion, nous sommes d'une opinion différente de celle du rapporteur sur un certain nombre de ses propositions. Mais, nous allons le redire très clairement, nous partageons le constat fait sur les dysfonctionnements de notre système pénitentiaire. Cet aspect des choses nous semble fondamental. Nous souhaitons que notre commission donne la force nécessaire à ce constat, pour que ce rapport ait des suites concrètes le plus rapidement possible. Voilà pourquoi le Groupe RPR votera ce rapport et souhaite qu'un accord unanime se fasse sur une telle ambition.
EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT La publication il y a quelques mois du livre du docteur Véronique Vasseur, ancien médecin chef de la Santé à Paris, a constitué un électrochoc, en attirant l'attention de l'opinion publique sur la situation souvent extrêmement difficile des prisons en France. Le groupe UDF a été le premier, à la suite de la publication de cet ouvrage, à saisir toute l'importance et l'urgence de cette question en demandant la constitution d'une commission d'enquête. Il a été sur ce point rejoint par l'ensemble des groupes de l'Assemblée. La commission d'enquête qui s'est mise en place sous la présidence de M. Laurent Fabius puis de M. Louis Mermaz a procédé depuis le mois de février à une série d'auditions au cours desquelles les parlementaires membres ont pu rencontrer et dialoguer avec les intervenants du milieu carcéral. Conscients par ailleurs de la nécessité de se rendre sur le terrain pour pleinement saisir la réalité du problème et des enjeux, les membres de la commission ont visité au cours des derniers mois la totalité des 187 prisons existantes en France. Enfin, ils ont souhaité connaître les expériences menées chez nos voisins et se sont donc rendus à l'étranger. Au terme de ce long et riche travail, les députés du groupe UDF partagent les orientations définies dans le rapport de la commission. Ils se félicitent tout particulièrement que le Parlement, en constituant une commission d'enquête, ait exercé sur ce sujet difficile toute l'étendue de son pouvoir de contrôle, inscrit dans la Constitution. Ils souhaitent que la publication de ce rapport permette à l'opinion de prendre conscience véritablement de la réalité de la prison et qu'elle aboutisse à l'ouverture d'un large débat public, indispensable. Ils veulent à cette occasion réaffirmer avec force un certain nombre de principes et d'objectifs qui doivent guider notre action future en direction des prisons et plus généralement du milieu carcéral. En effet, il ressort des nombreuses auditions et visites effectuées que ce qui est en jeu, au-delà de la nécessaire préoccupation des conditions du respect des droits de l'homme en prison, c'est le sens donné à la sanction, à la fois pour le détenu, pour le personnel, les victimes et la société tout entière. L'incarcération est une sanction se caractérisant par la privation de liberté. Elle répond à la nécessaire protection par l'Etat de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Elle est aussi une réponse pour les victimes et leurs familles. A partir de ce constat, il faut s'interroger sur la signification de la mission de la prison. Celle-ci permet d'écarter un individu de la société en l'isolant, mais cette privation de liberté est, dans la majorité des cas, temporaire. Il se pose alors nécessairement la question de la sortie de prison pour cet homme ou cette femme et donc de sa réinsertion. Cette réinsertion réussie constitue la meilleure des garanties pour assurer la sécurité des individus. C'est pourquoi, donner des moyens pour se réinsérer en prison, c'est aussi améliorer la protection de l'ordre public. Cette conviction, fruit de ce long travail de réflexion et de nos rencontres, nécessite de repenser en profondeur le sens et l'organisation de l'administration pénitentiaire car, en la matière, la France affiche un retard important. Elle amène notamment à s'interroger sur la longueur de la peine, particulièrement pour les mineurs et les jeunes adultes pour lesquels la question de la réinsertion se pose avec encore plus d'acuité. La prison ne doit ni accélérer l'exclusion, ni entretenir une spirale de la délinquance. En outre, elle conduit à souligner la nécessité d'établir, dans la perspective de cette sortie, un projet contractuel entre le détenu et l'administration pénitentiaire. En effet, derrière chaque détenu, il y a un homme et une femme, avec ses talents, ses difficultés, ses faiblesses. Les députés du groupe UDF ont été particulièrement impressionnés par l'exemple du Canada où un véritable contrat est établi au moment de l'incarcération, comprenant notamment un plan de formation au sens large, pouvant aller de l'apprentissage de la lecture à des études supérieures. Le personnel pénitentiaire joue un rôle essentiel dans ce projet d'exécution des peines. Les députés du groupe UDF souhaitent saluer le travail remarquable de ces personnes, qui exercent dans des conditions difficiles, une mission délicate. Leur rôle doit être repensé, car la multiplication des intervenants extérieurs les a parfois privés de leur mission essentielle de courroie de transmission entre les détenus et l'administration pénitentiaire. C'est pourquoi, il est indispensable qu'ils soient associés à toute réforme. En outre, ces personnels doivent pouvoir envisager une évolution de carrière, d'où la nécessité d'une formation continue, d'autant que le profil de la population carcérale évolue rapidement. Dans le cadre d'un tel contrat, il incombera aux parlementaires de réfléchir à la libération conditionnelle. Bien qu'accueillie avec réserve dans l'opinion publique, elle apparaît comme une des solutions à la fois en terme de réinsertion du détenu et également pour régler le problème de la surpopulation carcérale et des risques qui en découlent. Evidemment, elle doit être précisément encadrée et faire l'objet de tous les aménagements nécessaires. Le travail de la commission d'enquête a d'ailleurs souligné la nécessité de mettre en _uvre une étude approfondie sur la récidive, qui fait aujourd'hui défaut, et qui nous permettait d'envisager de façon sans doute plus sereine les enjeux de l'incarcération, et de la sortie de prison. Par ailleurs, la visite de plusieurs prisons a souligné la nécessité de réfléchir également à la spécialisation des établissements. En effet, certaines catégories de population, dont les malades psychotiques, n'ont pas leur place en prison, mais devraient être pris en charge dans des structures spécialisées, mieux à même de traiter leur cas. Le rôle du pénitentiaire n'est pas d'ordre sanitaire, mais judiciaire. Inversement, le système sanitaire doit trouver les voies et moyens propres à traiter et accueillir ces malades qui sont aussi des délinquants ou des criminels. Cependant, ces réformes concernant l'exécution des peines et la réinsertion du détenu ne pourront rentrer en _uvre que si on y associe étroitement les victimes et leur famille. Ceux-ci ne doivent pas être oubliés. Elles doivent pouvoir être informées de l'exécution de la peine si elles le souhaitent, et sans doute consultées dans la perspective d'une libération conditionnelle. C'est pourquoi le Groupe UDF a insisté sur la nécessité de mentionner cet enjeu essentiel dans le rapport. Enfin, la société doit également donner à l'individu qui a accompli sa peine la possibilité concrète de se réinsérer au regard des autres. Cette mise en place d'une réconciliation civile est indispensable car sinon nous ne pourrons pas aller vers une société de l'accueil des anciens détenus et c'est la récidive qui sera aggravée. On pourrait ainsi envisager l'effacement de la peine du casier judiciaire au bout d'un certain nombre d'années et en cas de non récidive. Au terme du rappel de ces principes fondamentaux, les députés du Groupe UDF pensent que plusieurs réformes sont à envisager. Tout d'abord, l'amélioration de la situation des établissements et des conditions de vie des détenus nécessite un véritable effort en matière de moyens affectés à l'administration pénitentiaire. Les députés du Groupe UDF sont favorables à l'adoption d'une loi de programmation pénitentiaire forte et immédiate. L'objectif d'une réinsertion réussie passe par une amélioration des conditions de vie en prison. Leur indécence, particulièrement dans les maisons d'arrêt pour ceux en détention provisoire (donc présumés innocents) a été à l'origine de la création de la commission d'enquête. La privation de liberté est la seule sanction légitime pour les détenus, et on ne doit pas y ajouter des conditions de détention particulièrement difficiles, sans parler du traumatisme de certains traitements dégradants. En la matière, les députés du Groupe UDF ont pu constater que la taille des établissements joue un rôle important sur les conditions de vie des détenus : il faut des établissements à taille humaine. Ces établissements doivent également disposer de davantage d'autonomie. Le système français se caractérise par une forte centralisation, d'où une lourdeur administrative, synonyme souvent de lenteur en matière d'investissement, de remplacement de postes... Les familles des détenus jouent également un rôle essentiel dans la manière dont l'incarcération est vécue, et donc dans la réinsertion. Les conditions de leur accueil sont encore trop inégales entre les différents établissements. Les députés du Groupe UDF sont favorables à l'expérimentation des unités de vie familiale, permettant au détenu d'accueillir et de partager des moments d'intimité avec sa famille. Enfin, il nous faudra dans un avenir proche régler la question de la surpopulation carcérale. Non seulement, certaines personnes sont incarcérées alors qu'elles devraient sans doute être dans des centres spécialisés (malades psychotiques), mais pour d'autres l'incarcération ne constitue sans doute pas la réponse la plus appropriée. Le rapport mentionne la mise en place d'un numerus clausus. En attendant de se prononcer sur le fond de cette proposition, il importe en tout état de cause de se donner les moyens de mettre véritablement en place une politique d'alternatives à l'incarcération. En effet, faute de moyens en personnel de contrôle, les tribunaux prononcent de moins en moins de peines de travail d'intérêt général ou de mise à l'épreuve. On constate pour la même raison une sous-utilisation des centres de semi-liberté. Quant aux bracelets électroniques, déjà en place dans plusieurs pays, on ne peut que déplorer les retards pris en France pour leur expérimentation. Pour toutes ces raisons et espérant qu'un large débat public s'engage sur tous ces enjeux et soit suivi de mesures effectives, les députés du Groupe UDF voteront les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les prisons. Ils souhaitent également que la commission des lois soit saisie sur ce sujet, et qu'un suivi précis soit effectué, notamment avec la publication d'un rapport dans un an faisant état des mesures concrètes prises pour le personnel, les établissements et les détenus.
EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT Ces derniers mois ont été l'occasion d'une prise de conscience sans précédent des dysfonctionnements du système pénitentiaire français. Les parlementaires ne pouvaient rester insensibles à l'émotion suscitée par les témoignages. C'est pourquoi le groupe Démocratie Libérale a été à l'initiative de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la situation des prisons françaises. Cependant, il ne faut pas se méprendre sur la signification de cette dernière. Sa démarche n'a pas été d'accuser mais de savoir, au-delà de toute considération de politique partisane. Elle n'a pas non plus entendu doubler l'inspection générale des services pénitentiaires. Sa mission était toute autre. Il ne s'agissait pas pour elle d'énumérer ou de faire le bilan d'éléments quantitatifs comme le nombre de prisons ou de détenus, ni de rentrer dans la querelle philosophique sans fin qui oppose sanction et réinsertion et qui ne représente qu'une caricature de débat. Si tel avait été le cas, nous aurions pris le risque de mettre en retrait le rôle de la sanction alors même que l'opinion a aujourd'hui besoin d'être rassurée. Par conséquent, tout au long de nos travaux, nous n'avons entendu être ni sécuritaires ni laxistes. Notre objectif était de faire comprendre que la prison entre dans un schéma différent. Elle ne représente qu'un élément de la sanction. La prison doit constituer une sanction intelligente dont on ne retire pas le caractère coercitif mais qui ne doit pas pour autant être facteur d'élimination. Les détenus ont, en effet, pour la plupart d'entre eux, vocation à se réinsérer et c'est la raison pour laquelle la peine de prison doit pouvoir être déclinée selon des modalités les plus diverses possibles dans l'application de la peine. Cette commission d'enquête a donné lieu à un rapport complet, bien construit et particulièrement enrichissant, auquel le groupe Démocratie Libérale souscrit, mais deux faiblesses apparaissent cependant qui auraient pu donner lieu à un approfondissement et une réflexion supplémentaire. La première concerne l'absence inacceptable des magistrats du milieu carcéral. Malgré les textes, ces derniers semblent totalement se désintéresser du sort des détenus. Une fois en prison, prétendre exercer un recours relève le plus souvent de la mission impossible, le monde carcéral étant presque totalement déjudiciarisé. Une fois le jugement prononcé, univers judiciaire et univers carcéral semblent étrangers l'un à l'autre, à l'exception peut-être du juge de l'application des peines, magistrat d'ailleurs insuffisamment valorisé. Une réforme profonde des relations entre magistrats et prisons est donc impérative. Il est du devoir des magistrats du parquet d'exercer un contrôle précis, régulier et quotidien sur l'évolution des détenus, de même qu'il est important que les juges d'instruction suivent individuellement ceux dont ils ont eu à s'occuper. Le cordon ombilical du système pénitentiaire doit être maintenu avec les juges et ne pas de limiter à un simple rattachement administratif auprès d'une direction du ministère de la Justice. La deuxième faiblesse concerne la partie relative aux mineurs. La France en est encore au stade où l'application de la peine aux mineurs relève d'expérimentations rares et coûteuses. La délinquance des mineurs est aujourd'hui un vrai sujet de société, un sujet à part entière auquel nous nous contentons de répondre par des expérimentations, par définition exceptionnelles. La France ne prend pas la mesure du problème grave qui se pose à elle. Le bon sens et la justice exigent que les mineurs ne soient pas traités comme les majeurs et de cette observation, simple, doit découler une conclusion toute aussi évidente : il est nécessaire de mettre en place un système spécifique aux mineurs, dans lequel insertion et enseignement seraient liés et obligatoires, sans refuser l'éloignement et la sévérité des sanctions. Il faut donc prendre à bras le corps le cas spécifique des mineurs et de ce que l'on appelle communément les mineurs majeurs, ce qui implique que la Chancellerie, l'Education nationale ou encore le ministère de la Jeunesse et des sports travaillent de concert pour mettre en place un système durable. C'est un système nouveau et une législation spéciale qu'il faut inventer. Le rôle de la prison tient donc, à la fois de la sanction et de la réinsertion. Or par ailleurs, compte tenu de la diversité des réalités vécues dans chaque établissement, la déconcentration de leur organisation et la possibilité pour chaque chef d'établissement d'appliquer une réglementation souple et individualisée est nécessaire. Outre ces remarques, la qualité du travail de la commission d'enquête mérite d'être saluée et le groupe Démocratie Libérale vote avec conviction le rapport auquel il aboutit. Mais il convient de ne pas s'arrêter là, une suite concrète doit lui être donnée, notamment sous la forme d'une grande loi pénitentiaire accompagnée de réels moyens financiers. L'examen d'une future loi sera l'occasion de mener un débat d'envergure, à la fois politique et pédagogique afin d'expliquer la place de la prison dans l'échelle des peines et son rôle de sanction. Ce rapport ne doit pas être, en effet, interprété comme un moyen pour les pouvoirs publics de se dérober à leurs responsabilités. Cette grande loi devra, par ailleurs, être fondée sur des moyens et ne pas négliger les victimes.
EXPLICATIONS DE VOTE DES COMMISSAIRES APPARTENANT En préalable, nous souhaitons dire l'appréciation très positive que nous portons à la démarche humaniste et réaliste, au travail sérieux et objectif de la commission sur un sujet délicat, qui renvoie à l'idée que chacun peut se faire de la justice et, au-delà, de la société et de son organisation. Les liens entre l'administration pénitentiaire et le politique sont nécessairement forts. Ce qui explique peut-être les résistances au changement que les députés communistes ont, pour leur part, longtemps déplorées dans les prisons. Après des décennies de silence, nous pouvons nous féliciter que les prisons sortent enfin de l'ombre. Sans tomber dans la facilité du « on ne savait pas », il faut noter cependant que les visites en milieu carcéral ont été un élément non négligeable quant à l'appréciation portée sur le travail de la commission d'enquête qui associe de manière cohérente, l'analyse sans complaisance de la situation et les propositions de changements radicaux. La situation actuelle des prisons françaises est des plus critiques : une surpopulation carcérale qui fait apparaître le poids écrasant des prévenus et des jeunes ; des conditions de détention et d'incarcération les plus diverses et souvent les plus mauvaises ; le non-respect de la dignité des détenus notamment l'hygiène, l'indigence et le travail pénitentiaire qui présente de graves lacunes en matière d'emploi, de formation professionnelle et de rémunération. D'autre part, chacun s'accordera à reconnaître que les personnels pénitentiaires ont une mission très difficile qu'ils exercent dans des conditions également très difficiles. Dans un système clos comme la prison, cette succession de carences en termes d'effectifs, de missions, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de rémunérations, ne peut qu'engendrer des conditions de vie néfastes pour les détenus. L'écart se creuse entre cette réalité et les objectifs déterminés et résolus que se fixe le gouvernement pour améliorer la vie en détention, favoriser les alternatives à la détention et rendre la prison transparente, au c_ur des préoccupations de nos concitoyens et des responsables. Le rapport formule des propositions positives qui traitent de la place et de la mission de la prison dans notre société, de l'identité de l'administration pénitentiaire et de sa nécessaire mission d'insertion qui doit être au c_ur de notre réflexion. Nous y sommes favorables. Cependant, les observations que souhaitent faire les députés communistes touchent au fond de notre mission. D'abord, la nécessité d'avoir une vision d'ensemble de la politique à mener sur des sujets aussi sensibles que les peines pénales et les alternatives à l'incarcération, la prison ou la délinquance es mineurs. Sachons garder à l'esprit les recommandations des organisations internationales qui affirment que la peine privative de liberté doit répondre à la réinsertion sociale que la société attend pour sa sécurité, en conciliant la nécessité de punir et la volonté de réintégrer socialement. N'y a-t-il pas lieu de s'engager vers les orientations du rapport Canivet qui stipule l'élaboration d'une « loi pénitentiaire » pour définir les missions de l'administration pénitentiaire en apportant une solution à l'opposition entre la sécurité et la réinsertion, les droits des détenus et les conditions générales de détention ? Ensuite, quand bien même l'effort financier engagé depuis trois ans traduit la volonté du gouvernement de réformer la politique pénitentiaire, reste que les crédits consacrés à ses services sont très en deçà des besoins. La plupart des établissements pénitentiaires sont vétustes, dégradés et fonctionnellement inadaptés. Le programme de rénovation engagé en 1998 sur l'ensemble du parc classique ne saurait suffire pour répondre aux situations de délabrement que nous avons constatées. Concernant la prise en compte de l'évolution des missions des personnels, il ressort que si des créations d'emplois et des mesures statutaires et indemnitaires ont été enregistrées ces dernières années, elles s'avèrent incomplètes, en particulier pour les effectifs et la formation professionnelle. D'autres engagements concernant la santé doivent être élaborés. Sous réserve de ces remarques, les commissaires communistes voteront ce rapport qui marque une avancée dans le sens souhaité par notre groupe.
CONTRIBUTION DE MME CHRISTINE BOUTIN La commission d'enquête fournit l'occasion de lancer et entretenir un débat dans l'opinion publique, et de porter un regard nouveau sur la prison et la sanction. 1. Constats En plus de la nécessaire préoccupation des responsables politiques (et au-delà des français eux-mêmes) relative aux conditions du respect des droits de l'homme dans l'univers carcéral, d'autres raisons existent et peuvent expliquer la raison d'être de la commission d'enquête et de son rapport. Premier constat : les dysfonctionnements de la prison sont les mêmes que ceux de la société « libre ». C'est pourquoi, en plus d'un ensemble de raisons réelles touchant à la dignité des personnes, il peut y avoir une utilité particulière à examiner ce cas limite. Deuxième constat : en ce sens, étudier les conditions de l'enfermement et de la détention des prisonniers, c'est s'intéresser par contrecoup à l'ensemble des relations sociales et à la façon dont nous voulons les vivre. Troisième constat : après les visites et les auditions de la Commission d'enquête on peut se rendre compte que ce qui est en jeu, c'est le SENS donné à la sanction : - par la société, - par les détenus, - par le personnel, - par les victimes - par la famille des détenus. Ainsi, la question qui nous est posée dans le cadre de la commission d'enquête est profondément celle du sens de la sanction et de l'enfermement, en plus des aménagements concrets qu'il faudra réaliser pour améliorer le quotidien des détenus. Pour donner à l'opinion publique quelque chance de débattre sur cette question et redonner du SENS à la prison, il faut : - réexaminer philosophiquement ce qu'est une sanction et ce que sont son rôle et son sens dans une société moderne, - réaffirmer les problèmes fondamentaux qui doivent soutenir la société, - faire quelques propositions simples et fortes. 2. Les axes fondamentaux Sanctionner par l'incarcération, c'est priver quelqu'un de sa liberté de mouvement. Ceci est une sanction suffisamment grave pour qu'on ne l'accompagne pas d'autres punitions qui viendraient s'y ajouter : impossibilité de la réinsertion, violence, conditions générales de détention avilissantes, etc. Il est important, et c'est peut-être même un des facteurs-clé de succès de toute réforme sur les prisons, que la puissance publique (institutions, médias, associations, responsables politiques, etc.) promeuvent cette manière de considérer l'incarcération, afin qu'elle soit finalement acceptée par l'ensemble du corps social. Dans le même ordre d'idées, il faut envisager l'incarcération comme un moyen ultime de punir une personne que l'on ne peut punir autrement, ceci afin : - de régler petit à petit la question de la surpopulation carcérale, - de ne pas mettre en contact les petits délinquants avec la mixité des établissements pénitentiaires; - de donner un sens social à la peine en recourant à des peines de substitution sous la forme de travaux d'intérêt général. Cela revient à dire que l'enfermement doit être considéré comme une peine possible parmi d'autres, et certainement pas comme la seule façon possible de sanctionner. La privation de liberté doit être considérée comme temporaire : elle l'est d'ailleurs dans l'immense majorité des cas. C'est pourquoi l'accomplissement de la sanction doit veiller premièrement à ce que le détenu soit mis en état de sortir correctement de la prison. Ceci nécessite de repenser totalement le sens et l'organisation de l'administration pénitentiaire. Tout détenu a des talents, un potentiel, des passions, même si l'histoire personnelle peut les avoir enfouis. Or il ne peut y avoir de véritable réinsertion qui ne s'appuie sur un projet personnel identifié et la maîtrise d'un certain nombre de moyens (notamment des compétences) pour le réaliser. Ce doit être le rôle de la prison que de permettre l'acquisition de ces moyens nécessaires. Un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les anciens détenus est la permanence de leur condamnation (même légère) sur leur casier judiciaire, très longtemps après que la peine a été purgée. Ceci est un frein authentique à la réinsertion, et donc, indirectement, une sorte d'incitation lointaine à la récidive. Il faut donc trouver tout moyen de mettre en place la réconciliation civique, au moyen de l'effacement des peines sur le casier judiciaire (les modalités sont à trouver). Le personnel pénitentiaire exerce une mission plus que délicate, qui doit être saluée dans des conditions de travail et psychologiques très difficiles. Il participe à la réalisation de l'état de droit dans notre pays. Pour toutes ces raisons, aucune évolution du système pénitentiaire ne peut être envisagée sans des aménagements de son statut, de sa formation et de ses moyens de travail. 3. Les principaux axes de proposition. La nécessité d'une volonté politique clairement affirmée : Nous l'avons vu, la question des prisons fournit à l'ensemble du corps social une occasion permanente d'interroger les principes les plus fondamentaux sur lesquels elle est assise, et notamment ceux qui guident sa conception de la justice. Ici, la réflexion sur les prisons et les conditions de détention et de réinsertion nous conduit à proposer trois axes forts d'une politique de réforme du monde carcéral, qui pourraient constituer d'ailleurs les axes majeurs de toute politique de la justice. Une société juste et vivant en sécurité : Il faut rappeler à titre de principe que le premier droit de tout citoyen est le droit à la sécurité. En conséquence, tout contrevenant doit être puni pour l'infraction qu'il a commise, de même que tout délit (même le plus petit) doit être sanctionné. Notre présent travail sur les prisons, les situations insupportables décrites par tel ou tel auteur à ce sujet, ont pu nous faire prendre conscience des conditions parfois infamantes dans lesquelles les prisonniers vivent : mais nous ne devons pas oublier que tout emprisonnement est - en principe - consécutif à un délit ou un crime, que sauf erreur judiciaire cet enfermement doit être au moins mérité, à défaut d'être justifié. La dignité de chaque personne, principe de l'organisation du monde pénitentiaire : Cependant, nous ne devons pas perdre de vue non plus que le droit à la sécurité ne s'applique pas qu'au-dehors des prisons, et qu'ainsi le devoir de la société d'assurer à chaque personne des conditions de vie sécures est également valable pour l'univers carcéral. Et au-delà de la seule sécurité, nous devons réaffirmer que les détenus ont des droits, hormis ceux de circuler librement et de décider de leur emploi du temps, qui leur sont retirés pour le temps de leur peine. Ici, le droit canadien, qui ne prive pas les détenus de leur droit de vote pendant qu'ils purgent leur peine, doit nous faire réfléchir. De même se posent dans ce cadre toutes les questions liées à la formation personnelle, aux relations des détenus avec leur famille, au droit de travailler dans des conditions décentes, au droit à un salaire, au droit à l'instruction, à la santé, etc. L'égalité des droits de toutes les personnes, et donc de tous les impétrants du monde pénitentiaire : Le travail sur l'aménagement des conditions de détention a trop souvent concentré les efforts (intellectuels et matériels) sur la seule relation du détenu avec l'administration pénitentiaire. Ces efforts sont bien entendu nécessaires. Mais d'autres personnes entrent en jeu dans ce que l'on pourrait appeler la « relation pénitentiaire ». Cette relation, en plus du détenu et de l'administration inclut également : - la famille du détenu, souvent très mal informée des conditions de détention et de l'évolution de la peine (sans compter les désagréments affectifs et sociaux qu'elle subit sans rien y pouvoir) ; - la ou les victimes, qu'il faut associer davantage à l'accomplissement de la peine ; - la société tout entière, qui s'interroge à bon droit sur la possibilité réelle de la réinsertion des détenus. C'est pourquoi il est impossible de réfléchir à une réforme pénitentiaire sans affirmer la présence de ces différentes personnes dans l'univers pénitentiaire. Des débats à poursuivre : Ces différents principes doivent conduire notre commission, et au-delà toute personne qui aurait pour projet d'entamer la nécessaire réforme de nos institutions pénitentiaires, à poursuivre son questionnement sur quatre problèmes centraux. Le premier est la question de la libération conditionnelle. Considérée et reconnue comme utile, notamment en vue de la réinsertion du détenu, elle est en même temps accueillie avec réserve par l'opinion qui y voit une sorte de « fleur » accordée à des personnes qui n'offrent pas toujours toutes les garanties de non-récidive, et donc d'insertion. L'on connaît les résultats obtenus par la troisième république qui a inventé cette disposition pénale. Il faut se souvenir que dans le même temps, elle prenait toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que le détenu libéré conditionnellement ne récidiverait pas, et elle disposait également, avec le système de la relégation, d'un instrument très adapté pour signifier l'impossibilité de la réinsertion. Aujourd'hui, la libération conditionnelle peut être précisément et efficacement encadrée. Elle peut permettre d'accomplir ce à quoi sert la prison : l'amendement personnel et la réinsertion normale dans un corps social qui considère que les dettes sont payées. Elle doit faire l'objet de tous les aménagements nécessaires, de même que d'une communication spécifique pour en faire comprendre le sens à l'opinion publique. Le deuxième est la question du numerus clausus. Il ne semble pas opportun aujourd'hui de construire de nouvelles places de prison ni de nouveaux établissements. En effet, la surpopulation carcérale est principalement due à la présence dans les maisons d'arrêt, de personnes qui n'ont rien à y faire : - soit parce qu'elles ne sont pas coupables (n'ayant pas encore été jugées) : c'est la détention préventive ; - soit parce que le délit commis ne justifie pas une incarcération et pourrait être réparé par des peines de substitution. C'est pourquoi il est nécessaire, sans doute davantage pour des raisons d'ordre pratique que pour des raisons d'ordre de principe juridique, d'inscrire dans la loi un numerus clausus de places en cellules, à ne pas dépasser. Aujourd'hui, cela semble être le seul moyen de remédier à l'incarcération systématique en contraignant l'administration à recourir à d'autres moyens. Le troisième et la question de la réconciliation civile, déjà évoquée, et maintes fois présentée à la presse ces derniers temps. L'instauration d'une telle disposition dans notre droit marquerait d'une manière forte que notre système pénitentiaire fonctionne sur les convictions suivantes : - tout détenu est amendable, et donc réinsérable ; - le corps social doit marquer cet état de fait par la loi ; - toutes les conditions doivent être réunies pour éviter la récidive. La quatrième est la question de la réclusion à perpétuité. Si l'on peut à bon droit se réjouir de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la question reste en revanche posée du traitement des crimes d'une exceptionnelle gravité qui conduisent les cours à prononcer des peines de réclusion perpétuelle. D'un côté en effet, la gravité de ces fautes conduit le corps social à souhaiter se mettre définitivement à l'abri de ses auteurs. Mais d'un autre côté, la réclusion perpétuelle conduit presque nécessairement à une forme certaine de désespérance des détenus, qui ne peut être prise en charge ni soignée par l'administration pénitentiaire. De sorte que la question est ouvertement posée : comment faut-il appliquer la réclusion perpétuelle, en rassurant le corps social tout en ne détruisant pas des détenus qui souhaitent réellement s'amender ? Propositions concernant les détenus Préalablement à toute proposition concernant les détenus, il faut examiner la détention sous deux angles : les conditions de vie et les conditions de la sortie. Les conditions de vie : l'indécence des conditions de détention est le premier fondement légitime de notre indignation, et sans doute la raison pour laquelle le Parlement a entamé une réflexion sur le sujet des prisons. Ces conditions sont aujourd'hui (sinon partout du moins dans de nombreux endroits) tout simplement indignes. Tout doit être fait pour que les prisonniers vivent décemment, et ne pas ajouter à la légitime privation de liberté l'illégitimité absolue d'un traitement que certains hommes refuseraient de faire subir à des animaux. La préparation de la sortie : la mise en place des conditions d'une sortie réussie fait également partie de la vie de la prison, de sorte que l'on peut dire que la préparation de la réinsertion est une de ses missions. Ici, il pourrait être utile de s'inspirer de l'exemple canadien, dans lequel chaque nouveau détenu bâtit avec l'administration pénitentiaire un plan de formation personnel destiné à lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences et faciliter ainsi sa réinsertion (définition d'un « plan correctionnel de formation », conformément à l'exemple canadien). Des propositions concernant les détenus doivent être fondées sur l'affirmation de principes forts : - l'objectif que poursuit l'administration pénitentiaire est « un prisonnier par cellule » ; - la priorité de l'administration pénitentiaire est la décence des conditions de vie des détenus. - de même que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'un tribunal en ait décidé autrement, de même tout détenu est présumé amendable ; - la prison est d'abord un lieu d'où l'on sort (sauf perpétuité : voir par ailleurs) : c'est pourquoi il est dans le rôle de la prison de préparer la sortie des détenus ; - un détenu est souvent membre d'une famille : les relations avec celle-ci doivent être maintenues à tout prix, afin de faciliter le retour à la vie sociale. En plus des propositions contenues dans le projet de rapport de la commission, il semble utile de réfléchir aux dispositions suivantes : - renouer avec une gestion au cas par cas de la remise de peine, et lui ôter définitivement tout caractère systématique ; - renforcer le recours à la libération conditionnelle et aux peines de substitution : l'enfermement carcéral doit être le dernier recours ; - spécialiser des établissements dans l'accueil des prisonniers âgés ou psychologiquement malades : le rôle de la pénitentiaire n'est pas d'ordre sanitaire, il est d'ordre judiciaire ; - mettre en place un médiateur agréé par l'administration pénitentiaire pour les commissions de discipline plutôt qu'un avocat ; - assurer un revenu minimum décent pour ceux qui souhaitent se réinsérer par le travail ou par la formation ; - mettre en place des unités de vie pour permettre aux détenus purgeant de longues peines d'entretenir des relations avec leur famille. Propositions concernant le personnel de l'administration pénitentiaire Parent pauvre de la fonction publique du point de vue de l'image, la pénitentiaire est aujourd'hui (en dépit de la double importance matérielle et symbolique de sa mission) traversée par une importante crise de sens et donc de motivation. Il n'est pas nécessaire d'entamer de grandes réformes de structures pour mettre les personnels un peu plus à l'aise. Une clarification des rôles et des missions de cette administration, est nécessaire, de même que tous moyens de valorisation de la mission de cette administration, dont le personnel (en dépit de quelques très malheureux exemples) est de qualité. On pourrait par exemple : - créer un secrétariat d'Etat à la condition pénitentiaire, rattaché au ministre de la Justice ; - créer un service d'évaluation des politiques pénitentiaires, notamment les décisions prises en termes de plans de formation des détenus ; - rendre obligatoire un stage dans un établissement pénitentiaire pour chaque élève sorti de l'ENA ou des grandes écoles ; - assurer davantage de mobilité des postes et des fonctions au cours d'une carrière dans cette administration. Propositions concernant le corps social Celles-ci concernent d'abord la justice, qui se doit de respecter tout autant le besoin de sanction porté par les victimes que les besoins de clarté portés par les prévenus. Elle doit donc agir vite, de manière transparente, et équitable. Cette exigence est un principe social constant, certes, mais le rappeler ici n'est pas inutile : les dysfonctionnements du système judiciaire (notamment la longueur des procédures et donc le recours à de longues périodes de détention préventive) ont des répercussions très concrètes sur la vie du système carcéral. Elles concernent ensuite les victimes. Il est normal que des victimes puissent avoir accès aux informations concernant le déroulement de la peine du condamné, tout particulièrement si l'on s'achemine vers la mise en place de la réconciliation civile. Quel meilleur moyen en effet de mettre en place les circonstances dans lesquelles la réconciliation est possible, y compris la plus difficile, c'est-à-dire celle qui rapproche la victime et le criminel ? Comment aboutir à cela si le lien qui peut unir ces deux personnes n'est pas maintenu ? Il ne s'agirait pas de rendre mécanique cette information des familles, mais bien de permettre leur accès aux victimes qui souhaiteraient la réconciliation, et de tout faire pour généraliser ce genre de procédure. Il est également respectueux à l'égard des victimes de faire en sorte que tout acte délictueux soit effectivement puni. Conclusion : que faire ? Trois axes de travail législatif concernant les prisons peuvent être suivis. Le premier concerne une loi de programmation pénitentiaire, prenant en charge : - la formation et les évolutions des personnels ; - un plan d'investissement pour la remise à niveau des équipements. Le deuxième concerne la mise en place de la réconciliation civile, sans laquelle nous ne pourrons pas aller vers une société de l'accueil des anciens détenus : nous prendrions alors le risque de la systématisation de la récidive, avec tous les coûts humains et sociaux que cela entraîne. L'organisation de la pénitentiaire, en général, est fondée sur la méfiance. Il faut la reconstruire sur la confiance. Le troisième concerne un ensemble de mesures diverses et d'ordre juridique à prendre pour améliorer chacun des différents plans décrits ci-dessus. A titre d'exemple : - le plan de réinsertion pour tous les prisonniers qui le souhaitent ; - la suppression formelle du caractère systématique de la remise de peine ; - la mise en place du médiateur ministériel qui assiste aux commissions de discipline ; - etc. A cette dimension législative du travail s'ajoute une dimension de débat : sur certains sujets, la réflexion est loin d'être aboutie : notamment sur la question de la réclusion à perpétuité. Il serait plus qu'utile que les pouvoirs publics organisent des échanges sur ces questions. Tout ceci résultera d'une volonté politique affirmée qui aidera, par cette volonté, l'opinion publique à évoluer.
CONTRIBUTION DE M. MICHEL MEYLAN La réalité carcérale est complexe. Une réforme, pour être efficace, doit intégrer la recherche de solutions pour répondre équitablement tant aux attentes des détenus qu'à celles des surveillants. 1- Plus de moyens pour réhabiliter le parc existant et construire de nouvelles unités mieux adaptées En premier lieu, les solutions sont à rechercher dans le cadre d'une réévaluation des budgets qui permettrait une salutaire réhabilitation du parc pénitentiaire. Comme l'ensemble des secteurs de la justice, la pénitentiaire souffre en effet d'une pénurie de crédits qui hypothèque son bon fonctionnement (à noter que le bon fonctionnement de la pénitentiaire est indissociable de celui de la justice en elle-même impliquant donc un accroissement du nombre de magistrats de manière à rendre des jugements plus rapides et ainsi limiter la détention provisoire). Le déblocage de crédits nouveaux devrait permettre par ailleurs de construire de nouvelles unités à taille plus humaine dont l'aptitude à limiter les dysfonctionnements serait plus importante, l'expérience des prisons 13 000 n'apparaissant pas satisfaisante (nombre de détenus trop important pour établir une relation constructive entre les détenus et les surveillants, établissements impersonnels). 2- Impulser une réflexion sur le rôle de la prison et des surveillants Il importe parallèlement de réfléchir au rôle de la prison et ainsi au rôle des agents de l'administration pénitentiaire : s'agit-il pour eux de répondre à une fonction de surveillance ou d'assumer une mission de réinsertion ? Les moyens à mettre en _uvre sont différents et doivent dans le deuxième cas impliquer des moyens financiers comme des moyens en terme de formation. Compte tenu de la diversité des réalités vécues dans chaque établissement, il serait opportun de laisser à chaque chef d'établissement, sous le contrôle de la direction régionale, la latitude d'appliquer une réglementation adaptée à sa situation propre. Un carcan de réglementation national aurait toutes les chances de ne pas correspondre aux impératifs de chaque unité dans ses spécificités et ainsi ne pas être appliqué. (On ne gère pas de la même manière un établissement où les détenus peuvent travailler et un où ils n'ont pas cette possibilité, un établissement où séjournent des mineurs issus de banlieues turbulentes...). Il importerait aussi de responsabiliser les chefs d'établissement autour de leur projet d'établissement en subordonnant leur avancement à sa bonne exécution et à son adéquation aux besoins. 3- Quel avenir pour les mineurs incarcérés et certains publics sensibles ? La situation des mineurs est préoccupante. Ils arrivent en détention avec un passé qui est surtout un passif et les perspectives d'améliorer leur comportement sont minces. Un suivi à leur sortie de prison serait nécessaire. Tous les acteurs sociaux rencontrés seraient d'accord pour assurer cette prise en charge. A noter qu'il est surprenant de constater qu'il y a un réel manque de liaison entre les magistrats et les détenus purgeant leur peine. Les détenus relevant de la psychiatrie devraient pouvoir trouver une réponse mieux adaptée à leur pathologie dans des établissements spécialisés. Les toxicomanes devraient, à un degré moindre, pouvoir bénéficier aussi de traitements mieux adaptés et qui ne soient pas simplement la prescription de traitements de substitution. 4- Revoir la problématique de la « peine de prison » Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que l'incarcération est une sanction d'un comportement à un moment donné. S'il est, dès lors, bien évident que les conditions d'incarcération doivent respecter des conditions d'hygiène, d'espace vital... suffisantes, il serait intéressant de réfléchir à l'opportunité de peines plus courtes dans un milieu carcéral relativement rudimentaire, la prison telle qu'elle existe aujourd'hui n'ayant pas la fonction repoussoir qu'on pourrait en attendre. Si les détenus doivent voir leurs droits élémentaires respectés, ils doivent pour autant garder un certain nombre de devoirs (respect d'eux-mêmes et des autres, de leur cellule...) et une discipline de vie compatible avec les exigences de la vie extérieure (obligation de réveil, de travail ou de formation et non la télévision en continu) qui doit être inscrite dans les règlements intérieurs des établissements et mis en pratique. L'inutilité pédagogique des peines de sursis est patente. A l'inverse, des peines aménagées favorisent la réinsertion des détenus. Dans le même temps, il faudrait étudier les perspectives à offrir aux longues peines. En tout état de cause, nous devons éviter de considérer que la prison pourra résoudre en bout de chaîne les difficultés de personnes fréquemment dépourvues de repères, et auxquelles le système de prise en charge sociale extérieur n'a pu apporter de solution. 5- Revaloriser l'administration pénitentiaire Enfin, les personnels méritent qu'on leur accorde une attention toute particulière et qu'on s'efforce de répondre aux besoins de reconnaissance auxquels ils aspirent. Cette reconnaissance passe par une revalorisation des traitements et par un travail de réhabilitation de la fonction de « surveillant de prison » pour lequel prévaut encore une imagerie collective négative. Des transferts de compétence pourraient utilement être opérés en leur faveur au terme de formations adéquates (encadrement des travaux d'intérêt général, suivi de la réinsertion des détenus...). Des passerelles vers la police et la gendarmerie pourraient aussi être mises en place de manière à favoriser une évolution de carrière plus enrichissante. Le remplacement des personnels partis en retraite (à la faveur de la bonification du cinquième notamment), ou en congé parental... devrait par ailleurs pouvoir se faire en temps et en heure, sans qu'il soit nécessaire d'en passer par des situations transitoires (qui s'éternisent) où la pénurie de personnel de base comme d'encadrement altère les conditions de travail des personnels restant. Dans la gendarmerie, grand corps de l'Etat, on sait bien à l'avance quand quelqu'un prend ses fonctions, quand il quitte son poste et qui le remplace. L'administration pénitentiaire doit bénéficier de cette capacité de planification et obtenir les moyens humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions. On peut constater, concernant la fonction de chef d'établissement (cadre B), que les hommes issus du rang ont une meilleure perception de la fonction, un meilleur contact avec les surveillants et avec les détenus et mériteraient de ce fait une revalorisation de leur statut par rapport aux directeurs (cadres A). Par ailleurs, il apparaît qu'une meilleure collaboration avec les collectivités locales (communes, conseils généraux) permettrait d'améliorer le travail des établissements (ex : le personnel social, culturel, technique de ces collectivités pourrait parfois compléter le travail de l'administration pénitentiaire). 2521 -Rapport de M. Jacques Floch sur la situation dans les prisons francaises : tome I (rapport) 1 Les établissements de Papeete, Nouméa et Wallis ont été visités en février 1994. Ceux de Mayotte et de la Réunion en septembre 1999. 2 Villefranche-sur-Saône : maison d'arrêt mise en service en 1990 pour désengorger les prisons de Lyon () CP de Laon, MC d'Arles, CP de St Quentin Fallavier, CP de Châteauroux. () Les communes volontaires pour l'implantation d'un établissement 13 000 sur leur territoire devaient céder gratuitement à l'administration des terrains viabilisés. () Coût final de la place : 337 000 F (Rapport de la Cour des comptes - 1994). () Fleury-Merogis, Fresnes, La Santé, Les Baumettes, Loos. () Enquête sur la santé des entrants en prison, 1997. 8 La gestion de la santé dans les établissements du programme 13 000. Pierre Pradier 9 Les ordonnances de non-lieu antérieures à 1984 ne distinguent pas celles ayant pour fondement l'irresponsabilité. Jusqu'en 1987, les statistiques ne portent que sur les affaires nouvelles. Les chiffres 1998 et 1999 ne sont pas publiés. 10 Service médico-psychologique régional. 11 « Les établissements psychiatriques ont humanisé leurs services, les ont ouverts. Ils ont un personnel souvent moindre qu'il y a quelques années. Ils ont fermé un nombre de lits assez important. Ils ne souhaitent pas fermer un pavillon de vingt-cinq places pour un détenu. Je rappelle qu'en psychiatrie, il n'y a pas de garde statique de policiers, contrairement aux services de médecine, chirurgie et obstétrique. Par conséquent, les membres de l'équipe de psychiatrie ont la charge non seulement des soins du patient, mais également de sa sécurité, ce qui les fait un peu réfléchir. Ils ont peur des conséquences. Ils se sentent investis d'une mission qu'ils ne peuvent pas remplir, ce qui les met dans une situation très délicate. » 12 Interdiction de la mise en détention provisoire de mineurs de moins de 16 ans en matière correctionnelle ; limitation de la durée de la détention provisoire en correctionnelle pour les mineurs de 16 à 18 ans. 14 Les fiches, plus ou moins à jour, précisent le type d'établissement, la date de mise en service, la capacité d'accueil, les autorités de rattachement, l'identité du chef d'établissement, les effectifs des personnels et récapitulent les créations d'emploi. 15 Il ressort de cette étude que 49,7 % des libérés ont une nouvelle condamnation inscrite au casier judiciaire dans les quatre ans. 27,9 % ont une nouvelle affaire sanctionnée par une peine d'emprisonnement ferme. Enfin, pour 5,3 % la nouvelle affaire est sanctionnée par une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ou plus. 16 Services pénitentiaires d'insertion et de probation. 17 Emmanuel Kant, 1724-1804, philosophe allemand. 18 Charles-Alexis de Tocqueville, 1805-1859, historien et magistrat français. 19 Charles Lucas, criminologue français, animateur de l'Ecole pénitentiaire. 20 Emile Durkheim, 1858-1917, fondateur de l'école de sociologie française. 21 Rapport travail et prison. M. Jean Talandier au nom du conseil économique et social. 8 et 9 décembre 1987 () Réponses au questionnaire adressé aux établissements pénitentiaires. () Ce service a pour mission de développer le travail de détenus, principalement dans les établissements pour peine où la demande de travail ne peut être satisfaite uniquement par le secteur de la concession. () L'évaluation de la durée du travail pour certaines tâches comme l'entretien est difficile car elle peut-être constituée d'interventions ponctuelles. () La journée de travail en atelier est plus courte qu'à l'extérieur. () Avis Travail et emploi précité () L'allocation d'insertion d'un montant de l'ordre de 1 800 francs est accordée, pour un an, aux détenus libérés qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi, à l'exclusion de ceux ayant été condamnés pour certains délits comme le trafic de stupéfiants. () Enquête administration pénitentiaire sur les sortants de prison. 1997. 29 Enquête « un jour donné ». Direction générale de la santé. () J. Combessie, M. Gheorghiu et S. Bouhedja - Pour une sociologie des pauvretés en prison, EHESS, 1993. () Rapport du groupe de travail sur l'amélioration des conditions de repérage et de prise en charge des personnes en situation d'indigence. Février 2000. 33 Mmes Yvette BENAYOUN-NAKACHE, Frédérique BREDIN, Nicole BRICQ, MM. Jean-Yves CAULLET, Jacky DARNE, Julien DRAY, Mme Nicole FEIDT, M. Jacques FLOCH, Mme Conchita LACUEY, MM. Bruno LE ROUX, François LONCLE, Louis MERMAZ, André VALLINI. 34 Mme Martine AURILLAC, MM. Alain COUSIN, Michel HUNAULT, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Marc NUDANT, Robert PANDRAUD, Jean-Luc WARSMANN. 35 Mme Christine BOUTIN, MM. Emile BLESSIG, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Hervé MORIN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
