N° 2788 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2000. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES (1), et présenté par MM. Pierre LELLOUCHE, Guy-Michel CHAUVEAU Députés. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Défense. La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de : M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Jean-Claude Sandrier, Michel Voisin, INTRODUCTION 7 I. - LA FACE CACHÉE DE LA MULTIPOLARITÉ : UNE GÉOGRAPHIE DES PROLIFÉRATIONS PRÉOCCUPANTE 27 A. VERS UN DEUXIÈME ÂGE NUCLÉAIRE ? DES ARMES EN QUÊTE D'IDÉOLOGIE 28 1. Au Nord, l'arme nucléaire dévaluée ? 29 a) Le monde occidental vit-il déjà dans un monde post-nucléaire ? 29 b) Une décennie de désarmement et de succès de la non-prolifération nucléaire 33 2. Au Sud, vers la deuxième génération d'acteurs nucléaires ? 36 a) Un deuxième âge nucléaire ? 37 b) L'Inde et le Pakistan ou la prolifération achevée et officialisée 40 c) Israël ou la continuité dans l'ambiguïté 57 d) Les candidats au nucléaire 64 B. LA PROLIFÉRATION DES ARMES CHIMIQUES : UNE MENACE SANS SOLUTIONS ? 81 1. « L'arme du pauvre » ? 82 a) Une perception divergente de l'arme chimique au Nord et au Sud 82 b) Une arme de terreur 86 2. D'une logique de production massive à une logique de gestion des stocks ? 90 a) Des arsenaux massifs 90 b) « L'archipel toxique » 98 C. L'ARCHIPEL BIOLOGIQUE OU L'ÉQUATION DE TOUS LES DANGERS 100 1. Une prolifération ancienne et méconnue 101 a) L'incroyable programme biologique soviétique 101 b) Une prolifération encore mal connue 109 2. L'arme nucléaire du XXIème siècle ? 115 a) Le panorama global de la prolifération biologique 115 b) Un programme russe ? 122 D. LA PROLIFÉRATION DES MISSILES : UN PHÉNOMÈNE NON MAÎTRISÉ 124 1. Le consensus sur l'accélération de la prolifération balistique 125 a) Approche globale 126 b) Approche par pays 128 c) Un sujet moins connu : la prolifération des missiles de croisière 136 2. La menace en débat : regard américain sur la prolifération balistique 137 a) Le débat aux Etats-Unis : l'évaluation de la menace comme enjeu politique 137 b) Une menace surévaluée : évaluation critique des thèses américaines 141 E. LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES DE LA PROLIFÉRATION : ARCS, RÉSEAUX ET ZONES DE CONFLITS 145 1. Réseaux et arcs de prolifération 146 a) L'arc anti-occidental 147 b) Un arc islamique ? 155 c) Le cas russe 157 2. Géographie de la prolifération et géographie des points de tension : un constat inquiétant 161 a) L'Asie : une cristallisation d'impasses inquiétante 161 b) Le Moyen-Orient, entre processus de paix et armes de destruction massive 166 II. - LE BILAN EN DEMI-TEINTE DES POLITIQUES DE NON-PROLIFÉRATION 169 A. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE : UN BILAN POSITIF MAIS DES HYPOTHÈQUES À LEVER POUR L'AVENIR 170 1. Le verrouillage juridique de la prolifération nucléaire 171 a) Au c_ur du dispositif : un système complexe de traités et d'accords 171 b) Les régimes de fournisseurs 178 c) Les solutions ad hoc : le cas russe 181 2. Un système qui n'est cependant pas sans failles 186 a) Le TNP entre universalité et remise en cause 186 b) La laborieuse mise en place du programme « 93 + 2 » 194 c) Le TICE ou le traité de Versailles du désarmement 196 d) L'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires : des perspectives peu favorables 199 e) Le traitement du nucléaire russe : un bilan mitigé 199 B. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION CHIMIQUE : UN DISPOSITIF TECHNIQUE ÉLABORÉ QUI DOIT ENCORE FAIRE SES PREUVES 202 1. La convention d'interdiction des armes chimiques : une victoire diplomatique incontestable 202 2. L'épreuve des faits 208 a) Une mise en _uvre encore trop partielle pour évaluer l'efficacité du dispositif 208 b) Une convention pour les « bons élèves » ? 212 c) Les armes chimiques russes : un dossier préoccupant 212 C. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION BIOLOGIQUE : L'IMPOSSIBLE NÉGOCIATION ? 216 1. La convention sur les armes biologiques de 1972 ou l'impasse du désarmement sans vérification 216 2. Vers un véritable système de lutte contre la prolifération biologique ? 220 a) Une négociation laborieuse 221 b) Et toujours le cas russe... 225 D. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MISSILES : UNE IMPASSE CONCEPTUELLE PRÉOCCUPANTE 228 1. Des moyens lacunaires 228 a) Le MTCR : origines et dispositif 228 b) Des faiblesses évidentes 230 2. Un problème méthodologique : une approche multilatérale de la lutte contre la prolifération balistique est-elle possible ? 234 a) Améliorer le MTCR : une faible marge de man_uvre 235 b) Les autres voies de la non-prolifération balistique 238 III. - QUELLES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS ? NON-PROLIFÉRATION, DÉFENSE ET DISSUASION AU XXIÈME SIÈCLE 247 A. QUELLE STRATÉGIE POUR LES DÉMOCRATIES ? 249 1. Le constat : des approches divergentes entre les démocraties 249 a) Les contradictions de l'unilatéralisme américain 250 b) La laborieuse émergence d'une politique de non-prolifération européenne 263 2. Pour une approche contractuelle 271 a) Les impasses de l'unilatéralisme américain 271 b) La nécessité d'un débat collectif sur non-prolifération et contre-prolifération 276 B. QUELLE STRATÉGIE POUR L'EUROPE ? 281 1. Le constat : entre non-dits, non-débats et tabous 281 a) L'Alliance atlantique et la prolifération 281 b) L'Europe et la prolifération : le tabou nucléaire 287 2. L'objectif : pour une réflexion européenne globale sur la menace et les réponses à y apporter 290 a) Construire une analyse européenne des risques et des menaces posés par les armes de destruction massive 290 b) S'affirmer comme l'acteur majeur de la non-prolifération 294 c) Réfléchir au couple « défense et dissuasion » en Europe 296 C. QUELLE STRATÉGIE POUR LA FRANCE ? 301 1. Dix ans de désarmement et de non-prolifération 302 a) Le nucléaire : soutien sans faille à la non-prolifération et désarmement unilatéral 303 b) Une action très déterminée contre la prolifération chimique 309 c) Une action de longue date en faveur de la non-prolifération des armes biologiques 309 d) Un rôle majeur dans la lutte contre la prolifération balistique 310 2. La doctrine française et la prolifération : une réponse adaptée ? 311 a) Le dogme de la dissuasion pure est-il encore valide ? 312 b) La France dispose-t-elle d'une stratégie de lutte contre la prolifération ? 318 c) Faut-il introduire un élément défensif dans la doctrine française ? 324 3. Les moyens : pour une action multiforme et volontariste 329 a) La prévention par le renseignement : développer les moyens existants et acquérir une capacité de détection des tirs de missiles 331 b) La dissuasion : maintenir la compétence nucléaire 333 c) La défense passive : organiser un système efficace de défense en profondeur contre la prolifération et ses conséquences 334 d) La défense active : développer une défense antimissile de théâtre et maintenir une veille technologique poussée sur l'interception précoce de missiles balistiques 337 CONCLUSION 345 EXAMEN EN COMMISSION 347 ANNEXES 361 Mesdames, Messieurs, La prolifération des armes de destruction massive - nucléaires, biologiques et chimiques - et de leurs vecteurs à travers le monde est un sujet grave mais, par un curieux paradoxe, peu évoqué en France. La création d'une mission d'information portant sur ce thème par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, au mois de janvier 2000, constitue donc une initiative dont il faut se féliciter. C'est en effet la première fois que cette commission, et l'on serait même tenté de préciser qu'une commission parlementaire, se donne les moyens de mener un travail de recherche et d'investigation aussi approfondi sur ce sujet. Elle a choisi de le faire sur une base bipartisane, consciente que, dans ce domaine aussi important que complexe, les clivages politiques devaient être placés au second plan. Le présent rapport illustre a posteriori la pertinence de ce choix dans la mesure où il témoigne d'une convergence de vues presque totale entre les rapporteurs sur les constats et enseignements relatifs à la prolifération. C'est donc le fruit d'un travail ambitieux d'investigation et d'information qui est contenu dans les pages qui suivent. Ambitieux d'abord car le concept de prolifération recouvre de multiples réalités. Comme le souligne le Livre blanc sur la défense de 1994, « l'expression très générale de prolifération des armes de destruction massive recouvre en fait des processus assez différents, mais souvent complémentaires ». Globalement, la prolifération revêt deux dimensions, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre : d'une part, le phénomène désigne les efforts menés « par un Etat pour rechercher, développer et produire » des armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi que les vecteurs susceptibles de les porter, généralement des missiles, balistiques le plus souvent ; d'autre part, la prolifération consiste en l'exportation ou la diffusion par un Etat ou une entreprise de technologies, de savoir-faire, de matériaux ou d'équipements nécessaires à la fabrication des mêmes armes. Dans les deux cas, elle suppose le plus souvent des pratiques illicites et clandestines visant à contourner les contrôles internationaux. Ambitieux également parce que vos rapporteurs ont choisi de faire porter leur analyse sur l'intégralité du spectre des armes de destruction massive. Ce choix témoigne certes d'une volonté d'exhaustivité et de pédagogie sur un thème trop peu abordé au niveau politique en France. Mais il est avant tout motivé par le constat fait par vos rapporteurs de l'insuffisante prise de conscience dans notre pays de certaines formes de prolifération, notamment biologique et bactériologique. La mission a pu en effet observer qu'une attention différenciée était apportée aux diverses formes de prolifération : autant la géographie et les risques de la prolifération de l'arme nucléaire représentent un phénomène connu, et largement traité, autant la prolifération des armes biologiques fait l'objet de ce qu'on pourrait appeler une impasse de connaissance, doublée d'une impasse conceptuelle, et donc opérationnelle. Tâche ambitieuse enfin car elle implique de jeter un regard global sur un phénomène par essence complexe. A cette fin, la mission a pris le parti de multiplier autant que possible ses sources d'information1. Elle a donc entendu la quasi-totalité des responsables institutionnels qui, en France, traitent la question de la prolifération, à une exception regrettable2 ; elle a de même recueilli les analyses de nombreux experts stratégiques dans notre pays. Mais elle a également souhaité étendre son champ d'investigation à la plupart des pays qui sont concernés par le sujet3 : question globale, notamment dans la mesure où elle profite de l'accélération des échanges internationaux et de la diffusion de l'information, notamment via les nouvelles technologies, la prolifération ne peut être envisagée dans le seul cadre national ou européen. Vos rapporteurs ne prétendent pas pour autant avoir épuisé la question de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ni même donner toutes les réponses aux nombreuses questions que ce phénomène soulève. Encore faut-il seulement poser ces questions : c'est avant tout dans cette perspective pédagogique, pour la France et pour l'Europe, que s'inscrit le présent rapport. * Risque, menace, défi : quelle est aujourd'hui la réalité de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ? Où passe la frontière entre analyse prospective rationnelle et diabolisation irresponsable d'un phénomène géostratégique majeur ? Le constat principal qui ressort du tableau général de la prolifération à l'aube du XXIème siècle est celui d'une détérioration accélérée des régimes de non-prolifération et de maîtrise des armements dans la deuxième moitié des années 1990. La conséquence principale en est un accroissement des risques de prolifération depuis quelques années. Cette photographie générale de la prolifération en 2000 contraste singulièrement avec les grands espoirs placés, au début de la décennie, dans la fin de la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique. De fait, cet optimisme n'était pas sans fondement. Ce sont d'abord trois traités majeurs de désarmement qui ont été conclus dans un laps de temps très restreint à la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante. En 1987, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) en Europe a permis l'élimination d'une catégorie entière d'armes nucléaires en soustrayant aux arsenaux soviétique et américain l'ensemble des missiles de croisière et balistique de courte et moyenne portée (500 à 5 000 kilomètres). Les négociations START entamées entre les Etats-Unis et l'URSS en 1982 ont abouti ensuite en 1991 au traité START I qui prévoit une réduction d'un tiers des arsenaux stratégiques russes et américains sur sept ans, soit un objectif de 7 000 têtes dans chacun des pays. Dès 1993, la Russie et les Etats-Unis sont allés plus loin en signant le traité START II qui fixe le plafond des arsenaux américains à 3 500 ogives nucléaires pour les Etats-Unis et 3 000 pour la Russie à l'horizon 2003, limite repoussée en 1997 à 2008. Parallèlement à ces progrès inégalés jusqu'alors en matière de maîtrise des armements, la lutte contre la prolifération a enregistré un certain nombre de succès au début des années 1990. Dans le domaine nucléaire tout d'abord, la liste des pays candidats au nucléaire s'est raccourcie avec la décision de l'Afrique du Sud en 1991, de l'Argentine et du Brésil en 1994 et 1995 d'abandonner et de démanteler leur programme. A ces « repentis » du nucléaire sont venus s'ajouter la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan qui ont décidé de renoncer à l'héritage nucléaire soviétique. De même, les outils juridiques de la non-prolifération nucléaire se sont renforcés et étoffés au cours de cette période. Le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a vu son universalité et sa légitimité renforcées par l'adhésion de deux puissances nucléaires, la France et la Chine, en 1992, ainsi que par sa prorogation illimitée en 1995. Par ailleurs, la mise au jour du programme irakien a eu au moins pour vertu de conduire à un renforcement des pouvoirs de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA), par l'adoption du programme dit « 93 + 2 ». En outre, la conclusion d'un marathon de quatre décennies, avec la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) en 1996, représente un indéniable succès diplomatique. C'est dans ce même climat d'euphorie qu'il faut replacer le lancement de la négociation du traité d'interdiction des matières fissiles à la suite de la conférence de renouvellement du TNP de 1995. Les autres champs de la lutte contre la prolifération ont également connu des avancées remarquables, avec la conclusion, en 1993, de la Convention d'interdiction des armes chimiques et le lancement de la négociation d'un protocole de vérification de la convention sur les armes biologiques de 1972. Réduction graduelle des arsenaux stratégiques, marginalisation de la prolifération, prise en compte des menaces nouvelles : tel était le bilan sans conteste positif qui pouvait être dressé au milieu de la décennie 1990. En cette année 2000, le panorama global de la situation internationale en matière de prolifération est tout autre et ne peut que susciter l'inquiétude. C'est d'abord du sous-continent indien que les coups les plus rudes ont été portés aux régimes de non-prolifération. Même si la capacité nucléaire de l'Inde et du Pakistan était connue de tous, les essais nucléaires réalisés par ces pays en 1998 constituent un revers grave pour le TNP et pour les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Et que dire de la succession d'essais de missiles balistiques dans cette région du monde, chacun des protagonistes se répondant en une escalade dont on distingue mal le résultat ? De même, l'affrontement de l'Inde et du Pakistan à Kargil en 1999, c'est-à-dire après leur nucléarisation officielle, ne laisse pas d'inquiéter. Il n'est pas certain que la mesure des bouleversements stratégiques majeurs induits par ces trois événements ait été encore prise à sa juste valeur. L'évolution de la Corée du Nord et de la Chine en matière de prolifération contribue également à assombrir le paysage en matière de désarmement et de non-prolifération. Certes, les événements les plus récents semblent montrer une relative ouverture de la Corée du Nord. Mais, aux engagements verbaux très flous de ce pays sur la limitation de ses exportations de missiles balistiques, on ne peut qu'opposer les faits qui, eux, n'incitent guère à l'optimisme : la Corée du Nord a procédé à un essai de missile balistique au-dessus du Japon le 31 août 1998, elle vend des missiles de toutes portées à qui veut en acheter et continue de maintenir ses installations nucléaires à l'écart des regards extérieurs. Quant à la Chine, elle poursuit également une prolifération active, stratégique pourrait-on dire, dans les domaines nucléaire et balistique. Au Moyen-Orient, les perspectives en matière de prolifération sont peu réjouissantes. L'Irak n'est plus soumise à un contrôle international depuis 1998, suite à l'éviction de la mission de l'ONU (UNSCOM) ; quant à l'Iran, il entretient avec la Russie des coopérations balistiques et nucléaires qui nourrissent des doutes marqués sur ses intentions. Sans oublier, enfin, la situation des programmes chimique et biologique dans ces deux pays, qui sont pour le moins sources d'interrogations. Plus globalement, la deuxième Intifada qui a cours aujourd'hui dans cette partie du monde ne peut que nourrir une course aux armements et donc une accélération de la prolifération. * Ce tableau est d'autant plus inquiétant que les régimes de non-prolifération et de maîtrise des armements semblent impuissants à relever le défi de la prolifération dans un monde multipolaire. Depuis deux ans, le sentiment se répand d'une lente, mais certaine, désagrégation du système de non-prolifération, notamment due à l'attitude des Etats-Unis, à tel point que nous sommes en droit de poser aujourd'hui la question suivante : les Etats-Unis croient-ils encore à la maîtrise des armements et à la non-prolifération ? Le rejet du TICE par le Sénat américain, la décision des Etats-Unis de doter le territoire national d'un système de défense contre les missiles balistiques (NMD) à la suite du rapport Rumsfeld sur la prolifération balistique représentent autant de signaux négatifs envoyés à l'approche préventive de la prolifération qui a prévalu jusqu'alors. Se répand en effet aux Etats-Unis l'idée que le système traditionnel ayant échoué, il faut développer les systèmes de défense contre l'ensemble des proliférations. Nul besoin de souligner les risques de crise internationale que l'adoption unilatérale et non négociée d'un système de défense contre les missiles balistiques est susceptible d'entraîner. La Russie a d'ores et déjà menacé de se retirer de tous les systèmes de désarmement existants ; quant à la Chine, qui peut à juste titre s'estimer la principale puissance visée par la NMD, elle n'a pas caché son intention d'accélérer la modernisation et le développement de son arsenal stratégique en cas de déploiement de la NMD. Une telle mesure aurait immanquablement pour effet de stimuler le programme nucléaire indien. Le Pakistan ne resterait pas sans réagir à son tour. En bref, l'effet domino d'un éventuel déploiement du système NMD aux Etats-Unis est un risque qui doit être pris très au sérieux et que nous avons pu vérifier sur place. Qu'en est-il de l'Europe dans cette perspective ? On ne peut qu'être frappé par l'absence d'action concrète de la part de l'Europe pour pallier la carence américaine et apporter des réponses efficaces aux nouveaux défis de la prolifération. Elle a certes exprimé son inquiétude sur la brutale dégradation du climat stratégique international et souligné les risques dont était porteuse la stratégie alternative de contre-prolifération promue de façon exclusive par les Etats-Unis. La France s'est faite le principal porte-parole de cette inquiétude, non sans raison d'ailleurs : alors qu'elle s'oppose traditionnellement à toute stratégie de défense, active ou passive, pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive - sauf dans un cadre très limité - , elle a mis en _uvre, dans les années 1990, des mesures de désarmement unilatéral sans équivalent dans aucune autre démocratie. Le démantèlement des sites d'essais nucléaires de Polynésie française et de la composante terrestre de notre force de dissuasion est achevé ; quant à celui des usines de Pierrelatte (uranium enrichi) et de Marcoule (plutonium), il est en cours. Ces trois exemples suffisent à montrer que le désarmement nucléaire entrepris par la France depuis quelques années n'est pas rhétorique, mais bien réel, et largement irréversible. La mise en cause actuelle des régimes de lutte contre la prolifération par les Etats-Unis ne doit pas être interprétée seulement comme le caprice d'une hyperpuissance trop prospère, en mal d'affectations de ses excédents budgétaires. Il existe aujourd'hui une perception générale, qui dépasse largement les Etats-Unis, que les mécanismes juridiques destinés à endiguer la prolifération fonctionnent mal. En dépit d'une réduction des arsenaux nucléaires, et chimiques dans certains pays, le système de non-prolifération semble en effet instable. La question des fuites au sein du TNP, pourtant quasi-universel, n'est pas réglée : l'option nucléaire peut, ou pourra à moyen terme, être exercée par des pays qui ont signé ce traité en tant qu'Etat non nucléaire. Que ferons-nous alors ? Par ailleurs, le traité d'interdiction des essais n'existe aujourd'hui que sur le papier, quels que soient les progrès de l'implantation des stations de détection. Même en matière chimique, l'adoption d'une convention très inquisitoriale ne doit pas faire oublier que les mécanismes concrets destinés à lutter efficacement contre la prolifération de ce type d'armes doivent encore faire leurs preuves. Sans parler du biologique qui demeure une option de choix ouverte sans risque aux candidats à la prolifération. Que dire enfin de la poursuite de la production de matières fissiles, qui échappe à ce jour à toute limitation, et du développement des missiles balistiques, lui aussi largement sans contrôle ? Ces constats, en eux-mêmes préoccupants, soulèvent des inquiétudes d'autant plus fortes que géographie des proliférations et géographie des crises se recoupent largement : les trois zones les plus concernées aujourd'hui par la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs sont également celles où les risques de conflits sont les plus élevés (Extrême-Orient), quand ils ne sont pas avérés (Asie du Sud et Moyen-Orient). C'est donc une spirale extrêmement dangereuse qui se développe sous nos yeux, avec d'un côté, le développement d'arsenaux dans des régions instables, et de l'autre, une volonté de désengagement de l'Etat qui est toujours posé en garant des divers régimes de non-prolifération, tant en raison de son influence que de sa taille. Il ne faut pas sous-estimer en effet la forte tentation, partagée par l'ensemble de la classe politique des Etats-Unis de rejeter en bloc l'ensemble des traités multilatéraux au profit d'une stratégie défensive exclusive, même unilatérale. Outre que ce désir d'émancipation du cadre traditionnel de la non-prolifération est nourri par les tendances lourdes de la mentalité américaine, notamment par la tentation depuis longtemps présente dans ce pays de sortir du nucléaire, il s'inscrit dans un contexte global de refondation de la stratégie militaire. En effet, à l'origine de la révolution dans les affaires militaires (Revolution in Military Affairs ou RMA) se trouve une fascination des Etats-Unis pour les progrès de la technologie conventionnelle et la guerre high tech. Ceci ne peut que favoriser la marginalisation croissante de l'arme nucléaire dans la pensée stratégique des Etats-Unis, d'autant que cette fascination pour la technologie conventionnelle qui est au c_ur de la RMA a été nourrie par les faits eux-mêmes, avec la guerre du Kosovo. Celle-ci a en effet conforté les Etats-Unis dans l'idée que leur puissance repose aujourd'hui, non sur des armes de destruction massive, mais sur leurs capacités technologiques, c'est-à-dire sur leur indéniable supériorité conventionnelle. Dans une certaine mesure par conséquent, aux yeux des Etats-Unis, la réalité stratégique mondiale est déjà celle d'un monde post-nucléaire : tant pour des raisons de prestige, de politique intérieure et extérieure et d'intérêt militaire, mieux vaut sortir du nucléaire. Dans cette perspective, les paramètres de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive changent du tout au tout : tel est, au fond, le message contenu dans les divers projets de défense antimissile des Etats-Unis. * Quelle doit être, dans ce contexte, la position de la France ? Quelles sont les conséquences, pour notre pays, de ce double phénomène de développement de la prolifération des armes de destruction massive dans les régions du monde particulièrement instables et de tentation de désengagement des Etats-Unis des moyens traditionnels de lutte contre la prolifération ? Certes, les réponses diplomatiques apportées par la communauté internationale depuis plus de trente ans jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, comme la mission a pu l'évaluer au cours de ses entretiens. Pour autant, le traitement diplomatique de la prolifération, nécessaire et qui, dans certains domaines, doit encore être renforcé, n'épuise pas la question de l'impact militaire de ce phénomène. Une politique de non-prolifération doit inclure les deux dimensions : l'exemple de la France, qui tout en étant très active dans le domaine diplomatique, possède toujours l'arme nucléaire, est d'ailleurs là pour le montrer. Tel n'est pourtant pas le discours actuel en France qui semble privilégier une approche exclusivement diplomatique, comme si les deux volets militaire et diplomatique de la lutte contre la prolifération s'excluaient mutuellement. Une véritable politique de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs doit pourtant articuler, de manière équilibrée, les volets militaire et diplomatique. (1) Dans le domaine diplomatique, la priorité doit aller aujourd'hui à un renforcement, et non à la mise au rebut, du système international en place. Pour ce faire, trois conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut amener les Etats-Unis à renoncer à leur démarche unilatérale au profit d'une approche contractuelle et multilatérale : l'avenir des régimes de non-prolifération passe par l'acceptation de la part de l'hyperpuissance américaine des règles du jeu multilatérales. Sans ce préalable, les Etats-Unis doivent prendre conscience des risques très graves dont leur attitude est porteuse pour la stabilité stratégique internationale. Deuxième condition nécessaire à la relance du processus diplomatique, l'évolution de l'attitude des Européens face aux projets de défense antimissiles national et de théâtre (TMD) envisagés outre-Atlantique : l'Europe doit intégrer dans ses raisonnements stratégiques la probable existence, dans les années à venir, de programmes de NMD et de TMD. Le consensus politique aux Etats-Unis, qui a reçu une traduction budgétaire massive, est tel qu'il ne fait aujourd'hui pas de doute que ces projets, longtemps serpents de mer de la réflexion stratégique américaine, vont, qu'on le veuille ou non, devenir réalité. Quelle est leur pertinence pour l'Europe ? Celle-ci doit se poser la question, sans crispation. L'intégration de la Russie dans ce processus multilatéral représente la dernière condition d'une politique efficace de non-prolifération : l'escalade rhétorique à laquelle nous assistons aujourd'hui de la part de la Russie n'est pas constructive, alors même que la Russie, dont les intérêts stratégiques sont communs avec ceux de l'Europe en termes de prolifération, ne peut que tirer profit d'un bon fonctionnement des régimes de non-prolifération. En un mot, l'efficacité de l'action diplomatique contre la prolifération présuppose un effort des Etats-Unis, de l'Europe et de la Russie pour rapprocher de leurs points de vue et un retour à la sagesse de leur part. L'action diplomatique de la France dans ce domaine devrait s'articuler autour de sept axes d'action : _ Il faut éviter de créer un précédent irakien : la politique de lutte contre la prolifération menée par la communauté internationale serait décrédibilisée en cas de démantèlement du contrôle sur ce pays. Renoncer à un droit de regard sur les programmes et les arsenaux militaires irakiens reviendrait à envoyer un signal positif aux candidats à la prolifération. _ La Russie doit interrompre ses activités clandestines dans le domaine de la guerre biologique. Elle doit, pour ce faire, procéder à un véritable démantèlement de Biopreparat, institut civil qui a couvert pendant vingt ans le programme pharaonique mené par l'URSS dans le biologique militaire et poursuit aujourd'hui son activité, avec à sa tête les mêmes responsables que durant la période soviétique. _ Il ne faut pas laisser la Chine s'installer dans un rôle de proliférateur stratégique. A cette fin, l'aide militaire à Taiwan pourrait être modulée en fonction de l'évolution de la politique chinoise en matière d'exportations nucléaires ou balistiques à destination de pays affichant une politique ostensiblement hostile au monde occidental. _ L'Inde et le Pakistan doivent être intégrés dans les régimes de non-prolifération. Techniquement, il s'agirait de lier la conclusion d'accords stratégiques avec ces deux pays à un triple engagement de leur part d'adopter des mesures de confiance mutuelle, de cesser leur production de matières fissiles et d'adhérer au TNP, avec un statut spécial adapté à leur situation. _ Il faut continuer d'exercer une pression ferme sur la Corée du Nord. On ne peut que regretter, à cet égard, l'empressement excessif de certains pays européens à reconnaître ce pays, alors qu'aucune action concrète en faveur de la non-prolifération n'a été mise en _uvre par la Corée du Nord, qui s'est contentée de déclarations floues. _ La France doit promouvoir la négociation et la conclusion d'un traité sur la notification des essais de missiles et la transparence balistique. _ Enfin, elle doit proposer l'universalisation du traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 1987. Telles sont les mesures susceptibles, aux yeux de vos rapporteurs, de relancer le volet diplomatique de la lutte contre la prolifération. Afin d'en renforcer l'impact, ces propositions devraient faire l'objet de stratégies communes européennes. (2) Aucune politique sérieuse de lutte contre la prolifération ne saurait cependant se limiter à une action exclusivement diplomatique. Dans la mesure où la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs fait peser un risque pour notre sécurité, nous devons développer les moyens militaires destinés à nous en protéger. D'autant que ce risque n'est pas théorique : comme nous l'avons souligné précédemment, la présence d'armes de ce type dans des zones de crise est potentiellement source de graves menaces pour la stabilité internationale. La mission considère à cet égard que les risques émanant du sous-continent indien doivent être pris très au sérieux : à ce jour, l'Inde et le Pakistan n'ont ni doctrine nucléaire, ni dispositif de sécurisation satisfaisant de leurs arsenaux. Par ailleurs, la configuration stratégique du sous-continent indien, inédite jusqu'alors, autorise toutes les inquiétudes : qu'en est-il des règles classiques de la dissuasion et du calcul raisonnable entre deux pays contigus qui se sont affrontés plusieurs fois au cours de la période contemporaine, y compris après avoir procédé à des essais nucléaires, et dont l'un, le Pakistan, est menacé de talibanisation ? De même, les paramètres de la sécurité européenne se trouveraient considérablement modifiés si l'équilibre stratégique était bouleversé en Extrême-Orient. Ce n'est pas là une hypothèse d'école dans la mesure où le triangle formé par la Chine, Taiwan et la Corée du Nord est porteur de crises majeures. La combinaison de la politique de développement balistique nord-coréenne, à des fins intérieures comme dans un objectif d'exportation, et de la mise en place d'une défense anti-missiles de théâtre de Taiwan pourrait conduire la Chine à une réaction extrêmement ferme et inciter le Japon à revoir sa position sur la détention de l'arme nucléaire. Reste enfin la question du Moyen-Orient, qui représente aujourd'hui le principal risque qui pèse sur la sécurité du continent européen, du fait de la proximité géographique entre les deux théâtres. En ce mois de décembre 2000, la mission ne peut que prendre acte de la brusque dégradation du processus d'Oslo qui prévalait tant bien que mal depuis sept ans et est probablement stoppé aujourd'hui. Dès lors, où va le Moyen-Orient ? Les plus optimistes feront valoir que l'on se dirige vers la séparation de corps, sans paix, entre Israéliens et Palestiniens. Mais rien n'exclut qu'Israël ne soit, dans les années à venir, le théâtre d'une guerre d'attrition urbaine et terroriste et que des Etats arabes, dotés de forces bien équipées et entraînées, n'entrent dans le conflit. Certes, l'arme nucléaire israélienne semble bien impuissante dans un tel contexte mais on ne peut, là encore, pas écarter du revers de la main l'hypothèse d'un dérapage si les événements devaient s'emballer. Pour des groupes terroristes, cette arme représente en effet une cible de choix, tandis qu'elle peut favoriser la prolifération de tous les types d'armes de destruction massive dans les pays arabes. Reste enfin, au-delà de ces risques régionaux, cette menace transversale et diffuse que représente le terrorisme, biologique et chimique notamment : l'attaque du métro de Tokyo au gaz sarin en 1995 doit-elle être considérée comme un acte isolé ou préfigure-t-elle le modus operandi par excellence du terroriste du XXIème siècle, qu'il s'appelle secte Aoum ou bien Oussama Ben Laden ? La question de l'impact militaire de ces menaces a été jusqu'alors très peu abordée en Europe, si ce n'est par l'OTAN et de manière encore très partielle. De même, en France, la réflexion sur la dimension militaire des conséquences de la prolifération reste confinée à des cercles étroits, voire est purement et simplement écartée. Peut-être faut-il voir dans cette discrétion une réticence à suivre la voie choisie par les Etats-Unis qui, même au niveau gouvernemental, ont pu privilégier une approche parfois théâtrale des questions liées à la prolifération. Peut-être surtout la difficile appréhension de ce phénomène bouleverse-t-elle les cadres conceptuels traditionnels, donc souvent confortables, de notre réflexion stratégique... Mais à l'heure où l'Europe de la défense trouve un nouvel élan, alors que la prochaine loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008 est en préparation, le dogmatisme n'est plus de mise, et poser la question des conséquences militaires de la prolifération pour la France et l'Europe est une nécessité. Car les interrogations soulevées sont multiples : quel est l'impact de l'accélération de la dissémination des armes de destruction massive sur la doctrine de défense française ? Sur ces moyens ? Notamment, la dissuasion offre-t-elle les meilleures garanties pour y répondre ? Quelles en sont les conséquences sur les outils de notre défense à l'horizon 2020-2030 ? Le traitement institutionnel du phénomène est-il satisfaisant en termes de recueil, de traitement et de diffusion de l'information ? Sans doute certaines des réponses à ces questions bouleverseront-elles le consensus actuel sur ces sujets. Mais dans un domaine où le délai entre la réflexion et l'action est souvent supérieur à une décennie, mieux vaut mettre en question les cadres de pensée traditionnels, quitte à les valider in fine, plutôt que de regretter que les décisions souhaitables n'aient pas été prises à temps. Nous ne connaissons que trop ce syndrome en France... L'inexistence de l'Europe sur ces questions pose également un problème majeur. L'Union Européenne n'a jusqu'alors envisagé la lutte contre la prolifération que sous l'angle diplomatique et s'est limité à une politique déclaratoire. Quant à la défense commune qui se met en place peu à peu depuis Saint-Malo (1998), elle a soigneusement écarté cette question. Plus encore, le tabou nucléaire est, en Europe, plus vivace que jamais, comme l'ont montré les réactions de nos partenaires aux propositions françaises de dissuasion concertée en 1995 et 1996. L'Union Européenne n'est donc aucunement en mesure d'occuper la place laissée vide par les Etats-Unis dans la défense des régimes de maîtrise des armements et de non-prolifération, faute d'avoir développé une réflexion propre et encore moins une action globale sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en général. Elle est encore moins en mesure de se défendre contre cette menace. L'impréparation des opinions publiques européennes sur cette question est donc totale : ni la dissuasion commune, ni la défense active ou la défense passive ne sont débattues publiquement en Europe. D'où la multiplicité des programmes de défense active en Europe, qui ne font l'objet d'aucune coordination : la France développe son propre programme avec Aster, tandis que l'Allemagne et l'Italie sont intégrées au programme d'origine américaine MEADS. Curieux paradoxe en vérité que cette Europe qui se désintéresse de la prolifération, alors même que sa situation géographique la rend beaucoup plus vulnérable aux armes de destruction massive et aux missiles balistiques que les Etats-Unis qui en font pourtant l'un des axes-clés de leur politique de défense ! La mission juge nécessaire de dénoncer aujourd'hui ce paradoxe : il en va autant de la crédibilité de l'Europe de la défense qui se construit sous nos yeux que de sa sécurité future. Elle recommande pour ce faire la mise en _uvre de sept axes d'action, qui pourraient utilement faire l'objet d'un Livre blanc européen de la défense : _ L'Union Européenne doit dresser un tableau des menaces directes pesant sur le territoire des Etats européens. A ce jour, cette analyse manque, alors qu'elle représente la condition préalable à la définition d'un format de forces. _ Le même bilan doit être établi s'agissant des menaces susceptibles de peser sur des forces militaires européennes déployées par des théâtres extérieurs. Rappelons que, dès 2003, le scénario de déploiement de forces européennes deviendra réalité. _ L'Europe doit voir au-delà des risques directs qui pèsent sur elle. L'évolution stratégique de l'Asie ou du Moyen-Orient la concerne. Il lui faut par conséquent s'interroger sur les conséquences pour elle d'une accélération de la course aux armements dans les régions les plus instables du globe. _ Par ailleurs, les velléités américaines de remettre en cause le traité ABM de 1972 qui réglemente le développement de systèmes de défense antimissile aux Etats-Unis et la Russie ont mis en lumière l'intérêt des Européens à la préservation du système de maîtrise des armements. Mais elles ont souligné tout aussi crûment l'absence de réflexion globale en Europe sur les risques qui pourraient peser sur elle dans l'hypothèse d'une remise en cause de ce système, qu'on ne peut pas exclure. La force de proposition alternative de l'Europe, notamment dans l'hypothèse où la Russie et les Etats-Unis parviendraient à un accord pour modifier en profondeur l'équilibre existant en matière de maîtrise des armements, est aujourd'hui quasiment nulle. Dans un domaine aussi essentiel pour sa sécurité, l'Europe ne peut se contenter d'une position exclusivement réactive. _ Aux portes de l'Union Européenne sont stockées des centaines d'armes nucléaires, des milliers de tonnes d'armes chimiques et des souches bactériologiques en tout genre, dans des conditions de sécurité telles que la Russie elle-même demande l'aide de la communauté internationale. Or, il n'existe à ce jour aucune évaluation proprement européenne des risques d'accidents ou d'emploi non autorisé de ces armes. _ En outre, la menace spécifique posée par le terrorisme à l'aide d'armes de destruction massive doit être précisément mesurée. Les pays européens sont de longue date familiers des problèmes de terrorisme ; ils doivent donc s'interroger sur les conséquences pour leur sécurité de l'utilisation éventuelle d'armes de destruction massive à des fins terroristes. _ Enfin, il est plus que temps de lever le tabou nucléaire qui pèse sur le débat européen, au moment où un autre tabou vient d'être levé avec la constitution d'une force d'intervention européenne. Les Européens ne peuvent plus, aujourd'hui, se contenter d'afficher une position commune sur la non-prolifération nucléaire, sans poser sur la place publique la question du rôle de l'arme nucléaire dans la sécurité européenne au XXIème siècle. Ce débat est inéluctable ; il serait regrettable de voir les Européens à nouveau à la traîne des Etats-Unis qui, notamment dans l'hypothèse de l'arrivée au pouvoir d'une administration républicaine aux Etats-Unis désireuse d'en finir avec l'âge nucléaire, ne resteront pas inactifs dans ce domaine. Qu'en est-il enfin des conséquences de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles sur l'appareil de défense français ? Jusqu'alors, ce débat a été soigneusement occulté. Notre pays n'est pourtant pas resté inactif, au cours de la décennie qui vient de s'écouler, dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération, bien au contraire. Par une ironie dont l'histoire a le secret, la période récente a même vu notre pays passer du statut de proliférateur militant, notamment jusqu'en 1976 - qui lui a fait refuser d'intégrer les régimes internationaux et l'a conduit à exporter dans un certain nombre de pays ses technologies et son savoir-faire nucléaire - à celui de champion hors catégorie du désarmement unilatéral. Quelle autre puissance militaire peut en effet se vanter d'avoir, en moins de dix ans, supprimé la composante terrestre de sa force de dissuasion, réduit les capacités de ces composantes maritimes et aéroportées, mis en _uvre le démantèlement de ses installations de productions de matières fissiles, reconverti de manière irréversible, sauf à engager des investissements majeurs, son site d'essais nucléaires ? Sur ce point, vos rapporteurs portent un jugement contrasté. M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur socialiste, estime que la politique française suivie en ce domaine depuis dix ans est conforme aux intérêts de notre pays : sans remettre en cause la crédibilité de notre force de frappe, les décisions successives relatives à la dissuasion permettent aujourd'hui à notre pays de se poser en interlocuteur écouté et respecté dans les enceintes internationales du désarmement et de la non-prolifération. Aux yeux de M. Pierre Lellouche, rapporteur RPR, une politique du juste milieu, qui évite à la France de passer d'une position extrême à l'autre, serait préférable. Qu'avons-nous obtenu, sur le plan diplomatique, en échange du démantèlement de nos sites de production de matières fissiles ? De même, il serait souhaitable de lier la fermeture de notre site d'essais nucléaires à des contreparties tangibles des autres puissances nucléaires, présentes ou à venir. Rappelons que le TICE lui-même offre aux Etats signataires la possibilité de reprendre les essais après un préavis de six mois en cas de circonstances exceptionnelles menaçant leur sécurité. Et les autres Etats nucléaires l'ont bien compris : ni la Russie, ni les Etats-Unis, ni la Chine n'ont désactivé leurs sites, sans parler des sites indiens et pakistanais... La mission d'information est en revanche unanime pour considérer que les conséquences militaires de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles doivent être prises en compte dans notre outil de défense, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut mettre fin à l'aveuglement provoqué par le concept de dissuasion pure sur notre doctrine et notre système de défense. La position dogmatique de la France en la matière n'est plus de mise aujourd'hui : sur quelles bases peut-on décréter que la dissuasion à la française est valide dans le monde multipolaire d'aujourd'hui et suffit à traiter le spectre des risques et des menaces pesant sur notre pays ? Nul n'a, à ce jour, démontré le théorème, qui prévaut aujourd'hui dans notre système de défense, selon lequel toute velléité de défense signifie ipso facto la mise en échec de la dissuasion, y compris dans une configuration du « fort au fou ». Tout simplement parce que ce théorème est conceptuellement invalide, donc impossible à démontrer. Il est temps de sortir des raisonnements théologiques pour examiner sans a priori la réalité stratégique et en tirer les conséquences opérationnelles. Afin de répondre de manière adaptée aux menaces posées par la prolifération, la France doit donc développer ses capacités militaires dans quatre domaines : _ En matière de renseignement, l'acquisition de données brutes sur l'ensemble des proliférations doit être renforcée, notamment grâce au renseignement humain. S'agissant plus spécifiquement de la prolifération balistique, la mission estime nécessaire l'acquisition d'une capacité européenne de détection de tirs de missiles. Sans compter que cette capacité pourrait jeter les bases d'une coopération avec les Etats-Unis et la Russie ; _ Dans le domaine de la dissuasion, les membres de la mission ont des avis divergents. Aux yeux de votre rapporteur socialiste, l'effort actuel de notre pays en faveur de la dissuasion doit être maintenu car il suffit à préserver sa crédibilité. En revanche, le rapporteur RPR de cette mission estime nécessaire d'élargir la gamme des options arrêtées en maintenant un niveau d'armes offensives conventionnelles et nucléaires suffisant pour exercer éventuellement une politique coercitive et de frappes préventives ; _ En matière de défense passive, la mission ne peut que constater l'insuffisante sensibilisation de l'opinion et des responsables politiques. C'est donc à un travail pédagogique qu'elle appelle d'abord. Au-delà, la mise en _uvre d'un système efficace de défense en profondeur contre la prolifération et ses conséquences doit être sérieusement envisagée. Il passe par un accroissement de notre effort budgétaire en ce domaine qui amplifie les progrès modestes faits en 2000 et 2001 ; _ S'agissant enfin de la défense contre les missiles, la France doit poursuivre le développement d'une défense antimissile de théâtre. Mais, en la matière, son action ne doit pas s'arrêter là. Afin de préserver les conditions de son autonomie de décision stratégique et industrielle, elle se doit de maintenir une veille technologique poussée sur l'interception précoce de missiles balistiques. I. - LA FACE CACHÉE DE LA MULTIPOLARITÉ : UNE GÉOGRAPHIE DES PROLIFÉRATIONS PRÉOCCUPANTE Ce n'est pas le moindre paradoxe de l'après-guerre froide que d'avoir remis la guerre à l'honneur, alors que, dans l'enthousiasme de la chute du mur de Berlin, la communauté internationale a pu croire qu'elle allait donner vie à l'ensemble des principes de la charte des Nations Unies et au vieux rêve de sécurité collective. Certes, la guerre froide n'avait pas marqué la fin des conflits armés ; mais leur conduite faisait l'objet d'une codification tacite entre les deux Grands, dans le but d'éviter la guerre ultime. Or, une décennie dans l'après-guerre froide a suffi pour nous rappeler que la guerre restait l'un des modes privilégiés de règlement des tensions : rien de bien nouveau en définitive, la période de la guerre froide apparaissant, elle, rétrospectivement comme une exception dans l'histoire de l'humanité. Depuis 1989, la prolifération des armes de destruction massive s'inscrit donc dans un contexte stratégique extrêmement volatile dont les règles de fonctionnement n'offrent plus le même degré de prévisibilité que pendant la période de guerre froide. On assiste par ailleurs à une diversification des formes de la prolifération. De simple, cette inconnue dans l'équation géopolitique qu'est la prolifération est devenue complexe. A l'hégémonie conceptuelle de la prolifération nucléaire doit dorénavant être substituée une réflexion sur les proliférations. Il ne s'agit en rien ici de minorer l'importance de la prolifération nucléaire, dont les pages qui suivent soulignent le caractère toujours préoccupant. Mais il est nécessaire de se détacher du cadre conceptuel de la guerre froide : d'une part, parce que, pour certains pays, la prolifération nucléaire est une option non exclusive de l'acquisition d'autres armes de destruction massive, souvent motivée par les mêmes facteurs ; d'autre part, parce que les progrès technologiques pourraient conférer à d'autres types d'armes, biologiques notamment, des pouvoirs aussi destructeurs que l'arme nucléaire. C'est précisément dans la conjonction de ces inconnues multiples que réside la difficulté à poser correctement l'équation géopolitique complexe du monde de l'après-guerre froide. Quel est aujourd'hui le tableau de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ? Afin de mieux évaluer le poids du phénomène, vos rapporteurs se proposent dans cette première partie de répertorier tout d'abord les pays détenteurs d'armes de destruction massive et les moyens qu'ils ont mis en _uvre pour se les procurer. Ce premier niveau d'analyse ne saurait toutefois suffire : la vraie question stratégique posée par la prolifération n'est en effet ni celle du « qui » ou du « comment » mais celle du « pourquoi ». Pour esquisser une géographie des proliférations, il convient de compléter l'approche verticale par types d'armes et par pays par une approche horizontale qui identifie les réseaux de prolifération. A. VERS UN DEUXIÈME ÂGE NUCLÉAIRE ? DES ARMES EN QUÊTE D'IDÉOLOGIE Il n'est pas d'arme dans l'histoire de l'humanité qui n'ait connu le déclin après avoir dominé sur les champs de bataille ou dans la stratégie militaire : cette courbe d'évolution des armements s'applique-t-elle à l'arme nucléaire ? Tel est en substance le débat ouvert depuis la fin de la guerre froide, en vertu d'un raisonnement somme toute assez logique : puisque le contexte stratégique de la guerre froide, fondé sur un affrontement bipolaire, a disparu, qu'advient-il de l'arme nucléaire, facteur structurant des relations internationales pendant cette période ? Les faits eux-mêmes sont venus nourrir ces interrogations, l'arme nucléaire ayant montré son incapacité à fournir quelque réponse que ce soit à la multiplication des conflits interethniques depuis une décennie, y compris dans les zones où elle a assuré la paix pendant quarante ans comme en Europe. La réponse à cette question est aujourd'hui très floue : il est certain que nous sommes sortis d'un monde dans lequel le seul étalon de puissance était l'arme nucléaire. Mais qu'y a-t-il après ? Bien sûr, dans le monde occidental, la marginalisation de l'arme nucléaire est incontestable : celle-ci a perdu le rôle central qu'elle avait avant 1989. Toutefois, cette marginalisation ne signifie pas disqualification. D'une part, les Etats occidentaux n'ont pas renoncé à leurs arsenaux nucléaires ; d'autre part, hors du monde occidental, l'arme nucléaire garde tout son prestige, quand elle ne voit pas son rôle réaffirmé avec force dans certaines régions. Ainsi, même si les armes nucléaires sont encore à la recherche d'un cadre idéologique dans l'après-guerre froide, les perspectives d'un monde post-nucléaire sont lointaines, comme les essais des bombes indienne et pakistanaise en 1998 l'ont rappelé avec force. Dès 1991, l'un des rapporteurs de la mission relevait « l'équation curieuse que celle du monde de demain où les riches sortent de l'ordre hiérarchisé par l'atome tout en conservant leurs arsenaux, tandis que les pauvres chercheront à « proliférer », peut-être plus encore (...) que par le passé »4. Ce constat demeure plus que jamais pertinent aujourd'hui. Le fait nucléaire est solidement ancré. Quant à savoir quelle réalité recouvre l'émergence d'une deuxième génération d'acteurs nucléaires, c'est une autre histoire : il est clair cependant qu'autant le monde post-nucléaire tel que le conçoivent les puissances occidentales fonctionne selon un code éprouvé, autant les aspirants à un deuxième âge nucléaire, au Sud, sont encore dans un monde pré-nucléaire. Un monde où règne le flou le plus grand sur la sûreté des arsenaux, leurs objectifs et leur efficacité. Un monde où l'arme nucléaire pourrait être une arme de terreur parmi d'autres. 1. Au Nord, l'arme nucléaire dévaluée ? Pendant quarante ans, le monde a été dominé par l'arme nucléaire et la hiérarchie des puissances organisée autour des accords de maîtrise des armements qui concrétisaient cette domination. A côté de l'affrontement idéologique entre les deux Grands, l'arme nucléaire représentait le pilier du monde bipolaire. Avec la fin de la guerre froide, elle a perdu le rôle central qu'elle jouait dans la configuration des relations internationales entre 1945 et 1989 et a vu son influence diminuer au sein du monde occidental. En témoignent les progrès du désarmement et les succès enregistrés par les régimes de non-prolifération depuis dix ans. a) Le monde occidental vit-il déjà dans un monde post-nucléaire ? · Marginalisation de l'arme nucléaire dans les arsenaux, disparition programmée de l'arme nucléaire réaffirmée à intervalles réguliers, renforcement des outils destinés à en limiter la dissémination : comment interpréter les progrès apparents du désarmement et de la lutte contre ce type de prolifération depuis le début des années 1990 ? S'agit-il simplement de revenir à moyen terme à un plateau du niveau des armements nucléaires, de geler en quelque sorte le paysage nucléaire en l'état, auquel cas la réduction des arsenaux ne postulerait en rien la disparition du fait nucléaire, dans les pays d'Europe et aux Etats-Unis du moins ? Ou quatre des cinq puissances nucléaires reconnues par la communauté internationale sont-elles entrées dans un processus structurel qui fait tendre leurs arsenaux vers zéro à terme ? Cette dernière hypothèse pose en filigrane la question de l'utilité de l'arme nucléaire aujourd'hui. Or, à n'en pas douter, celle-ci a fortement diminué. En termes stratégiques d'abord : les conflits les plus récents ont pu contribuer à véhiculer l'idée d'une disqualification théorique de l'arme nucléaire, notamment en Europe. Ainsi, les guerres successives qui se sont déroulées dans l'ex-Yougoslavie depuis dix ans ont rappelé que la dissuasion obéissait à des règles spécifiques et ne jouait que dans un contexte géostratégique déterminé. De manière plus générale, la conduite des conflits de l'après-guerre froide semble postuler l'inanité de l'arme nucléaire dans la mesure où elle privilégie les frappes de précision, avec un nombre de victimes minimal, là où l'arme nucléaire est synonyme de destructions maximales. Selon le processus de la courbe en cloche évoqué plus haut, les progrès technologiques, notamment dans le domaine des frappes de précision, conduiraient à l'obsolescence rapide de l'arme nucléaire. De la même façon, la révolution dans les affaires militaires (RMA) en cours aux Etats-Unis porte un coup à la valeur militaire de l'arme nucléaire, dans la mesure où ce concept repose sur la conviction que, du fait de leur incontestable avance technique dans les domaines de l'information et du renseignement, les Etats-Unis vont bénéficier dans les décennies à venir d'une incommensurable supériorité dans les conflits conventionnels. L'arme nucléaire n'est donc plus considérée comme le vecteur de la suprématie américaine par excellence. Certains pourront objecter que l'arme nucléaire aurait fait la preuve de son utilité et de sa pertinence pendant la guerre du Golfe. Certes, Saddam Hussein n'a pas été dissuadé d'envahir le Koweït par l'existence d'armes nucléaires au sein de ce qui allait devenir la coalition alliée. Mais certains soutiennent que c'est grâce à ces mêmes armes qu'il n'a pas utilisé des missiles balistiques à tête chimique contre Israël, alors qu'il en avait. Car ce ne sont pas des raisons morales qui auraient pu retenir le dictateur irakien : contre l'Iran lors de la guerre des villes en 1987 - 1988 et même contre sa propre population kurde, Saddam Hussein n'a pas hésité à recourir à une arme sur laquelle pesait pourtant un tabou très fort. Comment expliquer dès lors qu'il ne l'ait pas fait contre Israël, considéré comme un ennemi par nature de l'Etat irakien, si ce n'est par peur de subir des représailles qui auraient rayé l'Irak de la carte ? Il est, à dire vrai, impossible d'établir un lien de cause à effet entre le comportement du dirigeant irakien et la présence d'armes nucléaires au sein de la coalition alliée et on peut tout autant démontrer que la dissuasion n'a pas fonctionné vis-à-vis de l'Irak. D'une part, « dans le Golfe, c'est la puissance conventionnelle américaine, et elle seule qui fit la différence »5. D'autre part, même si Saddam Hussein n'a pas utilisé l'arme chimique, il n'a pas hésité à mettre son pays sur les genoux, à sacrifier une partie de ses forces militaires et de sa population civile, en bref il s'est montré largement indifférent à la rationalité de la dissuasion. Au total donc, l'utilité militaire de l'arme nucléaire aujourd'hui doit être sérieusement mise en doute. Qu'en est-il dès lors de son utilité politique ? En la matière, il faut bien conclure qu'aux yeux des pays occidentaux, et notamment de la majorité des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a été sérieusement entamée depuis 1989. Les opinions publiques occidentales ne se sont de fait jamais totalement accommodées de l'existence d'une telle arme et il n'est qu'à voir l'état d'esprit de l'opinion publique européenne pour s'en convaincre. Même au sein des Etats nucléaires, le consensus autour du maintien de la dissuasion est mou, car entaché d'une interrogation radicale sur le « qui dissuade-t-on ? », qui ne se satisfait guère de la réponse très vague qui y est apportée en l'absence d'ennemi identifié. Aux Etats-Unis, l'état d'esprit des experts rejoint largement celui de l'opinion publique. Il n'est qu'à lire ce qu'écrit sur le sujet l'un des meilleurs experts de la Rand Corporation, David Gompert, dans un mémorandum adressé au futur président américain présenté à l'institut d'Aspen en août 2000. Tout en rappelant l'existence de dangers dus à la prolifération des armes de destruction massive, David Gompert estime néanmoins qu'« en réponse à tous ces dangers, les Etats-Unis ont intérêt à minimiser l'importance des armes nucléaires ainsi que le risque qu'elles seront utilisées. (...) Du fait de leur supériorité militaire conventionnelle et des autres sources et symboles de pouvoir - économiques, technologies et politiques - qu'ils possèdent, les Etats-Unis devraient travailler à retirer leurs armes nucléaires de la sécurité et de la politique globale, même si elles ne peuvent pas être abolies, et débarrasser la planète des armes chimiques et biologiques6 ». Appelant ensuite à une réduction des armes nucléaires à un plafond inférieur à 1 000 têtes et au développement de défense contre les missiles balistiques, l'auteur conclut que « ces armes représentent le legs d'une ère ancienne, et non l'essence de l'ère nouvelle. Elles sont l'antithèse de la grandeur américaine ». Certes, ce papier se veut une défense et illustration de la défense antimissile, mais il reflète assez justement un état d'esprit présent de longue date aux Etats-Unis à l'égard de l'arme nucléaire, qui correspond aux ressorts profonds, notamment moraux, de la mentalité collective américaine. Il faut ajouter enfin qu'en raison des coûts importants d'acquisition, de développement et de maintenance qu'elle requiert, non seulement l'arme nucléaire n'est plus facteur de puissance, mais elle est même considérée comme un frein au développement économique. · Le rôle des armes nucléaires dans les arsenaux des grandes puissances est donc résiduel. Les postures doctrinales sont figées : la France conserve sa doctrine de dissuasion tout azimut ; de même, il n'existe pas d'enthousiasme aux Etats-Unis pour le maintien de l'arme nucléaire dans les arsenaux militaires et la Nuclear Posture Review de 1994 n'a in fine que très peu fait évoluer la doctrine américaine. De condition de survie, la doctrine de dissuasion s'analyse donc davantage aujourd'hui comme une police d'assurance contre certains risques, eux-mêmes mal identifiés dans un contexte stratégique mouvant. Elle se limite à un postulat aussi général que tautologique : le nucléaire dissuade ceux qui doivent être dissuadés. Il existe deux exceptions à ce tableau : à l'égard de l'arme nucléaire, la Russie et la Chine se situent aujourd'hui à la frontière entre le Nord post-nucléaire et le Sud pré-nucléaire. Ainsi, la Russie a adopté une politique d'ambiguïté stratégique qui ne reflète pas seulement la situation difficile que traverse le pays. Certes, la situation économique russe est telle que ce pays ne pourra pas maintenir en l'état son arsenal nucléaire et qu'il y aura, de toute façon, diminution quantitative de l'arsenal nucléaire russe. Mais dans le discours et dans la doctrine, l'arme nucléaire a vu récemment son rôle réaffirmé, dans la nouvelle doctrine de sécurité notamment. Or, s'agissant d'une arme qui, par nature, est davantage un outil politique qu'un instrument militaire et dont le fonctionnement fait intervenir des ressorts psychologiques, cette réaffirmation du rôle de l'arme nucléaire par la Russie n'est pas anodine, même si certains commentateurs ont pu noter le lien inversement proportionnel entre la réalité de la puissance de la Russie et le rôle accordé par ce pays à l'arme nucléaire. Cette réaffirmation du rôle du nucléaire n'est pas le fruit des pressions de militaires nostalgiques de la puissance soviétique. Lors de son déplacement à Moscou, la mission a même constaté que, du côté du ministère de la Défense, on soulignait davantage que la doctrine présentée en 2000 ne faisait que confirmer l'abandon du non-usage en premier déjà annoncé en 1993, qui s'avère aujourd'hui n'avoir été qu'un slogan à l'usage des opinions publiques hérité de la guerre froide. La volonté russe de réaffirmer la place du nucléaire est avant tout politique : comme l'a déclaré le vice-ministre des affaires étrangères, M. Georguy Mamedov, aux membres de la mission, même si cette doctrine évolue davantage sur la forme que sur le fond, il n'en reste pas moins qu'elle se veut le reflet de la volonté de la Russie « que tous, y compris la Chine, sachent que, si l'existence de la Russie est menacée, elle recourra à l'arme nucléaire ». Cette réaffirmation du nucléaire repose sur des raisons de fond : aux dires de l'ancien Premier Ministre russe, M. Evgueni Primakov, rencontré par la mission, l'évolution du concept nucléaire russe, qui se traduit par un abaissement du seuil nucléaire, est liée à la modification des rapports de force internationaux, la guerre du Kosovo ayant marqué une étape importante en la matière. Elle représente une garantie de l'intégrité du territoire russe, dans l'hypothèse d'ingérences extérieures. Le cas de la Chine ne présente, quant à lui, aucune ambiguïté : au regard du mouvement global de marginalisation relative du nucléaire parmi les puissances nucléaires officielles, il existe une véritable exception chinoise. A l'encontre de la tendance de baisse des arsenaux nucléaires dans les quatre autres Etats dotés d'armes nucléaires reconnus par le TNP, la Chine est engagée dans un double mouvement de modernisation et d'extension de son arsenal et cherche à acquérir une capacité de deuxième frappe. Les experts estiment que la Chine sera dotée vers 2010 de forces modernes, avec une capacité de frappe intercontinentale crédible. A l'heure actuelle, la Chine conduit en effet trois programmes de lanceurs intercontinentaux mobiles en cours de développement : - deux de ces programmes concernent des lanceurs mobiles terrestres, le missile DF-31 à trois étages, dont la portée est estimée à 8 400 kilomètres environ, et le DF-41, qui, avec une portée de 12 000 kilomètres, serait destiné à remplacer le CSS-4 déployé depuis 1980 et de portée équivalente, mais qui présente l'inconvénient majeur d'être à combustible liquide, donc d'un usage opérationnel difficile ; - le troisième programme, le JL - 2, vise à équiper les sous-marins stratégiques, dont la mise au point est en cours, et aurait une portée de 8 000 kilomètres au moins. Par ailleurs, la Chine travaille sur le mirvage et le durcissement de ses têtes, sans qu'on sache exactement l'état de ses avancées en la matière. b) Une décennie de désarmement et de succès de la non-prolifération nucléaire · La fin des années 1980 et la décennie 1990 resteront dans l'histoire du désarmement nucléaire comme une période exceptionnelle, caractérisée par une diminution massive et sans précédent des arsenaux nucléaires, tant stratégiques que tactiques. Celle-ci repose sur des décisions unilatérales, comme dans les cas français7 et britanniques, et bilatérales. A cet égard, les différents accords intervenus entre l'URSS, puis la Russie et les Etats-Unis sont particulièrement symptomatiques de cette baisse d'influence relative de l'arme nucléaire. Avec la mise en _uvre du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) signé en décembre 1987, qui portait sur l'élimination des missiles balistiques et des missiles de croisière de portée intermédiaire (1 000 à 5 000 kilomètres) et de courte portée (500 à 1 000 kilomètres), c'est toute une catégorie d'armes nucléaires qui a été soustraite aux arsenaux des deux pays. Depuis la chute de l'URSS, la logique de maîtrise des armements (Arms Control) a cédé le pas à une logique de désarmement. Le processus START, qui débute en juillet 1991 avec la signature par les deux Grands du traité START I, marque ainsi le début d'un désarmement stratégique massif, que vient confirmer la signature de START II en janvier 1993 : la mise en _uvre de ces deux traités devrait conduire à une diminution des armes nucléaires stratégiques russes et américaines de près de 70 % en 2003. Certes, ce processus a longtemps été hypothéqué par le refus de la Douma russe de ratifier le traité. Le revirement de sa position le 14 avril dernier, qui s'est traduit par une ratification du traité par 288 voix contre 250, a relancé le processus de désarmement nucléaire. Après plusieurs tentatives de ratification avortées au cours des derniers mois, la Russie a donc choisi d'afficher une position très nette en faveur d'une poursuite du désarmement nucléaire : le président Poutine a d'ailleurs clairement exprimé la volonté russe de poursuivre dans cette voie, notamment pour des raisons financières. Comme la mission a pu le constater lors des entretiens qu'elle a menés en Russie, les autorités russes, y compris militaires, sont prêtes, dans le cadre des négociations sur un traité START III, à examiner un abaissement des plafonds nucléaires bien en deçà du plafond de 2000 à 2 500 têtes fixé entre les Etats-Unis et la Russie au sommet d'Helsinki, le 21 mars 1997. Si, officiellement, les autorités russes ont soumis une proposition d'un plafond de 1 500 têtes, le chiffre de 1 000 têtes stratégiques, voire moins, est même évoqué au ministère de la défense russe. S'il est vrai que la situation financière de la Russie lui laisse peu de choix sur la fixation du niveau de son armement stratégique, il ne faut cependant pas se leurrer sur le sens de la ratification récente de START II par la Douma, liée à la volonté russe de mettre les Etats-Unis en difficulté sur la NMD. C'est ainsi que s'explique la réserve introduite par la Douma, qui, à l'occasion de son vote, a recommandé au président russe de « tenir compte des plans et actions des Etats-Unis relatifs à la création et au déploiement d'un système de défense antimissile du territoire ainsi que de l'éventualité d'un retrait des Etats-Unis du traité ABM de 1972 » ? N'empêche qu'en dépit du discours très dur développé sur ce sujet par certains parlementaires russes, le désarmement nucléaire de ce pays est inéluctable. · Les grandes puissances ne se sont pas contentées de réduire, bilatéralement ou unilatéralement, leurs arsenaux nucléaires. Elles ont également cherché à verrouiller les programmes existants en dehors du club des cinq Etats nucléaires reconnus par le TNP. Ainsi, parallèlement aux progrès du désarmement nucléaire, la lutte contre la prolifération a enregistré des succès qui ont également contribué à la marginalisation relative de l'arme nucléaire. Le premier de ses succès réside dans le renoncement d'un certain nombre d'Etats à l'option nucléaire, fait jusqu'alors inédit à l'âge atomique. L'Afrique du Sud est ainsi le premier Etat au monde à avoir annoncé coup sur coup qu'il renonçait à la bombe, en juin 1991, et qu'il adhérait au TNP, après avoir cherché, et réussi, tout au long des deux décennies précédentes à se doter de l'arme nucléaire. Les révélations sur le programme nucléaire sud-africain faites en mars 1993 ont en effet confirmé les suspicions sur l'existence d'un arsenal constitué, même si, avec six bombes, l'Afrique du Sud était loin de l'arsenal de 15 à 25 bombes qu'un spécialiste comme Léonard Spector lui attribuait. Deux Etats sont venus s'ajouter à cette nouvelle catégorie des « repentis » : l'Argentine et le Brésil, dont les programmes étaient moins avancés que ceux de l'Afrique du Sud, décidaient de renoncer à leur course mutuelle à l'arme nucléaire et rejoignaient les régimes internationaux de non-prolifération en 1994 et 1995. De même, les héritiers nucléaires de l'URSS qu'étaient la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan peuvent d'une certaine manière être inclus dans cette catégorie des repentis, - même si leur politique nucléaire ne résultait qu'en partie d'un choix propre - en signant le TNP en tant qu'Etats non nucléaires. Faut-il ajouter à la liste des succès de la lutte contre la prolifération le démantèlement du programme nucléaire irakien ainsi que la mise sous contrôle du programme nord-coréen ? Certes, les enseignements tirés de ces deux exemples ne sont pas univoques, dans la mesure où ils ont avant tout révélé les marges de man_uvre importantes qui existaient pour les tricheurs au sein même des régimes de non-prolifération. Sans invasion du Koweït par l'Irak, il n'est pas certain que la communauté internationale ne se trouverait pas aujourd'hui face à un autre Etat nucléaire de facto. Dans le tableau qu'elle dressera de la prolifération, la mission reviendra sur ces deux dossiers et sur les perspectives qu'ils ouvrent. A ce stade de la réflexion néanmoins, on ne peut nier que les cas irakien et, dans une moindre mesure, nord-coréen ont contribué au renforcement des instruments de lutte contre la prolifération et à la légitimité des régimes internationaux. C'est en effet dans la foulée des découvertes du programme clandestin irakien que les pouvoirs de contrôle de l'AIEA ont été notablement renforcés par l'adoption des mesures dites « 93 + 2 » de renforcement du système de contrôle de l'AIEA en deux ans (de 1993 à 1995)8. Cependant, le progrès majeur dans le renforcement des régimes de lutte contre la prolifération réside indéniablement dans la réaffirmation du rôle du TNP. L'adhésion en 1992 de la Chine et de la France à ce traité qu'elles avaient longtemps contesté avait déjà accru l'universalité et la pertinence de ce traité. De même, le fait que ni l'Irak, ni la Corée du Nord - qui avait pourtant menacé de le faire en 1994 - n'aient dénoncé le traité traduisait en creux le poids international du TNP. Mais c'est à l'évidence le renouvellement indéfini de ce traité en 1995 et le programme d'action adopté à cette occasion qui ont le plus largement assis l'autorité des systèmes de lutte contre la prolifération nucléaire. Le poids de cette « victoire éclatante » (Thérèse Delpech) réside non seulement dans la charge symbolique des engagements et des décisions prises, mais également, pour certaines d'entre elles, dans leur concrétisation rapide. De fait, comme ils s'y étaient engagés, les Etats parties au TNP ont conclu avant la fin de l'année 1996 un traité d'interdiction complète des essais (TICE)9, mettant fin à un marathon diplomatique de plus de quarante ans, depuis la proposition d'un tel traité par Jawaharlal Nehru en 1954. Plus récemment, l'absence de remise en cause de fond du TNP lors de la conférence d'examen de New York au printemps 2000, et ce en dépit de l'intervention des essais nucléaires indiens et pakistanais, a confirmé la légitimité de son existence. 2. Au Sud, vers la deuxième génération d'acteurs nucléaires ? A contre-courant du mouvement de remise en cause du nucléaire au Nord, les essais indiens et pakistanais d'avril 1998 ont rappelé avec force que le nucléaire gardait une forte attractivité dans certaines régions du monde. Comme ont pu le constater vos rapporteurs lors de leur déplacement en Inde et au Pakistan, vue de New Delhi et d'Islamabad, la marginalisation de l'arme nucléaire n'est rien d'autre qu'une vision foncièrement européo- et américano-centrée de la question et méconnaît la possibilité, et désormais la réalité, de la multipolarité nucléaire souhaitée par ces pays. Le tableau de la prolifération nucléaire conforte cette dichotomie entre un Nord post-nucléaire et un Sud pré-nucléaire. Trois groupes d'Etats cherchent aujourd'hui ou ont d'ores et déjà acquis l'arme nucléaire en dehors du cadre légal du TNP : - le premier groupe rassemble l'Inde et le Pakistan qui, sans avoir violé quelque engagement international que ce soit puisqu'ils n'étaient pas membres du TNP, ont néanmoins acquis l'arme nucléaire en dehors de tout cadre juridique et ont officialisé ce choix en 1998. Ces deux Etats peuvent être dénommés Etats nucléaires de facto, par opposition aux cinq Etats nucléaires de jure, définis par le TNP comme ceux qui ont fait exploser un engin atomique avant le 1er janvier 1967 ; - dans un deuxième groupe figure Israël, généralement considéré comme « Etat du seuil », expression qui signifie que, sans reconnaître officiellement son statut nucléaire, ce pays est réputé posséder une capacité nucléaire. Jusqu'en 1998, l'Inde et le Pakistan faisaient partie de cette catégorie ; - le troisième groupe est plus hétéroclite. Il rassemble les pays membres du TNP qui, récemment ou aujourd'hui encore, ont développé des programmes clandestins illégaux ou sont soupçonnés de le faire. Ces programmes sont, dans certains cas, avérés, comme dans le cas de la Corée du Nord et de l'Irak ; dans d'autres - Iran, Libye, Algérie - n'existent que des soupçons ou des interrogations. a) Un deuxième âge nucléaire ? En 1974, les experts des services de renseignement, notamment américains, prévoyaient l'émergence, dans les deux décennies à venir, d'une vingtaine de puissances nucléaires. Sans doute ces prévisions étaient-elles largement influencées par l'explosion « pacifique » que l'Inde venait de réaliser ; mais elles correspondaient à une estimation couramment admise dès les années 1960 qui avaient vu l'apparition de deux puissances nucléaires supplémentaires, la France et la Chine. Rétrospectivement, de telles analyses sont perçues comme relevant d'une approche plus catastrophiste que scientifique. En définitive, même si, depuis longtemps, il est acquis que le fait nucléaire ne se limite plus seulement aux cinq Etats reconnus par le traité de non-prolifération nucléaire, la prolifération nucléaire apparaît jugulée, ainsi qu'en témoigne l'accession de cinq pays seulement au rang de puissance nucléaire dans les vingt premières années de l'âge atomique, et de trois autres dans les trente dernières. Si le présent rapport avait été écrit en 1997, il s'en serait tenu à cette conclusion somme toute optimiste. L'intervention d'un événement majeur en 1998, avec l'officialisation spectaculaire du statut de puissance nucléaire de deux des trois pays dits du seuil, l'Inde et le Pakistan, conduit cependant à nuancer l'analyse. Sans doute les essais nucléaires indien et pakistanais doivent être correctement interprétés au sens où c'est parce qu'ils étaient des puissances nucléaires que l'Inde et le Pakistan ont fait des essais, et non pour le devenir. En bref, ils n'ont fait qu'afficher leur capacité. Sans doute encore, en dépit de la floraison de discours catastrophistes sur l'éclatement prochain d'une guerre nucléaire en Asie qu'ont suscités ces essais, force est de constater, deux ans après, que les « exemples » indien et pakistanais n'ont - pas encore ? - fait école. Et pourtant, la nucléarisation du sous-continent indien ne peut être considérée comme un non-événement du point de vue de la prolifération nucléaire, ni en elle-même, ni dans ses conséquences. De fait, les experts ont été surpris par l'avancement des programmes indien, et surtout pakistanais, même si, dès 1995, l'Inde avait été près de procéder à des essais et n'y avait renoncé que sous la pression américaine. Que conclure de ce tableau contrasté, qui fait apparaître d'un côté, une remise en cause, parfois radicale, de l'arme nucléaire au Nord, dont le maintien résulte davantage d'une non-décision, d'un consensus mou ou encore de la peur de l'inconnu, et de l'autre, un maintien, voire une réaffirmation de la pertinence de l'arme nucléaire ? Si, à l'évidence, les remarques qui précèdent invalident pour longtemps l'idée d'un monde post-nucléaire, faut-il pour autant conclure à l'existence, depuis 1989, d'un deuxième âge nucléaire10, comme le font certains experts en Inde notamment ? L'avenir est-il à la coexistence entre un Nord qui voit dans l'arme nucléaire le reliquat d'une autre époque dont il doit gérer l'héritage parfois très lourd et un Sud qui se veut acteur à part entière du nouvel âge nucléaire ? Dans l'esprit des tenants du deuxième âge nucléaire, même si la dissuasion nucléaire n'est plus au c_ur des relations entre les grandes puissances, elle reste néanmoins présente en arrière-plan dans un tableau géostratégique mouvant où le statut nucléaire ne serait pas le résultat d'un traité international, mais d'un choix national. Le ministre des Affaires étrangères indien, M. Jaswant Singh, résume parfaitement cette idée lorsqu'il affirme que les armes nucléaires en Asie du Sud sont « une réalité qui ne peut être ni niée ni écartée. La catégorie d'Etat doté de l'arme nucléaire [au sens du TNP] n'est pas quelque chose qui est octroyé, pas plus qu'un statut qu'il revient à d'autres d'accorder ». Dans la mesure où les règles et les modalités de ce nouvel âge restent opaques et où un tel concept valide in fine l'idée qu'existerait, dans ce nouvel âge, une deuxième génération d'acteurs nucléaires venant grossir le « club » reconnu par le TNP, on ne peut qu'afficher la plus extrême circonspection à l'égard de cette expression. Pour l'heure en effet, ce « deuxième âge nucléaire » n'a que peu en commun avec le monde nucléaire tel que l'a connu la guerre froide. Quelle est la fonction de l'arme nucléaire pour ces nouveaux Etats nucléaires ? Quelles règles définissent son usage ? Quelles sont les procédures de sécurisation des arsenaux en voie de constitution ? En bref, ce deuxième âge nucléaire a pour l'instant plus à voir avec un monde pré-nucléaire dans lequel la bombe atomique est davantage une arme de terreur qu'un outil militaire et politique obéissant aux règles codifiées de la dissuasion. C'est pourquoi l'entrée de nouveaux Etats dans ce nouvel âge atomique doit être combattue avec vigueur. b) L'Inde et le Pakistan ou la prolifération achevée et officialisée L'évolution du statut de l'Inde et du Pakistan en matière nucléaire11 représente un fait majeur dans le paysage de la prolifération, qui s'était stabilisé au milieu de la décennie après avoir connu successivement la découverte du programme irakien, le renoncement volontaire de l'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Argentine au statut nucléaire et celui, contraint, de la Corée du Nord. A ce titre, les modalités et les motivations du développement des programmes nucléaires militaires indien et pakistanais, de même que l'analyse des raisons qui ont conduit ces deux pays à renoncer à une posture d'ambiguïté pourtant adoptée de longue date méritent un examen attentif, d'autant qu'elles suscitent de nombreuses interrogations. Que veulent faire l'Inde et le Pakistan de leurs armes nucléaires et pourquoi ont-ils officialisé leur capacité ? En dépit d'informations ouvertes importantes, d'analyses très pertinentes sur les bombes indienne et pakistanaise, ces questions importantes restent en suspens. Ce sont en effet ces points d'interrogations que la mission a retenus de ses entretiens, pourtant nombreux et denses, dans ces deux pays. Et cette absence de réponse ne laisse pas d'inquiéter. _ La bombe indienne : une _uvre de longue haleine, aux déterminants aussi nombreux que complexes - La longue histoire de la bombe indienne C'est en 1948, sous Nehru, que le programme civil nucléaire de l'Inde a commencé, avec l'instauration de la commission de l'énergie atomique (AEC). En 1954, notamment avec l'aide des Etats-Unis et du Canada, le ministère de l'énergie atomique est créé. Dès le début du programme civil indien, l'option militaire est envisagée, avec une grande discrétion toutefois : dans le pays du Mahatma Gandhi et de la naissance de la politique de non-violence, l'acquisition de l'arme nucléaire ne va pas de soi. La défaite contre la Chine en 1962 et l'accession de la Chine au rang de puissance nucléaire en 1964 accroissent cependant les pressions en faveur du développement d'armes nucléaires. Sans être formellement choisie, cette option n'est pas écartée, notamment dans le contexte de négociation du TNP. Il semble que c'est en 1972 que la décision de procéder à un test nucléaire fut prise, qui faisait suite à la troisième guerre avec le Pakistan en 1971. Le fait qu'une fois encore Pékin ait soutenu le Pakistan, et surtout que les Etats-Unis aient envoyé le porte-avions USS Enterprise dans le Golfe du Bengale, avec à son bord des armes nucléaires, a largement contribué à la décision de l'Inde qui se sentit victime d'un chantage nucléaire. La décision d'Indira Gandhi doit toutefois également en large partie à des considérations de politique intérieure. L'essai de 1974, qualifié « d'explosion pacifique », entraîna l'arrêt de toutes les coopérations internationales en faveur du programme civil indien et fut suivi trois ans plus tard par un engagement solennel du Premier ministre Desai que l'Inde n'acquerrait pas l'arme nucléaire. L'établissement en 1983 d'un programme intégré de missile guidé suggère cependant que l'Inde n'a jamais totalement cessé le développement de capacités nucléaires. L'un des acteurs les plus influents dans ce domaine, K. Subrahmanyam, qui dirigeait l'Institut pour les études et analyses de défense, prétendit d'ailleurs qu'il poussa le Premier Ministre Rajiv Gandhi à exercer « l'option nucléaire » en 1985. Selon lui, c'est au début de 1990 que la dissuasion nucléaire indienne prit forme. Les développements dans le domaine balistique accréditent cette thèse dans la mesure où les missiles clés du programme balistique indien, le Prithvi et l'Agni, n'ont de sens économique et militaire qu'avec une capacité nucléaire. Or, c'est au début de la décennie 1990 que le Prithvi fut prêt à être déployé. - Le tournant de 1998 Comment s'insère, dans la longue histoire du programme nucléaire indien, la décision de procéder à des essais en 1998 ? Pourquoi décider de mettre fin à la politique d'ambiguïté nucléaire indienne, qui consistait à garder ouverte l'option nucléaire, contemporaine du TNP et réaffirmée avec l'explosion pacifique de 1974 ? Pourquoi le faire en 1998 ? Pour dérangeants qu'ils soient, les essais nucléaires indiens de 1998 ne représentaient pas une surprise totale. En effet, la multiplication des débats internes sur ce sujet en Inde depuis 1995, dans un contexte de pression accrue de la communauté internationale pour que l'Inde se rallie au Traité d'interdiction complète des essais (TICE), dont la négociation s'achevait, témoignait des hésitations de l'Inde à poursuivre sa politique ambiguë. Si le calendrier des essais trouve sa cause immédiate dans l'arrivée au pouvoir du BJP (parti Bharatiya Janata), favorable à l'option d'affichage du programme indien, le choix de 1998 a été dicté par des motivations aussi nombreuses que complexes, dont il serait vain de chercher à déterminer le poids respectif : - la première catégorie de motivations est liée à des considérations de sécurité, et, notamment, aux inquiétudes de l'Inde vis-à-vis de la Chine (1) ; - les pressions internes forment le deuxième ensemble de raisons, et ressortissent de considérations aussi bien politiques (affirmation du BJP) que scientifiques (évaluer les capacités technologiques nationales) (2) ; - la prise en compte du prestige conféré par l'arme atomique, aux yeux des Indiens, ne doit pas être sous-estimée (3) ; - enfin, les évolutions des négociations et des régimes de lutte contre la prolifération, ainsi que la quasi-universalité de celle-ci ont représenté un facteur de pression externe qui a influé sans doute de façon déterminante sur le « timing » de la décision indienne (4). (1) Les considérations de sécurité et le facteur chinois Dans le discours qu'il fit au Parlement le 27 mai 1998, le Premier ministre indien a clairement mis en avant la « pierre de touche » que représentait la sécurité nationale dans la décision indienne de procéder à des essais. L'histoire de l'Inde depuis l'indépendance est, de fait, marquée par de nombreux conflits : avec le Pakistan, en 1947, 1965, 1971 ; avec la Chine, en 1962 ; au Sri-Lanka entre 1987 et 1990. Sans compter également les crises récurrentes qui jalonnent les relations indo-pakistanaises : les exercices militaires indiens du Cachemire dits Brasstacks en 1987 ont été à la source d'une vive tension entre les deux pays ; c'est encore au Cachemire, en 1990, que les deux pays ont été près de s'affronter, à tel point qu'on peut se demander s'ils n'ont pas été prêts à utiliser l'arme nucléaire ou si c'est précisément celle-ci, et le rôle des Etats-Unis, qui les a dissuadés d'aller jusqu'à la guerre ; Kargil en 1999 fournit le dernier exemple en date de ces relations conflictuelles - cette fois, après la nucléarisation des deux pays. Les responsables indiens ne cessent de répéter que la principale menace pour la sécurité du pays vient de la Chine, et non du Pakistan. C'est ainsi que l'essai du Ghauri par le Pakistan en avril 1998, dont la portée est suffisante pour atteindre New Delhi, n'a jamais été présentée en Inde comme ayant pu jouer un rôle dans l'affichage de sa nucléarisation. Nul besoin de souligner qu'en minorant la menace pakistanaise, en dépit de l'existence d'un conflit, certes de basse intensité, mais permanent, au Cachemire qui mobilise un demi-million de soldats indiens, l'Inde entend se poser comme la puissance rivale de la Chine en Asie. La menace chinoise est ainsi explicitement mentionnée dans la lettre envoyée le 11 mai 1998 à Bill Clinton par le Premier ministre indien, qui évoquait « un environnement de sécurité qui se détériorait, notamment l'environnement nucléaire » et déclarait que « nous avons un état nucléaire déclaré sur nos frontières, un état qui a perpétré une agression armée contre l'Inde en 1962 » et qu'« une atmosphère de défiance persiste, essentiellement liée à un problème frontalier non résolu ». Il ajoutait que la Chine avait « aidé un autre de nos voisins à devenir un état nucléaire déclaré ». Il est certain que la rivalité avec la Chine dépasse de loin le seul cadre de la problématique de la sécurité nationale, même si celle-ci reste valable aujourd'hui : l'Inde conteste toujours l'occupation par la Chine, depuis 1960, de territoires situés dans l'ancien Etat princier de Jammu et Cachemire, tandis que la Chine revendique la plus grande partie de l'Arunachal Pradesh et ne reconnaît par le Sikkim comme faisant intégralement partie de l'Inde. Par ailleurs, les deux pays ont un désaccord sur le statut du Bhutan et du Népal et, encore récemment, les questions tibétaines ont pu être sources de tensions potentielles entre les deux pays. L'Inde est également inquiète des relations développées entre la Chine et Myanmar, qui incluent la fourniture d'armements, l'amélioration des infrastructures birmanes et une coopération militaire. Les commentateurs indiens insistent en outre sur la portée toujours plus importante des missiles balistiques chinois, faisant allusion au DF-31 (8 000 km) et au DF-41 (12 000 km) en développement. La modernisation de l'arsenal nucléaire chinois suscite également l'inquiétude, l'Inde ayant toujours vu dans celui-ci un possible outil de « chantage » nucléaire. Les préoccupations de l'Inde concernant l'émergence d'une menace chinoise ne sont cependant pas sans lien avec la question pakistanaise, dans la mesure où les relations étroites entre la Chine et le Pakistan, diplomatiques et militaires, sur lesquelles vos rapporteurs reviendront, préoccupent de longue date les Indiens. Lors du conflit sino-indien de 1962, la Chine s'était officiellement déclarée en faveur d'un référendum au Cachemire, à l'instar du Pakistan et contrairement à ce que la diplomatie indienne a toujours souhaité. L'Inde voit dans l'accord signé entre le Président Zulfikar Ali Bhutto et le Président chinois, en 1976, les fondements de la coopération nucléaire entre les deux pays. De même, les inquiétudes de l'Inde ont été nourries par les accusations récurrentes portées par les Etats-Unis contre la Chine sur ses exportations balistiques et par les sanctions afférentes prises suite à des exportations chinoises jugées dangereuses par les Etats-Unis. (2) Les pressions domestiques Victorieux en mai 1998, le BJP avait déjà conduit un gouvernement deux ans auparavant, qui n'avait tenu que treize jours. Durant ce bref exercice du pouvoir, le BJP avait clairement fait état de son intention de conduire des tests nucléaires, mais y avait renoncé faute d'une majorité suffisante au Parlement. En 1998 au contraire, l'ensemble de la coalition au pouvoir s'est engagée dans son programme électoral à réévaluer la politique nucléaire du pays et à « exercer l'option d'incorporer les armes nucléaires à la défense du pays ». La pression de la communauté scientifique indienne en faveur de tests supplémentaires est venue en renfort des considérations politiques. Celle-ci a en effet toujours joué un rôle majeur dans la conduite du programme indien, au contraire des militaires qui, même aujourd'hui, continuent d'être largement tenus à l'écart du programme et de l'élaboration d'une doctrine militaire. 3) Armes nucléaires et prestige Il est de notoriété publique que l'Inde aspire à figurer au nombre des puissances globales. Or, de longue date, nombreux sont les cercles indiens, notamment au ministère des affaires extérieures, qui considèrent l'arme nucléaire comme un indicateur clé de la puissance étatique, sa possession permettant en l'occurrence à l'Inde d'être placée sur un pied d'égalité avec la Chine et de prévenir toute tentative de chantage nucléaire de Washington ou Pékin. De fait, avec son milliard d'habitants et la deuxième population musulmane au monde, l'Inde est un géant démographique. C'est également une vraie démocratie, qui aspire à faire partie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (déclaration officielle en 1997) et ne ménage pas sa participation aux opérations de maintien de la paix. Depuis 1996, c'est un « partenaire de dialogue » de l'ASEAN et un membre du forum régional de l'ASEAN. Les progrès dans la réforme économique lancée en 1991 ont accru l'intérêt de l'Inde pour des partenariats avec ses voisins, dont témoigne la doctrine Gujral, formulée en 1996-1997, qui vise à l'amélioration des relations de l'Inde avec ses voisins. (4) Les évolutions dans la maîtrise des armements Les progrès de la maîtrise des armements et de la non-prolifération depuis le début des années 1990 représentèrent un sérieux défi pour la posture traditionnelle d'ambiguïté nucléaire. Si, en 1993, l'Inde supporte avec les Etats-Unis une résolution en faveur du TICE, l'opinion indienne se durcit cependant en 1995, dès lors qu'un consensus international se forme sur cette question. C'est par allusion à ce que les Indiens virent comme un rétrécissement de leur fenêtre d'opportunité que vos rapporteurs ont pu entendre à New Delhi que « la bombe indienne est fille de la politique de non-prolifération ». L'Inde vit en effet dans la signature éventuelle d'un tel traité la formalisation et la perpétuation du déséquilibre avec la Chine. En outre, comme l'a rappelé M. Jasjit Singh, directeur de l'Institut des Etudes et analyses de défense, aux membres de la mission, la clause introduite à l'article XIV du traité, qui lie son entrée en vigueur à sa signature par 44 pays disposant de réacteurs nucléaires, incluant de ce fait l'Inde et la Pakistan, a contraint l'Inde à agir : il était prévu en effet que trois ans après la conclusion des négociations et les premières signatures, c'est-à-dire en septembre 1999, les parties au traité se réuniraient afin d'examiner cette clause ainsi que les moyens de permettre l'entrée en vigueur du traité. Le TICE venait ainsi rejoindre le TNP parmi les symboles d'un « apartheid nucléaire » aux yeux des Indiens. Ceux-ci ont en effet toujours dénoncé le TNP comme reconnaissant la prolifération verticale - puisque rien n'empêche les cinq Etats nucléaires reconnus par le TNP de développer et moderniser leurs arsenaux - tout en empêchant la prolifération horizontale. Inutile de souligner à cet égard le revers que représenta pour l'Inde sa prorogation indéfinie en 1995. _ La bombe pakistanaise, fille de la bombe indienne - Une prolifération rapide Contrairement à l'Inde, le développement d'un programme nucléaire civil n'a pas été considéré comme une priorité lors de l'accession du Pakistan à l'indépendance, et ce n'est qu'en 1957 qu'une commission à l'énergie atomique est créée. Quant à l'option nucléaire militaire, c'est au début des années 1970 pour les uns - après la défaite contre l'Inde en 1971, pour les autres en 1974, à la suite de l'explosion « pacifique » indienne - qu'il faut en chercher l'origine. C'est à cette époque que le Pakistan multiplie les efforts pour sceller des coopérations internationales : des négociations très poussées ont d'ailleurs lieu avec la France pour la fourniture d'une usine de retraitement du plutonium mais elles échouent définitivement en 1978, sous la pression des Etats-Unis et du fait du revirement de la politique française de non-prolifération à partir de 1976. En revanche, la coopération avec la Chine qui débute à partir de 1976 permet au Pakistan de progresser rapidement dans l'acquisition d'une capacité nucléaire. Le rôle déterminant de cette coopération n'est cependant pas formellement admis par le Pakistan ; pourtant, la déclaration de Ali Bhutto en 1977, suite à son voyage en Chine avec laquelle un accord est signé en 1976, selon laquelle cet accord est « sa plus grande réussite et sa plus importante contribution à la survie » de [s]on peuple et de [s]a nation » conduit généralement à considérer l'année 1976 comme le point de départ d'une longue coopération entre les deux pays. Le Pakistan a cependant conduit son programme largement par lui-même, sous la double égide de la PAEK, commission pakistanaise de l'énergie atomique, et de l'entreprise du docteur A. Q. Khan, Khan Research Laboratories, deux filières qui continuent d'exister, non sans rivalité parfois. Entretien de la mission avec Le Docteur Abdul Qadeer Khan, Directeur de Khan Research Laboratories, (Islamabad, 6 juillet 2000) « La bombe pakistanaise est une nécessité. Nous n'avions pas d'autres options, même si je suis conscient que c'est une arme horrible. Je suis pour ma part un homme pacifique qui aime les animaux et la nature. Je suis favorable à la signature du TICE : le Pakistan doit se hâter de signer ce traité. Nous avons fait ce que nous avions à faire et je n'ai de cesse, depuis 1998, de conseiller le gouvernement pakistanais en ce sens. Nous devons maintenant écouter l'opinion publique mondiale. Nous ne pouvons rester des hors-la-loi. Je ne suis pour ma part qu'un métallurgiste. J'ai reçu une formation d'ingénieur à Berlin, en Hollande et à Louvin en Belgique. J'ai travaillé à Urenco aux Pays-Bas. Ce que l'on raconte sur le vol des plans de l'usine d'enrichissement à Urenco est une légende : j'ai été accusé d'espionnage, mais relaxé par la justice. Quand je suis revenu au Pakistan en 1976, la décision de construire la bombe atomique était déjà prise depuis 1973-1974. J'ai été recruté directement par le Général Zia Ul-Haq afin de dynamiser le programme nucléaire du pays, après avoir posé mes conditions au préalable : liberté d'aller et venir, liberté d'expression, absence de hiérarchie. Et j'ai commencé à travailler seul, dans un laboratoire envahi de scorpions et autres bêtes, ici, à Rawalpindi. Je gagnais 400 dollars par mois, aujourd'hui 500. En huit mois, j'ai construit une équipe de 25 personnes. Notre budget n'a jamais été supérieur à 20-30 millions de dollars par an, même aujourd'hui. J'avais lu toute la littérature existant sur la construction des bombes atomiques et j'avais déjà beaucoup d'idées après les quinze années durant lesquelles j'ai travaillé en Europe. Ajoutez à cela que je connaissais, grâce à mon passage en Europe, tous les fournisseurs, que je savais qui faisait quoi et c'est ainsi que j'ai pu acheter beaucoup de matériaux, en toute légalité d'ailleurs. Où passe la frontière entre contrebande et commerce ? Difficile à dire. L'équipement et les matériaux fissiles sont en vente libre sur le marché. Il suffisait de s'adresser à des marchands suffisamment avides de profit, comme ils le sont tous. Les fournisseurs sont venus de partout, y compris de France et de Russie, et l'uranium est arrivé au Pakistan sans contrebande. KRL a été le premier laboratoire pakistanais à produire de l'uranium enrichi. J'étais prêt en 1984 : en sept, huit ans, j'avais une quantité d'uranium enrichi suffisante pour faire une bombe et la capacité de la faire détonner avec un préavis d'une semaine. Le Pakistan n'est pas un pays proliférateur : il n'y a jamais eu de fuites de matériaux. Je ne suis pour ma part jamais allé en Irak. Regardez tout ce qu'on peut lire sur les ventes de matériaux nucléaires volés en Russie. Nous savons parfaitement que le moindre incident qui surviendrait au Pakistan serait monté en épingle. Nous prêtons une grande attention à la sécurité nucléaire. Des Saoudiens sont venus au centre de Kahuta en mai 1999 ? Ce n'est pas du tout afin d'acquérir des technologies nucléaires ou balistiques ; la visite du prince Sultan portait sur l'achat par son pays de certains matériels conventionnels (missiles antichars notamment). A vrai dire, il était bien incapable de distinguer ce qu'il avait vu... Bien sûr, les règles internationales de contrôle des exportations sensibles ne sont pas étanches. Les dirigeants d'un pays, ses hommes politiques refusent de vendre des technologies à l'étranger ? Les businessmen sont différents... Vous trouverez toujours un fournisseur disposé à vendre des technologies à l'étranger. Les businessmen ne connaissent pas le MTCR. Mais pour ce qui concerne le Pakistan, il a fabriqué lui-même le missile Ghauri et maîtrise les technologies des grandes puissances. Pourquoi aurait-il eu besoin d'exportations en provenance de Corée du Nord ? Nous sommes responsables. Nous ne sommes pas un « rogue state » (Etat voyou). Pour donner un exemple de cet esprit de responsabilité, sachez que 400 militaires placés sous les ordres d'un général protègent mes installations de recherche et que, depuis les essais de 1998, le dispositif a été renforcé. Nous devons aujourd'hui penser à l'avenir et ne plus regarder le passé. J'ai conseillé à l'ancien Président Sharif de signer le TICE. Je pense que nous devrions également signer un « cut off »12. Nous avons assez de matières fissiles pour nucléariser les villes indiennes. Nous devons donc rejoindre les régimes de non-prolifération. Pour ma part, même si je travaille à l'amélioration du missile Ghauri, mon c_ur appartient désormais à l'organisation charitable que je viens de fonder. Nous devons aujourd'hui nous concentrer sur l'éducation. » L'entretien que les rapporteurs ont eu avec cette figure qu'est le docteur Khan, sur lequel pèse le soupçon d'avoir dérobé les plans de l'usine de centrifugation d'Urenco - ce que l'intéressé nie formellement - est d'une certaine façon révélateur de ce qu'a pu être, avant le renforcement des contrôles à l'exportation, la relative facilité d'une entreprise proliférante. Certes, la faconde bien connue du docteur Khan, que d'aucuns qualifieront de provocation, ne doit pas abuser : le fait est cependant que sept ans après le véritable commencement du programme pakistanais, en 1984, le Pakistan disposait de 20 à 25 kilogrammes d'uranium enrichi, notamment grâce à l'expérience et aux contacts acquis en Europe par Abdul Qadeer Khan. Il est généralement admis que l'accession du Pakistan à la capacité nucléaire date de 1987 ; la CIA en fait d'ailleurs rapport cette même année. L'officialisation des doutes sur le programme pakistanais n'intervient cependant qu'avec la fin de la guerre d'Afghanistan et la dévaluation stratégique du Pakistan qu'elle entraîne aux yeux des Etats-Unis. En 1990, le Président Bush se déclare incapable de certifier que le Pakistan ne dispose pas d'un engin atomique. Le programme balistique pakistanais progresse parallèlement, exclusivement dirigé contre l'Inde, alors que celle-ci, avec l'Agni, vise aussi la Chine. A la mi-1997, le Hatf III (600 km de portée) est testé ; le 6 avril 1998, c'est au tour du Hatf V ou Ghauri (1 500 km) d'être testé. - Les essais de 1998 Les motivations qui ont conduit le Pakistan à procéder à des essais nucléaires en 1998 ne présentent pas le même degré de complexité qu'en Inde, même si certaines - telles que la quête du statut de grande puissance - leur sont communes. Le facteur indien doit être placé en première place pour expliquer les essais pakistanais. Le Pakistan est depuis longtemps conscient de la supériorité de l'Inde, aussi bien militaire que démographique ou économique, et de sa propre vulnérabilité face à une attaque conventionnelle éventuelle de l'Inde, en raison de l'absence de profondeur stratégique. Or, au c_ur de la relation entre l'Inde et le Pakistan, se situe un problème dont le Pakistan a fait une question vitale pour son existence : le Cachemire reste le n_ud des relations indo-pakistanaises et représente dans l'esprit des gouvernements pakistanais successifs « l'affaire non terminée de la partition ». Le Pakistan a toujours estimé que si la domination indienne n'était pas remise en cause, ses revendications sur le Cachemire perdraient de leur poids avec le temps. En procédant à des essais nucléaires, il a donc voulu signifier qu'il restait dans la course et pouvait, à tout moment, relever les défis que l'Inde lui opposerait. Pour prendre la mesure du poids du facteur indien et, in fine, cachemiri dans la décision du Pakistan d'afficher sa capacité nucléaire en 1998, il importe de rappeler qu'en 1998, le Pakistan était confronté à des difficultés internes majeures. En février 1997, la victoire de la ligue musulmane pakistanaise porte au pouvoir Nawaz Sharif qui se ménage plus de pouvoirs qu'aucun dirigeant pakistanais n'en a eus depuis l'indépendance. Malgré tout, le pays est soumis à des désordres civils importants, marqués par des attentats sectaires continuels. Et ce sur fond de situation financière et économique catastrophique : à la mi-mai 1998, la dette extérieure du pays est de 30 milliards de dollars, quand les réserves de change n'atteignent même pas le milliard de dollars. Mais, même dans ces conditions, l'intense pression internationale sur le Pakistan n'a pas joué, en dépit de tous les avantages que ce pays aurait pu retirer de l'option de retenue nucléaire : le Pakistan aurait pu reprendre ses achats d'armes conventionnelles à l'étranger et, pourquoi pas, se faire livrer les 30 F-16 bloqués par l'amendement Pressler voté en 1985 par le Congrès américain qui lie la coopération militaire des Etats-Unis au statut non nucléaire du Pakistan ; les institutions financières internationales auraient en outre considéré avec un _il plus bienveillant les difficultés du Pakistan. Mais aux yeux des dirigeants pakistanais d'alors et d'aujourd'hui, alors que les sanctions décidées à la suite des essais par certains pays ont mis le pays au bord de la faillite, l'Inde a contraint le Pakistan à « un choix obscène entre l'insécurité et l'effondrement financier du pays », comme l'a dit à vos rapporteurs M. Abdul Sattar, Ministre des affaires étrangères du Pakistan. Cette décision a également été nourrie par un rapport des services de renseignement pakistanais faisant état d'une frappe militaire imminente de l'Inde et d'Israël sur le complexe nucléaire de Kahuta. En outre, le Pakistan avait le sentiment que la communauté internationale n'était pas spécifiquement sévère contre l'Inde. Il faut enfin compter avec la pression scientifique et politique en faveur de tests qui permettaient de mettre à l'épreuve des capacités développées de longue date. _ Quelles doctrines, quels arsenaux, quels budgets ? Quelle est aujourd'hui la réalité nucléaire de l'Inde et du Pakistan ? Force est de constater qu'aussi bien en ce qui concerne la portée réelle des essais, la doctrine, les arsenaux ou le budget, les programmes indien et pakistanais suscitent plus d'interrogations qu'ils n'apportent de certitudes. - Quelle a été la puissance et l'objet des essais de 1998 ? Cette question n'a pas qu'une valeur historique : elle vise à évaluer l'état réel de l'avancement des programmes nucléaires dans les deux pays et débouche en définitive sur la question fondamentale de l'éventualité d'essais ultérieurs. Selon le ministère de l'énergie atomique indien et l'organisation pour la recherche et développement militaire, le premier essai effectué le 11 mai 1998 concernait trois engins : un engin à fission d'une puissance de 12 KT environ, un engin thermonucléaire de 43 KT environ et un engin subkilotonnique. Le 13 mai, deux engins d'une puissance de 0,2 et 0,6 KT furent testés simultanément. Le 17 mai, Abdul Kalam, responsable du programme de missiles indien, déclarait dans une conférence de presse que l'intégration des charges nucléaires à des vecteurs (weaponisation) était « achevée ». Selon d'autres sources indiennes, l'engin de 43 KT était une bombe à fission de troisième génération. Quant à l'ancien président de la Commission de l'énergie atomique, P.K. Iyengar, il déclarait en octobre 1998 que trois types d'engins étaient concernés : un engin tactique de faible puissance ; un engin à fission ; un dispositif thermonucléaire. Les relevés sismiques recueillis dans d'autres pays conduisent cependant à mettre en doute les affirmations indiennes : aux dires des spécialistes français notamment, les essais réalisés par l'Inde en 1998 ne permettent pas de déterminer avec certitude l'état d'avancement du programme indien, dans la mesure où les éléments détectés ne correspondent pas aux éléments annoncés. Ainsi, la puissance totale des trois premiers tests ne dépasserait pas 20 KT, tandis que rien n'a été relevé s'agissant des deux essais subkilotonniques. L'Inde a d'ailleurs révisé ses premières estimations à la baisse par la suite, reconnaissant que la puissance combinée des trois premiers essais se situait entre 25 et 30 KT. Ces incertitudes sur le résultat des essais conduisent à mettre en doute la capacité de ce pays à fabriquer des armes thermonucléaires et à poser la question d'éventuels essais qui lui permettraient de passer de la fission à la fusion. Il semblerait par ailleurs que, pour que l'Inde puisse accéder à la simulation et à la miniaturisation des têtes nucléaires, deux séries d'essais seraient encore nécessaires. Lors des entretiens qu'ils ont eus avec les experts et responsables indiens, vos rapporteurs ont eu le sentiment que l'Inde n'avait pas l'intention de procéder à de nouveaux essais et qu'elle respecterait le moratoire qu'elle avait édicté de manière unilatérale en 1998. A très court terme du moins : tous les interlocuteurs rencontrés par la mission ont en effet mis en avant le caractère extrêmement mouvant du contexte stratégique et les incertitudes qui y sont liées. Le même type d'incertitude plane sur les essais réalisés par le Pakistan. Le 31 mai 1998, le docteur A.Q. Khan, déclara que les six tests des 28 et 30 mai avaient porté sur des engins à fission améliorée fonctionnant avec de l'uranium 235. La puissance cumulée développée au cours des essais serait de 50 KT, soit une explosion de 25 KT, deux de 12 KT et trois subkilotonniques. Là encore, les relevés sismographiques attestent de puissances inférieures, la première série de tests ayant développé une énergie comprise entre 6 et 16 KT et la deuxième de 4 à 6 KT. Néanmoins, le nombre et la rapidité de montage des essais réalisés en 1998 ont surpris tous les observateurs, qui, pour certains, y ont vu la preuve de l'aide extérieure reçue par ce pays pour son programme nucléaire. Les spécialistes estiment en effet que les responsables du programme pakistanais ont bénéficié des résultats d'essais à Lop Nor, en 1989. Vos rapporteurs n'ont pas eu la confirmation de ce fait ; en revanche, il semblerait que les Pakistanais aient proposé, après leurs essais de 1998, d'en partager les résultats avec la Chine qui aurait refusé, ce qui pourrait confirmer une collaboration en sens inverse auparavant. Qu'en est-il de l'avenir ? Plus encore qu'en Inde, le Pakistan semble décidé à ne pas procéder à d'autres essais et à s'en tenir au moratoire unilatéral qu'il a lui aussi édicté en 1998. M. Abdul Sattar, Ministre des Affaires étrangères du Pakistan, l'a confirmé aux membres de la mission : le Pakistan, bien que non-signataire du TICE, en appliquera les principes et ne sera pas le premier à reprendre les essais. Les responsables du programme nucléaire pakistanais estiment pour leur part que la preuve a été faite des capacités du Pakistan dans le domaine nucléaire ; aux yeux du docteur Khan, « désormais, nous avons fait ce que nous avions à faire » et il est donc favorable à ce que le Pakistan rejoigne les régimes de non-prolifération. - Quelle est la taille des arsenaux nucléaires indien et pakistanais ? Le même type d'incertitude plane sur le véritable nombre de têtes dont dispose l'Inde et sur la taille de ses stocks de matières fissiles. En 1996, son stock de plutonium militaire pour 1995 était estimé à 330 kg, plus ou moins 30 %, soit une quantité suffisante pour 65 à 90 armes. L'Inde ayant une capacité de séparation du plutonium estimée à 20 kg/an, elle pourrait disposer de plus de 100 têtes en 2005. En 1998, le Conseil américain pour la défense des ressources naturelles (Natural Resources Defense Council ou NDRC) estimait que l'Inde disposait d'un stock de matières fissiles suffisant pour 50 têtes. En 1999, le service de recherche du Congrès américain (Congressionnal Research Service ou CRS) fixait leur nombre à 75. S'agissant des vecteurs, on ignore si l'Inde a la capacité de déployer un missile nucléaire à deux étages ou un dispositif à fission subkilotonnique sur un missile balistique. Les aéronefs demeurent le premier vecteur. S'agissant du Pakistan, ses stocks de matières fissiles (uranium enrichi) sont estimés entre 400 et 600 kg, soit une masse suffisante pour 20 à 30 armes. Le CRS estime leur nombre entre 10 et 15, tandis que la NDRC évoque une douzaine d'armes. - Quelle doctrine ? La mission revient du subcontinent indien avec le sentiment que l'Inde et le Pakistan ont procédé à des essais nucléaires et mis fin à une politique d'ambiguïté suivie de longue date sans avoir pour autant pesé précisément le sens à donner à la nouvelle ligne politique adoptée avec éclat en 1998. Ni l'Inde ni le Pakistan n'ont vraiment expliqué comment les armes nucléaires amélioreront leur sécurité. Jaswant Singh lui-même, ministre des Affaires étrangères, dans son ouvrage Defending India, pose la question de la valeur d'une dissuasion fondée sur des armes nucléaires qui ne sont pas réellement utilisables, nourrissant les interrogations sur le fait de savoir si, en définitive, l'Inde et le Pakistan continuent de n'avoir qu'une capacité nucléaire, ou si ce sont d'ores et déjà des puissances nucléaires. Car en rejetant les paradigmes de la guerre froide comme non pertinents dans leur cas, les responsables et les commentateurs indiens et pakistanais semblent gommer la distinction entre dissuasion et défense : à les croire, la simple possession d'une capacité nucléaire suffirait. La mission a été frappée en effet par ce souci constant de ses interlocuteurs de rejeter les exemples tirés de l'expérience des autres Etats nucléaires, que ce soit en matière doctrinale ou budgétaire. De ce fait, des questions essentielles restent en suspens : contre quelle menace ces armes sont-elles destinées ? Quel est le processus de décision en cas d'emploi ? Comment les réseaux de communication seront protégés ? Combien de vecteurs, combien de têtes ? Pour quel coût ? Autant de questions non résolues à ce jour. - L'Inde : un débat stratégique dense mais une doctrine officielle défaillante. En mai 1998, le Premier ministre indien s'est contenté de présenter les principaux éléments de la doctrine nucléaire indienne : l'Inde ne recourrait pas aux armes nucléaires pour agresser ou menacer un autre pays ; l'arme nucléaire indienne visait à soustraire le pays à toute menace ou coercition nucléaires, visant par-là un objectif d'autodéfense ; l'Inde ne s'engagerait pas dans une course aux armements ; elle observerait un moratoire sur les explosions souterraines ; elle disposait des ressources disponibles pour une dissuasion crédible ; elle était disposée à discuter d'un accord sur le non-usage en premier avec le Pakistan. En novembre 1998, conscient cependant de la nécessité de développer une doctrine nucléaire, le Premier Ministre Vajpayee mit en place une structure à trois niveaux qu'il chargea d'entreprendre une revue stratégique : cette structure comprenait le conseil de sécurité nationale (27 membres), placé sous la présidence du Premier Ministre, un groupe de politique stratégique regroupant les responsables des trois armées et le bureau consultatif pour la sécurité nationale (National Security Advisory Board ou NSAB), institut indépendant mais proche du pouvoir, placé sous la direction de K. Subrahmanyam. C'est en août 1999 que cette dernière entité publia un document définissant les « principes de développement et de déploiement des forces nucléaires indiennes ».13 L'élaboration de la politique nucléaire indienne dans l'année qui suivit les essais apparaît en réalité destinée principalement à l'opinion publique internationale. A cet égard, les autorités indiennes s'attachèrent à transmettre trois messages : en premier lieu, la situation de dissuasion opaque prévalant avant les essais n'avait pas réellement changé, et l'Ouest réagissait de manière excessive ; en deuxième lieu, les craintes concernant une course aux armements étaient injustifiées et relevaient de schémas de pensée propres à la guerre froide, inadaptés au sous-continent indien. En troisième lieu, l'Inde n'avait aucune intention de s'appauvrir en se lançant dans un programme cherchant à rivaliser avec celui des grandes puissances. On ne peut s'empêcher de remarquer cependant que le projet du NSAB laisse entrevoir une force de dissuasion bien plus importante que ne le suggéraient les déclarations officielles... sans pour autant en détailler ni les composantes ni surtout le coût. A cet égard, force est de constater le caractère décevant de ce document, d'autant moins satisfaisant qu'il est tantôt présenté comme reflétant les vues du gouvernement indien, tantôt marginalisé comme étant le simple résultat des réflexions d'un think tank. D'éminents spécialistes indiens se sont toutefois penchés sur ces questions et ont esquissé ce que devrait être la force nucléaire indienne. Le directeur de l'IDSA, Jasjit Singh, que la mission a rencontré, a développé une théorie originale de dissuasion « au repos » (recessed deterrence), qui serait encore à un niveau inférieur à la dissuasion minimale qu'il définit comme« le plus bas niveau d'armement susceptible de provoquer des décès et des destructions tels qu'ils dissuaderaient tout adversaire ». La dissuasion en repos ou en retrait impliquerait quant à elle la possession de capacités crédibles (vecteurs et têtes non assemblées) mais pas la weaponisation. Dans une telle configuration, deux à trois douzaines de têtes suffiraient. Selon Jasjit Singh, l'avantage de cette option est son caractère réversible, donc adaptable aux progrès du désarmement. S'agissant des vecteurs, dont il souligne le caractère crucial, car déterminant pour l'efficacité de la dissuasion, le même expert juge indispensable la constitution à terme d'une triade, le développement d'une composante maritime étant assurément la tâche la plus longue et la plus coûteuse. - Le Pakistan, pour sa part, s'attacha d'abord à critiquer l'Inde, plutôt que d'élaborer une doctrine. En mai 1998, le Premier ministre pakistanais défendit l'option pakistanaise, « due à la weaponisation du programme nucléaire indien ». Il assigna à l'arme nucléaire une fonction de dissuasion de toute agression, nucléaire ou conventionnelle. Aujourd'hui, tout comme l'Inde, le Pakistan insiste sur le caractère minimal de sa dissuasion. Au cours de l'entretien qu'il a accordé à la mission, M. Abdul Sattar, Ministre des Affaires étrangères au Pakistan, a mis en avant la « politique de retenue et de responsabilité » dans laquelle le Pakistan s'était engagé, évoquant notamment les mesures prises en matière de sécurisation de la force nucléaire. Ainsi, après les tests, et malgré sa situation financière désastreuse, le Pakistan a décidé de consacrer 200 millions de dollars sur cinq ans à cette fin (sécurisation des têtes par exemple). En l'absence de système de contrôle des sites par ordinateur, leur sécurité physique est assurée par des militaires. Par ailleurs, le Pakistan s'efforce d'organiser et de sécuriser la chaîne de commandement conduisant à l'emploi des armes. En mars 1999, a été créée une autorité de commandement national (National Command Authority), chargée de la formulation de la politique nucléaire et du contrôle de l'emploi et du développement de toutes les forces nucléaires stratégiques et des organisations stratégiques. La NCA se compose de deux commissions : - la commission de contrôle de l'emploi (Employment Control Committee), présidée par le Chef du gouvernement et composée du Ministre des affaires étrangères (vice-président), du Ministre de la Défense, du Ministre de l'Intérieur, des plus hauts responsables militaires (Chairman Joint Chiefs of Staff Committee ou CJCSC), des Chefs de service (Services Chiefs), du Directeur général de la division des plans stratégiques (secrétaire) et de conseillers désignés par le Président. Cette commission a un rôle d'orientation politique. En cas de conflit, c'est elle qui recommande l'emploi éventuel de l'arme nucléaire à la NCA, la décision revenant en dernière instance au Premier ministre, chef des forces armées pakistanaises ; - la commission de contrôle du développement (Development Control Committee) présidée par le Chef du gouvernement et composée des plus hauts responsables militaires (CJCSC), des Chefs de service, du Directeur général de la division des plans stratégiques (secrétaire) et d'un représentant de l'organisation stratégique et de la communauté scientifique. Cette commission est chargée de contrôler le développement effectif des forces stratégiques. Le secrétariat de la NCA est assuré par la division des plans stratégiques, dirigée par un officier supérieur et établie dans les quartiers généraux des services communs sous l'autorité de la CJCSC. Elle a un rôle de coordination et de prévision, notamment dans l'établissement d'un système de contrôle, de commandement, de communication et de renseignement (C4I) fiable destiné à la NCA. Il a été indiqué à la mission que, sur l'ensemble de ces points, l'aide étrangère, française notamment, serait bienvenue. On notera en outre qu'en février 1999, le Pakistan avait commencé à discuter avec l'Inde du problème des tirs accidentels ou non autorisés, dialogue coupé depuis la crise Kargil au printemps 1999 et le coup d'Etat du 12 octobre 1999. - Quels moyens ? La question des ressources allouées à la dissuasion est celle sur laquelle la mission estime avoir reçu les réponses les moins satisfaisantes, alors qu'il s'agit d'un domaine déterminant pour la crédibilité de la dissuasion que l'Inde et le Pakistan entendent mettre en place. Vos rapporteurs estiment notamment que l'Inde notamment, au vu de la triade qu'elle entend développer dans les deux décennies à venir, sous-estime notablement l'ampleur de l'effort qu'elle devra y consacrer. Les militaires membres de l'United Service Institution of India (USII) estiment que la constitution d'une triade (composante terrestre incluant des missiles portant jusqu'à 5 000 kilomètres, composante aérienne à capacité de courte portée et composante maritime avec déploiement en permanence de deux sous-marins) pouvait être estimée entre 20 et 30 milliards de dollars sur quinze ans, soit un effort budgétaire annuel de 0,5 % du PIB, ce qui représente un budget de la défense de l'ordre de 3 à 3,5 % du PIB. Des chiffres semblables ont été cités lors d'une réunion organisée au Delhi Policy Group, sous la direction de M. Brahma Chellaney, même si vos rapporteurs ont pu constater à cette occasion les divergences d'opinion existant sur ce sujet au sein de la communauté stratégique indienne. _ Un constat global d'inquiétude Au vu de ce débat pour le moins confus, les conclusions de la mission ne sont guère optimistes : - s'agissant des notions de représailles et de non-usage en premier, il semble qu'il ne faille accorder qu'une valeur toute relative aux déclarations indiennes sur le non-emploi en premier, que ne sanctionne aucune obligation légale. Elles sont néanmoins pertinentes pour tenter d'apprécier la taille de l'arsenal que l'Inde va s'efforcer de développer, cette doctrine suggérant une capacité de représailles, donc la capacité de résister à une première frappe. Le Pakistan ne peut pas adopter cette position, étant donné son absence de profondeur stratégique et la force conventionnelle de l'Inde. Une telle asymétrie est préoccupante dans la mesure où elle peut conduire à de mauvaises évaluations de part et d'autre : étant donné que le Pakistan est dans une situation d'infériorité militaire, il doit, pour maintenir la crédibilité de sa dissuasion, paraître prêt à utiliser les armes nucléaires à un stade précoce s'il se sent menacé dans son existence même. De l'autre côté, les Indiens peuvent croire que le Pakistan n'osera pas briser le tabou nucléaire ; - en matière de commandement de contrôle, bien que les deux pays aient prétendu le contraire, on peut légitimement douter de leur capacité dans ce domaine. Pour des raisons de prestige national et afin de préserver la crédibilité de la dissuasion, les gouvernements cherchent à donner l'impression qu'ils maîtrisent les problèmes techniques et scientifiques posés par les armes nucléaires. Pourtant, les risques de tirs accidentels ou non autorisés sont bien réels ; - pour ce qui est du coût du programme nucléaire indien, la mission exprime ses doutes sur le caractère soutenable de l'effort budgétaire que cela peut représenter, en dépit de l'existence de perspectives de croissance favorables en Inde notamment. On rappellera en effet que, s'il est vrai que le budget de la défense a augmenté de 28 % en un an, il n'est pas certain que le budget réellement exécuté reflète cette augmentation. En outre, il représente 2,78 % du PIB, ce qui traduit certes une évolution à la hausse depuis deux ans mais ne compense pas dix ans de baisse consécutive. Ce montant apparaît en outre largement insuffisant pour créer une dissuasion à trois composantes. De plus, l'état de la défense indienne n'est pas satisfaisant comme l'a révélé la crise de Kargil : l'armée de terre a des difficultés pour recruter ; les 1,2 million d'hommes de l'armée indienne sont mal équipés, malgré les contrats d'armement récents avec la Russie, aucune modernisation n'ayant eu lieu depuis le milieu des années 1980. Pour prendre l'exemple des forces aériennes, alors qu'en théorie, l'armée de l'air indienne possède quelque 800 avions, elle ne peut en aligner que moins de 400 et seuls 200 sont capables d'effectuer des missions opérationnelles. L'armée de l'air a en outre l'un des taux d'accidents les plus forts au monde. Enfin, d'un point de vue global, l'augmentation du budget de la défense devra se traduire par une amputation d'autres dépenses publiques dans un contexte budgétaire déjà dégradé, avec un déficit public de 10 % du PIB. La situation économique catastrophique du Pakistan incite plus encore à mettre en doute la capacité de ce pays à se doter des moyens budgétaires adéquats à la mise en _uvre d'un programme nucléaire fiable et sûr ; - même si la catastrophe suggérée par certains experts après les essais de 1998 n'a pas eu lieu, l'effet de résonance suscité par ces essais est indéniable et ne pourra être mesuré qu'avec le recul. En premier lieu, leurs effets psychologiques et politiques sur la poursuite d'autres programmes nucléaires clandestins ne doivent pas être sous-estimés. Qu'en est-il notamment de leurs conséquences sur la politique nucléaire de l'Iran ? En deuxième lieu, ils ne manqueront pas d'avoir une incidence sur le comportement de la Chine, le nucléaire militaire indien étant, avant toute chose, dirigé contre la Chine. Or - et c'est là le troisième volet de cet effet de résonance -, toute évolution de la Chine dans le domaine du nucléaire militaire ne manquera pas de provoquer des réactions en Russie. Au total donc, les essais nucléaires indiens et pakistanais sont porteurs d'un effet « boule de neige » sans doute progressif, difficile à mesurer, mais qui n'en est pas moins certain. Plus encore, les bombes indienne et pakistanaise remettent en cause le fonctionnement de la dissuasion, comme l'a montré l'affrontement des deux pays à Kargil, en 1999. c) Israël ou la continuité dans l'ambiguïté Situé dans un environnement hostile, Israël, dont l'existence même n'est pas reconnue par la majorité des pays du Proche-Orient, présente un très haut risque de prolifération nucléaire. Nul ne doute en effet que ses dirigeants successifs n'aient fait mettre au point une force de dissuasion nucléaire. D'où vient ce consensus, dans la mesure où les autorités israéliennes ont toujours tenu le langage selon lequel Israël ne serait pas le premier Etat à introduire des armes nucléaires au Proche-Orient ? Sans compter leurs multiples déclarations sur le souhait d'Israël de voir s'instaurer une zone exempte d'armes de destruction massive dans la région et le fait qu'Israël a par ailleurs signé, mais non ratifié, le traité d'interdiction des essais nucléaires en 1996. Dans ces conditions, si l'on est condamné aux spéculations sur le programme nucléaire israélien, des sources solides permettent néanmoins de fonder celles-ci. La principale d'entre elles réside dans les révélations faites par un ancien ingénieur nucléaire israélien qui travaillait à Dimona, Mordechai Vanunu, au Sunday Times en 1986. Kidnappé par les services secrets israéliens à la suite de cette interview, M. Vanunu est depuis lors emprisonné, après avoir été condamné à 18 ans de réclusion à la suite d'un procès secret. Depuis lors, le programme nucléaire israélien a fait l'objet d'études sérieuses : l'ouvrage publié en 1998 par Avner Cohen, Israel and the bomb14, retrace ainsi avec beaucoup de précision l'histoire du programme israélien jusqu'aux débuts des années 1970. Faut-il par ailleurs voir dans le fait qu'Israël a toujours refusé de signer le TNP un indice de l'existence du programme nucléaire israélien ? Il est en effet pour le moins tentant de rapprocher l'attitude israélienne vis-à-vis de ce traité de celle qu'ont toujours affichée deux des quatre Etats non-signataires du TNP, l'Inde et le Pakistan, même si les motivations avancées par chacun n'ont rien de commun. _ Un programme nucléaire ancien Il faut remonter à la deuxième moitié des années 1950 pour trouver l'origine du programme nucléaire israélien : en 1955 - 1957, un débat intense agite un cercle restreint de politiques et de scientifiques israéliens sur le caractère faisable et souhaitable de doter Israël d'une capacité nucléaire militaire. Deux événements liés conduisent le Premier ministre israélien, David Ben Gourion, à donner son aval au projet : la crise de Suez et l'aide massive que la France, qui vient elle-même de prendre des décisions fondamentales pour son propre programme, accepte de fournir. La naissance de ce programme est donc indissociablement liée à la coopération qui s'instaure entre Israël et la France, alors que le premier se sent vulnérable et que la seconde, au plus fort de la guerre d'Algérie, cherche à contenir le nationalisme arabe. A la mi-1957, avec l'accord du CEA, Israël signe un contrat avec Saint-Gobain Techniques Nouvelles pour la construction de plusieurs installations à Dimona, y compris d'infrastructure nécessaires à l'extraction du plutonium à partir du combustible usé de Dimona. Peu de temps après, la France fournit même à Israël les plans et les techniques de fabrication des armes nucléaires elles-mêmes : l'un des responsables du CEA de 1951 à 1970, Francis Perrin, reconnut en 1986 que, durant au moins deux années, à la fin des années 1950, Israël et la France avaient collaboré à la conception et au développement d'armes nucléaires. La décision de 1957 trouve un nouvel élan en 1961, quand sont révélés au grand jour les projets balistiques de l'Egypte, grâce à l'aide de savants allemands. Même s'il apparaît aujourd'hui que les services de renseignement israéliens connaissaient le projet balistique égyptien depuis plusieurs années, c'est à ce moment que le spectre de la « fusée arabe » (arab rocket) s'impose dans l'opinion publique. En 1962, le réacteur de Dimona atteint le seuil de criticité. Officiellement, les infrastructures construites dans le désert du Néguev, à Dimona, sont une usine de textile. Mais les photographies par satellite prises en 1960 par la CIA révèlent aux services de renseignement américains la vraie nature de Dimona, trois ans toutefois après le début du programme15. Jamais cependant les scientifiques américains en visite en Israël ne trouveront de preuves directes du programme israélien. La CIA fait état, à la fin de l'année 1966, de l'achèvement de la phase de développement du programme israélien et de l'imminence de l'assemblage d'une première bombe. De fait, il s'avère aujourd'hui que la guerre de 1967 a revêtu une dimension nucléaire majeure, bien que peu connue. Juste avant la guerre des Six jours, Israël a acquis une capacité nucléaire rudimentaire, qu'elle place en alerte opérationnelle au plus fort de la crise. La conclusion du TNP en 1968 ouvre une phase extrêmement tendue dans les relations entre Israël et les Etats-Unis, qui conduit, en 1970, à un arrangement informel entre les deux pays, suite à des rencontres répétées entre le Président Nixon et le Premier ministre Golda Meir : les Etats-Unis renoncent à faire pression sur Israël pour qu'il signe le TNP et mettent fin à leurs visites à Dimona ; en retour, Israël s'engage à garder un profil bas en matière nucléaire : pas d'essai, ni de déclaration, ni de reconnaissance du programme. Il faut attendre 1986 et les déclarations de Mordechai Vanunu pour que le nucléaire israélien revienne avec force au premier plan de la scène internationale. Il n'existe à ce jour aucune preuve qu'Israël ait conduit des essais nucléaires : on estime généralement que seuls ont fait l'objet de tests les composants non nucléaires et que, pour le reste, Israël s'est appuyé sur la simulation par ordinateur et sur ses collaborations extérieures. Ainsi, Israël aurait obtenu des éléments sur le premier essai nucléaire français de 1960, de même que sur les essais américains de l'époque. La principale interrogation sur l'éventualité d'un essai israélien porte sur le signal détecté par un satellite de surveillance américain VELA dans l'Atlantique Sud, le 22 septembre 1979. Ce signal, qui correspond à une explosion nucléaire de faible puissance, a été attribué par certains à l'Afrique du Sud et, pour d'autres, à Israël. Selon le journaliste américain Seymour Hersh, auteur en 1991 d'un ouvrage sur le nucléaire israélien, L'option Samson, ce flash serait effectivement dû à l'essai d'une arme nucléaire israélienne et serait, en l'occurrence, la troisième d'une série, les précédents n'ayant pas été détectés à cause des nuages. En réalité, la « paternité » du flash relevé en 1979 reste à ce jour inconnue... _ L'arsenal israélien Les évaluations sur le programme israélien ont laissé libre cours à toutes sortes de spéculations, plus ou moins porteuses d'arrière-pensées. Les analyses des instituts de recherche conduisent à des conclusions contradictoires sur le nombre et la qualité des armes israéliennes, les hypothèses allant de 70 à 200 armes, à fission pour la plupart. D'après le témoignage de Vanunu, le Sunday Times avait réalisé des projections qui conduisaient à estimer cet arsenal à 200 engins nucléaires. En réalité, au vu des capacités de production de plutonium du réacteur de Dimona, la taille de l'arsenal nucléaire israélien peut être estimée à moins de 100 armes, probablement entre 70 et 80. S'agissant de la nature des armes israéliennes, on estime généralement, qu'en l'absence d'essais, Israël n'a pas acquis la capacité thermonucléaire. Seymour Hersh estimait en 1991, sur la base d'entretiens avec les spécialistes des services de renseignement américains, qu'Israël possédait plusieurs centaines de têtes tactiques, dont beaucoup sous la forme de mines terrestres ou de pièces d'artillerie, de même que des armes thermonucléaires. La dernière évaluation sérieuse à ce jour porte sur la quantité de matières fissiles possédée par Israël, qui permet de déduire le nombre théorique d'armes nucléaires qu'il a la capacité d'assembler. Ainsi, le 9 octobre 1999, le Times faisait état d'un rapport secret du Ministère de l'Energie américain, selon lequel Israël se classerait au sixième rang des Etats détenteurs d'armes nucléaires. Selon ce document, Israël posséderait de 300 à 500 kilogrammes de plutonium de qualité militaire, soit un stock suffisant pour assembler au moins 250 têtes nucléaires. Par comparaison, la Russie, avec ses 140 tonnes de matières fissiles, arrive largement en tête, devant les Etats-Unis (85 tonnes), puis, loin derrière, le Royaume-Uni (7,6 tonnes), la France (6 à 7 tonnes) et la Chine (1,7 à 2,8 tonnes). L'Inde pour sa part posséderait 150 à 250 kilogrammes de matières fissiles, et la Corée du Nord 23 à 35 kilogrammes de plutonium militaire. En ce qui concerne les vecteurs, Israël déploie aujourd'hui deux systèmes balistiques à capacité nucléaire, le Jericho I et le Jericho II. On estime que cinquante Jericho I (missile à deux étages à carburant solide d'une portée de 660 km environ) seraient déployés sur des lanceurs mobiles. Le Jericho II présente les mêmes caractéristiques techniques mais a une portée de 1 500 km. Selon certains analystes, le lanceur spatial Shavit pourrait être modifié pour porter une charge de 500 kg sur 7 800 km, ce qui donne à Israël une capacité balistique intercontinentale. _ La politique d'ambiguïté nucléaire israélienne : une option soutenable ? La rationalité stratégique de l'acquisition de l'arme nucléaire par Israël s'explique aisément d'un point de vue théorique : d'une part, l'absence de profondeur stratégique d'Israël le rend très vulnérable à une attaque conventionnelle et laisse aux responsables israéliens un temps de réaction extrêmement bref ; d'autre part, la prépondérance démographique des voisins d'Israël place ce pays dans une position d'infériorité stratégique chronique. Dans les faits, Israël n'a jamais reconnu posséder l'arme nucléaire et, a fortiori, n'a jamais affiché de stratégie de dissuasion. C'est en 1961 que la doctrine d'ambiguïté nucléaire israélienne a été formulée par Shimon Pérès, alors adjoint du Premier ministre David Ben Gourion, quand il déclara qu'« Israël ne serait pas le premier pays à introduire l'arme nucléaire au Moyen-Orient ». Telle est depuis lors la ligne adoptée par tous les gouvernements israéliens. Elle a été complétée en 1981 par la « Doctrine Begin », définie lors de la frappe par l'aviation israélienne du réacteur de recherche irakien Osirak livré par la France, producteur de plutonium. A cette occasion, le Premier ministre israélien Menahem Begin déclara qu'Israël bloquerait toute tentative de ses adversaires d'acquérir des armes nucléaires. Le tabou nucléaire israélien est-il tenable ? La publication dans la presse, après autorisation de la censure militaire, de certains procès-verbaux de séance du procès de l'ingénieur nucléaire Mordechai Vanunu, le 24 novembre 1999, a suscité un débat passionné entre experts et journalistes sur l'opportunité de maintenir en l'état la doctrine officielle d'ambiguïté nucléaire. Les autorités israéliennes n'ont pas réagi ; seul M. Dan Meridor, Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset a déclaré qu'Israël ne devait pas « changer [sa] politique sur la question de la force nucléaire, si elle existe ou non. Cette attitude est bonne pour les intérêts d'Israël. Il ne faut pas en changer ». La presse israélienne a souligné que cette attitude était partagée par les experts militaires et les responsables des services de renseignement qui justifient cette politique particulière par le fait qu'Israël est lui-même confronté à des problèmes de sécurité particuliers , « qui obligent à des mesures qui n'ont pas cours dans les autres pays occidentaux » (M. Yossi Alper, directeur en 1999 du Centre Jaffee d'Etudes Stratégiques de Tel Aviv). La séance très agitée qui s'est tenue sur la question nucléaire à la Knesset le 1er février 2000 témoigne des débats passionnés que le tabou nucléaire continue de susciter en Israël. Le député arabe israélien, M. Issam Mahoul, qui avait demandé la tenue de ce débat, a en effet violemment mis en cause la politique d'Israël dans le domaine nucléaire et notamment déclaré que « tout le monde [sait] qu'Israël entasse à une grande échelle des armes nucléaires, chimiques et biologiques, qui sont à l'origine de la course aux armements non conventionnels dans la région », que, depuis 1986, l'arsenal nucléaire d'Israël est passé de cent bombes « au nombre fou de 200 à 300 », que les trois sous-marins construits offerts par l'Allemagne « vont être équipés d'armes nucléaires » afin de donner à Israël une capacité de frappe en second. Nul besoin de souligner la tempête qu'ont déclenchée ces déclarations parmi les députés membres des partis de la coalition gouvernementale ou de l'opposition. Faut-il interpréter cette décision d'ouverture des procès-verbaux du procès Vanunu, à laquelle les plus hautes autorités israéliennes ne pouvaient être étrangères, comme un signe d'évolution de la doctrine nucléaire d'Israël ? Aux yeux de la mission, cet épisode vient au contraire renforcer la politique d'ambiguïté traditionnelle : pour garder sa force dissuasive, une doctrine de flou nucléaire doit en effet être, à intervalles réguliers, rappelée, sinon ranimée, que ce soit à l'opinion publique nationale ou aux acteurs régionaux et internationaux. Or, force est de constater que les dirigeants israéliens maîtrisent parfaitement cet exercice. Il suffit pour s'en convaincre de confronter les différentes déclarations de l'ancien Premier ministre Shimon Pérès, qui a joué un rôle de premier plan dans la construction du centre nucléaire de Dimona. Ce dernier a, en effet, réagi très vigoureusement à la publication des procès-verbaux du procès Vanunu, estimant que ces révélations constituaient « une atteinte tangible à la sécurité d'Israël, et portent préjudice dans le même temps aux relations avec les pays voisins, l'Egypte en premier lieu ». Mais certains propos de l'ancien Premier ministre lui-même peuvent être interprétés comme une reconnaissance tacite du programme israélien. Il déclarait ainsi en 1995 que « Nous n'avons pas construit cette option [nucléaire] pour arriver à Hiroshima, mais bien davantage pour arriver à Oslo », faisant allusion au lieu de signature des premiers accords avec les Palestiniens. En ajoutant que, si Israël « avait été attaqué cinq fois, sans avoir provoqué qui que ce soit, [c'est] parce que certains de nos voisins pensaient qu'ils pouvaient nous surclasser » et qu'en conséquence, Israël « voulait créer une situation dans laquelle cette tentation n'existerait plus », Shimon Pérès, sans reconnaître explicitement le statut nucléaire d'Israël, en fournissait toutefois la principale justification théorique. Le retour sur le devant de la scène de l'affaire Vanunu sert donc les intérêts de la politique israélienne, sans compter qu'à un stade crucial des négociations sur le processus de paix, elle a rappelé avec force la priorité politique accordée à la sécurité d'Israël. Mais, au-delà de la ligne de fracture entre députés arabes et juifs révélée par le débat à la Knesset, la question posée est bel et bien celle du caractère soutenable de cette politique d'ambiguïté, alors qu'Israël s'est trouvée, d'une certaine manière, marginalisée par l'officialisation du statut nucléaire indien et pakistanais. Bien que les différents interlocuteurs rencontrés en Israël par la mission aient estimé que les événements de 1998 ne changeraient rien à la posture traditionnelle d'Israël, les débats intérieurs des derniers mois montrent la pertinence d'une réévaluation de la doctrine nucléaire israélienne, plus encore dans un contexte de guerre permanente qui montre l'impuissance des armes nucléaires dans ce cas. La catégorie des candidats au nucléaire regroupe des pays conduisant, ayant conduit ou sur lesquels pèse le soupçon de conduire un programme nucléaire. Cette définition souligne le problème méthodologique qui s'attache au traitement de ce type de programme, dans la mesure où, la plupart du temps, les informations ne peuvent être formellement prouvées et vérifiées et font davantage appel à la technique du faisceau d'indices. Au sein de cette catégorie hétérogène, plusieurs cercles apparaissent selon le degré d'avancement qu'ont pu atteindre les pays concernés : - dans un premier cercle se trouvent des pays qui ont été très proches d'acquérir l'arme nucléaire, tels que la Corée du Nord et l'Irak, qui ont pour point commun d'avoir vu leur programme stoppé par les efforts de la communauté internationale ; - dans un deuxième cercle figure l'Iran, pays sur lequel pèsent de forts soupçons, sans qu'existent pour autant de preuves formelles de sa volonté de se doter de l'arme nucléaire. La mission elle-même n'est pas en mesure de fournir de preuves sur l'existence du programme iranien ; au fur et à mesure des entretiens qu'ils ont menés, ses membres ont toutefois recueilli des informations concordantes qui tendraient à montrer que l'Iran mène une politique nucléaire très active et souhaitent donc, en toute objectivité, porter ces informations à la connaissance de l'opinion publique ; - le troisième et dernier cercle regroupe des Etats qui ont eu de petits programmes nucléaires rudimentaires, tels que la Libye ou l'Algérie. _ La Corée du Nord : un programme maîtrisé ? Peu d'informations sortent des frontières jusqu'alors quasi totalement hermétiques de la Corée du Nord. Néanmoins, la plupart des spécialistes s'accordent à considérer ce pays comme l'un des plus proliférants, toutes armes de destruction massive confondues, qu'il s'agisse de prolifération verticale (programmes nucléaire, chimique, biologique et balistique) ou horizontale dans le domaine balistique. Le trait dominant de la prolifération nord-coréenne réside dans son caractère largement autonome, le pays ayant avec constance, depuis plusieurs décennies, développé des capacités telles qu'il possède une des plus grandes armées du monde, forte de plus d'un million de personnes. - L'histoire encore mal connue du programme nord-coréen Le programme nucléaire nord-coréen est né dans les années 1960, avec l'acquisition auprès de l'Union soviétique d'un petit réacteur de recherche. A partir de cette base, la Corée du Nord a développé un programme indigène au sein du complexe de Yongbyon, dont le c_ur est constitué par : - un réacteur nucléaire expérimental en fonctionnement de 5 mégawatts ; - une usine de retraitement du plutonium partiellement achevée ; - plusieurs laboratoires de radiochimie pouvant être utilisés pour l'extraction du plutonium ; - une usine d'essais d'explosifs ; - une usine de fabrication de combustibles ; - et un réacteur partiellement achevé de 50 mégawatts. Par ailleurs, un réacteur de 200 mégawatts était en construction à Taechon jusqu'à l'accord de 1994 sur lequel on reviendra16. A ce jour, les étapes et l'ampleur de ce programme restent très mal connues. Il est acquis que le réacteur plutonigène de 5 mégawatts fut opérationnel en 1986, qu'au début des années 1990, la Corée du Nord maîtrisait l'ensemble du cycle du combustible permettant de produire du plutonium et que le déchargement du combustible du réacteur de 5 mégawatts aurait permis d'extraire une quantité suffisante de plutonium militaire pour fabriquer une à deux armes rudimentaires. - La crise et l'accord bilatéral de 1994 L'existence du programme nucléaire nord-coréen est découverte par les services de renseignement américains en 1984. En 1985, la Corée du Nord adhère au TNP mais ne conclut l'accord de garantie avec l'AIEA prévu par le traité que le 9 avril 1992. C'est donc seulement en mai 1992 que l'AIEA a pu commencer à mener des inspections et des visites destinées à vérifier l'inventaire initial des installations et matériaux nucléaires fourni par la Corée du Nord. Dès l'été et l'automne 1992, des écarts flagrants apparaissent entre cet inventaire et les résultats des inspections de l'AIEA concernant le niveau passé de la production de plutonium. Plus particulièrement, les analyses chimiques faites par l'AIEA à partir des échantillons de plutonium fournis par Pyongyang contredirent les déclarations de la Corée du Nord selon lesquelles elle aurait séparé quelques grammes de plutonium en une seule fois. Les analyses révélèrent au contraire que le plutonium avait été séparé à quatre reprises sur trois ans, à partir de 1989, ce qui venait nourrir les soupçons américains quant à l'existence d'un stock significatif de plutonium militaire. Face à ces multiples contradictions, l'AIEA demanda au début de l'année 1993 à mener une inspection spéciale sur deux sites non déclarés proches du complexe nucléaire de Yongbyon supposés contenir des déchets issus du processus de séparation du plutonium. La Corée du Nord refusa d'accéder à cette demande et annonça qu'elle se retirait du TNP, comme le traité en ouvre la faculté à tout Etat qui juge que ses intérêts nationaux suprêmes sont en jeu, à la condition de notifier son retrait 90 jours à l'avance. Ce processus de retrait fut cependant suspendu à l'issue de négociations avec les Etats-Unis en juin 1993, la Corée du Nord continuant néanmoins de déclarer qu'elle n'était plus pleinement partie au TNP et que l'AIEA n'avait par conséquent plus le droit de mener d'inspection de routine. Cette attitude conduisit le directeur général de l'AIEA, Hans Blix, à déclarer en 1993 que l'agence de Vienne n'était plus en mesure de fournir l'assurance que des matériaux nucléaires n'étaient pas détournés à des fins militaires en Corée du Nord. C'est en 1994 cependant que la crise atteint son paroxysme quand d'une part, la Corée du Nord, après avoir accepté une inspection de l'AIEA, refusa au dernier moment à celle-ci l'autorisation de prélever des échantillons radioactifs de l'usine d'extraction du plutonium de Yongbyon, et que d'autre part, en mai 1994, elle commença le déchargement du réacteur de 5 mégawatts sans accepter de suivre les procédures de garantie de l'AIEA. Or, seul le combustible usagé de ce réacteur permettait de reconstituer l'histoire du programme nord-coréen et, par conséquent, de savoir la quantité de plutonium qui avait pu en être extraite auparavant. Ce geste de la Corée du Nord conduisit le directeur de l'AIEA à répéter, dans une lettre adressée au Conseil de Sécurité, le 2 juin 1994, qu'il ne pouvait donner l'assurance que la Corée du Nord n'avait pas détourné des matériaux nucléaires, et à suspendre au même moment toute assistance technique à l'égard de ce pays. Le 13 juin, la Corée du Nord annonçait son retrait de l'AIEA. Si, dans un premier mouvement, les Etats-Unis proposèrent au Conseil de Sécurité, le 15 juin 1994, d'adopter une série de sanctions contre la Corée du Nord, c'est cependant la voie de la négociation qui fut rapidement privilégiée et aboutit à la signature, le 21 octobre 1994, d'un accord cadre entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Aux termes de cet accord, la Corée du Nord s'engagea à geler les opérations en cours dans ses installations nucléaires, et notamment à stopper la production de matières fissiles de qualité militaire, et promit de démanteler à terme ses réacteurs graphite-gaz et son usine de retraitement du combustible. En échange, un consortium multinational était constitué qui s'engageait à construire deux réacteurs à eau légère de 1 000 mégawatts, moins proliférants, et à livrer 500 000 tonnes de pétrole par an jusqu'à l'achèvement du premier de ces réacteurs. Ce consortium, plus connu sous le nom de KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization) fut mis en place le 9 mars 1995. Initialement composé de trois pays, les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon, il regroupait en 1997 11 membres et recevait des contributions internationales de 23 pays. Depuis l'accord du 15 mars 1997 entre la KEDO et l'Union européenne, Euratom est membre du bureau de l'organisation et contribue à hauteur de 86 millions de dollars sur cinq ans. La construction des réacteurs a commencé en août 1997 et devrait durer une dizaine d'années, pour un coût total de 6 milliards de dollars environ. En outre, selon ce même accord, la Corée du Nord reste membre du TNP même si elle n'a plus l'obligation de respecter l'ensemble des accords de garantie de l'AIEA jusqu'à ce qu'une partie significative du projet de réacteur à eau légère ait été mise en _uvre. Ceci signifie que, durant quatre à six ans, l'AIEA ne pourra pas mener les inspections nécessaires à la vérification de l'inventaire initial fourni par la Corée du Nord en 1992. - Quel bilan de l'accord de 1994 peut-on dresser aujourd'hui ? Les avantages de l'accord de 1994 sont indéniables dans la mesure où il a conduit au gel, voire au démantèlement, d'installations nucléaires qui auraient donné à la Corée du Nord la capacité de produire et éventuellement d'exporter une douzaine d'armes nucléaires par an. En outre, même si elle est repoussée à une échéance lointaine, l'inspection des deux sites de déchets non déclarés par l'AIEA est prévue, ce qui représente le seul moyen de connaître précisément la véritable histoire du programme nucléaire nord-coréen. Sur un plan plus général, la construction des réacteurs à eau légère, qui a conduit des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers sud-coréens à travailler en Corée du Nord pendant une décennie est de nature à contribuer à l'amélioration des relations entre les deux Corée, dont nous observons d'ailleurs les prémisses actuellement. Les inconvénients de l'accord de 1994 ne l'emportent-ils cependant pas sur ses avantages ? En premier lieu, la bilatéralisation du problème nord-coréen a marginalisé les régimes internationaux de prolifération, alors même que tous s'accordent à en souligner la quasi-universalité. De fait, même si c'est elle qui a dénoncé les violations nord-coréennes au Conseil de sécurité de l'ONU, l'AIEA ne sort pas grandie de la crise de 1994 : certes, l'acceptation par la Corée du Nord de l'inspection par l'AIEA de deux sites controversés représente un acquis non négligeable ; d'un autre côté, l'échéance fixée crée un précédent fâcheux et compromet l'efficacité même de cette inspection. De fait, à ce jour, nous ignorons toujours l'état réel du programme nord-coréen d'accès au plutonium, l'AIEA n'ayant pas encore été autorisée à accéder aux combustibles stockés pour y faire des prélèvements. A l'occasion d'une présentation au Conseil de Sécurité de l'ONU en octobre 1998, le Directeur de l'Agence, Monsieur El Baradeï, a rappelé que les inspecteurs avaient pu vérifier le gel des réacteurs graphique-gaz nord-coréens de Yongbyon et des installations afférentes. En outre, l'Agence de Vienne maintient une présence continue d'inspecteurs sur place. Reste qu'elle n'est toutefois pas en mesure de vérifier l'exactitude ni l'exhaustivité des déclarations nord-coréennes. Par ailleurs, cet accord peut donner l'impression que la communauté internationale a cédé au chantage et récompensé la Corée du Nord : n'a-t-on pas trop donné à ce pays, courant ainsi le risque d'un « toujours plus de concessions » de sa part ? Par exemple, Pyongyang a menacé de rompre l'accord KEDO si Washington et ses alliés ne lui octroyaient pas l'assistance en pétrole dont elle avait besoin. De même, si elle a bel et bien gelé le fonctionnement de plusieurs de ses installations-clés et mis fin à la construction de deux réacteurs, la construction, à Kumchang, d'une infrastructure souterraine, qui pourrait servir à la production de matériaux nucléaires et que la Corée du Nord a qualifié de « structure souterraine civile », suscite de multiples interrogations. Bien que les inspections conduites sur place par les Etats-Unis en mai 1999 aient montré que cette infrastructure n'était encore qu'un coffrage de béton - jugement confirmé par le directeur de l'Agence qui estime pour sa part que cette installation ne sera pas opérationnelle avant trois ou cinq ans -, il est vraisemblable que la Corée du Nord ait, avec Kumchang, voulu marquer son mécontentement vis-à-vis de ce qu'elle estime être un faible empressement des Etats-Unis dans la mise en _uvre de l'accord de 1994 ou bien ait tenté d'obtenir des concessions supplémentaires des Américains. Enfin, rien ne permet d'exclure que, sous la pression de factions politiques et scientifiques, la Corée du Nord ne nourrisse toujours des ambitions nucléaires et ne cherche à reconstituer son programme. Dans la mesure où elle a développé des moyens exclusivement indigènes, il n'existe, en l'absence d'inspections approfondies, aucune preuve formelle de l'abandon de toute recherche. Sans doute les procédures exceptionnelles mises en _uvre par la communauté internationale afin d'éviter l'apparition d'une bombe nord-coréenne visaient-elles avant tout à maintenir ce pays au sein des régimes de prolifération, qui représentent l'une des seules enceintes du dialogue avec ce pays aux frontières hermétiques. On ne peut à cet égard que se réjouir de l'annonce, par les dirigeants nord-coréens à l'été 2000, de la participation de la Corée du Nord au forum régional de l'ASEAN. Reste à espérer cependant que le message pour le moins ambigu délivré aux candidats à la prolifération à l'occasion du traitement du programme nucléaire nord-coréen ne suscitera pas des vocations. _ L'Irak ou le nucléaire sous contrôle L'étendue du programme nucléaire irakien est apparue au grand jour avec la mise en _uvre de la résolution n° 687 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en avril 1991 après la défaite de l'Irak dans la guerre du Golfe, qui établissait les procédures sans précédent de destruction des armes non conventionnelles possédées par l'Irak ainsi qu'un programme de surveillance destiné à en empêcher la reconduction. Le 13 octobre 1998, le directeur général de l'AIEA, M. Mohammed El Baradei, rapportait au Conseil de sécurité que « les capacités irakiennes connues en matière d'armes nucléaires avaient été détruites, enlevées ou rendues inoffensives ». Tel n'est cependant pas le sentiment des experts américains, alors que, depuis la crise de la fin de l'année 1998, les inspections et contrôles sur place ont été interrompus et qu'en 1996 et 1997, la Commission spéciale des Nations Unies en Irak (UNSCOM) a acquis la certitude que, dans le domaine balistique, l'Irak avait repris ses efforts d'acquisition de matériaux auprès de fournisseurs étrangers. - L'ampleur insoupçonnée du programme irakien La prise de conscience par la communauté internationale de l'étendue du programme nucléaire irakien a été progressive, résultant d'une part des découvertes faites par les inspecteurs de l'AIEA après la guerre du Golfe, d'autre part des révélations du Général Hussein Kamel, ancien ministre de l'Industrie et de l'industrialisation militaire, après sa défection en Jordanie le 8 août 1995. Les inspections conduites en Irak par l'AIEA ont établi que l'Irak avait massivement violé le TNP en poursuivant en toute clandestinité un programme nucléaire militaire de plusieurs milliards de dollars, connu sous le code secret « Pétrochimique 3 », mené par des milliers de techniciens dans de multiples infrastructures. Dès leur sixième inspection, les inspecteurs de l'AIEA mirent en effet la main sur des documents révélant l'étendue du programme nucléaire irakien, ce qui conduisit les autorités irakiennes à en admettre l'existence. D'après les experts de l'AIEA, sans la guerre du Golfe, l'Irak aurait pu fabriquer sa première bombe atomique à partir d'uranium enrichi de qualité militaire produit par elle-même dès l'automne 1993. L'une des caractéristiques majeures du programme irakien réside dans la multiplicité des voies techniques de production de matières fissiles qu'il a empruntées. En fait, presque toutes les techniques connues d'enrichissement de l'uranium ont été expérimentées, à des stades plus ou moins avancés, par les scientifiques irakiens : séparation par isotope électromagnétique, centrifugation, enrichissement chimique, diffusion gazeuse, séparation isotopique par laser. Sans compter par ailleurs les tentatives clandestines de production et de séparation de plutonium à partir d'une infrastructure qui était pourtant placée sous le contrôle de l'AIEA. Les inspecteurs ont ainsi découvert que les infrastructures destinées à l'enrichissement de l'uranium par séparation électromagnétique avaient été construites à l'échelle industrielle à partir de 1982, suite à la décision des autorités irakiennes d'abandonner le réacteur de recherche Osirak après son bombardement par l'aviation israélienne en 1981. Au moment de l'intervention alliée en Irak, 8 séparateurs étaient opérationnels et 17 en cours d'installation, sur un total de 90 prévus par la commission de l'énergie atomique irakienne. Les projections faites par les équipes de l'AIEA établirent alors que l'Irak aurait disposé d'une capacité de production à grande échelle d'uranium enrichi par ce moyen d'ici 18 à 36 mois ; plus récemment, les experts de l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI) ont estimé que l'Irak aurait pu disposer de 15 kg d'uranium enrichi entre la mi-1994 et la mi-1995. Dans les deux cas de figure, l'Irak était bien plus proche de voir ses efforts aboutir que ne le supposait le monde occidental avant la guerre du Golfe. D'aucuns pourront se demander comment un effort aussi massif n'a pu être détecté : l'explication réside dans le développement totalement indigène de cette partie du programme nucléaire irakien, rendu possible par l'abondante littérature ouverte sur le sujet et l'astuce des ingénieurs irakiens qui ont utilisé des techniques modernes sur une technique d'enrichissement considérée comme obsolète par le monde occidental. Le programme d'enrichissement de l'uranium par centrifugation gazeuse, développé plus tard, s'est au contraire appuyé sur une politique active d'acquisition de matériaux et de savoir-faire auprès de fournisseurs étrangers. Notamment, trois scientifiques allemands ont, par des canaux séparés, fourni des conseils précieux à l'Irak dans ce domaine. L'ampleur acquise en un temps relativement bref par les infrastructures destinées à la centrifugation gazeuse est révélatrice de l'importance que l'Irak attachait à cette technique d'enrichissement de l'uranium. Les deux autres voies - enrichissement chimique et séparation isotopique au laser - n'ont été suivies qu'à la marge : aux dires des scientifiques irakiens, la première aurait été abandonnée en 1987 faute des infrastructures nécessaires ; quant à la seconde, niée dans un premier temps par le gouvernement irakien, elle a vu son existence admise après qu'une inspection de l'AIEA en a apporté la preuve irréfutable en 1994. Quant à la voie du plutonium, elle est restée à un stade très limité, la capacité irakienne de séparation du plutonium ne dépassant pas 60 grammes par an. S'agissant de la mise au point des armes elles-mêmes, elle n'en était qu'à ses débuts au moment de l'intervention alliée. La guerre du Golfe et ses conséquences ont sans conteste entraîné une régression majeure des capacités irakiennes dans le domaine nucléaire : de nombreuses infrastructures liées au programme nucléaire militaire de l'Irak ont été détruites par les bombardements alliés, quand elles n'ont pas été démantelées par les Irakiens eux-mêmes, soucieux de tromper les inspections. Les destructions opérées par l'AIEA elle-même ont achevé de démanteler les infrastructures irakiennes. Le 19 septembre 1994, le directeur général de l'AIEA pouvait ainsi déclarer que l'agence de Vienne avait achevé la destruction et le déménagement de toutes les infrastructures nucléaires connues de l'Irak. Dès le 26 novembre 1993, l'Irak avait formellement accepté la surveillance de long terme par l'AIEA de ses installations. Les révélations du Général Hussein Kamel en août 1995 montrèrent que la communauté internationale n'en avait pas fini avec le programme nucléaire irakien. L'ancien ministre irakien avoua, entre autres éléments, qu'à la suite de l'invasion du Koweït en août 1990, l'Irak s'était engagé dans un programme de développement d'un engin nucléaire rudimentaire par extraction de matières fissiles militaires du combustible de réacteurs de recherche placés sous contrôle international. Saddam Hussein avait donné l'ordre de ce « programme-crash » destiné à doter l'Irak, le plus rapidement possible, d'une arme nucléaire, même grossière. 36 kg d'uranium hautement enrichi furent ainsi détournés à partir de septembre 1990, l'échéance du programme-crash ayant été fixée au mois d'avril 1991. Cette dernière était en réalité très optimiste et l'on estime que ce programme n'aurait pu être mené à bien qu'à la fin de l'année 1992. Les révélations du Général Hussein conduisirent en outre l'AIEA à de nouvelles découvertes sur le processus de mise au point de l'arme nucléaire elle-même. - Un programme sous contrôle ? Dans les années récentes et notamment depuis la crise de 1998, qui a mis fin aux travaux de l'UNSCOM en Irak, les préoccupations de la communauté internationale liées aux programmes d'armes de destruction massive irakiens ont surtout porté sur les capacités chimiques, biologiques et balistiques de l'Irak. S'agissant du nucléaire en revanche, le message délivré par l'AIEA sur la destruction ou, au moins, la neutralisation du programme irakien conduisait à penser que celui-ci était sous contrôle, même si, comme l'avait souligné l'agence de Vienne en 1996, l'expertise scientifique, technique et humaine restait en place, constituant une base idéale pour la reprise éventuelle du programme. Le débat complexe qui s'est noué entre les grandes puissances sur les modalités d'inspection en Irak et, plus fondamentalement, sur le bien-fondé de la politique américaine de refus strict de levée des sanctions tant que l'Irak n'aurait pas autorisé toutes les inspections, a conduit certains spécialistes à mettre en doute les conclusions de l'AIEA. Des experts, à l'instar de Paul Leventhal, Président du Nuclear Control Institute, vont jusqu'à estimer que la menace représentée par les capacités nucléaires de l'Irak est peut-être, aujourd'hui encore, plus élevée que celle, généralement mise en avant, liée aux autres armes de destruction massive et aux missiles, du fait même que le savoir-faire et l'expertise - humaine notamment avec la présence de 200 ingénieurs qui poursuivent leurs travaux sur des projets secrets - sont encore en place. Devant la Commission des relations extérieures du Sénat américain, le 22 mars dernier, ce même expert a rappelé en outre que le trafic routier entre la Turquie et l'Irak reste largement incontrôlé et que l'AIEA a autorisé l'Irak à conserver 1,7 tonne métrique d'uranium 235 enrichi à 3,6 %. _ L'énigme iranienne Le cas iranien pose un problème de méthodologie dans la mesure où il n'existe aucune preuve formelle et irréfutable de l'existence d'un programme nucléaire dans ce pays. Pour cette raison, et également parce qu'elle ne dispose pas de sources d'information qui lui sont propres, la mission n'est donc pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'exactitude des renseignements fournis par l'abondante littérature ouverte, quasiment exclusivement américaine, qui existe sur le sujet. Elle manquerait pourtant à son devoir d'exhaustivité si elle ne présentait pas les éléments et hypothèses présentés, construits grâce à la méthode du faisceau d'indices. - Les éléments du débat Depuis plusieurs années, les Etats-Unis ont acquis la conviction que l'Iran cherchait à acquérir l'arme nucléaire. Au début de l'année 1995, le Secrétaire d'Etat Warren Christopher déclarait : « En termes d'organisation, de programme, d'acquisitions et d'activités secrètes, l'Iran suit la voie classique vers l'arme nucléaire, qu'ont empruntée tous les Etats qui ont cherché à acquérir cette arme... Les efforts de l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire représentent un énorme danger. Chaque membre responsable de la communauté internationale a intérêt à voir ces efforts échouer. Il n'y a pas de place pour la complaisance. Rappelez-vous l'Irak ». Depuis lors, les plus hauts responsables américains n'ont cessé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le cas iranien. En mars 1997, John Holum, Directeur de l'Agence américaine pour le contrôle des armements et le désarmement, témoignait devant le Congrès que l'Iran développait activement des armes nucléaires, même s'il ajoutait que cet effort était lent et que l'Iran ne posséderait pas l'arme nucléaire avant 2005-2007. L'Union européenne a également exprimé ses préoccupations. Le 16 janvier 1998, des responsables de l'Union européenne présentaient aux Etats-Unis une liste, non rendue publique, de quinze mesures destinées à prévenir l'acquisition d'armes de destruction massive par l'Iran et à lutter contre le terrorisme. L'Union européenne a toutefois affiché sa différence concernant les mesures à prendre vis-à-vis de l'Iran, s'opposant notamment à la politique d'isolement pratiquée par les Etats-Unis ainsi qu'à la législation de sanctions adoptées par le Congrès américain. L'Iran n'a jamais confirmé ces accusations et ces soupçons, même si certaines déclarations ont pu nourrir les doutes occidentaux : ainsi en octobre 1991, le Vice-Président iranien déclarait que l'Iran devrait travailler avec d'autres Etats islamiques à la création d'une « bombe islamique ». En règle générale toutefois, le Gouvernement iranien a systématiquement nié vouloir acquérir des armes nucléaires, réitérant au contraire sa proposition de créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Ainsi, le Président Rafsanjani, en réponse à une question sur la possession par l'Iran d'armes nucléaires posée par un journaliste de CBS en février 1997, affirmait : « Non, résolument non. Je déteste cette arme. » Les médias iraniens ont de même nié toutes ces accusations, qu'ils qualifient de « sans fondement », et de « propagande développée par les médias occidentaux affiliés au régime sioniste ». Mêmes dénégations du côté de l'organisation pour l'énergie atomique iranienne (AEOI) qui a toujours insisté sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien et rappelé que l'Iran était signataire du TNP, d'un accord de garanties avec l'AIEA et du TICE. L'ensemble des acteurs politiques, scientifiques et diplomatiques du régime iranien ont par ailleurs toujours mis en avant la nécessité pour l'Iran de diversifier ses sources d'énergie. Certains experts occidentaux estiment qu'effectivement les accusations américaines contre l'Iran sont infondées. Par exemple, Eric Arnett, de l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI), souligne que l'Iran a proposé d'ouvrir tous ses sites aux inspecteurs de l'AIEA, a soutenu le renforcement des garanties, de même que toutes les mesures de contrôle des armements régionales. Mais tel n'est pas le sentiment de la plupart des experts occidentaux qui, généralement sur la base de sources des services de renseignement, estiment que l'Iran a bel et bien un programme nucléaire militaire. - L'histoire du programme nucléaire iranien Sur le fond, il semblerait que le programme nucléaire iranien ait connu des fluctuations d'intensité. Depuis 1998 en tout cas, l'Iran donne l'impression d'accroître le flux des affaires liées à son programme ; on observe des signaux qui peuvent conduire à penser soit à une réorganisation, soit à un abandon de celui-ci. C'est en 1967 que le premier réacteur nucléaire iranien est entré en fonctionnement, placé d'emblée sous le contrôle de l'AIEA qui l'a depuis régulièrement inspecté. En 1974 est créée l'organisation de l'énergie atomique iranienne qui s'engage dans une politique active d'achat de matériaux et de centrales nucléaires à l'étranger. Un plan très ambitieux de développement de l'énergie nucléaire est adopté, qui prévoit la création d'un réseau de 23 réacteurs sur le territoire iranien d'ici à 1995, notamment par la fourniture de centrales nucléaires en provenance d'Allemagne, de France ou des Etats-Unis. A la chute du Shah en 1979, l'Iran a six contrats d'achat de réacteurs en cours et est en passe d'acheter douze centrales nucléaires auprès de l'Allemagne, de la France et des Etats-Unis. Deux centrales allemandes de 1 300 mégawatts sont construites à 60 et 75 % à Busher. L'Iran est par ailleurs signataire du TNP dès 1970 et a adopté l'ensemble des procédures de garanties qui s'attachent à ce traité. Les experts américains estiment néanmoins que, dès l'époque du Shah, un petit programme de recherche militaire est mené au centre de recherches nucléaires d'Amirabad, principalement centré sur la conception des armes et le retraitement du plutonium. L'arrivée au pouvoir du régime islamique se traduit dans une première phase par un relatif abandon du programme nucléaire. Cependant, la guerre avec l'Irak conduit rapidement le gouvernement Khomeini à le revivifier et à s'intéresser aux armes nucléaires. C'est essentiellement dans la deuxième moitié des années 1980 que les efforts d'acquisition de l'arme nucléaire se seraient accélérés. A cette époque, l'Iran multiplie les contacts à l'étranger afin d'obtenir une aide extérieure diversifiée. Ainsi, un accord de coopération nucléaire est signé avec le Pakistan en 1987 et, à deux reprises, en février 1986 et janvier 1987, le docteur A. Q. Khan, l'un des principaux responsables du programme nucléaire militaire pakistanais, se rend à Téhéran et à Busher. L'Iran renforce également ses liens avec la Chine, avec laquelle un accord de coopération sur la recherche nucléaire est signé en 1990, alors que les deux pays coopèrent dans les faits depuis 1985. C'est en effet vers la Chine que l'Iran, ne parvenant pas à obtenir l'aide de la France et du Pakistan, serait tourné pour l'achat d'un réacteur de recherche sous-critique en 1985 et d'un petit Calutron, susceptible d'être utilisé pour la recherche sur l'enrichissement de l'uranium en 1987. Ces efforts subissent cependant de sérieux revers avec le bombardement par l'Irak, à plusieurs reprises, du site de Busher (24 mars 1984, 12 février et 4 mars 1985, 12 juillet 1986, 17 et 19 novembre 1987 et 19 juillet 1988). Depuis la fin de la guerre contre l'Irak, il est devenu plus difficile de suivre précisément l'évolution du programme nucléaire iranien. De ce fait, se développent de nombreuses rumeurs, souvent non confirmées, qui en exagèrent la taille comme le degré d'évolution. Néanmoins, la plupart des experts occidentaux s'accordent à reconnaître que le programme iranien est d'une échelle bien inférieure au programme irakien tel qu'il se présentait avant la guerre du Golfe, notamment du fait du caractère dual des importations technologiques iraniennes et des verrous très serrés mis par les pays occidentaux aux exportations vers l'Iran. En effet, les tentatives de l'Iran pour se procurer des technologies et des biens auprès des pays occidentaux se soldent par des échecs répétés dans la première moitié des années 1990 ; on rappellera par exemple la saisie, par les douaniers italiens, de huit condenseurs à vapeur susceptibles d'être utilisés dans un programme nucléaire en 1993 et d'équipements à ultrasons de haute technologie en janvier 1994 ainsi que celle, par les douaniers britanniques, d'aciers spéciaux à destination de l'Iran en juillet 1996. Suite à ces échecs, l'Iran se serait tourné vers la Chine et la Russie. Le 10 septembre 1992, le Président Rafsanjani se rend en visite à Pékin pour achever, pense-t-on, les négociations pour l'achat d'un ou deux réacteurs de 300 mégawatts. Ce contrat échoue toutefois à cause des protestations véhémentes des Américains auprès de la Chine. De même, la vente par la Chine d'une usine de conversion d'uranium hexafluoride a été stoppée après que ce pays s'est ravisé, là encore sous pression américaine. L'état exact des relations entre les deux pays dans ce domaine est en réalité mal connu et dépend largement des relations sino-américaines. Selon la CIA, cependant, aucune livraison chinoise liée au programme nucléaire iranien n'a eu lieu depuis la mi-1997. Pour sa part, l'Iran nie que la Chine ait mis fin à sa coopération nucléaire et qualifie ces rumeurs de propagande sans fondement. Par ailleurs, dès le milieu des années 1980, l'Iran a cherché à acheter des réacteurs nucléaires civils auprès de la Russie. Mais c'est le 8 janvier 1995 qu'est signé le principal contrat entre les deux pays (850 millions de dollars) pour la construction d'un réacteur civil à Busher et l'achèvement des centrales sur ce site. En effet, même si les travaux de cette centrale se sont arrêtés en 1979, l'Iran a toujours maintenu une activité sur ce site. Le contrat russo-iranien sur Busher a suscité, et suscite encore, de multiples commentaires et est devenu l'un des sujets du dialogue bilatéral entre la Russie et les Etats-Unis. Il pose la question du lien entre le programme nucléaire civil iranien et son programme militaire supposé, et conduit, au-delà du cas iranien, à s'interroger sur la politique russe de prolifération. C'est essentiellement la découverte par les responsables américains, en mars-avril 1995, d'un protocole secret au contrat de vente du réacteur qui est à l'origine de vives tensions entre la Russie et les Etats-Unis. Ce protocole prévoyait en effet la fourniture d'une usine d'enrichissement de l'uranium par centrifugation, placée sous le contrôle de l'AIEA et destinée uniquement à la production d'uranium faiblement enrichi ; il n'en reste pas moins qu'avec cette usine, l'Iran disposait d'une base technologique lui permettant la construction d'une installation similaire qui pouvait, elle, être utilisée pour la production d'uranium de qualité militaire. Le protocole prévoyait en outre la fourniture d'un réacteur de recherche à eau légère de 30 à 50 MW et de 2 000 tonnes métriques d'uranium naturel, ainsi que la formation en Russie de jeunes diplômés iraniens dans le domaine nucléaire. Sous la pression américaine, le Président Eltsine annonça, lors du sommet russo-américain de Moscou le 10 mai 1995, l'annulation de la livraison de l'usine d'enrichissement. Les autres dispositions du protocole restent applicables. Ainsi, dans le cadre du contrat signé en 1995 avec la Russie, il est prévu que 2 000 ouvriers russes viennent travailler à Busher et forment 500 techniciens iraniens. Il semblerait que les échéances fixées pour la réalisation de cette centrale aient dû être repoussées jusqu'en 2005, alors que la date initiale était fixée en 2000. On estime actuellement que 1 000 techniciens russes travaillent sur le site de Busher pour lequel l'Iran cherche par ailleurs à recruter des ingénieurs autochtones, comme en témoigne un appel à candidature lancé par l'AEIO en janvier 1999 pour le recrutement de 225 ingénieurs. Face aux inquiétudes exprimées notamment par les Etats-Unis au sujet de la coopération russo-iranienne à Busher, les autorités russes n'ont cessé de répéter que cette coopération s'inscrivait dans un cadre pacifique conformément aux règles internationales en matière de non-prolifération. Le 20 janvier 1999, le Ministre russe de l'énergie atomique Evgueni Adamov déclarait encore que les Etats-Unis n'avaient produit aucune preuve de la violation d'accords internationaux par les entreprises nucléaires russes depuis la mi-97 et que les services spéciaux russes exerçaient une surveillance quotidienne sur les organismes travaillant dans le domaine nucléaire. Il réaffirmait par ailleurs que la Russie n'avait aucune intention de voir les états frontaliers acquérir l'arme nucléaire. En janvier 2000, le Ministre de la défense russe a répété que la Russie avait l'intention de poursuivre ses relations bilatérales avec l'Iran dans les domaines militaire, technique, scientifique et énergétique. Les responsables russes rencontrés par la mission ont également confirmé que la coopération nucléaire avec l'Iran s'inscrivait dans un cadre légal et que, pour cette raison, elle n'avait aucune raison de s'arrêter, sauf défaut de paiement de la part de l'Iran. Il semble d'ailleurs que cette coopération ne se déroule pas dans des conditions optimales. Rencontré par la mission, M. Nicolas Ponomarev-Stepnoï, vice-président de l'Institut Kourtchatov, a confirmé que cette coopération ne se déroulait pas dans des conditions très satisfaisantes, faute d'une ressource humaine et d'une organisation suffisante du côté iranien. Il a également informé les membres de la mission que le réacteur en construction serait équipé d'un dispositif de contrôle de la prolifération. A la lumière de ce qui vient d'être dit, comment interpréter la suspension du transfert de la Russie vers l'Iran de technologies laser utilisables dans la fabrication d'armes nucléaires, annoncé par la Maison Blanche le 19 septembre 2000 ? Selon les Etats-Unis, le recours à une technologie laser pour fabriquer du combustible nucléaire en séparant les isotopes d'uranium 235 et 238 ne peut avoir d'applications civiles en raison de son coût beaucoup trop élevé. Faut-il y voir le résultat d'une prise de conscience par la Russie des risques de prolifération posée par sa coopération nucléaire avec l'Iran ou seulement le signe d'une coopération laborieuse entre les deux partenaires ? - Beaucoup d'interrogations, peu de réponses... Le programme iranien suscite de multiples interrogations. Les principales portent sur le lien entre le programme civil nucléaire avéré et le programme militaire supposé (1) et sur le calendrier du programme iranien (2). (1) Quelles passerelles entre le programme nucléaire civil et le programme militaire ? Les experts s'interrogent par ailleurs pour savoir si les achats de réacteurs par l'Iran sont destinés à être des parties intégrantes de son effort pour acquérir des armes nucléaires ou s'ils sont un moyen d'acquérir une base technologique à partir de laquelle des infrastructures indigènes seraient construites. De fait, le réacteur vendu par la Russie à l'Iran produit de très petites quantités de plutonium et, jusqu'à présent, aucun pays n'a utilisé ce type de réacteur pour acquérir des matières fissiles de qualité militaire. Par ailleurs, l'Iran justifie cette coopération par ses besoins d'approvisionnement en énergie électrique et son souhait de réduire concurremment son utilisation de pétrole et de gaz au profit d'une politique d'exportation. Les autres arguments iraniens pour justifier la poursuite de son programme nucléaire civil apparaissent également tout à fait contestables : - la rationalité économique d'un programme qui coûte des milliards de dollars n'est pas évidente dans un pays doté de ressources immenses en gaz naturel ; - de même, la justification économique de la concentration de tous les réacteurs nucléaires dans une seule zone, située en plein désert loin des villes et des infrastructures industrielles du pays ne va pas de soi. La communauté du renseignement américaine n'établit pas officiellement de liens entre l'acquisition de ce type de réacteur et les efforts de l'Iran pour se procurer des matières fissiles. Mais elle est préoccupée par les liens entre l'Iran et la Russie. En février 2000, le centre de non-prolifération de la direction centrale du renseignement américain résumait ainsi les efforts de l'Iran pour acquérir des technologies liées à l'arme nucléaire auprès de la Russie et de la Chine : « Au cours de la première moitié de l'année 1999, la Russie demeure un fournisseur clé des différents programmes nucléaires civils en Iran. En aidant l'Iran à construire une infrastructure nucléaire, l'assistance de la Russie améliore les capacités de l'Iran pour développer les armes nucléaires. Par sa nature intrinsèque, le transfert de technologies civiles peut être utilisé dans le programme d'armes nucléaires iranien. » (2) Quand l'Iran disposera-t-il de la bombe atomique ? Il n'existe à ce jour aucune réponse satisfaisante à cette question. La seule certitude en la matière, c'est que si l'Iran continue son programme nucléaire militaire, il n'acquerra pas pour autant l'arme nucléaire à court terme, sauf s'il parvient à acheter des matières fissiles à l'étranger. On remarquera par ailleurs que toutes les sources qui avaient indiqué que l'Iran pourrait construire une arme atomique rapidement se sont révélées pessimistes. Par exemple, le document de synthèse produit par les services de renseignement américains en 1992 prévoyait l'apparition de l'arme nucléaire iranienne en 2000 ; de même en 1995, des sources américaines et israéliennes faisaient état d'une arme nucléaire en Iran dans les cinq ans à venir. En 1995, John Holum évoquait, pour sa part, la date de 2003 ; en 1997, il fixait cette échéance vers 2005-2007. La difficulté à fournir une date convaincante vient, selon les experts, de la grande prudence adoptée par l'Iran, qui a pu être qualifiée de « prolifération rampante ». - Les conclusions A la lecture des publications relatives au programme nucléaire iranien, trois conclusions peuvent être tirées : - l'Iran possède la technologie de base pour construire une bombe mais n'a pas les moyens de disposer rapidement d'uranium ou de plutonium militaire, à moins de s'en procurer auprès d'un autre pays. Il s'efforce d'acquérir toutes les technologies en rapport avec le nucléaire, y compris des réacteurs de recherche et de puissance qui pourraient soutenir indirectement son programme d'armements nucléaires ou être réorientés au profit de celui-ci, ainsi que pour former ses propres experts ; - les inquiétudes iraniennes sur l'éventualité de frappes préventives par Israël ou par les Etats-Unis le conduisent à adopter un profil bas et une politique très prudente de développement de son programme nucléaire ; - par conséquent, selon certains experts, l'Iran pourrait disposer d'un engin nucléaire d'ici cinq à sept ans en utilisant ses propres matières fissiles enrichies et il lui faudrait six à neuf ans pour acquérir la capacité de mettre au point une arme nucléaire adaptable à un missile de longue portée. D'autre sources, qui paraissent plus fiables, estiment que l'Iran aurait besoin d'au moins dix ans pour parvenir au stade de production d'armes nucléaires, à la condition qu'il puisse se procurer équipements et biens à l'étranger. · Les programmes rudimentaires D'autres pays ont développé des programmes de recherche nucléaire dans le passé, mais ne présentent plus aujourd'hui de danger au regard de la prolifération : ainsi, en Algérie, aucune information ne vient alimenter les craintes, de même qu'en Libye, en Egypte et en Arabie saoudite. L'Algérie a ratifié le Traité de non-prolifération nucléaire en 1995 et toutes ses installations sont soumises aux garanties de l'AIEA. Elle dispose aujourd'hui de deux réacteurs nucléaires de recherche, l'un de faible puissance (1 mégawatt) à Draria près d'Alger fourni par l'Argentine, l'autre de 15 mégawatts à Ain Oussera, installé par la Chine. Le programme nucléaire de l'Algérie n'est pas aujourd'hui orienté vers la création d'une capacité nucléaire militaire. Toutefois, l'infrastructure nucléaire limitée et le savoir-faire que l'Algérie est en train d'acquérir pourraient être utilisés à l'appui d'un programme d'armement si une décision politique en ce sens était prise. La Libye est partie au Traité de non-prolifération nucléaire. Elle ne possède pas d'armes nucléaires et n'a pas d'infrastructure nucléaire viable qui lui permettrait d'en fabriquer. Cependant, sous la houlette du Colonel Khadafi, elle a développé un modeste programme de recherche nucléaire qui est entièrement tributaire du savoir-faire de l'étranger. Par le passé, la Libye s'est principalement reposée sur l'Union soviétique, puis la Russie, pour son assistance technique nucléaire. Elle a également cherché à établir des coopérations dans le domaine nucléaire avec la République Populaire de Chine, le Pakistan et l'Inde. * Les régions où les risques de prolifération nucléaire restent le plus forts sont le Moyen-Orient et le pourtour de la Méditerranée où l'on assiste à une croissance des capacités nucléaires, le sous-continent indien, l'Asie du nord-est. Soit dans des zones de crise larvée ou de conflits ouverts... En revanche, la prolifération nucléaire a régressé dans d'autres régions (Amérique latine, Afrique du Sud). Bien que circonscrite à un nombre relativement limité d'Etats, la prolifération nucléaire doit rester un sujet de préoccupation constant, plus encore alors que les nouvelles technologies de l'information conduisent à une banalisation des savoir-faire technologiques. Certes, l'information technique sur l'arme nucléaire a toujours été largement ouverte et disponible dans les bibliothèques. Cependant, l'expansion du réseau Internet facilite considérablement les démarches des proliférants. Des scientifiques de l'Ecole du génie atomique du CEA de Cherbourg ont réalisé une simulation afin d'évaluer s'il était possible, à partir du Net, de réaliser une arme atomique. Ce travail montre qu'environ 5 % des informations disponibles sur le réseau sont tout à fait pertinentes, en sorte qu'on peut conclure que des individus ou des équipes qui savent ce qu'ils cherchent peuvent progresser dans leurs travaux à partir d'Internet. Et l'exemple de l'Irak - qui a développé en parallèle six filières d'enrichissement ! - montre qu'avec des équipes de techniciens, un réseau de contrebande et des moyens financiers, il est possible de développer un programme nucléaire militaire dès lors qu'une forte volonté politique existe. B. LA PROLIFÉRATION DES ARMES CHIMIQUES : UNE MENACE SANS SOLUTIONS ? « Obnubilé pendant un demi-siècle par la menace nucléaire et l'omniprésence de l'« équilibre de la terreur » bipolaire, le monde n'a redécouvert les armes chimiques qu'avec la guerre Iran-Irak et surtout avec la guerre du Golfe »17. C'est bien d'une redécouverte qu'il s'agit. En Europe notamment, le souvenir des premiers usages militaires de cette arme, pendant la première guerre mondiale, reste vivace : une centaine de milliers de soldats en sont morts entre 1914 et 1918, tandis qu'un million d'autres en gardèrent des traces qui les invalidèrent à vie. En 1918, la plupart des artilleries, y compris celles de l'armée française, étaient équipées à 30 % d'obus chimiques. Par la suite, les armes chimiques furent employées par l'Italie fasciste en Ethiopie, dans les années 1930, et par le Japon contre la Chine. Cette nouvelle actualité de l'arme chimique au début de la décennie 1990 aura eu pour seul mérite de réactiver le tabou attaché à ce type d'armes, et a conduit, en 1993, à l'adoption de la convention internationale sur les armes chimiques, qui se signale par son caractère particulièrement intrusif. Ceci dit, pas plus que le TNP n'a mis fin au fait nucléaire, cette convention, qui postule pourtant l'interdiction absolue de cette arme - hormis pour les programmes défensifs, ne signifie la disparition du fait chimique. La prolifération chimique reste d'actualité, notamment dans les pays du Tiers Monde. Plus encore, le démantèlement de l'« archipel toxique » (Amy Smithson)18 russe ouvre aux candidats à la prolifération un marché potentiel énorme, et aux Etats attachés à la disparition de cette arme des perspectives angoissantes ... et une tâche de longue haleine. Après la deuxième guerre mondiale, l'avènement du système nucléaire bipolaire entraîna deux conséquences sur les armes chimiques. a) Une perception divergente de l'arme chimique au Nord et au Sud · Au Nord, la quasi-totalité des Etats choisirent de ne pas se lancer dans la course à l'arme chimique, pour des raisons à la fois politiques et militaires. La seule exception notoire concerne l'URSS qui se lança tout au contraire dans le développement d'un vaste programme chimique, dont la communauté internationale gère, non sans difficultés, le legs aujourd'hui. Artillerie, missiles, avions : un bon tiers des systèmes d'armes de l'Armée rouge furent équipés de ce type d'armes, tandis qu'étaient constituées des unités spécialisées de décontamination dans les différentes formations soviétiques. « En revanche, la doctrine de riposte graduée de l'OTAN ne prévoyait l'emploi d'armes chimiques par l'Alliance qu'en réponse à une attaque chimique. Les Alliés estimaient en effet que la dissuasion du potentiel chimique et soviétique résulterait d'abord de la position stratégique d'ensemble de l'Alliance et surtout des armes nucléaires, davantage que d'une panoplie chimique, militairement difficile à employer. Fidèle à sa doctrine de dissuasion pure, la France pour sa part préféra faire l'impasse sur les armes chimiques, convaincue que les armes nucléaires offraient la seule réponse adaptée. Le renouveau de la tension Est-Ouest au début des années 1980 entraîna, un temps, des inquiétudes nouvelles du côté occidental face à l'écrasante supériorité chimique soviétique. Les Etats-Unis décidèrent alors de moderniser leur stock (en introduisant des armes binaires), la France elle-même envisagea de constituer un « stock de sécurité » en 1987. Toutefois, avec la détente gorbatchévienne et la prise de conscience des risques de prolifération chimique dans le tiers-monde (illustrés alors par la guerre Iran-Irak et les massacres de Kurdes irakiens à l'arme chimique à Halabja), les Grands décidèrent de se débarrasser de ces armes par la négociation »19. D'où la relance, à la fin des années 1980, des pourparlers à la conférence du désarmement de Genève en vue de l'élimination totale des armes chimiques, sous l'impulsion des Américains et des Soviétiques. La France pour sa part a renoncé à son projet de stock chimique de dissuasion au lendemain de la réélection de François Mitterrand en 1988. En d'autres termes donc, le Nord, à la seule, mais importante exception soviétique, a à peu près renoncé au chimique à la fois pour des raisons politiques et de société -ces armes sont en effet difficiles à justifier devant l'opinion publique, au nom de la dissuasion-, et pour des raisons purement opérationnelles : les militaires n'aiment pas les armes chimiques, très difficiles à utiliser, peu efficaces sur le champ de bataille, et gênant de surcroît toute man_uvre rapide. A cet égard, le précédent de la guerre du Golfe, pendant laquelle l'Irak, contre toute attente, ne fit pas usage de gaz de combat, a illustré les limites du recours à l'arme chimique dans un contexte militaire. On rappellera ici que l'utilisation des diverses substances toxiques dans un contexte militaire varie selon qu'elles sont fugaces, persistantes ou semi-persistantes : - les agents fugaces (sarin, acide cyanhydrique et phosgène) visent à mettre hors de combat l'adversaire avant une attaque, leur effet étant susceptible de durer jusqu'à six heures, en fonction notamment des conditions atmosphériques ; - les produits persistants (ypérite, tabun, hydrogène arsénié...), qui se présentent sous forme de liquide ou d'aérosol, permettent de neutraliser un terrain afin d'empêcher l'adversaire d'y man_uvrer. Leurs effets peuvent se propager jusqu'à 15 km autour de la zone d'épandage. Ils contaminent les sols jusqu'à un mois après leur lancement ; - les agents semi-persistants (parmi lesquels le soman) ont la capacité de désorganiser l'adversaire en empêchant celui-ci, pendant quelques heures, d'accéder à certains points (gares, ponts, dépôts). De surcroît, les facteurs à prendre en compte pour utiliser l'arme chimique rendent son usage aussi complexe qu'aléatoire : configuration du terrain favorable à la persistance des gaz, conditions d'évaporation dans l'atmosphère, conditions météorologiques, rien ne doit être laissé au hasard sous peine non seulement de manquer l'objectif mais surtout de se retourner contre l'utilisateur. · « Au Sud cependant, la situation est exactement inverse. Et on assiste ici, de façon encore plus nette, au même chassé-croisé que l'on a déjà noté en matière nucléaire : les grands se dégagent du chimique, comme ils réduisent l'importance du nucléaire, au moment précis où ces armes prolifèrent dans le tiers-monde. Les raisons de cet état de fait sont essentiellement les mêmes que celles que l'on a étudiées précédemment s'agissant des armes nucléaires, à ceci près que le relatif succès des mécanismes internationaux de non-prolifération nucléaire, n'a fait que valoriser davantage la prolifération chimique. Constatant la difficulté de se procurer, hors de tout contrôle international, des matières et des équipements atomiques, bon nombre de candidats à la prolifération se sont alors tournés vers des domaines moins surveillés que le nucléaire. La prolifération chimique, celle « du pauvre », a donc été indirectement la conséquence de la mise en place d'un dispositif international de contrôle sur les transferts de technologies et de matières nucléaires ».20 Elle résulte également de la relative facilité technique avec laquelle une arme chimique peut être fabriquée : il est ainsi frappant de constater que, contrairement à tous les autres types d'armement, la technologie des armes chimiques n'a, somme toute, guère évolué depuis la première ou la deuxième guerre mondiale. Les agents militairement efficaces, de même que les principes de fabrication, de conservation et de militarisation de ces agents sont depuis longtemps dans le domaine public. « A cause du peu de cas qu'on faisait de la prolifération chimique jusqu'à la guerre du Golfe, les Etats du tiers-monde n'ont donc guère eu de peine pour constituer leurs manufactures et leurs arsenaux chimiques. Contrairement aux technologies nucléaires ou spatiales, le savoir-faire chimique n'était en effet soumis à aucune contrainte internationale d'exportation. Un groupe d'exportateurs, dit « groupe australien » (parce qu'il se réunit périodiquement à l'ambassade d'Australie à Paris), s'est cependant constitué à partir de 1984. Ce groupe, qui aurait également des contacts avec plusieurs pays de l'Est, a mis au point une liste de produits précurseurs sensibles soumis à des licences d'exportation. L'ennui, c'est que le système était notoirement insuffisant : les industriels des pays riches ont toujours répugné à s'y plier car ils craignaient d'être pénalisés sur les marchés à l'exportation ; les installations elles-mêmes, on l'a vu, se prêtent facilement à des détournements : n'importe quelle usine d'engrais peut fabriquer des armes chimiques ; n'importe quel laboratoire peut fabriquer des toxines militaires »21. L'emploi d'agents chimiques dans l'industrie (pesticides, produits pharmaceutiques et pétrochimiques) est en effet très répandu, et la conversion d'une usine civile à des fins militaires très facile. On estime par exemple qu'une usine chimique civile peut être convertie à la fabrication de substances toxiques militaires puis revenir à sa production licite en moins de 12 heures. Un exemple : on a constaté qu'un colorant, couramment employé dans la fabrication de bonbons au goût de cerise, contient des éléments du gaz BZ qui fut utilisé par les troupes soviétiques lors des émeutes de Géorgie en 1989. Les acheteurs potentiels, profitant du vide juridique des pays industrialisés, n'ont donc eu aucun mal à se procurer aux Etats-Unis, mais surtout en Allemagne, les produits et les installations requises. Les accords commerciaux les plus licites ont été passés, offrant au tiers-monde soit des agents chimiques précurseurs, soit des usines de transformation. Une certaine prise de conscience commença cependant à se manifester en 1988, lorsque les Etats-Unis annoncèrent avoir repéré l'usine chimique secrète de Rabta en Libye, livrée par la firme allemande Imhauen-Chemie. Par la suite, c'est surtout l'Irak qui, après la fin des hostilités avec l'Iran, retint un moment l'attention de la communauté internationale, mais sans grandes conséquences. Des poursuites furent certes engagées contre des entreprises occidentales compromises. Mais là encore sans résultats concrets : la base juridique pour de tels recours était faible (simple violation de règlements à l'exportation mal définis) et les sanctions encourues, le plus souvent insignifiantes. Ainsi, en 1988, l'entreprise KBS Holland Bv fut poursuivie pour avoir livré à la SEPP, établissement public irakien, soi-disant spécialisé dans la production de « pesticides », des centaines de tonnes de thiodigycol, qui sert à fabriquer du gaz moutarde. De même, la société Melchimie, hollandaise elle aussi, fut condamnée à une amende équivalente à... 150 000 francs pour la vente d'un autre précurseur à l'Irak. « Dans cette prolifération, les entreprises allemandes ont emporté le gros du marché irakien, par manque de scrupules selon certains, par esprit de commerce pour les autres. Paradoxalement, l'Allemagne, qui, comme le Japon, se targue d'avoir la législation la plus contraignante pour les exportations d'armes conventionnelles, a été la plus laxiste dans le domaine des transferts de technologie chimique, biologique et même nucléaire. Plus de cinquante firmes allemandes étaient, au début de 1991, poursuivies en justice pour avoir collaboré aux programmes irakiens. Une douzaine de personnes auraient été arrêtées dont onze ont été remises en liberté sous caution (de 900 000 F). Quant au dirigeant de Imhausen-Chemi GmbH qui avait livré aux Libyens l'usine de Rabta, il a été condamné à cinq ans de prison (International Herald Tribune, 18/19 août 1990). Interrogé sur ce laxisme, le responsable de services spéciaux auprès du chancelier Kohl, Lutz Stavenhagen, expliqua que le laxisme était aussi le fait des entreprises américaines (ce qui est vrai), que le gouvernement fédéral ne peut pas vérifier toutes les indélicatesses des firmes allemandes, et qu'en tout état de cause, la sanction pénale, qui était de trois ans de prison avant Rabta, a été relevée jusqu'à dix ans »22. Cette responsabilité des pays industrialisés du Nord (notamment occidentaux) est d'autant plus grande que, contrairement à d'autres domaines de la militarisation du tiers-monde (nucléaire, missiles notamment), les fournisseurs du Sud n'ont pendant longtemps guère participé à la prolifération chimique, soit par manque de moyens, soit parce que l'approvisionnement occidental (et soviétique dans le cas de la Syrie) suffisait aux besoins des « clients ». Une exception d'importance peut néanmoins être retenue : l'Inde a en effet vendu à l'Irak, à l'Iran et à l'Egypte des précurseurs d'ypérite et de neurotoxiques (dont 60 tonnes à l'Iran). Les Etats-Unis ont alors fait pression sur l'Inde, en juillet 1989, et obtenu l'annulation d'une seconde livraison, portant cette fois sur 257 tonnes. A ces arguments pratiques qui ont favorisé la prolifération chimique au Sud s'ajoutent des considérations politiques, elles aussi favorables à la constitution d'arsenaux chimiques pour bon nombre de « proliférateurs » du Sud. La détention d'armes chimiques permettrait de résister aux pressions d'une puissance nucléaire et, de ce fait, d'acquérir influence et prestige sur la scène internationale. Dans cet argumentaire politique, la rhétorique « pauvre contre riche » est très présente : c'est parce que le Nord lui interdit l'arme nucléaire que le tiers-monde se résout à acquérir des moyens chimiques. C'est parce qu'Israël a la bombe que le monde arabe applaudit, au printemps 1990, quand Saddam Hussein déclare qu'il va « réduire en cendres la moitié d'Israël » grâce à ses armes chimiques. La guerre Iran-Irak a joué un rôle déterminant dans la prolifération chimique, en donnant à penser -à tort- aux pays du tiers-monde qu'une telle arme avait une réelle utilité militaire23. Au cours de ce conflit, l'Irak eut massivement recours aux armes chimiques contre les offensives adverses ; il en fut de même pour le massacre, plus scandaleux encore, des populations kurdes en 1988-89. L'impact psychologique de cette utilisation a été considérable au sein de la population civile prise pour cible, mais aussi parmi les voisins de l'Irak, qui virent en Saddam le contrepoids naturel à Israël et à l'Occident, le bras armé de la revanche arabe, en bref un nouveau raïs. Qu'en est-il réellement des perspectives d'emploi d'une telle arme ? Un bref rappel méthodologique s'impose au préalable. Les agents de guerre chimique se répartissent entre quatre catégories principales, en fonction de leurs effets sur l'organisme : - Les vésicants se présentent sous forme de liquides épais, qui peuvent agir non seulement par inhalation, lorsqu'ils sont vaporisés, mais aussi sur la peau, dont ils détruisent les cellules. S'ils atteignent l'appareil respiratoire, ils causent la mort par asphyxie. La substance vésicante la plus célèbre est l'ypérite ou gaz moutarde, du nom de l'attaque allemande d'Ypres, en avril 1915 (5 000 morts et 15 000 blessés). - Les suffocants (chlore, phosgène, diphosgène) se présentent sous forme de liquides plus volatiles que les vésicants. Agissant exclusivement par inhalation, ils provoquent un _dème du poumon et l'asphyxie. - Les hémotoxiques (chlorure de cyanogène, acide cyanhydrique) détruisent les globules rouges et ont pour effet secondaire un empoisonnement par l'arsenic. L'acide cyanhydrique était utilisé par les nazis dans les chambres à gaz. - Les neurotoxiques (agents G : sarin, tabun, soman, et agents V, parmi lesquels le VX) provoquent la paralysie des muscles (notamment des muscles respiratoires). Ils sont dérivés d'ingrédients entrant dans la fabrication des insecticides, des engrais et de certains colorants. Notons que les effets produits par ces agents toxiques sur l'organisme dépendent de la dose reçue. Si la dose létale de l'ypérite est de 7 grammes, certains agents neurotoxiques ont une dose létale de 5 à 15 milligrammes. S'agissant de l'emploi militaire de ces substances, rappelons que, pour constituer une arme chimique, un agent toxique doit réunir différentes conditions24 : - pouvoir être produit à l'échelle industrielle à un coût acceptable ; - avoir une stabilité chimique permettant un stockage en réservoir ou dans des munitions sans risque pour le détenteur. A cet égard, l'apparition des armes binaires a permis d'améliorer la sécurité pendant les stockages, transports et autres manipulations. Ce dispositif consiste à remplacer l'agent toxique, dans son vecteur (bombe, obus...), par deux substances distinctes, sans effet tant qu'elles sont séparées, mais qui, se mélangeant lorsque le vecteur est lancé, acquièrent les caractéristiques toxiques d'une arme chimique ; - être peu dégradable ; - être apte à résister à l'opération de dispersion pour pouvoir atteindre l'objectif en concentration suffisante ; - être difficile à détecter ; - nécessiter la mise en _uvre, par l'agressé, de moyens de protection aussi contraignants que possible ; - être sans prophylaxie médicamenteuse totalement efficace. Les nombreux exemples d'emploi de l'arme chimique montrent que ces conditions ne sont pas des obstacles insurmontables, loin de là, surtout contre des populations civiles sans défense ! Au-delà de cette maîtrise technique, qu'en est-il dès lors des possibilités stratégiques d'emploi de ces armes dans l'après-guerre froide ? La guerre du Golfe a surpris bon nombre d'observateurs dans la mesure où les Irakiens, contrairement à leurs déclarations antérieures, n'ont pas eu recours à leurs armes chimiques alors que la coalition occidentale s'attendait à l'emploi de gaz de combat par l'Irak, soit contre l'offensive terrestre, soit lors de l'offensive aérienne des forces coalisées, soit contre des objectifs civils, en Israël et en Arabie Saoudite. On peut bien sûr s'interroger sur les raisons de cette abstention : incapacité de maîtriser la technologie de dispersion des gaz sur les ogives de missiles à moyenne portée de type Scud ou Al-Hussein, crainte de représailles nucléaires israéliennes, incapacité technique d'employer ces armes sur le champ de bataille contre des forces alliées opérant rapidement sur des zones très étendues, prise de conscience par Saddam Hussein des effets réduits de ces armes face à des troupes entraînées (les coalisés s'étant attendu à une attaque chimique, les troupes alliées avaient été entraînées pendant quelque cinq mois, et s'étaient familiarisées avec le port des équipements de protection. L'effet de surprise, primordial dans le cas d'une attaque chimique qui vise principalement à déstabiliser l'adversaire, n'aurait donc pas été obtenu) ou tout simplement volonté de Saddam Hussein de sauver ce qui pouvait l'être encore de son armée, sans provoquer d'escalade supplémentaire ? Tous ces facteurs, à un degré ou à un autre, ont sans doute joué dans la décision de ne pas utiliser ces armes. Mais l'important est ailleurs : sur le fond des choses, la guerre du Golfe est venue confirmer la leçon stratégique apprise depuis Ypres en 1915, qui est que l'arme chimique est d'abord une arme de terreur qui s'emploie contre un adversaire non protégé et qui ne dispose pas de moyens de représailles. A l'inverse sur le champ de bataille, surtout face à un adversaire résolu, lui-même protégé et préparé à ce type de combat, et disposant de surcroît de moyens de riposte, l'emploi de l'arme chimique se révèle d'une piètre utilité militaire. C'est pour cette raison par exemple que l'Allemagne nazie se garda d'employer ces armes, sauf pour le génocide de populations juives sans défense. C'est pour cette même raison que l'emploi du chimique par l'Irak n'a eu qu'un modeste impact militaire contre l'Irak (45 000 morts au total sur 1 million des deux côtés), tandis que son impact psychologique sur les populations civiles iraniennes puis kurdes (après Halabja) a été immense. Les précédents de recours aux armes chimiques par l'Irak -lors de la guerre Iran-Irak et, selon toute vraisemblance, contre la minorité kurde- ont pu rendre crédible l'hypothèse d'une escalade de tout conflit futur vers l'usage d'armes chimiques. La première « zone » d'emploi probable pour l'avenir concernera donc, comme par le passé, des actions de guerre contre des populations civiles dans le tiers-monde, ou même des actions terroristes contre le Nord, l'histoire récente prouvant que tous les pays n'ont pas -quoi qu'en disent les idéalistes impénitents et autres militants tiers-mondistes- les mêmes réticences morales ou politiques quant à l'emploi de telles armes. Le second type d'utilisation possible concerne l'emploi du chimique comme instrument de frappe stratégique contre un Etat puissant, voire nucléaire. L'arme chimique devenant alors non pas, comme le veut l'expression consacrée, « l'arme de dissuasion du pauvre », mais bien l'arme d'emploi du faible contre le fort. Les cas envisageables ici concernent d'abord Israël (dont 80 % de la population est concentrée sur une zone côtière extrêmement exiguë autour de Tel-Aviv), ou bien encore des villes européennes qui demain seront à portée des missiles tirés de l'autre côté de la Méditerranée, ou du Moyen-Orient. Cela étant, les effets militaires de telles actions -à moins d'imaginer des salves composées de très nombreux missiles ou des raids aériens très intenses- seraient relativement limités. Un Scud modifié pour accroître sa portée voit sa capacité d'emport baisser de près d'une tonne à 150-190 kg environ : sa létalité chimique serait sans commune mesure avec une charge nucléaire tactique. Tout autres, cependant, seraient les conséquences psychologiques (terreur) et stratégiques (représailles nucléaires ou non) d'une telle attaque. Au Moyen-Orient, le risque de voir le couple chimique-nucléaire dégénérer dans une escalade nucléaire ne peut donc pas être exclu, même si, répétons-le, les effets militaires d'une frappe chimique sont beaucoup plus modestes que les déclarations d'un Saddam Hussein ne le laisseraient penser. Quant aux risques d'attaques contre des villes européennes qu'on ne peut plus exclure aujourd'hui, celles-ci revêtiraient elles aussi un caractère terroriste plutôt que proprement militaire. L'effet dévastateur des armes chimiques paraît beaucoup moins incertain sur des populations civiles désarmées, ce qu'atteste l'impact, immense, sur le plan psychologique, des attaques chimiques imputées à l'Irak contre la communauté kurde. La même remarque vaut pour l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo, en mars 1995. L'hypothèse du recours à des gaz de combat contre des objectifs civils dans le cadre d'actions terroristes n'est donc pas à exclure, même si, le même exemple de la secte Aoum, dont il est établi qu'elle avait tenté à neuf reprises auparavant de perpétrer un attentat rappelle que l'image d'un « Docteur Folamour, capable de constituer des armes redoutables dans un garage, demeure un pur fantasme » 25. 2. D'une logique de production massive à une logique de gestion des stocks ? La conclusion, en 1993, de la convention internationale d'interdiction des armes chimiques représente un succès majeur dans la lutte contre la prolifération de ces armes. Le nombre relativement élevé de pays qui l'ont ratifié à ce jour incite également à un relatif optimisme. Est-ce à dire qu'on assiste au passage progressif d'une logique de production massive à une logique de gestion des stocks, et notamment du stock effrayant présent dans cet « archipel toxique » qu'est aujourd'hui la Russie ? Il est sans doute encore trop tôt pour préjuger de l'application effective d'un instrument juridique qui se caractérise par son caractère très intrusif, donc novateur. On peut seulement estimer qu'il permet d'avoir une vision plus précise des arsenaux existants, grâce aux déclarations des pays qui ont ratifié la convention ... et grâce au silence de ceux qui refusent de le faire. Facile d'accès, psychologiquement et stratégiquement payante -du moins jusqu'à la guerre du Golfe- la prolifération chimique est toujours une réalité, surtout dans le Sud. · Approche globale Le tableau suivant, établi en 1999 par le Centre d'études sur la non-prolifération (CNS) de Monterey à partir de sources quasi exclusivement américaines, fait apparaître quatre situations différentes au sein des 28 pays qui possèdent ou ont possédé des armes chimiques : les Etats qui possèdent des armes chimiques de façon certaine ; ceux qui en possèdent probablement et sont cités comme tels par les responsables américains ; les Etats qui sont largement reconnus comme possédant des armes chimiques par des sources autres que les sources officielles ; et enfin les Etats qui ont admis avoir possédé des armes chimiques dans le passé. PAYS DÉTENANT OU AYANT DÉTENU DES ARMES CHIMIQUES
A ce jour, cinq Etats entrent dans la première catégorie et possèdent donc des armes chimiques de façon avérée, qu'ils les aient eux-mêmes déclarées dans le cadre de la Convention ou qu'il y ait des preuves irréfutables de leur existence : - l'Inde a déclaré son arsenal en 1997, après avoir ratifié la convention en 1996 ; - l'Irak est un autre cas avéré, mais dans des conditions tout à fait différentes puisqu'il n'a pas adhéré à la convention internationale et que les certitudes reposent sur les résultats des inspections de l'UNSCOM. D'après le Pentagone, si le programme chimique de l'Irak a subi des dommages considérables suite aux bombardements alliés pendant la guerre du Golfe et aux destructions opérés par l'UNSCOM, il est vraisemblable que l'Irak a caché des précurseurs, des agents et des munitions chimiques, ainsi que de la documentation en vue d'une reprise de son programme. L'Irak a en outre reconstruit des parties clés de son infrastructure chimique commerciale ; - la Russie possède également des armes chimiques. Nous reviendrons plus tard sur la spécificité du cas russe ; - les Etats-Unis, qui ont arrêté la production de munitions chimiques en 1969, possèdent cependant toujours des armes chimiques, en cours de destruction. Dès novembre 1985, le Congrès a adopté une loi appelant à la destruction de 90 % des stocks d'agents chimiques unitaires. Le 13 mai 1991, l'administration Bush annonça que les stocks d'armes binaires et unitaires seraient détruits dès l'entrée en vigueur de la convention internationale. A l'heure actuelle, les armes chimiques américaines sont détruites sur deux sites, sur l'île de Johnston, dans le Pacifique, et à Tooele, dans l'Utah. Au mois d'octobre 1998, 12,2 % de l'arsenal total d'armes chimiques américaines avaient été détruits ; - enfin, la République fédérale de Yougoslavie posséderait de façon certaine des armes chimiques selon le Pentagone. La fédération des scientifiques américains signale l'existence de trois usines en Serbie, à Baric, Lucani et Krusevic. Elle posséderait une large gamme d'agents. Avec la deuxième et la troisième catégorie de pays, on entre dans la zone grise des pays sur lesquels ne pèsent que des soupçons, plus ou moins affirmés, et généralement de source américaine. S'agissant de la catégorie des pays possédant probablement des armes chimiques, soit douze au total (Chine, Egypte, Ethiopie, Iran, Israël, Libye, Birmanie, Corée du Nord, Corée du Sud, Pakistan, Syrie, Taiwan), un triple constat s'impose : d'abord, il s'agit sans exception de pays du Sud, ce qui confirme l'analyse précédente sur la perception divergente de l'arme chimique entre les deux parties de l'hémisphère ; en outre, on remarquera la surreprésentation du Moyen-Orient, d'autant plus remarquable que tous les acteurs majeurs de la région sont présents (Egypte, Iran, Israël, Syrie) ; enfin, de manière quasiment systématique, les armes chimiques sont présentes dans les zones où existent de fortes tensions bilatérales, ou multilatérales. Ce constat vaut bien sûr pour le Moyen-Orient, mais il doit être étendu à la péninsule coréenne - en 1988, Séoul avait notamment accusé Pyongyang de détenir des ogives chimiques adaptables à des vecteurs balistiques - et au sous-continent indien où, en plus du programme avéré de l'Inde, il existe une forte probabilité que le Pakistan ait également un programme de recherche militaire actif dans le domaine des armes chimiques. Dans la catégorie des États réputés, d'après des sources non officielles - généralement les instituts de recherche américains -, détenir des armes chimiques, on trouve l'Algérie et Cuba, sans qu'existent de données publiées sur la nature de leurs activités, le Soudan qui, d'après le Pentagone, cherche depuis plusieurs années à produire des armes chimiques et a, dans cette entreprise, obtenu l'aide de l'Irak notamment et, enfin, le Vietnam. Enfin, la dernière catégorie regroupe sept Etats - le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni - qui sont des « repentis » de l'arme chimique. A l'exception de l'Afrique du Sud, qui a mis fin à son programme en 1993, c'est-à-dire peu après sa renonciation à l'arme nucléaire, il s'agit sans exception d'Etats situés dans l'hémisphère nord. S'agissant de la France, elle a mis fin à son programme en 1969 et l'on se rappelle le discours prononcé par le Président François Mitterrand en 1988 devant les Nations Unis lors duquel il avait déclaré que la France ne possédait pas d'armes chimiques et n'en fabriquerait aucune. _ Les zones à risque Au-delà de ce constat statique sur la présence des armes chimiques dans le monde, qu'en est-il de la dynamique de la prolifération chimique ? Cette question peut paraître anachronique alors qu'un nombre croissant de pays rejoint le régime international d'interdiction mis en place. Et pourtant, la liste des pays détenteurs d'armes chimiques, et surtout leur répartition géographique montrent que cette arme reste considérée par un certain nombre d'États comme nécessaire à leur sécurité. Le cas du Moyen-Orient est symptomatique de cet état de fait, même si on notera avec satisfaction que l'Iran et Israël sont signataires de la convention de 1993, l'Iran l'ayant même ratifiée. Le cas de l'Iran mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête : il n'est pas anodin que ce pays, victime et utilisateur d'armes chimiques à une époque récente, ait choisi de renoncer à cette arme, alors que celui-là même qui l'a utilisée contre lui, et qui a conduit l'Etat iranien à se doter de telles armes, l'Irak, est toujours soupçonné de détenir des stocks, à tout le moins d'être en mesure de le faire très rapidement. L'évolution de l'attitude iranienne est d'autant plus marquante que cinq ans avant qu'il signe la convention, le Président Rafsanjani déclarait en 1988, lors d'un débat au Parlement iranien sur la sécurité des villes situées à proximité d'usines de gaz, que « les armes biologiques et chimiques sont les bombes atomiques du pauvre et peuvent être facilement produites. Nous devons au moins réfléchir à leur bien-fondé pour notre défense. Bien que l'usage de telles armes soit inhumain, la guerre nous a enseigné que les règles de droit international n'étaient que des morceaux de papier ». De fait, depuis un à deux ans environ au moment où ces paroles sont prononcées, l'Iran, qui travaillait sur les armes chimiques depuis le début des années 1980, dispose d'une infrastructure lui permettant de produire suffisamment d'agents létaux - acide cyanhydrique, phosgène, chlore - pour en équiper des armes, dont il se sert d'ailleurs immédiatement contre l'Irak. A cette fin, l'Iran s'est essentiellement fourni auprès d'entreprises européennes, officiellement pour acquérir des usines de pesticides ; s'agissant des souches, ce pays s'est appuyé sur son ambassade à Bonn pour trouver les contacts et relais nécessaires. A la fin de la guerre contre l'Irak cependant, et plus encore après la guerre du Golfe, l'Iran s'est heurté à des difficultés à se fournir auprès de ses fournisseurs européens habituels, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne unissant leurs efforts pour limiter -enfin !- les transferts de biens et technologies vers l'Iran. Après des années de laxisme et dans un contexte de mise en cause, y compris pénale, de certains de leurs ressortissants, les fournisseurs d'hier s'efforçaient enfin de réactiver le tabou sur l'arme chimique, mis à mal par l'Irak. Il n'en reste pas moins que l'Iran a activement poursuivi son programme, à telle enseigne que, dans un rapport récent, la CIA estimait que l'Iran avait acquis une capacité annuelle de production d'armes chimiques de 1 000 tonnes. La Chine serait l'un des principaux fournisseurs de l'Iran dans ce domaine. Ainsi, à la fin de l'année 1996, elle aurait fourni à l'Iran environ 400 tonnes d'agents chimiques destinés à la production de gaz neurologiques, ainsi que deux tonnes d'hypochlorite de calcium, produit utilisé pour la décontamination. Un certain nombre de contrats entre les deux pays auraient par ailleurs échoué, dont l'ampleur révèle néanmoins la dimension des ambitions iraniennes : par exemple, l'Iran aurait passé commande de 17 tonnes de sulfite de sodium, composant utilisé pour la fabrication du gaz moutarde. Des sanctions ont d'ailleurs été imposées en mai 1997 par les Etats-Unis à deux entreprises chinoises en cause dans ces trafics, Nanjing Chemical Industry Group et Jiangsu Yongli Chemical Engineering and Import/Export Corporation. D'après la CIA, il aurait en outre existé une coopération entre l'Inde et l'Iran. L'Inde aurait ainsi assisté l'Iran dans la construction d'une usine importante à Qazvim, près de Téhéran, destinée à la production d'un précurseur majeur de gaz neurologique, le pentasulfide de phosphore. En juin 1997, l'Iran a ratifié la convention sur les armes chimiques ; en février 2000 cependant, il n'avait pas fourni la liste de ses installations. Que conclure pour l'avenir ? Faut-il craindre que les infrastructures de production civiles qu'il a conservées puissent être facilement reconverties pour un usage militaire ? Que penser par ailleurs des rapports qui établissent que, sur les 200 Iraniens présents en Russie, un certain nombre travaille sur les armes chimiques et biologiques, sous couvert de coopération civile ? Indéniablement, si l'Iran se veut en la matière un bon élève de la communauté internationale, il a gardé en mémoire les effets militaires importants des armes chimiques utilisées par l'Irak en 1987-1988 - qui l'ont forcé à reculer. Il ne peut donc être exclu qu'il se garde les moyens de réagir rapidement en cas de réactivation de la menace irakienne. Une fois encore donc, on se heurte à l'inconnue irakienne : force est de constater en effet qu'il n'est pas possible à ce jour de considérer que l'Irak n'a plus d'armes chimiques, ni les moyens d'en produire rapidement. Rappelons que ce pays avait développé, avant la guerre du Golfe, un programme massif. L'Irak, avant sa défaite, possédait plusieurs installations de recherche et de production : trois à Samara, capables de produire sarin et tabun, mais ayant besoin pour cela d'importer les précurseurs ; un à Akashat ; un à Al-Qaim, trois à Al-Fallajah, produisant 2 000 tonnes de neurotoxiques, enfin, un près de Mossoul, connue sous le nom de code « Saad 16 ». Ces installations, de même que l'usine biologique de Salman Park, ont bénéficié de l'aide généreuse de nombreuses sociétés allemandes : plusieurs d'entre elles ont été mises en cause à l'occasion de la crise du Golfe de 1990-91. A l'issue du conflit, et conformément aux dispositions de la résolution 687 du 3 avril 1991, l'Irak communiqua aux Nations Unies un inventaire de son arsenal chimique. Les chiffres sont impressionnants, surtout si l'on prend en compte les six semaines de bombardements aériens alliés -et en tout cas très supérieurs aux estimations des experts occidentaux avant la guerre : 11 131 obus chimiques et 1 005 tonnes de gaz innervant, 6 920 roquettes de 120 mm chargées de gaz sarin, 2 500 têtes de missiles de type Saqr-30 également au sarin, 200 bombes DB-Z au sarin, 75 tonnes de sarin, 150 tonnes de tabun et 280 tonnes de gaz moutarde. Par ailleurs, l'Irak dut admettre, lors des visites d'inspection de l'ONU en été 1991, qu'il avait bien lancé un programme d'armements biologiques, mais que celui-ci avait été abandonné à l'automne 1990... Depuis la fin de la guerre du Golfe, l'Irak a reconstruit des infrastructures clés de son complexe chimique et a tenté, sous couvert d'usage civil, de se procurer des biens à double usage. Plus encore, juste avant son départ en décembre 1998, l'UNSCOM a acquis la conviction que l'Irak avait masqué des informations sur son programme passé et disposait de munitions chimiques supérieures à ce qu'il avait déclaré. Un document de l'Armée de l'Air irakienne saisi par les inspecteurs de l'ONU révélait en effet que le nombre de munitions chimiques consommées par l'Irak lors de la guerre contre l'Iran était en réalité inférieur de 6 000 aux déclarations irakiennes. Qu'est-il advenu de ce nombre conséquent de munitions ? En l'absence d'inspections depuis le départ de l'UNSCOM, il est impossible de se prononcer, de même que sur l'ensemble du programme chimique irakien. Mais l'expérience de l'UNSCOM conduit les experts de l'ONU à estimer que l'Irak aurait la capacité de relancer son programme chimique en quelques mois, voire quelques semaines. Le faisceau de soupçons qui pèse sur ce pays s'agissant d'autres catégories d'armes de destruction massive conduit en tout cas à estimer que les motivations de l'Irak pour se doter de tels armements sont intactes. S'agissant des autres pays du Moyen-Orient, Israël, pour sa part, est présumé conduire des recherches portant autant sur la protection et les antidotes que sur la fabrication. La Syrie, de son côté, possède des stocks de gaz sarin et chercherait également à développer d'autres agents neurotoxiques. Elle reste cependant dépendante de fournisseurs étrangers sur des aspects essentiels de son programme chimique, y compris les précurseurs et des équipements clés pour la production des armes. Elle a changé de fournisseurs à plusieurs reprises : l'Egypte au début des années 1970, l'URSS à la fin de la décennie, l'Occident après le refus d'assistance notifié par l'URSS en 1983. L'Egypte produit de l'ypérite depuis les années 1960 ; elle en a même utilisé au Yémen. Elle produit aussi des neurotoxiques et possède des stocks de bombes et d'obus de ce type. En 1989, la société suisse Krebs s'est trouvée impliquée dans le projet de construction et d'approvisionnement d'une nouvelle usine dans ce pays. Parmi les États représentant un risque en termes de prolifération, notamment du fait de leur passé terroriste, figure la Libye, qui, bien que fortement dépendante de l'étranger pour l'acquisition de précurseurs, n'a pas abandonné son objectif de se doter d'une capacité offensive autonome. Certaines rumeurs affirmaient qu'elle avait employé des gaz au Tchad en 1987 et, à la fin de cette même année, des satellites de reconnaissance américains avaient décelé la construction d'une usine chimique à Rabta. Cette affaire avait entraîné la mise en cause d'une entreprise japonaise, la Japan Steel Works, et l'arrestation du Président de la firme allemande Imhausen-Chemie, en mai 1989. Au début de 1990, un incendie eut lieu à Rabta ; plutôt qu'un sabotage, l'hypothèse d'un coup monté par les Libyens est le plus souvent retenue par les experts occidentaux, les photos satellites n'ayant révélé aucun dommage manifeste sur le site. La conclusion d'une convention très intrusive d'interdiction des armes chimiques26 signifie-t-elle la fin d'un certain âge d'or pour cette arme ? En un mot, une logique de gestion des stocks s'est-elle substituée à une logique de production massive et de transferts multiples et peu contrôlés ? De fait, les transferts internationaux en matière chimique sont rendus aujourd'hui plus difficiles par le système de déclaration et de contrôle qui devraient s'instaurer peu à peu sur les stocks existants. Reste qu'un certain nombre de pays n'ont pas signé la convention, parmi lesquels on compte des Etats soupçonnés de conduire des programmes offensifs et qu'une telle convention ne règle pas la question des risques terroristes... Il n'est pas certain en outre que la gestion de l'existant présente un degré de dangerosité moindre au regard des risques de prolifération. Bien au contraire : l'évocation de la Russie comme archipel toxique dit tout sur le risque majeur posé par les programmes chimique et biologique russes en termes de prolifération. Avec 40 000 tonnes d'agents chimiques, soit les deux tiers de stocks mondiaux, c'est un lourd héritage que la Russie a reçu de l'URSS, si lourd qu'elle reçoit pour ce faire une aide internationale massive. A ce chiffre effrayant à lui seul, il faut en outre ajouter que la Russie a développé de nouveaux types d'armes chimiques, selon le principe du « bigger bang for a buck » : alors que les spécialistes insistent souvent sur le fait que, par rapport à toutes les autres technologies militaires, la technologie des armes chimiques est, en cette fin de vingtième siècle, somme toute assez semblable à ce qu'elle était il y a de cela cinquante, voire quatre-vingts ans, l'Union soviétique a fait mentir ce principe en développant des dizaines de tonnes d'agents neurologiques cinq à dix fois plus mortels que tous les autres types d'agents chimiques connus. D'après un vétéran du programme chimique soviétique, le docteur Vil Mirzayanov, cette nouvelle génération de gaz mortels, connue sous le nom de code « novichok », était fabriquée dans des structures agrochimiques qui en dissimulaient la nature militaire. L'un des principaux sujets de préoccupation concernant le programme chimique russe réside dans le thème, popularisé dans le domaine nucléaire, de la fuite des cerveaux (brain drain). Cette prise de conscience est récente. Par exemple, alors que le programme américain Nunn-Lugar de traitement des risques liés au démantèlement des armes nucléaires soviétiques commence dès 1991, ce n'est qu'en janvier 1999 que le Président Clinton a pris acte du problème chimique et biologique en Russie en soulignant « la taille des programmes biologiques et chimiques soviétiques et le fait que nous savons que beaucoup d'autres nations essaient de développer une capacité chimique et biologique » et en concluant « nous avions un problème nucléaire, nous avons un problème biologique et chimique ». Or, même s'il est difficile d'en avoir une évaluation exacte, les scientifiques de l'armement de haut niveau présentant un risque important en termes de prolifération dans le domaine chimique seraient 3 500 - 7 000 pour le biologique, à rapporter aux 2 000 scientifiques dans le domaine nucléaire. Dès 1994, des cas de prolifération sont apparus, qui soulignent le caractère préoccupant de la situation. Boris Eltsine s'est vu à l'époque contraint de limoger le premier chef de la commission présidentielle mise en place précisément, en 1992, pour superviser la destruction des armes chimiques et pour mettre les installations en concordance avec les traités internationaux : ce dernier avait en effet vendu des équipements et des précurseurs à un laboratoire syrien ! De même, les inspecteurs de l'UNSCOM découvrirent la preuve qu'en 1995, des Russes avaient vendu une cuve de 5 000 litres à l'Irak, que l'on suppose destinée à Al Halam, l'un des centres du programme biologique irakien détruit en juin 1996 par l'UNSCOM. * A n'en pas douter, la prise de conscience par la communauté internationale après la guerre du Golfe des dangers posés par la prolifération chimique a mis fin à un certain âge d'or de celle-ci. Mais il est tout aussi certain que de nombreux Etats restent intéressés par cette arme, notamment au Moyen-Orient. En outre, le cas russe reste problématique au regard de l'énormité du programme légué par l'URSS. C. L'ARCHIPEL BIOLOGIQUE OU L'ÉQUATION DE TOUS LES DANGERS Paradoxalement, la communauté internationale a développé des instruments de protection efficaces contre la prolifération nucléaire, alors que, au regard des difficultés d'acquisition, de fabrication et d'emploi de l'arme nucléaire, le danger est somme toute modéré, mais elle se trouve largement démunie contre la prolifération biologique qui représente pourtant de vraies menaces, parce que moins spectaculaires, moins visibles, mais tout aussi dangereuses. Plus encore, dans le cas du biologique, il existe une véritable impasse conceptuelle et opérationnelle sur le danger représenté par cette arme dans de nombreux pays, à commencer par la France. Par une sorte d'ironie qu'il faut bien qualifier de macabre, l'arme biologique n'a pas eu de Saddam Hussein pour faire la démonstration de son efficacité, même si l'Irak disposait pendant la guerre du Golfe de charges biomilitarisées porteuses du bacille du charbon. Et la plupart des experts continuent de la considérer comme une arme trop difficile d'emploi pour intéresser les apprentis dictateurs, négligeant le fait que des avancées technologiques ont permis aux armes biologiques de faire des progrès considérables. Ainsi, les procédures de lyophilisation, maîtrisées même par des petits pays comme l'Irak, ont résolu les difficultés de stockage ; par ailleurs, les techniques de dispersion par aérosol sont aujourd'hui à la portée d'un nombre croissant de pays. L'un des arguments souvent avancés pour justifier le faible investissement intellectuel, financier et opérationnel sur cette question réside dans la complexité même du sujet. De fait, la lutte contre le développement des armes biologiques pose des problèmes considérables : des contrôles difficiles, une utilisation discrète, une impunité importante, tels sont les termes de ce que l'on pourrait définir comme « l'équation de tous les dangers ». Equation qui risque de se compliquer d'ailleurs avec la révolution en cours dans les manipulations génétiques et les sciences du vivant, qui permet de développer des armes encore plus résistantes, voire radicalement nouvelles. En bref, faute d'appréhender le problème dans toutes ses dimensions, on ferme les yeux, ou presque. Et pourtant, la mise au grand jour récente de ce qui fut le plus grand programme biologique, avec les révélations faites par Ken Alibek27 sur le programme soviétique connu sous le nom de Biopreparat, fournit l'occasion de lever le voile pudique jeté sur l'arme biologique, dont les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'elle peut être à l'origine de dégâts équivalents au nucléaire. A ceci près qu'elle ne tue « que » les humains et ne provoque aucune destruction, méritant d'ailleurs plus à cet égard d'être qualifiée d'arme de « tuerie massive » (weapon of mass casualty) que de destruction massive, comme le souligne avec justesse Ken Alibek. 1. Une prolifération ancienne et méconnue a) L'incroyable programme biologique soviétique Dès avant la deuxième guerre mondiale, la plupart des grands pays industrialisés avaient des programmes de recherche biologique : c'est le cas de la France, du Japon, de l'URSS et du Royaume-Uni. L'ampleur du programme japonais fut révélée en 1945 par la saisie des documents sur ses recherches par l'URSS, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Après la guerre, le Royaume-Uni et les Etats-Unis menèrent des recherches sur des agents anti-personnels et produisirent des quantités importantes d'agents bactériens, viraux et des toxines. Dans les années 1960 cependant, certains pays mirent fin à leur programme, estimant qu'ils n'offraient aucun avantage militaire offensif. Le Royaume-Uni, parmi les premiers, abandonna son effort, suivi par les Etats-Unis en 1969. La France, quant à elle, arrêta son programme en 1972. Dans ce paysage, l'URSS apparaît comme une exception : après avoir été le premier pays à mettre en place un programme de recherche, relancé par la saisie des plans japonais, elle met en sommeil ses recherches dans les années 1950 et 1960, pour se lancer dans les années 1970, alors qu'elle vient de signer la convention internationale d'interdiction des armes biologiques, dans un programme de recherche et de production pharaonique. A son apogée à la fin des années 1980, celui-ci permettait à l'URSS de développer une nouvelle arme biologique par an. Si, par son ampleur et cette forme de fuite en avant qui le caractérisait, le programme soviétique n'est pas représentatif de ce que peut être, aujourd'hui, la prolifération biologique, la mission estime néanmoins nécessaire de s'y arrêter. D'abord parce qu'il s'agit d'un sujet peu connu, hormis dans les pays anglo-saxons : de ce point de vue, témoignage sur un passé parfois très récent, l'ouvrage de Ken Alibek28, Biohazard est également un outil pédagogique. L'auteur veut en effet combler ce qu'il juge être une méconnaissance préoccupante des risques biologiques dans les sociétés occidentales et attirer l'attention sur leur préparation insuffisante contre ces dangers. Dans cette perspective, « le premier pas » que nos sociétés doivent faire pour se « protéger est de comprendre la nature et le fonctionnement des armes biologiques ». Ensuite, parce qu'il paraît à vos rapporteurs nécessaire de rappeler que, si le danger représenté autrefois par les armes biologiques soviétiques a très fortement diminué, la menace d'une attaque biologique est plus forte que par le passé. _ Les grandes étapes du programme biologique militaire soviétique Lors de la guerre civile du début des années 1920, l'armée rouge fut profondément impressionnée par les ravages causés par l'épidémie de typhus de 1918 à 1921. En 1928, le conseil révolutionnaire militaire prend un décret secret ordonnant la transformation du typhus en arme de champ de bataille. Le programme est alors placé sous l'égide du Guépéou, l'ancêtre du KGB. Cette mainmise de la police secrète sur le programme biologique militaire durera jusqu'au début des années 1950. La première installation utilisée pour la recherche biologique militaire fut l'académie militaire de Leningrad. Rapidement, les chercheurs se tournent vers d'autres maladies : sur l'île de Solovetsky, dans l'Arctique, utilisée comme prison pour les détenus politiques, des scientifiques travaillent dès le milieu des années 1930 sur le typhus ou la mononucléose infectieuse, c'est-à-dire sur des agents susceptibles d'entraver les capacités de troupes ennemies. Il est très probable que les prisonniers furent utilisés comme cobayes (après les années 1930 cependant, le docteur Alibek déclare n'avoir lu aucun rapport tendant à prouver que des expérimentations humaines aient eu lieu). L'invasion nazie de 1941 conduisit le haut commandement à transférer ces installations à Kirov, à l'Ouest de l'Oural. La saisie des plans des installations de recherche biologiques japonaises, en septembre 1945, en Mandchourie, marque un tournant dans le programme soviétique. Dès 1946, un nouveau complexe biologique militaire est établi à Sverdlovsk, d'après les plans japonais. A la fin des années 1950, des sites de recherche, tournés vers tous les aspects de la guerre biologique (militaires, agricoles...) parsemaient l'ensemble du territoire de l'URSS. Avec la prééminence des thèses de Lyssenko, qui niait l'importance de la génétique, science « bourgeoise », au profit de théories environnementalistes, la recherche biologique connaît, jusqu'au début des années 1970, une longue période de stagnation. Il faut attendre 1972 pour que Youri Ovchinnikov, vice-président de l'académie des sciences morales de l'URSS, convainque le ministère de la Défense, puis Léonid Brejnev, de relancer le programme. Un décret secret de 1973 prévoit la modernisation des armes existantes et le développement d'agents pathogènes génétiquement modifiés, résistants aux vaccins et aux antibiotiques et destinés à l'utilisation militaire. Baptisé « Enzyme », ce programme est axé sur la tularémie, la peste, l'anthrax et la morve, autant de maladies déjà visées par le précédent programme, mais pour lesquels des antibiotiques avaient été élaborés. D'autres voies sont explorées, telles que la variole, les fièvres hémorragiques de type Marburg, Ebola ou Machupo29. C'est donc paradoxalement à partir de 1972, année de signature de la convention sur les armes biologiques par Moscou30, que « l'Union soviétique a bâti le plus important et le plus avancé programme biologique militaire du monde ». C'est par ce même décret qu'est créée l'agence Biopreparat, qui est officiellement une institution civile autonome et sera rattachée en 1980 au ministère des industries médicales et microbiologiques. Le quartier général de Biopreparat était situé à Moscou, rue Samokatnaya, dans un bâtiment qui abritait officiellement le directoire principal du conseil des ministres soviétique (Main Directorate of the Council of Soviet Ministers). Biopreparat avait deux fonctions : le développement de nouvelles armes ainsi que la supervision du processus complexe qui va de la recherche à la production industrielle. Une fois le développement achevé (ce qui suppose déjà de multiples étapes), l'arme était testée sous l'autorité de la direction du ministère de la Défense compétente (15ème « directorat »). Les essais des armes biologiques soviétiques Les nouvelles armes biologiques étaient testées à 3 700 km au sud de Moscou, en mer d'Aral, sur une île appelée l'île de la Renaissance (Rebirth Island). Le complexe d'essai était une installation dirigée par le 15ème directorat de l'armée. Quatre ou cinq mois durant, les équipes de Biopreparat y testaient les armes de l'année. Les scientifiques qui menaient ces expériences avaient interdiction de dire, même à leurs familles, où et pourquoi ils partaient. Il y eut quelques « fuites » : en 1972, deux pêcheurs moururent de la peste suite à un brusque mouvement du vent. Dans les années 1970 et 1980, un nombre anormalement élevé de cas de peste fut observé chez les rongeurs qui vivaient dans les zones inhabitées au nord de la zone d'essai. Après la chute de l'URSS en 1991, des médecins firent état de cas de peste dans plusieurs zones d'Asie centrale. Il est impossible de prouver que ces cas étaient liées aux activités de Biopreparat, mais, d'après le docteur Alibek, cela semble plus que probable. Les essais à l'air libre sur l'île de la Renaissance cessèrent en 1992. Il n'en reste aucune trace. Les accidents survenus aux chercheurs qui travaillaient sur les armes biologiques furent par ailleurs utilisés à des fins scientifiques. Ken Alibek décrit ainsi en détail le calvaire du Colonel Ustinov, chef d'équipe à Vector- site de fabrication des armes utilisant le virus de Marburg sur lequel les scientifiques soviétiques travaillaient depuis 1977 -qui s'injecta par erreur ce virus en 1989. Loin de chercher à mettre fin aux souffrances terribles d'Ustinov, sa hiérarchie profita de cet accident pour poursuivre avec attention l'évolution de la maladie. Après sa mort, des prélèvements réalisés sur son cadavre permirent d'isoler une souche du virus qu'il avait développé sous une forme particulièrement violente. Baptisée « variante U » en référence à ce chercheur, elle fut approuvée pour utilisation par l'autorité militaire au début de 1990. Puis l'état-major décidait, en cas de succès, des cibles visées et du nombre d'armes nécessaires. En fonction de cela, les installations de production adaptées étaient mises en place sous la direction de Biopreparat. Il faut souligner que le programme Enzyme n'était qu'une partie du programme de guerre biologique, dont les composantes institutionnelles étaient nombreuses, Biopreparat n'en représentant qu'une partie. Le principal acteur en est effet le 15ème « directorat », branche du ministère de la Défense qui supervise le programme biologique militaire depuis la deuxième guerre mondiale. Ont aussi des installations le ministère de l'agriculture, le ministère de la santé, le KGB (qui développe notamment des armes miniatures destinées aux assassinats) et l'académie des sciences. L'ensemble forme un tout dont très peu d'acteurs du système ont une vision globale, le fonctionnement de ce complexe biologique étant totalement compartimenté. Ken Alibek lui-même n'a que des rapports très rares avec le 15ème « directorat » ou avec un agent du KGB impliqué dans cette matière. Jusqu'en 1979, les activités de Biopreparat sont restreintes. Il faut voir dans ce démarrage très lent de l'agence la marque des rivalités institutionnelles au sein de l'appareil soviétique : les militaires, qui fournissent d'ailleurs la plus grande partie du personnel de Biopreparat, voient dans cette agence une simple extension de leur propre programme, alors que l'objectif est de créer une couverture civile, qui intervient ostensiblement dans le domaine pharmaceutique civil en participant à des conférences internationales et en recevant des souches de banques de microbes du monde entier. Dans ce contexte conflictuel, aucun des objectifs qui sont assignés à Biopreparat par le plan quinquennal de 1975 n'est atteint quand arrive à sa tête, en 1979, le Général Kalinine, qui va lui donner l'impulsion décisive. Biopreparat connaît alors son apogée, à l'instar d'ailleurs du programme biologique soviétique. Près de 300 projets sont énumérés, de manière plus ou moins développée, dans le plan quinquennal de 1985 élaboré par la commission militaro-industriel (VPK) et approuvé par M. Gorbatchev. Au milieu des années 80, chaque laboratoire de Biopreparat, chaque institut de recherche, chaque site de reproduction fonctionne à plein régime : de nouveaux agents, de nouvelles souches de virus et de bactéries et de nouvelles méthodes de dispersion sont testés chaque mois. Même le SIDA fut étudié, mais abandonné en raison de sa trop longue durée d'incubation... Chacune des composantes du programme soviétique se développe, conduisant à la création de villes clandestines et de centres de recherche sur tout le territoire de l'URSS. Aux installations militaires de Sverdlovsk, Kirov et Zagorsk, il faut ajouter par exemple : - à Leningrad, l'institut de Biopréparation Ultra-Pure, créé pour développer de nouvelles techniques de cultures d'agents pathogènes ; - à Omutninsk, près de Kirov, une entreprise de recherche bactériologique et de production d'armements ; - à Obolensk, au sud de Moscou, une ville entière destinée à l'ingénierie génétique ; - un institut d'immunologie à Chekhov, chargé de faire des recherches sur des souches de maladies résistantes aux antibiotiques ; - enfin, pour travailler sur les virus, le complexe de recherche et d'essais de Vector en Sibérie, près de Novosibirsk. Au plus haut de son activité, à la fin des années 80, le programme de guerre biologique soviétique occupait plus de 70 000 personnes, dont 40 000 employés dépendant de Biopreparat, 15 000 au ministère de la Défense et 10 000 au ministère de l'Agriculture. Le KGB lui-même avait sa propre division biologique. Comme sous le nom de code « Flayta » (flûte), celle-ci était destinée aux « opérations spéciales » et autres assassinats. A aucun moment, des barrières financières ne furent opposées à ce programme qui, en 1990, représentaient un milliard de dollars par an. Selon Ken Alibek, il s'agit du programme le plus secret de l'histoire de l'URSS, plus encore que le programme nucléaire : « Les Américains avaient revêtu du même voile de secret le projet Manhattan : pour nous, Biopreparat était notre projet Manhattan ». _ La mise au jour du programme soviétique La première faille dans l'édifice clandestin que représentait le programme de guerre biologique soviétique eut lieu en 1979, lors de l'accident à l'usine de Sverdlovsk, qui était au c_ur du programme de développement d'armes à anthrax. Suite à une erreur humaine, des spores d'anthrax se répandirent dans l'atmosphère et contaminèrent plusieurs douzaines de personnes, notamment des hommes qui travaillaient dans l'entreprise. L'importance de l'épidémie, jointe au fait qu'elle touchait une population masculine, attira l'attention des Occidentaux, qui ne parvinrent cependant pas à obtenir une preuve claire de cet incident. Sverdlovsk 1979 Le dernier vendredi de mars 1979, le lieutenant-colonel Nicolaï Chernysov, chef d'équipe du bloc 19 du complexe militaire secret de Sverdlovsk, est pressé de rentrer chez lui pour le week-end. Comme le filtre d'évacuation d'air vers l'extérieur est bouché, il l'enlève, mais ne le remplace pas. Il laisse simplement une note manuscrite pour l'équipe suivante, qui ne la lira pas. Plusieurs heures s'écouleront avant que la brigade de nuit se rende compte qu'une fine poussière contenant des spores d'anthrax se répand librement à l'extérieur des bâtiments. Le bloc 19, dirigé par le 15ème directorat du ministère de la Défense, est à l'époque le principal centre de fabrication du virus de l'anthrax, le « charbon pulmonaire ». Il y aura plus d'une centaine de morts dans la capitale de l'Oural. Essentiellement des ouvriers de l'usine céramique toute proche. Les autorités prétendront que les victimes avaient mangé de la viande avariée achetée au marché libre de la ville. Les responsables du P.C. local, dont un certain Boris Eltsine est le secrétaire général, ordonneront l'arrestation de quelques bouchers « non officiels », puis feront piquer une centaine de chiens errants ! Dans un rapport établi en 1980, le microbiologiste américain Raymond Zilinskas écrivait « Aucune nation ne serait assez stupide pour installer une usine de guerre biologique à proximité d'un centre de population important ». Cependant, au regard de la pression internationale, et afin de ne pas nourrir les soupçons occidentaux, Léonid Brejnev signa un décret secret en 1980 ordonnant le déplacement des installations de Sverdlovsk vers Stepnogorsk, aux confins du nord Kazakhstan. La vérité sur l'accident de Sverdlovsk ne fut admise par le pouvoir russe qu'en 1993, lors d'une interview de Boris Eltsine par un journaliste de la Pravda. Le président russe reconnut que « nos recherches militaires furent la cause de cet accident. ». Mais c'est la défection du colonel Vladimir Pasechnik, directeur de l'Institut de Biopréparation Ultra-Pure de Leningrad, qui porte le premier véritable coup au programme soviétique, puisqu'est mis fin au caractère secret des activités de Biopreparat. Cet institut fut l'un des chaînons clés du programme soviétique dès les années 1970, ayant pour rôle la militarisation des agents biologiques. C'est notamment sous l'autorité du colonel Pasechnik que fut conduit le projet d'adaptation des missiles de croisière aux armes biologiques. Suite à la défection de Pasechnik, il fut décidé que tous les travaux qu'il avait menés dans un but militaire seraient détruits et que l'Institut de Leningrad deviendrait civil. En dépit de ces mesures, cette défection mit à mal la stratégie de l'URSS destinée à contrer la suspicion croissante des Occidentaux à l'égard de son programme. C'est à cette occasion que Ken Alibek apprit par exemple que les Américains avaient demandé à inspecter les laboratoires soviétiques dès 1986. La défection de Pasechnik est en effet intéressante en ce qu'elle souligna, même chez ses propres acteurs, l'extrême compartimentation de l'organisation du programme biologique soviétique : il paraît ainsi avéré aujourd'hui que même le Ministre des Affaires étrangères, à l'époque Edouard Shevardnadze, ignorait tout du programme biologique. Face aux accusations américaines, une cellule de crise fut chargée de mettre en place une couverture pour les recherches biologiques (création d'installations mobiles imitées ensuite par les Irakiens) et de faire la preuve du caractère civil des installations existant dans ce secteur. Elle fut dotée pour cela de 400 000 dollars. Il faut souligner en outre qu'un manuel avait été élaboré dès 1988 pour les employés de Biopreparat, destiné à leur permettre de donner des réponses toutes faites à d'éventuels inspecteurs. A la fin de l'année 1989, face à la pression diplomatique britannique et américaine, un programme de visites réciproques fut décidé, tout ceci dans le plus grand secret. Les gouvernements américain et britannique voulaient en effet éviter une querelle publique qui puisse mettre en danger d'autres négociations de contrôle des armements ou même Gorbatchev lui-même. En mai 1990, Gorbatchev mit fin au programme Enzyme par un décret-secret. En octobre 1990, un accord trilatéral fut conclu entre l'Union soviétique, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour organiser une série de visites réciproques dans les installations suspectes. A cette époque, Biopreparat contrôlait environ 40 installations dans 15 villes différentes sur l'ensemble du territoire de l'Union soviétique. Une douzaine de ces installations était destinée à des recherches offensives et beaucoup d'autres mêlaient activités civiles et militaires. Il fut décidé que quatre sites seraient ouverts à l'inspection : Obolensk, Vector, l'Institut de Leningrad, ainsi qu'un Institut de recherche proche de Moscou. Les inspections qui eurent lieu au mois de janvier 1991 montrèrent que les Occidentaux en savaient beaucoup sur les installations suspectes, vraisemblablement grâce à des photos de reconnaissance par satellite. L'inspection russe aux Etats-Unis eut lieu en décembre 1991 et avait reçu pour ordre de revenir avec les preuves d'un programme biologique militaire américain. Ken Alibek en revint avec la conviction que les Américains avaient cessé toute fabrication d'arme biologique31 et se démit alors petit à petit de toutes ses fonctions scientifiques et militaires jusqu'à sa défection finale. La tentative de Gorbatchev de mettre fin à une partie du programme soviétique - les installations militaires n'étaient pas concernées par son décret - se solda par un échec. Le 11 avril 1992, Boris Eltsine signa une nouvelle fois un décret interdisant toute recherche biologique militaire offensive et coupa dans les crédits les programmes défensifs à hauteur de 50 %. Le 15ème directoire du ministère de la Défense fut dissout et remplacé par un département militaire pour la défense contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques. Rien n'était dit concernant l'avenir de Biopreparat. En septembre 1992, la Russie, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne aboutirent à un accord selon lequel la Russie mettait fin à son programme d'armes biologiques. Les trois parties acceptaient de travailler ensemble à la conversion des anciennes installations dans des centres de recherche scientifique pacifique, de favoriser les échanges scientifiques et d'établir des visites réciproques. b) Une prolifération encore mal connue La prolifération biologique entretient de nombreux points communs avec la prolifération chimique32 : létalité théoriquement élevée, programmes peu onéreux et discrets car susceptibles de couverture civile, précédents d'utilisation lors de conflits. Et pourtant la prolifération biologique reste mal connue. Ceci est d'autant plus paradoxal que l'utilisation de l'arme biologique est antérieure à celle de l'arme chimique pour la simple raison que la première s'est longtemps appuyée exclusivement sur des agents naturels, tandis que la deuxième est fille des progrès de la science depuis le XIXème siècle. Une arme biologique peut en effet être décrite comme « l'association de tout agent infectieux avec un vecteur, quel qu'il soit (obus d'artillerie, bombes, missiles, aérosols,...) dans le but de nuire à d'autre personnes »33. Les agents biologiques utilisés pour la fabrication de telles armes sont soit des organismes vivants, soit des toxines. Dans la première catégorie se trouvent les bactéries, qui sont à l'origine de la peste, l'anthrax34 ou la tularémie ; les rickettsies, à l'origine de la fièvre Q ; les virus, qui peuvent causer des maladies telles que la variole, la fièvre jaune, d'Ebola ou de Marbourg ; et les champignons, qui agissent essentiellement sur les récoltes. Les toxines se définissent pour leur part comme des produits non vivants issus de plantes ou de micro-organismes, tels que, par exemple, le ricin ou la toxine botulique. La plupart des toxines sont cependant d'origine chimique : on entre alors dans le domaine jusqu'alors à peine exploré des biotechnologies de même qu'on se heurte au problème de la frontière floue entre le chimique et le biologique. Et là se situe une autre différence majeure entre les deux formes de prolifération : en définitive, sur les dizaines de milliers d'agents chimiques sur lesquels les scientifiques militaires travaillent depuis plusieurs décennies, la liste des agents à usage militaire s'est stabilisée autour d'une soixantaine de produits ; au contraire, les formidables progrès de la génétique dont on commence à pressentir l'ampleur - ne parle-t-on pas de révolution génétique ?- ouvrent à la biologie militaire des perspectives aussi vastes qu'inquiétantes. Les techniques biotechnologiques peuvent être utilisées pour produire des agents biologiques à des fins militaires en quantité importantes et il se dit même que l'ingénierie génétique est susceptible d'améliorer leur stabilité - longtemps l'un des principaux obstacles posés aux programmes biologiques militaires - et leur résistance aux vaccins ou aux traitements existants. Nul besoin de souligner l'intérêt militaire d'une arme contre laquelle il n'existe pas de remède. La nature infectieuse des agents biologiques leur donne un autre « avantage » sur les agents chimiques : à la différence de ces derniers, de nombreux agents biologiques peuvent se reproduire, se multiplier au sein de l'hôte et surtout se transmettre. De ce fait, l'impact d'une arme biologique se prolonge bien au-delà de la date de sa première utilisation. Ceci est moins vrai des toxines, qui ne peuvent se propager au-delà de la population visée et ont, de ce fait, un potentiel létal souvent moindre que les virus ou les bactéries. Dans tous les cas de figure, l'impact précis d'une arme biologique reste mal connu car dépendant de facteurs complexes, tenant tant à l'agent lui-même qu'à sa cible. D'où les travaux incessants des chercheurs pour rendre le plus résistants possible les agents biologiques afin de diminuer les facteurs d'incertitude qui ne peuvent de toute façon pas être réduits à néant dès lors qu'il s'agit d'agents vivants agissant sur un autre être vivant. Ceci dit, la létalité de certains virus et bactéries est bien connue : la peste est réputée létale dans 90 % des cas et l'anthrax dans 80 %. D'ailleurs, dans le système soviétique, les armes biologiques faisaient l'objet d'un classement stratégique au regard de leurs effets létaux ou non : - les armes stratégiques, dont les taux de contagion et de mortalité sont très élevés (type peste ou variole) ; - les armes opérationnelles, destinées à donner un avantage militaire sur un théâtre d'opération (type tularémie, brucellose, morve) ; - les armes stratégico-opérationnelles, qui mêlent les deux effets (type anthrax, Marburg, fièvre Q). Potentiellement, les dangers dont est porteuse la prolifération biologique sont par conséquent bien plus importants que dans le domaine chimique. Et pour un proliférateur, le comparatif favorise sans conteste les armes biologiques. Tout d'abord, en termes de létalité, on peut même considérer que le potentiel d'une arme biologique est supérieur à celui d'une arme nucléaire, à quantité égale. Le Secrétaire d'Etat à la Défense, William Cohen, déclarait ainsi, en 1998 qu'« une quantité d'anthrax équivalente à celle d'un sac de sucre », disséminée dans des conditions idéales, serait suffisante pour tuer la moitié de la population de Washington. On estime par ailleurs que la dispersion d'armes biologiques par moyens aériens pendant la guerre du Golfe aurait pu faire 70 000 victimes. En outre, vue du point de vue du proliférateur, la couverture d'activités biologiques militaires est peut-être même plus facile que dans le domaine chimique, dans la mesure où non seulement les activités industrielles, mais également les activités médicales et scientifiques peuvent servir de prétexte à l'acquisition de souches. Or, il s'agit là d'un secteur encore pas réglementé au niveau international. C'est bien le caractère légal du commerce des germes et des virus qui permit à l'URSS, sous couvert de recherche scientifique, d'acheter des souches de virus auprès d'universités ou d'entreprises, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique ! Ainsi, l'URSS acquit le virus Machupo, responsable d'une épidémie de fièvre hémorragique en Bolivie, aux Etats-Unis ; Biopreparat se procura le virus de la fièvre dite de Marburg, dérivée de la fièvre Ebola, en Allemagne. Et ce sont, non des chercheurs civils, mais des agents du KGB, plus spécifiquement de l'agence connue dans le système sous le nom de « Capturing Agency One », qui acquirent ces souches pour Biopreparat... Autre donnée essentielle : le coût, alors que se multiplient les conflits de basse intensité dans des régions souvent très défavorisées. Indéniablement, parmi les armes de destruction massive, les armes biologiques ont un rapport coût/efficacité très important : à effets égaux, il faut 1 000 dollars pour une arme nucléaire, 25 dollars pour une arme chimique et 1 dollar pour une arme biologique. Par exemple, 200 à 300 g de Marburg suffisent pour infecter une zone de 1 km2. Enfin, à Sverdlovsk en 1979, 50 à 100 g d'anthrax en poudre libérés ont fait une centaine de morts, malgré des conditions de dispersion non optimales. Par ailleurs, comme il a été souligné précédemment, les technologies développées dans le domaine biologique sont toujours plus efficaces : des souches génétiquement altérées résistantes à plusieurs antibiotiques sont aujourd'hui disponibles pour la peste ou pour l'anthrax. Il faut ajouter que ces technologies sont présentées dans des revues scientifiques russes de manière détaillée. Ken Alibek cite également la parution dans un journal russe d'une publicité indiquant comment se procurer des agents pathogènes génétiquement modifiés. Enfin, faut-il rappeler que, s'il existe depuis 1972 une convention d'interdiction de l'arme biologique, celle-ci ne comporte aucun protocole de vérification à ce jour. Plus radicalement, les enjeux industriels conduisent les États à être très peu regardants sur leurs exportations. En bref, le fait que le problème de l'interdiction de cette arme, posé dès 1925, n'ait pas encore abouti révèle l'absence de volonté collective de la société internationale de s'attaquer à la question biologique. Il ne s'agit pas pour autant tomber dans la caricature : le récit que fait Ken Alibek d'un projet pharaonique, qui a mobilisé, au plus fort de son existence, près de 70 000 personnes, des moyens énormes et était motivé par un puissant facteur idéologique, révèle la complexité des techniques en jeu, notamment celles qui concernent la militarisation d'un agent toxique et son adaptation à un vecteur. Or, c'est là un aspect essentiel de l'arme biologique, qui détermine son efficacité : il faut en effet trouver des vecteurs qui préservent la virulence des agents biologiques au moment de leur dispersion. Les témoignages sur le programme soviétique montrent que l'air est le milieu de contamination le plus favorable. C'est pourquoi, dès les années 1920, aux débuts du programme biologique militaire, l'URSS recourut à des avions utilisés pour la pulvérisation des récoltes et volant à basse altitude. Après la deuxième guerre mondiale, des bombardiers armés d'explosifs furent utilisés. Mais le grand progrès dans le domaine des vecteurs de l'arme biologique intervint dans les années 1970, avec le recours à des missiles balistiques intercontinentaux. A la fin des années 1980, l'URSS a même ajouté les SS - 18 à la liste des vecteurs. Le récit que fait le docteur Alibek de cette décision montre bien cependant que l'adaptation de l'arme biologique à ce genre de vecteur réclame des capacités de production énormes - ce type de missile peut porter dix têtes contenant chacune une charge de 500 kilotonnes - et une longue expérience technique. Jusqu'alors, ce type de missile n'avait jamais été considéré comme un vecteur de lancement d'armes biologiques : peu d'agents biologiques peuvent être développés en quantités suffisantes pour remplir en même temps des centaines de têtes. Il faut en effet soumettre les germes à un processus de fermentation assez complexe : une machine à fermentation de 20 tonnes peut produire suffisamment de spores pour remplir un missile en un ou deux jours. Cependant, Ken Alibek avait réussi à créer une variété d'anthrax plus concentrée, en sorte qu'un nombre réduit de spores suffisait à une attaque, découverte qui ouvrit la voie à une évolution des vecteurs de lancement. En 1987, la production totale d'anthrax était de 5 000 tonnes par an, soit un montant supérieur à ce que prévoyaient les plans du ministère de la Défense. L'usine de Stepnogorsk dans laquelle se trouvait Ken Alibek produisait 300 tonnes par an, pour un effectif de 900 personnes35. L'anthrax développé dans cette usine était trois fois plus efficace que celui de Sverdlovsk. Au total, Alibek estimait à deux semaines environ le délai nécessaire à la production d'anthrax pour remplir les SS - 18. Un seul SS - 18 chargé d'anthrax pourrait tuer l'équivalent de la population de New York. On notera que l'anthrax ne fut pas le seul agent biologique envisagé alors pour les SS - 18 : la peste, développée par Biopreparat dans une version plus virulente que la peste bubonique, pouvait être utilisée selon un calendrier similaire. De même, des quantités de germes de variole étaient stockées dans des bunkers souterrains des usines militaires. L'un des grands progrès réalisés dans le domaine des vecteurs, et qui rend l'arme biologique attractive, notamment pour un groupe terroriste, réside dans la possibilité de la disperser par aérosol. Là encore, la paternité technique de cette invention revient à Biopreparat, parvenu avec le temps, à mettre au point des techniques de contamination par aérosol, techniques complexes qui doivent prendre en compte la température extérieure, les conditions météorologiques, la fragilité des bactéries aux rayons du soleil et aux UV et le taux d'humidité de l'atmosphère. Que conclure, en termes opérationnels, de cette relative facilité, et, dans tous les cas, de ce potentiel de destruction énorme recelé par les armes biologiques ? En la matière, les positions sont tranchées et un débat de longue date oppose les alarmistes aux optimistes, les uns et les autres défendant des positions extrêmes, d'ailleurs largement à l'origine de ce qu'on pourrait appeler l'impensé biologique dans les doctrines militaires. Pour les alarmistes, le danger biologique est à nos portes et l'attentat chimique perpétré par la secte Aoum dans le métro de Tokyo préfigure le terrorisme de demain. Pour les autres, l'absence d'utilisation de cette arme dans des conflits récents, les difficultés d'utilisation qu'elle pose, les inhibitions morales et l'absence de lisibilité immédiate d'une attaque biologique rendent son usage futur improbable, tant par des militaires que par des terroristes. Les risques de voir se matérialiser la menace biologique se situent sans doute entre les deux extrêmes. On rappellera au préalable que l'arme biologique a déjà été utilisée : sans remonter aux Tartares, qui catapultaient des corps infectés par la peste bubonique dans les cités assiégées, ou aux colons espagnols qui distribuaient aux Amérindiens des couvertures infectées par la variole, il est utile de rappeler que le Japon a utilisé, et même expérimenté, l'arme biologique en Mandchourie à partir de 1937, utilisant des villages entiers comme terrains d'expérience ; que la tularémie aurait été utilisée à Stalingrad contre les troupes nazies et la morve, par l'URSS à nouveau, en Afghanistan, entre 1982 et 1984. Et même si ces cas d'utilisation sont sans commune mesure avec l'usage de l'arme chimique, l'argument de l'absence d'emploi passé pour justifier les faibles risques d'utilisation future ne vaut pas : absence d'emploi ne signifie pas absence d'intérêt. Pour un militaire, l'arme biologique présente deux grandes qualités : sa discrétion d'emploi, qui rend la détection, et donc la protection par des troupes ennemies difficiles, et l'absence de prophylaxie. Toutefois, elle présente également deux inconvénients : elle se développe plus ou moins rapidement et, en tout état de cause, n'acquiert son plein effet qu'après un certain temps ; elle ne peut être utilisée que dans certaines circonstances : il vaut en effet mieux frapper au crépuscule, quand l'air chaud près de la surface du sol est recouvert d'une couche d'air plus frais qui l'empêche de remonter. Dans la stratégie soviétique, il semble que l'utilisation des armes biologiques était envisagée dans une perspective de guerre totale, en complément à une frappe nucléaire. Dans cette perspective, le programme biologique soviétique était exclusivement offensif. Tandis qu'au plus fort de leur programme biologique militaire, les Etats-Unis restreignirent leurs recherches aux agents susceptibles d'être traités par antibiotiques ou par vaccins, le gouvernement soviétique décida pour sa part qu'il fallait privilégier le développement d'agents pour lesquels n'existait aucun traitement. Il s'agit là d'une constante du programme biologique soviétique, ce qui en fit d'ailleurs une course sans fin contre la recherche médicale. « Chaque fois qu'un traitement ou un vaccin était découvert quelque part, nous retournions à nos labos pour tenter de trouver comment contourner ses effets », rappelle Ken Alibek. Par exemple, dès lors que l'organisation mondiale de la santé déclara l'éradication de la variole en 1980, contre laquelle les populations ne furent plus vaccinées - il faut être un scientifique ou un militaire pour être vacciné aux Etats-Unis par exemple - ce virus fut considéré comme intéressant pour le programme militaire soviétique. Tout en déclarant officiellement le petit stock qu'elle possédait à l'institut Ivanovsky de virologie à Moscou, l'URSS cultiva des tonnes de virus de la variole à Zagorsk (Sergiyev Posad). Aux yeux du terroriste, la forte létalité de l'arme biologique est un atout majeur ; mais l'absence de signature, de visibilité immédiate et la forte technicité qu'elle requiert peut jouer contre l'attractivité de cette arme. Le risque terroriste est donc réel, même si « rares sont les pays et encore plus rares sont les organisations terroristes qui seraient en mesure de procéder à une attaque à l'air libre susceptible d'entraîner des pertes massives en vies humaines »36. 2. L'arme nucléaire du XXIème siècle ? L'évaluation de la prolifération biologique est très problématique. L'ouvrage de Ken Alibek, Biohazard, montre que la mise au point d'armes biologiques peut être menée à bien assez rapidement par de petites équipes et surtout que ce domaine recèle un champ d'innovations considérable. Dans ce domaine, le contrôle est quasiment impossible du fait des progrès constants de la recherche, de la perméabilité des frontières avec l'industrie chimique, de l'impossibilité à détecter les infrastructures par satellite et de l'existence d'équipes réduites. On sait toutefois que, globalement, la liste des pays proliférants est la même que pour les autres armes de destruction massive. a) Le panorama global de la prolifération biologique Le tableau des pays possédant, ou ayant possédé, des armes biologiques souligne une fois encore la parenté entre les proliférations biologique et chimique : tous les États qui développent, ou ont développé, un programme biologique, sont ou se sont également intéressés à l'arme chimique. En 1999, le centre de Monterey a recensé dix-neuf pays concernés par l'arme biologique, dont treize seraient encore actifs. Il s'agit de l'Algérie, la Chine, l'Egypte, l'Inde, l'Iran, l'Irak, Israël, la Libye, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie, Taiwan et les Etats-Unis. On rappellera qu'en 1995 un rapport de l'office d'évaluation technologique américain évaluait à dix sept le nombre de pays soupçonnés de posséder des armes biologiques : Libye, Corée du Nord, Corée du sud, Irak, Taiwan, Syrie, Israël, Iran, Chine, Egypte, Vietnam, Laos, Cuba, Bulgarie, Inde, Afrique du Sud et Russie. PAYS DÉTENANT OU AYANT DÉTENU DES ARMES BIOLOGIQUES
La liste fournie par le centre de Monterey inclut des pays au statut très divers : - à un premier niveau, se trouvent les pays qui, tout à fait officiellement et dans le cadre de la Convention internationale, conduisent un programme de recherche à des fins défensives. Il s'agit de l'Inde et des Etats-Unis ; - à un deuxième niveau, se trouvent des Etats qui mènent un effort de recherche, plus ou moins avancé. A l'exception de la Corée du Nord et de Taiwan, tous ces pays sont situés au Moyen-Orient (Egypte, Iran, Irak, Israël, Syrie) ou en Afrique du Nord (Algérie, Libye). Les deux pays qui présenteraient le plus fort risque en termes de prolifération sont l'Iran et l'Irak. D'après le secrétariat d'Etat américain à la Défense, l'Iran « possède l'expertise et l'infrastructure nécessaires pour soutenir un programme biologique. Il pourrait détenir des agents biologiques en petites quantités ». De même, Graham Pearson, du Mercury Center, notait en 1998 que « les pays occidentaux avaient remarqué des tentatives de la part d'Iraniens pour acheter, de manière non officielle, des technologies et des matériaux spécifiquement utilisés pour la production d'armes biologiques, en particulier de mycotoxines ». L'intérêt de l'Iran pour l'arme biologique est signalé par les services de renseignement américains à partir de 1996. Au total donc, rien ne permet d'exclure qu'en plus de son programme de recherche, l'Iran ne produise également des agents biologiques. De même, le cas de l'Irak soulève de multiples interrogations : ce pays a mené un programme de recherche et de production extrêmement actif et, bien que soumis à une stricte surveillance de la communauté internationale, est parvenu à dissimuler des éléments de son programme. Les Etats-Unis soutiennent qu'en cas de levée des sanctions, l'Irak reprendrait immédiatement un programme offensif dans la mesure où il a conservé la base technique nécessaire ; - au troisième niveau, la Russie doit être traitée à part dans la mesure où, bien qu'elle conduise tout aussi officiellement que l'Inde et les Etats-Unis un programme de recherche défensif, des soupçons pèsent sur la réalité de ses activités ; - enfin, le quatrième et plus élevé degré de risque en termes de prolifération concerne la Chine, qui maintient vraisemblablement un programme offensif. Le témoignage de Ken Alibek37 représente une deuxième source fournissant des indications sur les principaux pays intéressés par l'arme biologique. A partir de 1988, l'existence d'un programme biologique militaire est prouvée en Irak. D'après les experts américains, l'Irak a obtenu ses souches d'anthrax les plus virulentes auprès de l'American Type Culture Collection à Rockville, dans le Maryland, l'une des plus grandes banques de micro-organismes. Le Congrès vota en avril 1996 une loi obligeant les banques de virus et les firmes de biotechnologies à vérifier l'identité de tous les candidats à l'achat. Le programme irakien ne s'est vraisemblablement pas arrêté après la guerre du Golfe : l'auteur cite la tentative irakienne d'acheter des équipements de fermentation en 1995, destinés en théorie à la production de protéines pour le bétail. Or, l'Irak assortit sa demande d'un équipement de filtration capable de purifier l'air à 99,99 %, niveau utilisé seulement dans les laboratoires de mise au point d'armement. La Russie est supposée avoir négocié le même type d'installation avec l'Iran en 1997. De même, Ken Alibek rappelle que, dans le nord-ouest de la Chine, des photos satellites ont détecté ce qui semble être une usine de fermentation ; par ailleurs, des sources issues des services de renseignement ont établi que deux épidémies de fièvre hémorragique avaient eu lieu dans cette région à la fin des années 1980. Ken Alibek rappelle par ailleurs que la Russie a accueilli pendant des décennies des chercheurs d'Europe de l'Est, de Cuba, de Libye, d'Inde, d'Iran et d'Irak. Quarante chercheurs étrangers étaient acceptés chaque année comme stagiaires. Au cours de l'année qu'il a passée à décrire le programme soviétique aux experts américains, Ken Alibek s'est rendu compte que ceux-ci estimaient que ce programme était bel et bien terminé. Il exprime quant à lui ses doutes sur ce point et a été rejoint par la plupart des experts. Il cite notamment le fait qu'aucune installation militaire n'a pu être inspectée par des équipes étrangères depuis 1994. Il évoque également les paroles prononcées en 1997 par le major général Anatoly Khorechko qui déclarait : « Nous remettons en place ce qui a été détruit entre 1986 et 1989 ». Ken Alibek admet que les chaînes de production ont été détruites à Omutninsk ou Stepnogorsk, conformément au décret de Gorbatchev et transformées en usine pharmaceutique ou de pesticides. Il estime néanmoins que quelques modifications suffiraient à remettre en place les chaînes de production d'armes, sauf peut-être à Stepnorsk. En revanche, les sites de Vector, Obolensk, de même que l'Institut de Leningrad, restent sous contrôle étatique. Quant à d'autres usines, telles que certaines installations du conglomérat Biomash, elles ont été reformatées pour un usage civil, mais auraient, pour certaines d'entre elles, des contrats avec l'armée sur la défense biologique. Ken Alibek estime que la Russie continue à accorder une grande importance à ses anciennes infrastructures de guerre biologique : les dirigeants des trois principales installations biologiques militaires (Sverdlovsk, Zagorsk et Kirov) ont été promus dans l'armée entre 1992 et 1994 ; beaucoup d'anciens commandants et de bureaucrates de la machine de guerre biologique soviétique continuent d'occuper des fonctions gouvernementales importantes : le général Valentin Yevstigneyev qui dirigeait le 15ème « directorat » en 1991-1992 est maintenant directeur adjoint du « directorat » pour le contrôle des armes nucléaires, biologiques et chimiques de l'armée russe. Dans un rapport de janvier 2000, le ministère de la défense américain constatait également que les mêmes généraux qui dirigeaient le programme militaire biologique soviétique sont toujours à la tête du programme biologique défensif de la Russie. Plus encore, c'est le même général qu'à l'époque soviétique qui continue de diriger l'institut civil Biopreparat. Tous les interlocuteurs rencontrés par les membres de la mission à Moscou ont nié que la Russie poursuivait un programme biologique offensif, certains déclarant même découvrir l'existence de Biopreparat dont ils n'avaient jusqu'alors jamais entendu parler... Vos rapporteurs s'étonnent d'autant plus que l'accès aux quatre sites militaires fermés à toute inspection depuis 1994 leur ait été refusé pour des motifs tenant soit à la longueur de la procédure d'acceptation soit à la nécessité de vaccinations préalables... La mission ne peut donc que se faire l'écho des doutes de la grande majorité des experts internationaux. Reste qu'André Kokochine, ex-Secrétaire d'Etat à la Défense, qui estime que l'Occident surestime largement l'ampleur de Biopréparat, souligne avec justesse que l'arrêt de ce programme - qu'il juge complet - entraîne un risque de prolifération du fait de la mise au chômage de nombreux scientifiques. Ken Alibek met d'ailleurs l'accent sur le « boum » de cette mini-industrie que représentent les consultants en biodéfense, soulignant que pour de nombreux pays, le service d'un ancien scientifique de Biopreparat se monnaierait à n'importe quel prix. Il estime à 25 les spécialistes présents aux Etats-Unis et indique que beaucoup plus sont partis en Europe et en Asie. Il lui a été dit que plusieurs s'étaient rendus en Irak ou en Corée du Nord et que cinq d'entre eux étaient en Iran. Le New York Times a révélé en décembre 1998 que le gouvernement iranien avait dépêché un conseiller scientifique à Moscou pour recruter d'anciens scientifiques de notre programme. En mai 1997, plus de 100 scientifiques des laboratoires russes, dont Vector et Obolensk, ont assisté à une foire commerciale de biotechnologies à Téhéran. L'un des directeurs actuels d'un institut civil a déclaré à Ken Alibek que les Iraniens avaient visité Vector plusieurs fois. * De cet examen de l'état de la prolifération biologique, et notamment l'inconnue russe, vos rapporteurs ne peuvent que tirer des conclusions relativement pessimistes. L'absence de transparence du gouvernement russe en la matière n'est en effet pas de nature à apaiser ces craintes. La mission estime qu'il y a donc urgence à demander fermement à la Russie de se conformer aux obligations qu'elle a contractées en 1972. Nous devons demander à la Russie de lever la chape du secret qui pèse, comme au temps de l'URSS, sur ce programme qui constitue officiellement les vestiges d'une époque révolue. L'Europe ne peut accepter la présence à ses frontières de cet arsenal de mort, ce Tchernobyl puissance dix. De manière générale, la gestion du stock d'armes de destruction massive présent en Russie est une priorité absolue pour l'Europe du XXIème siècle : la Russie ne peut engranger de l'Occident les aides techniques, financières et humaines dans le nucléaire et le chimique et en même temps fermer ses centres d'armes bactériologiquement à tout regard étranger. D. LA PROLIFÉRATION DES MISSILES : UN PHÉNOMÈNE NON MAÎTRISÉ La prolifération des missiles, notamment balistiques, occupe le devant de la scène depuis quelques années : les débats américains sur l'évaluation de la menace dans le cadre du développement de programmes de défense antimissile, nationale (NMD) ou de théâtre (TMD) ont en effet conduit à donner un coup de projecteur sur ce champ de la prolifération longtemps considéré comme secondaire. S'il faut se réjouir de la sensibilisation des responsables politiques et des opinions publiques à ces sujets, il n'en faut pas moins regretter les termes excessifs, donc souvent trompeurs, dans lesquels la problématique a pu être posée, aux Etats-Unis notamment. Peut-être plus regrettable encore est le silence de l'Europe, au moins aussi concernée vue sa position géographique. Si le débat sur la menace balistique est aujourd'hui confisqué par les Etats-Unis, c'est en effet largement du fait des réticences de l'Europe à aborder ces thèmes publiquement. La mission rejoint les estimations américaines sur le fait que la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak développent des programmes balistiques ; en revanche, ses analyses divergent dès lors que sont posées les questions des délais et plus encore des motivations et des scénarios qui pourraient conduire ces pays à menacer le territoire américain ou d'autres pays. 1. Le consensus sur l'accélération de la prolifération balistique La prolifération balistique, et plus précisément, l'accélération de celle-ci dans les années récentes constituent des faits avérés : en dehors des cinq Etats nucléaires reconnus par le TNP, huit Etats disposent aujourd'hui de missiles à moyenne portée et ont en cours un projet de développement de missiles de moyenne longue portée qui pourrait arriver à maturation au cours de la seconde moitié de la décennie à venir38. Dans cette catégorie, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et l'Iran sont les plus avancés, qui ont testé ou du moins possèdent des engins de portée avoisinant ou dépassant 1 000 kilomètres, avec une capacité de charge utile d'une tonne environ et cherchent à se doter de capacités supérieures à 2 000 kilomètres. Dans un deuxième groupe se trouvent des pays tels que la Libye, la Syrie ou l'Egypte qui disposent aujourd'hui de missiles portant entre 300 et 500 kilomètres. L'Irak développe pour sa part des engins de portée inférieure à 150 kilomètres. L'histoire de la prolifération des missiles a connu deux phases39. Dans les années 1970, les principaux pays fournisseurs d'armes, dont l'URSS ou la France, ont largement contribué à la prolifération en vendant ce type d'armements à l'Algérie, la Libye, l'Egypte, le Yémen, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan ou l'Israël (MD 660 devenu le Jéricho-I). La deuxième phase de la prolifération des missiles s'est déroulée dans les années 1990, touchant un nombre de pays plus réduits (Corée du Nord, Inde, Pakistan, Iran) et se traduisant par l'existence d'un réseau missilier qui part de la Corée du Nord pour aller vers l'Iran, en passant par le Pakistan. Depuis 1998, un seuil psychologique et technique a été franchi en matière de prolifération balistique, qui se traduit par la croissance irrésistible des savoir-faire d'une part et de la production d'autre part, ainsi que par l'accès de plusieurs pays à une capacité balistique d'au moins 1 000 kilomètres. La chronologie de cette poussée de prolifération balistique n'est pas liée au calendrier des essais nucléaires indiens et pakistanais, comme le montre le tableau ci-après.
Si la sensibilité au problème de la prolifération balistique est récente, l'histoire du développement des missiles balistiques a déjà plusieurs décennies. La première occurrence d'emploi opérationnel des missiles remonte à la deuxième guerre mondiale, avec l'utilisation par l'Allemagne du premier missile balistique, le V 2. Depuis cette date, c'est essentiellement au Moyen-Orient que les missiles balistiques ont été utilisés en opérations : en 1973, par l'Egypte, lors de la guerre contre Israël, en 1986 par la Libye contre l'île italienne de Lampedusa, en 1988 par l'Iran et l'Irak lors de la guerre des villes et en 1991, pendant la guerre du Golfe. La Russie a recouru pour sa part par deux fois au missile balistique : en 1989 en Afghanistan et en 2000, à Grosny. La prolifération balistique est quasiment contemporaine de l'apparition de l'arme elle-même puisque, dès les années 1950, des connexions se créent à partir de l'URSS. C'est en effet à partir du Scud et des technologies soviétiques que la Chine, la Corée du Nord, l'Algérie, la Libye, l'Egypte, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Afghanistan acquièrent des capacités balistiques. A partir de ce tronc commun, des coopérations secondaires se sont créées, généralement Sud-Sud : la Chine a elle-même disséminé des technologies balistiques vers la Corée du Nord, la Syrie, l'Egypte, la Libye, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Pakistan ; la Corée du Nord a exporté vers l'Iran, la Syrie, l'Egypte et la Libye. La seule exception dans ce réseau de prolifération concerne l'Inde, dont les capacités balistiques sont exclusivement indigènes. Cette expansion géographique s'est accompagnée d'un processus d'amélioration continue de la technologie des missiles balistiques qui n'a cessé de s'améliorer. Les performances de cette arme ont progressé selon deux axes principaux : l'augmentation de la portée, ce qui suppose la maîtrise des techniques de séparation des têtes et des étages ; l'amélioration de la précision, c'est-à-dire des techniques de navigation et de guidage. Parallèlement, les pays producteurs de missiles balistiques ont cherché à en accroître les capacités d'emploi opérationnel par trois moyens : - la maîtrise de la propulsion solide. Le missile Scud, tronc commun de la plupart des programmes balistiques, présente en effet l'inconvénient d'être à propulsion liquide, ce qui le rend d'un maniement peu compatible avec un emploi opérationnel (5 à 6 heures pour remplir le missile de carburant, obligation de l'employer sous trente jours). La propulsion solide requiert cependant la maîtrise de technologies élaborées ; - la pénétration des défenses ; - la nature de la charge militaire (simple ou sophistiquée avec recours à des sous-munitions). Les performances des missiles testés par les pays qui ont développé des programmes balistiques attestent ces progrès constants. Alors que le Scud avait, en 1970, une portée de 300 kilomètres, le Al - Hussein irakien testé en 1989 affiche une portée de 550 kilomètres, le No Dong coréen testé en 1993 une portée de 1 000 kilomètres. Les missiles testés récemment ont des portées comprises entre 1 300 et 2 500 kilomètres : 1 300 kilomètres pour le Shihab III iranien (1998), 1 600 kilomètres pour le Taepo Dong I de la Corée du Nord (1998), 1 500 kilomètres pour le Ghauri pakistanais (1999) et 2 500 kilomètres pour l'Agni II indien (1999). Le DF-31 chinois testé en 1999 est un cas à part avec ses 8 000 kilomètres de portée. Les perspectives à 2005 confirment cette tendance constante à l'accroissement des portées : - s'agissant de la Corée du Nord, le développement d'un missile ayant une portée comprise entre 3 500 et 6 000 kilomètres, le Taepo Dong II serait presque achevé, l'échéance de l'année 2000 ayant même été avancée ; - le Pakistan pourrait disposer dès 2001, avec le Ghauri II, d'un missile multi-étages de 2 000 kilomètres de portée, la fin du développement du Shaheen II (2 500 kilomètres) étant prévue pour 2005 ; - l'Iran vise à atteindre une portée comprise entre 2 000 et 4 000 kilomètres pour 2005 avec le Shihab IV ; - enfin, l'Inde poursuit le développement de trois missiles balistiques de portée supérieure à 3 500 kilomètres, avec l'Agni III pour 2001 (3 500 à 3 700 kilomètres), l'Agni IV à une échéance non fixée (4 000 à 5 000 kilomètres) et enfin le Surya pour 2005 (12 000 kilomètres de portée). En termes techniques, l'Europe se trouve donc déjà à portée des missiles balistiques développés par les pays du Moyen-Orient. L'examen de la carte de la prolifération balistique fait apparaître trois zones particulièrement touchées par ce phénomène : - l'Extrême-Orient asiatique, avec la Corée du Nord ; - l'Asie du Sud, avec l'Inde et le Pakistan ; - le Moyen-Orient et le pourtour de la Méditerranée, En revanche, comme en matière nucléaire, la prolifération a régressé en Amérique Latine ou en Afrique du Sud. _ La Corée du Nord D'une certaine manière, la Corée du Nord représente l'archétype du proliférateur dans le domaine balistique40 : à partir d'une coopération qui lui a permis d'acquérir des Scuds, elle a développé un programme indigène qui ressortit, aux yeux des experts occidentaux, davantage du bricolage que d'une ingénierie de haut niveau, avant de devenir elle-même, comme nous le verrons, source de prolifération. Néanmoins, les faits sont là : la Corée dispose d'une capacité balistique qui n'est pas négligeable, au point d'être invoquée comme une menace majeure par l'hyperpuissance américaine. Dès le milieu des années 1970, la Corée du Nord développe une coopération avec la Chine sur le DF-61, qui s'achève en 1980. C'est cependant grâce à la fourniture de Scuds par l'Egypte que le programme nord-coréen démarre vraiment. Dans les années 1980, le pays produit des Scud B, dont les essais en vol répertoriés à ce jour se soldent par quatre échecs et trois succès. A la toute fin des années 1980, mais surtout dans la première moitié des années 1990, la Corée du Nord développe le Scud C, dont les essais répertoriés (six au total) se soldent par cinq succès et un échec. A la même époque, et à partir du Scud C, la Corée du Nord développe le No Dong dont les deux premiers essais se soldent par un échec, mais qui est testé avec succès par la suite. Vers 1993, le développement du Taepo Dong, dérivé du No Dong, est lancé et c'est le 31 août 1998 qu'a lieu le premier, mais retentissant, essai de ce missile : si la satellisation était l'objectif recherché pour l'engin testé à cette date, cet essai est un échec ; en revanche, si c'est un missile balistique qui a été testé, l'essai doit être considéré comme un succès. Aujourd'hui, la Corée du Nord dispose d'un marché conséquent : le prix de vente du Scud peut être évalué à 1 million de dollars, celui du No Dong à 1,5 million de dollars, le Taepo Dong étant estimé quant à lui entre six et sept millions de dollars pièce. _ Le Pakistan Les programmes d'armes de destruction massive du Pakistan constituent une source particulière de risques de prolifération. Ce pays conserve des relations stratégiques avec la République Populaire de Chine qui lui a apporté dans le passé une assistance technique pour son programme nucléaire. Le Pakistan s'est doté d'une industrie missilière pour produire des missiles à courte portée. Il développe la série de missiles Haft (Haft-1 de 80 km de portée en service) et Haft-2 (portée environ 300 km) qui pourrait être un clone du missile chinois M-11, et Haft 3 (portée environ 600 km). En avril 1998 et 1999, il a effectué des tests du missile Ghauri d'une portée annoncée de 1 100 km. · L'Inde L'Inde a lancé au début des années 1980 un programme ambitieux visant à développer une large gamme de missiles allant du missile stratégique sol-sol Agni aux missiles sol-sol de courte portée Prithvi en passant par une gamme de missiles sol-air et antichar. Plusieurs sources indiquent que l'Inde cherche à développer un missile de croisière, le Sagarika (300 km/500 kg). Un missile balistique intercontinental futur, le Surya serait également en projet. L'Inde assemble dans le centre Bharat Dynamics Limited (BDL) d'Hyderabad un missile mobile à courte portée, le Prithvi, missile mono-étage à propulsion liquide dérivé du SA-2 soviétique. Sa capacité de production est évaluée à quelques missiles par mois au maximum. Le Prithvi est un missile hybride, balistique et aérodynamique, dont il existe aujourd'hui deux modèles, l'un d'une portée de 150 km pour l'armée de terre (charge explosive de 1 000 kg), l'autre d'une portée de 250 km pour une charge explosive de 500 kg. Le premier tir du missile Prithvi a eu lieu en 1988 ; 16 essais en vol ont été réalisés depuis 41. Ce missile a été exhibé en public pour la première fois 26 janvier 1997, à l'occasion du défilé marquant l'anniversaire de la naissance de la République indienne. L'Inde développe également un missile à moyenne portée, Agni, qui pourrait emporter une charge explosive ou nucléaire de 1 000 kg à 2 500 km. Il s'agit d'un missile à deux étages. Le premier étage est le lanceur civil SLV-3, et le second étage serait un missile Prithvi. Après des résultats assez probants du démonstrateur Agni - trois essais réussis, dont un d'une portée de 1 400 km avec test d'un véhicule de rentrée - les autorités indiennes avaient annoncé au printemps 1997 qu'elles renonçaient à produire ce missile de moyenne portée, au grand dam des partisans nationalistes du BJP. Suite à l'essai en juillet 1997 du missile pakistanais 42 Hatf IV, d'une portée estimée à 600-700 km, le ministre de la défense indien a annoncé en août 1997, devant le Parlement, que le gouvernement avait décidé d'accorder une haute priorité à une nouvelle phase du programme Agni. Le lancement du missile pakistanais Ghauri en avril 1998, et l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste BJP a relancé le programme Agni. Un tir expérimental de l'Agni-II a été effectué le 11 avril 1999. Lancé du pas de tir de l'île Wheeler, le missile a parcouru environ 2 000 km avant de retomber dans les eaux du golfe du Bengale. Selon le directeur du DRDO (Defense Research and Development Organization), le docteur Abdul Kalam, un missile Agni-III d'une portée estimée de 3 500 km est en phase avancée. _ Le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen Jusqu'en 1996, on aurait pu penser que les progrès substantiels réalisés en vue d'une solution négociée de la question palestinienne modifieraient le contexte de la sécurité au Moyen-Orient. On pouvait espérer que les conflits régionaux, avec leur cortège de rivalités et de course aux armements, s'atténueraient, et qu'un coup d'arrêt serait donné aux programmes relatifs aux armes de destruction massive que l'insécurité séculaire a souvent entretenus. Cette perspective ne s'est pas, notamment en raison des difficultés rencontrées dans la mise en _uvre du processus de paix. Quatre pays de la région suscitent une inquiétude particulière. Il s'agit de l'Iran, de l'Irak, de la Libye et de la Syrie qui détiennent ou ont continué à développer les connaissances nécessaires à la mise au point de missiles vecteurs d'armes de destruction massive. D'autres pays de la région développent, eux aussi, des capacités même si aujourd'hui leurs intentions ne suscitent pas d'inquiétudes. Ceci est particulièrement vrai pour des pays comme Israël et l'Arabie Saoudite. Il faut également tenir compte des moyens dont disposent l'Egypte et l'Algérie car, comme l'histoire l'a montré, les intentions ou les régimes politiques peuvent changer, mais les réalisations industrielles et militaires demeurent. Ces pays cherchent également à acquérir ou à développer des vecteurs mobiles et plus performants en améliorant leur portée, leur précision, et leurs délais de mise en _uvre opérationnelle, ce qui est susceptible d'entraîner à terme une aggravation de la menace militaire. Leur objectif est également de les utiliser comme arme de dissuasion en développant parallèlement les moyens d'accès à des ogives nucléaires, chimiques ou biologiques. En règle générale, l'acquisition des technologies proliférantes à l'extérieur, s'accompagne de la volonté de développer une capacité de production locale de façon à acquérir leur propre autonomie. C'est le cas par exemple, de l'Iran qui fait des efforts pour disposer, avant la fin de la décennie, de sa capacité propre de production de missiles. Certains développements en matière de missiles ne parviendront pas à maturité, voire échoueront. On peut cependant estimer que certains pourraient être menés à terme. Ils contiennent en germe une plus grande vulnérabilité de certaines zones européennes à des missiles balistiques lancés du Moyen-Orient. D'autant que, l'exemple irakien nous rappelle que la production d'agents chimiques et surtout biologiques peut passer pratiquement inaperçu aux meilleurs services de renseignements de l'Occident. - L'Iran Alors que l'Irak est soumis aux contraintes imposées par la communauté internationale, le programme balistique de l'Iran suscite de nombreuses interrogations, notamment au vu du développement parallèle de programmes biologiques et chimiques et des soupçons qui pèsent sur l'existence d'un programme nucléaire. L'Iran dispose aujourd'hui d'artillerie, d'aéronefs et de missiles pouvant tirer ou emporter des armes de destruction massive. Sa panoplie de missiles comprend des Scud B et C construits localement (dont la portée et la charge utile sont respectivement 300 km/1 000 kg et 500 km/770 kg). L'Iran a en outre acquis au minimum 200 missiles à courte portée de type CSS-8 (dérivé du missile SA-2 chinois) et un grand nombre de missiles de défense côtière anti-navires. L'Iran a manifesté son intérêt pour des vecteurs plus modernes et de portée supérieure, comme le Nodong nord-coréen. Israël et les Etats-Unis font par ailleurs état d'une coopération avec des experts russes pour la mise au point de missiles Shihab III et IV, d'une portée respective de 1 300 km et de près de 2 000 km. Téhéran a procédé le 22 juillet 1998 à un tir de missile balistique de moyenne portée Shihab III. Détecté par un satellite américain, ce tir a été confirmé par la presse iranienne du 26 juillet qui cite les propos du ministre iranien de la défense, l'amiral Ali Chamkhani, se félicitant du « succès du tir d'essai du missile Shihab III entièrement développé en Iran, sans assistance étrangère ». Le missile testé serait du type Nodong, à propulsion liquide, de conception proche du missile pakistanais Ghauri tiré en avril 1998, c'est-à-dire d'une portée théorique estimée à 1 000 km pour une charge d'emport de 1 000 kg. Il aurait explosé au bout de 100 secondes de vol, soit peu de temps avant la fin théorique de la phase de propulsion. Cette explosion aurait eu lieu à l'est d'Ispahan, à 200 km environ du point de lancement. Deux hypothèses peuvent expliquer cette explosion : soit une destruction automatique en raison d'une déviation de trajectoire, soit un incident au niveau de la propulsion. Les experts israéliens de la défense estiment que le développement de ce missile pourrait être achevé d'ici moins d'un an. Le Ministre israélien de la Défense déclarait au début du mois d'août 1998 : « le missile qui a été essayé ne peut encore atteindre Israël, mais la menace est sérieuse et c'est l'équilibre stratégique du Proche-Orient qui est en cause ». - L'Irak Avant la guerre du Golfe, l'Irak avait réussi à augmenter de manière significative la portée de ses Scud d'origine soviétique de 375 km à 600 km (mais les missiles ainsi obtenus étaient notoirement instables en vol). De 1984 à 1989, l'Irak a également participé au programme Condor II en compagnie de l'Egypte et de l'Argentine. Depuis 1991, conformément à la Résolution 687 des Nations Unies, tous les missiles irakiens dont la portée excède 150 km ont été détruits. Toutefois, l'Irak peut avoir réussi à dissimuler quelques éléments de missiles Scud. L'UNSCOM, organisme des Nations Unies chargé du désarmement de l'Irak, a répertorié 819 missiles Scud, à l'été 1997, 817 ont été reconnus détruits par cette commission. Des doutes subsistent sur les deux derniers. L'Irak conserve des missiles à courte portée de fabrication soviétique (FROG 7) et des missiles sol-air de type SA-2. Il dispose toujours d'un savoir-faire considérable pour développer des missiles et, par ailleurs, la résolution 687 ne lui interdit pas de construire des missiles d'une portée inférieure ou égale à 150 km. L'Irak travaille au développement du missile à propulsion solide Ababil-100 et du missile Al Samoud à propulsion liquide que les experts qualifient de mini-Scud du fait de sa ressemblance avec ce missile, tous deux d'une portée d'environ 150 km. L'Irak a perdu l'essentiel de l'infrastructure utilisée pour ses programmes de missiles balistiques et il lui faudra beaucoup de temps pour la reconstituer. De surcroît, la majeure partie de ses programmes précédents concernait des versions dérivées de missiles Scud importés. La reprise de ces programmes dépendra des équipements qui auraient pu être dissimulés ou bien de nouvelles importations. L'Irak est toutefois autorisé à conduire des programmes concernant des missiles de portée égale ou inférieure à 150 km mais qui pourraient constituer le germe de missiles futurs de portée supérieure. Il faut ajouter que l'Irak dispose d'un personnel expérimenté et muni du savoir-faire requis pour la conception et l'assemblage de missiles. - La Libye La Libye a reçu des missiles Scud B de l'ex-Union soviétique mais n'a pu obtenir de systèmes à plus longue portée ni de la Chine, ni de la Corée du Nord. Elle aurait tenté de développer un projet de missile à plus longue portée (950 km) connu sous le nom de projet Al Fatah. Ce programme serait aujourd'hui abandonné et, à ce jour, la capacité de production libyenne de missiles semble nulle. Les activités futures dépendent très largement de l'aide étrangère. Les acquisitions récentes de la Libye ont surtout concerné les composants pour missiles et des équipements ayant trait à leur développement. - La Syrie La Syrie a été, dans le passé, largement dépendante de l'assistance militaire et économique de l'ex-Union soviétique. Dans le sillage de la fin de la guerre froide, elle a amélioré ses relations avec les pays occidentaux mais il n'en reste pas moins vrai que la Syrie déploie toujours des efforts importants pour se procurer certaines armes de destruction massive ainsi que des missiles balistiques. Elle a notamment acquis auprès de la Corée du Nord des missiles Scud C ainsi que la technologie de production correspondante. La Syrie dispose de trois types de missiles balistiques capables d'emporter des munitions NBC : le SS-21 MOD 3 (120 km et 450 kg), le Scud B (300 km et 1 000 kg) et le Scud C (500 km et 770 kg). La Syrie pourrait avoir développé une coopération active avec l'Iran et la Corée du Nord pour le développement de missiles à plus longue portée de type No-Dong. La Syrie assemble ses Scud C (500 km et 770 kg) à partir d'éléments importés ; elle pourrait être capable de construire des missiles de ce type à un rythme réduit dans deux ou trois ans. La Syrie est probablement à la recherche d'aides d'un autre genre auprès de la Chine, de la Russie et de certains pays occidentaux, les domaines concernés étant vraisemblablement les systèmes de guidage, les composants de propulseurs et les technologies qui s'y rapportent. Avec le temps, ces apports permettront sans doute à la Syrie de fabriquer des missiles à propulsion solide. - L'Egypte L'Egypte dispose de toute une gamme de vecteurs, dont des missiles balistiques, des missiles anti-navires, des aéronefs, des drones et des batteries d'artillerie qui pourraient être modifiés pour acheminer des armements NBC. Elle a en particulier des missiles balistiques à courte portée Scud B (et vraisemblablement des Scuds C fournis par la Corée du Nord), ainsi que d'autres missiles du champ de bataille à portée encore plus réduite qui, tous, sont d'origine soviétique ou ont été fabriqués localement. L'Egypte avait dans les années 1980 participé avec l'Argentine et l'Irak au programme Condor II dont l'objectif était de développer un missile à propergol solide d'une portée de 1 000 km. Pour compléter les technologies militaires apportées par les pays occidentaux et l'ex-Union soviétique, l'Egypte est susceptible de se tourner vers les fournisseurs de remplacement que sont certains pays en voie de développement comme la Corée du Nord en particulier et peut-être la Chine. Elle cherchera vraisemblablement à se procurer des composants de missiles balistiques et des équipements de production auprès de la Corée du Nord, de la Russie et de fournisseurs occidentaux. - L'Arabie saoudite L'Arabie saoudite ne détient pas d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques. En revanche, depuis 1989 l'Arabie saoudite possède des missiles (entre 20 et 50) fournis par les Chinois, à charge conventionnelle CSS-2 de portée intermédiaire (charge utile de 2 150 kg acheminée à 2 800 km), donc capable d'atteindre le sud de l'Europe. c) Un sujet moins connu : la prolifération des missiles de croisière Considéré aujourd'hui comme un armement indispensable à la panoplie de toute armée, le missile de croisière fait peu l'objet de développement spécifique. Or, ce type d'armes peut avoir des effets déstabilisateurs importants et fait, pour cette raison, l'objet de contrôles internationaux. Il est par conséquent intéressant de constater qu'un certain nombre de pays, tous situés dans des régions névralgiques, ont détourné la fonction principale d'un autre système d'armes (anti-navire, air/sol, cible...) pour la transformer en missile de croisière. Cette voie permet en effet de contourner les éventuels embargos sur des composantes sensibles (composants inertiels, turboréacteurs, GPS,...). Le tableau suivant, non exhaustif, fournit quelques exemples :
2. La menace en débat : regard américain sur la prolifération balistique Aux Etats-Unis, le discours sur l'évaluation de la menace - dont les termes sont largement déterminés par la pression constante d'un Congrès soucieux de reprendre puis de maintenir un pouvoir d'initiative sur les questions touchant à la sécurité nationale - fait l'objet d'un consensus quasiment parfait, tant au sein de la classe politique que chez les experts ou dans l'opinion publique. Les analyses parfois apocalyptiques des menaces pesant sur les Etats-Unis n'ont donc pas hypothéqué la crédibilité d'un constat aujourd'hui tenu pour incontestable par la très grande majorité des Américains : il existe, à moyen terme, une menace de la Corée du Nord, de l'Irak ou de l'Iran sur le territoire américain. La plupart des pays européens mettent en doute les évaluations américaines, dont la méthodologie notamment est contestée : risque ne signifie pas menace, pas plus que la détention d'une capacité technique n'implique un usage politique de celle-ci. En fait, derrière l'argumentaire développé par les uns et les autres, c'est, en filigrane, le débat sur la pertinence d'une stratégie de défense antimissile qui apparaît. a) Le débat aux Etats-Unis : l'évaluation de la menace comme enjeu politique Si l'opinion publique américaine a redécouvert la crainte d'attaques balistiques avec l'essai du Taepo Dong 1 le 31 août 1998 par la Corée du Nord, le thème de l'attaque surprise constitue en réalité un « ferment de la politique stratégique américaine » (Xavier Pasco)43 depuis la présidence Eisenhower. Ce débat a néanmoins pris une dimension nouvelle avec la fin de la guerre froide, en se doublant d'une controverse sur la capacité des services de renseignement à évaluer les nouvelles menaces. Dès 1990-1991, le Pentagone a quelques difficultés à présenter au Congrès les programmes de défense sur la base de « menaces établies » ; dans le même temps, l'adaptation des structures militaires américaines aux nouveaux enjeux stratégiques et militaires devient un thème majeur des Présidences Bush et Clinton, comme en témoigne le lancement d'une revue de fond en comble de ces structures (Bottom-Up review) par Lee Aspin, Secrétaire d'Etat à la Défense, en 1993. Dans ce contexte, la mise en perspective d'une « menace établie » devient rapidement une priorité, non seulement pour le Pentagone, mais aussi et surtout pour le Congrès, soucieux de reprendre l'avantage politique dans le débat sur la sécurité nationale du pays. A cet égard, le rapport Rumsfeld, fruit d'un débat dont les termes sont posés en 1994, avec la victoire des Républicains au Congrès, et 1995, avec la présentation par la CIA de son estimation nationale de renseignement (National Intelligence Estimate ou NIE)44, représente « la concrétisation d'un nouveau scepticisme né de la fin de la guerre froide et de la nécessité qu'elle a entraînée de redéfinir la menace » (Xavier Pasco). _ La NIE de 1995 ou la contestation par le Congrès de la capacité des services de renseignement à évaluer la menace Les NIE de 1993 et plus encore de 1995 peuvent être considérées comme le point d'origine officiel de la controverse autour de l'évaluation de la menace balistique. Elles concluent en effet que : - « aucun pays, autre que les puissances nucléaires majeures déclarées, ne développera ou n'acquerra d'une autre manière un missile balistique d'ici les quinze prochaines années, qui puisse menacer les 48 Etats [des Etats-Unis] ou le Canada ; - le MTCR continuera de limiter de manière significative le transfert de missiles, de composants ou de technologie associée, mais des fuites de composants ou de technologies critiques continueront probablement ; - aucun pays disposant d'ICBM ne les vendra ; - un programme d'essais en vol d'au moins cinq ans est un élément essentiel pour le développement d'un ICBM ». Dans un contexte de débats virulents entre partisans de la défense antimissile de théâtre (TMD), défendue notamment par l'Administration Clinton, et tenants d'un système de défense antimissiles protégeant l'ensemble du territoire national (NMD) et alors qu'en 1993, le Président Clinton a substitué la BMDO à la SDIO, la controverse sur la NIE ne se fait pas attendre. Les critiques sur ce document portent aussi bien sur la méthode (insuffisante prise en compte de l'Alaska et d'Hawaï, absence de toute échelle de probabilité45, de scénario) que sur le fond (accusation d'affirmer sans preuve ni démonstration). Elles conduisent le Congrès à commander une contre-analyse au directeur central du renseignement, John Deutch, qui confie cette tâche à son prédécesseur, Robert Gates. Le rapport Gates, présenté au Congrès à la fin de l'année 1996, se veut modéré. Il admet que les conclusions de la NIE 1995 sont parfois trop optimistes (délai de quinze ans pour développer un missile) et reconnaît que le cadre d'analyse est incomplet, en ce qu'il n'évoque pas les autres types de menace (missiles de croisière) ou les motivations susceptibles de conduire au développement d'ICBM. Mais il n'en réaffirme pas moins la conclusion de la NIE 1995 : « le panel est convaincu du bien-fondé de l'analyse menée par la communauté du renseignement sur des bases techniques saines ; que les Etats-Unis ont peu de chances de devoir faire face à une menace en provenance du Tiers Monde sous la forme d'un ICBM développé et testé de manière indigène, même en tenant compte d'une assistance technique et de l'acquisition de matériel étranger ». _ Le rapport Rumsfeld (juillet 1998) : un tournant majeur du débat Peu satisfait des conclusions de cette contre-expertise, le Congrès décide, dans le cadre du budget de la défense pour 1997, de lancer sa propre étude, en contrôlant cette fois la nomination des membres du groupe d'évaluation, choisis à l'écart de la communauté du renseignement en activité et sur une base « bi-partisane » (3 démocrates, 5 Républicains). Dans un rapport classifié, dont n'a été diffusée qu'une version succincte au mois de juillet 1998, la commission Rumsfeld établit à l'unanimité que : - la menace balistique qui pèse sur les Etats-Unis, émanant de la Corée du Nord, de l'Iran ou de l'Irak, ne cesse de croître, venant s'ajouter aux inquiétudes suscitées par les arsenaux russe et chinois (scénario de tirs accidentels ou non autorisés dits « octobre rouge »). « Les efforts concertés de plusieurs nations ouvertement ou potentiellement hostiles en vue d'acquérir des missiles balistiques équipés de têtes nucléaires ou biologiques font peser une menace grandissante sur les Etats-Unis, leurs forces déployées ou leurs alliés » ; - s'ils décident d'acquérir une capacité balistique intercontinentale, ces différents pays sont capables d'infliger des destructions majeures aux Etats-Unis dans un délai de cinq années après l'intervention d'une telle décision (dix pour l'Irak). ; - la menace posée par ces capacités émergentes sur les Etats-Unis est plus large, plus mûre et évolue plus rapidement que ce qui a été rapporté dans les estimations et les rapports produits par la communauté du renseignement ; - la capacité de la communauté du renseignement à fournir des estimations précises et fiables de la menace balistique pesant sur les Etats-Unis s'érode. Cette érosion trouve son origine à la fois au sein et en dehors de la communauté du renseignement. Les capacités de la communauté dans ce domaine doivent être renforcées, à la fois du point de vue des ressources et de la méthodologie ; - les temps d'alerte dont disposent les Etats-Unis vis-à-vis des déploiements de missiles balistiques se réduisent. Plusieurs scénarios plausibles, comprenant des relocalisations ou des transferts de missiles opérationnels, des options consistant à lancer depuis la mer ou les airs, ou des programmes de développement raccourcis qui pourraient faire intervenir des tests menés dans des pays tiers, ou une combinaison de ces différentes possibilités, estiment que les Etats-Unis pourraient être victimes d'un raccourcissement ou d'une interdiction de tout délai d'alerte. Si le rapport Rumsfeld s'éloigne de la NIE tant sur la méthode (par exemple, mesurer la progression d'un programme balistique non à partir d'un point d'origine connu mais en évaluant combien de temps il reste avant le premier essai en vol d'un missile balistique intercontinental) que sur le fond (temps d'alerte réduit), ce sont essentiellement les jugements très durs du rapport sur les manquements du renseignement qui alimenteront le débat. Dans la foulée de ce rapport, le Congrès mandate une commission chargée d'évaluer l'organisation de l'Etat fédéral dans le domaine de la prolifération, sous la présidence de l'ancien directeur de la CIA, John Deutch. Cette tentative du Congrès de tirer les conclusions institutionnelles des menaces existantes se solde, en juillet 1999, par un rapport qui confirme la possibilité de menaces sérieuses provenant de : - « l'utilisation terroriste d'armes de destruction massive contre les Etats-Unis ou leurs alliés ; - la détention ou les capacités de fabrication d'armes de destruction massive en Iran, en Irak, en Corée du Nord ou par d'autres pays hostiles aux Etats-Unis ; - la dispersion des armes, de la technologie, des matériels et de l'expertise portant sur les armes de destruction massive en provenance de la Russie ; - le transfert d'armes nucléaires, chimiques, biologiques, de technologies et de vecteurs par la Chine ; - les conséquences déstabilisantes des programmes d'armes de destruction massive au Proche-Orient, en Asie du Sud et en Asie Orientale ». S'agissant de l'organisation institutionnelle de la lutte contre la prolifération, le rapport propose la création d'un « Combating Proliferation Council » au sein du NSC, dirigé par un « National Director for Combating Proliferation ». _ La NIE de 1999 : un compromis sur la forme qui change peu de choses sur le fond de l'analyse La NIE de 1999 donne acte au Congrès des impasses méthodologiques constatées. Cette estimation reprend l'idée désormais admise par l'ensemble des acteurs du débat aux Etats-Unis que « sur les quinze prochaines années, les Etats-Unis devront faire face à des menaces balistiques en provenance de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, probablement de l'Iran, et potentiellement de l'Irak ». Elle identifie par ailleurs de nouveaux réseaux de prolifération : « certains pays qui avaient été traditionnellement les destinataires de technologies étrangères dans le domaine balistique les partagent maintenant entre eux et poursuivent des programmes de coopération en matière de missiles ». Elle examine enfin d'autres types de menaces, balistiques (lancement de missile depuis un avion commercial, une unité navale ou un sous-marin) ou non qui sont jugées « significatives bien que doté d'un prestige moindre en terme de dissuasion ou de diplomatie coercitive ». b) Une menace surévaluée : évaluation critique des thèses américaines La menace décrite par les Etats-Unis existe-t-elle ? Certes brutale, cette question n'en est pas moins pertinente : le tir nord-coréen du 31 août 1998 a entraîné un basculement des Etats-Unis vers l'alarmisme, dans un contexte de pression accrue en faveur de la NMD. Les Etats-Unis utilisent à l'appui de leur discours leur incontestable supériorité dans le domaine du renseignement d'origine spatiale, héritée des investissements réalisés dans le cadre du programme avorté de l'initiative de défense stratégique (SDI), supériorité qui ne va que croître avec la NMD. Cependant, même si la capacité d'information des pays alliés sur la réalité du phénomène balistique est moindre, du moins dans le renseignement spatial, les limites méthodologiques de l'évaluation américaine sont évidentes. Sur le constat tout d'abord, l'analyse américaine du degré de maturation des programmes cités est discutable. Les experts français mettent notamment en cause l'utilisation systématique de la technique de l'extrapolation par les Etats-Unis, dont témoignent, par exemple, la méthode et le style mêmes du rapport Rumsfeld. Que penser par exemple de la méthodologie adoptée par ce rapport qui prend en compte non seulement des données disponibles « mais également les manques souvent significatifs dans ces données » ? C'est notamment sur le cas de la Corée du Nord qu'existent les plus fortes divergences d'appréciation avec les Etats-Unis. Sur les plans techniques et financiers, la maîtrise de la capacité balistique suppose un savoir-faire technologique et des investissements considérables, tant en matière financière qu'humaine. Même pour les pays les plus développés dans le domaine des technologies de pointe, les techniques liées à la propulsion font appel à des compétences extrêmement complexes. Les Etats-Unis opposent à cet argument l'existence du No Dong II qui serait entré en service en 1998 (portée de 1 500 à 2 200 km) et l'essai du Taepo Dong I le 31 août 1998 (portée théorique de 2 000 km). Mais, qu'est-ce que le No Dong II, sinon un missile dérivé du Scud sur lequel les Coréens ont recouru à une technique bien connue pour augmenter la portée du missile - en jouant sur le volume de carburant - qui ne permet toutefois pas d'atteindre une portée intercontinentale ? Le résultat de l'essai du Taepo Dong I est en outre diversement interprété par les spécialistes : les Etats-Unis estiment qu'il ouvre la voie à un missile balistique intercontinental ; dans les faits, la Corée du Nord a procédé aux essais de un ou deux missiles, qui sont souvent des demi-échecs ou des demi-succès. Le saut conceptuel qu'effectuent les Etats-Unis entre risque constaté et menace avérée représente un deuxième sujet de divergence d'appréciation entre les experts français et leurs homologues américains. Car, de fait, le discours systématique sur la « threat assessment » élude tout aussi systématiquement la question du « pourquoi » et conduit donc à une analyse simplificatrice et réductrice. Or, il importe de revenir aux réalités stratégiques et à la diversité des logiques régionales. Pourquoi l'acquisition d'une capacité technique s'accompagnerait-elle systématiquement d'une volonté politique d'emploi, contre le territoire de la superpuissance que sont aujourd'hui les Etats-Unis qui plus est ? Par ailleurs, si volonté d'emploi il y a, quel intérêt l'ensemble des pays cités aurait à disposer d'une capacité balistique intercontinentale, alors qu'ils sont tous situés dans des zones où les conflits éventuels seront régionaux et requerront en conséquence une capacité d'au plus 1 500 km ? Là encore, le cas de la Corée du Nord met en lumière une contradiction du raisonnement des Etats-Unis qui prétextent de l'imperméabilité des dirigeants nord-coréens à la rationalité de la dissuasion mais poursuivent à l'égard de ce pays un programme de coopération dans le domaine nucléaire, au travers de la KEDO, qui postule en définitive la rationalité des responsables de ce pays. Or, il est permis de douter qu'un dirigeant coréen rationnel, alors que le pays est dans une situation catastrophique, se risquerait à attaquer un pays dont la riposte signifierait sa disparition. Les Etats-Unis omettent en outre la valeur d'affichage que peut revêtir, pour un pays, l'acquisition d'une capacité balistique, valeur qui n'est pas nécessairement couplée à une volonté d'emploi opérationnel. Par exemple, pourquoi exclure d'emblée que, vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN, l'Iran n'a pas obligatoirement besoin d'une capacité opérationnelle mais qu'il se situe avant tout dans une logique d'affichage ? Si, de fait, ce pays peut représenter une menace contre des forces occidentales déployées au Moyen-Orient, affirmer que l'acquisition d'une capacité balistique intercontinentale, à terme, par ce pays représente une menace pour le territoire des Etats-Unis relève de l'extrapolation. Dans l'absolu, des risques existent tandis qu'une menace est le fruit d'une équation stratégique, opérationnelle et politique complexe. A cela, les Etats-Unis opposent l'argument du chantage : ces pays voudraient se doter de missiles balistiques intercontinentaux pour être en mesure de faire du chantage aux Etats-Unis et c'est en cela qu'ils doivent être considérés comme des menaces pour la sécurité des Etats-Unis. Outre le fait qu'on peut douter que les Américains soient prêts à dépenser plusieurs dizaines de milliards de dollars pour lutter contre ce type de risque, l'argument du chantage se heurte à deux autres objections. Sur le fond d'une part, les objectifs potentiels d'un tel chantage apparaissent très flous ; par ailleurs, ces pays sont, autant que d'autres, réceptifs au concept de dissuasion qui, s'agissant de la protection du territoire national, ne présente pas d'ambiguïté. Sur la forme d'autre part, il existe bien d'autres moyens, beaucoup moins chers, de faire du chantage aux Etats-Unis, que l'acquisition politiquement et économiquement coûteuse d'une capacité balistique de longue portée. Enfin, autant que par ce qu'il dit, le discours américain sur la menace pèche par ses non-dits : jamais le programme balistique en pleine modernisation de la Chine n'a été mis en avant par les responsables américains, à l'exception notable de l'Amiral Dennis Blair, commandant en chef des forces américaines dans le Pacifique, qui avait évoqué dans une interview au Washington Times du 12 novembre 1999 « la menace grandissante posée par les missiles nord-coréens et chinois ». Depuis lors, il est vrai, les « fuites » émanant de milieux officiels et pointant la menace chinoise se multiplient. Or, les conséquences tirées de l'analyse de la menace en termes de défense antimissile laissent penser que l'arsenal chinois n'est pas absent des arrière-pensées stratégiques américaines. Pour toutes ces raisons, l'évaluation de la menace établie par les Etats-Unis ne doit pas être considérée comme un bilan objectif des capacités balistiques existantes, mais comme un outil politico-stratégique qui ne peut, par définition, être validé tel quel par les alliés des Etats-Unis. Plus particulièrement, deux enseignements peuvent être tirés de cette accélération de la prolifération balistique : - les capacités d'expertise des services de renseignement occidentaux n'ont pas permis de prendre la mesure de cette évolution qui surprend tous les experts du dossier. L'explication de cette faiblesse des capacités prévisionnelles des services de renseignement tient d'une part à la sous-estimation des niveaux technologiques atteints par ces pays, notamment de l'Inde qui a un programme spatial civil conséquent, et d'autre part, de l'insuffisante prise en compte de leurs capacités à élaborer des systèmes rustiques, c'est-à-dire petits, pas nécessairement précis mais efficaces. Dans une certaine mesure, la communauté du renseignement a été victime de la culture d'excellence technologique qui caractérise les armées et les organismes responsables de l'acquisition des armements des pays occidentaux ; - cette analyse rétrospective conduit à s'interroger sur le délai dans lequel ces pays parviendront à mettre au point des missiles dont la portée dépasse les 2 000 km. Si l'on extrapole à partir du cas indien, ce délai peut être estimé, pour ce pays et notamment au vu de son programme spatial civil, à 10 ans. Le même raisonnement n'est pas forcément applicable à la Corée du Nord ou à l'Iran qui n'ont pas de programme spatial civil. Il faut également prendre en compte les méthodes de prolifération : dans le cas de la Corée du Nord comme dans celui de la Chine, c'est à partir du Scud qu'ont été élaborés ces missiles. On remarquera enfin que ces différents pays ont une attitude plus ou moins évolutive : la Chine est peut-être plus prudente aujourd'hui, notamment du fait des pressions diplomatiques, alors que, pour la Corée du Nord, l'exportation de technologies est source de devises. On ne sait pas exactement de ce qu'il en est de l'accord avec l'Iran et le Pakistan. Au total donc, on peut estimer qu'un savoir-faire technologique, conjugué à une aide directe et à la recherche de performances peu sophistiquées mais suffisantes, explique l'évolution en matière de prolifération balistique. Au-delà de cette assertion, la question du rythme de la prolifération reste entière. Si les délais présentés dans le rapport Rumsfeld ont pu être contestés, en Europe notamment, ils ont au moins l'intérêt de souligner notre relative incapacité à extrapoler sur l'évolution des programmes balistiques dans un certain nombre de pays et de vous inciter à la prudence. S'agissant par exemple de l'acquisition de capacités balistiques par certains pays d'Afrique du Nord, une menace pour la France pourrait apparaître à court terme, dans l'hypothèse où la Corée du Nord transférerait des missiles du type Taepo Dong ou No Dong vers ces pays. En résumé, il est probable que d'ici dix à quinze ans, une capacité autonome apparaîtra dans un nombre limité de pays et qu'à plus court terme, existe seulement un risque de voir le scénario évoqué pour l'Afrique du Nord se réaliser. E. LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES DE LA PROLIFÉRATION : ARCS, RÉSEAUX ET ZONES DE CONFLITS Au-delà de cette approche statique, de ce constat brut sur « qui possède quoi » (c'est ce qu'on appelle la prolifération passive), la prolifération est également un phénomène dynamique, qui suppose des transferts, des exportations et des trafics généralement illicites (prolifération dite « active »). La géographie de ces formes de prolifération est différente : il n'existe pas de lien mécanique entre prolifération passive et prolifération active. Le meilleur exemple à cet égard est fourni par l'Inde qui, considérée comme proliférant nucléaire et balistique, n'a jamais mené de politique de prolifération active. Généralement toutefois, les deux aspects du phénomène sont liés, quoiqu'il faille à cet égard distinguer entre les différents types d'armements sur lesquels porte la prolifération : d'une part, la prolifération active concerne davantage les domaines nucléaire et balistique que les secteurs du chimique et du biologique pour lesquels le développement de programmes quasi exclusivement indigènes est généralement la règle ; d'autre part, au sein des domaines nucléaire et balistique, la plupart des proliférants actifs ont été plus restrictifs dans leurs exportations et trafics nucléaires. Si la distinction entre prolifération active et passive n'est pas nouvelle, l'apparition de réseaux et même d'arcs de prolifération constitue en revanche le trait marquant de la période récente. Le fait majeur de la décennie 1990 réside en effet dans la constitution de chaînes entre les pays proliférants : réseaux simples, qui ne concernent qu'un type d'arme, ou complexes, dans lesquels la coopération est multiforme (nucléaire et balistique par exemple). Certains de ces réseaux se sont même développés grâce à ce qu'on pourrait appeler une prolifération secondaire - le proliférant passif devient lui-même actif, tout en continuant de recevoir une aide extérieure -, à telle enseigne que certains experts rencontrés par la prolifération évoquent, non sans humour, la constitution d'« amicales de proliférants ». Connexion d'intérêts politico-stratégiques communs, la prolifération et ses réseaux laissent également apparaître une constellation d'impasses d'autant plus inquiétantes qu'elles sont liées entre elles. La superposition entre la carte des zones de conflits et de tensions et celle de la prolifération et de ses réseaux n'incite guère à l'optimisme : la géographie des proliférations à l'orée du XXIème siècle est même préoccupante. 1. Réseaux et arcs de prolifération Trois pays sont généralement considérés comme des sources majeures de la prolifération au sens où des transferts et exportations ont lieu à partir de leur territoire, à l'initiative, soit des autorités gouvernementales elles-mêmes, soit d'entités publiques plus ou moins autonomes, soit d'entités ou d'individus privés. Il s'agit de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord. A partir de ces sources, se sont constitués deux arcs de prolifération : - l'un, partant de la Chine et de la Corée du Nord pour aller notamment vers le Pakistan, l'Iran et certains pays du Moyen-Orient qui peut être qualifié d'arc anti-occidental ; - le second lie certains pays islamiques et est également nourri par des sentiments hostiles au monde occidental. Faut-il enfin parler d'un arc terroriste ? Si ce dernier relève encore largement de la spéculation dans la mesure où aucun fait terroriste majeur ne vient en confirmer l'existence, les formidables ressources que recèle la Russie en termes de prolifération font craindre qu'elle ne soit, malgré elle, la plaque tournante de trafics multiples. Or, là encore, l'Occident représente la cible principale. _ Vers un tarissement de la source chinoise ? La Chine a longtemps été un fournisseur notoire et majeur de technologies, matériaux, savoir-faire et assistance dans les domaines nucléaire et balistique. Aux yeux des Etats-Unis, la Chine peut même être considérée comme le principal fournisseur d'armes de destruction massive et de technologie de missile dans le monde. Ainsi, dès la fin des années 1970, elle a commencé à exporter des armements et des technologies militaires à une échelle significative, y compris, à partir des années 80, de technologies nucléaires et balistiques sensibles. D'après les différents entretiens conduits par la mission, il semblerait que la Chine ait évolué de manière significative dans le domaine nucléaire depuis la deuxième moitié des années 1990 ; de même, notamment sous la pression américaine, elle a revu à la baisse ses coopérations balistiques. - Des coopérations nucléaires multiples Jusqu'à son adhésion au TNP en 1992, la Chine a joué un rôle majeur dans la prolifération nucléaire en coopérant, en dehors des contrôles de l'AIEA, avec des pays soupçonnés de développer un programme nucléaire militaire clandestin. Encore aujourd'hui, la Chine refuse l'adhésion au groupe des fournisseurs nucléaires, qui interdit l'exportation d'équipements et de technologies nucléaires vers des pays qui n'acceptent pas de mettre l'ensemble de leurs installations et matériaux nucléaires sous le contrôle complet de l'AIEA. Ainsi, la Chine a massivement soutenu le programme nucléaire civil de l'Iran, dont elle a été le premier pourvoyeur. Or, certaines des technologies qu'elle a fournies à ce pays peuvent servir à des fins d'instruction au profit des programmes d'armement nucléaire de l'Iran. En outre, dès 1983, la Chine avait entrepris la construction d'un réacteur nucléaire de recherche au bénéfice de l'Algérie. Mais c'est le Pakistan qui a été le principal bénéficiaire de l'aide chinoise. Une des principales raisons pour lesquelles l'adhésion de la Chine au TNP était attendue, outre l'intérêt d'avoir les cinq puissances dotées d'armes parties au traité, était d'ailleurs son assistance connue depuis la fin des années 1970 au programme nucléaire pakistanais. Alors que la plupart des coopérations et exportations nucléaires chinoises étaient de nature civile, l'assistance nucléaire de la Chine vers le Pakistan a été avant tout militaire. Cette coopération se caractérise par son caractère multiforme. La collaboration apparaît nettement au tout début des années 1980, mais les intentions militaires pakistanaises sont claires depuis la fin des années 1970. A l'époque, la Chine était inquiète à la fois de la présence soviétique en Afghanistan, de la présence américaine au Pakistan et de la politique nucléaire indienne. Très bonnes raisons d'aider le Pakistan. Les Etats-Unis détectent cette collaboration très tôt. Ils sont suffisamment préoccupés par le soutien de la Chine au Pakistan pour suspendre en 1982 les négociations entamées avec Pékin en vue d'une coopération nucléaire46. Dès 1983, des rumeurs circulent en effet selon lesquels la Chine aurait transféré une arme nucléaire complète au Pakistan, ainsi qu'une quantité d'uranium enrichi militaire suffisante pour deux armes. Ce plan d'arme aurait été « prélevé » par les services américains dans les bagages du Docteur A. Q. Khan, responsable du programme nucléaire militaire pakistanais. En 1986, les deux pays concluent un large accord de coopération nucléaire : des scientifiques chinois commencent alors à assister le Pakistan pour l'enrichissement de l'uranium tandis qu'est transférée vers ce pays une quantité de tritium suffisante pour dix armes nucléaires. On dit en effet qu'ayant des difficultés pour construire les machines nécessaires à l'enrichissement de l'uranium sur le site de Kahuta, à partir des plans que le Dr Khan a été accusé d'avoir volé à Urenco, aux Pays Bas, le Pakistan a sollicité l'assistance chinoise contre la fourniture à Pékin des plans d'Urenco. En outre, juste avant d'adhérer au TNP en 1992, la Chine a conclu un contrat de 500 millions de dollars pour la construction d'un réacteur nucléaire de 300 MW à Chasma. Le Pakistan a accepté de placer Chasma sous contrôle de l'AIEA mais a refusé l'adoption des garanties complètes de l'AIEA pour l'ensemble de son programme nucléaire. Depuis lors, la fourniture de différents produits et services nucléaires, allant des techniques d'enrichissement de l'uranium à la fourniture de réacteurs de recherche ou d'électricité s'est poursuivie. Une autre rumeur fait par ailleurs état de la participation d'un haut responsable pakistanais (M. Yakub Khan) à un essai nucléaire chinois à Lop Nor en 1983. On notera cependant que les échanges se font sans doute dans les deux sens, les Pakistanais étant au moins aussi compétents que les Chinois en matière d'enrichissement par exemple. Dans les années récentes, deux dossiers relatifs à la coopération nucléaire sino-pakistanaise ont plus particulièrement été mis en avant par les Etats-Unis, créant des frictions avec la Chine. Le premier concerne la fourniture d'aimants circulaires (ring magnets) entre 1994 et la mi-1995, qui auraient été destinés au programme d'enrichissement de l'uranium à Kahuta. Ce transfert a été révélé au grand jour le 5 février 1996, par un article du Washington Times faisant état de rapports des services de renseignement américains indiquant que la Chine avait transféré 5 000 de ces dispositifs à A. Q. Khan Research Laboratory, à Kahuta, infrastructure non contrôlée par l'AIEA. Il se serait agi d'aimants exclusivement destinés à être utilisés dans des centrifugeuses, elles-mêmes uniquement utilisées pour l'enrichissement de l'uranium. Le secrétaire d'Etat adjoint américain pour la non-prolifération, Robert Einhorn, déclara devant le Sénat que l'administration n'était pas en mesure de déterminer si les autorités chinoises avaient elles-mêmes approuvé la vente. La Chine et le Pakistan ont officiellement nié l'existence de ce transfert. Cependant, selon le Centre d'études sur la non-prolifération de Monterey, dans leurs discussions privées avec les Etats-Unis, les responsables chinois auraient admis que la vente avait eu lieu, mais ont estimé que la Chine n'avait pas à en être sanctionnée : d'une part, parce que l'entreprise responsable du transfert, la China Nuclear Energy Industry Corporation, bien que propriété du gouvernement chinois47, n'avait pas informé les autorités gouvernementales ; d'autre part, parce que les aimants n'étaient pas magnétisés et ne faisaient donc pas partie des produits figurant sur la liste du groupe des fournisseurs nucléaires. Le 10 mai 1996, les Etats-Unis annonçaient qu'ils renonçaient à sanctionner la Chine, sous réserve d'un engagement renouvelé de sa part en faveur de la non-prolifération. Le deuxième sujet de préoccupation concerne l'assistance fournie par la Chine dans l'édification du complexe nucléaire de Kushab. Les services de renseignement américains estiment que le réacteur à eau lourde de 40 mégawatts fourni par la Chine, qui n'est pas placé sous le contrôle de l'AIEA, ainsi que l'eau lourde et la chaudière également fournies par la Chine, permettent au Pakistan de développer une deuxième filière de production de matières fissiles, à base de plutonium, alors que le Pakistan a jusqu'alors privilégié la voie de l'enrichissement de l'uranium. - Une source de prolifération balistique très active Selon le rapport Cox48 paru en 1999, la Chine « a volé des renseignements sur le concept des armes thermonucléaires américaines les plus avancées, éléments qui pourraient être mis à profit par la Chine pour sa prochaine génération d'ICBM »49. Il note par ailleurs que la Chine « a volé de la technologie de guidage de missile d'application directe pour les missiles balistiques de l'armée de libération du peuple. La Chine a transféré de la technologie de missiles balistiques à l'Iran, au Pakistan, à la Corée du Nord, à l'Arabie Saoudite, à la Libye et à d'autres pays ». Le tableau de la situation dressé devant le Congrès par le directeur du centre de non-prolifération de la CIA, le 29 avril 1999, se veut plus nuancé et évoque un bilan en demi-teinte. C'est encore avec le Pakistan que la Chine a développé une coopération balistique de grande envergure. Le transfert de 34 missiles M-11 (missile chinois mobile sol-sol à combustible solide CSS-X-7 de 300 km de portée et de charge utile de 500 kg) vers le Pakistan, en novembre 1992, a alimenté un débat intense entre la Chine et les Etats-Unis tout au long de la décennie 1990. Les rumeurs concernant ce transfert sont apparues dans la presse américaine en avril 1991, même si le contrat entre la Chine et le Pakistan, signé, pense-t-on, en 1988, était connu dès l'année précédente des services de renseignement américains. La présence de ce missile au Pakistan a d'emblée été considérée comme problématique dans la mesure où il peut être armé d'une tête nucléaire et où, depuis 1987, le Pakistan avait une capacité nucléaire, connue des Etats-Unis. Ce transfert a valu à la Chine de se voir imposer des sanctions par les Etats-Unis, en juin 1991. Plus particulièrement, ces sanctions50 ont été imposées à deux entreprises d'État, la China Great Wall Industry Corporation, entreprise de lancement de satellites, et la China Precision Machinery Import-Export Corporation, qui produit des missiles. En novembre 1991, pendant la visite du secrétaire d'État James Baker, la Chine s'engagea à respecter les principes du MTCR, ce qui conduisit à une levée des sanctions en mars 1992. Un article du Los Angeles Times du 4 décembre 1992 établissait néanmoins que, selon des sources officieuses des services de renseignement américains, la Chine avait livré dans les deux semaines précédentes environ deux douzaines de composants clés de M-11 au Pakistan, à Karachi. L'ancien chef d'Etat-Major, le Général Mirza Aslam Beg, avait alors admis l'achat de M-11 mais déclaré qu'ils n'avaient pas la capacité nucléaire. Arguant de l'existence de preuves de plus en plus nombreuses, l'administration Clinton imposa à nouveau des sanctions au ministère de la défense pakistanais et à onze entreprises de défense et d'aéronautique chinoises pour violation de la catégorie 2 du MTCR (composants de missiles et équipements à double usage). En octobre 1994, ces sanctions furent levées suite à un nouvel engagement de la Chine de ne pas exporter des missiles sol-sol portant une charge d'au moins 500 kilogrammes à 300 kilomètres au moins. Un flux constant d'articles n'en cessa pas moins de faire état d'une assistance continue de la Chine au Pakistan en matière balistique. En juillet 1995, le Washington Post revenait sur l'affaire des missiles M-11 en indiquant la présence au Pakistan, à partir de novembre 1992, de plus de 30 M-11, entreposés sur la base aérienne de Sardhoga, près de Lahore, où avaient été construits des abris pour missiles et lanceurs, ainsi que des installation de maintenance et des logements pour les équipes de lancement. Ce même journal indiquait en 1996 que les services américains de renseignement pensaient avec une forte certitude que le Pakistan avait probablement terminé de développer des têtes nucléaires pour ses M-11. En août 1996, il publia une NIE classifiée concluant que le Pakistan était capable de lancer ce type de missile sous 48 heures et que le Pakistan construisait une usine de production de M-11 à Rawalpindi - dont des images satellites ont été récemment diffusées sur Internet - ou de ses composants principaux d'après des plans et à l'aide d'équipements fournis par la Chine. Bien que les fournitures par la Chine de systèmes de missiles complets aient cessé, les transferts de sous-composants et de technologies de production se seraient néanmoins poursuivis. La Chine aurait ainsi exporté en 1996 au Pakistan des équipements relatifs au missile courte portée M-11. Avec l'inflexion de la politique chinoise depuis les essais nucléaires de l'Inde, il est possible que la Chine se rapproche en 1999 des normes du régime de contrôle des technologies de missiles (MTCR). Certains experts estiment en outre que le Shaheen pakistanais, testé en avril 1999, entretient une forte ressemblance avec le DF-15 chinois (M-9 dans sa version à l'exportation). Les Indiens font notamment remarquer que le Pakistan est le seul pays dont les missiles sont testés au-dessus de zones concentrant de fortes densités de population, ce qui, à leurs yeux, suggère un apport extérieur non négligeable. L'exportation de missiles M-9 n'a cependant jamais été confirmée par les responsables chinois ni par les pays dans lesquels ils ont été exportés. Par ailleurs, la Chine est le premier pays à avoir vendu des missiles de portée intermédiaire (IRBM) au Moyen-Orient, avec la vente, en 1989, de 30 CSS-2 (missile d'une portée d'environ 2 500 km pour une charge utile de 2 000 kg) vers l'Arabie Saoudite. Elle est également soupçonnée d'avoir exporté des missiles balistiques à moyenne portée de type M-9 (CSS-X-6 ; portée 600 km, charge utile 500 kg) vers la Syrie début 90. Enfin, jusqu'en 1996, des sociétés chinoises du domaine du guidage des missiles et de la propulsion auraient aidé l'Iran à développer son industrie missilière. - Vers une évolution de la politique de prolifération chinoise ? Sans doute, la Chine a-t-elle réaffirmé en 1994 son engagement pris en 1992 de respecter les principes du MTCR et déclaré en 1996 qu'elle « ne fournirait pas d'assistance à des installations nucléaires non soumises aux garanties de l'AIEA ». Elle a toujours martelé que sa coopération était destinée à des fins pacifiques. L'ambassadeur Sha Zukang répétait encore en septembre 1999 que « la question de la prolifération nucléaire et balistique de la Chine vers le Pakistan n'existe pas ». Néanmoins, en avril 1996, William Cohen déclarait que « la Chine demeure le plus important fournisseur de technologies de missiles au Pakistan ». En décembre 1998, le Washington Times faisait état d'une poursuite de l'assistance intellectuelle de la Chine avec le Pakistan, à l'Iran et à la Corée du Nord. La connexion pakistano-nord coréenne est intéressante, parce qu'elle révèle très probablement l'usage par la Chine d'un canal nord coréen pour certains de ses transferts. En mai 1993, des officiels iraniens et pakistanais étaient présents lors du lancement du missile No-Dong. En décembre de la même année, Benazir Bhutto lors d'une visite en Chine, aurait passé un accord avec Pékin selon lequel la Corée du Nord serait désormais utilisée pour des transferts dans le domaine balistique. Un des meilleurs experts du programme nord coréen, Joseph Bermudez, écrit : « La Corée du Nord aurait servi de canal pour une partie de l'assistance chinoise et aurait fourni le hardware et les composants des missiles No-Dong et Taepo-Dong. La Chine aurait de son côté accepté de fournir des composants pour d'autres domaines dans lesquels la DPRK piétinait, notamment le guidage ». C'est un point très important pour les affaires liées au missile Ghauri en 1998. Le 25 juin 1999, un bateau nord coréen (le Ku Wol San) était saisi par les autorités indiennes dans le port de Kandha, où il débarquait du sucre. Le prochain arrêt était Karachi. Sur le bateau se trouvaient de nombreux équipements utilisés dans la fabrication de missiles (presses, théodolites, machines outils...) ainsi que des plans de production. Dans un premier temps, ce transfert a seulement permis de confirmer les relations pakistano-nord-coréennes. Mais les douanes indiennes ont déclaré que les équipements étaient d'origine chinoise (« chinese markings »). Ceci confirmerait le canal nord-coréen et son utilisation par Pékin. La Corée du Sud, dans un article du Korea Times, s'est inquiétée des termes de l'échange entre Islamabad et Pyongyang, en émettant la crainte que le Pakistan ne transmette des informations ou technologies nucléaires. En 1999, les Etats-Unis continuent de désigner la Chine comme un fournisseur de biens liés aux armes de destruction massive et déclarent que des organisations chinoises « ont continué de fournir leur assistance au programme balistique pakistanais au cours de la première moitié de l'année 1998, et qu'« une forme d'assistance se poursuit ». En août 1999, le Washington Times révélait que la Chine avait vendu à l'Iran pour 11 millions de dollars de missiles anti-navires en contravention de ses engagements de l'année précédente. La plupart des experts s'accordent néanmoins à reconnaître que, globalement, l'attitude de la Chine à l'égard des armes de destruction massive a évolué. Jusqu'en 1998, la Chine ne respectait que d'une manière très sélective - souvent liée d'ailleurs au poids plus ou moins important des pressions américaines - les normes et régimes de non-prolifération et ne contrôlait pratiquement pas les transferts d'équipements liés aux armes de destruction massive. Il semblerait que les essais nucléaires de l'Inde en 1998 aient donné une impulsion à la politique chinoise de non-prolifération. Pour citer à nouveau M. Sha Zukang, auditionné par la mission, la Chine a, semble-t-il adopté « une approche positive, flexible et pragmatique et procédé aux réajustements appropriés de certains aspects de sa politique ». Dans le domaine nucléaire notamment, des signes avant-coureurs de cette évolution d'attitude étaient déjà perceptibles. Sans doute, les arrière-pensées commerciales ne sont-elles pas absentes de ce revirement de stratégie, dans la mesure où le maintien d'un niveau de croissance minimal de 7 % est vitale pour la survie du régime : la Chine a, semble-t-il, compris qu'elle avait plus à gagner qu'à perdre en évitant des transferts proliférants. La déclaration du gouvernement chinois du 21 novembre 2000 et l'accord sino-américain du 23 novembre 2000 vont en effet dans ce sens. La Chine s'engage dans ce texte à « améliorer et renforcer encore son système de contrôle à l'exportation et à publier la liste complète des biens liés aux missiles soumis à des contrôles à l'exportation, y compris des biens à double usage ». Rien ne permet cependant d'exclure qu'une évolution du cadre stratégique régional (par exemple l'introduction d'une défense antimissile à Taiwan) ne conduise la Chine à revenir sur sa politique de responsabilisation. _ La Corée du Nord, source majeure de prolifération balistique La Corée du Nord est aujourd'hui le plus gros proliférateur dans le domaine des missiles balistiques. Ses motivations sont essentiellement financières : la Corée du Nord aurait engrangé depuis 1987 l'équivalent de plus d'un milliard de dollars grâce à ce marché. De fait, la Corée du Nord vend tout, à tout le monde, même si, à la différence de la Chine, elle n'a pas exporté de technologies nucléaires. Cette prise de conscience du pôle majeur que représente la Corée du Nord dans le domaine balistique est récente. C'est notamment la multiplication des essais constatée depuis 1998 de missiles de moyenne portée issus du No Dong dans le sous-continent indien et au Moyen-Orient (Ghauri au Pakistan, Shihab III en Iran, Taepo Dong I en Corée du Nord) qui a révélé au grand jour l'implication plus importante que prévue de la Corée du Nord dans la prolifération balistique, avec des résultats substantiels en termes de développement industriel. La Corée du Nord vend donc non seulement des missiles complets mais encore la technologie nécessaire à leur fabrication. Plus de 400 missiles de type Scud auraient été exportés. Les pays bénéficiaires de ces transferts sont l'Iran, la Syrie, l'Egypte et la Libye. Sa clientèle pourrait d'autant plus se diversifier qu'elle devrait proposer, à court terme, une gamme de produits variés, en termes de portée et de charge utile. En effet, on rappellera qu'en sus de systèmes qui sont d'ores et déjà disponibles, comme les Scud B et C, la Corée du Nord a au moins trois missiles en cours de développement, le No Dong, le Taepo Dong I et le Taepo Dong II. A court terme, les principales inquiétudes proviennent de l'éventuelle mise sur le marché du No Dong. Estimé pouvoir acheminer une charge utile de 1 000 kg à 1 000 km, ce missile n'aurait été testé qu'une seule fois en vol nominal, partiellement réussi, en 1993. Par sa portée comprise entre 1 000 et 1 300 km selon sa charge utile, ce missile et ses clones pourraient induire des bouleversements stratégiques intensifs. Or, la Corée du Nord serait engagée dans des transferts de missiles complets de ce type avec le Pakistan (missile Ghauri) et l'Iran (missile Shihab). Dotée d'un tel missile, la Corée du Nord peut menacer une grande partie du Japon ; le Pakistan est en mesure de viser New Delhi ; l'Iran peut atteindre Israël, la quasi-totalité du territoire turc (dont Ankara) et l'Arabie Saoudite dans son ensemble. L'évolution de la menace est plus rapide que prévue, avec un horizon de mise en service de ce type de missile en 2002-2003 plutôt qu'en 2005, alors que cette date était considérée comme l'hypothèse la plus pessimiste. A plus long terme, il pourrait être également à craindre que les Nord-Coréens ne transfèrent dans quelques années des missiles à longue portée à deux voire trois étages51 Taepo Dong, dont ils ont testé un premier exemplaire en août 1998 au-dessus du Japon. D'une portée estimée à plus de 2 000 km, ce missile représenterait une menace certaine pour le territoire européen aux mains de pays proliférants du Moyen-Orient. L'attitude nord-coréenne est d'autant plus préoccupante que l'exportation d'armes et de technologies sensibles, et notamment de missiles, est pour elle une nécessité vitale. Il faut donc se réjouir du mouvement d'ouverture actuelle de ce pays qui pourrait - du moins peut-on l'espérer - la conduire à se comporter en acteur responsable en matière de prolifération. La reconnaissance par certains pays de l'Union européenne de ce pays semble tout de même un peu prématurée. La dissémination d'armes de destruction massive dans des pays musulmans, dont certains revendiquent un régime islamique, conduit à s'interroger sur l'apparition d'un arc islamique, version moderne de la notion, particulièrement en vogue au cours de la décennie précédente, de « bombe islamique ». Le fait que le Pakistan, l'Iran, la Syrie, l'Egypte, l'Irak ou la Libye aient développé ou développent plus ou moins activement des programmes d'armes de destruction massive justifie cette interrogation. · Les interlocuteurs que la mission a rencontrés au Pakistan ou en Egypte ont vigoureusement rejeté la notion même de « bombe islamique », arguant du fait que cette expression mêlait deux concepts, l'un religieux, l'autre politico-stratégique. M. Abdul Sattar, Ministre des affaires étrangères du Pakistan, a rappelé à cet égard que, dans les années 1970, Bhutto soulignait que les bombes atomiques occidentales n'étaient pas des bombes chrétiennes, ni la bombe israélienne une bombe juive. Ainsi, les responsables pakistanais rencontrés par la mission ont fait valoir que : - jamais le Pakistan n'avait eu recours à la notion de bombe islamique, qui sous-entend l'exportation vers des pays musulmans ou islamiques de technologies nucléaires ; - bien que le Pakistan maîtrise cette technologie depuis des années, qu'il entretienne de bonnes relations avec la Libye, l'Iran - qui auraient certes aimé profiter de ses connaissances - ou, hors du monde musulman, la Corée du Nord et qu'il ait besoin d'argent, on ne trouverait pas un exemple de ce type d'exportations ; - les relations, aussi bonnes soient-elles, du Pakistan avec la Libye ou l'Algérie sont compliquées par le problème du terrorisme, dont le Pakistan est d'ailleurs victime - après en avoir été la cause ! - avec la décomposition de l'Etat afghan. En bref, pour toutes ces raisons, « la capacité nucléaire du Pakistan n'est pas à vendre », pour reprendre l'expression de M. Abdul Sattar. Il n'en reste pas moins qu'on a pu entendre, aux lendemains des essais nucléaires réalisés par le Pakistan en mai 1998, certains dirigeants saluer la première bombe musulmane. Par ailleurs, des monarchies pétrolières auraient des intérêts financiers importants dans le programme balistique et nucléaire pakistanais et, en mai 1999, il est avéré que le ministre de la Défense saoudien, le Prince Sultan ben Abdul Aziz al-Saud, a visité l'usine d'enrichissement d'uranium de Kahuta ; des rumeurs circulent sur sa visite des sites de production du Ghauri 52. Si donc, la notion de bombe islamique est, à ce qu'ils disent, infondée dans le cas du Pakistan, qui a été jusqu'alors un proliférateur passif, des raisons financières pourraient modifier la donne et le conduire à devenir non seulement actif, mais à rechercher des coopérations accrues. En effet, dans un contexte qu'il estime dangereux pour sa sécurité, le Pakistan est déterminé à moderniser son arsenal ; or, il n'est pas certain qu'il puisse compter pour ce faire sur ses seules capacités, comme en témoigne par exemple la saisie récente en France de documents sensibles, concernant des moteurs pour drones, à destination du Pakistan. Par ailleurs, la création de liens entre groupes terroristes, à l'insu des autorités gouvernementales ne peut être exclue à terme, compte tenu de la situation intérieure, caractérisée par la décapitation des partis politiques et les risques de talibanisation du pays. · Faut-il inclure l'Iran dans cet arc islamique ? Pour répondre à cette question, il faut examiner d'une part les modalités de développement de ces programmes, notamment dans les domaines nucléaire et balistique, d'autre part leurs motivations. Qui sont les fournisseurs de l'Iran ? La coopération nucléaire entre la Russie et l'Iran a été traitée précédemment. Dans le domaine balistique, trois pays sont généralement désignés comme les principaux fournisseurs de l'Iran : la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Ainsi, pour le développement du Shihab III, l'Iran aurait bénéficié de l'aide de la Corée du Nord à partir de 1993-1994. La Russie, à laquelle l'Iran a fait appel en raison d'une coopération d'abord médiocre avec la Corée du Nord, a apporté une aide sur les matériaux et les équipements nécessaires à la production du missile (moteur, métaux spéciaux, systèmes de guidage, système de navigation, éléments nécessaires aux essais, entraînements). Cette coopération est le fait d'individus, rattachés ou non à des entreprises, et d'entreprises, fantoches ou réelles. On notera enfin que l'Iran a également noué des liens avec la Chine sur les systèmes de guidage de missiles, afin de pallier l'insuffisante précision des systèmes nord-coréens. Au total donc, le recensement des fournisseurs de l'Iran situe ce pays à la frontière entre l'arc anti-occidental et l'arc islamique. Qu'en est-il des motivations de l'Iran ? Proliférant passif, l'Iran a développé des programmes d'armes de destruction massives essentiellement à des fins de suprématie régionale. Les déclarations récentes du Général Rahim Safavi, commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution le confirment : annonçant la création de cinq unités de lancement de missiles balistiques, ce dernier a assuré que « grâce à ses missiles balistiques, la capacité de dissuasion de l'Iran avait sensiblement augmenté et que l'Iran était désormais parmi les principales puissances militaires de la région ». De fait, les experts s'admettent généralement à reconnaître que, des deux tendances qui s'affrontent au sein de l'Etat iranien - l'universalisme islamique et le nationalisme perse -, la première a, dans le courant des années 1990, largement cédé le pas à la seconde. Dans ces conditions, et en dépit de déclarations en ce sens de responsables iraniens, l'ennemi n'est pas tant ou seulement Israël mais bien plutôt l'Irak ou la puissante Arabie Saoudite et, en filigrane, les intérêts américains dans la région. Sans doute les inquiétudes d'Israël, renouvelées après l'essai du Shihab III le 15 juillet dernier, ne sont pas sans fondement dans la mesure où les tensions internes à l'Etat iranien pourraient faire resurgir au premier plan l'universalisme islamique. Au total par conséquent, dans leurs modalités et dans leurs motivations, les programmes d'armes de destruction massives de l'Iran sont guidés par un subtil mélange de considérations idéologiques et d'équilibre régional. · Qu'en est-il des réseaux, aussi complexes qu'efficaces, de l'Irak ? Au début de l'année 1996, l'UNSCOM en est arrivée à la conclusion que l'Irak avait repris ses efforts d'acquisition de matériels à l'étranger pour son programme balistique. La trace de contrats, signés entre les négociations de 1993 et le départ de l'UNSCOM a en effet été retrouvée, prouvant que l'Irak cherchait à se procurer des technologies de missiles sophistiquées auprès d'entités ukrainiennes, russes ou roumaines. Ces contrats n'ont pas abouti en raison des difficultés financières de l'Irak. L'absence de toute inspection depuis la fin de l'année 1998 ne peut donc qu'inciter au pessimisme, plus encore au regard des rumeurs sur les exportations illégales de pétrole à partir d'Irak, qui lui permettraient de trouver une source de devises étrangères importante. Le cas de la Russie est sans nul doute le plus problématique : comment gérer le déclin d'une puissance nucléaire qui a produit au cours des cinquante dernières années entre 125 et 175 tonnes de plutonium militaire53, d'un Etat qui possède 40 000 tonnes d'armes chimiques, qui a développé le programme biologique de loin le plus sophistiqué et qui démantèle des milliers de missiles balistiques ? A n'en pas douter, aux yeux de tout candidat à la prolifération, la Russie, et les Etats issus de l'URSS, représentent un formidable marché. Ce constat conduit aussi à poser la question de l'éventuelle existence d'un arc terroriste, dont la Russie serait la plaque tournante, volontairement ou non. S'agissant tout d'abord, du domaine nucléaire, la Russie dispose de l'infrastructure voulue pour produire pratiquement tout ce qui a trait aux armes nucléaires. En dépit des assurances prodiguées par de hauts responsables et de nombreux membres du gouvernement russes, on peut craindre que le marché noir, les aventuriers et les éléments du crime organisé en Russie ne parviennent à acquérir et revendre des composants ou technologies relatives aux armes nucléaires. A l'heure actuelle toutefois, les vols n'ont concerné que de petites quantités de matériaux fissiles. On citera par exemple la saisie de dix grammes d'uranium enrichi en Bulgarie, à la frontière turque, qui, d'après le trafiquant, auraient été achetés en Moldavie. Un cas a été signalé en Géorgie : environ 2 kilogrammes de matières fissiles (uranium enrichi à 90 %) avaient été recensés à l'Institut de physique et de technologie de Vekua, à Sukhumi. En 1993, la prise de Tbilissi par les rebelles abkhazes a contraint les scientifiques de l'Institut de fuir. Depuis 1993, aucun scientifique ou responsable géorgien n'a été autorisé à visiter le site. A la fin de l'année 1997, des officiels russes ont néanmoins reçu l'autorisation de se rendre sur ce site et ont constaté que les matières fissiles avaient disparu. Nul ne sait ce qu'il en est advenu. D'autres cas ont montré l'importance du rôle des Etats nouvellement indépendants comme point de passage vers d'autres pays. Ainsi, en mars 1998, les responsables azéris ont saisi un chargement d'acier spécial à destination de l'Iran, confirmant le rôle de pays de transit des Etats issus de l'ex-URSS. Un autre cas a été révélé en décembre 1998 par le service de sécurité fédéral russe : il a annoncé avoir déjoué la tentative d'un groupe d'employés de l'une des installations nucléaires de Tchéliablinsk de détourner 18,5 kg de « matériaux radioactifs qui auraient pu servir à la production d'armes nucléaires ». Plus généralement, les tentatives d'exportation ou d'importation d'uranium faiblement enrichi ou d'isotopes non directement utilisables à des fins militaires sont en augmentation : en 1998, les douanes russes ont détecté environ cent tentatives, dont 40 d'exportation, alors que cinq cas avaient été détectés en 1995. Les premiers résultats pour 1999 montrent une augmentation de ces chiffres qui révèlent certes les résultats positifs des programmes russo-américains de formation des douaniers, mais aussi l'importance du phénomène. Par ailleurs, l'émigration de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens soviétiques familiers des technologies relatives aux armes de destruction massive est également un risque à prendre en compte. Pour ce qui est de la fuite des cerveaux, les évaluations sont difficiles. L'office budgétaire du Congrès américain (CBO) estime à environ 20 000 le marché potentiel des scientifiques et ouvriers du secteur nucléaire susceptibles de représenter un risque en termes de prolifération, évaluation qui rejoint celle qu'avait donnée en 1996 Glenn Schweitzer, le directeur de l'International Science and Technology Center (ISTC) de Moscou. A noter que ce chiffre n'inclut pas les personnes chargées de garder les sites, et qui ont donc accès aux installations. S'il est certain que des scientifiques russes (plus de cinquante) travaillent sur les programmes balistiques irakiens et iraniens, seules des rumeurs existent quant à l'implication de scientifiques russes dans des programmes nucléaires. La tendance est très certainement à un tarissement des flux de départ mais ceci ne renseigne pas sur la qualité des personnes qui partent (2 000 personnes étaient au c_ur du complexe nucléaire soviétique). Reste le cas des personnes qui viennent en stage à Moscou, dont la CIA a beaucoup de difficultés à estimer le nombre et les activités, plus encore lorsqu'ils viennent de territoires de l'ex-URSS. Le facteur régional vient également compliquer la tâche. Car, qui des autorités centrales ou des gouverneurs locaux, assure le contrôle effectif des sites ? Dans des régions particulièrement pauvres, comme le Kamchatka, cette question prend toute son acuité dans la mesure où les installations nucléaires deviennent un atout économique. C'est ainsi que récemment, en janvier 2000, des marins ont tenté de subtiliser du combustible nucléaire du réacteur d'un sous-marin : emprisonnés, ils ont déclaré avoir agi sur les ordres du commandant. A Sakhaline, en 1999, des suspects ont reconnu le meurtre, en 1993, du directeur adjoint des chantiers Zvezda (installation de démantèlement de SSBM) et révélé que l'objectif principal de la mafia qui les payait était de le menacer pour qu'il l'aide à prendre le contrôle de l'entreprise. Dès lors, on est en droit de s'interroger : qu'en est-il de ceux qui ont accepté de collaborer pour sauver leur vie ? Cette question est particulièrement aiguë dans l'Extrême-Orient russe, où la présence d'espions chinois et nord-coréens est de notoriété publique. En 1999, un ancien employé de ces mêmes chantiers a été pris en train d'essayer de revendre à des agents nord-coréens des matériaux radioactifs que l'on suppose avoir été subtilisés dans cette entreprise. Déjà, au début de l'année 1996, par exemple, 17 travailleurs nord-coréens ont été pris en essayant d'infiltrer une usine de sous-marins nucléaires à Primorskiy Kray. Et les arrestations sont également nombreuses de Nord-Coréens qui essayaient de se procurer les programmes de démantèlement des sous-marins nucléaires ou les schémas de navigation de bâtiments nucléaires en service. Cette question du contrôle local n'est assurément pas close : la décision du Président Poutine de nommer des « super-gouverneurs » en témoigne. En matière balistique, il semblerait que les fuites vers d'autres pays soient le fait d'individus ou de sociétés privées. L'un des cas les plus intéressants concerne la saisie de composants de missiles à destination de l'Irak, en 1995. Il pose la question de l'attitude des autorités russes et témoigne de la complexité des réseaux de prolifération, ce alors que l'Irak est sans doute le pays le plus surveillé dans le domaine des armes de destruction massive. Le 10 novembre 1995, les autorités jordaniennes interceptent une cargaison à destination de l'Irak, contenant 240 gyroscopes russes utilisés dans les systèmes de guidage de missiles, ainsi que des accéléromètres. Dans la deuxième quinzaine du mois de décembre 1995, l'UNSCOM récupère dans le Tigre, à proximité de Bagdad, 200 autres composants de missiles. Tous ces composants proviennent de missiles russes SS - N 18, démantelés à Sergiyev Posad. Dans un premier temps, les autorités russes en démentent l'origine russe, en dépit de l'existence de numéros de série inscrits en lettres cyrilliques. Puis, admettant cette hypothèse, elles entament une enquête le 9 avril 1996, close définitivement en février 1998, sans qu'aucune charge ne soit retenue, au motif que ces gyroscopes issus de missiles démantelés, avaient été vendus comme pièces de métal usagé et n'étaient donc pas soumises à des restrictions à l'exportation ! L'enquête menée notamment par Vladimir Orlov et William Potter, du CNS, a révélé que ces pièces saisies ne représentaient qu'une partie de plusieurs contrats passés entre un homme d'affaires palestino-jordanien et des entreprises russes et que des industriels irakiens avaient visité plusieurs installations à Sergiyev Posad. Les contrats signés ne concernaient pas que la fourniture de matériaux, mais également de services puisqu'était prévu l'envoi d'experts russes à Bagdad afin de certifier l'équipement fourni et de faire de la formation. La question la plus préoccupante reste celle des systèmes de guidage qui n'ont pas été retrouvés : on suppose en effet que le contrat portait sur 80 systèmes de guidage complets, comportant chacun trois gyroscopes, trois accéléromètres et trois indicateurs de position angulaire GIMBAL, ainsi qu'un ou deux régulateurs de pression, soit au total 800 composants, suffisants pour 80 missiles. Sur ce nombre, 120 gyroscopes et 120 accéléromètres ont été saisis à Amman tandis que 33 gyroscopes et 26 accéléromètres étaient repêchés dans le Tigre. Restent 180 gyroscopes et accéléromètres dont on ignore ce qu'ils sont devenus... 2. Géographie de la prolifération et géographie des points de tension : un constat inquiétant Le choix d'un pays de se doter d'armes de destruction massive réside généralement dans la perception qu'il a de sa sécurité. D'où une coïncidence entre la carte des proliférations et celle des zones de tensions ou de conflits. Ce constat classique a pris une nouvelle acuité dans les années récentes, avec la multiplication des essais de missiles et plus encore avec la nucléarisation officielle du sous-continent indien. a) L'Asie : une cristallisation d'impasses inquiétante L'Asie est-il le continent de tous les dangers ? Cette question sans doute brutale doit néanmoins être posée au vu de la conjonction de trois phénomènes : l'importance du fait nucléaire en Asie, la question taiwanaise et les incertitudes pesant sur l'évolution de la Corée du Nord. · Le triangle Inde - Pakistan - Chine La constitution d'un triangle Inde - Pakistan - Chine est un fait majeur qui doit faire l'objet d'un suivi attentif en tant que matrice de conflit potentielle. En effet, trois des sept puissances nucléaires actuelles sont en Asie. A cet argument, certains pourront objecter qu'il en existe trois autres en Europe, si l'on inclut la Russie parmi les puissances européennes. Certes, mais, d'une part, à la différence de la Russie et de la France, ou de la Russie et du Royaume-Uni, les puissances nucléaires asiatiques ont une frontière commune. Plus encore, ces frontières sont contestées, alors qu'en Europe, le révisionnisme frontalier est cantonnée à la péninsule balkanique. Enfin, et c'est là le point nodal de la problématique nucléaire en Asie, non seulement la Chine, l'Inde et le Pakistan se sont heurtés à plusieurs reprises dans des conflits au cours des dernières décennies, mais plus encore, dans le cas de l'Inde et du Pakistan, un conflit violent a éclaté après les essais nucléaires de 1998. Les essais nucléaires réalisés par l'Inde et le Pakistan en 1998 ont profondément secoué la région et défient le consensus quasi-unanime sur la non-prolifération. Avec la confrontation des deux pays à Kargil au Cachemire, en 1999, la nucléarisation du sous-continent indien a pris une dimension inquiétante : l'Asie du Sud représente aujourd'hui la seule région où la confrontation de deux puissances nucléaires frontalières est aussi volatile. Dans quelle mesure faut-il craindre le recours à l'arme atomique pour le règlement d'un différend frontalier, épiphénomène d'un conflit identitaire et religieux entre l'Inde et un Pakistan dont la raison d'être est l'islamisme ? Cette question s'impose d'autant plus que de nombreux doutes restent en suspens sur la nucléarisation de l'Inde et du Pakistan : que veulent faire, aujourd'hui, l'Inde et le Pakistan de l'arme nucléaire ? Quelles forces veulent-ils ? Qui contrôle l'arme nucléaire ? Autant de questions sans réponse à ce jour, ce qui pourrait contribuer à miner le statut international que l'Inde notamment revendique à travers la possession de l'arme nucléaire. La communauté internationale semble aujourd'hui bien démunie pour répondre aux questions radicales, parfois angoissantes posées par la nucléarisation de pays qui se veulent les symboles d'un « deuxième âge nucléaire ». Les sanctions imposées par certains pays se sont révélées inefficaces et, loin de se sentir ostracisés, l'Inde et le Pakistan ont fêté avec enthousiasme le premier anniversaire des essais. Depuis les essais de 1998, l'Inde et le Pakistan n'ont donné aucun signe durable d'une volonté de pacifier leurs relations, tant s'en faut. Bien au contraire, les relations entre l'Inde et le Pakistan se détériorèrent également dans la foulée des essais. Les échanges de tirs d'artillerie s'intensifièrent sur la ligne de contrôle (LOC) au Cachemire et les incursions territoriales se multiplièrent. A l'été 1998, les relations entre les deux pays connurent toutefois une amélioration qui culmina en février 1999 avec le déplacement du Premier ministre indien à Lahore, fait historique puisqu'aucun Premier ministre indien n'avait jusque là traversé la frontière à cet endroit. Le 21 février, les deux pays adoptèrent une déclaration commune contenant des engagements mutuels sur une politique de restriction et de non-ingérence. Un document d'intention prévoyait en outre un plan ambitieux de consultations bilatérales sur les concepts de sécurité et les doctrines nucléaires, la notification préalable d'essais de missiles balistiques, les mesures de réduction des risques de tirs accidentels ou non autorisés, la réaffirmation conditionnelle des moratoires respectifs sur les essais, la liste des moyens de communication entre les deux pays et des mesures de confiance. Deux mois plus tard cependant, l'Inde et le Pakistan s'affrontaient à Kargil, au Cachemire, du côté indien de la LOC, suite au franchissement de celle-ci par 2 000 militaires venus du Pakistan, décrits par Islamabad comme des moudjahidin, qui pénétrèrent dans le territoire indien jusqu'à sept kilomètres de profondeur Cette infiltration était particulièrement massive et coupait la route permettant aux troupes indiennes de rejoindre le glacier du Siachen. Surpris, le gouvernement indien réagit avec force : des frappes aériennes - les premières depuis 1971 - eurent lieu le 26 mai. Alors que la tension montait, la pression internationale sur Islamabad conduisit le Pakistan à ordonner aux moudjahidin d'abandonner leurs positions. Les pertes indiennes s'élevèrent à 407 morts et 584 blessés, tandis que le Pakistan reconnut 407 morts, 204 blessés et 24 disparus. Si cette crise provoqua une grave crise interne au Pakistan, ce dernier réussit toutefois avec Kargil à internationaliser la question du Cachemire, but depuis longtemps poursuivi par le gouvernement pakistanais. La crise de Kargil a démontré que les inquiétudes de la communauté internationale pour la stabilité régionale en Asie du Sud n'étaient en aucun cas déplacées. Les essais nucléaires en Asie du Sud ont fait resurgir le spectre de la course aux armements dans une région qui reste un foyer de tensions majeur. Les acteurs de ce nouveau défi stratégique ont-ils pris la mesure des changements que ces essais impliquent ? La bienveillance des autorités pakistanaises à l'égard des militaires qui ont infiltré le territoire indien à Kargil permet d'en douter. Cette crise pose une question tout aussi angoissante que fondamentale sur le rôle de l'arme nucléaire en Asie du Sud. Si le doute reste permis de savoir si elle a empêché une guerre totale entre les deux pays, en tout cas, elle n'a pas permis d'éviter un conflit de basse intensité, à l'instar de ceux qu'ont connus les deux pays dans le passé. Rien n'aurait donc changé pour eux. Et pourtant tout est différent ; notamment, cette crise fait resurgir le spectre d'une utilisation incontrôlée ou mal contrôlée de l'arme nucléaire. L'Inde, tout comme le Pakistan, n'a pas nié la légitimité des inquiétudes de la communauté internationale. Reste qu'en dépit d'avancées favorables, même si rapidement avortées, comme à Lahore, le passif entre les deux pays n'est pas soldé et toutes les tentatives pour améliorer les relations entre les eux pays ont échoué. En juin 1997, un accord avait été conclu sur la constitution de groupes de travail chargés d'examiner huit questions, y compris les mesures de confiance. Cette initiative a rapidement tourné court. Même au moment des essais, en 1998, les mesures de confiance et de sécurité existantes furent laissées de côté : les « hotlines » entre les deux premiers ministres ne furent pas utilisées et ce n'est que quelques jours après que le Pakistan se fût alarmé d'une possible attaque indo-israëlienne sur Kahuta que l'on se souvint de l'accord bilatéral de 1988 sur l'engagement de ne pas attaquer les installations nucléaires de l'autre. Même « l'esprit de Lahore » semble relever du mythe : dès le lendemain du sommet, le ministre de la Défense chinois en visite à Islamabad exprimait son soutien à la position pakistanaise sur le Cachemire, déclenchant l'ire des Indiens. L'essai du missile Agni en avril 1999 ne fut notifié au Pakistan que deux jours avant, en même temps qu'à d'autres pays. Ni l'Inde ni le Pakistan n'ont fait preuve de quelque volonté que ce soit de ralentir, a fortiori de mettre fin au développement des missiles à capacité nucléaire ou de têtes nucléaires, tout en répétant inlassablement qu'ils n'avaient nulle intention de se lancer dans une course aux armements. Dans les faits, les essais de missiles répondent aux essais de missiles : le 11 avril 1998, le Pakistan teste le Ghauri I (IRBM), suivi en 1999 par l'essai du missile indien Agni II, également de portée intermédiaire. Le Pakistan réagit aussitôt en procédant au premier essai du Ghauri II et du missile de courte portée Shaheen, qu'Islamabad lia explicitement à l'essai d'Agni, qui n'a pourtant que peu à voir avec le théâtre indo-pakistanais. De la même façon, l'Inde ne semble nullement désireuse de ralentir sa production de Prithvis. En avril 1999, d'autres tests de la version navale de ce missile (350 km de portée) et de sa version air-sol (250 km) étaient annoncés tandis que la version de 150 km de portée équipe les unités depuis plusieurs années. Dans ces conditions, quelle pertinence pour le concept de retenue stratégique ? Les pas les plus importants pourraient être l'absence de miniaturisation des têtes, le non-déploiement de missiles qui seraient à portée de cibles clés ou la disjonction entre les têtes et les vecteurs. Par ailleurs, des discussions sur les doctrines respectives de chacun seraient utiles. Mais, à ce jour, force est de constater l'absence d'un véritable dialogue de fond. Peut-être le fait que les Premiers ministres indien et pakistanais se soient parlé pendant Kargil suggère-t-il que des progrès peuvent être faits et qu'une prise de conscience a eu lieu de la nécessité de construire des mesures de confiance. · L'Asie du Sud-Est à la recherche de la stabilité stratégique Moins tendue que dans le sous-continent indien, la situation en Asie du Sud-Est est cependant préoccupante. Deux points de tension se concentrent dans cette région, qui sont autant de facteurs d'instabilité stratégique dans une zone marquée par la présence de compétences nucléaires et balistiques développées : - lors de son déplacement en Chine, la mission a été frappée par le ton extrêmement ferme, voire virulent, de ses interlocuteurs sur la question taiwanaise, qui correspond à de profondes inquiétudes des autorités chinoises sur l'évolution de Taiwan. Le débat sur la défense antimissile de théâtre contribue à expliquer l'attitude chinoise : aux yeux de la Chine, la participation de Taiwan à ce système renforcerait les velléités d'indépendance de l'île, dans la mesure où les séparatistes taiwanais y verraient une protection susceptible d'appuyer un processus d'indépendance. Or, en cas de proclamation de son indépendance par Taiwan, il est acquis pour tous les interlocuteurs que la mission a rencontrés, officiels ou universitaires, que la Chine devra entrer en guerre, sous peine de voir son propre système politique remis en cause. Plus fondamentalement, le résultat des élections du 18 mars 2000, à Taiwan en bouleversant les cadres politiques traditionnels, a profondément déstabilisé les autorités chinoises ; - même si la péninsule coréenne connaît actuellement des évolutions positives, il ne faut pas oublier qu'aucune action concrète en faveur de la non-prolifération n'a été mise en _uvre jusqu'alors par la Corée du Nord. Celle-ci a même annulé une réunion à l'AIEA à la mi-novembre 2000. En outre, ses exportations balistiques vers l'Iran, la Libye, l'Egypte et la Syrie se poursuivent. Enfin, l'imprévisibilité dont ont fait preuve dans le passé les dirigeants nord-coréens ne permet pas d'exclure un retournement de situation. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l'effet qu'a eu l'essai du Taepo Dong I, le 31 août 1998, sur le Japon, survolé par le missile, alors que les deux pays ont toujours un contentieux lourd sur la question de ressortissants japonais retenus en Corée du Nord. Les incertitudes stratégiques en Extrême-Orient pourraient-elles être de nature à conduire certains pays à reconsidérer leur stratégie de défense ? Une telle question pose en fait le double problème du rôle de l'arme nucléaire dans cette région et de la défense antimissile. Ce dernier aspect, très actuel, sera abordé dans la suite du rapport. A ce stade de la réflexion cependant, on soulignera seulement que le débat sur l'introduction de la défense de théâtre en Asie témoigne des interrogations réelles du Japon ou de Taiwan sur la meilleure manière pour eux d'assurer leur sécurité dans un contexte mouvant. De ce point de vue, même si, vu d'Europe, l'arme nucléaire semble en déclin, il se pourrait qu'à terme, en Asie, elle ne soit considérée par ces acteurs régionaux comme la meilleure protection. La nucléarisation du Japon ne poserait pas de problème technique dans un pays qui maîtrise en outre les technologies balistiques. Certes, le sujet demeure largement tabou dans le seul pays où l'arme nucléaire a été utilisée dans le cadre d'un conflit. Mais on rappellera également qu'au-delà des trois principes, quasiment supraconstitutionnels sur lesquels repose la politique japonaise à l'égard de l'arme nucléaire - pas de possession d'armes nucléaires, pas de fabrication de celles-ci, pas d'entrée d'armes nucléaires sur le territoire japonais -, le Japon s'appuie sur la dissuasion extensive des Etats-Unis et que, depuis dix ans, le débat nucléaire est présent dans ce pays. S'agissant enfin de Taiwan, il a certes arrêté son programme nucléaire sous la pression américaine et est soumis aux inspections régulières de l'AIEA. Mais il a, dans le passé, étudié sérieusement l'option nucléaire et, comme dans le cas du Japon, possède une base technologique qui fait de la question nucléaire un problème avant tout politique. b) Le Moyen-Orient, entre processus de paix et armes de destruction massive Nulle région du monde ne concentre davantage d'armes de destruction massive que le Moyen-Orient : dans une surface relativement limitée, tous les types d'armes de destruction massive sont présents, possédées par des pays qui, en dépit d'évolutions favorables, nourrissent entre eux des différends majeurs. D'un côté, les états arabes mettent en cause l'asymétrie induite par l'existence de la bombe israélienne. Comme il a été dit à vos rapporteurs lors de leurs entretiens avec les autorités égyptiennes, « les Etats du Moyen-Orient ne toléreront pas qu'existe un monopole nucléaire dans la région. ». A cet égard, les pays arabes ne contestent en rien le droit pour l'Iran de développer ses capacités dans le domaine des armes de destruction massive. De son côté, Israël estime que « beaucoup d'actions dangereuses en matière de prolifération ont eu lieu dans notre région au cours des dernières années et aucune n'a été le fait d'Israël ». Ces paroles prononcées le 20 septembre 2000 par le directeur général de la commission de l'Energie atomique israélienne visent essentiellement l'Iran dans lequel Israël voit une menace très sérieuse pour sa sécurité. Il est vrai que certaines déclarations iraniennes sont de nature à susciter les inquiétudes israéliennes. Ainsi, en novembre 1999, l'agence officielle iranienne affirmait que « la neutralisation de la menace nucléaire israélienne était une priorité », tandis que le porte-parole du ministère des affaires étrangères estimait que « le régime sioniste, doté d'armes atomiques, constitue une grande menace pour la région et la république islamique, et la neutralisation de ce danger est l'une des priorités de l'Iran ». De même, l'essai récent du Shihab III (1 300 kilomètres de portée), le 15 juillet 2000, n'a fait que renforcer ce sentiment dans un pays obsédé par la menace balistique depuis la guerre du Golfe. Le ministère de la Défense israélien établit ainsi des projections pessimistes de la menace balistique d'ici à 2018 au Proche-Orient, qui font apparaître un quasi-doublement du nombre de missiles balistiques, qui passeraient de 560 à 1 070 : - la Syrie passerait d'un arsenal de 490 à 530 missiles (Scud-B, Scud-C, M-9, SS 21 et missiles de longue portée) ; - la Libye posséderait 70 missiles de longue portée (elle n'en a pas actuellement) ; - l'Irak, dans l'hypothèse où elle ne serait pas désarmée, passerait de 30 à 390 missiles dérivés du SCUD ; - enfin, l'arsenal iranien passerait de 0 à 120 missiles (Shihab III et IV). Et encore ces projections prenaient-elles en compte les effets du processus de paix dont l'impact est estimé par les experts israéliens à une diminution de moitié de la menace balistique. La reprise de l'Intifada depuis octobre 2000 laisse présager des projections beaucoup plus sombres, à mesure que le processus d'Oslo se délite. Jusqu'alors, aucun progrès n'a été fait au Moyen-Orient dans un cadre strictement régional. Suite à la conférence de Madrid, cinq groupes de travail ont été mis en place, dont un consacré aux questions de sécurité. Alors qu'Israël, considérant que le premier problème de sécurité au Proche-Orient concernait les conflits de basse intensité, souhaitait discuter de l'adoption de mesures de confiance, l'Égypte voulait d'abord traiter des questions les plus difficiles telles que le nucléaire. Le processus, qui avait débuté en 1992, a donc été arrêté en 1995. La proposition israélienne, en mai 2000, de reprendre ce dialogue n'a reçu aucune réponse à ce jour. Et si le Moyen-Orient s'enfonce dans une guérilla urbaine d'attrition comme le laissent malheureusement présager les événements de l'automne 2000, il n'est pas près d'être libéré des armes de destruction massive, bien au contraire. II. - LE BILAN EN DEMI-TEINTE DES POLITIQUES DE NON-PROLIFÉRATION « Nous devons, avec détermination, poursuivre nos efforts pour éviter la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ». Ces mots prononcés par le Président de la République le 8 juin 1996, lors de son discours devant l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, témoignent de la place qu'occupe désormais la lutte contre la prolifération dans toutes les grandes démocraties. Cette prise de conscience n'est certes pas nouvelle, et la lutte contre la prolifération a déjà derrière elle plus de trente ans d'une histoire aussi riche qu'innovante, centrée sur le concept de non-prolifération, c'est-à-dire sur la prévention de la dissémination des armes de destruction massive. Certains voient parfois les prémisses des politiques de non-prolifération dès l'accord passé en 1943 entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni par lequel les deux Etats s'engagent à ne pas révéler à un tiers les résultats de leurs découvertes nucléaires. C'est cependant dans les années 1960 que se mettent véritablement en place les politiques de non-prolifération, sous l'impulsion de l'administration Kennedy et dans un contexte de multiplication des puissances nucléaires. L'adoption du traité de non-prolifération nucléaire (TNP) en 1968 représente à cet égard un acte fondateur, dans la mesure où c'est le premier véritable instrument global de lutte contre la prolifération qui voit le jour avec ce traité54 et où, par son ampleur et l'universalité qu'il a acquise, il représente une sorte d'archétype de la politique de non-prolifération. Depuis lors, les dispositifs de prévention de la prolifération se sont diversifiés, dépassant de loin le seul cadre du traité international multilatéral, même s'ils reposent tous sur le principe de la diplomatie préventive et sur une approche contractuelle. Outre les traités internationaux multilatéraux (traité de non-prolifération nucléaire, convention d'interdiction des armes biologiques, convention d'interdiction des armes chimiques, traité d'interdiction complète des essais nucléaires), des dispositifs bilatéraux se sont également développés, dans le domaine nucléaire notamment (accords de garanties de l'AIEA, accord entre les Etats-Unis et la Russie pour l'application de la législation Nunn-Lugar, etc.) ou balistique (traité ABM). Des organisations internationales spécifiques ont été créées : c'est le cas de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, dont le rôle dépasse cependant la lutte contre la prolifération, de la KEDO ou des deux organismes créés pour l'application de la convention sur les armes chimiques et du traité d'interdiction des essais. Enfin, des régimes plus informels (Groupe des fournisseurs nucléaires, Comité Zangger, Groupe australien, MTCR) se sont créés dans tous les secteurs de la prolifération afin de limiter et décourager le transfert des matériaux et biens sensibles, qui reposent sur l'auto-contrôle des pays fournisseurs et leur adhésion à un certain nombre de principes. Quel bilan tirer du fonctionnement de cet édifice à l'architecture élaborée ? Jusqu'en 1998, la réponse à cette question aurait été globalement positive. De fait, les régimes de non-prolifération ont connu de nombreux succès entre 1992 et 1997 : dans le domaine nucléaire, c'est le durcissement des règles d'exportation en 1992, le renforcement des clauses de garantie de l'AIEA en 1993 (programme dit « 93 + 2 »), la prorogation indéfinie du TNP en 1995 et la conclusion du TICE en 1996 ; s'agissant du balistique, c'est le renforcement du régime de fournisseurs en 1992 ; dans le domaine chimique enfin, c'est, en 1993, la conclusion d'une convention très intrusive sur l'interdiction des armes de ce type. Aujourd'hui cependant, le ton a changé : « les régimes de non-prolifération assiégés », « les régimes de non-prolifération en danger », peut-on lire sous la plume de George Bunn, l'un des éminents contributeurs à la conclusion du TNP, ou de William Potter, le directeur du centre d'études de non-prolifération de Monterey. De l'autre côté de l'Atlantique, on n'hésite pas à mettre en doute l'avenir même des structures de non-prolifération : pessimisme exagéré né de la décision du Sénat américain de ne pas ratifier le TICE ou pressentiment d'une lente mais certaine érosion de systèmes qui peinent, de fait, à prendre en compte ce phénomène largement inédit de la constitution de « clubs de proliférants » qui font pièce aux « clubs de fournisseurs » ? Globalement, la mission a le sentiment d'un bilan en demi-teinte, contrasté selon les domaines de la prolifération concernés, mais qui ne remet en aucun cas en cause la légitimité des régimes existants. A. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE : UN BILAN POSITIF MAIS DES HYPOTHÈQUES À LEVER POUR L'AVENIR Dans le domaine nucléaire, le constat général est celui d'une clarification de la situation par rapport au début des années 1990 : 187 pays ont signé le TNP, dont cinq à titre d'Etats nucléaires ; seuls quatre Etats (Inde, Pakistan, Israël, Cuba) restent à ce jour en dehors du TNP. On notera en outre que, depuis la mise au grand jour - à temps ! - des programmes irakien et nord-coréen, aucun cas flagrant de violation des dispositions internationales mises en _uvre au titre du TNP, des contrôles de l'AIEA et du groupe des fournisseurs nucléaires n'a été enregistré, en dépit d'un niveau de risque élevé et d'allégations réitérées de la part de certains pays. Il faut donc conclure à la solidité du système mis en place et renforcé après les découvertes en Irak. Reste qu'en dépit d'un bilan positif, un certain nombre d'hypothèques pèsent sur le régime de non-prolifération nucléaire, qui devront être levées sous peine de remettre en cause, à terme, la pérennité du système. 1. Le verrouillage juridique de la prolifération nucléaire C'est dans le domaine nucléaire qu'ont été développés les instruments de lutte contre la prolifération les plus nombreux et les plus variés. Il existe en effet : - un arsenal préventif dans le cadre onusien, constitué, en son c_ur, par le TNP ainsi que par les accords de garantie de l'AIEA, renforcés après l'affaire irakienne (programme 93 + 2), par le traité d'interdiction complète des essais et par des traités régionaux instaurant des zones exemptes d'armes nucléaires ; - un double dispositif de contrôle à l'exportation multilatéral (club de Londres et comité Zangger), lui aussi renforcé dans les années récentes ; - des dispositifs spécifiques pour certains pays (accords entre la Russie et les Etats-Unis d'une part, la Russie et certains pays européens d'autre part et création de la KEDO pour la Corée du Nord). a) Au c_ur du dispositif : un système complexe de traités et d'accords Pierre angulaire du régime international de non-prolifération nucléaire, le traité de non-prolifération (TNP) est complété par un ensemble d'instruments internationaux au statut varié, dont le but est de contenir tant la prolifération verticale (nombre d'Etats dotés d'un armement nucléaire) que horizontale (augmentation et perfectionnement des arsenaux). _ Le Traité de non-prolifération Mis au point dans le cadre du Comité de désarmement à l'ONU, le TNP a été signé le 1er juillet 196855. Il est entré en vigueur en mars 1970 après avoir été signé et ratifié par quarante Etats. Aujourd'hui, le TNP est un traité quasi universel puisque seuls quatre pays (Cuba, Israël, Inde et Pakistan) n'y sont pas partie. Le principe de base du TNP repose sur la discrimination opérée entre les Etats dotés de l'arme nucléaire ayant fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les Etats non dotés de l'arme nucléaire (ENDAN) : - les premiers (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France, Chine), également membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent, en signant le traité, à ne pas aider un autre pays à acquérir des armes nucléaires ; - les seconds s'engagent, pour leur part, à ne pas fabriquer d'armes nucléaires et à ne pas essayer de s'en procurer d'une autre façon. Un accord de garanties doit être en outre signé par chaque ENDAN avec l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) afin que celle-ci vérifie la validité de leurs engagements. Le traité favorise en revanche les usages pacifiques de l'atome, en affirmant le droit inaliénable de toutes les parties au traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Tous les pays signataires, et notamment les Etats les plus avancés dans le domaine nucléaire civil, s'engagent ainsi à faciliter un échange aussi large que possible d'informations, d'équipements et de matières nucléaires pour les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. De même, les pays non dotés d'armes nucléaires peuvent bénéficier, dans des conditions très strictes et sous un contrôle approprié, des applications pacifiques des explosions nucléaires. Le TNP contient également une clause relative au désarmement (article VI), tous les signataires devant s'engager à négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course aux armements nucléaires et à un désarmement général et complet sous un contrôle international. Le Traité prévoit en outre que les signataires se réuniront tous les cinq ans pour examiner les conditions dans lesquelles il a été appliqué. De plus, il est prévu que, vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité (c'est-à-dire en 1995), les signataires se réunissent pour décider, à la majorité, s'il doit demeurer en vigueur indéfiniment ou être prorogé pour une ou plusieurs périodes de durée déterminée. Le 11 mai 1995, c'est la première solution qui a été adoptée par consensus par l'ensemble des Etats parties au traité. Il est enfin prévu qu'un Etat signataire peut se retirer du Traité, après un préavis de trois mois, s'il décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet du traité, ont compromis ses intérêts suprêmes. En juin 1994, la Corée du Nord a essayé ; c'est le seul cas à ce jour. Si le TNP vise essentiellement à lutter contre la prolifération verticale, en limitant le nombre légal d'Etats autorisés à disposer d'armes nucléaires, il est complété par d'autres dispositifs poursuivant le même objectif mais s'inscrivant également dans une perspective de limitation des arsenaux existants et de leur perfectionnement. _ Les accords de garantie de l'AIEA et le programme « 93 + 2 » L'article III du TNP stipule que « tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'AIEA, conformément au Statut de l'AlEA et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire soit détournée des utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres engins explosifs nucléaires ». Conformément à cet article du TNP, l'AIEA a élaboré un protocole d'accord qui sert de base à la signature d'accords bilatéraux entre l'Agence et les Etats non dotés parties au Traité. Si les principaux Etats non dotés ont signé un accord de ce type, une cinquantaine ne sont pas encore signataires. L'efficacité de ces accords a cependant souffert des limites techniques du système de vérification, fondé sur les déclarations des Etat signataires. La découverte d'activités nucléaires clandestines en Irak est venue démontrer que les déclarations volontaires pouvaient dissimuler des activités clandestines étendues. C'est à la suite de cette crise que le programme de renforcement des garanties de l'AIEA, dit « 93 + 2 », a été lancé. Ce programme vise à accroître l'étendue et la précision des contrôles de l'AIEA afin de garantir l'efficacité du régime de non-prolifération nucléaire. II ne doit pas être compris comme un simple prolongement du régime de garanties précédent, mais constitue au contraire une véritable révolution dans l'organisation des contrôles de l'AIEA. Le programme « 93 + 2 » signifie en effet le passage d'une logique strictement comptable, dans laquelle l'Agence se contente de vérifier l'exactitude des déclarations des Etats soumis aux garanties, à une logique inquisitoire, dans laquelle l'Agence enquête directement sur les activités nucléaires de ces Etats. Le système de garanties renforcées fait entrer le contrôle nucléaire dans l'ère de l'intrusion quasi juridictionnelle. Ce programme comporte à la fois des mesures renforcées s'inscrivant dans le cadre des pouvoirs juridiques existants et des mesures nouvelles prévues par un protocole additionnel. Les principales mesures renforcées sont les suivantes : - la fourniture d'informations supplémentaires sur les installations qui ont contenu un jour, ou qui contiendront à l'avenir des matières nucléaires soumises aux garanties de l'Agence ; - le recours accru aux inspections inopinées ; - le prélèvement d'échantillons dans l'environnement ; - le recours à des techniques de pointe pour surveiller à distance les mouvements de matières nucléaires. Les mesures nouvelles sont définies par le Protocole additionnel aux Accords de garanties, approuvé par le Conseil des Gouverneurs le 15 mai 1997. Ce Protocole prévoit : - la communication de renseignements sur - et l'accès des inspecteurs à - toutes les opérations du cycle du combustible nucléaire des Etats, depuis les mines d'uranium jusqu'aux déchets nucléaires et aux emplacements où sont présentes des matières nucléaires destinées à des usages non nucléaires ; - la communication de renseignements sur - et l'accès des inspecteurs à - tous les bâtiments se trouvant sur un site nucléaire ; - la communication de renseignements sur - et l'accès des inspecteurs à - la recherche développement liée au cycle du combustible ; - la communication de renseignements sur la fabrication et l'exportation de techniques sensibles liées au nucléaire et l'accès des inspecteurs aux lieux de fabrication et d'importation ; - le prélèvement d'échantillons de l'environnement en-dehors des emplacements déclarés, lorsque l'AIEA le juge nécessaire. Combiné à l'Accord de garanties, le Protocole additionnel permet donc d'avoir le tableau le plus complet possible de la production et du stock de matières nucléaires brutes d'un Etat, des activités de traitement des matières et des éléments spécifiés de l'infrastructure du cycle du combustible nucléaire existant ou en projet dans l'Etat. _ Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires Jusqu'à la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE ou CTBT pour Comprehensive Test Ban Treaty), ce sont seulement des dispositifs partiels qui ont été instaurés. - Une négociation complexe Le souci de réglementer les essais nucléaires remonte à 1954 : dès cette date, l'Inde lance une campagne au sein de l'ONU afin d'interdire totalement les essais nucléaires. Les efforts diplomatiques de l'Inde conduisent au lancement de négociations à partir de 1957, qui aboutissent le 5 août 1963 à la signature du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires (PTBT pour Partial Test Ban Treaty). Par ce traité, qui entre en vigueur dès le mois d'octobre 1963, sont interdits les essais dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace extra-atmosphérique. En bref, seuls sont autorisés les essais souterrains. Il faut noter que la France et la Chine n'ont jamais signé ce traité, dont elles étaient les cibles principales. Il faut attendre ensuite la décennie 1990 pour que le dossier de l'interdiction des essais nucléaires retrouve un nouveau souffle. Tout d'abord, entrent en vigueur en 1990 les deux traités bilatéraux que l'URSS et les Etats-Unis avaient signés sur ce thème en 1974, l'un portant sur la limitation de la puissance des essais souterrains (interdiction des essais d'une puissance supérieure à 150 kilotonnes), le second restreignant les explosions nucléaires pacifiques. Puis, à partir de 1993, les Etats membres de la conférence du désarmement, qui viennent d'achever les négociations relatives à la convention sur les armes chimiques, décident d'engager celles sur l'interdiction des essais nucléaires. Elles aboutissent à la signature du TICE à New-York, le 24 septembre 1996, qui représente l'étape ultime des efforts engagés par la communauté internationale depuis près de quarante années et clôt l'une des négociations diplomatiques les plus complexes. L'échéance de 1996 fixée par la conférence d'examen du TNP, le 11 mai 1995, est ainsi respectée. Sans minimiser le succès représenté par la conclusion de cette négociation, il ne faut pas fermer les yeux sur ses conséquences : si le TICE favorise les programmes de simulation, il pousse les pays qui n'en ont ni les moyens financiers, ni les moyens techniques, à la clandestinité. - Le dispositif du TICE Le traité pose le principe de l'interdiction totale des explosions expérimentales d'armes nucléaires et de toute autre explosion nucléaire. Sont donc incluses les explosions nucléaires pacifiques. Son respect est assuré par la mise en _uvre d'un système de vérification élaboré : il s'agit d'une vérification a posteriori, fondée sur le déploiement d'un système capable de détecter et de traiter à distance tous les événements susceptibles de constituer une explosion nucléaire d'un kilotonne au moins (système de surveillance international, dont le Centre international de données) et sur une capacité à identifier et à détecter la nature nucléaire d'un événement (système de consultation de l'Etat concerné, de demande de clarification et d'inspections sur place). Si le système de vérification s'appuie sur une structure spécialement créée pour l'application du traité, il recourt également aux moyens techniques nationaux et à des inspections à partir d'aéronefs. Afin d'assurer l'exécution du traité, une Organisation permanente (OTICE) est mise en place, composée de trois organes : - la conférence des Etats parties, principal organe de cette structure, qui examine toute question entrant dans le champ du traité. Cet organe n'existera qu'à partir de l'entrée en vigueur du traité ; - le conseil exécutif, qui comprend 51 membres représentant six groupes géographiques, est l'organe d'exécution de l'OTICE ; - le secrétariat exécutif est chargé de coordonner l'exploitation du système de surveillance international, composé d'un réseau planétaire de 321 stations, et de recueillir, traiter et analyser en continu toutes les données émises par les stations dans le Centre international de données. - Des conditions d'entrée en vigueur complexes L'entrée en vigueur du traité est subordonnée à la signature et à la ratification par un certain nombre d'Etats désignés, notamment les Etats disposant d'une capacité nucléaire au sens de l'agence internationale de l'énergie atomique, soit les cinq EDAN et les trois Etats du seuil (Israël, Inde, Pakistan). L'Inde ayant, lors de la négociation, indiqué qu'elle ne voulait pas signer le traité, l'entrée en vigueur du traité risquait d'être repoussée à une date lointaine. C'est pourquoi a été proposée la tenue d'une conférence des Etats signataires, trois ans après la date anniversaire de l'ouverture du traité à la signature (24 septembre 1996). Si, à cette date (soit en septembre 1999), le traité n'est pas encore entré en vigueur, ceux-ci pourront « se prononcer par consensus sur les mesures conformes au droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et d'accélérer ainsi l'entrée en vigueur du traité ». Comme nous le verrons ci-après, rien ne s'est passé en réalité, notamment à cause de la défection américaine. _ Les traités établissant des zones exemptes d'armes nucléaires Il existe à ce jour cinq zones exemptes d'armes nucléaires : - l'Antarctique (Traité de Washington sur l'Antarctique de 1959). Ce traité prévoit même une démilitarisation totale du continent austral ; - l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Antilles (traité de Tlatelolco du 14 février 1967). Le Brésil et l'Argentine n'ont accepté de ratifier le traité qu'en 1994, à l'issue de longues négociations qui les ont conduits à renoncer au nucléaire militaire ; - le Pacifique Sud (traité de Rarotonga du 6 août 1985). La France a ratifié les protocoles annexés au traité le 20 septembre 1996, après l'achèvement de sa dernière campagne d'essais nucléaires ; - l'Asie du sud-est (traité de Bangkok du 15 décembre 1995). La Chine ne se considère pas comme faisant partie de la région et n'a donc pas signé ce traité, qui perd ainsi de son intérêt, notamment aux yeux de l'Inde ; - l'Afrique (traité de Pelindaba du 11 avril 1996). Ce projet de traité n'a pu aboutir qu'après la renonciation de l'Afrique du Sud au nucléaire militaire en 1991. Ces zones exemptes d'armes nucléaires ne sont pas des zones dénucléarisées, aucun des traités précités n'empêchant le développement d'activités nucléaires civiles. La constitution de chacune de ces zones résulte de la volonté des Etats de la région : elle est fondée sur le renoncement de chaque Etat partie à détenir des armes nucléaires ou à en autoriser le stationnement et sur son acceptation d'un système de vérification mutuelle qui s'appuie sur la conclusion d'accords spécifiques avec l'Agence internationale de l'Energie atomique. La notion de zone exempte d'armes nucléaires requiert également que les EDAN s'engagent à la respecter : c'est pourquoi des protocoles additionnels entre les Etats parties de la zone et chaque EDAN ont généralement été signés. Par ailleurs, les Etats de la zone ont cherché à se prémunir d'éventuelles attaques par des garanties négatives de sécurité de la part des EDAN (engagement des EDAN à ne pas utiliser l'arme nucléaire contre eux), ce qui a conduit à la conclusion d'autres protocoles avec les EDAN. La France, concernée par la plupart de ces dispositifs du fait de sa présence outre-mer, a signé l'ensemble de ceux-ci. Elle a toujours en effet considéré ce type de zones comme l'un des instruments privilégiés de la non-prolifération nucléaire, estimant que la plupart des risques de prolifération nucléaire étaient liés à des enjeux régionaux. Des projets de nouvelles zones exemptes d'armes nucléaires ont été ou sont régulièrement proposés : - au Moyen-Orient, l'Egypte déposant chaque année, depuis 1974, à l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution sur ce sujet. A l'issue de la conférence de prorogation du TNP de 1995, une résolution a proposé « la création au Moyen-Orient d'une zone libre d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques, et de leurs vecteurs, effectivement soumise à vérification » ; - l'idée d'une telle zone en Europe centrale et orientale resurgit régulièrement (par exemple, propositions de l'Ukraine, de la Biélorussie). Le Conseil de l'Atlantique nord a indiqué pour sa part en décembre 1996 que « les pays de l'OTAN n'ont aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres ». En fait, à ce jour, les trois zones clés de prolifération échappent à de tels régimes, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, du sous-continent indien ou de l'Extrême-Orient. Ce qui fait des zones exemptes d'armes nucléaires des mesures notariales de constatation de l'absence de conflits. b) Les régimes de fournisseurs Le TNP a été complété par des dispositifs réglementant l'exportation de produits et de technologies sensibles, qui trouvent leur fondement dans l'article III-2 de ce traité qui dispose que « tout Etat partie au traité s'engage à ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou d'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties » de l'AIEA. Deux enceintes de fournisseurs mettent en _uvre ces dispositions : - le Comité Zangger, du nom de son premier président, a été fondé en 1974 par quelques Etats exportateurs dans le but explicite de mettre en _uvre cet article du TNP. Il rassemble aujourd'hui une trentaine de pays56 qui soumettent les produits et technologies contenus dans la liste de base (trigger list) à un régime d'exportation spécifique vers les pays non-adhérents au TNP (garantie formelle d'un usage non explosif et droit de contrôle en cas de retransfert) ; - le Club de Londres, devenu en 1992 le groupe des fournisseurs nucléaires (Nuclear Suppliers Group ou NSG)57, a été fondé en 1975, suite à l'essai nucléaire indien de mai 1974, qui a conduit les principaux fournisseurs de biens nucléaires à renforcer le régime défini par le Comité Zangger. La liste des technologies sensibles a donc été étendue à d'autres biens potentiellement proliférants et les conditions d'exportation rendues plus rigoureuses. Des directives, dites « directives de Londres », ont été adoptées et définissent une discipline commune. A la différence des règles de fonctionnement du Comité Zangger, elles s'appliquent à tous les Etats non dotés de l'arme nucléaire, qu'ils soient partie ou non au TNP. Ce régime a été renforcé en 1992, après les révélations sur le programme clandestin irakien, notamment en ce qui concerne les biens à double usage. En outre, le contrôle intégral est désormais une condition d'exportation de biens spécifiquement nucléaires : il permet de n'exporter ces biens que si l'Etat acheteur soumet toutes ses installations nucléaires aux garanties de l'AIEA. Bien que les deux régimes poursuivent le même objectif, il n'est pourtant pas envisagé de les fusionner, le Comité Zangger exerçant un contrôle certes plus lâche, mais pouvant jouer un rôle pédagogique pour les Etats que le caractère très strict des directives de Londres effraie. Par exemple, après son adhésion au TNP en 1992, la Chine n'entendait pas se plier aux normes de non-prolifération fixées par le groupe de fournisseurs nucléaires, auquel elle a toujours refusé d'adhérer. Elle a en revanche adhéré au comité Zangger en 1997 et signé avec l'AIEA un protocole d'accord dans le cadre du programme « 93+2 ». c) Les solutions ad hoc : le cas russe La situation de certains pays a nécessité la mise en place de dispositifs spécifiques, faute d'une adéquation satisfaisante entre les outils de lutte contre la prolifération existants et les circonstances propres à ces pays. Le cas particulier de la Corée du Nord, à l'origine de la création de la KEDO, a été évoqué précédemment. Mais c'est essentiellement en Russie que la communauté internationale a ressenti la nécessité de créer des outils ad hoc, car elle était confrontée au problème aussi complexe que nouveau de la gestion du déclin, voire de l'éclatement, d'une puissance nucléaire qui avait produit au cours des cinquante dernières années entre 125 et 175 tonnes de plutonium militaire58. Depuis 1991, l'effort d'une partie de la communauté internationale se porte en Russie sur trois dossiers : - le démantèlement des armes stratégiques ainsi que la sécurisation et la reconversion des installations nucléaires ; - la gestion des stocks massifs de matières fissiles, notamment l'élimination des excédents de plutonium militaire ; - la prévention de la fuite des cerveaux. L'ampleur de la tâche a conduit les grands pays industrialisés à mettre en _uvre des solutions innovantes, qui forment aujourd'hui une architecture extrêmement complexe. Quatre pays sont particulièrement impliqués dans cette _uvre de longue haleine : il s'agit des Etats-Unis, de la France, de l'Allemagne et du Japon, auxquels il faut ajouter l'Union européenne qui intervient par le biais de plusieurs programmes : - le démantèlement de l'arsenal soviétique et la sécurisation des sites sont plus particulièrement traités dans le cadre des relations bilatérales russo-américaines, et notamment du programme Nunn-Lugar ; - le problème du retraitement du plutonium militaire a d'abord été pris en charge par la France, puis également par l'Allemagne dans le cadre du programme AIDA MOX et tend aujourd'hui à s'internationaliser puisque des accords récents sont intervenus entre la Russie et les Etats-Unis dans le cadre du programme de réduction de la menace. On ajoutera par ailleurs la création de consortiums industriels internationaux dans ce domaine ; - enfin, s'agissant de la reconversion des scientifiques, elle est essentiellement traitée dans un cadre international, à travers le Centre scientifique et technologique international (ISTC) de Moscou, créé le 27 novembre 1992. On notera enfin que l'Union Européenne, dans le cadre du programme TACIS a dépensé, entre 1991 et 1998, 767 millions d'euros pour la sécurité nucléaire et l'environnement en Russie et dans les Etats issus de l'ex-URSS, sur un total de 3,8 milliards d'euros dépensés dans le cadre de ce programme. _ Les programmes russo-américains de réduction de la menace Considérant que le risque que faisait peser l'éclatement de l'URSS sur les infrastructures militaires nucléaires, balistiques, biologiques et chimiques représentait une menace directe pour leur sécurité, les États-Unis se sont engagés depuis l'adoption de la loi Nunn-Lugar (Soviet Nuclear Threat Reduction Act en 1991, devenu en 1993 le Cooperative Threat Reduction Act ou CTR) dans un programme de réduction de la menace. Depuis 1991, 2,7 milliards de dollars ont ainsi été dépensés pour l'assistance à la non-prolifération et aux activités de démantèlement des armes en Russie, en Biélorussie, au Kazakhstan et en Ukraine. Un accord cadre prolongeant le programme CTR pour sept ans a été signé en juin 1999 et ce sont 182 millions de dollars qui ont été inscrits au budget américain en 2000 pour l'élimination des armes stratégiques offensives en Russie et 35 millions pour l'Ukraine. Dans les faits, ce programme global comporte de nombreux projets en coopération, sous l'égide du ministère de la Défense américain, même si les ministères de l'Energie, du Commerce et des Affaires étrangères interviennent également (protection des matériaux nucléaires, formation au contrôle des exportations, reconversion des scientifiques dans le domaine civil). Bien que mis en _uvre dès 1991, ces programmes ne sont entrés dans leur phase de maturité qu'en 1996 : l'accord entre la Russie et les Etats-Unis n'a été signé que le 17 juin 1992, une fois l'effet de surprise passé et les réticences des militaires russes à ouvrir des installations ultra-secrètes surmontées. Les deux annuités de 1992 et 1993 ont été consacrées à l'établissement des grandes lignes du programme et à la mise en place d'outils juridiques. Quant aux années 1994 et 1995, elles ont vu les structures de gestion et les stratégies d'acquisition s'installer progressivement. Globalement, les experts américains s'accordent à considérer que, dans les Etats issus de l'ex-URSS, hors Russie, le bilan de l'application des mesures Nunn-Lugar est bon : - c'est au Kazakhstan que le programme d'élimination des armes stratégiques offensives a le mieux réussi. Toutes les armes et toutes les infrastructures liées aux armes nucléaires ont été éliminées, soit 104 ICBM, 40 bombardiers, 1 400 têtes retournées en Russie, 148 lanceurs d'ICBM et 178 tunnels d'essais nucléaires fermés ; - la coopération avec la Biélorussie s'est révélée beaucoup plus délicate pour des raisons de politique intérieure. Si tous les ICBM et les têtes avaient été retirés en novembre 1996, la suspension du programme en mars 1997 n'a pas permis de détruire les 1 000 tonnes métriques de combustible liquide ni les 9 000 tonnes métriques d'oxydant qui restent sur place. Il semblerait par ailleurs que la destruction des sites de lancement des SS - 25 soit stoppée ; - en Ukraine, le travail est toujours en cours. Les 130 silos de SS - 19 avaient été détruits en décembre 1998 et les missiles eux-mêmes étaient tous démantelés en février 1999. Tous les SS - 24 ont été retirés des silos, dont la destruction devrait s'achever d'ici à la fin 2001. 10 bombardiers lourds devaient avoir été éliminés au début de 2000 et 11 transférés à la Russie (accord entre les deux pays de l'été 1999) ; 21 bombardiers devaient être détruits d'ici au début 2001. Enfin, il est prévu de construire des infrastructures de destruction des combustibles liquides et solides. Cette assistance, destinée à aider les Etats nouvellement indépendants issus de l'URSS à gérer l'héritage nucléaire soviétique en matière d'armes de destruction massive, a grandement facilité la transition de la Biélorussie, de l'Ukraine et du Kazakhstan vers le statut d'état non nucléaire. Sans cette aide, il est certain que ces Etats auraient toujours sur leurs territoires des stocks d'armes nucléaires et des systèmes de lancement dont les conditions de sécurité seraient plus que douteuses. En Russie, principal destinataire des fonds américains, des pas importants ont été accomplis dans l'élimination d'un grand nombre d'armes nucléaires, la formation à la protection et au contrôle de technologies nucléaires et la destruction de vecteurs et de leurs carburants toxiques. Le nombre d'armes nucléaires retirées du service en Russie depuis 1991 grâce au programme Nunn-Lugar est très supérieur aux arsenaux actuels cumulés de la France, de la Chine et du Royaume-Uni. En décembre 1999, 4 854 têtes nucléaires avaient été désactivées grâce à ce programme, 373 missiles balistiques détruits, 354 silos à missiles éliminés, 191 tunnels à essais fermés et 12 sous-marins nucléaires démantelés, capables d'emporter 160 lanceurs de missiles stratégiques. Par ailleurs, la ratification de START II devrait entraîner la destruction d'ici à 2007 de 200 silos, 1 400 missiles et 50 bombardiers. La question d'actualité porte maintenant sur la sécurité des sites eux-mêmes en Russie, sécurité tant à l'égard d'agresseurs externes, que des personnels eux-mêmes, mal payés et souvent isolés. En 1995, les experts estimaient entre 80 et 100 le nombre de sites civils et militaires à protéger en Russie (instituts de recherche, centrales, installations de la Marine, complexe de conception et de fabrication des armes nucléaires), pour un coût unitaire de 10 millions de dollars. En 1999, 62 de ces sites étaient équipés de systèmes de protection. Des incidents s'étant produits, la protection physique des sites a été renforcée ; un centre d'évaluation et d'entraînement à la sécurité a été mis en place en novembre 1999, à Sergiyev Posad. Par ailleurs, un système de gestion des têtes nucléaires par ordinateur a été mis en place, qui sera opérationnel début 2001. _ L'élimination des excédents de plutonium russes L'élimination du plutonium russe représente aujourd'hui l'une des clés du désarmement et de la prolifération nucléaires. La quantité de plutonium russe officiellement reconnue comme destructible dans le cadre des accords START est de cinquante tonnes ; l'inventaire total est toutefois considéré par les experts comme plusieurs fois supérieur à ce chiffre. Les grandes puissances ont officiellement pris acte des enjeux de premier plan liés au plutonium militaire russe et appelé à un règlement de cette question lors du sommet du G 8 de Cologne, en 1999. Les Etats-Unis ont clairement marqué leur intention de continuer de suivre cette question au niveau du G 8. La France a très tôt pris conscience de la nécessité d'assister la Russie dans ce domaine : les deux pays ont donc signé le 12 novembre 1992 un accord bilatéral qui fournit la base d'un programme global d'Aide au Démantèlement des Armes (AIDA) pour la période 1992-1996. La France a investi 400 millions de francs dans ce programme, coordonné, du côté français, par le Commissariat à l'énergie atomique. Ce programme comprend cinq volets, dont les quatre premiers complètent en fait largement les mesures mises en _uvre dans le cadre du programme Nunn-Lugar : - la fourniture de matériel de radioprotection afin d'assurer la sécurité du transport, de l'entreposage et du démantèlement des armes, effectuée en 1995 ; - la fourniture d'une centaine de super-conteneurs résistants à des agressions sévères pour assurer la sûreté du transport des munitions entre les sites de stockage et de démantèlement. Cette livraison s'est achevée en avril 1998 ; - la construction d'un bâtiment de stockage de matériaux hydrogénés lithiés à Novossibirsk, achevée en décembre 1997 ; - la conduite d'études consacrées à la transformation du plutonium militaire en combustible MOX59, destiné à être brûlé sous forme de combustible dans des réacteurs russes existants. Ce programme d'études, nommé AIDA MOX, a démontré la faisabilité de l'opération. D'où la prolongation et l'extension de la coopération franco-russe sur cette question, avec la signature, le 2 juin 1998, par la France, l'Allemagne et la Russie60, de l'accord AIDA MOX II, qui doit confirmer la faisabilité du recyclage à une échelle industrielle. La forte implication de la France et de l'Europe dans ce dossier doit se poursuivre. Il serait notamment souhaitable qu'elles participent financièrement au financement du développement d'un nouveau type de réacteur, (le GT - MHR ou Gas Turbine Modular Helium Reactor) susceptible de brûler des quantités supérieures de plutonium que ne le permettent les technologies existantes61. A l'heure actuelle, seuls les Russes et les Américains se sont mis d'accord pour financer le développement de ce réacteur sur six ans, soit 320 millions de dollars au total, et attendent du Japon et de l'Europe une participation de 25 % chacun, soit 10 à 15 millions de dollars par an. Ainsi, le Congrès américain a approuvé l'inscription, pour les années 2000-2004, de 8 millions de dollars pour ce projet. On rappellera en outre qu'en février 2000, la Russie et les Etats-Unis ont signé un accord par lequel la Russie s'est engagée à cesser le retraitement du combustible usagé de ses réacteurs civils en plutonium, en échange de quoi les Etats-Unis ont accru leur aide à la protection des matières nucléaires et à la reconversion des scientifiques russes de 100 millions de dollars. _ Prévenir la fuite des cerveaux Le principal outil destiné à reconvertir les scientifiques qui étaient impliqués dans les programmes d'armes de destruction massive soviétiques - nucléaires, chimiques ou biologiques - est le Centre international de science et de technologie (ISTC) de Moscou. Créé en novembre 1992 par un accord international signé par la Russie, le Japon, les Etats-Unis et l'Union européenne, ce centre a pour objectif de donner aux scientifiques issus de l'ex-URSS la possibilité de mener des programmes de recherche à des fins pacifiques. La Norvège et la Corée du Sud ont rejoint le centre depuis. Depuis le début du fonctionnement du centre, en 1994, 2 380 projets lui ont été soumis, au nombre desquels 1 040 avaient été approuvés au mois de juin 2000. 297 millions de dollars ont été engagés dans des projets, soit 133,3 millions de dollars par les Etats-Unis, 101,3 par l'Union européenne, 36 par le Japon, 1,8 par la Norvège, 1 par la Corée du Sud et 43,6 par d'autres sources (organisations internationales, entreprises privées, etc.). Plus de 400 institutions et 30 000 scientifiques ont reçu des bourses de l'ISTC. On rappellera à cet égard que le nombre de scientifiques russes susceptibles de présenter un très haut niveau de risque de prolifération nucléaire est évalué à 2 000 (plus de 10 000 dans les domaines chimique et biologique). 2. Un système qui n'est cependant pas sans failles Cinq ans après, l'optimisme qui prévalait après la prorogation indéfinie du TNP en 1995 a cédé la place à la prudence, voire, chez les plus pessimistes, à l'inquiétude, à tel point que certains s'interrogent sur l'avenir même des régimes de non-prolifération nucléaires. Il est vrai qu'après les succès enregistrés dans la première moitié de la décennie, le régime international de lutte contre la prolifération a été ébranlé en 1998 et 1999 par un certain nombre d'événements de nature et d'ampleur diverses sur lesquels on ne reviendra pas ici pour les avoir traités longuement précédemment. Sans partager les vues alarmistes de certains experts, la mission estime néanmoins nécessaire de souligner les failles d'un système qui, en dépit des résultats satisfaisants qu'il a obtenus dans la lutte contre la prolifération, est encore largement perfectible. a) Le TNP entre universalité et remise en cause _ Le TNP est-il adapté aux formes actuelles de la prolifération ? Le TNP a été conçu comme un « contrat, à la fois moral et technologique, entre les puissances nucléaires militaires et les non nucléaires : les secondes s'engagent à ne pas fabriquer la bombe et pour cela à soumettre toutes leurs installations atomiques aux inspections de l'Agence de Vienne (article III) ; en échange, les premières s'engagent à désarmer progressivement (article VI), mais aussi à transférer aux secondes toutes les installations et matières susceptibles de les aider dans leurs programmes nucléaires civils (article IV)62 ». Le TNP est donc le fruit d'une époque où existait un lien que l'on pensait indissociable entre nucléaire civil et nucléaire militaire : pour faire la bombe, il fallait d'abord passer par le civil, à l'instar de l'Inde par exemple. Or, à cette époque, très peu de pays se lançaient dans « l'aventure difficile et coûteuse de l'énergie électronucléaire63 ». Le premier choc pétrolier changea radicalement la situation : les pays industrialisés se lancèrent dans des programmes nucléaires extrêmement ambitieux, tandis que, profitant de cette vague nucléaire au Nord, un certain nombre d'Etats du Sud se lançaient dans cette même voie, le plus souvent avec des objectifs à la fois civils et militaires. Ils ne faisaient après tout que s'inscrire dans la philosophie libre-échangiste inscrite au c_ur du TNP et du fonctionnement de l'AIEA, elle-même inspirée du plan Eisenhower « Atom for peace » de 1953, fruit d'un temps où énergie atomique et développement étaient conceptuellement liés. Les Etats-Unis revinrent alors, sous Carter, sur cette politique d'ouverture, alarmés tant par l'explosion indienne de 1974 que par la multiplication de contrats de grande envergure entre des fournisseurs européens et des pays « sensibles » tels que le Pakistan, le Brésil, l'Argentine, l'Iran ou la Corée. Les considérations industrielles n'étaient pas absentes non plus... D'où l'adoption, en 1978, par le Congrès américain, de la loi sur la non-prolifération (Non Nuclear Proliferation Act), introduisant le concept de « garanties intégrales » comme condition sine qua non de toute exportation nucléaire vers un pays donné, signataire ou non du TNP et interdisant l'accès au cycle du combustible (vente d'une centrale, enrichissement et retraitement). Dans de telles conditions par conséquent s'est opérée une véritable déconnexion entre le nucléaire civil et militaire : ainsi, l'ensemble des verrous posés par les Etats-Unis et les pays industrialisés ont « conduit les proliférateurs potentiels à rechercher 1) la militarisation de leurs programmes nucléaires (au lieu de poursuivre des programmes civils trop coûteux, trop visibles et trop complexes) et 2) la clandestinité dans l'acquisition, ou le développement sur place, d'installations proprement militaires. Ainsi, l'Irak, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, par exemple, travaillent à la bombe, mais par le biais de programmes clandestins qui échappent précisément aux règles d'exportations actuelles conçues pour le cycle civil. Il en résulte que le phénomène de la prolifération est devenu de plus en plus diffus, clandestin, et moins facile à maîtriser : l'accession à la capacité nucléaire se prépare dorénavant non plus à partir du détournement du cycle du combustible civil à des fins militaires, comme on le craignait dans les années 1960 et 1970, mais par un véritable détournement du système de contrôle du TNP et de l'AIEA, par des pays qui peuvent parfaitement se prévaloir de leur adhésion au traité64 ». Dans ces conditions, ni le TNP ni les contrôles de l'AIEA, y compris leur version « 93 + 2 », ne répondent au problème, qui est aujourd'hui celui de la détection d'installations militaires de petite taille. D'un autre côté, le développement de l'énergie nucléaire, dont il manquera 30 % eu égard aux besoins de la population de 2040, est brimé... Des solutions nouvelles restent donc à mettre en _uvre pour lutter contre le « deuxième âge » de la prolifération nucléaire. _ La conférence d'examen du printemps 2000 : des inquiétudes apaisées Contrairement aux craintes de analystes, qui estimaient à 50 % les chances de succès de la conférence d'examen du TNP du printemps 2000, celle-ci s'est soldée par un résultat positif, marqué notamment par l'« engagement sans équivoque » des cinq puissances nucléaires officielles d'éliminer les quelque 35 000 armes nucléaires qu'elles détiennent. Certes, elles ont refusé d'adopter un calendrier mais se sont engagées sur des mesures concrètes de désarmement comme la réduction de leurs arsenaux, l'élimination des armes tactiques et la baisse du niveau d'alerte de leurs missiles. Ce succès était nécessaire : la question de la mise en _uvre par les EDAN des dispositions relatives au désarmement contenues dans l'article VI du TNP et rappelées dans les principes et objectifs de 1995, était devenue, dans les années récentes, un point d'achoppement majeur avec les autres Etats parties au TNP. Force est de reconnaître en effet que c'est un message pour le moins brouillé qu'ont envoyé les deux grandes puissances nucléaires au cours des dernières années. Or, l'absence de cohésion des EDAN, voire les tensions entre eux, met en péril la pérennité des dispositifs internationaux de lutte contre la prolifération. D'abord parce que la Grande-Bretagne, la Russie et les Etats-Unis, étant les Etats dépositaires du TNP, ont à ce titre la responsabilité de convoquer des réunions formelles ou informelles des Etats parties ayant pour objectif la mise en _uvre du traité. En outre, les cinq Etats dotés de l'arme nucléaire, ainsi que les autres fournisseurs les plus importants de matériaux et de technologies nucléaires et balistiques (Australie, Belgique, Canada, Allemagne, Japon, Afrique du Sud, ...) ont également une responsabilité importante dans la mise en _uvre de règles de contrôle à l'exportation, dont l'efficacité repose sur leur bonne coopération. Par conséquent, tout événement ou décision de nature à remettre en cause les bonnes relations de travail entre ces pays est susceptible de menacer le régime du TNP. Plus encore, il faut rappeler que le TNP est fondé sur un compromis entre les Etats qui renoncent à se doter de l'arme atomique contre l'assurance des Etats nucléaires de poursuivre de bonne foi les négociations sur les mesures mettant fin à la course aux armements et aboutissant au désarmement nucléaire. En bref, le TNP est fondé sur une inégalité théoriquement temporaire. Dès lors que ces négociations, dont l'obligation est posée par le traité lui-même, sont bloquées ou même stoppées, les Etats non nucléaires peuvent s'estimer en droit de faire valoir que les cinq puissances nucléaires ne respectent pas leur engagement. Cet argument a été avancé notamment lors de la Commission préparatoire au TNP de 1999, au cours de laquelle 44 Etats non nucléaires, dont les huit pays fondateurs de la coalition « du nouvel agenda » (New Agenda Coalition)65, ont déclaré que « un ordre mondial par lequel un groupe de cinq Etats peut indéfiniment posséder des armes nucléaires pendant que 181 Etats se refusent à en acquérir conformément au traité auquel ils sont parties n'est pas acceptable ». Cet argument a été développé de longue date par le mouvement des non-alignés. La grande différence aujourd'hui est que des pays d'Europe occidentale, tels que l'Irlande, la Suède, la Suisse ou encore des pays alliés des Etats-Unis non européens (Brésil, Mexique, Nouvelle-Zélande, Philippines, ...) ont rejoint cette coalition. Cette déclaration souligne à quel point de bonnes relations entre les cinq EDAN, en bref leur cohésion, sont déterminantes pour l'efficacité et la crédibilité du régime de non-prolifération nucléaire66. _ L'embarrassante question du statut de l'Inde et du Pakistan Le TNP a, pour l'heure, surmonté la contestation d'une partie de ses membres. Mais il reste soumis à un défi majeur, venu de l'extérieur : l'accession de facto de l'Inde et du Pakistan au rang d'Etat nucléaire. Aux termes de l'article IX du TNP, un EDAN est un Etat qui a fabriqué ou fait exploser une arme nucléaire ou tout autre engin nucléaire avant le 1er janvier 1967. Le statut d'EDAN ne peut donc être reconnu ni à l'Inde, ni au Pakistan. Pour autant, il est peu probable, à brève échéance, que ces deux Etats signent le TNP en tant qu'ENDAN. Restent les faits : comme l'a fait remarquer le ministre des Affaires étrangères indien, Jasjit Singh, les armes nucléaires en Asie du Sud sont « une réalité qui ne peut être ni niée ni écartée ». De fait, le non-événement juridique que représente pour le TNP la nucléarisation officielle du sous-continent indien - étant donné que ni l'un ni l'autre n'ont violé quelque engagement que ce soit, n'étant membres du TNP, ni du TICE ou du PTBT - n'en pose pas moins une question essentielle, celle du statut futur de l'Inde et du Pakistan au regard de l'arme nucléaire. Il n'est pas imaginable en effet de renoncer à intégrer ces pays dans les mécanismes de lutte contre la prolifération nucléaire qui, par essence, doit être globale. La communauté internationale se trouve donc confrontée à un double dilemme : - comment pousser les deux pays à coopérer aux efforts internationaux de non-prolifération sans pour autant légitimer leur nucléarisation, sous peine de miner plus encore les régimes de non-prolifération ? - comment réduire les risques liés à l'existence des arsenaux nucléaires sans pour autant aider à leur renforcement et leur développement ? Le danger nucléaire dans le sous-continent indien n'est pas nouveau. Reste aujourd'hui à inventer les moyens de le maîtriser. Et c'est là que le bât blesse : l'absence de consensus de la communauté internationale sur l'attitude à adopter après les essais de 1998 a révélé son embarras profond devant une situation inédite - et pourtant pas totalement imprévisible. Certes, la condamnation de ces essais a été quasi unanime : cent cinquante-deux Etats, ainsi que de très nombreuses organisations internationales (G8, UE, l'Organisation des Etats américains, le Conseil de coopération du Golfe...) ont fait officiellement part de leur désaccord avec le choix de l'Inde et du Pakistan. En outre, une résolution très ferme a été adoptée par le Conseil de sécurité, le 6 juin 1998, qui exige de l'Inde et du Pakistan qu'ils ne conduisent pas de tests supplémentaires. La résolution n° 1172 énumère par ailleurs une série de principes susceptibles de restaurer la stabilité et de ramener les deux pays dans les régimes de non-prolifération. Les deux pays sont instamment priés de reprendre le dialogue, notamment sur le Cachemire identifié comme l'une des causes clés de leurs tensions. Dans le domaine nucléaire, il leur est demandé de cesser de développer leurs armes, de cesser la production de matières fissiles et de participer aux négociations sur le traité d'interdiction de la production de matières fissiles, de ne pas adapter leurs engins nucléaires à des vecteurs et de ne pas déployer leurs armes. La résolution rejette enfin explicitement les revendications de l'Inde et du Pakistan d'être reconnus comme des puissances nucléaires. Un groupe de travail rassemblant les responsables de nombreux pays est créé afin de coordonner les positions de la communauté internationale. Cependant, dès lors qu'il s'est agi de définir une attitude concrète vis-à-vis des deux pays, le front uni des membres du TNP s'est fissuré. Seuls quatorze pays ont adopté des mesures spécifiques : ce sont les Etats-Unis qui sont allés le plus loin en annonçant, le 16 juin, une série de sanctions prises sur la base de l'amendement Glenn à la loi sur le contrôle des exportations d'armement. Ces sanctions recouvraient : - l'arrêt de l'aide au développement, sauf pour motif humanitaire ; - la suppression des ventes et des livraisons d'équipements militaires ; - l'arrêt des garanties de crédits ; - le report des prêts par les institutions financières internationales, en coopération avec d'autres pays ; - l'interdiction aux banques américaines de consentir des prêts ou crédits à des entités gouvernementales indiennes ou pakistanaises ; - le durcissement des contrôles à l'exportation sur les biens à double usage. La politique des sanctions n'a toutefois pas été sans susciter des critiques : la Russie déclara que la diplomatie, non la coercition, était efficace ; la France eut une réaction semblable et refusa de s'associer aux sanctions, privilégiant tout au contraire le dialogue. Sous-jacente était la crainte d'un effet contre-productif des sanctions et, de fait, en Inde comme au Pakistan, les réactions internationales ne firent que renforcer le soutien de l'opinion aux essais. En outre, dans le cas du Pakistan, déjà en situation de quasi-faillite, les sanctions ont presque conduit le pays au chaos. Enfin, la prise de sanctions posait également la question de leur levée, en un mot d'une stratégie de sortie : or, il était peu probable que les exigences posées par la communauté internationale trouvent rapidement un écho. Pour reprendre l'expression de Hillary Synnott 67, le génie était sorti de la bouteille et aucune force ne pouvait l'y faire entrer à nouveau. D'où la victoire progressive de l'approche pragmatique prônée d'emblée par la France : dès la fin de l'année 1998, le Congrès américain adoptait une loi (India-Pakistan Relief Act ou amendement Brownback) allégeant les sanctions pour un an, mesure reconduite en juin 1999. Cette approche pragmatique incluait également le dialogue et la reconnaissance implicite que ni l'Inde ni le Pakistan ne signeraient pas le TNP dans un futur proche. La France continua la politique de réchauffement de ses relations avec l'Inde, qu'elle avait mise en _uvre avant les essais, avec la visite du Président Jacques Chirac dans ce pays en janvier 1998 et dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. Aujourd'hui, la politique des Etats membres du Conseil de sécurité vis-à-vis de l'Inde et du Pakistan s'articule autour de cinq thèmes : - encourager la signature et la ratification du TICE par les deux pays ; - obtenir l'arrêt de la production de matières fissiles ; - limiter le développement des missiles et avions susceptibles de porter l'arme nucléaire ; - encourager l'Inde et le Pakistan à resserrer leurs contrôles à l'exportation ; - encourager un dialogue mutuel et l'adoption de mesures de confiance. De leur côté, l'Inde et le Pakistan se sont également engagés dans une voie plus pragmatique. Les dirigeants des deux pays acceptèrent de participer aux négociations sur le cut off et affirment travailler à l'émergence d'un consensus national sur le TICE. A ce jour néanmoins, il est difficile d'identifier les voies permettant une normalisation du statut de l'Inde et du Pakistan. Dès lors que l'application de la résolution n° 1172 paraît difficile, peut-on établir un dialogue sans mettre à mal à terme le régime de non-prolifération ? Quelques pistes apparaissent déjà toutefois : - la présence en Inde et au Pakistan de réacteurs civils peu sûrs et peu efficaces pourrait être un premier biais de nouer un dialogue sur le nucléaire : un accord d'assistance pour diminuer les risques d'accident serait de l'intérêt de tous et pourrait ouvrir la voie à d'autres progrès. Entre le souhait d'éliminer les armes nucléaires du sous-continent indien et le besoin de s'assurer du caractère sûr de l'arsenal existant, il faut trouver la voie médiane et éviter les approches doctrinales ; - il est urgent par conséquent d'élaborer les mécanismes d'un dialogue ou d'une dissuasion à plus large échelle qui manquent cruellement à ce jour. La constitution d'une architecture de sécurité asiatique est nécessaire, alors que n'existe pas de forum de dissuasion adapté. A ce titre, le rôle de la Chine est crucial et nul doute que les soupçons larvés et permanents à l'égard d'une Chine pourvoyeuse de technologies ne sont pas de nature à créer une base favorable ; - en outre, l'Inde et le Pakistan doivent tous deux être plus profondément impliqués dans les régimes internationaux de maîtrise des armements, sans pour autant les saper. La signature et la ratification du TICE pourraient représenter un bon moyen pour eux de réaffirmer leur engagement en faveur de la maîtrise des armements, sur lequel les essais ont pu jeter le doute. Il est clair toutefois que ce traité rassemble contre lui une majorité d'opposants en Inde, tandis que le Pakistan lie sa signature à celle de l'Inde. Vos rapporteurs ont pu constater sur place, en entendant s'exprimer les acteurs de la vie politique ou les membres de la communauté stratégique, que les assurances données par le Premier Ministre indien aux membres de l'Union européenne à Lisbonne, en juillet dernier, sur la signature du TICE par l'Inde nécessiteraient, pour se concrétiser, un gros travail pédagogique du gouvernement indien. Il est vrai que la question de la ratification du TICE par ces deux pays rejoint le problème plus global de l'avenir même de ce traité. De même, l'Inde et le Pakistan trouvent dans les atermoiements de la communauté internationale sur la conclusion d'un traité d'interdiction de la production des matières fissiles (TIPMF ou cut-off) un excellent prétexte. Même si, en septembre 1999, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de participer aux négociations sur ce traité, les conditions posées par chacun d'eux à leur soutien à ce traité augurent mal de l'avenir : craignant que les stocks de plutonium indiens obtenus par retraitement ne dépassent ses propres stocks d'uranium enrichi, le Pakistan insiste pour que le cut-off prenne en compte les stocks de matières fissiles existants, condition que New Delhi rejette totalement. Quant aux régimes de contrôle à l'exportation, dont ils étaient plutôt la cible, aucun des deux pays n'en est membre. La France, qui préside actuellement le groupe des fournisseurs nucléaires, travaille cependant activement aux moyens d'y intégrer l'Inde. Reste la question fondamentale : peut-on envisager un jour de voir l'Inde et le Pakistan adhérer au TNP ? En 1984, Michael Wilmshurt, alors à la tête de la délégation britannique de l'AIEA, avait examiné la possibilité d'amender le TNP en créant un statut intermédiaire susceptible d'englober les pays non-signataires, comportant notamment l'interdiction de transférer ou de recevoir des dispositifs explosifs nucléaires et l'acceptation des garanties de l'AIEA sur toutes les activités pacifiques. Ce statut aurait pu s'appliquer à tous les pays ayant le potentiel de fabriquer des armes nucléaires. Pour l'heure cependant, la question n'est pas posée. La mission estime qu'il y a pourtant là un vrai sujet de débat, qui restera attaché pour longtemps à toute réflexion sur l'avenir et la portée du TNP. b) La laborieuse mise en place du programme « 93 + 2 » · Un bilan décevant Le Programme « 93 + 2 » a été conçu à l'origine pour les Etats ayant des Accords de garanties généralisées avec l'Agence. Il est cependant très vite apparu qu'il pourrait s'appliquer utilement aux Etats dotés d'armes nucléaires et aux Etats ayant souscrit des accords de garanties partielles. Dix-sept protocoles additionnels sont aujourd'hui entrés en vigueur. Quarante-neuf ont été signés et sont en cours de ratification68. - Les Etats ayant des Accords de garanties généralisées Les neuf protocoles en vigueur le sont dans des Etats ayant des accords de garanties généralisées avec l'AIEA. Ce résultat est appréciable mais encore décevant. Pour être véritablement efficace, le protocole additionnel devrait être en vigueur dans les régions les plus sensibles du point de vue de la prolifération nucléaire, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Or, au Moyen-Orient, la Jordanie est le seul Etat de la région à avoir conclu un accord. Des démarches ont par ailleurs été effectuées auprès des autorités iraniennes, afin de les inciter à signer un accord « 93 + 2 ». Cette signature pourrait être comprise comme un signe positif permettant de relancer une éventuelle coopération dans le domaine nucléaire civil. - Les Etats dotés d'armes nucléaires Dès 1997, des protocoles additionnels aux Accords de garanties conclus avec le Royaume-Uni et avec la France ont été soumis à l'examen du Conseil des Gouverneurs. Chacun de ces projets de protocole additionnel contenait celles des mesures prévues dans le modèle de protocole dont les autorités françaises (ou britanniques) jugeaient qu'elles pouvaient contribuer à l'objectif de non-prolifération tout en étant compatibles avec les obligations qui incombent à la France (ou au Royaume-Uni) en vertu de l'article 1er du TNP. A la suite de cette procédure, deux protocoles additionnels ont été signés avec l'AIEA le 22 septembre 1998, conjointement avec les autres membres de l'Union européenne. Les États-Unis ont conclu un accord le 6 décembre de la même année. Les procédures de ratification sont en cours. S'agissant de la France, elles devraient pouvoir aboutir dans le courant de l'année 2001. - Les Etats sous Accords de garanties partielles (Etats du seuil) Si Cuba envisage de conclure un Protocole additionnel, l'Inde et le Pakistan en revanche continuent d'estimer que les mesures prévues dans le modèle de protocole sont uniquement applicables aux Etats ayant des Accords de garanties conclus dans le cadre du TNP. L'Inde a malgré tout accepté des visites de l'AIEA dans des installations qui ne sont pas sous garanties. S'il ne s'agissait que de contrôles au titre de la sûreté nucléaire, ce geste n'en constitue pas moins un premier pas en avant. · La question cruciale des tricheurs du TNP Le programme de renforcement des garanties mis en _uvre par l'AIEA constitue un gage essentiel du renforcement du régime de non-prolifération. Au même titre que les autres instruments de non-prolifération, il mérite donc d'être étendu le plus largement possible. Or, comme on vient de le voir, le bilan de la mise en _uvre de ces accords est décevant : 53 accords ont été signés à ce jour, mais neuf seulement ont été ratifiés. Or, il faut rappeler que le programme « 93 + 2 » est né du constat des lacunes du contrôle de l'AIEA et représente la principale solution apportée à la question des tricheurs du TNP. Tant que la mise en _uvre de ce programme est incomplète, les solutions offertes par le TNP et l'AIEA ne peuvent donc être que partielles dans la mesure où, tant qu'aucune preuve n'est donnée de la violation d'engagements internationaux, les contrôles réalisés par l'AIEA légitiment l'importation de technologies nucléaires à des fins pacifiques. On rappellera en effet qu'aux termes de l'article V du TNP, les Etats ont le droit d'importer des réacteurs nucléaires et un nombre substantiel de technologies nucléaires, aussi longtemps qu'ils autorisent les inspections de l'AIEA dans les installations déclarées. Dans la mesure où les autres installations ne font pas l'objet d'inspections, le certificat délivré par l'AIEA n'est donc en rien un certificat de bonne conduite en matière de prolifération. L'Irak a sur ce point donné un cours magistral à la communauté internationale. De la même façon, la Corée du Nord a montré qu'un pays pouvait parfaitement respecter les garanties de régime de non-prolifération dans ses achats de réacteurs et pouvait, une fois l'achèvement des réacteurs, rejeter les garanties de l'AIEA. En conséquence, le risque demeure de voir le TNP et l'AIEA être utilisés comme outils de légitimation d'une politique d'ambiguïté. Conscients des critiques portées contre le régime actuel, et des limites du système, les gouverneurs de l'AIEA ont proposé en mai 1997 d'autoriser l'AIEA à inspecter toutes les installations des pays membres du TNP, déclarées ou non. Actuellement, en effet, les non-signataires du TNP, loin d'être pénalisés par leur refus d'adhérer au traité, peuvent continuer à acquérir les mêmes installations que les signataires, mais avec des conditions de contrôle bien moins contraignantes. Afin d'être réellement efficaces, ces inspections devraient s'appuyer sur une coopération internationale beaucoup plus élaborée, s'agissant notamment des informations relatives aux exportations de technologies à double usage. c) Le TICE ou le traité de Versailles du désarmement Le dispositif de surveillance des essais nucléaires, qui se met progressivement en place dans le cadre du traité sur l'interdiction totale des essais (TICE), participe également de l'efficacité de ce dispositif de surveillance international. Les Etats-Unis poursuivent des essais sous-critiques69, dans le cadre autorisé par le traité, afin de maîtriser le vieillissement de leurs armes : ces essais représentent un élément important de leur programme de simulation. Les Russes affirment qu'ils procèdent au même type d'expériences en Nouvelle-Zemble : il n'existe à ce jour pas d'indice indiquant le contraire. Or, il faut savoir qu'avec 350 stations internationales - dont 160 sismiques - et autant de stations nationales, essentiellement françaises et américaines, auxquelles il faut ajouter l'observation par satellite, il est extrêmement difficile de tricher avec le TICE. On relèvera avec intérêt que l'Inde a dépensé de gros moyens pour se protéger de ces différents systèmes de surveillance. Reste que l'actualité du TICE ne porte pas sur sa mise en _uvre, mais sur son avenir. Le 24 janvier 2000, le Ministre indien de la Défense, M. George Fernandes, déclarait que le traité d'interdiction complète des essais (TICE) était « dans le coma ». De fait, le refus du Sénat américain de ratifier ce traité le 13 octobre 1999 lui a porté un sérieux coup. Comme l'a indiqué le ministre de la Défense, M. Alain Richard, le 21 octobre 1999, « la décision qui vient d'être prise par le Sénat américain refusant la ratification du TICE représente un coup d'arrêt très préoccupant à un processus de désarmement et de contrôle de la prolifération dans lequel la France, associée heureusement à beaucoup d'Etats amis, a joué un rôle moteur ». Dans la lettre ouverte qu'ils avaient publiée dans le New York Times le 9 octobre 1999, le Président de la République, le Premier ministre britannique et le Chancelier allemand avaient insisté sur les enjeux d'une application effective du TICE : barrière supplémentaire opposée à la prolifération nucléaire, en ce qu'il empêche d'éventuels proliférants de s'assurer de l'efficacité de leurs armes, ce traité accroît la sécurité de l'ensemble des Etats. D'autant plus qu'il met en place un système de détection fiable, contrairement à ce qu'ont pu en dire ses détracteurs. On ne développera pas ici les raisons de politique intérieure qui ont conduit les sénateurs américains à ce vote, même s'il faut souligner avec force l'incroyable impréparation dont a fait preuve l'Administration Clinton dans la soumission de cet texte au Sénat, alors que le poids de ceux qu'on appelle les « faucons » était bien connu. Notamment, il est pour le moins surprenant que la nomination d'une personnalité chargée de coordonner l'action de l'administration sur ce traité avec le Sénat, en l'occurrence le Général Shalikashvili, ancien SACEUR et ancien Chef d'Etat-major de l'armée, soit intervenue après le vote, alors que cette procédure est habituelle pour les traités qui tiennent particulièrement à c_ur à la Maison Blanche. On rappellera à cet égard qu'au soir de la signature du traité, le 24 septembre 1996, le Président Clinton saluait le TICE comme « la récompense la plus longtemps recherchée et pour laquelle les combats les plus ardus avaient été menés dans l'histoire de la maîtrise des armements »... Certes, la diplomatie américaine s'est employée depuis à rassurer la communauté internationale. Dès le soir du vote du Sénat, le Président Clinton s'adressait à la nation et au monde entier pour assurer que le vote du Sénat n'engageait que lui-même ( !) et souligner que l'Administration se considérait toujours liée par ce traité. En mars 2000, le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright répétait que le TICE était « trop important pour être abandonné ». Le vote du Sénat américain a quelque peu éclipsé les résultats de la conférence qui s'est tenue à Vienne du 6 au 9 octobre 1999 dans le cadre de l'article XIV, qui prévoyait qu'à partir de trois ans après la signature du traité, les Etats parties se réuniraient pour faire le bilan des signatures et des ratifications, celles de 44 Etats nommément désignés étant nécessaires à l'entrée en vigueur du traité. De fait, si l'augmentation du nombre des signatures et des ratifications (67 au 28 novembre 2000) est satisfaisante70, les Etats qui manquent aujourd'hui à l'appel sont précisément ceux dont la signature et la ratification sont nécessaires à l'entrée en vigueur du traité. Ainsi, trois des 44 Etats n'ont toujours pas signé le traité (l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord), tandis que sept ne l'ont pas encore ratifié (Etats-Unis, Russie, Chine, Iran, Israël, Egypte et Algérie). Dans ces conditions, la conférence de Vienne n'a pu que répéter l'attachement de la communauté internationale au traité, sans aller plus loin. Au-delà des jugements, à juste titre consternés, émis par les responsables politiques et la presse internationale en dehors - et même au sein - des Etats-Unis, qu'en est-il de la mise en _uvre des procédures prévues par le traité ? De manière générale, les différents instruments prévus par le traité se mettent en place de manière laborieuse : faut-il y voir le résultat du vote du Sénat, qui a sans conteste cassé la dynamique réelle qui existait autour de ce traité ? Sans doute, mais il semble également que l'ampleur de la tâche ait été notoirement sous-estimée. Notamment, la constitution d'un réseau de 321 stations et de 16 laboratoires sur l'ensemble du globe est plus lente que prévu : à la fin de l'année 1999, sept stations conformes aux normes fixées par l'OTICE étaient reliées au centre international de données de Vienne, tandis que la mise à niveau des installations scientifiques préexistantes était toujours en cours. En revanche, l'installation des stations françaises s'effectue à un rythme conforme aux prévisions. Le même retard doit être noté s'agissant de la mise en place du système global de communications. Néanmoins, ces retards n'hypothèquent en rien l'efficacité théorique du dispositif qui sera mis en place, contrairement à ce qu'ont pu prétendre des responsables politiques et des scientifiques américains. d) L'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires : des perspectives peu favorables La négociation d'un traité d'interdiction de la production des matières fissiles figurait au nombre des engagements pris à l'issue de la conférence de prorogation du TNP en 1995. A l'été 1997, les huit pays les plus riches réunis à Denver réaffirmaient leur « engagement de commencer immédiatement et de conclure rapidement la négociation d'une convention interdisant la production de matières fissiles ». Force est de constater, cinq ans après, que rien n'est encore sorti de ces négociations. C'est là un résultat particulièrement préoccupant dans la mesure où l'arrêt de la production des matières fissiles constitue l'un des verrous essentiels de la prolifération nucléaire. A ce jour, les principales divergences constatées concernent la délimitation du champ de négociations, un certain nombre de pays, dont l'Egypte et le Pakistan, souhaitant inclure dans le mandat de négociation non seulement l'interdiction de la production future de matières fissiles, mais également l'instauration d'un contrôle international sur les stocks existants. Nul besoin de souligner que le premier vise Israël et le second l'Inde. Cette proposition se heurte au refus catégorique des EDAN. Enfin, il apparaît que ni ces derniers, ni les trois Etats non membres du TNP disposant d'armes nucléaires ne sont désireux de voir se mettre en place des mécanismes d'inspection intrusifs. e) Le traitement du nucléaire russe : un bilan mitigé Le chaos nucléaire ne s'est pas produit en Russie. Il est néanmoins difficile d'évaluer précisément l'impact des programmes mis en _uvre depuis 1991. D'après une étude récente du Centre de Monterey, lancée alors qu'aux Etats-Unis, les programmes de coopération russo-américains qui représentent une dépense annuelle de 400 millions71 de dollars suscitent de plus en plus de critiques (fonds profitant insuffisamment aux entreprises américaines ou, à l'inverse, aux sites russes, inefficacité, aide à la modernisation de l'armement russe... ), il est indéniable qu'un retard important a été pris sur un certain nombre d'aspects du programme. Or, celui-ci ne s'explique pas seulement par l'ampleur de la tâche : le haut niveau de secret, le fait que la destruction des matériaux soit faite par les Russes eux-mêmes, avec des équipements américains, et non par des cocontractants américains, ainsi que l'opposition fréquente de la population locale à l'implantation d'infrastructures d'élimination des armes sont ainsi mis en cause par les Etats-Unis. Par exemple, la mise en place des infrastructures nécessaires à la destruction du combustible solide ou liquide des missiles a pris deux ans de retard, alors que, dans le même temps, la destruction de missiles s'est poursuivie à un rythme normal. Le même type de problème, quoique à une moindre échelle, s'est produit en Ukraine. Par ailleurs, on ne peut manquer d'être frappé par l'effet de substitution qu'a joué ce programme : alors qu'il devait, aux termes de son mandat initial, « faciliter » l'élimination des armes, il est clair qu'il en est le moteur principal, la Russie n'intervenant à titre propre que de manière subsidiaire. En matière de sécurisation des armes et des sites, on serait même tenté d'affirmer que les Etats-Unis font ce que l'URSS n'a jamais fait. Mais au-delà des retards et de la dénaturation du rôle initial de la coopération, c'est sur un aspect non traité du désarmement nucléaire que le Centre de Monterey, et notamment le docteur Nicolas Sokov, souhaitent attirer l'attention de la communauté internationale. Ce dernier souligne en effet que rien ne régit la gestion et le devenir des armes nucléaires tactiques, alors que les risques d'emploi non autorisé de ce type d'armes sont beaucoup plus importants et probables que pour les armes stratégiques, du fait de l'absence de procédures rigoureuses entourant leur stockage et leur utilisation. Or, même si les engagements unilatéraux des présidents Bush et Gorbatchev en septembre et octobre 1991 ont conduit à une forte réduction du nombre d'armes tactiques (on estime aujourd'hui que 14 à 15 000 armes tactiques des 22 000 initiales ont été démantelées par chacun des protagonistes), il resterait toujours 3 000 armes nucléaires tactiques russes déployées, c'est-à-dire stockées dans des installations placées à proximité des bases aériennes, le reste étant stocké ailleurs. The Bulletin of Atomic Scientists les estimait à 2 200, dont la moitié en Europe, au dernier trimestre de 1996. En l'absence d'échanges de données et plus encore de système de vérification, il est en fait impossible de savoir exactement combien la Russie possède d'armes tactiques et, au sein de cette catégorie, combien sont effectivement déployées. Certes, des échanges d'informations ont pu avoir lieu. A partir de 1997 notamment, le Conseil permanent OTAN-Russie (Nato-Russia Permanent Joint Council) est devenu un forum d'échanges privilégié. Même dans cette enceinte toutefois, les parties n'évoquaient que la part d'armes éliminées ou stockées de manière centralisée, mais jamais de chiffres en valeur absolue. Le bilan du régime de 1991 est riche d'enseignements théoriques sur les limites de l'action unilatérale comme modalité de désarmement : il rappelle que l'enthousiasme qui préside généralement à ce type d'action est un signe de désespoir autant que d'optimisme. De fait, les opposants au désarmement sont généralement les plus fervents partisans de l'unilatéralisme et les plus farouches opposants au principe même d'un traité juridiquement contraignant. Il souligne, par contraste, la nécessité de compléter les mesures unilatérales par des engagements juridiquement contraignants. Faute de cet élément, le régime de 1991, loin de rester comme le fondement de la suppression des armes nucléaires tactiques, devrait rester dans l'histoire comme une occasion manquée. En pratique, la mission estime qu'il est urgent de prendre des mesures pour sauver le régime de 1991. Un véritable travail pédagogique reste à faire dans ce domaine, même s'il est positif de constater que cette question a été soulevée à la conférence préparatoire à la conférence d'examen du TNP en 1999. Techniquement, trois axes d'action sont envisageables : - dans une première étape, il serait souhaitable, tout en conservant au régime actuel son caractère souple, de mettre en place un certain nombre d'obligations vérifiables qui lieraient chacun des deux pays. Un régime formel pourrait être ensuite négocié ; - ce régime pourrait inclure l'interdiction de déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire des nouveaux Etats membres de l'OTAN d'une part, en Biélorussie et en Ukraine d'autre part, ce qui rendrait de facto impossible tout conflit impliquant ce type d'armement et créerait une zone exempte d'armes nucléaires tactiques. Par la même occasion, le risque de provocation ou d'incident imprévu serait exclu. Il ne faut pas se cacher que la vérification des mesures prises dans le cadre d'un régime formel sera extrêmement difficile et ne ressemblera en rien à celles qui existent dans le cadre de START ou même du traité FNI. Notamment, le caractère dual des vecteurs de lancement est source de complexité ; - il faudrait enfin prévoir une interdiction d'exportation de ce type d'armement. Jusqu'alors, aucun cas d'exportation illicite d'armes tactiques n'a été enregistré, mais le risque est là. B. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION CHIMIQUE : UN DISPOSITIF TECHNIQUE ÉLABORÉ QUI DOIT ENCORE FAIRE SES PREUVES L'utilisation des armes chimiques pendant la guerre Iran-Irak a profondément choqué la communauté internationale, surtout après que l'Irak eut utilisé les armes chimiques contre sa propre minorité Shia dans le village de Halabjah. Mais, au-delà de cette émotion, la communauté internationale s'est bien gardée de passer à l'action, laissant l'Irak utiliser des armes toujours plus sophistiquées. Tout au plus, la guerre entre l'Iran et l'Irak a-t-elle suscité la création en 1985 d'un groupe de pays exportateurs de produits chimiques et biologiques. Le groupe australien - appellation liée au fait que ses membres se réunissent à l'ambassade d'Australie, à Paris - qui compte aujourd'hui 30 membres72, vise à limiter la dissémination des armes chimiques et biologiques par le contrôle des précurseurs chimiques, des agents et organismes biologiques et des équipements qui leur sont liés. Avec la guerre du Golfe, la perception change : en définitive, « la bombe du pauvre » semble capable de menacer aussi les pays les plus riches. Cette prise de conscience a stimulé les négociations en cours sur un traité d'interdiction de l'arme chimique. Alors que ce texte, aux dires de certains « l'accord de maîtrise des armements le plus complet jamais négocié »73, est en vigueur depuis le 29 avril 1997, quel bilan faut-il tirer de plus de trois ans de mise en _uvre ? Les réalisations sont-elles à la hauteur des espérances ? 1. La convention d'interdiction des armes chimiques : une victoire diplomatique incontestable · La longue histoire des négociations sur la réglementation des armes chimiques Les tentatives de la communauté internationale pour limiter l'utilisation des armes chimiques sont anciennes : en 1675, l'Empire et la France s'engagent à ne pas utiliser de balles empoisonnées. Deux cents ans plus tard, la Convention de Bruxelles sur les règles de la guerre interdit l'emploi des poisons et des armes empoisonnées dans la conduite des guerres. A la Haye en 1899, est signé un accord international interdisant l'utilisation de projectiles chargés de gaz. Mais c'est à la suite de l'électrochoc causé par l'utilisation des armes chimiques pendant la première guerre mondiale qu'intervient le premier traité global interdisant l'usage des armes chimiques. Cependant, si le Protocole signé à Genève en 1925 interdit l'usage des armes chimiques et bactériologiques dans le cadre d'un conflit, il n'interdit ni la production ni la détention de ces armes, pas plus qu'il ne met en place de système de vérification. C'est pourquoi la plupart des Etats signataires associent à leur ralliement au traité des réserves tenant tant au droit de répondre au chimique par le chimique qu'à celui d'utiliser l'arme chimique contre les Etats qui refusent d'adhérer au protocole. Après cet échec de la communauté internationale pour réglementer l'arme chimique, il faut attendre les années soixante pour que la commission du désarmement s'en saisisse à nouveau. Ce n'est cependant qu'en 1980, avec la création du comité spécial des armes chimiques au sein de la conférence du désarmement de Genève, que commencent véritablement les travaux sur ce qui allait devenir la Convention d'interdiction des armes chimiques. Les grandes étapes de cette négociation font apparaître le rôle moteur joué par les Etats-Unis, la Russie et la France74 : - en 1983, le comité spécial reçoit mandat d'élaborer un projet de convention ; - en avril 1984, George Bush, alors vice-Président des Etats-Unis, présente un projet d'interdiction totale des armes chimiques très intrusif ; - en août 1987, Edouard Chevarnadzé, ministre des affaires étrangères de l'URSS, déclare que l'URSS accepte le principe des inspections sur place par des inspecteurs internationaux, sans droit de refus ; - en janvier 1989, à l'initiative française, la Conférence de Paris appelle à un renforcement du protocole de Genève de 1925 et à une accélération des travaux de la Conférence de Genève ; - en juin 1990, les Présidents Bush et Gorbatchev signent à Washington un accord bilatéral sur la destruction et la non-production des armes chimiques ; - en mai 1991, les Etats-Unis renoncent au maintien d'un stock minimum d'armes chimiques prévu par l'accord de Washington ; - en septembre 1992, la Conférence du désarmement adopte par consensus le texte de la Convention d'interdiction des armes chimiques ; - le 13 janvier 1993, 130 Etats signent la Convention d'interdiction des armes chimiques75 au cours d'une cérémonie officielle à Paris. · Le dispositif de la Convention La Convention d'interdiction des armes chimiques76 représente une étape décisive de l'histoire du désarmement et répond aux objectifs constants de la France en la matière : - il s'agit d'un véritable traité de désarmement à vocation universelle ; - elle institue l'interdiction d'une catégorie entière d'armes de destruction massive ; - elle prévoit un régime de vérification efficace reposant sur des inspections de routine et sur des inspections par mise en demeure ; - enfin, elle établit un équilibre entre les droits et les obligations de tous les Etats, dans l'intérêt de toute la communauté internationale. Le principe est l'interdiction générale de toute arme chimique. La convention interdit non seulement d'utiliser - comme le fait déjà le protocole de Genève de 1925 - mais aussi de produire, d'acquérir, de stocker et de transférer des armes chimiques. Les Etats s'engagent ensuite à détruire les armes chimiques sur leur territoire et celles qu'ils ont abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie ainsi que les installations de fabrication. Chaque Etat partie s'engage enfin à ne pas utiliser d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyen de guerre. L'article II précise les termes des obligations incombant aux Etats parties. Il est précisé en particulier que le terme « arme chimique » couvre aussi bien : - les munitions mettant en _uvre des produits chimiques toxiques (définis comme des produits qui par leur action chimique sur des processus biologiques peuvent « provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort ou l'incapacité temporaire ou des dommages permanents ») ; - les matériels conçus pour utiliser ces munitions ; - mais aussi les produits chimiques toxiques eux-mêmes, ainsi que leurs précurseurs directs, « à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention -c'est-à-dire des fins civiles ou de protection - aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ». Autrement dit, un produit chimique toxique devient une arme chimique dès lors que les quantités produites cessent d'être compatibles avec un usage non interdit. Les précurseurs directs de produits chimiques toxiques sont ceux à partir desquels ont peut obtenir en une seule étape des produits chimiques toxiques. Leur assimilation aux produits chimiques toxiques est indispensable du fait de l'existence d'armes chimiques dites binaires, c'est-à-dire composées de deux produits chimiques non toxiques dont le contact va créer un produit chimique toxique. La définition choisie par la Convention pour les armes chimiques permet ainsi de faire porter le contrôle de ces armes sur la production des produits chimiques toxiques eux-mêmes. La convention établit en effet un régime global de surveillance internationale des activités non interdites, en particulier dans l'industrie chimique. Ce régime est fondé sur trois listes de classification des produits chimiques toxiques qui peuvent être utilisés en tant qu'armes chimiques ou qui en sont les précurseurs. Les inspections sont plus ou moins rigoureuses et intrusives en fonction de la toxicité des produits. - le tableau 1 regroupe les produits ayant été conçus comme armes chimiques (tels que le sarin, le tabun ou le gaz moutarde) ou qui apparaissent susceptibles d'être utilisés comme tels du fait de leur composition ou de leurs propriétés, et qui n'ont guère ou pas d'utilisation autre que la guerre chimique, ainsi que leurs précurseurs ; - le tableau 2 regroupe les produits susceptibles d'être utilisés comme armes chimiques du fait de leurs propriétés et qui ne sont pas fabriqués en grande quantité industrielle à des fins licites (pacifiques ou de protection), ainsi que leurs précurseurs ; - le tableau 3 concerne des produits de même type que ceux du tableau 2, mais qui sont fabriqués en grande quantité industrielle à des fins licites. Chaque Etat partie doit présenter à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques plusieurs déclarations, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur de la convention à son égard, dans lesquelles doivent figurer des renseignements précis sur l'emplacement et les quantités d'armes chimiques dont il est propriétaire, les armes chimiques anciennes et abandonnées, les installations de fabrication d'armes chimiques, les autres installations et les agents de lutte anti-émeute. Chaque Etat doit également fournir les plans de destruction envisagés. La convention prévoit la destruction des armes chimiques et des installations de fabrication dans un délai de dix ans, qui peut être étendu dans des cas exceptionnels jusqu'à quinze ans. De surcroît, dans certains cas, les installations de fabrication d'armes chimiques peuvent faire l'objet d'une conversion, dans des conditions très strictes. Pour garantir la réalité des destructions et éviter toute reconversion vers des activités prohibées, un régime de vérification systématique est prévu par inspection sur place et par surveillance sur les sites concernés. Chaque Etat partie doit prendre les mesures nécessaires à la bonne application de la Convention et mette en place une autorité nationale en vue d'assurer une liaison efficace avec l'organisation et les autres Etats parties. Afin de veiller à l'application de la convention et d'assurer les activités de vérification, une organisation pour l'interdiction des armes chimiques sera installée à La Haye lors de l'entrée en vigueur de la convention. Elle comporte les trois organes suivants : - la conférence des Etats parties : organe principal de l'organisation, elle est composée de tous les Etats membres et se réunit tous les ans ; - le conseil exécutif : organe exécutif de l'organisation, il est composé de quarante et un membres, élus par la conférence pour une période de deux ans, suivant le principe de rotation au sein de cinq groupes géographiques et la prise en compte de l'importance de l'industrie chimique et des intérêts politiques et de sécurité de chaque Etat membre. La France y est assurée d'un siège permanent ; - le secrétariat technique fournit un appui administratif et technique aux deux premiers organes et aux Etats parties. Il assure également l'organisation des inspections prévues dans la convention par le biais d'un corps d'inspecteurs, composé de spécialistes agréés par les Etats parties. La convention prévoit des consultations entre Etat parties et des demandes d'éclaircissement sur toute situation jugée ambiguë ou préoccupante au regard du respect de la convention. De surcroît, chaque Etat partie peut demander une inspection par mise en demeure pour visiter toute installation ou tout emplacement, même non déclaré, donc non soumis à inspection de routine, en cas de doute sérieux sur le respect de la convention. Elle peut se dérouler tous les jours ouvrables ou non, à toute heure, de jour comme de nuit. L'inspection, qui peut débuter douze heures après sa notification par le directeur général, est conduite par une équipe d'inspecteurs internationaux. Ces inspecteurs disposent de larges pouvoirs d'investigation, y compris dans des lieux privés. Néanmoins, les Etats parties sont fondés à exiger que les données confidentielles restent protégées et que soient exclues de l'inspection les installations sensibles dès lors qu'elles sont sans rapport avec l'objet de la convention. Ce type d'inspection requiert donc une préparation minutieuse de la part des Etats parties pour éviter la divulgation d'informations sensibles. En contrepartie des obligations qu'elle impose, la convention prévoit : - un dispositif d'assistance et de protection contre les armes chimiques qui constitue une garantie contre l'emploi ou les menaces d'emploi de telles armes ; - des dispositions visant à promouvoir le commerce international, le développement technologique et la coopération économique dans le secteur de l'industrie chimique. Les Etats parties s'engagent à ne pas appliquer entre eux de restrictions qui imposeraient des limites dans ce domaine. Cette clause vise également à inciter les Etats non parties à adhérer à la convention. La convention est également assortie de mesures qui peuvent être prises à l'encontre des Etats parties qui n'en respecteraient pas les dispositions. La conférence des Etats peut, par consensus ou à la majorité des deux tiers s'il est impossible de parvenir à un consensus dans les vingt-quatre heures, décider de restreindre ou de suspendre les droits et les privilèges dont jouissent les Etats parties au titre de la convention. Si la situation est particulièrement grave, la conférence des Etats peut décider, dans les mêmes conditions, de recommander aux Etats parties des mesures collectives, voire même de saisir l'assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'O.N.U. La Convention sur les armes chimiques est le premier accord en matière de désarmement négocié au niveau multilatéral qui interdit une catégorie complète d'armes de destruction massive de manière réellement vérifiable. Après deux décennies de négociations et de préparation, elle est entrée en vigueur le 29 avril 1997 ; au 30 mai 2000, 172 Etats y étaient parties et 135 l'avaient ratifiée, dont les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran, le Japon et tous les Etats membres de l'Union européenne. Les quatre années qui se sont écoulées entre la signature et l'entrée en vigueur du traité s'expliquent techniquement par l'obligation posée par le traité de réunir 65 instruments de ratification pour qu'il puisse entrer en vigueur. Mais, comme le constate Michael Moodie, Président de l'Institut de maîtrise des armements biologiques et chimiques de Virginie, « le rythme fut toutefois considérablement ralenti par certains doutes concernant la position de quelques Etats clés à l'égard de la ratification. Les craintes étaient particulièrement élevées au sujet des Etats-Unis et de la Fédération de Russie, les deux nations disposant des plus importants stocks déclarés d'armes chimiques (respectivement 30 000 et 40 000 hommes) ». Il semble que ces craintes n'étaient pas totalement injustifiées : - dans le cas des Etats-Unis, non seulement la ratification a été particulièrement laborieuse, n'intervenant que deux jours avant l'entrée en vigueur de la Convention - il semblerait que le gouvernement ait été tout aussi négligent que pour le TICE, face à un Sénat très mal informé sur la question - mais la déclaration des installations se fait toujours attendre ; - du côté de la Russie, les législateurs ont également traîné les pieds avant de ratifier le traité, estimant, non sans raison comme nous le verrons plus tard, que la Russie n'avait pas les fonds nécessaires pour remplir les obligations inscrites dans le traité. D'où la mention, dans la résolution de ratification adoptée par la Douma, de l'indispensable aide financière que la communauté internationale doit fournir à la Russie afin de lui permettre de remplir ses engagements. a) Une mise en _uvre encore trop partielle pour évaluer l'efficacité du dispositif L'OIAC a pu mener à bien 698 inspections de mai 1997 à avril 2000, sur 340 sites, soit 461 inspections dans 140 installations spécifiquement dédiées aux armes chimiques et 237 inspections sur 200 sites industriels.77 INSPECTIONS MENÉES PAR L'OIAC DE MAI 1997 À AVRIL 2000
Pour la seule année 1999, ce sont quelque 180 inspections qui ont été conduites, soit 110 dans les installations spécifiquement dédiées aux armes chimiques et 70 dans des installations industrielles. Le tableau suivant détaille la nature des installations chimiques inspectées. TYPES D'INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES INSPECTÉES
Les installations de 24 pays ont été inspectées, dont le tableau suivant détaille la liste. On notera la double anomalie que représentent les trois inspections aux Etats-Unis et l'unique inspection en Russie au regard de l'importance de leurs stocks respectifs. LISTE DES ÉTATS AYANT ÉTÉ INSPECTÉS EN 1999
Ce premier bilan est assez encourageant dans la mesure où l'une des principales difficultés de l'application de la convention résidait dans le mécanisme des inspections et notamment la conciliation entre la recherche des infractions éventuelles et la préservation légitime des secrets de fabrication des industriels. A cet égard, la plupart des Etats ont adopté des dispositions nationales d'application de la convention destinées à préserver les intérêts industriels sans remettre en cause l'engagement de l'Etat en faveur de la convention. Dans le cas français, la loi relative à l'application de la Convention prévoit que les inspecteurs sont, de leur arrivée sur le territoire français à leur départ, escortés par des « accompagnateurs » représentants de l'Etat français. Elle donne au chef de l'équipe d'accompagnement un rôle de garant des droits de l'exploitant dans le respect de la Convention et d'intermédiaire entre l'équipe d'inspection et l'exploitant. Il revient en effet au chef de l'équipe d'accompagnement de veiller à ce que l'équipe d'inspection ait accès à l'ensemble des documents et lieux nécessaires à l'exercice de sa mission, mais aussi à ce qu'elle n'outrepasse pas celle-ci. Ainsi, le chef de l'équipe d'accompagnement veille notamment à ce que l'équipe d'inspection n'utilise les facilités offertes que pour vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits chimiques déclarés et que la nature et les quantités de produits sont conformes aux déclarations ; dans le cas de prélèvement d'échantillons, il veille à ce que les analyses ne portent que sur l'absence ou la présence de produits chimiques non déclarés inscrits sur l'un des trois tableaux. L'équipe d'accompagnement accompagne partout les inspecteurs. Certains experts estiment toutefois que plusieurs décisions de la commission préparatoire destinées à préciser les procédures de vérification et, plus récemment, de la Conférence des Etats parties, tendent à diminuer l'efficacité du régime de vérification de la Convention. Selon Jonathan Tucker, du centre de Monterey78, dans une certaine mesure, ces décisions ont bouleversé l'équilibre délicat instauré par le traité entre les droits de l'organisme de mise en _uvre de la Convention, l'OIAC, et les droits de l'Etat inspecté. Par exemple, alors que le champ d'interdiction de la Convention vise l'ensemble des composants chimiques pouvant être utilisés comme une arme, la Conférence des Etats parties a décidé que les techniques d'analyse des inspecteurs ne viseraient à détecter que les composants chimiques explicitement mentionnés par le traité. En d'autres termes, il deviendrait possible pour un Etat désireux de violer le traité de produire un composant qui ne figure pas dans la liste limitative du traité sans risquer d'être sanctionné. Le même expert note par ailleurs une tendance des Etats parties à surclassifier les données contenues dans leurs déclarations, ce qui complique, en vertu du traité, la tâche des inspecteurs. S'agissant de l'application du régime de vérification de cette Convention, il semblerait que les Etats-Unis ne montrent pas l'exemple, alors qu'ils ont été paradoxalement très actifs lors de la négociation. A ce jour, ils n'ont toujours pas soumis à l'OIAC la liste de leurs installations, en violation des dispositions du traité, ce retard s'expliquant largement par le peu d'empressement du Congrès à voter la loi d'application nationale de la Convention, nécessaire à la mise en _uvre de celle-ci. Cette attitude n'est pas sans susciter l'irritation de pays qui, comme l'Allemagne ou le Japon, possèdent des entreprises en concurrence directe avec les entreprises américaines dans le secteur chimique mais qui sont, eux, d'ores et déjà soumis aux inspections très intrusives de l'OIAC. b) Une convention pour les « bons élèves » ? Les pays non signataires restent nombreux : manquent notamment la plupart des pays de la Ligue arabe qui avaient adopté une position de principe hostile à la convention, en lien avec leur contestation du programme nucléaire militaire israélien. Ainsi, plusieurs Etats connus ou suspectés comme possédant des armes chimiques restent en dehors du dispositif, qu'il s'agisse de l'Egypte, de la Libye, de la Corée du Nord ou de la Syrie. Certains pays du Sud contestent en outre la multiplicité des instruments existants dans les domaines chimique et biologique, par référence au maintien du groupe australien. Cependant, même sans être universelle, il est indéniable que la Convention devrait favoriser le ralentissement, voire faire reculer, la prolifération chimique en isolant le petit nombre de pays qui refusent de la rejoindre, en leur limitant l'accès aux précurseurs - d'autant que, conformément au traité, depuis avril 2000, les produits du tableau II font l'objet d'une clause de non-transfert vers les pays non adhérents - et, en définitive, en servant de base à des pressions économiques et politiques sur les Etats qui s'obstinent à poursuivre sur la voie de la prolifération chimique. Reste la question du terrorisme : en tant que traité international liant des Etats souverains, la Convention n'est pas faite pour traiter le problème du terrorisme qui concerne généralement des groupes infraétatiques ou transnationaux. Néanmoins, on peut penser qu'elle pourra avoir un impact indirect, en rendant le terrorisme chimique plus complexe, donc moins attractif. c) Les armes chimiques russes : un dossier préoccupant « Eliminer l'héritage mortel de la guerre froide : les obstacles à surmonter pour parvenir au désarmement chimique de la Russie » : ce titre du rapport établi en 1998 par une équipe mixte russo-américaine79 dit tout de la difficulté que rencontre, en Russie, la mise en _uvre de la convention sur les armes chimiques. Nous retrouvons là « l'archipel toxique » évoqué précédemment, qui fait écho aux inquiétudes suscitées, dans le domaine nucléaire, par les dizaines de tonnes de plutonium excédentaires dans ce pays. Aux termes du calendrier fixé par la Convention, la Russie est supposée avoir éliminé 1 % - soit 400 tonnes - de son immense stock en avril 2000, puis, d'ici à 2002, 20 %, et la totalité en 2007, ou 2012 si elle utilise la faculté offerte par le traité de repousser de cinq ans l'échéance de la destruction totale des stocks. Or, tous les experts s'accordent à estimer que, toutes choses égales par ailleurs, cet échéancier ne pourra pas être tenu et qu'il faudra au bas mot 25 à 30 ans pour éliminer la totalité du stock russe ! Sans une aide massive de la communauté internationale, la Russie est donc incapable de mener à bien la destruction d'ici 2007 des armes chimiques qui lui ont été léguées par l'URSS, dont le coût total est évalué à 5,7 milliards de dollars sur dix à quinze ans. Certes, le cadre légal et institutionnel nécessaire est en place, la loi sur la destruction des armes chimiques ayant été adoptée par la Douma le 2 mai 1997 et le calendrier de destruction ayant été défini par un décret antérieur, du 21 mars 1996. Aux termes de celui-ci, il est prévu que les agents vésicants (gaz moutarde, lewisite...) soient détruits d'abord, notamment à cause de la détérioration rapide des citernes dans lesquelles ils sont contenus, qui représente une grande menace en termes de santé publique et d'environnement. La mise en _uvre de ces dispositions se heurte cependant à des obstacles considérables, d'abord financiers : au chiffre énorme qui vient d'être cité, il faut ajouter 330 millions de dollars par an pendant dix ans, qui représentent les coûts liés à l'action de l'OIAC et un milliard de dollars pour construire des infrastructures socio-économiques à proximité des lieux de destruction des armes. Ceci sans compter le financement des mesures de sécurité physiques des sites de stockage et de reconversion... Or, non seulement les sommes allouées par le Parlement russe à ce programme se sont révélées notoirement insuffisantes, mais 14 % de ces sommes seulement ont été dépensées de 1995 à 1997, soit moins de dix millions de dollars. La communauté internationale, et notamment les Etats-Unis et l'Union européenne, ont donc ajouté le chimique à leur coopération nucléaire avec la Russie, parfois même dans le cadre créé à cette fin. Ainsi, comme dans le domaine nucléaire, l'ISTC joue un rôle majeur dans la prévention de la « fuite des cerveaux » : on estime à 3 500 le nombre de chimistes présentant un risque élevé à cet égard. Une organisation similaire à l'ISTC a été créée en Ukraine, en 1995, le Centre pour la science et la technologie, qui finance les bourses en faveur d'ingénieurs issus de Géorgie, d'Ukraine et d'Ouzbékistan. Cet organisme est soutenu par le Canada, la Suède, l'Ukraine, les Etats-Unis et l'Union européenne. Les Etats-Unis contribuent à hauteur de 80 % du budget du CST (21,4 millions de dollars en 1998) ; l'Union européenne, qui n'a rejoint les pays fondateurs qu'en décembre 1998, a contribué à son fonctionnement, à hauteur de 3,1 millions de dollars en 1999. Les Etats-Unis ont par ailleurs financé des bourses en faveur des chimistes à hauteur de 7,55 millions de dollars entre 1994 et 1999, l'effort européen s'élevant pour sa part à 1,3 million de dollars80. S'agissant des initiatives spécifiquement américaines sur ce dossier, un autre programme, la Fondation pour la recherche et le développement civil, a été créé en 1995 pour compléter les travaux de l'ISTC, qui réunit des scientifiques américains et ceux de pays issus de l'ex-URSS. En outre, le département de l'énergie américain a mis en place son propre programme, qui a bénéficié de 126,7 millions de dollars entre 1994 et 1999. D'après un rapport très critique du General Accounting Office, seuls 37 % de ces fonds auraient toutefois bénéficié à d'anciens ingénieurs soviétiques. Au-delà de la question spécifique de la « fuite des cerveaux », les Etats-Unis ont apporté à la lutte contre la prolifération chimique en Russie jusqu'en 1998 136,5 millions de dollars dans le cadre du programme Nunn-Lugar. La mise en _uvre du programme de réduction de la menace est cependant laborieuse, notamment à cause du choix de la nationalité des cocontractants. Le Congrès américain a d'ailleurs exprimé ses doutes quant à l'efficacité de cette coopération en diminuant l'aide financière destinée au démantèlement des armes chimiques russes : en octobre 1999, il a ainsi soustrait au budget 2000 les 125 millions de dollars qui devaient être affectés à la construction d'une usine de destruction d'agents neurotoxiques, à Shushye, l'un des sept sites de stockage déclarés par la Russie. M. Georgui Mamedov, vice-ministre des affaires étrangères de la Russie, a exprimé le souhait que la France, et plus largement l'Union européenne, suppléent l'action défaillante des Etats-Unis à Shushye lors de l'entretien qu'il a eu avec la mission. Le Congrès américain est, depuis lors, à l'automne 2000, revenu sur sa décision de blocage. L'aide européenne n'en continue pas moins d'être souhaitée, par les Russes et les Américains. Il existe enfin une action spécifiquement européenne dans ce domaine, qui va au-delà de la participation de celle-ci au financement des instituts de recherche précités. Le 4 juin 1999, le Conseil européen a adopté une stratégie commune à l'égard de la Russie et, au nombre des domaines d'action de l'Union, figure l'engagement de pratiquer une diplomatie préventive « en encourageant la maîtrise des armements et le désarmement et la mise en _uvre des accords existants en renforçant le contrôle des exportations, en endiguant la prolifération des armes de destruction massive et en _uvrant en faveur du désarmement nucléaire et de la destruction des armes chimiques ». Par la suite, le 17 décembre 1999, le Conseil a adopté une action commune établissant un programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération et du désarmement dans la Fédération de Russie qui vise à aider la Russie « dans les efforts qu'elle déploie pour assurer dans des conditions de sûreté et de respect de l'environnement, le démantèlement et/ou la reconversion des infrastructures et des équipements liés à ses armes de destruction massive ». Dans ce cadre, l'Union européenne participe à un projet relatif à une usine pilote de destruction d'armes chimiques à Gorny, l'un des sept sites russes consacrés à la destruction des armes chimiques, où étaient produits des agents vésicants81. En réalité, ce site faisait déjà, depuis 1993, l'objet d'un programme bilatéral entre la Russie et l'Allemagne, qui a dépensé environ 50 millions de marks depuis cette date. Jusqu'alors en effet, hormis une assistance européenne dans le cadre du programme TACIS, évaluée entre 15 et 20 millions de dollars, c'est essentiellement dans un cadre bilatéral que différents pays d'Europe (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Suède, Finlande) sont intervenus. Au total donc, les Etats occidentaux ont indéniablement pris conscience de l'enjeu majeur que représente, en termes de sécurité globale notamment, la question du démantèlement des armes chimiques russes. En témoignent récemment les déclarations du Premier ministre Lionel Jospin lors de son discours devant l'IHEDN, le 23 septembre 2000, faisant part de la disponibilité de la France pour aider la Russie. Reste que les obstacles sont nombreux, financiers certes, mais également politiques : la mission estime notamment qu'il serait nécessaire d'établir un lien formel entre l'assistance occidentale et d'autres aspects du programme d'armes de destruction massives hérité de l'URSS. En 1995, le Congrès américain soulevait ainsi la question du programme biologique en Russie, en demandant à ce que l'assistance américaine dans le domaine chimique soit conditionnée à l'engagement par le Président russe que la Russie respectait bien la convention de 1972 sur les armes biologiques. Cinq ans après, il n'est pas dit que cette initiative ait perdu son bien-fondé. C'est même plus largement l'aide économique apportée à la Russie qui pourrait être mise en question. C. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION BIOLOGIQUE : L'IMPOSSIBLE NÉGOCIATION ? Dans le domaine nucléaire, les instruments de lutte contre la prolifération sont nombreux, divers et, même si des progrès restent à faire dans leur mise en _uvre, il est difficile d'imaginer pour l'avenir des solutions innovantes. Dans le domaine chimique, il n'y a longtemps rien eu, ou presque : mais, avec la Convention d'interdiction adoptée en 1993, la communauté internationale s'est dotée d'un outil de lutte potentiellement efficace pour lutter contre la prolifération chimique. On pourrait croire qu'il en est de même s'agissant de la non-prolifération des armes biologiques : n'existe-t-il pas une convention sur les armes biologiques, entrée en vigueur depuis vingt-cinq ans, signée par 159 pays et ratifiée par 141 ? Après tout, l'absence d'utilisation connue des armes biologiques dans un conflit ne témoigne-t-elle pas du succès du régime mis en place quasiment au même moment que le TNP ? En l'occurrence, les apparences sont trompeuses : dès 1971, au moment de la signature de la Convention, un certain nombre d'Etats, dont la France82, avait souligné les lacunes de la Convention en matière de vérification. Les révélations récentes sur l'énorme programme mis en _uvre par l'URSS, pays dépositaire de la Convention, à partir de 1972, c'est-à-dire au moment même où elle venait d'être signée (!), ont achevé de miner la crédibilité de cet instrument. En sorte qu'aujourd'hui la communauté internationale n'a pas les moyens de lutter contre la prolifération biologique. Saura-t-elle se les donner ? Le veut-elle même ? 1. La convention sur les armes biologiques de 1972 ou l'impasse du désarmement sans vérification Armes chimiques et biologiques ont longtemps été associées dans les enceintes diplomatiques, ce qui a d'ailleurs bloqué tout progrès dans ce domaine jusqu'au début des années 1970 : les armes chimiques ayant été utilisées dans des conflits contemporains, de nombreux Etats estimaient nécessaire de conserver ce type d'armes dans leurs arsenaux afin d'en dissuader l'usage par d'éventuels adversaires. En revanche, l'arme biologique restant d'un usage largement théorique, son interdiction pouvait être envisagée de manière plus conventionnelle. Forts de cet argument, les Etats-Unis soutinrent en 1969 un projet de convention britannique présenté à l'ONU, alors qu'eux-mêmes, sous l'impulsion du Président Nixon, renonçaient, à la fin de cette même année, à produire et utiliser toute arme biologique, si ce n'est à des fins défensives strictement définies. L'exemple américain fut suivi par le Canada, la Suède et le Royaume-Uni qui déclarèrent ne pas posséder d'armes biologiques et s'engagèrent à ne jamais en produire. La voie unilatérale ne pouvait cependant pas se substituer à la conclusion d'un traité international juridiquement contraignant. Les négociations en vue d'un tel traité ne furent néanmoins possibles qu'après le revirement de l'URSS et de ses alliés qui, alors qu'ils avaient jusqu'alors strictement lié le chimique et le biologique, annoncèrent en mars 1971 qu'ils étaient prêts à examiner une convention portant sur les seules armes biologiques. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1971, la Convention sur les armes biologiques83 fut ouverte à la signature à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972. En comparaison du texte adopté sur les armes chimiques, la Convention de 1972 frappe par sa grande simplicité et, pour tout dire, son caractère lacunaire. Aux termes de l'article I, tout Etat s'engage à ne jamais développer, produire, stocker ou acquérir d'agents ou de toxines biologiques « de nature et en quantité telles qu'elles n'ont pas de justification prophylactique, protectrice ou pacifique » ou encore d'armes, d'équipements ou de vecteurs propres à permettre une utilisation hostile ou militaire de ces agents et toxines. En outre, les Etats possédant les produits visés à l'article I s'engagent à les détruire ou à les reconvertir à des fins pacifiques dans un délai maximal de neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention. Enfin, il est interdit à tout Etat de favoriser le développement de ces produits. La Convention envisage en outre les moyens de résoudre les difficultés liées à sa mise en _uvre ou au respect de ses dispositions : dans ce cas de figure, une procédure de consultation et de coopération est prévue, avec, le cas échéant, dépôt de plainte auprès du Conseil de sécurité. Par ailleurs, il est prévu que les Etats puissent échanger entre eux des informations scientifiques. De plus, il est spécifié que la Convention ne préjuge en rien de la conclusion d'une convention sur les armes chimiques, en vue de laquelle les Etats s'engagent à poursuivre des négociations. D'une durée illimitée, la Convention prévoit enfin la convocation d'une conférence d'examen tous les cinq ans, si les Etats l'acceptent, dont le rôle est de renforcer les dispositions de la Convention et de résoudre, le cas échéant, les différends entre les Etats parties. Aucun protocole de vérification n'est prévu dans la convention de 1972 sur les armes biologiques, domaine pourtant réputé mettre en jeu des technologies duales. Cette lacune est la marque de la conviction des spécialistes de l'époque de l'inutilité militaire des armes biologiques, dont le stockage était considéré comme difficile à maîtriser et l'efficacité de leur utilisation limitée. On l'aura compris, l'absence de tout système de vérification hypothéquait d'emblée la crédibilité de la Convention. Plus encore, ce type de traités nuit à la cause même qu'il prétend servir, l'adhésion, et plus encore la ratification de la Convention, pouvant être utilisées comme blanc-seing par des Etats aussi soucieux de donner l'image de « bons élèves » de la société internationale qu'indifférents aux règles qu'elle édicte. C'est ce qui n'a pas manqué de se produire avec l'URSS - pays dépositaire de la Convention, répétons-le - et l'Irak. A cet égard, la Convention sur les armes biologiques de 1972 doit être considérée comme l'anti-modèle des traités de désarmement en ce qu'elle ne donne que l'illusion de la sécurité. Conscients des limites de la Convention, les Etats parties ont tenté de mettre à profit les conférences d'examen quinquennales pour en améliorer le fonctionnement. Jusqu'en 1991, ces rencontres ne permirent pas de grandes avancées. En 1986, les Etats parties adoptèrent une série de mesures de confiance destinées à améliorer l'échange des données nationales sur les activités liées aux armes biologiques, sans toutefois les rendre obligatoires. Le bilan ne se fit pas attendre : en 1987, seuls 13 Etats s'étaient rendus à ces mesures, chiffre qui augmenta dans des proportions modestes pour atteindre 36 en 1990. La réunion de la troisième conférence d'examen, en septembre 1991, intervint dans un tout autre climat que la précédente : la guerre froide était terminée et la coalition d'Etats alliés autour des Etats-Unis venait de défaire les troupes de Saddam Hussein. Ces deux facteurs contribuèrent à donner une actualité nouvelle à l'arme biologique : - pendant la guerre froide, le rôle de la Convention était avant tout de prévenir le recours aux armes biologiques dans le cadre d'un conflit entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. C'est pour cette raison que les auteurs du traité n'avaient envisagé aucun système de vérification incluant notamment des inspections sur place. En outre, ces deux pays étaient les seuls dont on pensait qu'ils possédaient des armes biologiques en nombre significatif lors de l'adoption de la Convention ; - la guerre du Golfe a pour sa part fait surgir la menace biologique, ébranlant par-là même la conviction largement partagée de l'inutilité militaire de ces armes qui était largement à l'origine des lacunes de la Convention de 1972. L'Irak a en quelque sorte représenté un cas pratique, une mise à l'épreuve pour la Convention de 1972... et chacun a pu constater son inadéquation. Ce constat ne conduisit pas au consensus pour autant. Certes, d'importantes décisions furent prises en 1991, comme l'adoption de mesures de confiance facultatives supplémentaires, prévoyant par exemple la communication par les parties d'informations sur les activités passées à caractère offensif ou sur leurs centres et laboratoires de recherche hautement confidentiels, mesures destinées à accroître la transparence des activités de chacun. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le bilan de l'application de ces mesures laissées à l'appréciation de chaque Etat se révéla tout aussi maigre que pour les mesures adoptées en 1986. Au total, de 1987 à 1997, 50 % des Etat parties avaient fourni des données, seuls 9 % d'entre eux l'ayant systématiquement fait. Il n'existe de toute façon pas de structure suffisamment étoffée pour assurer le suivi de ces déclarations et en relever les anomalies. Mise au pied du mur, la communauté internationale révéla surtout ses divergences profondes sur ce dossier, divergences qui expliquent la faiblesse du dispositif adopté en 1972, comme elles expliquent aujourd'hui le caractère extrêmement laborieux de la négociation en cours sur l'adoption d'un protocole de vérification efficace. En l'occurrence, les termes du débat sur le biologique n'ont pas changé en trois décennies. Les nouvelles mesures de confiance révélaient en effet la position des Etats-Unis, favorables à un renforcement de la Convention par une plus grande transparence des activités nationales dans le domaine biologique. Outre le fait que l'application des mesures de confiance, dont procédait la proposition américaine, était jusqu'alors peu convaincante, la position des Etats-Unis reflétait leur conviction profonde que la vérification n'était pas applicable au domaine biologique : à leurs yeux, la communauté internationale était allée jusqu'au bout de ce qui était possible dans la lutte contre la prolifération biologique ; pour le reste, il fallait s'en remettre à la bonne volonté des Etats. Tel n'était cependant pas le sentiment de la majorité des Etats parties, qui voulaient s'attaquer à la question de la vérification. La conciliation de ces deux positions antagoniques conduisit à la création d'un comité d'experts techniques et scientifiques ad hoc, dénommée groupe VEREX, chargé d'évaluer les mesures de vérification qu'il était possible de mettre en _uvre pour permettre une véritable application de la Convention. A l'issue de ses travaux, conduits de mars 1992 à septembre 1993, le groupe VEREX conclut que : - chacune des 21 mesures envisagées en théorie peut contribuer à l'élaboration d'un système de vérification efficace ; - mais aucune d'entre elles ne fournit la solution à ce problème ; - en conséquence, la combinaison de certaines de ces mesures permettrait de renforcer la confiance dans le respect des dispositions de la convention. Lors de l'examen des conclusions du groupe VEREX, à la fin de l'année 1994, les Etats parties réunis dans une conférence spéciale décidèrent de créer un groupe spécial chargé de négocier un protocole juridiquement contraignant à la Convention sur les armes biologiques, c'est-à-dire de transformer en mesures obligatoires les mesures existantes et d'étudier l'utilité de nouvelles mesures. Plus précisément, le mandat du groupe ad hoc portait sur quatre points : - définir les éléments objectifs, tels que la liste des agents et toxines bactériologiques, les seuils quantitatifs au-delà desquels leur production est interdite et les types d'activités autorisées ; - insérer au dispositif les mesures de confiance ; - définir les mécanismes permettant d'assurer le respect de la Convention ; - étudier les modalités d'une mise en _uvre efficace des dispositions de la Convention relatives à la coopération internationale et à la promotion des activités pacifiques. 2. Vers un véritable système de lutte contre la prolifération biologique ? Depuis 1995, c'est dans ce cadre que se déroule une négociation qu'il faut bien qualifier de laborieuse. On rappellera seulement le souhait du Président Clinton de voir se terminer les négociations... avant la fin de l'année 1998. Or, selon les experts, aucune perspective favorable n'est en vue à l'automne 2000. Après cinquante semaines de travaux au sein du groupe ad hoc, la négociation achoppe, d'une part, sur la définition d'un équilibre entre la préservation de la sécurité nationale et de la propriété commerciale et une véritable application de la Convention, et, d'autre part, les contrôles à l'exportation et la coopération internationale. La chronologie de la négociation, telle que donnée par l'ambassadeur Tibor Toth84, président du groupe ad hoc, révèle la lenteur du processus : - de janvier 1995 à juillet 1997, les parties ont défini les points à inclure dans le protocole et établi un premier projet ; - de juillet 1997 à novembre 1998, elles ont identifié leurs points de désaccord (dix par page sur un document de 320 pages) ; - de novembre 1998 à janvier 2000, environ la moitié des désaccords a pu être résolue. La reprise de la session en mars 2000 semble cependant difficile. Les difficultés de la négociation s'expliquent aisément. Sept facteurs explicatifs peuvent être fournis à cet égard. · En premier lieu, le sujet de la vérification dans le domaine biologique est, par nature, complexe, à telle enseigne qu'en 1972, les négociations avaient fait l'impasse dessus. Comme le souligne Michael Moodie85, « la maîtrise des armements n'est qu'une réponse partielle à la menace complexe des armes biologiques et, s'il est vrai que le protocole pourrait masquer un important pas en avant, attacher une importance exagérée aux « mesures » risquerait d'éveiller des attentes excessives et conduire à la déception ». Dissimulation aisée derrière un « paravent » civil, équipes de recherche réduites, dualité des substances de base : l'équation de la lutte contre la prolifération biologique est particulièrement complexe. Pis encore, la révolution qui se profile dans le domaine des biotechnologies (par exemple, la création de toxines synthétiques) rend plus difficile encore la question des armes biologiques au regard de l'élaboration d'une norme de contrôle : les obstacles technologiques à la création d'armes biologiques se réduiront avec le développement de la biotechnologie. Par conséquent, non seulement le régime juridique actuel n'est pas adapté, mais il est à craindre, au vu de la création de nouveaux types d'agents tous les deux à cinq ans, que l'introduction de normes de vérification soit rapidement inadaptée. Certains experts, comme André Kokochine, estiment en conséquence qu'il serait nécessaire de mettre au point une convention traitant des biotechnologies. L'institut des questions de sécurité internationale de Moscou travaille d'ailleurs à la mise sur pied d'un programme d'experts multilatéral sur ce sujet. La mission soutient totalement cette initiative. Pour toutes ces raisons, d'aucuns contestent la faisabilité même d'un régime de surveillance dans le domaine biologique. Comme on l'a vu, telle a longtemps été la position plus ou moins avouée des Etats-Unis. Aujourd'hui encore, le remise en question par une partie des responsables et experts américains du contrôle des armements et de la non-prolifération au profit de la contre-prolifération est encore très vivace. Et, de fait, le cas irakien n'a pu que nourrir ces inquiétudes. De 1991 à 1995, 22 inspections ont été conduites en Irak dans le domaine biologique. Après la défection d'Hussein Kamel en août 1995, ce sont 23 inspections supplémentaires qui ont été menées. Du cas irakien, il ressort que, pour identifier l'existence possible d'une prolifération biologique à un stade suffisamment précoce pour pouvoir l'arrêter, il faut d'abord suivre en permanence les développements dans le domaine biotechnologique. Par ailleurs, la plupart des preuves qui ont permis de conclure à l'existence d'un programme biologique en Irak proviennent de données sur les transferts d'équipements, les achats, les transferts et la consommation de produits microbiologiques, d'éléments financiers, de même que des anomalies et incohérences des récits irakiens : en bref, même des mesures particulièrement intrusives n'ont pas permis de mettre à jour en détail ce programme. En outre, le cas irakien a montré la nécessité d'interventions rapides : les installations biologiques peuvent être transformées et nettoyées beaucoup plus rapidement que les infrastructures chimiques. D'après Annabelle Duncan et Kenneth Johnson86, microbiologistes qui ont participé aux activités de l'UNSCOM, le « nettoyage » de sites biologiques - c'est-à-dire la stérilisation des cuves et la destruction des stocks de cultures - ne demande pas plus de 24 heures. L'expérience de l'UNSCOM dans le domaine biologique n'est donc pas pour rassurer : en dépit de pouvoirs de vérification particulièrement inquisitoriaux, aucun élément concret n'a été trouvé par l'UNSCOM avant que les Irakiens eux-mêmes n'admettent l'existence d'un programme. Et seul un examen attentif des documents a pu conduire à accumuler suffisamment de preuves pour que les Irakiens en arrivent à cet aveu. Cette expérience est cependant précieuse car elle fournit des pistes utiles à la négociation. Elle conduit notamment à conclure à la nécessité de mettre en place, dans le cadre d'un régime international de lutte contre la prolifération biologique, un secrétariat permanent suffisamment étoffé d'inspecteurs à plein temps et bien formés. L'expérience de l'OIAC souligne d'ailleurs la nécessité de bien adapter la taille, le budget et les moyens aussi bien matériels qu'humains de l'organe de contrôle aux obligations imposées par le traité. On estime aujourd'hui qu'un organisme de 250 experts fonctionnant avec un budget annuel de 30 millions de dollars est en mesure de diligenter une centaine de visites et d'inspections par an. · En deuxième lieu, la mise en place d'un véritable système de vérification se heurte à l'intérêt financier des Etats et à ceux, économiques, industriels et scientifiques, de l'industrie biologique. D'un côté, les premiers redoutent le caractère très onéreux du dispositif de vérification, plus encore si, comme c'est probable, d'importantes sommes devront être déboursées par la communauté internationale pour démanteler et reconvertir le programme biologique hérité de l'URSS (l'expérience de la Convention sur les armes chimiques est dans tous les esprits). De l'autre côté, le secteur industriel de la biotechnologie est particulièrement inquiet de devoir se soumettre à des inspections, alors que la concurrence, très rude dans ce domaine, et les perspectives de profits dont il est porteur donnent à la confidentialité un caractère quasiment sacro-saint. La négociation fait ainsi apparaître le souci permanent des Etats-Unis de réduire l'impact du futur protocole sur l'industrie biotechnologique et leur infrastructure de biodéfense. Tel est bien d'ailleurs le discours que la mission a entendu au Sénat lors de son déplacement aux Etats-Unis : le Sénat américain n'est pas disposé à ratifier un texte dont il estimerait qu'il porte atteinte aux intérêts de son industrie de la biotechnologie. Si, à l'évidence, cette attitude s'inscrit dans la problématique plus large de remise en cause de la non-prolifération qui vient d'être évoquée, elle traduit également une inquiétude spécifique sur la compatibilité entre un traité international et des intérêts économiques nationaux. · En troisième lieu, l'étendue du champ des produits susceptibles de servir de base à la fabrication d'armes biologiques pose de redoutables problèmes techniques quant à la liste des installations à déclarer par les Etats - trop longue, elle rend le dispositif inapplicable ; trop restreinte, elle lui enlève son efficacité - et aux critères des visites. · En quatrième lieu, l'absence de participation d'Israël au régime de 1972 et ses conséquences sur l'attitude des pays arables pose le problème de l'universalité de la Convention. · En cinquième lieu, la négociation est entravée par les questions soulevées par les dispositions du traité relatives aux échanges scientifiques et technologies à des fins pacifiques et à la coopération technique. Sur la base de cet article, certains Etats non alignés réclament la dissolution du groupe australien et l'élimination des contrôles des exportations pour les Etats parties qui honorent les engagements qu'ils ont pris au titre de la Convention. Leur position a été renforcée par la conclusion de la Convention sur les armes chimiques. Ces Etats invoquent notamment le poids déterminant de ces technologies dans leur développement économique : « trouver le juste équilibre entre le besoin d'échanges technologiques pour favoriser le développement économique et la nécessité d'éviter tout usage détourné de la technologie est un véritable dilemme ».87 · Sixième source de difficulté, les procédures de négociation adoptées ne sont pas efficaces : les sessions se déroulent ponctuellement, en dehors de la conférence du désarmement et rassemblent une cinquantaine de participants. Parmi les Etats qui se signalent par leur participation active, on remarquera, au sein du groupe occidental, les Etats membres de l'Union européenne, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les Etats-Unis, et, parmi le groupe des pays non-alignés, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, Cuba, l'Inde, le Pakistan et l'Iran. · Enfin, et c'est là un point sur lequel la mission souhaite à nouveau attirer l'attention, la négociation ne peut que pâtir des soupçons qui continuent de peser sur l'éventuelle poursuite du programme biologique hérité de l'URSS en Russie. Les difficultés techniques que rencontre la négociation ne doivent pas faire oublier que la question est avant tout de nature politique. Comme le souligne l'ambassadeur Toth, « à ce stade des négociations, nous avons besoin d'une décision politique ». Et de conclure que, si celle-ci est positive, les négociations pourront être achevées en 2001. Il ne fait pas de doute que, tôt ou tard, un protocole de vérification sera conclu. Quels en seront les éléments constitutifs ? Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, la présence de deux dispositions paraît indispensable : d'une part, l'obligation de déclaration des installations liées au domaine biologique ; d'autre part, la possibilité pour l'organe de contrôle de réaliser, outre des visites de clarification et des visites aléatoires, des inspections par défi en cas de suspicion, à l'instar de ce qui se pratique pour les armes chimiques. Ceci pose la question de la nature des preuves susceptibles d'enclencher une telle procédure et des modalités de celle-ci. Il ne serait en outre pas inutile d'introduire dans ce protocole des dispositions permettant de refuser l'exportation de certains agents biologiques vers les Etats n'ayant pas adhéré à la convention plusieurs années après son adoption. Ce point suscite des débats, les Etats-Unis souhaitant préserver leur liberté d'exporter des produits pharmaceutiques vers certains pays du Moyen-Orient ou d'Asie. Mais il ne fait pas de doute non plus que l'ensemble du processus qui conduira à son entrée en vigueur se heurtera à des obstacles importants, notamment liés aux intérêts commerciaux. A cet égard, selon Brad Roberts88, « la ratification des Etats-Unis n'est en aucune manière acquise » vu l'état d'esprit actuel dans ce pays. Il estime même qu'« au mieux, un système à deux niveaux, dans lequel certains Etat acceptent des inspections inquisitoriales et d'autres non, prévaudra pendant longtemps ». Certes indispensable, la conclusion d'un traité international comportant des engagements vérifiables ne suffit cependant pas pour lutter contre la prolifération biologique. Lorsque la Convention de 1972 est entrée en vigueur, on estimait généralement qu'en plus des deux grandes puissances, seuls un ou deux Etats avaient aussi développé des armes biologiques. Aujourd'hui, au moins une douzaine de pays en possèdent, ou cherchent activement à en acquérir. A l'avenir, la crédibilité du régime de lutte contre la prolifération biologique est donc liée à sa capacité à traiter les cas de violation flagrante par certains Etats : l'Irak a été un échec cuisant, mais la Russie et, d'après de nombreux experts, la Chine, sont également à l'origine de préoccupations croissantes. De plus, l'existence d'un régime de contrôle des exportations dans le domaine biologique est indispensable : même s'il est insuffisant en lui-même, le groupe australien ne doit donc en aucun cas être sacrifié sur l'autel de la recherche d'un consensus autour du protocole de vérification. b) Et toujours le cas russe... Si la conclusion d'un protocole de vérification est susceptible de répondre aux questions sur l'éventuelle existence d'un programme biologique russe, reste à traiter le programme biologique soviétique, ce qui ne relève ni de la convention, ni du groupe australien, mais, une fois encore, de dispositifs ad hoc. Les deux questions sont toutefois liées, comme le souligne un rapport récent du GAO89 : les efforts conduits par les Etats-Unis pour réduire la menace biologique en Russie servent certes la lutte contre la prolifération, mais ne sont pas dénués de risques. Le GAO estime que « l'expansion du programme d'assistance à la Russie dans le domaine biologique posera certains risques aux Etats-Unis : maintien de l'infrastructure existante dans le domaine du biologique militaire, préservation, voire progression, des capacités scientifiques russes pour développer des armes biologiques, détournement éventuel de l'aide américaine à des fins offensives ». Ceci alors que, toujours selon ce rapport, les ministères des affaires étrangères et de la défense américains font état de contacts entre certains laboratoires russes et des pays étrangers : « depuis 1997, l'Iran et d'autres pays intensifient leurs efforts pour acquérir de l'expertise et des matériaux liés aux armes biologiques auprès d'anciens instituts ayant participé au programme soviétique ». Quinze d'entre eux auraient été contactés. C'est à partir de 1994 que les Etats-Unis ont lancé des programmes de recherche destinés à éviter que les scientifiques biologiques soviétiques ne poursuivent leurs activités, en Russie ou ailleurs. Combien sont-ils concernés par ce risque ? Amy Smithson évoque le chiffre de 7 300 personnes. Le rapport du GAO, sur la base d'informations de l'ISTC, estime à 15 000 le nombre de scientifiques et chercheurs sous-payés susceptibles de présenter un risque de prolifération : 5 000 personnes représentent un risque de prolifération significatif dans le domaine biologique, tandis que 10 000 autres possèdent des aptitudes pour adapter un agent biologique à un vecteur militaire. Afin de réduire la tentation des scientifiques russes - le salaire actuel d'un biologiste confirmé en Russie va de 40 à 80 dollars par mois Pour les années 2000 à 2004, le gouvernement américain souhaite multiplier par dix son engagement financier dans ce domaine, ce qui représente un effort de 220 millions de dollars. La moitié de ces fonds concernerait encore la reconversion civile des scientifiques russes ; l'autre moitié serait destinée à mettre en place une collaboration scientifique russo-américaine destinée à renforcer le programme de défense biologique américain (36 millions de dollars), à mettre à niveau le dispositif de sécurité d'un certain nombre d'infrastructures russes (40 millions de dollars) et à démanteler d'autres de ces installations (39 millions de dollars). Des éléments clés d'un programme biologique militaire sont en effet toujours en place en Russie. Le GAO cite notamment : - l'existence au Centre de virologie et de biotechnologie de Vector de deux chambres d'essai d'aérosols, qui sont les plus grandes existant à ce jour en Europe et en Russie. On rappellera que de telles infrastructures sont utilisées pour la mise au point d'aérosols contenant des agents biologiques, ce qui est l'un des vecteurs de dispersion les plus redoutables ; - à Vector toujours, une importante collection de souches virales (15 000) a été conservée, incluant notamment les virus Marburg et Ebola ; - en décembre 1999, un journal russe estimait que l'Institut militaire de recherche scientifique microbiologique de Sergyev Posad possédait lui aussi une importante collection de virus extrêmement dangereux. A la lumière de ces analyses, quel bilan dresser de la lutte contre la prolifération biologique ? La mission a le sentiment que ce domaine de la lutte contre la prolifération est encore considéré comme marginal, sauf aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où ce sujet fait l'objet de débats et de réflexions au plus haut niveau. Le problème vient de ce que le premier de ces pays n'est pas le meilleur avocat des régimes internationaux de non-prolifération aujourd'hui et privilégie en la matière la contre-prolifération. 1,4 milliard de dollars ont été inscrits au budget américain de défense passive contre les armes biologiques en 1999. S'agissant des autres pays, ces questions ne dépassent pas le cercle étroit des experts stratégiques et des diplomates. Il faut bien constater l'absence de prise de conscience de la plupart des pays des enjeux dont le biologique est porteur, notamment en termes de terrorisme. En France même si le sujet a été abordé au plus haut niveau de l'Etat, la négociation biologique n'intéresse de fait personne. La mission le regrette vivement. A la question que nous posions en exergue de ce chapitre, sur le fait de savoir si la communauté internationale voulait se donner les moyens de lutter contre la prolifération biologique, nous devons donc répondre aujourd'hui par la négative. D. LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MISSILES : UNE IMPASSE CONCEPTUELLE PRÉOCCUPANTE « La prolifération des missiles balistiques, vecteurs potentiels d'armes de destruction massive, représente une menace déstabilisante pour la sécurité et la paix dans le monde. Elle risque de mettre en cause l'action multilatérale entreprise en faveur du désarmement depuis la guerre froide. »90 Il est apparu très tôt que, sans être des armes de destruction massive, les missiles pouvaient jouer un rôle déstabilisateur en tant que vecteurs d'emport de telles armes. Et pourtant, préoccupation ancienne, la lutte contre la prolifération des missiles n'a trouvé une dimension active que récemment. Plus encore, en dépit d'un large consensus au sein de la communauté internationale sur le constat, les instruments de lutte contre la prolifération balistique sont les plus sommaires de tous ceux qui ont été développés jusqu'alors dans la lutte contre les armes de destruction massive. A ce jour en effet, seul existe le régime de contrôle des technologies de missiles (Missile Technology Control Regime ou MTCR), régime de fournisseurs rassemblant certains des pays qui ont ou ont eu des capacités dans la fabrication de missiles. Manque de volonté de la communauté internationale ou difficulté méthodologique : que traduit la faiblesse des instruments de lutte contre la prolifération balistique ? a) Le MTCR : origines et dispositif Dès le printemps 1960, la France présente un document de travail relatif au contrôle des véhicules porteurs de l'arme nucléaire. Ce document est le premier à prendre en compte la menace potentielle que pose l'existence de missiles balistiques. Dans son préambule, le TNP signé huit ans plus tard fait également référence à « l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs ». L'apparition, dans les années 1970, d'une nouvelle menace de prolifération nucléaire parmi les Etats du seuil mit en lumière le risque représenté par la dissémination des missiles balistiques. Elle se traduisit par l'adoption, de la part des pays producteurs et exportateurs de missiles, d'une politique prudente en la matière, dans laquelle les préoccupations suscitées par la non-prolifération restaient subordonnées aux intérêts économiques. Ainsi, en France, les lanceurs spatiaux et les technologies connexes furent inscrits sur la liste de biens soumis au régime des matériels de guerre en vertu d'une circulaire du 11 mai 1981. Il n'échappa cependant à aucun des grands pays exportateurs que l'efficacité de ces politiques à l'exportation était d'autant plus forte qu'elle était concertée. C'est pour cette raison qu'à partir de 1982, les sept pays les plus industrialisés (G 7), notamment grâce à l'initiative de la France qui assure depuis le point de contact permanent entre les partenaires du régime, engagèrent des négociations pour parvenir à une attitude commune sur les transferts sensibles au regard de la prolifération balistique. Cette concertation aboutit le 16 avril 1987 à la publication de « directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles », qui représente l'acte fondateur du régime de contrôle de technologie des missiles. Institué à l'origine par les seuls pays du G 7, le MTCR compte aujourd'hui 32 membres91. Par ailleurs, plusieurs pays, sans adhérer à l'accord, ont, à titre national, mis leur législation en conformité avec le MTCR ; tel est notamment le cas d'Israël ou de la Chine depuis 2000. Comme le groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) pour les exportations dans le domaine nucléaire ou le groupe australien en matière chimique, le MTCR repose sur un accord entre pays exportateurs d'équipements et de technologies sensibles pouvant contribuer à la mise au point de missiles balistiques. Les directives du MTCR ont pour but de « limiter les risques de prolifération des armes de destruction massive (armes nucléaires, chimiques et biologiques) par le biais d'un contrôle des transferts susceptibles de contribuer à des systèmes de lancement92 (autres que les avions pilotés par l'homme) de telles armes ». A l'origine, le régime de contrôle des technologies de missiles (MTCR) s'appliquait aux vecteurs capables d'emporter une charge nucléaire de 500 kg au moins (cela correspond à la masse approximative d'une arme nucléaire de première génération) à une portée d'au moins 300 km. Tels sont d'ailleurs les vecteurs visés par la catégorie 1 du MTCR. Cependant, la prise en compte des menaces chimiques et biologiques s'est traduite par une extension du champ du régime. La catégorie 2 recouvre donc les vecteurs balistiques et aérobies non pilotés capables d'atteindre 300 km quelle que soit la charge utile. Selon la catégorie dont ils relèvent, les biens et de technologies visés par le MTCR obéissent à des règles d'exportation différentes : les systèmes visés par la catégorie 1 sont frappés d'une présomption de refus d'exportation, qui ne peut être levée que par des garanties formelles de la part de l'acquéreur. S'agissant de la catégorie 2, c'est au fournisseur qu'il revient d'apprécier, au cas par cas, les garanties qu'il doit demander au pays acheteur. L'évaluation du bien-fondé des exportations prend en compte quatre éléments : - la situation du pays destinataire au regard de la prolifération des armes de destruction massive ; - les capacités et objectifs des programmes spatiaux et missiles de l'Etat destinataire ; - la portée du transfert en termes de développement potentiel de vecteurs pouvant porter des armes de destruction massive ; - les garanties de non-retransfert. Dans l'hypothèse où le transfert peut contribuer au développement de vecteurs pouvant être associés à des armes de destruction massive, le gouvernement du pays exportateur ne peut l'autoriser d'une part que sous réserve de l'engagement par le gouvernement du pays destinataire que les biens exportés seront utilisés comme ce dernier s'est engagé à le faire et que toute modification de leur usage ne se fera qu'après acceptation du fournisseur ; d'autre part que les produits exportés, leurs répliques ou leurs dérivés ne seront pas retransférés sans l'accord du gouvernement fournisseur. Alors que la lutte contre la prolifération balistique semble remise en cause par la multiplication des essais de tirs de missiles depuis 1998, certains se plaisent à rappeler que, deux semaines avant la signature du MTCR en avril 1987, l'Irak procédait avec succès au premier essai du missile Al-Hussein, missile construit grâce à une large assistance extérieure, symbolisant donc le type de prolifération que le MTCR visait précisément à éviter. Le régime subit une double critique, celle traditionnelle des Etats qui n'en sont pas membres et qui voient dans ce régime un refus d'accès des pays les plus pauvres aux technologies modernes, et celle, nouvelle, de certains de ses membres qui contestent l'approche même sur laquelle le MTCR repose. Trois défis menacent à terme la pérennité du MTCR. · En premier lieu, la vente de technologies visées par les catégories 1 et 2 du MTCR se poursuit, comme le montre les succès récents d'un certain nombre de pays dans la quête d'une capacité balistique. Or, la lutte contre la prolifération des missiles balistiques devient de plus en plus difficile du fait même de la dissémination de ce type d'armements : alors que pendant longtemps, l'achat de missiles complets prêts à l'emploi était la seule solution pour un Etat souhaitant se doter de ce type d'armement, la réticence des fournisseurs a conduit à un recours accru au transfert de technologies et, plus encore, au développement de missiles par des moyens indigènes. L'offre se diversifie donc, d'autant plus difficile à contrôler qu'elle émane d'Etats qui sont en dehors du système et répond à la demande d'Etats tout aussi extérieurs à celui-ci. Ces chaînes de prolifération, et la prolifération secondaire qu'elles favorisent, représentent un défi redoutable pour l'ensemble des régimes de contrôle international. Plus encore, la vente de composants sensibles émane dans certains cas de membres du régime, chacun étant en définitive seul juge pour apprécier l'adéquation du contrat aux normes fixées par le MTCR. De fait, le régime de non-prolifération balistique présente la caractéristique de viser des équipements et des technologies non pas en fonction de leurs seules caractéristiques techniques mais surtout en fonction de leur destination. La décision d'exportation ne peut donc intervenir qu'au cas par cas et ne saurait se référer à des normes automatiques. L'exemple évoqué précédemment des gyroscopes de missiles russes retrouvés en Irak illustre cette limite inhérente au MTCR : l'enquête diligentée par les autorités russes a conclu que lesdites pièces n'étaient que de simples morceaux d'acier. De même, l'interprétation des clauses relatives aux programmes spatiaux a conduit dans le passé à des exportations sensibles présentant un risque de prolifération, comme, par exemple, l'exportation par la Russie de technologies liées à la propulsion à l'organisation pour la recherche spatiale indienne. Il est vrai cependant que, dans certains cas, la définition de principes communs est particulièrement difficile. Le cas des missiles de croisière en fournit un bon exemple. Selon un article paru dans Defense News le 24 juillet 2000, les membres du MTCR travailleraient actuellement à la mise au point de paramètres standards permettant de mesurer la performance des missiles de croisière, sur lesquels le MTCR souhaiterait accentuer son effort. Or, « déterminer les performances d'un missile de croisière en termes de charge et de portée est particulièrement difficile ». Ainsi, en 1998, la vente de missiles de croisière de type Black Shaheen aux Emirats arabes Unis a suscité d'intenses débats transatlantiques du fait de divergences d'interprétation sur la portée du missile. Plus récemment, la vente par la Russie de technologies de missiles de croisière à l'Inde d'une portée maximale de 300 km, a également suscité des interrogations. · En deuxième lieu, certains spécialistes estiment qu'en gagnant en universalité - limitée, avec 32 membres -, le MTCR aurait perdu de sa cohérence au cours des six dernières années93. Dans sa conception initiale, le régime n'avait en effet pas pour objectif de faciliter l'accès aux technologies spatiales, pas plus qu'il ne visait à récompenser de bonnes relations diplomatiques. Or, aux yeux d'un spécialiste tel que Timothy McCarthy94, l'extension même du régime, pourtant souhaitable en termes de lutte contre la prolifération, s'est traduite par une « érosion significative des critères d'entrée, conduisant à l'acceptation d'Etats ne disposant pas d'institutions viables et/ou de la volonté nécessaire pour contrôler leurs exportations de missiles ». En bref, le MTCR aurait entamé sa crédibilité en s'éloignant de la philosophie initiale qui l'avait fondé. La Russie est généralement visée par les critiques de ce type, son adhésion étant considérée par certains comme relevant davantage de considérations diplomatico-politiques que du souci d'améliorer la non-prolifération. En outre, le consensus au sein du MTCR est de plus en plus difficile à atteindre au fur et à mesure que le nombre de ses membres croît, notamment sur les questions politiques les plus sensibles telles que la création de procédures d'application renforcées. · En troisième lieu, en dépit de l'arrivée de nouveaux membres tels que l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, qui a contribué à briser la réputation de cartel occidental que ses détracteurs voulaient lui donner, une image discriminatoire reste attachée au MTCR. Certes, tous les régimes de fournisseurs se sont vu accuser de favoriser les intérêts de leurs membres - les pays industrialisés - et d'être les outils d'une pérennisation de la supériorité des pays riches sur les pays pauvres. Mais c'est dans le cas du MTCR que cette critique est la plus forte. D'abord parce qu'il pose la question de l'accès de tous aux technologies spatiales et satellitaires, donc de l'accès de tous à la révolution de l'information. Même si le texte fondateur du MTCR précise que les directives qu'il édicte « ne sont pas destinées à entraver les programmes spatiaux nationaux ni la coopération relative à ces programmes », un certain nombre des pays du Tiers Monde, à commencer par l'Inde, dénoncent le caractère discriminatoire du MTCR qu'ils voient essentiellement comme un moyen, pour les pays industrialisés, de préserver leur supériorité technologique dans des domaines clés du développement économique. En cela, la problématique du MTCR n'est pas très différente de ce qui a longtemps été le discours des pays répugnant à se plier aux règles de la non-prolifération nucléaire, sous prétexte que cela gênait leur accès au nucléaire civil. Cet argument, de mauvaise foi dans le cas du nucléaire, n'est aujourd'hui plus défendu que par l'Inde. Pour ce qui est du balistique, il faut bien admettre qu'existe, chez certains membres fondateurs du régime, une répugnance à soutenir le développement de programmes spatiaux nouveaux, voire en cours. C'est d'ailleurs pourquoi un pays comme l'Inde, qui, tout en ayant une capacité balistique et spatiale, pratique une politique d'exportations très responsable et pourrait parfaitement rejoindre le MTCR, refuse de le faire ou même d'adhérer à ses principes. L'absence de l'Inde dans le MTCR ne contribue d'ailleurs pas à renforcer la légitimité du régime. Ensuite parce que, contrairement aux armes nucléaires chimiques et biologiques, les missiles ne sont pas en soi des armes illicites ou des menaces, mais participent au contraire de la politique de sécurité d'un Etat. Dès lors l'argumentaire des pays réfractaires à ce régime, que vos rapporteurs ont pu entendre en Egypte, par exemple, est le suivant : s'il s'agit vraiment de bloquer la prolifération des armes conventionnelles, il faut traiter le problème des missiles de croisière, dont la guerre du Golfe ou les événements du Kosovo ont montré toute l'importance ; et s'il s'agit de limiter la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive, il faut également traiter la question des avions. Et pourquoi, enfin, exclure les systèmes de défense aériens, notamment les missiles contre les missiles tactiques ? Les pays arabes du Moyen-Orient vont même plus loin, en soulignant que le problème clé de la prolifération balistique ... est la prolifération nucléaire. Ainsi, M. Alaa Issa, Directeur du désarmement au ministère égyptien des Affaires étrangères, a exposé aux membres de la mission que l'impact militaire d'un missile balistique étant négligeable quand il est utilisé comme arme conventionnelle, tout dépendait par conséquent de la nature de la tête du missile. Or, d'après ce même interlocuteur, il n'existe aucun élément empirique probant sur l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques dans un missile balistique. Seule l'URSS aurait maîtrisé l'adaptation d'armes biologiques à des missiles balistiques : cette tâche difficile ne peut donc être menée à bien que dans un contexte politique, scientifique et industriel spécifique et suppose une allocation asymétrique des ressources difficilement tenable pour beaucoup de pays. M. Alaa Issa a par ailleurs rappelé aux membres de la mission que l'utilisation de l'arme chimique par l'Irak contre l'Iran avait eu peu d'impact sur le conflit, 98 % des soldats iraniens touchés ayant pu être soignés, selon les autorités iraniennes. D'après l'Egypte, la seule menace véritable réside donc dans l'adaptation d'une tête nucléaire à un missile balistique. Il est inutile de souligner que cette démonstration ne vise pas seulement à dénoncer les lacunes du MTCR, mais répond aux préoccupations égyptiennes à l'égard d'Israël. · Enfin, à l'heure où les projets de défense antimissile sont au premier plan de l'actualité, il n'est pas illégitime de s'interroger sur l'impact qu'ils auront sur le MTCR. Comme le souligne Timothy McCarthy, le déploiement de défenses de théâtre, la modification unilatérale, voire l'abrogation du traité ABM pourraient se traduire par un accroissement quantitatif et qualitatif des ventes de technologies de missiles de la part de pays qui s'estimeraient le plus menacés par ces évolutions, tels que la Chine ou la Russie. 2. Un problème méthodologique : une approche multilatérale de la lutte contre la prolifération balistique est-elle possible ? A l'heure où la prolifération balistique s'accélère - le mérite du débat sur la NMD réside d'ailleurs dans le coup de projecteur qu'il permet de jeter sur ce sujet -, le débat est engagé sur les moyens à mettre en _uvre pour donner un coup d'arrêt à cette évolution. Or, au sein de ce débat pourtant riche et dense, il est frappant de constater que, jusqu'à une date récente, existaient très peu de réflexions sur les moyens à mettre en _uvre pour renforcer le MTCR. Certes, chacun reconnaissait que le MTCR demeure à ce jour la seule enceinte de réflexion et de concertation en matière de non-prolifération balistique, mais pour constater aussitôt que ce régime retarde mais n'entrave pas la prolifération balistique. C'est à la lumière de ce constat qu'il faut interpréter le monopole conceptuel de la contre-prolifération dans le débat actuel, et notamment des projets américains de défense antimissile. En bref, le très faible investissement intellectuel sur le MTCR, et plus largement sur ce que pourrait être une stratégie de non-prolifération dans le domaine balistique semblait traduire un ralliement tacite, mais quasi universel au postulat américain : la non-prolifération en matière balistique est vouée à l'échec et la contre-prolifération fournit la seule réponse au fait balistique. Ce postulat est discutable. Sans préjuger, à ce stade du rapport, de la pertinence d'une approche de la question balistique par la contre-prolifération, la politique de non-prolifération balistique a encore un avenir, position que la France notamment a défendu sans relâche dans les enceintes multilatérales. La question de savoir si ce régime a évité ou retardé une dissémination encore plus large des missiles balistiques reste en effet ouverte. De fait, comme le souligne Robert Gallucci95, doyen de l'Ecole des affaires étrangères de l'Université de Georgetown, « le MTCR est globalement un succès, tout comme le régime du TNP est globalement un succès. Ce qui ne fait que mettre en lumière le cas où ces régimes ont échoué. Le cas où l'Inde et du Pakistan vient immédiatement à l'esprit dans le domaine nucléaire. Et, pour ce qui est du MTCR, trois cas de transferts de technologie sont intervenus, en provenance de Chine, de Corée du Nord et de Russie. » Et Robert Gallucci d'admettre que, bien qu'en nombre limité, ces transferts sont en effet très déstabilisateurs sur l'Asie du Sud et le Moyen-Orient. C'est dans cette optique que la France a contribué activement à la rédaction et à la conclusion d'un code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques. a) Améliorer le MTCR : une faible marge de man_uvre Le renforcement du MTCR passe par trois voies : (1) le recentrage sur son rôle initial. Il est évident que jamais le MTCR ne pourra jouer un autre rôle que celui qui est dévolu aux régimes de fournisseurs, c'est-à-dire limiter, ralentir, en un mot rendre la prolifération balistique difficile et coûteuse en temps et en argent. De ce point de vue, il conserve toute sa légitimité. Précisément, alors qu'un certain nombre de pays, généralement connus, ont atteint, dans le domaine balistique, un plateau technique, il y a là une opportunité à saisir pour le MTCR dans la mesure où, pour dépasser ce plateau, ces pays auront besoin de technologies et d'équipement importés qui tombent sous le coup du MTCR. En effet, tout comme dans le domaine nucléaire, il existe des seuils en matière de prolifération balistique. Dans le nucléaire, ce seuil, ce point de non-retour se situe d'abord entre l'absence de capacité nucléaire et l'acquisition d'un engin, même rudimentaire, puis entre la possession d'un outil rustique et l'existence d'un arsenal digne de ce nom. Dans le domaine balistique, on peut également distinguer deux seuils : le premier réside dans l'acquisition d'une capacité de moyenne portée suffisante pour atteindre un éventuel adversaire, le second dans la capacité d'adapter à ce vecteur une arme de destruction massive, notamment une arme nucléaire. En Asie du Sud, les deux seuils ont été franchis : l'Inde et le Pakistan disposent d'armes nucléaires déployables et travaillent au déploiement de missiles de moyenne portée. Au Moyen-Orient, si Israël maîtrise d'ores et déjà les deux processus, dans le cas de l'Iran, seul le premier seuil a été franchi. Il y a donc là un champ d'intervention du MTCR qui lui permettrait de retrouver sa philosophie initiale et reconquérir une partie de sa légitimité perdue. Trois domaines pourraient notamment être traités avec vigilance : la portée des missiles, la capacité à miniaturiser les têtes et les systèmes de guidage, autant de paramètres qui déterminent la capacité d'un pays à passer du « bricolage » rustique à la maîtrise scientifique des compétences balistiques. (2) L'élargissement. Celui-ci doit se faire vis-à-vis de pays dont les contrôles à l'exportation sont efficaces. A cet égard, l'adhésion de l'Inde à ce régime en renforcerait considérablement la crédibilité. Il serait souhaitable également que la Corée du Nord, la Chine, le Pakistan, l'Iran et Israël le rejoignent comme membres à part entière. (3) L'ouverture. Il faut développer le dialogue avec les pays qui n'en sont pas membres, ce à quoi se refusaient traditionnellement les pays membres du MTCR. Cette politique d'ouverture est nécessaire pour contrer les critiques sur le caractère discriminatoire du MTCR. L'adoption d'une véritable politique de sanctions pourrait-elle compléter le système ? Simple d'apparence, cette question recèle des enjeux en réalité très complexes. Que sanctionnerait-on en effet ? Le fait accompli, c'est-à-dire l'essai de missile, ou les transferts avérés ? Dans le premier cas, cela reviendrait à faire sanctionner par les membres du MTCR le résultat de son échec ; dans le deuxième cas, on se heurte à la délicate question des capacités d'informations des membres, à la coopération entre les services de renseignement et à la volonté des Etats membres de mettre publiquement en accusation un autre Etat. Pour toutes ces raisons, l'adoption d'une politique de sanctions formalisée paraît difficile. Et pourtant, elle doit être envisagée. Même si l'on peut porter un regard critique sur les résultats de la politique américaine vis-à-vis de la Chine dans ce domaine, la déclaration chinoise du 21 novembre 2000, par laquelle ce pays s'engage solennellement à contrôler ses exportations, incite à croire que les sanctions ne sont pas sans effet. Encore faut-il disposer de leviers d'action suffisants... b) Les autres voies de la non-prolifération balistique En dehors du triptyque « recentrage - élargissement - ouverture » du MTCR, quelles solutions pourraient être envisagées pour renforcer la non-prolifération dans le domaine balistique ? · Au sein des membres du MTCR, deux écoles s'opposent : - vis-à-vis d'un pays comme la Corée du Nord, par exemple, les Etats-Unis défendent une approche incitative (aide dans le domaine civil en échange d'un renoncement dans le domaine militaire), à l'instar de ce qu'ils ont fait dans la KEDO. L'inconvénient d'une telle approche réside dans son caractère partiel et bilatéral. En outre, les remarques qui ont été faites précédemment sur la KEDO (notamment les risques de chantage) valent également dans ce cadre. Enfin, la vérification dans le domaine balistique est encore plus complexe que dans le domaine nucléaire. Cette approche n'a pour l'instant pas donné de résultats. En juin 1998, la Corée du Nord a officiellement reconnu qu'elle exportait des SCUD-B et des SCUD-C, sans toutefois préciser vers quels pays ses exportations avaient lieu. L'agence de presse officielle ajoutait également que la Corée du Nord continuerait à développer, tester et déployer des missiles et les exporterait en échange de devises étrangères. Les discussions bilatérales sur ce sujet, entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, à l'été 1998, n'aboutirent à aucun progrès. En septembre 1999, toutefois, la Corée du Nord a accepté de suspendre ses essais de missiles au moment des discussions bilatérales, tandis que les Etats-Unis annonçaient qu'ils assoupliraient les mesures d'embargo économique contre la Corée du Nord. Aujourd'hui, à l'heure d'un rapprochement historique entre les deux Corée, la péninsule coréenne est à la croisée des chemins : comment interpréter l'engagement pris - puis repris d'ailleurs - par la Corée du Nord à l'été 2000, lors du déplacement du Président russe dans ce pays, d'un abandon du programme balistique en échange d'un accès aux lanceurs de satellites ? La question reste en suspens aujourd'hui de savoir si la Corée du Nord s'est engagée à suspendre le développement de tous ses missiles ou seulement de ses missiles intercontinentaux. Reste qu'une telle approche n'est pas applicable de manière systématique à d'autres pays car elle entre dans un cadre politico-diplomatique complexe et spécifique ; - de leur côté, la France et la Grande-Bretagne plaident en faveur de l'élaboration de règles de transparence dans les activités balistiques et spatiales, afin de réduire les tensions nées de la prolifération balistique. On remarquera au passage que cette approche a ceci de commun avec les positions américaines en matière de contre-prolifération qu'elle prend acte du fait balistique. Mais, indirectement, par le climat de confiance qu'elle prétend instaurer, elle est à même de limiter la prolifération balistique. Le c_ur de cette proposition réside dans la mise en place d'un système multilatéral de notification des essais de missiles et des lancements d'engins spatiaux. La France a ainsi proposé dans le passé récent plusieurs initiatives en ce sens. En 1991, elle a proposé à la Conférence du désarmement des mesures tendant à la notification préalable des tirs de missiles balistiques d'une portée égale ou supérieure à 300 km. Le 12 mars 1993, elle a à nouveau suggéré que les Etats de lancement notifient a priori les lancements de tout système, satellites ou autre véhicule spatial et missile à trajectoire balistique. Elle proposait que les notifications soient transmises à un centre international qui pourrait prendre la forme d'une division au sein de la Direction des affaires de désarmement du Secrétariat des Nations Unies. La proposition française va au-delà de la convention de 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace, qui ne s'appliquent pas aux missiles balistiques, et des obligations internationales sur les tirs de missiles. Elle repose sur l'obligation de notifier à l'avance (par exemple un mois avant la date prévue avec confirmation 24 heures avant l'échéance avancée) les tirs de missiles balistiques d'une portée égale ou supérieure à 300 km, en communiquant à un centre international, une série d'informations relatives notamment à la zone de tir et aux zones de retombées. Les Etats-Unis et le Japon se sont élevés contre cette approche en reprenant l'argument précité de la légitimation de programmes contestables du type de celui de la Corée du Nord. On remarquera cependant que la proposition française a été reprise sous forme bilatérale par les Etats-Unis et la Russie : évoquée lors du sommet Clinton - Eltsine de septembre 1998, elle s'est traduite par un accord lors du sommet Clinton - Poutine de juin 2000. Il est ainsi prévu de mettre un place un centre commun auquel seront transmises les données de lancements d'engins des territoires américain et russe, puis dans un deuxième temps tous les éléments détectés par les systèmes des deux pays. Dans une troisième phase, d'autres pays pourraient fournir ce type de données au centre, sous le contrôle bilatéral de la Russie et des Etats-Unis. Avec l'adoption d'un projet de code de conduite international contre la prolifération balistique par les membres du MTCR, le 13 octobre 200096, l'approche franco-britannique a cependant marqué un point. Ce projet, qui ne vise que les missiles balistiques - l'inclusion des missiles de croisière dans le champ du code de conduite aurait ouvert la voie à un débat complexe sur la définition de leurs paramètres - est articulé autour de cinq points : - les Etats adhérents s'engagent à exercer la plus grande retenue possible en matière de développement, d'essai et de déploiement de missiles balistiques. Ils s'engagent également à ne soutenir d'aucune façon un programme de missiles balistiques dans un pays qui pourrait développer des armes de destruction massive, en contradiction avec les normes établies par les traités de désarmement et de non-prolifération ; - les bases d'un régime d'incitations sont jetées dans le projet de code de conduite. Ce régime reste cependant une simple option ouverte aux Etats qui le souhaitent ; - les mesures de confiance constituent le c_ur de code de conduite. Elles ont un caractère obligatoire. Sous ce chapitre se trouvent à la fois des mesures de transparence sur les programmes de missiles balistiques et de lanceurs spatiaux non réutilisables ainsi qu'un système de pré-notification des tirs de missiles et des lancements spatiaux. Cette dernière mesure est une reprise directe de la proposition formulée le 12 mars 1993 par la France à la conférence du désarmement. La nature même des éléments susceptibles d'entrer dans l'échange de pré-notifications reprend la liste proposée dans le document de travail français : classe générique de l'engin, date et lieu du lancement, trajectoire envisagée ; - la nécessité de tenir des réunions annuelles pour poursuivre les travaux sur le code de conduite est affirmée par les Etats membres. L'établissement d'un centre chargé de recueillir les données issues de l'échange de notifications figure également à l'ordre du jour ; - le recueil des décisions prises par consensus lors de la réunion plénière d'Helsinki comporte des éléments relatifs à la « multilatéralisation du projet international de code de conduite contre la prolifération des missiles balistiques ». L'adoption à Helsinki d'un projet de code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques constitue un résultat positif à plusieurs titres. La mission se réjouit de voir confortée, par l'adoption de ce code, la légitimité des instruments de non-prolifération dans la lutte contre la menace balistique, face aux tenants de la seule politique de contre-prolifération. En outre, le MTCR sort renforcé de cet exercice. Face aux initiatives d'autres pays, il a su mettre sur pied au moment opportun une proposition concrète pour contenir la prolifération balistique. On ne peut que se féliciter de voir une position française soutenue depuis 1993 à la conférence du désarmement reprise dans ce projet de code. La France a pu jouer un rôle moteur dans la négociation, en maintenant en particulier une excellente coordination avec les délégations américaine et russe. Reste à régler l'importante question de l'adhésion rapide des Etats les plus sensibles (Corée du Nord, Chine, Inde, Pakistan, Iran, Israël notamment) à ce projet de code, qui pourrait sinon rester lettre morte. Il est également nécessaire de réfléchir aux modalités de coordination de ce code avec le centre conjoint d'alerte avancée russo-américain. · Que penser de la pertinence d'un traité international qui permettrait de garantir à terme un traitement multilatéral de la question balistique ? Cette approche se fonde sur le constat suivant : le plafonnement, la destruction partielle, voire la disposition totale de certaines catégories de missiles, ont été réglementées par des traités bilatéraux (START I et II, traité FNI) entre les deux Grands. Pourquoi ne pas traiter le problème de la prolifération balistique dans son ensemble de cette façon ? D'où, par exemple, la proposition de certains experts, tels que François Heisbourg, de multilatéraliser le traité FNI, qui permet la disparition de missiles de portées comprises entre 50 et 1 500 km. A ce jour cependant, ce genre de propositions n'a pas été reprise à un niveau institutionnel. Elle mériterait pourtant un examen attentif. Deux autres voies en revanche sont étudiées à ce niveau. En premier lieu, certains experts plaident en faveur d'un « TNP balistique », c'est-à-dire, d'un instrument formel qui traiterait de la prolifération des missiles en général - le terme de balistique ne doit pas tromper -, et non pas du seul problème des exportations. En outre, tout comme le TNP, un tel traité reposerait sur un engagement des « nantis » à favoriser l'accès des autres aux technologies spatiales civiles en échange de leur engagement à ne pas exporter de technologies sensibles. Pour séduisante qu'elle soit, une telle proposition se heurte à un obstacle majeur, la définition des « nantis ». A la différence des Etats nucléaires, la liste des pays possédant des missiles balistiques est longue, comme nous l'avons vu précédemment, et l'on voit mal la communauté internationale légitimer les programmes nord-coréen ou irakien. Il serait pour le moins difficile de distinguer entre les missiles qu'un pays utilise pour sa défense et ceux dont il vise à faire les vecteurs d'emport d'une arme de destruction massive. C'est dans cette perspective qu'il faut interpréter l'absence de traité international relatif à la prolifération balistique. On remarquera par ailleurs que les technologies utilisées en matière balistique sont très proches de celles de l'industrie spatiale, ce qui rendrait le contrôle inhérent à un traité réglementant la possession de missiles balistiques largement inefficace. Une description trop large des matériels visés dans un traité entraverait indûment les transferts légitimes tandis qu'un texte trop restrictif n'aurait que peu de poids pour lutter contre la prolifération. En outre, l'expérience irakienne a montré les difficultés énormes de vérification en matière balistique. Seul un organe de contrôle aux pouvoirs inquisitoriaux, fonctionnant largement grâce aux informations fournies par les services de renseignement, serait à même de mener cette tâche à bien. C'est là encore une perspective largement théorique à ce jour. La deuxième proposition émane de la Russie qui prône un système global de contrôle. Cette proposition, qui n'en est encore qu'au stade du débat d'idées entre les Etats - auquel on peut noter avec satisfaction que des pays comme l'Inde ou l'Iran se sont joints - est depuis longtemps étudiée par les experts stratégiques97. Il ne faut pas se cacher qu'un tel système suppose la mise en place d'une infrastructure extrêmement lourde, incluant un contrôle à distance, par satellite ou reconnaissance aérienne, un contrôle sur place et un échange de données. Ce constat pose d'emblée la question de l'équilibre entre les intérêts nationaux et l'efficacité du système de vérification. L'expérience des traités bilatéraux stratégiques entre les deux Grands montre qu'avec le temps, les systèmes de contrôle sont devenus de plus en plus inquisitoriaux : le contrôle de la mise en _uvre du traité SALT reposait sur des moyens techniques nationaux de chacune des parties ; en revanche, le traité FNI autorisait les inspections sur place. Faut-il en conclure aujourd'hui, les Etats accepteraient de se plier à ces règles contraignantes ? On peut en douter, alors que la principale puissance dans le monde semble s'éloigner aujourd'hui de l'approche multilatérale et des contraintes qui s'y attachent. * L'acquis de plus de trois décennies de politique de non-prolifération est indéniable. C'est notamment dans la décennie 1987 - 1997, qui restera sans nul doute comme un âge d'or de la non-prolifération, que la communauté internationale a su forger les outils d'une véritable prévention de la dissémination des armes de destruction massive. A cet égard, la grande révolution conceptuelle réside dans le passage d'une logique de maîtrise des armements à une véritable logique de désarmement, notamment dans les domaines nucléaire, chimique, mais également balistique. Peuvent être cités, pêle-mêle, les accords bilatéraux américano-russes de désarmement nucléaire (FNI, START I, START II), ainsi que les initiatives unilatérales de tous les Etats nucléaires, sauf la Chine. Dans le domaine des grands traités multilatéraux, il faut mentionner la victoire que représente la prolongation illimitée du TNP en 1995, la conclusion d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, l'aboutissement des négociations sur la convention des armes chimiques et l'inscription à l'ordre du jour de négociations, plus ou moins avancées à ce stade, sur un régime de vérification de la convention sur les armes biologiques et sur un traité d'interdiction de la production des matières fissiles. Après une décennie de progrès remarquables, la non-prolifération donne pourtant aujourd'hui l'impression d'être en panne, voire en repli. On en donnera pour preuve la manière dont s'est déroulée la conférence d'examen du TNP qui s'est tenue à New York au printemps 2000, symptomatique de cet essoufflement de la non-prolifération, notamment par contraste avec l'enthousiasme qui avait prévalu lors de la conférence de prorogation du même traité cinq ans plus tôt. Certes, en apparence, le bilan de cette conférence est bon, et en tout cas bien meilleur que ne le laissaient présager les réunions préparatoires annuelles de cette conférence, qui avaient pour but d'examiner la mise en _uvre des principes et objectifs définis en 1995 et de faire des recommandations pour la conférence d'examen de 2000. La Conférence d'examen du TNP qui s'est tenue à New York au printemps 2000 a permis à chacun des participants d'y trouver son compte : les Etats dotés de l'arme nucléaire (EDAN) maintiennent un contrôle sur les autres Etats par le biais de l'AIEA ; quant aux Etats non dotés de l'arme nucléaire (ENDAN), ils ont obtenu une réaffirmation du principe du désarmement nucléaire par les EDAN, ainsi que l'engagement de ceux-ci à faciliter la coopération pacifique dans le domaine nucléaire civil. La déclaration finale de la Conférence ne change rien par rapport au texte de 1995, qui avait explicité l'engagement de désarmement déjà contenu dans l'article VI du TNP. Y sont réaffirmés l'objectif d'une élimination totale des armes nucléaires, la nécessité d'une mise en _uvre du TICE, l'obligation de négocier et de conclure un traité d'interdiction de la production de matières fissiles et les principes de sécurité stratégique et de transparence. Le principal changement par rapport à la Conférence de 1995 réside dans l'évolution du contexte, marqué notamment par un refroidissement certain des relations entre les Etats-Unis et la Russie, auquel les décisions récentes prises de part et d'autre ont largement contribué. D'un côté, le Conseil de sécurité russe a présenté une nouvelle formulation de la doctrine de défense nationale qui accentue le rôle des armes nucléaires, dont l'emploi est envisagé même face à des menaces conventionnelles pour compenser le déclin de ses forces classiques. De l'autre côté, le processus de déploiement d'une défense nationale antimissile se poursuit aux Etats-Unis. La Chine et la Russie ont d'ailleurs fait savoir qu'elles pourraient augmenter leurs stocks de missiles à longue portée, la Chine ayant même ajouté que les négociations entre les Etats-Unis et le Japon d'une part, et entre les Etats-Unis et Taiwan d'autre part, relatives à un système de défense antimissile de théâtre, pourraient la conduire à se retirer des négociations sur l'arrêt de la production de matières fissiles. Par ailleurs, si aucun de ces deux pays n'a fait part de son intention de reprendre les essais nucléaires, aucun des deux n'a ratifié le TICE. On sait par ailleurs le sort que lui a réservé le Sénat américain. Un autre facteur de tension est venu s'ajouter récemment, avec le vote par le Sénat américain, le 24 février dernier, d'un projet de loi visant à punir la Russie ou d'autres pays qui aideraient l'Iran à se procurer des armes de destruction massive. A quoi la Russie, par la voix de son ministre des affaires étrangères, a répondu que cette approche était « inadmissible » et portait « un coup sérieux à la collaboration bilatérale et internationale dans le domaine de la non-prolifération ». D'où une double ligne de fracture au sein des membres du TNP. D'une part, la pression des ENDAN sur les EDAN, qui s'était déjà fait sentir dans les commissions préparatoires à la Conférence d'examen, s'est accrue. Il ne s'agit pas là d'un fait nouveau. Mais les formes que prend cette pression ont évolué dans deux directions. Tout d'abord, traditionnellement, cette pression émanait des pays non-alignés qui utilisaient la non-prolifération pour réaliser des objectifs en matière de désarmement ; or, aujourd'hui, ils semblent engagés « dans une logique de confrontation avec les puissances nucléaires surtout occidentales sur le thème du désarmement nucléaire ». Cette stratégie a des conséquences redoutables, dans la mesure où elle s'apparente à une politique délibérée du pire et revient « à fragiliser l'édifice global en réfutant l'idée d'équilibre des obligations à l'origine du TNP au nom d'objectifs politiques maximalistes à plus court terme. (...) Les différents forums de négociation deviennent ainsi le lieu de l'expression rhétorique de ranc_urs accumulées dans d'autres domaines, où les modérés parmi les non-alignés sont, par définition, les moins audibles »98. En second lieu, cette pression s'est étendue au-delà du cercle traditionnel des pays non-alignés, parmi des Etats non radicaux, y compris européens (Irlande, Suède), dont les arguments (transparence, irréversibilité du désarmement nucléaire) ne sont pas sans poids dans l'opinion publique. D'autre part, les EDAN ne sont plus unis par la même solidarité qu'en 1995, où tous travaillaient à ce qui représentait leur intérêt clair et commun, à savoir la prorogation illimitée du TNP. Au contraire, en 2000, même si le résultat de la Conférence est conforme aux objectifs de chacun d'eux, chacun l'a fait pour des raisons strictement nationales : - les Etats-Unis cherchaient à redresser leur image de marque après l'échec de la ratification du TICE et dans un contexte de contestation du traité ABM ; - la Russie, du fait d'un contexte intérieur complexe et de son différend avec les Etats-Unis sur la NMD, a été peu active au cours de cette conférence ; - la Chine cherchait à tirer partie de la mise en cause des Etats-Unis sur la NMD et à se dégager des engagements contraignants qu'elle avait pris en 1995 sur la négociation et la conclusion du cut-off ; - la France est moins sensible aux pressions des ENDAN du fait de sa doctrine de suffisance et de non-emploi, de la réduction unilatérale de son arsenal et de ses stocks de matières fissiles et, enfin, des mesures de transparence qu'elle a adoptées ; - la Grande-Bretagne, pour des raisons de politique intérieure, s'est montrée assez ouverte aux discours des sept ENDAN précités. Dans un tel climat, des accords ont pu être conclus entre les cinq EDAN qui préservent une unanimité de façade, mais qui ne servent pas nécessairement la cause de la non-prolifération. Par exemple, dans quelle mesure les formules molles sur le cut-off ne sont-elles pas le résultat du souhait des Etats-Unis de ne pas se voir excessivement attaquer sur le traité ABM et de la répugnance de la Chine à s'engager dans cette négociation ? A n'en pas douter la clé du redressement des politiques de non-prolifération réside dans la cohésion retrouvée des EDAN et, en leur sein, des Etats qui sont, chacun à leur manière, engagés dans des politiques de désarmement unilatérales ou bilatérales. A moins de voir, petit à petit, les régimes de non-prolifération s'éroder car, pas plus que la prolifération, la non-prolifération n'est irréversible. Les régimes internationaux ne sont pas des outils abstraits, mais le fruit de coopérations au quotidien entre leurs membres, tous leurs membres. III. - QUELLES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS ? NON-PROLIFÉRATION, DÉFENSE ET DISSUASION AU XXIÈME SIÈCLE La communauté internationale ne peut se satisfaire de régimes de non-prolifération en panne alors qu'une très large majorité d'Etats est favorable à la prévention de la dissémination des armes de destruction massive et que la prolifération s'accélère. Dans ces conditions, comment relancer la dynamique des politiques de lutte contre la prolifération ? Des analyses qui précèdent, il ressort que le réponse à cette question réside avant tout dans la volonté des cinq Etats nucléaires, et notamment des grandes démocraties, de faire avancer la lutte contre la prolifération. Et c'est là que le bât blesse : dans les années récentes, les termes de ce débat ont été en effet profondément renouvelés par le développement de la politique américaine de contre-prolifération et sa domination sur le sujet. Le débat sur la lutte contre la prolifération est donc à la croisée des chemins, entre non-prolifération et contre-prolifération. Alors que la première approche, traditionnelle, vise à empêcher la dissémination des armes de destruction massive et repose sur la prévention et la diplomatie, la deuxième prend acte de la prolifération et vise à dissuader les détenteurs d'armes de destruction massive de les utiliser. Cette distinction n'est pas nouvelle, puisque la contre-prolifération est apparue dans les années 1980. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que les Etats-Unis, qui sont largement à l'origine du débat actuel, donnent le sentiment de considérer la contre-prolifération non plus comme un complément de la non-prolifération - on se protège ou on attaque quand la non-prolifération a échoué - mais de plus en plus comme un substitut postulant par avance l'échec de la non-prolifération. En sorte que l'on est aujourd'hui en droit de se demander si les Etats-Unis, inventeurs de l'arms control et de la non-prolifération, souhaitent toujours investir dans ces sujets et s'ils y croient même encore. Il n'est qu'à parcourir la littérature stratégique américaine pour évaluer le faible poids de la réflexion sur la non-prolifération, qui contraste avec l'avalanche d'analyses sur la défense contre les menaces des armes de destruction massive. L'attitude de l'« hyperpuissance » américaine est-elle la cause ou la conséquence de l'érosion des régimes de non-prolifération ? Les deux hypothèses sont sans doute vraies. Difficultés constantes à sécuriser et canaliser les infrastructures, les matériaux et le savoir-faire russes balistique, nucléaire, biologique et chimique, course aux armements dans le sous-continent indien, crise entre les grandes puissances sur la stratégie à adopter contre l'Irak, multiplication des essais balistiques dans l'Extrême-Orient asiatique, en Asie du Sud et au Moyen-Orient... De fait, les trois dernières années ont vu se multiplier les défis aux régimes de non-prolifération, alors que l'édifice juridique et diplomatique n'a jamais été aussi varié et complet. Dans ce paysage confus, le refus du Sénat américain a en outre fait l'effet d'un coup de tonnerre, en ce qu'il rompt singulièrement avec l'approche contractuelle affichée jusqu'alors par les grandes puissance et marque, entre autres indices, le réveil de l'unilatéralisme américain, alors que l'Europe, pour sa part, ne parvient pas à émerger comme acteur de substitution sur ces sujets. Le débat ne se pose cependant pas en ces termes : il n'existe pas d'antinomie entre non-prolifération et contre-prolifération, c'est-à-dire entre une approche par la diplomatie et une approche par la défense. Le vrai débat porte sur la combinaison optimale entre les deux approches pour atteindre un objectif : entraver et faire cesser la prolifération des armes de destruction massive et des missiles. A cet égard, de même qu'il est illusoire, et déstabilisant pour l'équilibre stratégique international, de prétendre y parvenir seulement en se défendant et en se protégeant comme semblent le croire les Etats-Unis, de même l'Europe manquera cet objectif en recourant à la seule diplomatie. Vos rapporteurs ont conscience que cette affirmation ne va pas de soi dans un pays comme la France, qui, depuis le début de la décennie notamment, n'a pas ménagé ses efforts en faveur de la politique de non-prolifération et s'est toujours défiée des mesures de contre-prolifération comme contraires par nature à une doctrine de dissuasion continuellement réaffirmée. Et pourtant, dans la mesure où l'évolution à laquelle on assiste actuellement outre-Atlantique n'est le fait ni d'une minorité isolationniste, ni le fruit d'excès électoralistes, mais bien le reflet de l'opinion de la majeure partie de la classe politique américaine, cette question aussi dérangeante que fondamentale, puisqu'elle pose in fine la question des rôles respectifs de la défense et de la dissuasion dans la lutte contre la prolifération, doit être examinée avec attention. Il faut bien être conscient en outre qu'on n'arrêtera pas toutes les formes de prolifération par la diplomatie. Certaines d'entre elles posent inéluctablement la question des moyens de défense nécessaires pour y parer. Dans cette perspective, la question pertinente est ainsi posée : comment faire en sorte, en développant des stratégies de défense à des fins de protection, de ne pas déstabiliser l'édifice diplomatique, même incomplet ? A. QUELLE STRATÉGIE POUR LES DÉMOCRATIES ? Ni les Etats-Unis ni l'Europe n'ont intérêt à ce que perdure l'absence de consensus sur les stratégies à suivre dans la lutte contre la prolifération : la brèche qui se crée entre des Etats aux intérêts stratégiques pourtant communs, voire identiques, ne sert que les Etats qui tirent avantage d'un blocage de la lutte contre la prolifération. Ainsi, dans une certaine mesure, ni la Russie ni la Chine n'ont intérêt à un déblocage de la situation actuelle, qui est favorable à leurs objectifs stratégiques : la première parce que cela lui permet de préserver l'héritage d'une époque dans laquelle elle était une superpuissance, la seconde parce qu'elle trouve non seulement une occasion, mais plus encore une justification à la modernisation de son arsenal nucléaire. S'agissant de l'Inde, l'affichage, par les Etats-Unis, de priorités strictement nationales vient nourrir son propre discours sur la légitimité de ses choix. Reste à définir les voies d'une stratégie renouvelée de lutte contre la prolifération. A n'en pas douter, cette quête passe nécessairement par une réflexion de fond sur non-prolifération et contre-prolifération. D'ores et déjà, deux conclusions s'imposent : - il n'existe pas de rapport exclusif entre ces deux concepts. S'autoriser à une réflexion large sur le contre-prolifération ne signifie pas faire table rase du passé dominé par la non-prolifération. Bien au contraire : comme nous l'avons montré auparavant, celle-ci a largement rempli ses objectifs et c'est sur les moyens de la renforcer - et de l'adapter le cas échéant aux paramètres de la nouvelle ère stratégique ouverte depuis 1989 - qu'il faut s'interroger ; - cette réflexion de fond doit être multilatérale. De même que les politiques de non-prolifération ont fonctionné parce qu'elles reposaient sur une base contractuelle, de même, une éventuelle politique de contre-prolifération ne fonctionnera que si elle est fondée sur cette même base. Il faut éviter l'unilatéralisme, qui ne conduira qu'à ruiner l'ensemble de l'édifice. 1. Le constat : des approches divergentes entre les démocraties Le moteur traditionnel de la non-prolifération qu'étaient les Etats-Unis est en panne, du fait d'un Congrès qui, sous l'impulsion des Républicains au départ, au sein des deux partis désormais, réprouve la logique même des engagements mulilatéraux et va jusqu'à refuser de ratifier ceux qui ont été négociés par le Gouvernement. Or, l'Europe, en dépit de progrès constants dans l'élaboration d'une politique de non-prolifération, n'est pas en mesure aujourd'hui de prendre le relais des Etats-Unis dans la non-prolifération, tout en affichant un silence gêné sur le contre-prolifération. a) Les contradictions de l'unilatéralisme américain Les Etats-Unis croient-ils encore à la maîtrise des armements (arms control), dont ils furent pourtant les concepteurs et les prédicateurs les plus convaincus depuis les années 1960 ? Les années récentes ont vu se multiplier dans ce pays les remises en cause, plus ou moins directes, plus ou moins radicales, de cette stratégie de lutte contre la prolifération fondée sur la limitation des armes de destruction massive par des traités internationaux multilatéraux ou bilatéraux. Le fait même qu'au département d'Etat américain, la fonction de secrétaire d'Etat adjoint à la maîtrise des armements et la lutte contre la prolifération ait été disjointe - les deux domaines étant désormais de la responsabilité de deux secrétaires d'Etat adjoints - montre que le mécanisme de l'arms control n'est plus considéré comme l'outil de lutte contre la prolifération par excellence, mais que celle-ci fonctionne avec ses propres outils et avec une logique différente. Certes, jamais la pression anti-prolifération n'aura été aussi forte qu'en ce moment aux Etats-Unis, comme l'atteste la richesse du débat stratégique, qui s'étend même à l'opinion publique grâce aux projets de déploiement d'un système national de défense antimissile (National Missile Defense ou NMD). Mais jamais non plus la détermination de la plus grande partie de la classe politique américaine de traiter cette question dans un cadre strictement national et de remettre en cause les instruments traditionnel de la non-prolifération et du désarmement n'aura été aussi affirmée. Le rejet du fond - les régimes de non-prolifération - est-il une conséquence du rejet de la forme - le multilatéralisme - ou est-ce parce que la majorité de la classe politique américaine ne veut plus de l'approche multilatérale, qu'elle rejette les politiques de non-prolifération ? La réponse tient sans doute dans les deux hypothèses. Reste que, pour certains responsables américains, NMD semble également signifier « No More Disarmament », pour reprendre le titre d'un article de George Bunn, l'un des principaux artisans du TNP. · Le rejet du multilatéralisme Tous les débats stratégiques américains soulignent la montée très forte d'un certain unilatéralisme américain, qui se traduit notamment par le rejet du désarmement multilatéral. Aux yeux des Etats-Unis, la crise du désarmement multilatéral est incarnée, en termes institutionnels, par la paralysie de la conférence du désarmement et, en termes techniques, par les évolutions technologiques qui rendent la lutte contre la prolifération extrêmement difficile. Le rejet du TICE par le Sénat américain en 1998 représente sans doute l'acte le plus symbolique de cette tendance. Il ne s'agit pas ici de rappeler le contexte politique complexe dans lequel s'est déroulé ce vote. Reste néanmoins à faire la part, dans ce rejet par 51 voix contre 48 d'un traité que les Etats-Unis ont largement contribué à promouvoir et à faire aboutir, entre les motivations proprement politiques et les oppositions de fond au principe même du multilatéralisme comme outil de lutte contre la prolifération nucléaire en l'occurrence. Le résultat est là néanmoins, et les propos entendus par la mission auprès de ses interlocuteurs américains confirment la prégnance des thèses unilatéralistes. Ainsi, M. Steve Hadley, conseiller pour les affaires stratégiques de M. George Bush Jr, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, M. Steve Cambone, Directeur de recherche à la National Defense University et ancien directeur de la commission Rumsfeld, et M. Christopher Makins, Président de l'Atlantic Council des Etats-Unis, ont confirmé à vos rapporteurs qu'il existait aux Etats-Unis un très grand scepticisme sur l'efficacité des régimes de non-prolifération, dans la mesure où ils ne sont pas crédibles, « trop lourds et coûteux pour l'immense majorité des Etats qui respectaient leurs obligations, pas assez exigeants pour les Etats qui trichaient ». Tel est également le message qui ressort de la série d'auditions99 conduite par la commission des affaires étrangères du Sénat américain, du 21 au 30 mars 2000, sur la politique américaine de non-prolifération. Certes, le fait même que ce sujet ait été abordé dans une telle enceinte est un signe plutôt positif dans la mesure où il existe aux Etats-Unis une relative inattention à ce dossier, généralement abordé en deux phrases en introduction, avant le « vrai » sujet : quelle défense contre la prolifération ? De ces auditions, il ressort, outre un constat unanime sur la réalité de la menace, une critique largement partagée des outils juridiques multilatéraux. Les plus modérés, minoritaires, estiment qu'en dépit de leurs limitations intrinsèques, de tels outils conservent leur utilité. Ainsi, aux yeux de Joseph Cirincione, du Carnegie Endowment for International Peace, 100« en dépit des analyses de certains experts qui estiment que le réseau de traités, d'organisations et d'accords qui fonde le régime de non-prolifération n'est pas adapté aux travaux du nouveau siècle, je dirais que ce régime a bien surmonté les épreuves de l'histoire. Et il a un argument supplémentaire en sa faveur : il fonctionne ». Cependant, pour la majorité des spécialistes entendus par le Sénat, non contents d'être inutiles, ces régimes sont dangereux : ils ne donnent que l'illusion de la sécurité et, par le blanc-seing que l'adhésion à ceux-ci confère, ils permettent à des Etats peu scrupuleux de profiter des coopérations scientifiques et technologiques organisées par ces régimes, ce qui renforce encore la menace pesant sur les Etats-Unis. Ainsi, pour Robert Joseph, Directeur au centre de recherche sur la contre-prolifération à la National Defense University101, « Aujourd'hui, (...) nous n'avons plus les moyens de nous offrir le luxe de traiter la prolifération comme un problème politique (...) Le TNP, la convention sur les armes biologiques et le traité d'interdiction des armes chimiques ont un faible impact sur les Etats qui ne respectent pas les normes internationales ». Pour Steve Cambone, « L'approche actuelle d'adhésion universelle en faveur d'organisations globales est insuffisante... Nous devrions résister aux pressions visant à faire en sorte que les Etats-Unis et d'autres investissent davantage dans les concepts d'adhésion universelle, de désarmement global et de confiance dans des régimes internationaux d'inspection ». Et cet expert de proposer une discussion multilatérale sur l'inadéquation de l'approche multilatérale : « Nous devons en parler avec la communauté internationale ; nous ne pouvons pas faire cela de manière unilatérale et sans prendre en compte ses intérêts ». L'un des experts stratégiques entendus par les sénateurs est même allé jusqu'à soutenir que le TICE était dangereux car il renforçait la prolifération des armes de destruction massive en minant la crédibilité de la dissuasion américaine... · La NMD comme révélateur Si le rejet du TICE, symptôme le plus spectaculaire de la tendance unilatéraliste, conduit à poser une question aussi radicale que celle de l'attachement de l'« hyperpuissance » américaine à l'arms control, c'est non seulement parce que, comme nous l'avons montré ci-dessus, il ne fait pas qu'exprimer la mauvaise humeur du Sénat américain à l'égard d'une administration décriée, mais également parce qu'il ne constitue pas un acte isolé. Les débats nourris sur la NMD depuis deux ans aux Etats-Unis s'inscrivent dans la même tendance. Ils remettent en cause les paradigmes classiques de la non-prolifération, et de la dissuasion, tant sur la forme que sur le fond. (1) Sur la forme, ce projet traduit une remise en cause de l'approche traditionnelle de la lutte contre la prolifération, dans la mesure où les Etats-Unis ont affirmé leur volonté de mettre en _uvre une défense antimissile, avec ou sans l'accord de la Russie sur la modification du traité ABM. A cet égard, il faut souligner qu'aux yeux d'une partie influente de la classe politique américaine, le débat sur la compatibilité entre la NMD et le traité ABM relève de la spéculation intellectuelle, pour la simple raison, selon eux, que le traité ABM a disparu avec l'URSS. Tel est en substance l'argumentaire développé par le sénateur Jesse Helms, qui conteste le fait que la Russie soit l'Etat successeur de l'URSS, en dépit d'accords signés en ce sens entre les Etats-Unis et les Etats issus de l'ex-URSS en 1997, et se refuse donc à reconnaître l'existence de ce traité. Ainsi, le 26 mai 1999, à l'occasion d'une réunion de la commission des affaires étrangères du Sénat américain, ce sénateur déclarait qu'il était « largement reconnu que le traité ABM lui-même avait disparu avec la dissolution de l'Union soviétique ». Et le même d'ajouter que « le temps était venu de laisser de côté le traité ABM ». La suite de l'argumentaire développé par ce sénateur montre que l'argumentaire juridique est une man_uvre qui cache mal le fait que les courants unilatéralistes américains refusent de voir les Etats-Unis liés par des traités internationaux, dès lors qu'ils estiment que les intérêts du pays s'y opposent : « le traité ABM n'apporte rien aux Etats-Unis aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, même dans un contexte de vide juridique, c'est de compliquer les plans de défense antimissile (...) L'idée de limiter les défenses antimissiles est une proposition moralement nulle pour une Nation qui a tant les capacités qu'un besoin urgent de ce type de défenses. (...) Aucune nation n'a le droit de rayer de la carte les villes américaines et aucune nation n'a le droit de mettre son veto aux plans de défense américains. La Russie n'est pas l'Union soviétique et elle ne devrait pas être encouragée à penser le traité ABM dans les mêmes termes que l'Union soviétique ». Loin d'être isolé, le Sénateur Helms a été rejoint par 24 de ses collègues pour déclarer, dans une lettre publique, qu'il ne ratifierait aucun accord avec la Russie limitant la NMD, ce qui inclut notamment les accords de démarcation de 1997102. Il n'est pas besoin de préciser que cette argumentation à une valeur douteuse au regard du droit international : la Russie est l'état successeur de l'URSS, comme on le voit notamment à l'ONU. Néanmoins, au vu des règles constitutionnelles américaines concernant la ratification des traités internationaux, qui impose de recueillir la majorité absolue des voix au Sénat, il est très clair qu'aucun des accords de 1997 notamment ne pourra obtenir une majorité suffisante devant le Congrès dans l'état actuel du rapport des forces politiques américaines. Certes, il serait hâtif de juger de la nature de la politique étrangère américaine à partir des déclarations des plus radicaux de ses acteurs. Néanmoins, même s'ils sont excessifs, de tels propos ne doivent pas être tenus pour insignifiants, car ils témoignent en l'occurrence d'un débat de fond sur lequel la classe politique américaine dans son ensemble a trouvé un véritable consensus. D'aucuns objecteront que la décision du Président Clinton du 1er septembre dernier - en l'occurrence une non-décision puisqu'il a laissé à son successeur le soin de décider de la construction du radar qui viole le traité ABM - montre que les Etats-Unis n'envisagent pas facilement de se retirer d'un traité bilatéral. Encore faudrait-il déterminer la part qu'ont prise, dans cette décision, les enjeux de politique extérieure et les problèmes intérieurs : dans le contexte d'une campagne pour l'élection présidentielle très ouverte, on penchera plutôt en faveur de considérations de politique intérieure. D'autres encore feront remarquer qu'aucun traité international n'est gravé dans le marbre et, qu'en l'occurrence, le traité ABM a déjà été modifié, y compris récemment. Ainsi, le traité ABM a fait l'objet de modifications assez importantes le 26 septembre 1997, dans l'indifférence générale de la communauté internationale d'ailleurs. Quatre accords ont en effet été conclus à cette date entre la Russie et les Etats-Unis : - un document sur la multilatéralisation du traité, spécifiant que la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan succèdent à l'URSS comme Etats parties au traité ; - un accord sur les basses vitesses, concernant les défenses de théâtre dont les intercepteurs ont une vitesse inférieure ou égale à 3 km/seconde ; - un accord sur les vitesses élevées, concernant les défenses de théâtre dont les intercepteurs ont une vitesse supérieure à 3 km/seconde ; - un accord sur des mesures de confiance. Néanmoins, comme le souligne Gérard Errera, Directeur des Affaires politiques au ministère des affaires étrangères, dans quelle mesure la remise en cause du traité ABM par les Etats-Unis ne préjuge-t-elle pas de la contestation des traités relevant du même esprit ? Et notamment, ne risque-t-on pas de voir les Etats-Unis poser la question de la pertinence d'un traité contemporain du traité ABM, c'est-à-dire du TNP ? HISTORIQUE DES PROJETS DE SYSTÈME DE DÉFENSE ANTIMISSILE Depuis le lancement de Spoutnik, il n'est pas un président américain qui n'ait attaché son nom à un projet de défense antimissile ; aucun n'est cependant parvenu à terme. Les premiers temps : la course à la défense Le premier projet envisagé dès 1957 frappe par son ampleur : le système Ballistic Anti-Missile Boost interceptor (BAMBI) proposé par le Pentagone vise à déployer 3 600 satellites en orbite basse prêts à lancer des mini-missiles afin d'intercepter les ICBM soviétiques. Dès 1964 cependant, le projet est jugé irréalisable, notamment au regard des coûts comparés de l'attaque et de la défense. Le déploiement par l'URSS d'un système ABM autour de Moscou conduit néanmoins les Etats-Unis à lancer un nouveau projet : en 1967, le Secrétaire à la défense Robert McNamara lance le programme Sentinel, dans le but officiel de protéger le territoire américain contre une attaque chinoise. Là encore, c'est un système de grande envergure qui est envisagé puisque l'objectif est de déployer 2 500 missiles intercepteurs, répartis sur 25 sites différents (16 sites équipés chacun de 100 missiles Spartan dotés d'une charge nucléaire en vue d'interceptions exo-atmosphériques et 9 sites équipés de missiles Sprint également pourvus d'une charge nucléaire mais réalisant des interceptions dans l'atmosphère). La mise en place d'un réseau de 23 radars d'alerte et de désignation d'objectifs est également prévue. Le traité ABM ou le triomphe de la dissuasion Le projet Safeguard développé sous l'administration Nixon reprend largement la configuration du programme Sentinel, dans un objectif différent : à la logique de défense s'ajoute le souci de rester dans la course technologique avec l'URSS qui poursuit un programme ambitieux. Les progrès parallèles des négociations sur le contrôle des armements conduisent néanmoins à revoir à la baisse le projet dont le déploiement n'est plus envisagé que sur deux sites en 1971, configuration que le traité ABM de 1972 confirme en droit. L'amendement à ce traité introduit en 1974 limite encore le schéma de déploiement puisqu'un seul site est autorisé pour chacune des parties : Moscou pour l'URSS, le site de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, pour les Etats-Unis. Ce dernier est opérationnel le 1er octobre 1975, pour peu de temps toutefois puisque, dès le mois de janvier 1976, le Congrès met fin au programme Safeguard. Il faut voir dans ce revirement la marque de trois facteurs. Les deux premiers sont d'ordre technique : d'une part, il est évident que l'impulsion électromagnétique suscitée par l'explosion de charges nucléaires dans la haute atmosphère aurait des conséquences désastreuses sur l'ensemble des équipements électroniques militaires, y compris d'ailleurs sur le réseau de radar utilisé par Safeguard ; d'autre part, la capacité des missiles à têtes multiples de l'adversaire à pénétrer le système lui enlève toute pertinence. Le troisième facteur est d'ordre stratégique : au milieu des années 1970, force est de constater que la menace chinoise avancée par l'administration Johnson pour justifier le programme Sentinel ne s'est pas réalisée. La logique de contrôle des armements balistiques, que symbolise le traité ABM, joue à plein, dans un contexte de consensus national autour du concept de dissuasion et de destruction mutuelle assurée. La relance du débat : le projet IDS Ce consensus ne dure qu'un temps et ne résiste pas au refroidissement des relations entre les deux Grands. Avec l'annonce, le 23 mars 1983, par le président Reagan de l'Initiative de défense stratégique (IDS), dont le but avoué est de rendre les armes nucléaires « impuissantes et obsolètes », les Etats-Unis reviennent à un programme très ambitieux de défense antimissile, que symbolise l'expression de « bouclier antimissiles ». Par rapport aux projets précédents, la différence dans le modèle d'interception envisagé tient à l'utilisation de technologies novatrices (lasers basés dans l'espace) et à une intervention très précoce des interceptions, prévues dans la phase propulsée du missile assaillant. Le programme ne résiste cependant pas au changement d'Administration, et encore moins à la fin de la guerre froide - à laquelle il a d'ailleurs contribué en entraînant le régime soviétique dans un défi qu'elle n'a pas pu relever. Dans cette perspective, mais également en considération des progrès techniques qu'elle a suscités dans la recherche sur la défense antimissile, grâce aux 26 milliards de dollars qu'elle a reçus, l'Initiative de défense stratégique a de facto au un impact majeur. S'il semble au premier abord difficile d'établir un lien de filiation entre le programme SDI et son successeur, le GPALS (Protection Globale Contre des Frappes Limitées), la part de la défense active dans la dissuasion reste la même, quoiqu'adaptée au nouvel environnement stratégique. Il ne s'agit plus en l'occurrence de se protéger contre une attaque massive par un adversaire identifié, mais de parer à l'éventualité d'un lancement accidentel ou non autorisé, ce qui conduit à un format relativement réduit. Ce programme vise en effet à permettre l'interception de 200 têtes, grâce au déploiement avant 1996 de 1 000 intercepteurs au sol (ground-based interceptors), sur le site de Grand Forks, ainsi que d'un réseau de radars et de satellites d'alerte. Parallèlement, les enseignements tirés de la guerre du Golfe conduisent à une relance des programmes de défense antimissile de théâtre. L'ensemble se traduit par l'adoption, en 1991, du Missile Defense Act qui prévoit : - une renégociation immédiate du traité ABM sur trois points (possibilité d'augmenter le nombre de radars et d'intercepteurs, question de la flexibilité du traité vis-à-vis de nouvelles technologies d'interception et démarcation entre défense de théâtre et défense du territoire). Des négociations sont entreprises dès 1992 avec la Russie ; - un déploiement au plus vite d'une capacité limitée de défense du territoire. * Bambi, Sentinel, Safeguard, SDI, GPALS... Autant de projets qui témoignent de la prégnance d'un thème structurant du débat stratégique américain, même s'il est vrai qu'au plus fort de la rivalité stratégique américano-russe, le souci de ne pas se laisser distancer par la technologie de l'autre, voire de défier en permanence les capacités technologiques et financières de l'adversaire, était également présent. La SDI en est sans aucun doute l'exemple extrême. Plus fondamentalement, la succession de ces différents programmes traduit la tension constante dans la pensée stratégique américaine entre dissuasion et défense ou plus exactement, entre dissuasion pure et réintroduction de la défense dans la dissuasion. (2) Mais c'est sur le fond que la NMD marque la rupture la plus radicale dans la lutte contre la prolifération, en ce que ce projet joue l'unilatéralisme contre une certaine forme de diplomatie multilatérale, la défense contre une certaine lecture de la dissuasion - la dissuasion pure « à la française » - à l'encontre du consensus stratégique qui prévaut à l'échelle internationale depuis vingt ans. Certes, loin d'être un thème nouveau dans le débat stratégique aux Etats-Unis103, la défense antimissile hante la réflexion des stratèges et experts de ce pays depuis 1957, date de la fin de l'invulnérabilité du territoire américain suite au lancement de Spoutnik par l'URSS. Depuis lors, les recherches, les développements, voire les prémisses de mise en _uvre de systèmes de défense contre les missiles balistiques intercontinentaux n'ont jamais cessé, sauf à de rares exceptions. Certains experts104 estiment qu'au total, 120 milliards de dollars ont été dépensés depuis les années 1950 dans ce secteur, dont 69 milliards de dollars depuis l'annonce de la SDI par le président Reagan, en 1983. En ce sens, on pourrait croire que la National Missile Defense (NMD) n'est en définitive que le nouvel avatar des projets de défense du territoire américain contre les missiles balistiques qui ponctuent le débat stratégique dans ce pays depuis plus de quarante ans maintenant. L'aperçu historique ci-dessus, en soulignant l'enracinement de la NMD dans le long terme, conduit dans le même temps à s'interroger sur l'effectivité de ce qui n'est encore qu'un projet : après tout, pas plus les systèmes limités tels que le GPALS qu'a fortiori les programmes extrêmement ambitieux de type SDI n'ayant été mis en _uvre, pourquoi la NMD ne serait-elle pas promise au même sort, dès lors que sera passée l'échéance électorale de 2000 ? Certains responsables russes soulignent d'ailleurs à l'envi cet écart déjà observé entre une rhétorique et un affichage très volontaristes et les tendances lourdes de l'histoire stratégique américaine des cinquante dernières années qui font ressembler la défense antimissile à un serpent de mer. La NMD n'est-elle donc en définitive qu'un projet de plus ? Les prémisses de ce programme pourraient laisser penser qu'on se trouve une fois encore face à un projet susceptible de durer aussi longtemps que l'Administration qui l'a lancé. L'histoire de la défense antimissile aux Etats-Unis souligne en effet qu'aucun projet n'a survécu, dans sa configuration initiale, à l'Administration qui l'a promu. De fait, dès son arrivée au pouvoir, le Président Clinton a infléchi la politique de défense antimissile en faveur de la défense de théâtre (Theater Missile Defense), en ne maintenant qu'une veille technologique sur ce qui s'appelait déjà la National Missile defense (NMD). C'est à ce moment que fut créée, au sein du Pentagone, dans la lignée de la SDIO, la BMDO (Ballistic Missile Defense Organization), organisme chargé de piloter les différents projets de défense antimissile. La décision même prise par le Président Clinton le 1er septembre témoigne de ce qu'il laisse le soin à son successeur de décider de la configuration de la NMD. Pourtant, si la filiation historique de la NMD avec les projets précédents est indéniable, il ne semble pas qu'elle soit promise au même sort, le contexte stratégique, la technologie, de même que la situation politique intérieure, ouvrant à ce projet déjà avancé des perspectives de mise en _uvre solides. Pour reprendre l'expression d'Ivo Daalder105, la question pertinente est, non de savoir si les Etats-Unis vont déployer une défense nationale antimissile, mais comment ils vont le faire. En effet, la victoire des Républicains au Congrès en 1994 - et à nouveau en 2000 - a introduit de nouveaux paramètres dans l'équation politico-stratégique : d'une certaine manière, le pouvoir exécutif a perdu depuis cette date la maîtrise d'un projet pourtant traditionnellement associé à l'Administration en place, au profit des parlementaires, républicains d'abord, des deux camps ensuite, qui en font leur cheval de bataille populaire dans l'opinion américaine. Ce qui s'apparente à une « politisation » bipartisane de la défense antimissile explique à bien des égards le débat actuel et la forte probabilité que le projet aboutisse. A partir de 1994 en effet commence une période d'affrontements continus sur la défense antimissile entre les deux pouvoirs. En 1995, le président Clinton oppose son veto à une proposition de loi sur la défense antimissile, en invoquant les menaces qu'elle fait peser sur le processus de négociations START ; le Congrès vote néanmoins une enveloppe de 3,7 milliards de dollars en faveur de l'ensemble des systèmes de défense antimissile, soit de 30 % supérieure à la demande présidentielle. Une nouvelle offensive législative intervient en 1996, sous l'égide du leader de la majorité sénatoriale, Bob Dole, et du speaker de la Chambre, Newt Gingrich. Si elle échoue, elle n'en influe pas moins la politique de l'administration qui propose un nouveau plan dit « 3 + 3 », soit trois ans de développement et trois ans avant un déploiement éventuel. Fondé sur le rapport rendu par les services de renseignement américains de 1995 sur l'évaluation de la menace (National Intelligence Estimate ou NIE), déjà évoqué qui conclut à l'absence de menace balistique pour le territoire des Etats-Unis avant 2010, il permet à l'administration de gagner du temps sur un projet qui lui échappe de plus en plus. La pression républicaine ne se poursuit pas moins, avec une nouvelle proposition du leader de la majorité sénatoriale Trent Lott en 1997. C'est en 1998 que les termes du débat actuel se nouent : dans un contexte marqué par une double inquiétude à l'égard des arsenaux russe (crainte d'un lancement accidentel ou non autorisé vu la dégradation du système d'alerte avancée) et chinois (discours sur la « menace chinoise »), le rapport rendu par la commission présidée par l'ancien Secrétaire d'Etat à la défense, Donald Rumsfeld, chargée par le Congrès d'évaluer la menace balistique pesant sur le territoire américain106, remet totalement en cause la NIE de 1995107. L'impact du rapport Rumsfeld a été en outre décuplé par l'évolution du contexte stratégique en 1998, avec l'intervention d'essais successifs de missiles balistiques par plusieurs pays. Le 6 avril 1998, le Pakistan teste le Ghauri ; le 11 avril, c'est au tour de l'Inde de tester le missile Agni II. Viennent ensuite les essais nucléaires indiens et pakistanais. En juillet intervient un essai de missile iranien. Enfin, le 31 août 1998, la Corée du Nord teste le Taepo Dong 1, qualifié par les experts américains de « tir de validation du rapport Rumsfeld », expression qui en dit long sur le consensus rapide et non remis en cause depuis qui s'est développé autour du rapport Rumsfeld. Le gouvernement américain n'a pu que prendre acte de ce consensus. Ces différents éléments conduisent l'Administration Clinton à revoir sa position : le concept de « 3 + 3 » est abandonné au profit d'un nouveau calendrier. D'une part, en janvier 1999, le Secrétaire d'Etat à la Défense, William Cohen, annonce que l'administration décidera à l'été 2000 de déployer ou non une défense nationale antimissile, tout en repoussant le délai limite de déploiement effectif de 2003 à 2005. D'autre part, l'Administration Clinton propose pour la première fois une ligne budgétaire pour l'acquisition de matériels de défense antimissile, gonflant ainsi le budget de la défense antimissile de 6,6 milliards de dollars supplémentaires, 10,5 milliards de dollars étant prévus au total sur cinq ans. Ces annonces ne suffisent pas à apaiser le Sénat qui propose d'inscrire dans la loi le principe du déploiement d'une défense antimissile « aussitôt que techniquement possible ». Les démocrates se résolvent à une stratégie consensuelle en proposant deux amendements disposant, pour l'un, que l'autorisation du budget pour le déploiement d'un système antimissile doit être annuelle, pour l'autre que la politique américaine doit continuer à rechercher des réductions négociées de l'arsenal russe. C'est dans ce contexte qu'est promulgué, le 22 juillet 1999, le National Missile Defense Act, qui dispose que « la politique des Etats-Unis est de déployer aussitôt que techniquement possible une défense nationale contre une attaque limitée par des missiles, qu'elle soit accidentelle, non autorisée ou délibérée ». En décembre 1999, un document publié par la Maison Blanche, A National Security Strategy for a new Century, explicite les quatre critères qui fonderont la décision présidentielle de l'été 2000 : - l'évolution de la réalité concrète de la menace (« whether the threat is materalizing ») ; - l'état de la technologie validée par une première série de tests rigoureux et l'efficacité opérationnelle du système proposé ; - le coût du système (« whether the system is affordable ») ; - enfin, les conséquences de la poursuite du programme sur l'environnement stratégique global et sur les objectifs des Etats-Unis dans le domaine de la maîtrise des armements, y compris dans le domaine de la réduction des armes nucléaires stratégiques dans le cadre de START II et START III. Depuis le 1er septembre 2000 et à la suite de l'échec du troisième essai d'interception au début du mois de juillet de cette année, on sait que l'ensemble de ces critères a conduit le gouvernement américain à remettre à plus tard la décision de déploiement. Après avoir atteint son paroxysme au cours des six derniers mois écoulés, la vigueur du débat sur ce projet devrait donc décliner dans les mois à venir, notamment du fait des échéances électorales et du temps nécessaire à l'installation de la nouvelle administration. Non qu'il faille conclure hâtivement à une marginalisation de ce projet, bien au contraire : les débats récents ont renforcé l'imprégnation profonde de l'ensemble de la classe politique américaine par le projet de défense antimissile. Avec la non-décision de Bill Clinton, le problème a été repoussé dans le temps mais nullement résolu. Les échecs successifs, les critiques internes et internationales et, enfin, les risques stratégiques mis en avant devraient tout au plus faire entrer le programme dans une phase de moindre visibilité - sans sous-financement cependant - et se traduire par un regain des réflexions sur les conditions techniques de développement du programme, dans la lignée des recommandations du rapport Welsh. En effet, dans le contexte de préparation du rapport Rumsfeld, plusieurs réflexions de haut niveau sur la NMD avaient été entreprises visant, pour le Pentagone, à mieux contrôler l'évolution des programmes gérés par le BMDO et, pour l'administration présidentielle, à prendre l'initiative dans la polémique qui l'opposait au Congrès. Ainsi, un groupe d'experts (Panel on Reducing Risk in Ballistic Missile Defense Flight Test Programs), placés sous la direction de l'ancien Chef d'Etat-major de l'Air Force Larry Welsh, rendait ses premières conclusions en février 1998. Il soulignait alors la trop grande précipitation dans laquelle les programmes étaient entrepris avec la crainte de voir ces programmes « courir à l'échec » (rush to failure). Le groupe a d'ailleurs réitéré ses conclusions en novembre 1999. En outre, un programme peut en cacher un autre : s'il est probable que la NMD dans sa configuration actuelle cesse d'être un programme fédérateur de haut profil dans l'immédiat, il est tout aussi probable que ce projet reviendra sur le devant de la scène par le biais du débat sur l'interception en phase de décollage (Boost Phase Interception ou BPI), doté d'une charge politique beaucoup moins lourde que l'actuelle NMD, du fait de la modification moins radicale du traité ABM qu'il suppose et des possibilités de coopération avec la Russie qu'il recèle. b) La laborieuse émergence d'une politique de non-prolifération européenne Le retrait américain des politiques de non-prolifération conduit à s'interroger sur l'identité des acteurs alternatifs susceptibles, non seulement de reprendre le flambeau, mais également de se poser en interlocuteur crédible des Etats-Unis sur les questions de prolifération dans leur ensemble. Les regards se tournent dès lors vers l'Union européenne qui présente dans ce domaine un visage paradoxal. Le premier paradoxe réside dans le bilan de la politique européenne de non-prolifération, qui se limite essentiellement au domaine nucléaire. Certes, « au cours des dernières décennies et alors que la prolifération des armes nucléaires devenait une préoccupation majeure de sécurité, l'Union européenne s'est progressivement affirmée comme un acteur important de la non-prolifération. Cet acquis européen en matière de non-prolifération est le fruit d'un intérêt croissant pour cette question, dont on peut situer les origines dans les années 60, mais qui s'est réellement matérialisé dans les années 90 avec le rapprochement des positions de tous les pays européens. »108. Reste qu'aujourd'hui, la politique de non-prolifération européenne est en panne : aucune initiative n'est intervenue depuis 1995, alors que les régimes de non-prolifération n'ont jamais été aussi menacés. Ce paradoxe incite à se demander si l'Union européenne veut - ou peut - vraiment être un acteur de la non-prolifération. Le deuxième paradoxe est à chercher dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de schizophrénie européenne : autant l'Europe a investi intellectuellement, politiquement et juridiquement dans la non-prolifération, autant elle est muette sur la prolifération en général et plus encore sur le thème de la lutte contre la prolifération. Comme le note Joachim Krause, « l'opinion générale est qu'il s'agit là d'un processus malsain et dangereux, mais on cherche rarement à savoir ce qu'il signifie précisément »109. En ce sens, les perspectives de dialogue euro-américain semblent bien maigres. Dernier paradoxe, et non le moindre : alors que l'Europe est stratégiquement la plus concernée et la plus vulnérable à toutes les formes de prolifération, compte tenu de la géographie110, elle ne semble pas intéressée à ce problème. Il s'agit pourtant en l'occurrence d'un problème de protection élémentaire de son territoire et de sa population. · Les prémisses d'une politique européenne de non-prolifération L'émergence d'une politique européenne de non-prolifération n'allait pas de soi. D'une part, elle n'a été possible qu'avec la fin du monopole russo-américain sur cette question au milieu des années 1980. D'autre part, l'arme nucléaire est traditionnellement un sujet difficile entre les pays européens. Ainsi, dans les années 1970 et 1980 : - « deux pays (France et Espagne) n'étaient pas membres du TNP et critiquaient même la logique du Traité ; - deux Etats nucléaires (France et Royaume-Uni) poursuivaient leurs expérimentations nucléaires et refusaient d'envisager une quelconque participation aux négociations de désarmement nucléaire ; - les Européens étaient divisés, à propos des contrôles à l'exportation de technologies nucléaires, entre les partisans des « garanties intégrales » (Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas) et les tenants d'une approche plus souple (France, Allemagne et Belgique) ; - l'avenir des Forces nucléaires de portée intermédiaire (FNI) américaines stationnées en Europe partageait les populations européennes entre les partisans d'un désarmement rapide et de négociations avec l'URSS, et ceux qui craignaient surtout le découplage stratégique entre Europe et Etats-Unis ».111 Les progrès de la prolifération dans les années 1970 ont cependant conduit l'Europe à se pencher sur le sujet, alors que les pays européens comptaient parmi les fournisseurs les plus importants dans le domaine des biens et technologies sensibles112. C'est pour cette raison qu'ils se sont fortement impliqués dans la création de régimes de contrôles à l'exportation. Notamment, sous la pression américaine, l'Allemagne fédérale, la France et le Royaume-Uni ont participé aux travaux du Groupe des fournisseurs nucléaires en qualité de membres fondateurs et définissent les « directives de Londres » (1975), qui visent à jeter les bases d'une politique commune de contrôles à l'exportation pour les membres du « Club ». Comptant à l'origine sept membres (Allemagne de l'Ouest, Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, URSS et Japon), le « Club de Londres » s'est élargi en 1976-1977 à de nouveaux Etats (Allemagne de l'Est, Belgique, Italie, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Suède et Suisse) dont trois appartiennent à la Communauté européenne. Par ailleurs, comme le rappelle Camille Grand, c'est également à cette époque que les Européens s'illustrent, entre 1977 et 1980, dans les débats internationaux portant sur la non-prolifération et le cycle du combustible nucléaire, connu sous le nom d'INFCE (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation), pendant lesquels Allemands de l'Ouest, Belges, Britanniques et Français se trouvent sur la même ligne face aux Américains, qui jugent proliférante l'industrie du retraitement. · Le rapprochement des politiques européennes de 1981 à 1995 A partir de 1981, l'intérêt croissant des Européens pour la non-prolifération nucléaire reçoit un début de traduction institutionnelle, avec son inclusion dans le mécanisme intergouvernemental de la Coopération politique européenne (CPE), instituée en 1970. Comme le note Harald Müller, « entre 1985 et 1990, la coopération en matière de non-prolifération s'est intensifiée. Le groupe s'est réuni plus souvent, au moins deux fois par présidence. Les consultations bilatérales sont devenues habituelles. Les messages COREU (du nom du système intra-européen de télégrammes diplomatiques) se sont multipliés »113. La concertation au sein de la CPE aboutit même, au sommet de Dublin en 1990, à l'adoption d'un document commun sur la non-prolifération. Il faut toutefois attendre le début des années 90 pour que ce rapprochement prenne véritablement forme, avant de se concrétiser à l'occasion de l'action commune de 1994-1995. Plusieurs facteurs se conjuguent qui contribuent à l'émergence d'une véritable politique européenne sur le sujet : le contexte international, et notamment la guerre du Golfe, acte fondateur à plusieurs égards des politiques suivies dans ce domaine au cours de la décennie, mais également le changement décisif dans le contexte européen que représente l'adhésion de la France au TNP, annoncée le 3 juin 1991 et effective en août 1992. Il s'agit là d'un événement majeur qui fait sauter le dernier verrou à la mise en place d'une politique européenne plus visible. A partir de 1991, se multiplient les initiatives communes, tandis que la PESC en gestation place la non-prolifération au nombre des sujets importants. Ce sont les Européens qui formulent en 1991-1992 les principes qui ont donné naissance au programme « 93 + 2 ». Ce sont également eux qui sont à l'origine de la déclaration commune du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 janvier 1992, assimilant la prolifération des armes de destruction massive à une « menace pour la paix et la sécurité internationale ». Dans cette logique, le Conseil européen de Lisbonne, définissant les domaines de la politique étrangère et de sécurité, « qui pourraient, dès l'entrée en vigueur du traité [de Maastricht], faire l'objet d'actions communes » au titre de la PESC, cite d'emblée « les questions relatives à la non-prolifération nucléaire ». La traduction concrète de cet affichage de la non-prolifération dans la politique européenne ne se fait pas attendre et se manifeste par deux actions majeures. D'une part, le 19 décembre 1994, le Conseil européen adopte simultanément une réglementation communautaire et une action commune relative aux exportations de biens à double usage. « Au terme d'une négociation difficile, cette double décision vient compléter l'harmonisation des contrôles européens à l'exportation de technologies sensibles, notamment nucléaires »114. Mais c'est surtout l'action commune décidée pour la préparation de la Conférence d'examen du TNP de 1995 qui marque l'apogée de la politique européenne de non-prolifération. La décision de mener une action commune a été prise lors du sommet de Corfou (24-25 juin 1994), qui a défini « les orientations pour une action commune relative à la préparation de la conférence de 1995 des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ». La déclaration finale précisait que l'action commune devrait être préparée sur la base des orientations suivantes : - parvenir à un « consensus parmi les partenaires en faveur d'une prorogation illimitée et inconditionnelle du TNP »; - « promouvoir cet objectif auprès des Etats parties au traité qui pourraient ne pas partager cette conviction » ; - « convaincre les Etats qui ne sont pas encore parties au traité d'y adhérer, si possible avant 1995, et pour aider les Etats disposés à y adhérer à accélérer leur adhésion ». Visant principalement à la reconduction illimitée du TNP, cette action commune a été couronnée de succès grâce à une étroite collaboration entre Européens (et avec les Américains) et à une campagne diplomatique de grande envergure. Notons pourtant que l'objectif ambitieux défini par l'action commune, à savoir le choix d'une prorogation inconditionnelle pour une durée illimitée, n'allait pas de soi pour plusieurs Etats membres : « cette option relançait des débats intellectuels sur la logique du TNP en France ou en Allemagne ; elle est surtout longtemps apparue en contradiction avec des objectifs plus ambitieux en matière de désarmement nucléaire pour des pays comme l'Irlande et la Suède ». Le discours prononcé au nom des Quinze par le Ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, est symptomatique de l'état d'esprit de la politique européenne de non-prolifération à cette époque : « L'Europe compte (...) des pays qu'a longtemps et douloureusement divisés la guerre froide, des pays dont les niveaux de développement économique diffèrent encore sensiblement, des pays qui ont une industrie nucléaire civile conséquente et d'autres qui ont fait des choix énergétiques différents, des pays dotés de l'arme nucléaire et d'autres qui y ont renoncé. (...) Ce qui les unit aujourd'hui, c'est d'avoir fait le même choix en faveur d'une prorogation indéfinie du Traité de non-prolifération. Nos différences soulignent avec force le sens de ce choix puisqu'elles s'effacent devant notre volonté d'assurer la pérennité d'un bien commun : le Traité de non-prolifération des armes nucléaires. L'Union européenne s'est engagée sans équivoque, par une action commune, en faveur de la prorogation indéfinie et inconditionnelle du TNP. Cet engagement n'est pas pour surprendre. (...) Parce que nous sommes convaincus que, comme l'a déclaré le Conseil de sécurité réuni au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement le 31 janvier 1992, la prolifération des armes nucléaires constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Enfin, parce que, face à cette menace, nos pays savent que le TNP correspond à un besoin fondamental de la communauté internationale. (...) Considérons notre objectif commun plutôt que nos différences. (...) La prorogation indéfinie du Traité de non-prolifération constitue la seule solution compatible avec ces objectifs ». Il serait présomptueux d'attribuer à l'action de l'Europe le succès de la Conférence. Il est certain en revanche que celle-ci a pu conduire certains Etats parties à adhérer plus volontiers au consensus sur la prolongation indéfinie du traité, dans la mesure où cet objectif n'a pas été porté uniquement par les Etats-Unis. Reste qu'au-delà de cet objectif global de prorogation du traité, la participation des Etats européens à la Conférence s'est faite en ordre dispersé et que ceux-ci ne sont pas parvenus à dépasser les lignes de fracture classiques entre EDAN et ENDAN, au mépris des solidarités européennes. En résumé, « individuellement, les gouvernements européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont joué des rôles constructifs et utiles aux moments critiques de ces négociations épineuses. Collectivement, l'Europe est restée muette »115. Du point de vue de la PESC, c'est donc d'une semi-réussite qu'il faut parler, plus encore avec le recul, qui montre que cette action n'a pas enclenché la dynamique que l'on pouvait en attendre. · La politique européenne de non-prolifération depuis 1995 ou l'impossible émergence de l'acteur européen Force est de constater qu'après l'accélération de la politique européenne de non-prolifération au cours des années 1994-1995, un palier semble avoir été atteint. Plus encore, alors que jamais les défis lancés aux régimes de non-prolifération n'auront été aussi nombreux, les vieilles querelles et les vieux démons européens dans le domaine nucléaire ont resurgi. A telle enseigne qu'il faut constater aujourd'hui « une renationalisation des politiques de désarmement et de non-prolifération »116, comme si, de 1995, les Européens n'avaient retenu que la reprise des essais nucléaires et non leur action commune en faveur de la prorogation illimitée du TNP. Il est vrai que la décision française de reprendre les essais nucléaires est symptomatique de cette « renationalisation » que nous venons de relever. Elle a, de fait, suscité une vraie rupture au sein de l'Union européenne. Lors du vote d'un résolution à l'Assemblée des Nations Unies, seul le Royaume-Uni s'est montré solidaire et s'est abstenu de tout commentaire négatif, l'Allemagne et l'Espagne restant, il est vrai, particulièrement modérées dans leurs déclarations. D'autres symptômes ont révélé la persistance de fractures toujours importantes sur le nucléaire en Europe. Ainsi, le débat, en 1996, autour de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de l'emploi ou de la menace d'emploi des armes nucléaires a également donné lieu à des divisions flagrantes au sein de l'Union européenne. Au cours de la phase orale de la procédure, seuls quatre pays de l'UE ont soutenu la thèse de la licéité (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni), alors que la Suède se prononçait contre. D'où, depuis 1995, un maigre bilan européen en termes d'actions communes et, pour tout dire, le retour à « ce qui est encore trop souvent le cadre commun de la PESC : une politique essentiellement déclaratoire mais rarement audible »117. Et même, les quelques actions et positions communes, ou encore les déclarations de la Présidence masquent mal l'inexistence, voire les divisions des Européens sur ces questions. Ce constat vaut moins pour l'action commune du 29 avril 1997, consacrée à la transparence en matière de contrôles à l'exportation qui a une importance réelle pour l'avenir du régime de non-prolifération. En revanche, l'exemple de l'action commune « relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO) », décidée lors du Conseil européen de Madrid des 15-16 décembre 1995, est révélateur de cette incapacité de l'Europe à émerger en acteur crédible de la non-prolifération. En pratique, la participation européenne, gérée par l'Euratom, se limite en effet à une contribution financière l'autorisant à siéger au conseil d'administration de la KEDO. Faute d'une véritable alternative proposée par l'Europe, le dossier nord-coréen reste donc bilatéral, c'est-à-dire essentiellement dominé par les Etats-Unis. Au-delà d'un certain activisme verbal, l'Union européenne n'a lancé aucune initiative majeure depuis la Conférence du TNP de 1995. « L'examen détaillé des dernières années montre une Union européenne peu innovante, parfois divisée dans les débats, qui ne se rassemble que pour des déclarations attendues et sans impact réel. » Certes, comme le note Christophe Carle, "à l'argument que la PESC est vouée à ne produire que des déclarations, on pourra objecter que l'importance du déclaratoire est loin d'être négligeable dans le domaine de l'anti-prolifération"118. Mais l'ampleur des crises intervenues en Asie du Sud, en Irak ou en Corée du Nord, dans lesquelles des armes de destruction massive ont été impliquées, pouvait laisser espérer de la part de l'Europe plus qu'une posture déclaratoire, ni visible ni même lisible dans les cas de l'Irak, de l'Inde et du Pakistan. Il est éminemment regrettable, dans ce dernier cas, qui représente un bouleversement majeur du paysage stratégique mondial, que les Européens aient eu une réaction tardive et peu susceptible de faire avancer un dossier qui ne saurait pourtant supporter le statu quo. Ainsi, « Au mois de mai, deux déclarations de la présidence ont fait suite aux essais, l'Union européenne s'affirmant "consternée et déçue" et appelant les deux pays à signer le TICE et à contribuer à l'ouverture de la négociation du traité d'interdiction de production des matières fissiles. Elaborée tardivement en octobre 1998 (!), une position commune visant « à contribuer à assurer la non-prolifération des missiles nucléaires et balistiques en Asie du Sud et à instaurer un climat de confiance » a également une dimension essentiellement déclaratoire, les pays européens paraissant divisés sur l'opportunité de sanctions sévères pour les deux pays d'Asie du Sud et privilégiant la poursuite du dialogue »119. Seul peut-être le traitement du cas russe et des pays issus de l'ex-URSS peut sembler satisfaisant, comme nous l'avons vu précédemment. Tant le programme franco-allemand AIDA MOX que la participation européenne à l'ISTC ou l'action commune sur le chimique et le nucléaire reflètent la cohésion de l'engagement européen en faveur de la non-prolifération nucléaire, mais aussi chimique et biologique. Au total, le bilan de la politique de non-prolifération européenne est maigre, à telle enseigne qu'il faut se poser la question de savoir si les Européens veulent vraiment émerger comme acteur de la non-prolifération. « L'Union semble paradoxalement être revenue à un stade antérieur dominé par l'adoption de déclarations communes relevant du plus petit dénominateur commun »120. Certes, il ne faut pas minimiser les acquis depuis le début des années 80. On ne peut conclure pour autant à l'existence d'une véritable politique de non-prolifération qui permette à l'Europe de prendre le relais des Etats-Unis dans la conduite de la non-prolifération au niveau international. Plusieurs facteurs expliquent ce blocage. En premier lieu, le repli sur des positions nationales est sans nul doute plus facile que le développement de véritables politiques concertées. Dans ces conditions, seuls émergent au niveau européen les éléments les plus consensuels, généralement sans grande portée, qui reflètent la « tyrannie du plus petit dénominateur commun » (Camille Grand). En deuxième lieu, l'impasse de la politique de non-prolifération est liée à l'absence d'une réflexion européenne globale sur la prolifération, sur ses enjeux stratégiques et sur les moyens de défense qu'elle implique. Or, faute d'une expertise propre sur les menaces liées aux armes de destruction massive, l'Europe ne pourra jamais être un acteur majeur et crédible de la politique de non-prolifération. Il est à cet égard révélateur que, dans les cas de proliférations régionales en Asie, certains pays européens ne voyaient pas l'intérêt d'une prise de position européenne, estimant que l'Europe n'était pas concernée ! En troisième lieu, le problème nucléaire reste au c_ur des divergences européennes. Il existe à cet égard un véritable tabou européen, dont la levée conditionne les progrès de la politique européenne de non-prolifération mais également l'amorce d'une réflexion sur les stratégies de lutte contre la prolifération, totalement absente à ce jour. Sans débat sur le rôle de l'arme nucléaire en Europe, comment définir en effet une position européenne sur la non-prolifération ? 2. Pour une approche contractuelle Les divergences d'approche qu'on observe aujourd'hui parmi les grandes démocraties sur ce que doit être la lutte contre la prolifération au début du XXIème siècle ne sont pas à la hauteur des enjeux : - d'un côté, les avatars du projet américain de défense antimissile nationale et la levée de boucliers quasi unanime qu'il suscite dans le monde illustrent clairement les impasses de l'unilatéralisme américain, alors même que la question posée par ce projet mérite un examen sérieux ; - de l'autre côté, le silence européen, ou du moins le caractère inaudible de la politique européenne de non-prolifération n'est pas tenable alors que l'Europe est pourtant concernée au premier chef. a) Les impasses de l'unilatéralisme américain La remise en cause par les Etats-Unis de la politique internationale de lutte contre la prolifération ne saurait se faire entre les murs d'un Congrès hermétique à toute logique extérieure, qui fonctionne entièrement replié sur lui-même, alors que les décisions qu'il prend ont un impact sur la stabilité internationale. Car, de fait, en dépit d'une terminologie aussi maladroite que trompeuse, la NMD a des implications globales extrêmement importantes. · Le premier enjeu international de la NMD concerne l'avenir du traité ABM et, à travers lui, la stabilité stratégique internationale. Le projet NMD est en effet incompatible avec le traité ABM signé en 1972 par les Etats-Unis et la Russie121. C'est pourquoi le gouvernement américain a proposé à la Russie d'apporter des modifications à ce traité. Aux dires des Etats-Unis, il ne s'agirait que de légers ajustements au traité. Les Russes, tout au contraire, dénoncent une remise en cause radicale du traité, suivis en cela par une grande partie de la communauté internationale comme en témoigne l'adoption, le 5 novembre dernier, d'une résolution par le premier Comité de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à un strict respect des dispositions du traité ABM. Qu'en est-il exactement ? La question est fondamentale dans la mesure où, le traité ABM est généralement considéré, non comme une relique de la guerre froide, mais comme l'outil nécessaire à la préservation de l'équilibre de la relation de dissuasion entre les Etats-Unis et la Russie. L'analyse des mécanismes du traité et l'architecture du projet NMD montre qu'on ne peut effectivement pas adapter le traité à la NMD sans le remettre radicalement en cause, pour deux raisons : - en premier lieu, le traité a mis en place trois types de mécanismes pour garantir l'exercice d'une dissuasion mutuelle. (1) Dans son article 1er, il prohibe le déploiement de systèmes de défense antimissile destinés à défendre l'ensemble du territoire. Une seule exception est autorisée, au niveau régional (protocole de 1974) : chacune des parties au traité est autorisée à déployer un système limité (100 intercepteurs et 100 lanceurs) dans un rayon inférieur ou égal à 150 kilomètres. La Russie a choisi le site de Moscou et les Etats-Unis, le Dakota du Nord (désaffection du site dès 1975). (2) Il instaure des mécanismes destinés à prévenir la mise en place rapide d'une défense antimissile, en interdisant la construction d'infrastructures ainsi que le développement, l'essai et le déploiement de composants susceptibles de servir de base au déploiement rapide d'un tel système. Les intercepteurs pouvant être construits relativement rapidement, ce sont essentiellement les détecteurs qui sont visés par cette disposition. (3) Il prévoit des dispositions permettant d'éviter le contournement des interdictions qu'il édicte. Sont notamment prohibés les systèmes de défense aérienne ainsi que les défenses antimissile de théâtre pouvant être utilisés contre des missiles balistiques. S'agissant des systèmes de détection, seuls des radars de pré-alerte sont autorisés, sous des conditions restrictives ; - or, l'adaptation du traité à la NMD suppose de remettre fondamentalement en cause deux de ces mécanismes, ce qui reviendrait à faire perdre au traité une partie considérable de sa substance. Les Etats-Unis présentent les modifications requises pour adapter le traité à la NMD comme étant mineures, les comparant à celles qui ont permis, en 1974, d'instaurer un système régional de défense antimissile dans chaque pays. Trois modifications seraient seulement requises à leurs yeux : l'autorisation de déploiement de 100 intercepteurs sur un site unique (Alaska) ; la modernisation des radars d'alerte existants et le déploiement d'un radar ABM additionnel sur le territoire de chaque partie. Serait ajouté un engagement des parties à ouvrir de nouvelles négociations au printemps 2001 afin d'adapter le traité aux modifications éventuelles de l'environnement stratégique (déploiement des deux autres phases de la NMD) souhaité par les Etats-Unis. En réalité, même dans sa première phase122, il semble que la NMD requiert des modifications substantielles du traité ABM : - elle va à l'encontre de l'article 1er du traité ABM qui interdit de déployer un système de défense anti-missiles protégeant l'ensemble du territoire ; - contrairement aux dispositions de 1974 permettant de déployer un système régional, le X-band radar sera déployé à 1 000 kilomètres (îles Aléoutiennes) du site de déploiement des intercepteurs (Alaska) ; - l'utilisation de radars de pré-alerte basés au Royaume-Uni et au Groenland est contraire aux dispositions interdisant le déploiement de composantes d'un système anti-missiles sur le territoire d'un tiers. Certes, le traité ABM a déjà connu plusieurs modifications. Ainsi, en septembre 1997, deux accords ont été signés par les parties à New York (demarcation agreements), visant à permettre le déploiement de systèmes de défense anti-missiles de théâtre -notamment le système américain de THAAD ou Theater High-Altitude Area Defense. Les accords de démarcation de 1997 Les deux accords sur les vitesses des intercepteurs sont au c_ur des négociations de 1997. Ils trouvent leur origine dans le flou juridique du traité sur les défenses de théâtre, apparu au grand jour quand les Etats-Unis ont décidé d'accélérer leurs programmes de défense de théâtre après la guerre du Golfe. C'est notamment en considération de l'incertitude sur la compatibilité des performances du système THAAD avec le traité ABM que les Etats-Unis proposèrent ces négociations à la Russie en 1993. Les Etats-Unis souhaitaient obtenir la reconnaissance par le traité de tous les systèmes de défense de théâtre, pour peu qu'ils ne soient pas testés contre des missiles d'une portée supérieure à 3 500 kilomètres. La Russie pour sa part voulait interdire tout système à haute vitesse, ce qui aurait conduit à autoriser le THAAD mais pas le système naval Navy Theater Wide (NTW), dont la vitesse des intercepteurs est de 4,5 km/seconde. Les accords conclus reflètent ces positions de départ et frappent par leur nature très différente. Le traité sur les vitesses basses spécifie clairement que tout système dont les intercepteurs ont une vitesse inférieure à 3 km/seconde sont compatibles avec le traité, dès lors qu'ils ne sont pas testés contre des missiles cibles qui ont une vitesse supérieure à 5 km/seconde ou une portée supérieure à 3 500 kilomètres. L'accord sur les vitesses élevées est beaucoup plus flou : il se contente de préciser que les systèmes à haute vitesse doivent répondre aux mêmes conditions d'essai que les systèmes à vitesse basse et que les parties au traité devront discuter de toute question qui reste sur ce type de systèmes. C'est donc le principe d'une négociation au cas par cas qui a été retenu. On notera toutefois qu'en dépit de son caractère quelque peu inachevé, cet accord spécifie que sont interdits tous les intercepteurs basés dans l'espace et que les missiles contre les missiles intercontinentaux (ICBM) sont en fait interdits. Les nouvelles modifications souhaitées par les Etats-Unis vont bien au-delà de ces changements puisqu'elles conduiraient à permettre une NMD limitée mais sans empêcher une évolution rapide du système vers un système antimissile complet ou un contournement des dispositions du traité. La Russie souligne pour sa part l'ampleur des capacités de repérage, de traçage et de guidage qui seraient acquises par les Etats-Unis. Par ailleurs, elle juge que la construction des infrastructures nécessaires au déploiement de la première phase porte en elle un développement beaucoup plus important du système. Enfin, elle nourrit de réelles inquiétudes sur les capacités énormes de renseignement et de surveillance dont les Etats-Unis seront en mesure de disposer dans ce cadre, alors qu'elle-même n'est pas en mesure de moderniser, voire simplement d'assurer la maintenance du réseau de radars d'alerte avancée relativement sophistiqué qu'elle avait déployée dans le cadre du traité initial. Il est vrai que la localisation du radar ultra-sophistiqué qui doit être construit dans la première phase (îles Aléoutiennes), de même que celle du radar que les Etats-Unis envisagent de moderniser en Norvège (à Varda, soit au point le plus oriental du pays) ne les incitent guère à accorder beaucoup de foi aux discours américains sur la menace nord-coréenne ou iranienne... · Au-delà de ces débats techniques, la question essentielle réside dans la portée internationale d'une telle modification du traité ABM et dans un éventuel effet domino sur les autres traités de désarmement. La plupart des experts français s'attachent, avec d'autres, à souligner la réaction en chaîne que ce programme est susceptible de déclencher dans les programmes balistiques ou nucléaires nationaux. S'agissant du traité ABM, la question de savoir si la remise en cause de ce traité porterait atteinte à l'équilibre stratégique international a été largement débattue. Tous les opposants à la NMD ont rappelé avec force qu'il s'agissait de la pierre d'angle en la matière, ce que ne contestent pas d'ailleurs les Etats-Unis. On notera toutefois avec intérêt la thèse dissidente avancée par le négociateur du traité ABM, Henry Kissinger, qui rappelle qu'en définitive, ce traité n'était qu'un pis-aller permettant de maintenir un système minimal de défense antimissile face à un Congrès qui n'en voulait aucun à l'époque. Dans le même temps, c'est l'ensemble des négociations de désarmement qui risquent de pâtir de la décision américaine. Comme on l'a vu précédemment, les différents traités qui fondent le régime de non-prolifération sont inextricablement liés les uns aux autres : que l'un cède, et c'est l'ensemble qui vacille, en vertu du fait que l'édifice ne tient que parce qu'en retour d'un certain degré de vulnérabilité qui est demandé aux Etats, leur est accordée une retenue collective dans tel ou tel champ des armes de destruction massive. Par conséquent, si la plus grande puissance militaire se retire de l'un de ces traités, les autres Etats, militairement inférieurs, pourront estimer que la renonciation à certaines armes de destruction massive les met dans une situation dangereuse soit directement, soit indirectement par effet induit sur les puissances régionales voisines. Un certain nombre d'Etats pourraient appliquer aux Etats-Unis le raisonnement appliqué par ceux-ci à la Corée du Nord : d'un pays impossible à dissuader, donc susceptible de recourir à une attaque balistique de manière relativement imprévisible, il faut se prémunir en renforçant le nombre de ses propres missiles. De fait, les Russes ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se tiendraient plus liés par les accords de désarmement nucléaires, y compris le traité FNI. Même si cette annonce est largement rhétorique, dans la mesure où une reprise des programmes d'armements russes est difficilement envisageable, ne serait-ce que pour des raisons financières, elle laisse présager des négociations difficiles dans les enceintes du désarmement, dont le fonctionnement est déjà laborieux. De même, la Chine n'hésitera pas non plus à arguer de ce programme pour bloquer durablement la négociation sur l'arrêt de la production des matières fissiles (cut-off), déjà extrêmement difficile, et pour poursuivre la modernisation de ses forces nucléaires, qui sont, en l'état, vulnérables à la NMD. L'effet domino sur ses voisins, rencontrés par la mission, serait alors inéluctable : New Delhi a les yeux rivés sur Pékin, tandis qu'Islamabad est obsédé par l'évolution de l'arsenal indien. b) La nécessité d'un débat collectif sur non-prolifération et contre-prolifération C'est, en définitive, à une révolution copernicienne de la lutte contre la prolifération que les Etats-Unis appellent la communauté internationale. Or, celle-ci doit être discutée, et non imposée, sous peine de conduire à une équation globale de la sécurité, non pas à somme nulle, mais au résultat largement négatif. Le débat doit porter tant sur la non-prolifération que sur la contre-prolifération. · En premier lieu, le postulat américain selon lequel les régimes de non-prolifération auraient vécu avec la fin de la guerre froide et seraient inadaptés pour répondre aux risques posés par la dissémination des armes de destruction massive dans un certain nombre de pays, doit être combattu avec vigueur. Mais il ne suffit pas pour cela de multiplier les condamnations globales sur les dangers de la prolifération : de même que les Etats-Unis ont un travail collectif à mener sur les vertus partagés de la défense et de la dissuasion, de même l'Europe, puisque c'est la seule alternative possible sur ce dossier, doit faire entendre sa voix et discuter avec les Etats-Unis des raisons qui la conduisent à conclure à la nécessité de renforcer les régimes de non-prolifération. Ni dans un cas, ni dans l'autre, l'approche dogmatique ne doit prévaloir sur la démonstration stratégique. Il est à cet égard pour le moins regrettable que, dans le domaine de la non-prolifération balistique par exemple, la principale initiative constructive émane de la seule Russie, à laquelle la Chine s'est jointe. Ni la volonté ni les outils communs ne manquent aux Européens. Il ne faut en effet pas négliger qu'au-delà de leurs divergences, les Européens sont tous attachés à l'existence des traités et à la logique de la non-prolifération. Or, « dans ce contexte, l'influence des Européens n'est pas seulement liée à l'addition des poids nationaux de chacun des pays membres de l'Union européenne, mais peut également jouer de la diversité même des positions européennes qui constituent paradoxalement un réel multiplicateur d'influence »123. En bref, c'est paradoxalement si les Européens montrent qu'ils sont capables de faire entendre un discours fort sur la non-prolifération que les Etats-Unis considéreront l'Union européenne comme un interlocuteur crédible sur l'ensemble des questions liées à la dissémination des armes de destruction massive. Pour faire entendre sa voix sur les limites de la contre-prolifération, considérée aux yeux de tous les Européens comme un complément, et non comme un substitut aux régimes de non-prolifération, il faut en effet que l'Europe montre sa détermination à préserver ces derniers et son engagement concret en matière de contrôle à l'exportation notamment. · De même que les incantations sans conséquences concrètes n'ont pas de sens s'agissant du renforcement des régimes de non-prolifération, de même, la condamnation plus ou moins audible, en ordre dispersé, des projets américains de défense antimissile, voire le rejet de toute réflexion sur le sujet, ne suffit pas. A l'inverse, du côté des Etats-Unis, ce projet ne mérite pas d'être considéré uniquement comme un enjeu de politique intérieure américaine. De leur côté aussi, les Etats-Unis doivent prendre conscience de la voie sans issue que représente l'unilatéralisme dès lors qu'est en jeu l'équation stratégique globale. En bref, pour mettre fin à la course contre la montre qui se joue entre un processus de décision et un débat dense aux Etats-Unis et un débat en Europe qui ne fait que commencer, il faut que les deux parties acceptent de discuter l'ensemble de ces sujets. Car, tôt ou tard, le débat aura lieu : en dépit de ses failles et du caractère inadapté de la méthode choisie, le programme américain de défense antimissile pose en effet une question pertinente sur les rôles respectifs de la dissuasion et de la défense dans un contexte de multiplication et de diversification des menaces. Aucune puissance nucléaire, pas même les Etats non nucléaires en Europe, ne pourra faire l'économie d'une telle réflexion. Nul doute que l'Europe devra se la poser. Certains de nos voisins ne sont d'ailleurs pas insensibles à cette problématique124 : sans parler des Britanniques qui semblent considérer comme acquis le déploiement de la phase I, tout en s'inquiétant du déploiement d'une éventuelle phase II, les Italiens sont sensibles aux analyses américaines sur la menace venant du Moyen-Orient. Non sans raison : à supposer en effet que certains des pays visés officiellement par le programme NMD développent dans les délais estimés par les Etats-Unis des missiles de moyenne à longue portée et qu'ils veuillent en faire une utilisation agressive, beaucoup plus que le territoire des Etats-Unis, ce sont les territoires des pays européens ou de la Russie qui seront les premiers menacés. Pourquoi poser aujourd'hui la question de la valeur de la dissuasion ? Durant quarante ans, le monde a vécu sous le régime de l'équilibre de la terreur nucléaire, de la destruction mutuelle assurée (Mutual Assured Destruction ou MAD). Dans un tel contexte, la dissuasion pure, c'est-à-dire à base des seules armes offensives - on dissuade par la menace de milliers de morts civils, en restant soi-même sans défense -, était la règle sacro-sainte. Ce que proposent aujourd'hui les Etats-Unis, ce qu'ils ont déjà proposé dans les années 1980, c'est ni plus ni moins de sortir de la MAD : le discours de George W. Bush du 23 mai 2000 fait en effet écho à celui prononcé quelque dix-sept ans plus tôt, le 23 mars 1983, par Ronald Reagan. Avec le refus de la MAD, on retrouve donc une antienne du discours républicain qui consiste à rendre les armes nucléaires « impuissantes et obsolètes », c'est à dire à entrer dans un monde dénucléarisé. Sauf qu'aujourd'hui, alors que la guerre froide est finie, de telles propositions ne sont pas sans écho auprès d'une opinion publique américaine et européenne lasse de l'arme nucléaire ou d'une Russie qui pourrait y voir l'occasion de négocier la réduction inéluctable de son arsenal nucléaire. De fait, la proposition américaine met l'accent sur la fragilité intrinsèque du concept de destruction mutuelle assurée : la MAD a toujours été socialement fragile, dans la mesure où le concept selon lequel être soi-même vulnérable est considéré comme une bonne chose et « tuer des gens » un objectif souhaitable, est une notion profondément contre nature et difficile à justifier au plan de la morale. La mission ne prétend nullement dans ce rapport clore un débat de quarante ans mais souhaite en revanche vivement insister sur son importance dans le nouveau contexte stratégique et technologique de l'après-guerre froide : la réflexion stratégique ne saurait se nourrir de dogmes. De fait, à y regarder de plus près, le lien entre défense et dissuasion n'est pas univoque et mérite un débat approfondi, à l'encontre des réactions épidermiques observées en Europe ou en France qui se bornent à décréter que la défense tue la dissuasion. Comme le souligne Thérèse Delpech125, plusieurs arguments peuvent en effet être avancés, tendant à montrer au contraire que les deux concepts se renforcent : - la défense peut compléter la dissuasion. Tel est d'ailleurs le principe du traité ABM qui aménage un espace de défense, dont l'URSS a d'ailleurs profité ; - alors que, dans la logique de guerre froide, la dissuasion offensive est la seule police d'assurance, en revanche, dans un monde où émergent de nouveaux acteurs, dont on ignore s'ils sont sensibles à la dissuasion, il n'est pas dit que la défense ne soit pas la meilleure police d'assurance. Certes, l'idée que certains Etats pourraient ne pas être sensibles à la dissuasion est discutable - et c'est d'ailleurs là une des grandes faiblesses du discours américain ; mais les années récentes et l'actualité encore soulignent la difficulté de traiter, selon des modes classiques, un Saddam Hussein ou un Milosevic. Au minimum, les erreurs de calcul sont hélas possibles ! - dans un monde multipolaire, la pression qui pèse sur la dissuasion est beaucoup plus forte que dans un contexte bipolaire, en vertu du triptyque « plus de joueurs, plus d'incertitudes, plus de risques » ; Mais comme le montre encore Thérèse Delpech, il est tout aussi possible de plaider que dissuasion et défense sont incompatibles : - les deux concepts reflètent deux âges stratégiques différentes. La dissuasion ne serait qu'un vestige du passé, tandis que la défense représenterait l'avenir dans un monde stratégique aux contours mouvants ; - la présence de système de défense antimissile pourrait pousser les états qui n'en sont pas dotés à des frappes en premier, dans la mesure où le seuil nucléaire est repoussé, voire supprimé ; - les systèmes de défense amoindrissent la crédibilité de la dissuasion sans offrir des garanties aussi importantes que celle-ci. En effet, des Etats proliférants peuvent utiliser bien d'autres moyens que les missiles pour porter des armes de destruction massive, notamment biologiques. Que conclure de ces quelques réflexions sinon que, comme nous l'avons souligné précédemment, le débat mérite autre chose que le dogmatisme ? De vraies questions sont en jeu, que rappelle avec justesse Thérèse Delpech : « Allons-nous vers un monde dominé par la défense, après avoir vécu dans un monde dominé par la dissuasion ? La dissuasion élargie est-elle soutenable à l'avenir dans un monde sans défenses antimissiles ? Comment les principaux acteurs étatiques pratiqueront-ils la dissuasion au XXIème siècle ? La dissuasion deviendra-t-elle résiduelle dans les stratégies post-modernes ? Dans quelles circonstances sera-t-il nécessaire de faire appel à la dissuasion ? »126. Et l'on serait même tenté d'ajouter une question : ne pas vouloir discuter de l'adéquation même de la dissuasion au nouveau contexte international, n'est-ce pas porter atteinte à sa crédibilité, la « fossiliser » en quelque sorte ? Un bref regard sur les débats stratégiques de la guerre froide montre en effet que la dissuasion a toujours fait l'objet de débats intenses et n'a, en tout cas, jamais été conçue comme un outil figé. Sa capacité à s'adapter à la situation stratégique et politique est la condition de son efficacité. Vrai durant la guerre froide, ce postulat l'est plus encore aujourd'hui. * Quelle stratégie pour les démocraties ? La réponse à cette question tient en deux mots : contrat et débat. L'existence d'une seule puissance, fût-elle une hyperpuissance, ne saurait justifier l'unilatéralisme, dont les effets sont contraires à l'objectif recherché de renforcement de la sécurité nationale, dans la mesure où c'est la sécurité globale elle-même qui serait remise en cause. A cet égard, et dans la mesure où la tendance au repli sur soi émane essentiellement d'un Congrès hermétique à tout ce qui se passe en dehors de Washington127, des rencontres multilatérales entre les parlementaires européens et américains pourraient être extrêmement utiles. Les experts stratégiques des deux rives de l'Atlantique débattent d'ores et déjà de longue date de ces questions. Mais puisque c'est le Congrès qui a la haute main sur les affaires stratégiques, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Encore faut-il le convaincre d'écouter. Pour cela, l'Europe, et notamment les Parlements nationaux et le Parlement européen, devraient s'affirmer comme un acteur crédible sur ces questions et développer une véritable stratégie dans ce domaine. B. QUELLE STRATÉGIE POUR L'EUROPE ? Pourquoi l'Europe ne parvient-elle pas à s'affirmer comme le nouveau leader des politiques de non-prolifération ou, au moins, à s'intéresser à ces sujets ? Les pages qui précèdent fournissent une esquisse de réponse, qui tient essentiellement aux divergences majeures des Européens sur l'arme nucléaire. Pour cette raison, la prolifération n'est actuellement abordée en Europe qu'à travers l'OTAN, sans qu'existe d'ailleurs dans cette enceinte une stratégie consensuelle en la matière. La question de l'intégration de cette problématique dans les structures de l'Europe de la défense reste donc entière. Le statu quo est pourtant impossible : des pays sources de prolifération sont aux frontières de l'Europe ; par ailleurs, comment concevoir qu'une force multinationale déployée soit composée de soldats diversement protégés contre des risques biologiques ou chimiques ? L'Europe est enfermée dans un cercle infernal : alors qu'elle en a les moyens et la volonté, elle ne parvient pas à aller plus avant dans la non-prolifération parce qu'elle se refuse à parler de la prolifération en général. Ce par peur d'aborder le débat sur la défense et la dissuasion comme moyen de répondre à la prolifération. Or, ce que révèle le blocage des politiques de non-prolifération, c'est qu'il est impossible de restreindre le champ de réflexion sur la prolifération aux seuls régimes de non-prolifération. Pour sortir de cette spirale, les pays européens doivent par conséquent aller au-delà des faux débats, des non-dits et des tabous, et commencer à réfléchir de manière plus large aux menaces qui pèsent sur la sécurité du vieux continent comme sur les moyens, politiques, diplomatiques ou militaires qu'ils veulent mettre en _uvre pour y faire face. A l'heure où l'Europe de la défense se construit, faire l'impasse sur ce débat minerait sérieusement la crédibilité du processus en cours. 1. Le constat : entre non-dits, non-débats et tabous S'il n'existe pas aujourd'hui de réflexion européenne globale sur la prolifération, essentiellement à cause du tabou nucléaire, de nombreux pays européens abordent néanmoins ce thème à travers l'OTAN. a) L'Alliance atlantique et la prolifération Depuis le sommet de Bruxelles en 1994, la prolifération tend à s'affirmer comme l'une des justifications nouvelles du rôle de l'Alliance (avec des conflits régionaux hors zone). En 1994, lors du sommet de Bruxelles, l'Alliance atlantique reconnaît que la prolifération des armes de destruction massive représente une menace pour elle. Deux groupes sont alors créés : le Senior Group on Proliferation (SGP), à l'activité assez réduite, et le Defense Group on Proliferation (DGP), plus efficace. Le principe est celui d'une co-présidence entre les Etats-Unis et un allié. Lors du sommet de Washington en avril 1999, les Etats-Unis ont tenté de donner une nouvelle fois de donner un coup de projecteur sur ce thème, tentative quelque peu atténuée par les événements du Kosovo. La question de la prolifération ne pose pas de problème technique pour l'Alliance : elle sait la traiter. En revanche, elle pose un problème de fond sur le sens et le rôle de l'Alliance dans la mesure où la prolifération des armes de destruction massive n'est pas un phénomène qui se développe dans la zone relevant de la compétence de l'Alliance atlantique. Pour autant, si c'est un problème hors zone, ce n'est pas une question hors sujet pour l'Alliance et cela pose un véritable problème de sécurité. D'où la place croissante prise par ce thème et les probables développements qu'il va connaître dans les années à venir. En témoigne la place qui lui est d'ores et déjà attribuée dans la version 2000 du MC 161, document secret élaboré tous les deux ans et présentant l'analyse des risques auxquels les pays de l'Alliance doivent faire face. Traditionnellement, ce document servait à évaluer régulièrement l'état des forces du Pacte de Varsovie ; aujourd'hui, une proportion importante de ce document concerne la prolifération, ce qui n'est pas allé sans susciter les réticences de la France notamment, qui se refusait à avaliser systématiquement l'ensemble des analyses présentées. A ce jour, la réflexion et l'action de l'OTAN dans le domaine de la prolifération se sont développées dans trois directions : - la création d'un centre des armes de destruction massive ; - le développement de programmes de défense antimissile théâtre (TMD) ; - l'information des alliés sur les projets américains de NMD. · Le centre des armes de destruction massive En septembre 1998, lors d'une réunion informelle des ministres de la défense à Villamura, le secrétaire d'État à la Défense, William Cohen, proposa de renforcer les capacités et les activités de l'Alliance en matière de prolifération, en augmentant son information dans ce domaine par la création d'un centre sur la prolifération des armes de destruction massive s'apparentant à une base de données. De cette façon, l'Alliance renforcerait ses capacités sur la protection des populations (capacités civiles d'urgence) et sur leur information. L'enjeu consistait à faire de ce centre, non pas seulement une tour de contrôle du phénomène de la prolifération, mais un point de contact entre alliés, à partir duquel des menaces seraient identifiées, à partir de sources généralement américaines, et dont il faudrait tirer les conséquences politiques et militaires. Ces « propositions » américaines étaient en réalité très directives et en l'absence de consensus global entre les membres de l'Alliance sur l'étendue du rôle que l'OTAN doit jouer en matière de prolifération, le rôle de ce centre, au demeurant fort utile, a été revu à la baisse. Administrativement, le centre a été mis en place en avril-mai 1999, non pas, comme prévu à Villamura hors des locaux de l'Alliance - à l'instar du centre sur la prolifération à Washington -, mais en leur sein, sous l'égide de la direction des affaires politiques. Un chef de centre a été nommé et les alliés se sont engagés à fournir des techniciens sur une base volontaire : le centre se compose actuellement d'un chef canadien, de deux adjoints, italien et français, et de six experts de nationalité diverse. Le centre des armes de destruction massive est un outil modeste pour collecter les informations disponibles dans les Etats de l'Alliance sur la prolifération des armes de destruction massive. Pour l'instant, l'ambition n'est pas de développer des actions ou une position communes de l'Alliance sur ce sujet. Cette conception du centre est le fruit de l'approche politique défendue par la France : le centre est construit comme un soutien aux différents groupes de l'Alliance qui travaillent sur ces sujets (environ 50 comités sont concernés, à des degrés divers) et une instance de coordination de l'information. D'où son rattachement à la direction des affaires politiques, et non à la division des plans. Le débat franco-américain qui s'est joué avec ce centre n'est en fait que la réplique du débat plus vaste qui se joue sur la threat assessment (évaluation de la menace) dans le cadre de la NMD : pour justifier la poursuite de projets militaires, on développe un discours sur la menace, qui lui-même vient nourrir le renforcement des projets existants. Or, dès lors que les informations dont disposent un tel centre émanent d'une source quasiment exclusive, le débat est faussé. Maintenant que le centre existe, il serait cependant souhaitable et constructif d'examiner, sans être dupe des arrières-pensées américaines, comment il pourrait servir à jeter les bases d'actions ou de positions communes de l'Alliance. Cela implique, pour les Etats-Unis, d'accepter le postulat de la multilatéralisation des politiques de contre-prolifération, et, du côté européen, français notamment, une décrispation sur ces sujets. · L'Alliance atlantique et la défense de théâtre Aucune discussion globale sur la défense de théâtre (TMD) n'a eu lieu jusqu'alors entre les Alliés, sauf en ce qui concerne les propositions de la Russie sur une TMD associant la Russie et des pays européens. Les projets de TMD émanant des Etats-Unis n'ont jusqu'alors été abordés qu'au sein des comités. Le NATO TMD Project Group a produit une feuille de route approuvée par la conférence des directeurs des armements nationaux le 13 mars 2000, qui souligne que les tendances de la prolifération suscitent des préoccupations telles que l'OTAN doit développer des programmes susceptibles d'être prêts d'ici à 2010. Ce document rappelle que l'Alliance atlantique a fait le choix d'une approche stratégique large pour préserver sa sécurité dans l'environnement international de l'après-guerre froide et que la défense aérienne intégrée fait partie de cette nouvelle approche. La défense de théâtre contre les missiles balistiques est considérée justement comme une partie de la défense aérienne. C'est donc la conjonction des préoccupations sur la prolifération et de l'existence de programme de défense aérienne qui a conduit petit à petit à l'émergence d'une réflexion très informelle sur la défense de théâtre contre les missiles balistiques. La réflexion atlantique a atteint des stades différents selon le type des programmes concernés : - il existe un consensus au sein de l'OTAN sur l'acquisition par l'Alliance d'une capacité de défense antimissile de courte portée dits de « basse couche » (programmes Patriot PAC - 2 et PAC - 3), qui sont déjà disponibles. La France ne participe pas pour sa part à ces programmes, développant ses propres capacités navales et terrestres à l'horizon 2005 ; - s'agissant des programmes dits de haute couche THAAD et NTW (upper layer approach), l'OTAN développe ce qu'on pourrait appeler une police d'assurance préventive. La seule décision formelle dans ce domaine a été prise par le Conseil en janvier 2000, après l'approbation par le NATO Infrastructure Committee d'une enveloppe de 40 millions de dollars pour lancer une étude de faisabilité auprès de deux industriels sur ces deux types de programmes, qui concernent des missiles de portée égale à 3000 ou 3500 kilomètres. L'objectif est de permettre à l'OTAN de disposer d'une capacité de défense contre les missiles balistiques dans les couches hautes de l'atmosphère à l'horizon 2010. Dans cette optique, le programme français dérivé de l'Aster est considéré comme une capacité susceptible d'être utilisé, en cas de besoin, dans le cadre de l'Alliance. Si l'OTAN prend des assurances techniques en conservant une réflexion technologique sur ces programmes, sans pour autant lancer une politique d'acquisition de ces systèmes, la réflexion politique qui les accompagne manque encore à ce jour. Or c'est là le débat essentiel, qui n'a été encore qu'effleuré avec les demandes française, italienne et allemande pour que les défenses de théâtre protègent non les populations civiles, mais les forces en opération. En ce sens, étant donné le refus européen à discuter du nucléaire, il est difficile de reprocher aux Etats-Unis de ne pas lancer le débat ! · L'Alliance atlantique et la défense antimissile La consultation des alliés sur la NMD est récente puisqu'elle a été lancée à la fin de l'année 1999 : la place donnée à cette consultation dans la liste des conditions fixées par le gouvernement Clinton pour la prise de décision sur la NMD (la dernière !) est éloquente et explique largement la faible priorité qui a été donnée -jusqu'ici au moins- à cette consultation. Le discours des Etats-Unis sur la NMD jusqu'au printemps 1999 était d'ailleurs celui du fait accompli : la NMD allait être déployée, quoi qu'en disent les alliés ou d'autres pays. Cette erreur de la diplomatie américaine a été corrigée depuis lors et les Alliés sont destinataires d'une information très lourde de l'évolution du dossier. Depuis lors, le sujet est abordé sous trois angles à l'OTAN : - l'évaluation du risque. Dès ce stade, des divergences importantes se font jour ; - la faisabilité technique et financière du programme ; - son implication sur le désarmement et le contrôle des armements. Deux discussions ont eu lieu à ce jour, qui n'ont abouti à aucune réponse précise. Jusqu'alors, ce processus de consultation très informel n'a rien donné ; tous les alliés ont d'ailleurs conscience que cette procédure ne peut pas aboutir, du fait des questions si nombreuses et si importantes qu'elle pose. On remarquera que la France a développé le discours et la politique la plus structurée de tous les alliés sur ce dossier, position qui puise d'ailleurs largement dans le débat interne américain. N'oublions pas en effet qu'avant d'être atlantique, le débat sur la NMD est américano-américain. La NMD a néanmoins un impact direct sur l'Alliance car elle introduit la question majeure de la défense antimissile dans le fonctionnement de l'Alliance : pour prendre l'image de l'arbre de Noël, si la NMD se situe à la pointe de l'arbre, on trouve tout en bas, en un remarquable continuum, la défense aérienne et, au milieu, la défense antimissile de théâtre. C'est en vertu de cette continuité que les Etats-Unis soulignent la cohérence entre NMD et TMD. D'ailleurs, l'insistance de pays comme la France pour limiter l'utilisation de la TMD à la protection des forces, et non des populations civiles, est liée au débat de fond sur la NMD et ses conséquences sur la dissuasion. b) L'Europe et la prolifération : le tabou nucléaire L'Union Européenne n'a jusqu'ici développé aucune réflexion autonome sur la prolifération, engagée, en matière de défense, dans une réflexion exclusivement capacitaire. Tout reste à faire concernant la vision stratégique commune et les concepts d'emploi. La répugnance des pays de l'Union Européenne à évoquer la prolifération des armes de destruction massive, réside dans le fait que cela réintroduit la question nucléaire ; de la même façon, le Canada voit dans les initiatives américaines sur la non-prolifération un moyen de justifier le nucléaire américain. Même dans le contexte de l'après-guerre froide, pourtant particulièrement propice à un débat sur l'avenir du nucléaire, le tabou demeure. En témoigne par exemple la manière dont les Européens ont accueilli, en 1995 et 1996, les propositions françaises de « dissuasion concertée », alors même que les réactions européennes à la reprise des essais nucléaires à cette même date ont paradoxalement mis en pleine lumière l'inévitable dimension européenne du débat sur l'avenir de la dissuasion. Ce débat mérite pourtant qu'on s'y arrête, tant il est révélateur des blocages européens sur ce sujet.. Loin d'être une man_uvre dilatoire de la France au moment de la reprise des essais, cette proposition posait pourtant une vraie question, depuis longtemps présente dans le non-débat stratégique européen : « le problème de l'articulation entre la dissuasion française et la défense européenne est une vieille préoccupation, présente dès les origines de l'effort nucléaire français dont elle a même été l'une des principales justifications »128. Et si, pendant la guerre froide, la France a interprété la dissuasion nucléaire de façon uniquement nationale, c'est à la suite de circonstances historiques particulières et non en vertu d'un parti-pris délibérément national. Ainsi, en 1957, avant même l'achèvement du programme nucléaire français, des négociations très poussées ont lieu entre la France, l'Allemagne et l'Italie, allant même jusqu'à la signature d'un protocole d'accord entre les ministres Chaban-Delmas et Strauss. Les dirigeants français ont toujours eu présente à l'esprit la dimension européenne de la dissuasion française, même lorsqu'il s'agissait d'en souligner les limites, voire de la nier. C'est ainsi qu'en 1975, M. Jacques Chirac, alors Premier ministre, déclare que « nos armes peuvent apporter, par leur existence même, une contribution à la défense de l'Europe ». En 1976, le Chef d'état-major des armées, le Général Guy Méry, provoque un tollé en proposant la « sanctuarisation élargie ». Avec la fin de la guerre froide et l'évolution radicale du contexte stratégique, la question est revenue à l'ordre du jour. Le 10 janvier 1992, le Président François Mitterrand déclare que « le débat sur la défense de l'Europe pose des problèmes non résolus qu'il faudra résoudre. Je pense en particulier à la puissance nucléaire. Seuls deux des douze sont détenteurs d'une force atomique, chacun avec sa doctrine nationale. Est-il possible de concevoir une doctrine européenne ? C'est cette question-là qui deviendra très vite une des questions majeures de la construction d'une défense européenne commune ». Le thème n'est abordé que très discrètement dans le Livre Blanc sur la défense de 1994 : « Avec le nucléaire en effet, l'autonomie de l'Europe en matière de défense est possible. Sans lui, elle est exclue ». L'année 1995 voit le sujet revenir au premier plan. Avant même l'annonce de la reprise des essais nucléaires français, M. Alain Juppé, Ministre des Affaires étrangères, évoque le sujet le 30 janvier 1995, lors du vingtième anniversaire du Centre d'analyse et de prévision : « Après l'élaboration d'une doctrine commune à la France et au Royaume-Uni, notre génération doit-elle craindre d'envisager, non une dissuasion partagée, mais au minimum une dissuasion concertée avec nos principaux partenaires ? ». Ce sont ensuite les nouvelles propositions formulées par le Président Jacques Chirac le 31 août 1995 et précisées par Alain Juppé devant l'IHEDN le 7 septembre 1995, visant à réfléchir à une dissuasion concertée avec les partenaires européens de la France, qui relancent le débat sur le rôle et l'avenir de l'arme nucléaire dans la sécurité européenne. Ce thème a enfin été abordé par Lionel Jospin lors de son discours devant l'IHEDN le 7 septembre 1997. Les réactions souvent silencieuses, gênées ou hostiles des partenaires européens de la France à ses propositions de dissuasion concertée ont montré que le débat sur la dissuasion concertée se heurterait à de nombreux obstacles. L'existence d'un coeur nucléaire en Europe (France, Italie et Royaume-Uni) ne doit pas faire oublier la force des oppositions dans ce domaine, notamment de la part des pays nordiques, promoteurs inlassables du désarmement, des pays neutres ou non-alignés (Autriche, Irlande, Suède) qui ne sont pas prêts à faire jouer la solidarité européenne dans ce domaine. Au-delà de leur opposition viscérale au nucléaire, ces Etats ont souligné, de manière contestable, l'incompatibilité entre un débat sur la dissuasion concertée et une politique européenne de lutte contre la prolifération. Pour cette école de pensée, qui rejoint les positions des pays du Tiers Monde, on ne peut à la fois valoriser l'arme nucléaire à travers la dissuasion et en minimiser le rôle au nom de la lutte contre la prolifération. Le deuxième obstacle majeur tient à la présence de la garantie américaine à travers l'OTAN. Car l'attachement de nos partenaires à l'OTAN ne doit pas non plus être sous-estimé. Il demeure puissant, en dépit - ou peut-être à cause - de l'absence de remise à plat de la doctrine de l'OTAN en matière nucléaire et de l'affaiblissement du dispositif nucléaire de l'OTAN en Europe. Cet attachement au statu quo hérité de la guerre froide est d'ailleurs paradoxal : cet héritage fait l'objet d'un consensus politique, bien que devenu stratégiquement peu crédible, alors que, pendant la guerre froide, il était contesté politiquement en dépit de sa très forte crédibilité stratégique. Une autre difficulté doit encore être soulignée, qui concerne moins le principe d'une débat que le calendrier de la construction européenne. De fait, les réactions de la plupart des partenaires de la France en 1995 ont montré qu'à leurs yeux, ce dossier n'était pas prioritaire dans l'Europe qui se construit. Sans doute, « le fait que la question nucléaire soit à terme incontournable dans la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune est une évidence ; que le débat soit porté si tôt sur la place publique l'est déjà moins, dans la mesure où il est largement admis que celui-ci ne pourrait que couronner un long cheminement politique »129. Plusieurs arguments peuvent être avancés à cet égard. On peut d'abord soutenir que l'absence de menace majeure et la pause stratégique induite justifient l'actualité d'un débat : jamais l'Europe n'a connu une situation aussi favorable au regard de sa sécurité globale, c'est donc le moment idéal pour débattre, à froid, de cette question qui ne sera pas polluée par d'autres thèmes. Telles est notamment l'opinion de Bruno Tertrais selon lequel « en l'absence de menace immédiate, le contexte géostratégique contemporain autorise une liberté de réflexion, de discussion et d'analyse qu'il est souhaitable de mettre à profit ». En bref, il serait judicieux de profiter de cette relative pause stratégique pour lever ce qui s'apparente jusqu'alors à un tabou ou à un non-dit de la future Europe de la défense : sa dimension nucléaire. Cet argument est retourné par ceux qui contestent la validité d'un tel débat à l'heure actuelle : précisément, il n'y aurait aucune urgence à évoquer cette question, l'arme nucléaire n'étant plus au centre des débats stratégiques dans l'après-guerre froide. Plus encore, un tel débat, en faisant resurgir des positions divergentes marquées, crisperait les relations intra-européennes et pourrait bloquer d'autres dossiers, à commencer par la constitution de l'Europe de la Défense. Ainsi, Javier Solana avait déclaré, lors du Conseil européen de 1996, que « traiter des questions nucléaires dès maintenant reviendrait à construire une maison en commençant par le toit ». 2. L'objectif : pour une réflexion européenne globale sur la menace et les réponses à y apporter De fait, l'Europe de la défense qui se construit aujourd'hui sous nos yeux se concentre totalement sur des objectifs capacitaires, exclusivement conventionnels qui plus est. A plus ou moins long terme cependant, une réflexion plus vaste sur les menaces et les moyens d'y faire face s'impose : car, pour paraphraser celui qui était alors Secrétaire général de l'Otan et occupe aujourd'hui les fonctions de Secrétaire général adjoint du conseil, chargé de la PESC, construire une force sans définir le cadre de son action ni ses objectifs revient à construire une maison en commençant par le toit. C'est d'ailleurs en vertu de ce raisonnement que, dans le cadre de ses travaux, la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale a déjà souligné l'opportunité qu'il y aurait pour l'Union européenne d'établir un livre blanc sur la défense, à l'instar de ce qui se pratique au niveau national. Aux yeux de vos rapporteurs, un tel document devrait contenir, en matière de prolifération trois types de dispositions : - une analyse des risques et des menaces que pose à l'Europe la dissémination des armes de destruction massive ; - les axes d'une politique européenne globale de non-prolifération ; - l'évaluation du rôle respectif de la défense et de la dissuasion face aux risques avérés de prolifération et ses conséquences en termes de capacité. a) Construire une analyse européenne des risques et des menaces posés par les armes de destruction massive « Les nombreux débats qui ont récemment traité d'une politique de défense commune en Europe ont accordé plus de temps et consacré davantage d'attention aux questions de principe, aux arrangements institutionnels et aux réformes organisationnelles qu'aux risques, aux menaces et aux scénarios de crises, lesquels sont pourtant au c_ur d'une politique de sécurité et de défense, qui elle-même n'aura de chances de susciter le soutien du public que si elle relève certains défis efficacement »130. En la matière, l'Europe est donc totalement dépendante des très nombreuses analyses américaines sur l'évaluation de la menace, dont les limites aussi bien méthodologiques que conceptuelles ont été soulignées. En raison de sa géographie et de ses intérêts spécifiques, l'Europe doit pourtant se doter des moyens de procéder à une analyse des risques spécifiques qui la touchent s'agissant de la prolifération des armes de destruction massive. La mission propose six pistes de réflexion qui pourraient utilement être rassemblées dans un Livre blanc de la défense européen, dont elles formeraient la partie d'analyse et d'évaluation des menaces. (1) Les risques directs pesant sur le territoire des Etats européens131 Techniquement, le seul pays capable de menacer toute l'Europe occidentale avec des missiles balistiques est la Russie. Quant aux capacités balistiques venant du Sud, elles se limitent aujourd'hui à l'Iran, à la Libye ou à l'Arabie Saoudite et ne seraient susceptibles d'atteindre que les Balkans ou l'Italie. N'oublions pas cependant l'existence des lanceurs intercontinentaux chinois... Contrairement aux Etats-Unis, les Européens se refusent à voir une menace dans l'existence de capacités balistiques dans ces pays. Le risque représenté par les pays cités ne deviendrait menace qu'en cas d'évolutions politiques conduisant ces Etats à se doter de gouvernement hostile à l'Europe. A cet égard, aux yeux de beaucoup d'experts européens, aucune menace n'est susceptible d'émerger à moyen terme. Et même si ce qu'il faut considérer comme l'hypothèse du pire se réalisait, encore faudrait-il poser la question de l'intérêt stratégique pour ces pays de menacer les pays occidentaux. Car, faut-il le rappeler, la menace représentée par les missiles balistiques est essentiellement psychologique. Dans cette mesure, aucun de ces Etats ne parviendrait à entamer les capacités militaires des pays européens, qui sont d'avance beaucoup plus perfectionnées. Il faut enfin ajouter que les arsenaux de ces Etats sont, dans le domaine balistique, relativement limités. Ceci dit, c'est prendre un pari risqué que de postuler l'absence de menace dans le moyen terme, car la menace indirecte existe toujours. On ne peut exclure à ce titre qu'un missile balistique soit utilisé à des fins de chantage et de contournement pour neutraliser toute velléité d'emploi des forces européennes sur des théâtres pourtant vitaux. (2) Les risques directs pesant sur des forces militaires européennes déployées sur des théâtres extérieurs C'est là le risque le plus sérieux que la prolifération des armes de destruction massive pourrait faire peser sur l'Europe. Sans doute d'ailleurs faudrait-il mettre cette phrase au futur au regard des avancées rapides de la construction de l'Europe de la défense. L'existence de plusieurs programmes de défense antimissile de théâtre menés par des pays européens hors de l'OTAN relève d'ailleurs de la prise en compte d'un tel risque. Ainsi, comme le souligne Joachim Krause, il aurait pu arriver que les forces armées de l'Europe occidentale servant dans le cadre de l'ONU ou d'une autre organisation internationale en ex-Yougoslavie soient menacées par des armes chimiques. L'armée fédérale de l'ex-Yougoslavie disposait très vraisemblablement de telles armes, qu'elle avait, semble-t-il, utilisées à plusieurs occasions, mais sans qu'il n'y en ait aucune preuve. Les forces serbes ont tenté à maintes reprises de tester la détermination de la FORPRONU, en défiant notamment les soldats envoyés par les principaux pays occidentaux tels que la France et le Royaume-Uni. Les troupes de ces deux pays ont certainement les moyens de survivre, voire d'opérer en ambiance chimique, mais les débats politiques auraient risqué d'être sérieux à Paris et à Londres après une attaque avec ce genre de munitions (à plus forte raison si l'on n'avait pas su d'où elle venait). (3) Les risques indirects liés à une situation d'instabilité régionale impliquant des armes de destruction massive C'est essentiellement d'Asie qu'un tel risque pourrait provenir. Comme nous l'avons vu précédemment, rien ne permet d'exclure à moyen terme que la modernisation de l'arsenal chinois et le développement des capacités balistiques dans cette région ne conduisent le Japon ou Taiwan à réexaminer leur position par rapport à l'arme nucléaire. Par ailleurs, la situation dans le sous-continent indien ouvre la porte à des scénarios pessimistes dont la réalisation, y compris à court terme, ne peut être exclue. L'Europe, étant donné sa dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen-Orient, pourrait également se trouver menacée par la rupture de l'équilibre stratégique dans la région qui concentre la plus forte diversité d'armes de destruction massive. (4) Les risques suscités par la remise en cause d'accords internationaux importants pour la stabilité internationale C'est essentiellement en vertu de ce risque que la plupart des pays européens récusent une remise en cause unilatérale du traité ABM par les Etats-Unis. On a souligné précédemment l'effet de domino qu'une telle décision pourrait avoir. Reste cependant à examiner dans quelle mesure une modification contractuelle du traité ABM ne représenterait pas également un problème pour l'Europe. Il ne s'agit pas là d'une question théorique, bien au contraire : la mission est convaincue que la Russie pourrait accepter cette modification lorsque la nouvelle administration américaine sera en place après l'élection présidentielle de novembre 2000. Négocié ou non, le feu vert donné à la NMD ne manquera pas d'avoir des conséquences importantes sur la Chine qui poursuivra la modernisation et le développement de ses forces stratégiques. L'accélération du programme chinois ne pourra pas laisser l'Inde, donc le Pakistan, indifférents. L'Iran a les yeux rivés sur l'évolution stratégique du Pakistan qui pourrait le conduire à appuyer son effort nucléaire et balistique. Une telle décision aurait un impact important sur Israël qui, à tort ou à raison, s'estime menacé par l'Iran. Et c'est toute la question du rôle et de la place des armes de destruction massive au Moyen-Orient qui resurgirait. Scénario catastrophe ou enchaînement logique de causes et de conséquences, cette hypothèse ne peut être exclue. (5) Le danger d'accidents impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou d'emploi non autorisé des armes nucléaires S'agissant de la Russie, un risque spécifique existe tenant à l'incapacité des autorités centrales à contrôler les stocks d'armes de destruction massive existants. Sur ce point, une vraie vigilance s'impose, dont l'Europe a d'ailleurs conscience comme le montre sa participation à de nombreux programmes visant à prévenir leur dissémination. (6) Les nouvelles formes de terrorisme. L'Europe est de longue date familière des problèmes de terrorisme. Elle doit donc examiner sérieusement l'hypothèse d'une évolution des outils du terrorisme : qui peut affirmer que l'attentat de la secte Aoum au gaz sarin dans le métro de Tokyo était un accident isolé qui ne préjuge pas du modus operandi du terroriste du XXIème siècle ? Que retenir de ce rapide tableau des risques liés à la prolifération des armes de destruction massive pouvant peser sur l'Europe ? La conclusion essentielle est que la sécurité de l'Europe occidentale n'est pas menacée dans l'immédiat par le danger de prolifération, sauf terrorisme et chantage, dont il faut se prémunir. Ce constat résulte d'ailleurs largement des politiques de prévention mises en place par les régimes de non-prolifération. A ce titre, une poursuite et un renforcement des efforts engagés dans cette voie s'imposent. Néanmoins, à l'horizon 2010-2020, l'Europe doit être vigilante s'agissant des quatre risques les plus probables : c'est d'abord le risque direct pouvant peser sur des forces d'intervention européennes engagées à l'étranger qui doit faire l'objet d'un examen attentif. Viennent ensuite les risques de menace directe sur le territoire, d'accident et d'instabilités régionales. Dans ces domaines, une réflexion sur l'ensemble des moyens de lutter contre la prolifération s'impose. b) S'affirmer comme l'acteur majeur de la non-prolifération Aussi bien pour des raisons tenant à l'évolution de l'attitude américaine que pour des motifs liés aux aspirations profondes des peuples européens, les Européens doivent s'affirmer comme l'acteur majeur de la non-prolifération. Il y va de son intérêt comme de celui des régimes de non-prolifération, dont la crédibilité et l'efficacité doivent être réaffirmées. L'action européenne pourrait se déployer dans chacun des grands domaines de la non-prolifération : - Dans le domaine nucléaire, le champ d'action est particulièrement large. S'agissant du TICE, c'est aux Européens, exemplaires vis-à-vis de ce traité, qu'il appartient de défendre l'importance et la pérennité du traité. L'intervention publique, évoquée précédemment, de MM. Jacques Chirac, Tony Blair et Gerhardt Schröder a représenté un premier pas majeur. Désormais, seuls les Européens sont légitimes pour demander les signatures ou les ratifications promises par la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan ou Israël. De la même façon, les Européens doivent s'engager fortement dans le fonctionnement de l'organisme mis en place par le TICE afin de montrer qu'ils croient à la pérennité et à l'efficacité de ce traité. Par ailleurs, un gros travail reste à faire sur les négociations d'un traité d'interdiction de la production de matières fissiles (TIPMF), dont la conclusion permettrait de poser un verrou majeur à la prolifération nucléaire. Or, ce traité est aujourd'hui l'otage d'un certain nombre de pays qui veulent l'insérer dans une négociation globale sur le désarmement nucléaire. Les Européens ont, à plusieurs reprises, proclamé leur attachement à ce traité. Mais une action commune déterminée pourrait avoir du poids, dans la mesure où elle émanerait d'Etats nucléaires comme d'Etats ayant toujours milité pour le désarmement nucléaire. Car, comme le notent David Fischer et Harald Müller, « nous ne devons pas oublier que l'Union présente un bon microcosme de la non-prolifération, avec des Etats nucléaires et non nucléaires, des pays membres de l'Alliance Atlantique et des neutres, des exportateurs nucléaires et des non-exportateurs, des producteurs d'énergie atomique et des antinucléaires. »132 Le traitement des dangers lié au matériel nucléaire disséminé sur le territoire des Etats successeurs de l'ex-Union soviétique est également un champ d'action potentiel immense pour une Europe déterminée. A cet égard, force est de reconnaître la pertinence de l'approche bilatérale mise en _uvre par les Etats-Unis à travers le programme Nunn-Lugar. Néanmoins, si, aujourd'hui les instruments mis en _uvre dans ce cadre sont en place, l'esprit qui a présidé à leur instauration a largement disparu : cette coopération est ressentie de part et d'autre plus comme une obligation que comme un atout. L'Europe est certes déjà présente en Russie, en elle-même, comme en témoigne par exemple l'action commune adoptée par le Conseil en 1999, ou à travers les actions de certains Etats membres. Il faut à cet égard souligner encore le succès du programme AIDA MOX. Mais tous les interlocuteurs rencontrés par la mission en Russie ont estimé que la coopération russo-européenne pourrait être beaucoup plus large. Cela impliquerait certes des responsabilités et des dépenses accrues mais, outre que l'Europe y a intérêt pour des raisons de sécurité, une telle coopération pourrait représenter une base de discussions sur la non-prolifération avec la Russie et, pour les Européens, sur les questions nucléaires. - Dans le domaine balistique, la proposition française de notification préalable des essais pourrait être utilement reprise par l'Union européenne, alors que Russes et Américains se sont entendus sur la création d'un centre bilatéral de ce type. Cet accord est d'ailleurs symptomatique du risque de marginalisation qui existe pour l'Europe, quand bien même elle est concernée au premier chef. - Dans le domaine biologique enfin, il faudrait d'abord qu'existe une prise de conscience européenne pour que ce dossier fasse l'objet de l'attention qu'il mérite. Là encore, les négociations laborieuses entreprises à Genève pourraient être dynamisées par l'émergence d'un acteur européen déterminé. C'est plus généralement la question de l'attitude de l'Europe à l'égard de la Russie qui est en cause ici, attitude dont on peut regretter le manque de fermeté, y compris sur des sujets majeurs tels que la question des droits de l'homme. De manière générale, l'Europe doit développer une approche régionale des questions de prolifération. Le traitement de la situation nucléaire dans le sous-continent indien a été jusqu'alors particulièrement peu satisfaisant. Or, l'ensemble des membres de l'Union européenne doit prendre la mesure de l'importance pour l'avenir de la stabilité stratégique internationale du triangle Chine - Inde - Pakistan qui se constitue dans une zone qui concentre 50 % de la population mondiale et est entrée dans une phase de développement rapide. De même, une plus grande attention doit être accordée aux événements du Moyen-Orient et de la Communauté des Etats Indépendants ayant un impact sur la prolifération des armes de destruction massive. L'Europe occidentale doit prendre en considération les évolutions en cours dans des espaces dont l'importance stratégique peut influencer son engagement dans la gestion de la sécurité régionale - que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou de l'OTAN. c) Réfléchir au couple « défense et dissuasion » en Europe L'Union européenne n'a, en tant que telle, pris que récemment position sur les projets américains de défense antimissile du territoire. Ainsi, au mois de juillet 2000, le Président de la Commission européenne, M. Romano Prodi, a exprimé ses inquiétudes sur la NMD et ses conséquences en termes de reprise de la course aux armements. Lors de la réunion du G 8 au Japon, le 23 juillet 2000, les responsables des pays européens ont également exprimé leurs préoccupations, la condamnation la plus forte ayant été faite par la France qui, par la voix du Président de la République, a estimé que « ce projet pourrait donner un nouvel élan à la prolifération des armements, balistiques ou nucléaires ». Certes, cette discrétion reflète largement l'état encore embryonnaire d'une défense européenne autonome. Mais elle a une cause plus profonde, qui tient au débat global que ces projets soulèvent quant au lien entre défense et dissuasion dans un monde multiproliférant : dans la mesure où parler de défense revient, explicitement ou non, à poser la question du rôle de la dissuasion exercée par les armes nucléaires aujourd'hui en Europe, le débat n'est même pas ouvert. Et toute la question est là : l'Europe ne pourra pas devenir un acteur stratégique et militaire crédible tant qu'elle s'en tiendra à la pratique consistant à éviter les sujets qui fâchent. En ce sens, elle n'est pas très crédible lorsqu'elle dénonce l'unilatéralisme américain, alors que ses Etats membres ne sont même pas capables de seulement ouvrir le débat entre eux. C'est à ce pas minimal - poser les questions - que la mission appelle pourtant : il faut enfin aborder la question des rôles respectifs de la dissuasion élargie américaine, des dissuasions britannique et française, de leur capacité à répondre aux diverses formes de prolifération et de la pertinence d'une réponse en termes de défense, active et passive, pour protéger les troupes européennes intervenant sur des théâtres extérieures et/ou du territoire des Etats membres. · Ouvrir le débat sur la dissuasion en Europe - Pourquoi un tel débat ? Aux yeux de vos rapporteurs, trois raisons le justifient. Le premier argument procède d'une mise en perspective globale de la construction européenne. L'approfondissement des débats sur le nucléaire militaire entre Européens permettrait de tirer les conséquences de l'intégration croissante des Etats européens. Tel est d'ailleurs l'accent qui a été mis par le Président de la République qui, à l'occasion de la présentation de la proposition française de dissuasion concertée en 1995, a évoqué la « communauté de destin » qui unissait les Européens. On peut même considérer qu'il serait souhaitable d'éviter que le statut nucléaire de la France et du Royaume-Uni ne soit un obstacle à la poursuite de la construction de l'Europe de la défense et de faire en sorte que les armes nucléaires soient au contraire un instrument de nature à y contribuer La deuxième série d'arguments se fonde sur la proximité stratégique très forte des Alliés nucléaires de l'OTAN. D'une part, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis partagent les mêmes principes doctrinaux fondamentaux ; notamment, il n'y a plus d'ennemi identifié, la dissuasion s'adressant à « ceux qu'elle est susceptible de concerner » pour reprendre l'expression de Sir Michael Quinlan133. La Grande-Bretagne et la France ont, d'ailleurs, explicitement reconnu qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre leurs doctrines. On peut donc aller jusqu'à dire avec Bruno Tertrais134 que du fait de l'importance de l'engagement de la France en faveur l'Europe de la défense, sa coopération croissante avec la Grande-Bretagne et le rapprochement qu'elle a opéré vers l'OTAN, il n'y a plus en Europe de dissuasion strictement nationale, du moins dans ses objectifs (pas dans ses conditions d'emploi). La dernière série d'arguments est liée à l'avenir de l'OTAN. Au regard de la très forte réduction des arsenaux nucléaires de l'OTAN basés en Europe, il n'est pas illégitime de se demander comment va évoluer la protection nucléaire offerte aux Européens dans le cadre de l`OTAN et si les Américains accepteront indéfiniment de payer pour l'entretien et le stockage des armes nucléaires encore basées en Europe. Les tentatives du Congrès américain pour réduire de manière substantielle la part financière des Etats-Unis dans le financement de l'OTAN nourrissent ce genre de débats. En outre, les événements récents au Kosovo ont montré que les armes nucléaires basées en Europe n'ajoutaient que peu à l'influence politique de Washington sur le continent. - L'échec de l'initiative française de dissuasion concertée de 1995 a révélé la force du tabou nucléaire en Europe, sans contribuer à le faire tomber pour autant. Ce débat doit donc être abordé avec la plus grande prudence. L'histoire de la défense de l'Europe est là pour rappeler que, dans ce domaine, rien n'est jamais acquis et que les arrière-pensées ont toujours été très présentes. C'est donc à une véritable démarche pédagogique qu'il convient d'appeler. Sur le fond, de quoi faut-il débattre exactement ? Le débat sur la dissuasion recouvre en réalité trois questions : - la fin de la guerre froide signifie-t-elle l'obsolescence de l'arme nucléaire et de la doctrine de dissuasion ? Pour reprendre la formule de Bruno Tertrais, est-il prématuré ou non de « déclarer close la parenthèse dissuasive » ? - l'arme nucléaire reste-t-elle au contraire l'ultima ratio de la sécurité en Europe après la guerre froide ? - l'émergence d'un rôle stratégique propre à l'Europe passe-t-elle par sa participation à l'inévitable processus de redéfinition du rôle de l'élément nucléaire dans la société internationale ? Il serait présomptueux de prétendre répondre à ces questions en quelques lignes. Vos rapporteurs souhaitent néanmoins d'ores et déjà jeter les bases de cette réflexion. La première question revient en fait à s'interroger sur la possibilité de construire une politique européenne de défense sans le nucléaire. Sur ce sujet, les Européens devront faire preuve de cohérence : on ne peut à la fois rejeter toute stratégie de défense contre la prolifération et souhaiter un désarmement nucléaire total de l'Europe, y compris unilatéral, comme c'est le cas chez certains de nos voisins. Sauf à envisager une Europe vulnérable... ce que les Etats-Unis ne sauraient accepter d'ailleurs ! On rejoint la deuxième question : si l'arme nucléaire n'est plus au fondement de la sécurité européenne, quelle stratégie alternative faut-il adopter ? Se profile alors notamment le débat sur la défense antimissile..., système stratégiquement pertinent en Europe eu égard à sa situation géographique. La dernière question que le débat nucléaire en Europe devra aborder n'est ni plus ni moins que celle de son rôle international : si l'Europe refuse d'entrer dans le débat sur le rôle de l'arme nucléaire dans l'après-guerre froide, le débat en restera au monologue actuel, américain ! En un mot, le silence européen sur ces questions ne fait que cautionner l'unilatéralisme américain. C'est donc à l'évidence une réponse positive qu'il faut apporter à cette dernière question : l'Europe ne peut prétendre être crédible sur la scène stratégique et rester passive sur les questions nucléaires. Deuxième point de méthode : avec qui et dans quel cadre débattre ? Sur ce point, trois lignes de force doivent être mises en avant. En premier lieu, le débat doit partir du cadre existant, et dont le bilan de fonctionnement semble satisfaisant, de la coopération franco-britannique. D'abord ponctuelle, la coopération franco-britannique est devenue structurelle lorsqu'en juillet 1993, la commission mixte sur les questions de politique et de doctrine nucléaires qui avait été créée en décembre 1992 devient un organe permanent. Cette commission est composée de hauts fonctionnaires des ministères de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays. Si les rapports qu'elle a rendus n'ont pas été publiés, il semble qu'elle ait permis de réaliser de grandes avancées : Le Président Jacques Chirac et le Premier ministre britannique John Major n'ont-ils pas déclaré en 1995 qu'« ils ne voyaient pas de cas dans lequel les intérêts vitaux de la France ou du Royaume-Uni puissent être menacés sans que les intérêts vitaux de l'autre ne le soient également »? Pour autant, rien ne pourra se faire sans l'Allemagne. Ce principe, valable pour la construction européenne dans son ensemble, revêt une acuité particulière en matière de défense pour des raisons historiques évidentes. Tous les spécialistes soulignent avec force qu'aucun débat sérieux ne pourra être engagé sur la dissuasion sans que l'Allemagne n'y soit étroitement associée. Si celle-ci a été relativement prudente dans ses réactions à la proposition de 1995, elle est néanmoins toujours favorable à un débat conduisant à une concertation accrue. Le concept stratégique franco-allemand adopté par Jacques Chirac et Helmut Kohl en décembre 1996 évoquait d'ailleurs le problème de la dissuasion nucléaire : « Nos pays sont prêts à engager un dialogue sur le rôle de la dissuasion nucléaire, dans le contexte d'une politique de défense européenne ». Il faut toutefois noter que, dans ce même document, la France reconnaît que « la garantie suprême de la sécurité des Alliés est assurée par les forces stratégiques de l'Alliance, en particulier par celles des Etats-Unis ». Il est douteux que l'Allemagne se serait engagée dans cette voie sans ce rappel du rôle prééminent des Etats-Unis dans la défense de l'Europe. Enfin, le débat doit être élargi. Même si l'apport des deux puissances nucléaires européennes, et de l'Allemagne, est déterminant pour lancer le débat sur la dissuasion concertée, il faut éviter de donner l'impression d'une formule qui s'apparenterait à un directoire ou tendrait à accréditer l'idée que les deux Etats nucléaires ne cherchent qu'à imposer ou à « vendre » leurs doctrines de dissuasion. Les Etats non nucléaires qui le souhaitent (c'est-à-dire les Etats membres de l'UEO) seraient associés au débat. La création d'un haut représentant pour la PESC et d'institutions spécifiques à la défense fournit un cadre approprié au dialogue qui devra être engagé. Par la suite, pourrait être mis en place un groupe de planification nucléaire européen, sur le modèle du Nuclear Planning Group de l'Otan. Rappelons que, déjà, en juillet 1997, M. Paul Quilès, Président de la Commission de la défense nationale de l'Assemblée nationale, et son homologue allemand Günter Verheugen proposaient d'établir un groupe de consultation nucléaire européen. Quant à l'initiative d'un tel débat, faut-il qu'elle revienne à un Etat nucléaire ? L'épisode de 1995 a rappelé que tout Etat nuclaire qui proposait ce genre de débat était immédiatement soupçonné d'arrière-pensées. De même, elle ne peut revenir à un Etat à tradition antinucléaire, car elle se heurterait à l'hostilité des puissances atomiques. Une initiative du « Haut représentant pour la PESC » pourrait donc être une option sérieuse. · Quelle défense pour l'Europe dans un monde multiproliférant ? La question du rôle que pourrait jouer la défense, active ou passive, en Europe contre les risques posés par des armes de destruction massive n'a jamais été abordée au niveau opérationnel ou politique. Néanmoins, il n'est pas douteux que les Etats-Unis disposeront d'un système de défense antimissile contre des menaces élaborées d'abord au niveau tactique puis d'un système de défense continentale. Dans ces conditions, quelle doit être l'attitude de l'Europe ? Pour des raisons de pertinence géographique et financière, cette question doit en effet être posée au niveau européen, même s'il conviendra d'examiner ultérieurement quelle pourrait être la contribution française à un projet européen de défense antimissile. L'Europe est actuellement en retard sur les Etats-Unis comme sur la Russie dans le domaine de la défense contre les missiles balistiques. Elle l'est d'ailleurs également sur Israël, qui dispose d'ores et déjà, avec l'Arrow, d'un tel système. Ce constat prend tout son sens si l'on garde en mémoire le fait que dix à quinze ans sont nécessaires pour développer une défense de haute altitude opérationnelle. Il est donc indispensable que les industriels européens développent à tout le moins des créneaux dans lesquels ils disposeront des capacités crédibles, afin de pouvoir éventuellement développer des coopérations avec les Etats-Unis. Par ailleurs, si l'Europe vise à acquérir une autonomie dans ce domaine, des coopérations sont indispensables. Dans le cadre de la mise en place de l'Europe de la défense, il semble cependant que des réflexions et des coopérations s'ébauchent d'ores et déjà en matière de défense active. Notamment, l'état-major des armées français étudie l'instauration d'une coopération européenne sur ce thème, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne et, à l'extérieur de l'Europe, le Canada. Certes, plusieurs pays européens conduisent par ailleurs des programmes de défense antimissile. L'Allemagne et l'Italie sont associées avec les Etats-Unis sur le programme MEADS. A ce jour cependant, il n'existe qu'un seul programme strictement européen, avec Aster, programme franco-italien. Mais il ne s'agit pas de programmes de dimension européenne. En outre, complément nécessaire, l'acquisition par l'Europe d'une capacité de détection des tirs de missiles n'est pas du tout envisagée à ce jour. C. QUELLE STRATÉGIE POUR LA FRANCE ? Dans le domaine de la lutte contre la prolifération, en termes de capacités, seule une approche européenne est crédible eu égard à l'ampleur des moyens concernés. Mais, aussi bien en termes conceptuels qu'opérationnels, le jour est encore lointain où ces thèmes pourront être abordés en termes exclusivement européens. L'impulsion doit donc venir des Etats : et, en la matière, du fait de son excellence technique et de ses ambitions, la France a un rôle moteur à jouer. Certes, la mission ne peut que saluer l'action soutenue et déterminée de la France dans les domaines de la non-prolifération et du désarmement depuis 1976. Le bilan des mesures mises en _uvre par notre pays est, à cet égard, impressionnant, quel que soit le jugement que l'on porte sur leur pertinence. D'un autre côté cependant, elle s'interroge sur l'existence d'une véritable stratégie de lutte contre la prolifération dans notre pays, une politique de non-prolifération ne constituant pas, à elle seule, une stratégie globale. Certes, la réflexion collective sur ce sujet a fortement progressé, notamment depuis la parution du Livre blanc de 1994. Mais, au volontarisme qui a entouré la conférence de prorogation du TNP en 1995 n'a-t-il pas succédé une certaine atonie embarrassée, que révèlent les projets américains de défense antimissile ? Ce que révèle le climat actuel en France, sur les questions de prolifération, c'est un divorce entre une action diplomatique importante, qu'il faut saluer, et une impasse totale en matière de défense, comme si la diplomatie allait parvenir, à elle seule, à contrôler le problème. Pour mettre fin à ce décalage, il faut se donner les moyens militaires de lutter contre certaines formes de prolifération. 1. Dix ans de désarmement et de non-prolifération La France a longtemps contesté le bien-fondé de la notion même de non-prolifération. Ayant eu elle-même à souffrir, pendant son « aventure nucléaire » (Bertrand Goldschmidt) des pressions américaines, y compris des embargos sur les livraisons de matériels sensibles, visant à la dissuader de « faire sa bombe », la France refusa de participer à son tour à un mécanisme contraignant et discriminatoire qu'est, de fait, le régime de non-prolifération. D'un autre côté, les dirigeants et les responsables français - hormis peut-être le Général Gallois pour qui la multipolarité atomique était un facteur stabilisant - ont toujours reconnu que la multiplication des acteurs nucléaires n'était pas à l'avantage de la France, ni sur le plan politique (banalisation de l'arme nucléaire), ni sur le plan militaire. Par conséquent, la France appliqua jusqu'au début des années 1990 une double politique : d'un côté, dans les enceintes diplomatiques internationales, elle présentait la non-prolifération comme une non-question, la seule vraie question étant la disparition de l'arme nucléaire. En outre, l'arsenal français étant strictement défensif, elle disait ne pas se sentir concernée par le traité de non-prolifération nucléaire. Rappelons à cet égard les mots du représentant français, Armand Bérard, à la tribune des Nations Unies, le 12 juin 1968135 : la France entend conserver ses armes atomiques qu'elle fabrique « à des fins strictement défensives... ni pour menacer, ni pour attaquer qui que ce soit ». La France n'avait donc « ni à condamner, ni à conseiller la conclusion d'un traité au demeurant sans implication » pour elle. Néanmoins, sans adhérer formellement au traité, elle en a largement appliqué les principes. Avec la fin de la guerre froide, la position française a totalement changé : la France a adhéré au TNP en 1992 et s'affirme depuis cette date comme le champion de la non-prolifération, dans les domaines nucléaire, balistique, chimique et biologique. Cet engagement s'est traduit dans les faits par des mesures de désarmement unilatérales, dont le niveau n'est, en proportion de son arsenal, égalé par aucune autre puissance nucléaire. Le bilan de la politique de non-prolifération et de désarmement conduite par la France depuis le début de la décennie 1990 est tout à fait impressionnant.136 a) Le nucléaire : soutien sans faille à la non-prolifération et désarmement unilatéral La France a annoncé son adhésion formelle au TNP dans le cadre du « plan global de maîtrise des armements et de désarmement » présenté par le Président de la République devant l'ONU le 3 juin 1991. Ratifiée à l'unanimité par le Parlement, cette décision a permis à la France de rejoindre le TNP le 2 août 1992. Il faut souligner que la France avait participé dès l'origine à l'élaboration des directives de Londres édictées par le groupe des fournisseurs nucléaires et à leur renforcement ultérieur le 24 septembre 1991. Depuis lors, la France n'a pas ménagé son soutien au TNP qu'elle considère désormais comme la pierre angulaire du régime international de non-prolifération et le point d'appui du désarmement nucléaire. Elle a d'ailleurs une approche dynamique et volontariste de sa mise en _uvre. Ainsi, elle s'est engagée sans équivoque en faveur du désarmement nucléaire en conformité avec les dispositions de l'article VI. Certes, elle a toujours maintenu son arsenal nucléaire à un niveau de stricte suffisance et n'a jamais participé à la course aux armements nucléaires. Mais les années récentes ont vu un renforcement de son action en faveur de la négociation de mesures efficaces de désarmement nucléaire. Ainsi, la France a contribué à l'adoption de la déclaration de la Présidence du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 janvier 1992 assimilant la « prolifération des armes de destruction massive » à « une menace pour la paix et la sécurité internationales ». De même, elle a joué un rôle majeur au cours de la conférence d'examen et de prorogation du TNP de 1995 où, présidant l'Union européenne, elle s'est engagée sans équivoque en faveur de la prorogation indéfinie du traité et a contribué activement à la décision prise en ce sens par les Etats parties. Plus encore, elle a pris des mesures d'une portée considérable en matière de désarmement unilatéral. Un seul chiffre traduit l'ampleur de cet effort : la part des dépenses liées à la dissuasion nucléaire de la France dans le budget de la défense (hors pensions) est passée de 16,9 % à 8,75 % entre 1990 et 1999. Ainsi, dès la fin de la guerre froide, la France a renoncé au développement de certains programmes (missiles stratégiques sol-sol S45), et avancé le retrait de deux systèmes (missiles Pluton et bombes AN-52). Puis, suite à la décision du Président de la République en février 1996, elle a adopté un format plus réduit pour ses forces nucléaires, passant d'une triade à une dissuasion à deux composantes, navales et aéroportées. Les deux composantes restantes ont elles-mêmes été simplifiées : le nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d'engin (SNLE) est passé de cinq à quatre ; les bombardiers Mirage IVP ont été retirés de la mission nucléaire. Le 26 septembre 1997, le Président de la République a en outre annoncé le déciblage des forces de dissuasion : « Avec le démantèlement des missiles sol-sol français du plateau d'Albion, aucun des moyens nucléaires de la force française de dissuasion n'est désormais ciblé ». Par ailleurs, la France est la seule puissance nucléaire à avoir annoncé et engagé le démantèlement de ses installations de production de matières fissiles. Ainsi, depuis 1992, la France ne produit plus de plutonium pour les armes nucléaires. Elle a fermé fin 1997 l'usine de retraitement de Marcoule où était réalisée cette production ainsi que l'usine d'enrichissement de Pierrelatte qui produisait l'uranium hautement enrichi pour les armes. Le démantèlement de ces usines, décidé en février 1996, est aujourd'hui en cours. Tout en menant une dernière campagne d'essais nucléaires en 1995-1996, destinée à lui permettre de passer à la simulation, la France a été le premier Etat doté de l'arme nucléaire à avoir proposé « l'option zéro ». Elle a par conséquent activement contribué à la conclusion de la négociation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et, le 6 avril 1998, le premier Etat doté de l'arme nucléaire avec le Royaume-Uni à ratifier ce traité qu'elle avait signé le 24 septembre 1996. De plus, elle a décidé de donner un caractère irréversible à la décision annoncée par le Président de la République le 28 janvier 1996 d'arrêt des essais nucléaires en procédant, entre 1996 et 1998, au démantèlement de son site d'expérimentations dans le Pacifique. 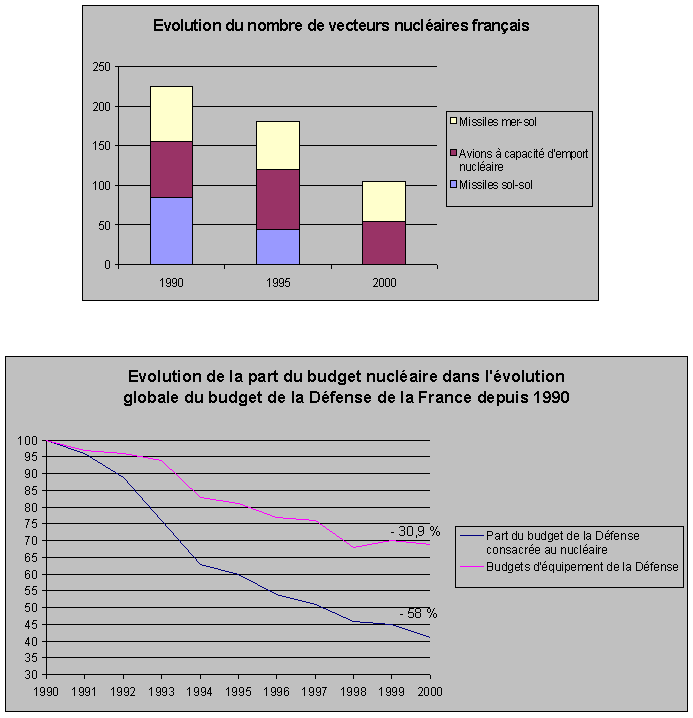 Source : ministère des Affaires étrangères Source : ministère des Affaires étrangères On relèvera avec intérêt qu'elle est le seul Etat à l'avoir fait : ni la Russie, ni les Etats-Unis n'ont désactivé leurs sites, tout comme Lop Nor, en Chine, reste en fonctionnement. Sans parler des sites indiens et pakistanais. D'aucuns considèrent que l'ensemble de ces décisions ont exposé la France au risque de se trouver sans solution immédiatement disponible sur le plan national dans l'hypothèse d'une accélération de la prolifération. Ce qui souligne la nécessité de conserver l'option des essais ouverte pour le cas où la situation internationale se dégradait et conduisait notre pays à exercer la possibilité offerte par le TICE de se retirer du traité. En outre, la France apporte sa contribution à la mise en place de la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) qui assumera, dès que le traité sera entré en vigueur, sa vérification internationale, en particulier par la construction de stations de détection, sur son sol ou en coopération avec d'autres Etats (27 stations réalisées, dont 11 en coopération avec d'autres pays). La priorité de la France pour l'avenir est inchangée : obtenir l'entrée en vigueur rapide du TICE et l'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires grâce au lancement immédiat des négociations à la Conférence du désarmement sur l'interdiction de la production des matières fissiles pour des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires (cut-off). Par ailleurs, en ratifiant les protocoles annexés au traité de Tlatelolco (1974 et 1992) et aux traités de Rarotonga et de Pelindaba (en 1996), la France a démontré son plein soutien à la constitution de zones exemptes d'armes nucléaires sur la base d'arrangements librement consentis entre les Etats des régions considérées. De manière générale, la France est en outre présente dans tous les dispositifs régionaux visant à lutter contre la prolifération nucléaire. Elle participe financièrement pour 460 millions de francs à l'aide au démantèlement des armes nucléaires russes : des machines-outils, du matériel radiologique, des conteneurs et un bâtiment de stockage ont été ainsi fournis. Elle est l'instigatrice, rappelons-le, du programme AIDA MOX 2 de retraitement du plutonium militaire russe. La contribution financière de la France s'est élevée, de 1998 à 2000, à 60 millions de francs. STATIONS DE DÉTECTION OU RÉSULTANT
Dès la mise en place de la KEDO, elle a apporté, en décembre 1995, une contribution financière nationale de 10 millions de francs et a, par la suite, _uvré activement en faveur de la participation de l'Union européenne à cette organisation. Enfin, la France participe indirectement à la lutte contre la prolifération par sa politique de garanties de sécurité, négatives et positives137. En juin 1982, la France a accordé pour la première fois des garanties négatives de sécurité à l'ensemble des Etats non dotés de l'arme nucléaire, par une déclaration du ministre des affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations unies. Le 6 avril 1995, elle a réaffirmé, en les précisant ces garanties négatives et a donné, pour la première fois, des garanties positives de sécurité à tous les Etats non dotés de l'arme nucléaire parties au TNP. b) Une action très déterminée contre la prolifération chimique En matière de désarmement chimique, la France a joué un rôle moteur dans l'élaboration puis l'entrée en vigueur de la convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques (CIAC) : c'est elle qui, en 1989, avait convoqué une conférence à Paris pour relancer les négociations sur le désarmement chimique, et c'est elle qui a accueilli la cérémonie de signature de la Convention le 10 janvier 1993 également à Paris. C'est encore la France qui, le 2 mars 1995, devenait le premier Etat membre permanent du Conseil de sécurité à ratifier cette Convention, qui marque une nouvelle étape dans le domaine des accords de désarmement, et voit s'imposer le concept, défendu par la France, d'interdiction « totale et soumise à vérification par des inspecteurs internationaux ». Après l'étape de l'entrée en vigueur, franchie le 29 avril 1997, il s'agit désormais de faire en sorte que cette convention devienne universelle. La France participe à tous les efforts qui sont menés au niveau international pour inciter l'ensemble des Etats qui ne l'ont pas encore fait à ratifier, ou à adhérer à cette Convention. Conformément aux dispositions de la CIAC, la France a mis sur pied une « autorité nationale » assurant le suivi intégral des relations avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) basée à la Haye. Elle a par ailleurs créé, en vue d'assurer une mise en _uvre efficace de la convention au plan interne, un comité interministériel pour la mise en _uvre de la convention sur l'interdiction des armes chimiques (CICIAC). La France a en outre mis sur pied un centre de formation pour l'interdiction des armes chimiques (CEFFIAC), qui a procédé à la formation initiale des inspecteurs internationaux travaillant pour l'OIAC, et continue de mener des actions de sensibilisation auprès des administrations françaises en charge de l'application de la CIAC. Enfin, le Parlement français a adopté une loi relative à l'application de la Convention le 17 juin 1998. c) Une action de longue date en faveur de la non-prolifération des armes biologiques La France est dépositaire du Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et d'agents bactériologiques138 et a levé en 1996 l'ensemble des réserves dont elle avait à l'époque assorti la signature de ce protocole. Elle est le seul membre permanent du Conseil de sécurité à l'avoir fait. Dans le domaine du désarmement biologique, la question du renforcement, notamment par l'adjonction d'un dispositif de vérification, de la convention de 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction constitue un souci majeur pour la France. Si la France n'est devenue partie à cette convention qu'en 1984, c'est précisément parce qu'elle jugeait qu'en l'absence de dispositions relatives à la vérification, la crédibilité de cet instrument était affectée (le ralliement de la plupart des Etats à ce point de vue est d'ailleurs à l'origine des négociations actuelles sur le renforcement de la convention). La France n'en avait pas moins reconnu l'importance de cette convention et avait adopté, dès 1972, une législation interne prévoyant des dispositions analogues aux obligations stipulées par la convention. Depuis sa décision d'adhérer à la convention en 1984, la France a _uvré sans relâche en faveur d'un renforcement de ce traité et d'une amélioration de son application. Cela s'est tout d'abord traduit, lors de la troisième conférence d'examen en 1991, par l'action de la France en faveur de la création d'un groupe spécial d'experts (VEREX) chargé d'examiner d'un point de vue scientifique et technique des mesures de vérification éventuelles. Cela s'est ensuite manifesté par son soutien, lors de la conférence spéciale de 1994, à la décision de mise en place du groupe spécial chargé de négocier et de mettre au point un protocole juridiquement contraignant sur l'interdiction des armes biologiques incluant des mesures de vérification efficaces propres à assurer un plus grand respect des exigences fixées par la convention. De manière plus précise, la vérification d'un tel traité, pour la France, doit reposer sur un ensemble de mesures complémentaires, associant déclarations obligatoires, dispositif de visites et recours éventuel à des enquêtes en cas de violation. Elle participe activement à cette fin aux travaux du groupe spécial à Genève. La France insiste également sur la nécessaire universalisation de cette convention et sur la poursuite de la lutte contre la prolifération des armes biologiques, étant entendu que cette lutte ne saurait freiner les transferts de connaissances à des fins pacifiques. d) Un rôle majeur dans la lutte contre la prolifération balistique La France participe activement au régime de surveillance des technologies balistiques (MTCR), qui permet à ceux qui détiennent aujourd'hui le savoir-faire dans ce domaine de limiter les risques de la prolifération balistique. Elle assure le secrétariat de ce régime et organise au moins une fois par an une réunion rassemblant les délégations des 32 Etats membres. Elle souhaite comme d'autres Etats membres, que le MTCR soit mieux à même d'agir contre la prolifération balistique actuelle qui se produit en dehors du régime, par des coopérations entre Etats non membres et a fait des propositions en ce sens. Plus généralement, la France insiste sur la nécessaire recherche de mesures de confiance afin de promouvoir des dispositions internationales visant à accroître la sécurité, la transparence et la prévisibilité des activités spatiales. Dans cette perspective, dès le début de la décennie comme on l'a vu précédemment, la France a présenté à la Conférence du désarmement une proposition relative à la notification des lancements d'objets spatiaux et de missiles balistiques qu'elle a renouvelée en 1999 au sein du MTCR. C'est donc largement à ses efforts que nous devons l'adoption dans cette enceinte d'un code de conduite international contre la prolifération balistique. 2. La doctrine française et la prolifération : une réponse adaptée ? « La nécessité de disposer d'armes nucléaires dans le nouveau contexte stratégique demeure, au plan politique comme un élément majeur de l'indépendance de la France, au plan militaire face à des risques moins immédiats que naguère, plus diffus et variés, mais persistants ou peut-être croissants sur la période prévisible. (...) Le concept français continuera de se définir par la volonté et la capacité de faire redouter à un adversaire, quel qu'il soit et quels que soient ses moyens, des dommages inacceptables, hors de proportion avec l'enjeu d'un conflit, s'il cherche à s'en prendre à nos intérêts vitaux. » Continuité : tel est le mot qui résume au mieux ces quelques lignes du Livre blanc sur la défense de 1994. La loi de programmation militaire pour 1997-2002 ne dit pas autre chose : « La dissuasion reste l'élément fondamental de la stratégie de défense de la France. Elle demeure la garantie contre toute menace sur nos intérêts vitaux, quelles qu'en soient l'origine et la forme. Elle reste nécessaire dans un monde où la vigilance continue de s'imposer ». Tel est aujourd'hui l'état des lieux en France : la prééminence absolue du dogme de la dissuasion pure. Il faut bien prendre conscience du fait que ce discours n'est pas universel. Aux Etats-Unis notamment, un vif débat existe sur ce sujet, dans le cadre des réflexions sur la mise en place d'un système de défense antimissile. Pour de nombreux experts américains, et également aux yeux de nombreux responsables politiques de ce pays, le concept de dissuasion, tel que conçu et affiné depuis les années 1950, a vécu et il faut en forger un nouveau, tout comme il a fallu, dans les années 1970, dans le domaine monétaire, abandonner le système d'étalon de change-or et en inventer un autre. Audacieuse comparaison, certes ! Mais le fait est que la bipolarité nucléaire et la glaciation des rapports de force sont mortes avec la guerre froide et qu'en conséquence, ici ou là, le retour de la défense est inéluctable, d'autant qu'il est impossible de geler la technologie militaire. D'où, aux yeux de vos rapporteurs, la nécessaire ouverture d'un débat en France. L'objectif de la réflexion que la mission appelle de ses v_ux n'est nullement la remise en cause de la doctrine française de dissuasion, mais son adaptation : la doctrine nucléaire actuelle de la France ne doit pas devenir une nouvelle ligne Maginot par rigidité bureaucratique et frilosité politique ! Certes, cette doctrine a parfaitement rempli son rôle durant la guerre froide. Reste qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Nous devons réfléchir à la réintroduction de la défense et à la diversification des moyens offensifs dans notre doctrine et notre outil militaire. Le débat qui se joue actuellement aux Etats-Unis ne saurait être interprété seulement comme le caprice d'une superpuissance en mal d'affectations de ses excédents budgétaires. C'est d'ailleurs précisément parce que le budget de la défense en France, comme en Europe, évolue dans un cadre contraint par des choix collectifs, que la question de l'allocation optimale des ressources militaires est nécessaire et que nous n'avons pas le droit de nous tromper de débat, ni de siècle. a) Le dogme de la dissuasion pure est-il encore valide ? · Le concept de dissuasion français distingue deux paramètres : - la nature des armes de destruction massive concernées. A cet égard, la doctrine française considère que la prolifération des vecteurs est un problème spécifique qui n'entretient pas de connexion obligatoire avec les autres types de prolifération ; - la nature de la menace exercée, la summa divisio devant être tracée entre les menaces pesant sur les forces déployées sur des théâtres d'opération extérieurs (1) et les menaces qui s'exercent contre le territoire national (2). (1) S'agissant des menaces contre les forces, scénario n° 2 envisagé par le Livre blanc de 1994, la doctrine militaire de la France repose sur une dialectique complexe entre protection et dissuasion. Le concept de dissuasion français est en effet volontairement flou sur le rôle de la dissuasion en cas d'attaque avec une arme de destruction massive contre des forces françaises déployées sur un théâtre d'opération étranger. De fait, le principe classique de la dissuasion du faible au fort ne s'appliquerait pas dans un tel contexte, étant donné les lieux et les conditions d'engagement probables de nos forces dans les années à venir. C'est bien plutôt un scénario du type de celui de la guerre du Golfe qui a le plus de chances de se produire et pose la question suivante : un Etat qui se refuse, dans tous les domaines, à adhérer aux valeurs et aux principes de fonctionnement de la société internationale est-il réceptif à la doctrine de dissuasion, élaborée dans un contexte où, en dépit de divergences idéologiques très fortes, les deux systèmes qui s'opposaient respectaient, formellement du moins, des principes communs ? Nous serions en l'occurrence tenté de parler de dissuasion « du fort au fou », terme récusé par notre doctrine qui, postulant la rationalité de l'adversaire, nie l'existence de « fous » dans le jeu stratégique... Nos gardiens du dogme considèrent même ce concept dissuasion comme la négation même de la dissuasion, contrairement aux Etats-Unis qui, sur ce fondement, estiment que, vis-à-vis de certains pays, la dissuasion ne marche pas et qu'il faut développer d'autres moyens de protection. Comme nous l'avons vu précédemment, les enseignements tirés de la guerre du Golfe ne permettent pas de répondre de manière univoque à la question de savoir si un Etat peut ne pas être réceptif à la dissuasion. Saddam Hussein a-t-il renoncé à utiliser l'arme chimique par peur des représailles américaines, ou israéliennes ? Est-ce plutôt parce qu'il doutait de la faible fiabilité opérationnelle d'un missile armé d'une tête chimique ou biologique ? Pourquoi a-t-il jugé en revanche que l'utilisation du missile balistique ne lui vaudrait-pas de représailles ? Faut-il en déduire que la dissuasion fonctionne contre le nucléaire, le chimique et le biologique, mais pas contre le balistique ? Malgré l'absence de réponse à ces questions, la France s'en tient au concept de dissuasion. Toutefois, comme l'ont fait remarquer les responsables français à vos rapporteurs, plutôt que d'en arriver à la situation - humainement et politiquement intenable - qui poserait la question du seuil de victimes nécessaires pour que le concept de dissuasion joue, la France a introduit dans sa doctrine une part de défense passive, extrêmement limitée. Ainsi, lors de la guerre du Golfe par exemple, nos soldats étaient dotés de combinaisons de protection contre les menaces biologiques et chimiques et, aux dires des spécialistes de la Défense, notre pays n'avait pas à rougir, notamment vis-à-vis de ses alliés européens dans la coalition139. (2) La problématique posée par les menaces liée à la prolifération des armes de destruction massive ou des vecteurs pesant sur le territoire national est tout autre puisqu'il s'agit alors d'une menace globale. Dans ce cas de figure, c'est la dialectique de la dissuasion qui joue, de manière exclusive. Le concept français intègre tous les types de menaces, qui dépassent de loin les seules menaces balistiques, et ne se réfère à aucune menace en particulier. Comme nous l'avons indiqué précédemment, il postule également la rationalité de l'adversaire. C'est pour ces raisons que la France se refuse absolument à souscrire, sur le plan conceptuel, au projet de NMD. Aux yeux de nos gardiens du dogme, ce projet est d'abord la mauvaise réponse à une mauvaise question, qui est de savoir comment on peut accepter que le peuple américain ne soit pas protégé à 100 % au regard de l'effort financier qu'il consent pour sa politique de défense. Or, la protection à 100 % n'existe pas, ce que savent d'ailleurs parfaitement les militaires américains. Mais le défaut majeur de la NMD n'est pas là, aux yeux des stratèges français : si elle est rejetée, c'est qu'elle est considérée comme totalement incomptaible avec notre concept de dissuasion. Dans une perspective strictement franco-française, la NMD apparaît comme un aveu de faiblesse, dans la mesure où elle semble signifier que la dissuasion ne répond pas à toutes les menaces pesant sur son territoire ou sur ses forces. En un mot, la dissuasion sera pure ou ne sera pas... L'optique américaine va donc totalement à l'encontre de la doctrine française de dissuasion, qui est exclusive : dans la logique du concept français actuel, créer un outil supplémentaire qui présuppose l'impuissance de la dissuasion dans certains cas de figure revient à affaiblir celle-ci. En bref, pour résumer la doctrine française actuelle, contre la protection - qui affaiblit la dissuasion, sans être efficace à 100 %, en consommant beaucoup de moyens qui plus est -, la France fait le choix du couple prévention/dissuasion, auquel elle adjoint très timidement un troisième terme - dont la part est mineure - la protection, s'agissant des forces déployées sur des théâtres d'opération étrangers. Elle justifie en outre ce choix par sa cohérence avec la politique de non-prolifération qui, sur la base de régimes renforcées et d'un contexte mondial privilégiant la coopération internationale, constitue à ses yeux la seule réponse viable au défi de la prolifération. · Notre concept de dissuasion est-il encore adapté à la réalité stratégique mondiale ? Aux yeux de vos rapporteurs, la réponse à cette question est clairement négative et à tout le moins peut-on regretter l'absence de débat sur ces questions. S'agissant d'abord du concept applicable aux forces déployées sur des théâtres extérieurs, tout le débat porte sur le caractère extrêmement limité de la défense mise en _uvre et, au fond, sur le flou de notre doctrine dans un tel contexte. De deux choses l'une : soit c'est la dissuasion nucléaire qui s'applique, auquel cas l'adversaire connaît les conséquences de ses actes, soit la priorité va à la défense, active et passive, de nos troupes, la dissuasion n'intervenant qu'en ultime recours. Là encore, l'adversaire éventuel sait à quoi s'en tenir. Nous ne sommes aujourd'hui dans aucun de ces deux cas de figure et même si l'ambiguïté est partie prenante de la stratégie, notre posture actuelle, extrêmement floue, reflète avant tout notre embarras conceptuel et nos moyens limités. Dans la mesure où les circonstances dans lesquelles la France recourrait à l'arme nucléaire dans un tel scénario sont assez difficiles à imaginer, mais également où nos moyens de défense passive sont faibles, et de défense active limités - et, en tout cas, nuls contre les missiles balistiques -, l'affirmation du couple défense-dissuasion paraît assez factice, voire dangereuse, rendant nos troupes vulnérables. Un éventuel agresseur peut en effet se demander si, après la guerre du Golfe, la dissuasion française fonctionne dans le cadre de troupes _uvrant sur un théâtre d'opérations, et être tenté de la tester. Dans une telle hypothèse, le choix défensif actuel, extrêmement limité, est insuffisant. Certes, notre pays n'avait pas, nous dit-on, à rougir de la comparaison avec ses partenaires pendant la guerre du Golfe mais à quoi compare-t-on ? Hormis nos voisins britanniques, qui ont accentué très fortement leurs efforts de défense passive dans les années récentes, quelles autres forces militaires européennes sont intervenues plus de soixante fois sur des théâtres extérieurs en dix ans ? Quels autres pays européens ont les ambitions militaires de la France ? Et, même si les troupes françaises ont des combinaisons contre les risques chimiques et biologiques, quid des capacités de détection précoce d'attaques à l'arme chimique, et surtout bactériologique ? S'agissant ensuite de notre concept de protection du territoire, fondé exclusivement sur la dissuasion, on ne peut que constater le fossé qui nous sépare des conceptions américaines. Il ne s'agit pas ici de se livrer à une défense et illustration des projets de défense antimissile américains : vos rapporteurs ont suffisamment montré dans les pages précédentes les risques de déstabilisation dont un tel projet était porteur. Faut-il pour autant rejeter, avec la méthode contestable, le débat de fond que ces projets ouvrent ? Certes non : la France doit, elle aussi, se poser la question des conséquences de la prolifération sur sa doctrine. Est-on plus ou moins en sûreté, avec notre seule arme nucléaire pour défendre notre territoire, dans un monde où de plus en plus d'armes nucléaires sont présentes ? Que signifie pour nous le « deuxième âge nucléaire », dans lequel les règles de fonctionnement de l'arme nucléaire sont celles de l'époque pré-nucléaire, c'est-à-dire dans lequel l'arme nucléaire est une arme de terreur ? Les Etats-Unis répondent à ces questions notamment par la NMD. Celle-ci n'annule pas, à leurs yeux, la logique de dissuasion ; elle vise au contraire à la compléter, voire à la renforcer. Elle s'insère en effet dans une man_uvre globale qui vise à compléter la dissuasion américaine face aux défis dits asymétriques. Jamais la dissuasion nucléaire américaine n'a eu, d'ailleurs, l'ambition de répondre à toutes les menaces : les Etats-Unis ont toujours cherché à intégrer la dissuasion nucléaire dans un ensemble plus vaste, comprenant aussi un volet conventionnel et un volet protection. La NMD se veut donc un complément à la dissuasion nucléaire américaine face à des scénarios spécifiques (tir accidentel ou incontrôlé, Etat proliférant peu ou pas sensible à la logique de dissuasion). Dans ces conditions, les responsables américains peuvent affirmer que la NMD, loin d'affaiblir la dissuasion, la complète utilement en répondant à une vulnérabilité mal traitée par la seule dissuasion nucléaire, voire la renforce en soustrayant le territoire américain à toute possibilité de « chantage ». Que retenir de ce débat ? Aux yeux de la mission, deux constats s'imposent : - La rationalité politique de la dissuasion reste valide, à telle enseigne que toutes les puissances nucléaires ont gardé leurs arsenal depuis dix ans. Dans un monde instable, l'arme nucléaire reste une police d'assurance valable. Et même les projets de dénucléarisation qui ont cours aux Etats-Unis ne postulent pas la dispartion complète de cette arme. Quant à la France, elle a hérité l'arme nucléaire de la guerre froide ; elle doit la concevoir aujourd'hui comme une assurance contre d'éventuels contentieux susceptibles d'apparaître et comme un actif dont il serait imprudent de se défaire. En outre, un équilibre a été trouvé entre une dissuasion minimale et une politique active de désarmement. Pour la première fois, en effet, la France n'est plus montrée du doigt pour ses armes nucléaires, contrairement aux Etats-Unis, à la Chine ou à l'Inde. Il est d'ailleurs pour le moins paradoxal dans ces conditions de constater l'hostilité des jeunes Français de moins de 25 ans à l'égard de l'arme nucléaire, comme en témoigne le récent sondage de la SOFRES sur la Défense et les Français, commandé par la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. 30 % des personnes de 18 à 24 ans estiment que l'évolution de la situation internationale justifie l'abondon de notre force de dissuasion, contre 16 % seulement des plus de 50 ans140. Les causes de ce rejet sont sans doute multiples mais on peut penser que l'absence de tout débat sur ces sujets dans notre pays joue un rôle non négligeable. Cette police d'assurance pourrait notamment se révéler précieuse si la situation de la prolifération en Asie s'aggravait. En effet, le risque principal que subit aujourd'hui le régime de non-prolifération est asiatique, à tel point que c'est le Japon, et non l'Inde ou le Pakistan, qui risque d'apparaître de plus en plus comme une anomalie sur ce continent - nul besoin de souligner à quel point l'accès du Japon à l'arme nucléaire serait un moteur majeur de destruction du régime de non-prolifération : ne serait-ce que pour des raisons politiques, d'autres Etats suivraient ce mouvement. C'est d'abord vers la Chine que nos regards doivent se tourner, vers une Chine qui modernise et développe son arsenal sans discontinuer et dont les missiles peuvent nous atteindre. C'est également la Chine, proliférateur stratégique, c'est-à-dire exportatrice de technologies, matériaux et savoir-faire nucléaires et balistiques, que nous devons regarder avec attention. Par ailleurs, s'il est vrai qu'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan n'entraînerait probablement pas l'intervention de puissances non asiatiques, l'ensemble de la communauté internationale se trouverait néanmoins concernée par cette remise en cause du principe de la dissuasion. Un tel scénario conduirait-il à la suppression du tabou nucléaire qui régit les relations stratégiques internationales depuis 1945 ou à une reconfirmation de celui-ci ? Le coup porté à la dissuasion banaliserait-il l'arme nucléaire ou conduirait-il à son élimination ? Le seul précédent quant à l'utilisation d'une arme de destruction massive dans un conflit concerne le recours aux armes chimiques : dans ce cas précis, l'utilisation a conduit à une réaffirmation du tabou, comme en témoigne de façon éclatante la conclusion en 1993 de la Convention internationale d'interdiction des armes chimiques. S'agissant du nucléaire cependant, l'impossibilité de répondre à cette question valide le maintien de la posture actuelle de la France, de stricte suffisance certes mais de préservation de la dissuasion par la simulation. - Le deuxième constat qui s'impose aux yeux de la mission concerne le lien défense/dissuasion. Il est nécessaire d'introduire la défense active et passive dans le concept de dissuasion et surtout d'y adjoindre les moyens qui s'y attachent. Dans les pages qui suivent, vos rapporteurs font d'ailleurs des recommandations en ce sens. Mais, s'ils souhaitent d'ores et déjà poser la question des moyens, c'est qu'ils ont le sentiment que le dogme de la dissuasion pure ne repose pas seulement sur des bases conceptuelles, mais procède également de considérations budgétaires. Si la France, et plus généralement l'Europe, rentraient dans la spirale de la défense antimissile, il est généralement considéré que le coût d'un système antimissile pour l'Europe141 entraînerait immanquablement un effet d'éviction sur l'équipement conventionnel (renseignement, planification stratégique, projection) dont la modernisation ne pourrait pas être mise en _uvre, mais également sur la dissuasion. Si nous nous refusons un débat sur le rôle de l'arme nucléaire, si nous nous fermons l'option de la défense pour des raisons budgétaires, nous devons le reconnaître publiquement. Et en assumer les conséquences le moment venu. La mission refuse cependant cette logique de rationnement des moyens : avec la construction de l'Europe de la défense, se développe une dynamique positive, de nature à permettre un accroissement global des budgets de défense européen. Fait révélateur, même symbolique : le Parlement hollandais a, en cet automne 2000, obtenu une rallonge budgétaire de 140 millions de francs sur le budget de la défense en arguant des leçons de la guerre du Kosovo en matière aérienne. Expliquons aux opinions publiques européennes que, de même que les armées européennes auront besoin d'avions gros porteurs pour déplacer les forces sur les théâtres extérieurs, de même ces forces devront être protégées contre de nouvelles menaces. A la logique du rationnement il faut substituer une logique de débat, puis d'action volontariste. b) La France dispose-t-elle d'une stratégie de lutte contre la prolifération ? Au-delà des questions de doctrine, existe-t-il une véritable stratégie de lutte contre la prolifération dans notre pays ? Cette question revêt une importance fondamentale dans la mesure où, comme l'ensemble de ce rapport tend à le montrer, ce qu'on pourrait appeler le « fait proliférant » persiste en dépit de l'architecture complexe de non-prolifération mis en _uvre pour en prévenir le développement. Dès lors, la capacité de la France à définir une politique cohérente face à ce phénomène est essentielle à la préservation de ses intérêts de sécurité. Après une politique d'exportation quelque peu erratique, la France a pris conscience relativement tôt de la nécessité de disposer d'une stratégie cohérente, comme l'atteste la création, dès 1976, du Conseil de Politique nucléaire extérieure (CPNE)142 chargé de définir les différents aspects de la politique nucléaire, notamment en ce qui concerne l'exportation des équipements et produits nucléaires sensibles. Ainsi, dès sa première réunion, le 11 octobre 1976, le Conseil définissait une doctrine en six points, destinée à éviter que la France ne favorise la prolifération nucléaire. Qu'en est-il cependant du traitement des proliférations en général ? En la matière, un constat s'impose : il n'existe pas, dans le paysage institutionnel français, d'institution maîtresse qui a pour mission de traiter le problème de la prolifération dans son intégralité. En revanche, plusieurs acteurs de l'appareil administratif français s'intéressent à la lutte contre la prolifération. Pour ce qui est de la conception des principes et des outils de la politique française de non-prolifération, le ministère des affaires étrangères est sans doute l'acteur majeur. De même, la direction des affaires stratégiques du ministère de la défense a fait de ce sujet l'un des principaux axes de sa réflexion depuis sa création et est en cela rejointe par d'autres acteurs administratifs. Elle occupe par conséquent une place essentielle dans la réflexion en amont mais également dans l'analyse des stratégies à mener dès lors que les chaînes, points chauds ou réseaux de prolifération sont identifiés. Par ailleurs, le Commissariat à l'Energie atomique peut intervenir comme expert technique. L'information brute sur la prolifération est fournie par les différents acteurs du renseignement français, dont la Direction du renseignement militaire (DRM) mais surtout la Direction générale de la Sécurité extérieure. Celle-ci dispose d'une continuité d'analyse et d'expertise dans ce domaine même si se pose une vraie question quant à savoir quelles sont ses sources propres et celles qui lui sont transmises par des services étrangers. A dire vrai, vos rapporteurs ne peuvent fournir de réponse à cette question, le Ministre de la Défense ayant opposé une fin de non-recevoir à leur demande d'entretien avec le directeur de la DGSE, pour des motifs qui ne leur apparaissent pas clairement. Il s'agit pourtant là d'une question essentielle pour évaluer la capacité d'analyse autonome de notre pays. D'autant que, comme l'ont souligné certains interlocuteurs de la mission, nous manquons d'informations sur certains pays, y compris des puissances appelées à jouer un rôle stratégique majeur dans les années et décennies qui viennent. Dans la constellation française du renseignement, il ne faut enfin pas négliger le rôle des douanes qui, par leur action générale, mais aussi par une action spécifique peuvent jouer un rôle dans le dispositif de lutte contre la prolifération143. la douane et la lutte contre la prolifération Le rôle de la douane en matière de lutte contre la prolifération résulte pour une part de ses missions traditionnelles de contrôle des mouvements de marchandises144. Notamment, la douane, en particulier, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières(DNRED), peut mobiliser 10 000 agents pour les contrôles, même s'il n'existe que dix enquêteurs spécialisés sur les questions liées à la prolifération à Paris, soutenus, il est vrai, par des équipes régionales polyvalentes. Par ailleurs, la douane intervient dans le contrôle des biens à double usage et des matériels de guerre et la mise en _uvre des embargos commerciaux. Elle intervient également dans le dispositif de lutte contre la fraude qui repose essentiellement sur trois piliers que sont le contrôle, le renseignement et l'action antifraude, c'est-à-dire l'ensemble des mesures visant à démanteler des organisations et des réseaux. Les services de renseignement et d'enquête de la DNRED participent au Comité interministériel du renseignement (C.I.R.) placé sous l'égide du SGDN. La participation à cette instance permet de déboucher sur des actions concrètes en terme de lutte contre la fraude. L'ensemble de ce dispositif a permis d'effectuer onze enquêtes en 1998 et douze en 1999. La douane ne participe en revanche normalement pas à des groupes inter-étatiques tel que le MTCR. Elle est toutefois associée, en tant que de besoin aux réunions interministérielles de préparation et de débriefing qui peuvent avoir lieu dans les groupes du SGDN. La douane ne dispose pas d'un annuaire des entreprises fabriquant des produits sensibles. Elle travaille à l'aide d'une base de données américaine Risk Report. Serait-il possible d'ailleurs de disposer d'un tel annuaire, dans la mesure où toute entreprise fabriquant des produits de haute technologie peut fabriquer des biens à double usage ? L'approche qui prévaut aujourd'hui est davantage une approche par licence plutôt qu'une approche par entreprise. On peut le regretter. Ceci dit, du fait de sa double compétence dans le dédouanement (une entreprise qui prolifère devra, à un moment ou un autre, passer par une procédure douanière) et la lutte contre la fraude (même si elle n'a pas en charge l'analyse du tissu industriel, la douane fait remonter toutes les informations, à la DGA ou au service spécialisé de la DIGITIP), la douane dispose d'atouts majeurs, que n'ont pas d'autres services européens, notamment au Sud de l'Europe. Comment juger de l'efficacité du système français de lutte contre la prolifération ? Dans un système faisant appel à des moyens de lutte très disparates, c'est à l'aune de la coordination des acteurs qu'il faut répondre à cette question. Or, il n'est pas certain que la France dispose d'un outil de coordination adéquat. Certes, le Secrétariat général pour la Défense nationale (SGDN), placé sous l'autorité du Premier ministre, assure une coordination administrative, étant chargé de gérer la collecte du renseignement. La prolifération est une priorité pour le SGDN, qui a un rôle de centralisation et de synthèse du renseignement recueilli sur ce sujet. Il préside en effet les deux instances de synthèse dans ce domaine, le GRIP (groupe de renseignement interministériel sur la prolifération) et le CIR (comité interministériel de renseignement), dont l'une des priorités est la lutte contre la prolifération. C'est en effet sous son égide que le CIR, réactivé depuis 1990, fixe les objectifs pour les services de renseignement. Sans nul doute donc le SGDN se situe au c_ur du traitement de ce dossier par les pouvoirs publics français. Reste que, dans le domaine de la prolifération comme dans d'autres, on se heurte à la question plus large de l'organisation des services de renseignement et de la circulation de l'information qu'ils recueillent. Le SGDN coordonne et recueille les données, certes ; mais il est lui-même dépendant en amont du degré de coordination de ces différents services et de leur capacité à faire remonter l'information. Et, de fait, le SGDN ne traite pas de la gestion quotidienne du renseignement ni de sa diffusion. Sans parler par ailleurs de ce péché originel propre aux services de renseignement, particulièrement accentué dans le cas de la France, qui consiste à donner des coups de projecteurs sur tel problème ou tel pays, au détriment d'autres, en vertu d'un phénomène d'« auto-orientation » qui trouve sa cause dans l'insuffisant contrôle dont ses services font l'objet du fait de leur trop grande dispersion. En un mot, c'est l'offre de renseignement qui suscite la demande, et non l'inverse. Faut-il par conséquent concevoir, dans le domaine de la prolifération, une institution pilote, qui jouerait un rôle non seulement administratif mais également politique ? Faut-il s'inspirer de l'exemple du Royaume-Uni, où la commission conjointe (Joint Intelligence Committee)145 joue ce rôle ? Placée sous la responsabilité du Premier ministre, celle-ci représente en effet un instrument de coordination politique - et pas seulement administrative - rassemblant les collaborateurs des ministres concernés et ayant la responsabilité de l'élaboration d'une appréciation quotidienne de la situation, de la production de renseignements et de la gestion des services de renseignement et de sécurité. Elle dispose pour ce faire de la Joint Intelligence Organization, qui se compose de petits groupes de travail chargés d'étudier un domaine ou une région particulière. Sans doute l'existence d'un tel instrument poserait-elle inévitablement en France la question de son contrôle, du fait de la dyarchie du pouvoir exécutif. Il est pourtant nécessaire d'aller vers un mode de gestion du renseignement plus transparent, La création d'un organe de pilotage, politiquement responsable, est donc une nécessité. La bonne organisation de la collecte du renseignement ne saurait en effet suffire à pallier l'absence d'un comité de pilotage. La création d'instances européennes fournit en outre l'occasion d'avoir un partage européen du renseignement à un niveau élevé, dans un cadre institutionnel. Il faut là encore se référer à l'exemple britannique, le gouvernement ayant décidé d'affecter au comité d'Etat-major européen, qui se met en place actuellement, un général issu du monde du renseignement. A terme, la création d'un JIC rassemblant certains pays de l'Union européenne pourrait être envisagée146. Enfin, il est un autre critère qui permet de jauger l'efficacité du dispositif institutionnel français de lutte contre la prolifération : c'est sa capacité de sensibilisation de l'opinion publique, dans ses dimensions chimique et biologique notamment L'information des populations civiles fait en effet partie intégrante du dispositif de lutte en la matière. Sans invoquer un modèle américain, il faut toutefois prendre acte de la capacité des Etats-Unis à coordonner les efforts de lutte contre la prolifération et ses conséquences. Or, force est de constater que la France est très en retard dans ce domaine. Jamais elle n'a conduit d'exercice de simulation des conséquences d'une attaque de la population par une arme de destruction massive résultant de la prolifération. Sensibiliser en mobilisant, sans faire naître de sentiment de panique : telle devrait être la deuxième priorité de l'appareil institutionnel français de lutte contre la prolifération. Il faut, pour cela, se donner des moyens. Le principal domaine de sensibilisation concerne le risque biologique. A cet égard, on ne peut qu'être frappé par l'absence de littérature publique sur la menace biologique en France, d'autant plus marquante en comparaison de l'approche pédagogique adoptée par le Royaume-Uni. C'est ainsi que l'unité de maîtrise des armements du ministère de la Défense britannique a édité en août 1999 une brochure publique sur le risque biologique et ses conséquences. Ce constat rejoint la problématique de la coordination : si ce genre de publications n'existe pas, c'est bien parce que manque l'instance susceptible de les suggérer. Manque surtout la volonté, paralysée par la pureté du dogme de la dissuasion : le nucléaire nous protégerait contre tout ! Au total, l'appréciation portée par la mission sur l'existence d'une véritable stratégie de lutte contre la prolifération est mitigée : les instances de renseignement sont là mais la coordination est insuffisante, du moins dans sa dimension politique. Là réside d'ailleurs sans doute la principale difficulté : vos rapporteurs n'ont pas l'impression que la prolifération en général soit une priorité suffisamment mise en avant par les responsables politiques. C'est bien d'ailleurs dans cet esprit que la Commission de la Défense les a chargés d'établir le présent rapport. Autant la France affiche avec clarté ses efforts diplomatiques dans la non-prolifération, autant les risques de prolifération eux-mêmes et la définition d'une stratégie globale de défense pour y faire face n'apparaissent pas clairement. On retrouve en réalité la même frilosité stratégique que la mission a relevée au niveau européen, notamment parce que ces questions viennent bouleverser le consensus sur la doctrine et l'outil de défense. c) Faut-il introduire un élément défensif dans la doctrine française ? Est-il sage de ne pas accorder une place plus importante aux stratégies de contre-prolifération ? Il n'est pas certain qu'au fur et à mesure que les technologies de neutralisation des missiles balistiques s'amélioreront, l'idée qu'il vaut mieux laisser sa population vulnérable à une attaque soit nécessairement bien acceptée des opinions publiques. Sans doute les projets américains de NMD ne permettront-ils pas une protection totale ; sans doute relèvent-ils d'un syndrome du « zéro mort » qui n'est pas compatible avec les responsabilités d'une hyperpuissance. Reste que le développement de la défense antimissile est sans doute inéluctable147. D'ores et déjà des programmes existent, y compris en Europe où existe une sensibilité certaine au système de défense aérienne. Ainsi, l'Allemagne a une longue tradition de système de défense aérienne du territoire (programmes Hawk et Patriot). Elle entretient avec les Etats-Unis une coopération opérationnelle et industrielle intense et a fait de ce thème l'axe privilégié de la coopération transatlantique dans le domaine de l'armement avec le projet MEADS. Si celui-ci était mené à son terme, en dépit des hésitations récurrentes des Etats-Unis, il pourrait, vu de Berlin, constituer la « couche basse » d'un système de défense du territoire, le financement d'une « couche haute » étant amené par le budget commun de l'OTAN. Il ne peut non plus être exclu qu'à terme, l'Allemagne se dote de frégates avec une capacité contre les missiles balistiques de théâtre. S'agissant de l'Allemagne, où a toujours existé la crainte qu'en cas de crise grave, les autorités américaines ne « troquent Berlin contre New-York », le programme NMD, en limitant le champ de la dissuasion américaine, pourrait être séduisant aux yeux d'une partie des Allemands. A cet égard, toutes les remarques que la France pourra faire quant à l'impact de la NMD sur l'avenir du nucléaire ne manqueront pas d'être interprétées outre-Rhin comme la manifestation d'intérêts égoïstes liés à l'existence de la dissuasion française. Reste que globalement cependant, la sensibilité des Européens sur la défense antimissile est variable : si les Allemands et les Néerlandais soutiennent clairement les projets OTAN, y compris de « haute couche », les Italiens et les Turcs privilégient pour leur part une défense du territoire tandis que les Britanniques affichent leur préférence en faveur d'une défense des forces projetées et se montrent prudents sur les autres thèmes. S'agissant de la situation en Asie, c'est le Japon qui s'est jusqu'alors le plus engagé dans la coopération avec les Américains sur les systèmes de défense de théâtre, même si cette question a fait l'objet d'un débat intense dès les premières propositions américaines de 1994. Le survol du territoire japonais par un missile nord-coréen le 31 août 1998 a cependant fait pencher la balance en faveur des partisans de la TMD. Les autorités japonaises ont ainsi signé une lettre d'intention qui prévoit une dépense initiale de 45 millions de dollars sur deux ans pour un coût global de 500 millions de dollars sur cinq à six ans à la charge du Japon. Cette lettre d'intention porte sur un système antimissile basé en mer (Navy Theatre Wide ou NTW) ; les Américains envisagent de déployer un tel système comprenant 80 missiles intercepteurs sur quatre croiseurs Aegis en 2007. Au total, la participation du Japon représenterait 1/9è du coût estimé du programme NTW. Certes, les autorités japonaises soulignent que les études lancées n'ont qu'un caractère préliminaire et qu'il n'est pas encore question de déploiement. Par ailleurs, elles insistent sur le rôle limité de la participation japonaise à la maîtrise d'_uvre du système infrarouge et du second étage de propulsion des missiles. Néanmoins, dans un pays qui entretient avec l'arme nucléaire une relation complexe, marquée d'un côté par une profonde répulsion, de l'autre par la résignation, la défense de théâtre pourrait permettre au Japon de s'affranchir, ne serait-ce que partiellement, du parapluie nucléaire américain. La Corée du Sud a pour sa part officiellement renoncé au système de défense de théâtre en août 1999, jugeant le coût de tels programmes trop élevé et partiellement adapté aux menaces qu'elle peut avoir à affronter. Taiwan en revanche, entretient de longue date une coopération avec les Etats-Unis sur le programme Patriot et se montre extrêmement intéressé par l'ensemble des programmes de TMD américains. Cet intérêt inquiète d'ailleurs très fortement la Chine qui estime ses intérêts de sécurité beaucoup plus menacés par la TMD que par la NMD. En Asie du Sud enfin, l'Inde se montre extrêmement intéressée par l'acquisition de systèmes de défense de théâtre russes S-300, ce qui suscite la plus grande inquiétude du côté pakistanais. C'est au Moyen-Orient qu'existe le seul système de défense antimissile, entré en service en mars 2000 et déclaré opérationnel à l'été 2000. La guerre du Golfe a montré l'impact militaire et politique de la menace balistique pour Israël, puisqu'elle a conduit à un exode massif de la population israélienne vers Eilat, seule zone du territoire d'Israël hors des missiles irakiens. Cette démonstration grandeur nature de la pertinence de systèmes de défense contre les missiles de théâtre est renforcée, aux yeux des Israéliens, par le fait que ni l'Irak, ni l'Iran, ni la Libye ne sont parties au processus de paix. D'un point de vue théorique enfin, il est clair que toute attaque future contre ce pays risque fort d'être d'abord balistique, dans la mesure où c'est le moyen le plus efficace pour neutraliser le recours à la réserve, qui constitue la base du système de défense israélien. D'où la pertinence de défenses antimissiles, complément nécessaire de la défense civile, dont la guerre du Golfe a montré l'efficacité, en dépit du faible préavis laissé à Israël (5 minutes). C'est en 1988 qu'a été lancé le programme Arrow, résultat d'une proposition de coopération américaine, dans la foulée de la SDI. Ce système (Arrow Weapon System ou AWS) est conçu comme un système de défense antimissile national, reposant sur l'alerte avancée, l'identification des cibles, la localisation des sites de lancement et des points d'impacts148 et un système de gestion du combat et de C3I avancé. L'interception des missiles assaillants s'effectue à haute et basse altitude. L'AWS est par ailleurs interopérable avec d'autres systèmes de défense de théâtre, ce qui permet une défense à tous les niveaux. L'interception ne repose pas sur la technique de l'interception directe(hit-to-kill) mais sur la technique classique de la fragmentation, notamment pour détruire des sous-munitions chimiques. Les Israéliens projettent de développer l'interopérabilité de leur système de défense antimissile avec les systèmes de défense de théâtre américains basés sur mer. Un milliard de dollars ont été dépensés en 12 ans, dont 60 % à la charge des Etats-Unis, même si l'input technologique américain est inférieur à 10 %. Le coût total du programme - soit la production de 6 batteries en tout, trois restant à produire dans les dix ans - est estimé entre 1,7 et 2 milliards de dollars. 12 essais ont été réalisés depuis 1991, avec un taux d'échec de 50 % ; les essais les plus récents se sont cependant tous soldés par un succès. Faut-il considérer que le développement très probable de la défense antimissile dans un horizon de vingt à trente ans va mettre mécaniquement en cause la dissuasion française ? L'exemple israélien, comme du Japon ou de Taiwan d'ailleurs, est extrêmement intéressant dans la mesure où il met en lumière la frontière ténue entre défense de théâtre et défense du territoire. Cette approche est en réalité largement factice, la distinction pertinente s'établissant entre défense contre les missiles tactiques et défense contre les missiles stratégiques. On notera d'ailleurs qu'une défense tactique pour l'un peut être stratégique pour l'autre. C'est d'ailleurs afin de fixer les limites entre toutes ces notions que Russes et Américains ont négocié à Helsinki, en mars 1997, les accords de démarcation qui déterminent les systèmes de défense de théâtre autorisés dans le cadre de ce traité. Or, le résultat des négociations illustre les ambiguïtés existants dans ce domaine149. Les Etats-Unis souhaitaient obtenir la reconnaissance par le traité de tous les systèmes de défense de théâtre, pour peu qu'ils ne soient pas testés contre des missiles d'une portée supérieure à 3 500 kilomètres. La Russie pour sa part voulait interdire tout système à haute vitesse, ce qui aurait conduit à autoriser le THAAD mais pas le système NTW, dont la vitesse des intercepteurs est de 4,5 km/seconde. L'absence de consensus sur le statut du programme naval Navy Theater Wide (NTW) est révélateur du caractère largement factice de toute tentative de catégorisation. Et le fait que les Etats-Unis attachent, parmi l'ensemble des programmes de défense de théâtre, une importance particulière à ce programme l'est tout autant. En effet, l'intérêt que lui portent des pays comme le Japon, Israël ou Taiwan montre que ce système peut en réalité jouer un rôle de défense du territoire dans certaines configurations géopolitiques. Le glissement qui s'opère actuellement dans certains milieux stratégiques américains de la NMD vers l'interception des missiles en phase précoce (Boost-Phase Interception ou BPI) n'exprime pas autre chose. A cet égard, l'analyse qu'en donne un spécialiste tel que Richard Garwin150 est extrêmement intéressante : ce dernier considère en effet que « le système le plus efficace n'est pas fondé sur l'architecture actuelle de la NMD », faisant remarquer qu'un système d'interception à mi-course est vulnérable aux contre-mesures et faible pour régler le problème des sous-munitions et des têtes multiples. A titre indicatif, on goûtera également l'argument sur les avantages stratégiques de la BPI : « Parce qu'elle ne représente pas une menace pour les dissuasions russe et chinoise, la BPI ne bouleversera pas l'équilibre stratégique international et, par conséquent, aura un bien moindre impact sur l'avenir de la maîtrise des armements que la NMD ». Mais l'essentiel n'est pas là : il réside dans le fait que la BPI gomme totalement les frontières classiques. Quand Richard Garwin écrit qu'« il faudrait songer à utiliser l'intercepteur basé au sol développé pour la NMD pour un déploiement de théâtre avancé permettant l'interception en phase de décollage », on voit s'ébaucher la notion de défense du territoire à partir d'un théâtre qui peut être situé à des milliers de kilomètres de la cible. Par conséquent, la multiplication de ce type de programmes ne pourra que gommer un peu plus les distinctions entre stratégie de défense et stratégie de dissuasion. La réflexion stratégique fonctionnant, comme les perspectives de déploiement de ces programmes, à quinze ou vingt ans, c'est aujourd'hui que cette question doit être abordée dans la réflexion stratégique française. Un dogmatisme excessif constituerait un frein au lancement de cette réflexion et exposerait la France au risque d'une réaction par à-coup lorsqu'une crise surgira. Car, à moyen terme, la NMD peut remettre en cause l'efficacité opérationnelle de notre dissuasion. Et ses effets indirects sur celle-ci sont nombreux : sur le plan conceptuel, les paramètres de l'équation entre défense et dissuasion pourraient en être considérablement modifiés, ce qui impliquerait une rénovation considérable de notre cadre de réflexion stratégique. En outre, dans l'éventualité d'un accord russo-américain sur le traité ABM, la portée des avantages et des coopérations technologiques consentis par les Etats-Unis en faveur de la Russie devra être examinée avec attention par la France. Car, si des défenses contre les missiles balistiques sont déployées un peu partout dans vingt ans, qu'en sera-t-il des capacités de pénétration de nos systèmes sans essais, ni programmes nouveaux ? Reste enfin un problème que ni la dissuasion ni la défense antimissile ne peuvent régler : l'hypothèse d'une attaque terroriste, sur le territoire national, à l'aide d'armes de destruction massive, vraisemblablement biologiques ou chimiques. Dans ce cas, la France dispose d'une seule arme à ce jour : celle de la prévention par le renseignement. En matière de défense passive de sa population en revanche, elle est totalement dépourvue de moyens de réaction. 3. Les moyens : pour une action multiforme et volontariste Il existe quatre moyens de lutter contre la prolifération, qui peuvent d'ailleurs être complémentaires : la prévention par le renseignement, la dissuasion, la défense passive et la défense active, qui inclut théoriquement les frappes préventives et la défense antimissile. Le socle de la posture traditionnelle française est formé par le couple prévention - dissuasion, tandis que les défenses active et passive n'en sont encore dans notre pays qu'à des stades peu avancés. Quant aux frappes préventives, elles ne font pas partie du concept français. Au terme de son analyse, la mission estime que les différentes composantes de cette palette de moyens trouvent chacune leur justification et doivent être préservées ou développées quand elles n'existent pas. Reste que, ici et là, elle a identifié des manques, qu'il impose de combler pour que la France dispose d'une véritable stratégie de lutte contre la prolifération. Elle recommande donc l'adoption de quatre types de mesures : - en matière de renseignement, l'acquisition de données brutes sur l'ensemble des proliférations doit être renforcée, notamment grâce au renseignement humain. S'agissant plus spécifiquement de la prolifération balistique, la mission appelle à une action volontariste pour l'acquisition d'une capacité européenne de détection de tirs de missiles ; - dans le domaine de la dissuasion, les membres de la mission ont des avis divergents. Aux yeux de votre rapporteur socialiste, l'effort actuel de notre pays en faveur de la dissuasion doit être maintenu car il suffit à préserver sa crédibilité. En revanche, le rapporteur RPR de cette mission estime nécessaire d'élargir la gamme des options arrêtées en maintenant un niveau d'armes offensives supérieur pour exercer éventuellement une politique coercitive et de frappes préventives ; - en revanche, en matière de défense passive, la mission ne peut que constater l'insuffisante sensibilisation de l'opinion et des responsables politiques. C'est donc à un travail pédagogique qu'elle appelle d'abord. Au-delà, la mise en _uvre d'un système efficace de défense en profondeur contre la prolifération et ses conséquences doit être sérieusement envisagée ; - s'agissant enfin de la défense contre les missiles, la France doit poursuivre le développement d'une défense antimissile de théâtre. Mais, en la matière, son action ne doit pas s'arrêter là. Afin de préserver les conditions de son autonomie de décision stratégique et industrielle, elle se doit de maintenir une veille technologique poussée sur l'interception précoce de missiles balistiques. a) La prévention par le renseignement : développer les moyens existants et acquérir une capacité de détection des tirs de missiles « La prévention doit aussi, par le renseignement, nous mettre à l'abri de surprises stratégiques ». Cet extrait du rapport annexé à la loi de programmation souligne parfaitement le rôle que peuvent jouer les capacités de renseignement dans la lutte contre la prolifération, qu'il s'agisse de la non-prolifération en aidant à contrôler le respect des engagements internationaux ou de la détection des tirs de missile et des infrastructures suspectes. Car, comme nous l'avons montré précédemment, la prolifération prend de plus en plus la forme de programmes de petite ampleur clandestins, très difficiles à détecter. La mise en _uvre des traités devient donc de plus en plus une affaire de services secrets, et de moins en moins de diplomates. Par conséquent, le travail de surveillance en amont de la prolifération doit être approfondi, accéléré, ce qui implique une augmentation des moyens pour affiner la connaissance du niveau de risques, l'objectif minimal devant être d'éviter le « coup anonyme facile ». Il faut pouvoir dissuader un Etat hostile en lui faisant comprendre que ses activités hostiles sont connues, s'agissant tant des vecteurs que des charges. Actuellement, la France dispose d'une capacité d'apport national à une analyse globale. D'après les informations recueillies par la mission, les autorités françaises manquent de données brutes sur certaines capacités étrangères, qui n'ont jusqu'alors que peu suscité l'attention car sans doute considérées comme trop lointaines ou trop peu crédibles. Si l'on raisonne par type de prolifération, deux constats peuvent être faits : - dans les domaines biologique et chimique, la France sous-estime nettement les risques associés à ces deux types de prolifération, au contraire de ses alliés anglo-saxons ; - dans le domaine balistique, alors qu'existe une vraie prise de conscience des risques, le dispositif d'évaluation de la prolifération balistique est faible, le MTCR n'étant de toute façon qu'un système de coordination entre pays fournisseurs, faute de pouvoir être un instrument de contrôle efficace du fait de la nature duale des technologies concernées. Notre capacité de veille (renseignement humain et spatial, écoutes) doit donc augmenter, de même que nos moyens de gestion de crise. Dès 1994, le Livre blanc sur la défense, rompant avec l'approche traditionnelle de la France, a souligné l'importance d'une réponse conjuguant prévention et dissuasion face au risque balistique : « dans le domaine de la lutte antimissiles, l'étude des défenses possibles concerne à ce stade les capacités de défense aérienne et de détection notamment spatiale ». Aujourd'hui en effet, la France, et les pays européens dépendent totalement des DSP américains. C'est donc sur l'acquisition d'une capacité de détection des tirs de missiles que la mission souhaite attirer l'attention : nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce besoin. La mise en _uvre d'une capacité de veille et d'observation autonome ne pourrait se faire qu'au niveau européen. Il s'agit là une capacité d'observation complexe, la détection de départs de missiles sur fond de terre étant particulièrement difficile. L'apport technique de satellites géostationnaires porteurs d'instruments d'observation de la terre capables de détecter les jets de gaz chaud de la phase propulsée des missiles balistiques est de quatre ordres : - par l'observation permanente d'une large zone terrestre, ils permettent d'avoir connaissance de tout essai de missile balistique et constituent en cela un élément de souveraineté ; - en cas d'agression, l'auteur est immédiatement identifié, ce qui renforce la crédibilité de la dissuasion ; - le satellite remplit une fonction d'alerte et donne un temps de préavis en cas de crise ; - dans ses versions les plus évoluées, il fournit les éléments de trajectoire nécessaires à la mise en _uvre de défense active. A l'heure actuelle, ce sont les Etats-Unis qui disposent des systèmes les plus évolués151. D'une part, les DSP, en service depuis les années 1970, ont été conçus pour l'alerte stratégique des Etats-Unis contre les missiles intercontinentaux soviétiques, mais sont peu adaptés à l'observation de missiles de courte portée. Ils ont pu en revanche, pendant la guerre du Golfe, être utilisés pour la détection et la surveillance des missiles de courte portée et servir à la mise en alerte du théâtre d'opérations. Depuis 1996, les Etats-Unis ont lancé le programme SBIRS, partie intégrante des systèmes antimissiles. Par rapport aux DSP, les SBIRS disposent d'un deuxième senseur à plus faible champ, avec une cadence de balayage élevée, donc une capacité de détection beaucoup plus puissance. Au regard du concept français, comme des menaces susceptibles de peser sur l'Europe et des moyens dont elle dispose, le consensus sur l'acquisition d'un système tel que le SBIRS est peu réaliste à court et moyen terme. En revanche, pour la surveillance des théâtres extérieurs, bien que le satellite ne soit pas strictement indispensable, (d'autres moyens tels que les radars au sol ou des capteurs infrarouges sur avion ou drone haute altitude pouvant y suppléer), l'acquisition d'une capacité de type DSP est souhaitable, ne serait-ce que pour des raisons de crédibilité et d'indépendance à l'heure où l'Europe de la défense se construit. En outre, sur le plan diplomatique, cette mesure permettrait aux Européens de coopérer avec les Etats-Unis et avec la Russie qui a d'ores et déjà proposé une coopération avec l'Europe, alors que celle-ci n'a pour l'instant rien à échanger. Même si les satellites géostationnaires russes ne sont pas en très bon état, cette coopération serait d'autant plus riche qu'elle aurait une double dimension, civile - notamment sur les questions d'environnement - et militaire. L'acquisition d'une capacité de renseignement et d'alerte pose un problème financier - aucun financement n'est prévu actuellement pour ce type de capacité - et non technique puisque la France par exemple dispose de la compétence nécessaire. D'après les estimations recueillies par la mission, le coût de l'investissement initial en serait pour la France de 10 milliards de francs environ : acquisition de deux satellites géostationnaires avec capacité de détection infrarouge, satellites radars, drones haute altitude, utilisation des capacités de Hélios II, moyens d'intelligence au sol. b) La dissuasion : maintenir la compétence nucléaire C'est avant tout la dissuasion qui assure la protection du territoire national dans la doctrine française. Elle reste l'élément déterminant de la posture et du discours publics, comme l'ont rappelé le Président de la République dans son discours du 30 août 1995 et le Premier Ministre devant l'IHEDN en octobre 1999. La valeur pédagogique de ces discours ne doit pas être négligée, d'autant qu'ils sont appuyés par les moyens prévus en loi de programmation : deux composantes en voie de modernisation, (l'une balistique, emportée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de nouvelle génération (SNLE- Ng) équipés à l'horizon 2008 du missile M 51, l'autre aérobie, emportée par des aéronefs, qui vont être dotés du missile air-sol moyenne portée amélioré), programme Palen de simulation. La question n'est donc pas celle des moyens mais celle de leur affichage. Dans cette optique, il faut réaffirmer le caractère-clé du maintien de la compétence humaine : la réussite du programme de simulation est indissociablement liée à la capacité de recruter de jeunes chercheurs capables de reprendre le relais des concepteurs de charges nucléaires qui ont bénéficié de l'expérience des essais. Par ailleurs, il faut réaffirmer le rôle clé des SNLE-Ng, qui apportent toutes les garanties, y compris contre les puissances nucléaires émergentes. Notre effort actuel est-il suffisant ? Sur ce point, vos rapporteurs ont un avis divergent. Aux yeux du rapporteur socialiste, les choix faits en matière de dissuasion depuis le début de la décennie 1990 garantissent la crédibilité de notre force de dissuasion, au moins d'ici à l'échéance fixé par le modèle d'armée 2015 : en 2008, la France disposera, avec le M 51, d'une composante maritime susceptible de nous prémunir encore plus efficacement des menaces les plus lointaines ; de même, le couple Mirage 2000 N-missile ASMP amélioré, opérationnel d'ici à 2007, assurera pleinement la crédibilité de notre force aéroportée. Le rapporteur RPR de cette mission s'interroge pour sa part sur les capacités de notre force de dissuasion d'ici à vingt ans : même si la tête du missile M 51 est durcie par rapport à celle du M 45, même si ses capacités de furtivité et de pénétration sont supérieures, ces progrès sont-ils suffisants dans l'éventualité probable d'un développement des défenses antimissiles ? Par ailleurs, notre capacité de frappe à moyenne portée - songeons aux menaces venant des rives du sud de la Méditerranée - est insuffisante. En bref, la gamme des options de notre dissuasion est trop restreinte et doit donc être accrue. c) La défense passive : organiser un système efficace de défense en profondeur contre la prolifération et ses conséquences La défense passive concerne la défense de la population et des troupes contre les radiations nucléaires mais surtout contre les effets des gaz et agents chimiques et biologiques. Dans ce domaine, la France part avec deux handicaps majeurs : elle a de longue date abandonné ses programmes chimique et plus encore biologique. En outre, cette notion ne fait pas partie de notre culture, contrairement aux pays anglo-saxons, essentiellement pour des raisons géographiques. Ainsi, aux Etats-Unis, l'executive order n °12938 du 14 novembre 1994 reconnaît que l'usage potentiel d'armes nucléaires, biologiques et chimiques par des groupes terroristes ou des Etats voyous représente une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis. En juin 1995, a été lancée dans ce pays une campagne contre le super-terrorisme, c'est-à-dire le terrorisme qui recourt à des armes de destruction massive. En 1997, 52,6 millions de dollars ont été alloués au programme de préparation domestique, qui vise à former des équipes d'urgence dans 120 villes sélectionnées aux Etats-Unis. Enfin, le 22 mai 1998, dans un discours à l'académie navale d'Annapolis, le président Clinton a proposé de débloquer 420 millions de dollars sur cinq ans pour créer un stock de vaccins et d'antibiotiques pour protéger les Américains contre des attaques biologiques. Cette initiative faisait suite à un plan restreint aux seules forces armées. A partir de ce double constat, quels peuvent être les axes d'action pour la France ? La protection du territoire relève davantage des moyens de la lutte anti-terroriste que des questions de défense. Il n'empêche qu'une meilleure sensibilisation aux risques potentiels devrait être diffusée au sein de l'opinion publique qui a récemment découvert le terrorisme chimique avec l'attentat du métro de Tokyo. Certes, comme ce cas l'a montré, il n'est pas facile de réussir une attaque de ce type : neuf tentatives ont été perpétrées avant l'attaque du métro de Tokyo. La presse britannique s'était d'ailleurs fait l'écho de morts mystérieuses dans une ville au Nord de Tokyo, trois mois avant cet épisode, et s'était interrogée sur l'éventualité d'une attaque biologique. Mais ces difficultés techniques n'annulent pas l'existence d'un risque. Le principal domaine d'action concerne la protection des troupes, ce qui suppose, en amont, une capacité d'expertise et de recherche (1), en aval, une capacité de détection puis de protection (2). (1) Dans le domaine chimique, le souci de la France est d'abord de conserver une capacité d'expertise : en effet, ne développant plus elle-même ce type de technologies du fait de ses engagements internationaux, elle risque de perdre ses compétences d'analyse. Elle maintient donc une petite capacité de veille dans un domaine qui intéresse peu, il est vrai, les jeunes chercheurs. Dans le domaine biologique en revanche, la France dispose d'une très faible capacité d'expertise. Un fait très révélateur suffit à donner la mesure du retard français : lorsque l'un des acteurs majeurs du programme biologique soviétique, Victor Pasechnik, qui dirigeait le centre de virologie militaire de Leningrad, a fait défection à Paris en 1989, les autorités françaises ont été incapables de recueillir ses informations - en jargon militaire de le « débriefer » -, faute d'une expertise technique suffisante. Et c'est à nos voisins britanniques que cette tâche est revenue, alors même que, comme il a été confirmé à vos rapporteurs lors de leurs entretiens en France, notre pays manque considérablement d'informations pour évaluer la situation actuelle du biologique en Russie. (2) S'agissant de la détection, la France est relativement bien positionnée dans le domaine chimique et travaille actuellement à mettre en _uvre une capacité de détection avancée. En revanche, elle est beaucoup plus vulnérable sur le traitement d'une attaque biologique. Pour être efficace, la protection contre les armes biologiques doit relever quatre défis : - un défi médical (mise au point de vaccins ou d'antibiotiques) ; - un défi scientifique (s'adapter aux nouvelles armes) ; - un défi logistique (être mise en _uvre rapidement, pour tous) ; - un défi tactique (capacité de détection précoce). Au total, la complexité de la prolifération biologique, ne serait-ce qu'au vu de la diversité des vecteurs d'utilisation, conjuguée à ce que tous les spécialistes rencontrés par la mission ont reconnu être un retard français dans ce domaine, rend les forces françaises extrêmement vulnérables à ce type d'attaques à ce jour. La France est donc très loin d'avoir atteint les capacités britanniques, encore moins américaines, pour qui, alors qu'ils sont déjà très avancés, des progrès énormes restent à faire. La mission estime que ce retard doit être comblé, ne serait-ce que pour des raisons d'interopérabilité. On rappellera à titre d'information, que les Etats-Unis dépensent 1,4 milliard de dollars par an (chiffres 1999) sur des programmes de défense biologique. Or, contrairement aux Etats-Unis, qui prennent ce sujet très au sérieux, et au Royaume-Uni (où 1 milliard de francs a été investi dans la production d'un vaccin contre l'anthrax pour les forces), la France n'a jamais tellement investi dans ce secteur et s'est limitée à un effort minimal. Pour 2001, 85 milliards de francs sont inscrits au budget pour l'équipement des forces terrestres en matériels NBC (c'est-à-dire de protection contre les menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques) : ce montant est largement insuffisant et même en baisse par rapport à 2000 (101 millions de francs). La prochaine loi de programmation militaire doit rompre avec cette approche minimaliste. Ce retard français tient largement à l'insuffisante sensibilité des autorités politiques françaises à ce problème, essentiellement du fait de l'angle mort de notre dissuasion sur le problème d'une attaque des forces avec une arme biologique ou chimique. L'évolution du budget du programme civil de défense dit tout de cette absence d'intérêt : il représentait 170 millions de francs en 1990-1992, mais seulement 8 en 1999 - dont 4 millions de francs pour le programme de transmission de l'OTAN. Certes, les crédits du programme civil de défense (PCD) géré par le SGDN sont remontés à 17 millions de francs dans la loi de finances pour 2000 tandis que 25 millions de francs sont inscrits dans le projet de loi de finances pour 2001. Ces crédits devraient financer le réseau interministériel de base uniformément durci « Rimbaud », à hauteur de 11,5 millions de francs. Quant au programme interministériel de lutte contre le terrorisme nucléaire, biologique et chimique, il sera renforcé avec une dotation de 13,5 millions de francs. « Il s'agit ici d'une première étape visant, dans un cadre interministériel, à retrouver un niveau de protection en rapport avec la menace telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Les crédits que le SGDN va consacrer à un meilleur équipement ont vocation à susciter un effort correspondant dans chacun des ministères concernés » 152. Cette approche va dans le bon sens, mais est encore trop timorée. Si vraiment il s'agit d'harmoniser menace et moyens, il faut encore augmenter les moyens de protection dans ce domaine. Selon les experts français, l'effort budgétaire dans ce domaine doit être porté à 30-35 millions de francs. C'est bien le minimum. Il semblerait par ailleurs que, d'ores et déjà, un travail interministériel soit en cours : des directives et des dispositifs auraient été arrêtés dans les domaines nucléaire et chimique et devraient l'être prochainement en matière biologique. Il s'agit désormais de promouvoir une réflexion européenne sur ce sujet, travail auquel s'est attelé le SGDN. d) La défense active : développer une défense antimissile de théâtre et maintenir une veille technologique poussée sur l'interception précoce de missiles balistiques · La défense antimissile : point de méthode Face à des missiles de portées, et donc de vitesses, variées, il faut des défenses variées. Les capacités de défense aérienne sol-air offrent une première capacité anti-balistique. Face aux menaces balistiques les plus évoluées, les capacités de défense aérienne sont toutefois insuffisantes et des défenses spécifiques s'imposent, elles-mêmes adaptées à la vitesse des missiles balistiques qu'elles visent. Ces défenses spécifiques reposent sur le triptyque « grande vitesse, (des missiles comme des intercepteurs) - haute altitude - grande zone défendue ». Globalement, il existe trois types de systèmes antimissiles : - la première catégorie de défenses contre les missiles balistiques inclut des systèmes visant les missiles ayant une vitesse inférieure à 5 000 m/seconde et reposant sur des intercepteurs volant à moins de 3 000 m/seconde. On trouve dans ce premier ensemble des systèmes que l'on peut qualifier de défense aérienne élargie. Tel est le cas du missile russe S 300 PMU (SA 10), du missile franco-italien Aster (1 500 m /seconde), des missiles américains Patriot pour le programme PAC 2 (1 000 m/seconde), ERINT pour les programmes PAC 3 et MEADS (1 500 m/seconde), du missile intégré dans le système THAAD (2 800 m/seconde) et enfin du missile israélien développé dans le cadre du programme Arrow (2 900 m/seconde) ; - la deuxième catégorie de systèmes de défense antimissile concerne le même type de missiles balistiques (vitesse inférieure à 5 000 m/seconde), mais repose sur des missiles intercepteurs plus rapides (vitesse supérieure à 3 000 m/seconde). Dans cette catégorie, comme dans la suivante d'ailleurs, seuls sont présents les Etats-Unis, avec le SM3 développé pour le programme de défense basée sur mer NTW (3 500 m/seconde) et la Russie, dont le missile S 300 V (SA 12 Giant) intercepte les missiles balistiques à une vitesse comprise entre 2 700 et 3 100 m/seconde ; - la dernière catégorie de systèmes de défense antimissile est celle que le traité ABM réglemente depuis 1972. Si la vitesse d'interception est identique à celle des systèmes de la deuxième catégorie, les missiles balistiques visés atteignent pour leur part des vitesses supérieures à 5 000 m/seconde. Seuls deux systèmes de défense contre ce type de missiles existent à ce jour, tous deux russes, puisque, dès 1976, soit six mois après son entrée en service opérationnel, les Etats-Unis avaient mis fin au programme Safeguard - tout en conservant toutefois le réseau de détection du système et en menant des recherches ininterrompues dans ces domaines. Il s'agit du missile Gazelle SH - 8, qui réalise des interceptions dans l'espace endo-atmosphérique, et du Galosh SH - 11, qui réalise des interceptions exo-atmosphériques, soit à 80 mètres d'altitude au moins. Tout l'enjeu actuel du débat sur la NMD vise à la création d'un système américain qui entrerait dans cette catégorie, avec la mise au point du GBI (Ground Based Interceptor). La comparaison entre les deux pays montre que des choix différents ont été faits dans le domaine de la défense contre les missiles balistiques. La Russie a déjà quarante ans d'expérience dans le domaine de la défense antibalistique153. Dès le début des années 1960 en effet, elle dispose des trois éléments nécessaires à ce type de missions : un radar d'alerte (Hen House), un radar de conduite de la bataille (Dog House) et un intercepteur exo-atmosphérique, le Galosh. Le système est complété au début des années 1980 par un satellite d'alerte et un deuxième type d'intercepteur, qui intervient dans l'espace endo-atmosphérique, le Gazelle. A noter que les deux générations d'intercepteurs sont à charge nucléaire. L'histoire de la défense antimissile aux Etats-Unis n'offre pas la même continuité technologique ; il n'a d'ailleurs jamais existé à proprement parler de défense antimissile américaine, dans la mesure où le seul système opérationnel de défense active ne l'a été que six mois. Toutefois, les recherches n'ont jamais cessé, de même que le système d'alerte par satellite est actif depuis les années soixante-dix. A cet égard, alors qu'avec les DSP, les Etats-Unis peuvent surveiller l'ensemble des départs de missiles dans le monde, il n'est pas certain que les satellites russes soient toujours opérationnels. Il se pourrait donc que les Etats-Unis détiennent aujourd'hui un monopole en la matière. Avec le système envisagé dans la NMD du SBIRS-Low, les Etats-Unis disposeront en outre d'une technologie totalement nouvelle : alors que les satellites actuels ne permettent de surveiller que les départs de missiles, c'est-à-dire la phase de propulsion (trace d'un jet chaud qui dure 60 secondes pour un SCUD et deux minutes pour le M 45 par exemple), le SBIRS-Low aura la capacité de suivre en infrarouge le missile balistique après sa phase propulsée, c'est-à-dire de désigner l'objectif aux radars basés au sol. S'agissant de l'interception, les choix technologiques américains se sont d'abord tournés vers des systèmes d'interception à base de charge nucléaire, à l'instar de la Russie. Tous les projets successivement étudiés de 1955 à la fin des années 1970 reposaient sur ce principe, qu'il s'agisse de Nike Zeus, Nike X, Defender, Sentinel, Safeguard. Le tournant majeur dans la défense antimissile s'opère en 1978, avec le système Overlay, fondé sur le principe du « hit-to-kill », c'est-à-dire de l'interception directe : en bref, pour que l'interception réussisse, il faut que l'intercepteur passe à moins de deux mètres de l'assaillant. C'est sur cette même base qu'est construite la SDI de 1983 à 1993 ou la BMD depuis cette date154. Les Etats-Unis disposent donc d'une expérience de vingt ans sur la technique de l'interception directe. Quatre essais d'interception ont été réalisés dans le cadre du programme Overlay, dont les trois premiers se sont soldés par un échec ; l'ERIS (Exo Atmospheric Range Interception System) a été testé deux fois (un succès, un échec). Quant aux essais du GBI, ils se sont soldés par trois succès et deux échecs, dus pour le premier à un problème de refroidissement de l'autodirecteur et pour le second à la non-séparation de deux étages. Les études pour la seule NMD ont représenté 7 milliards de dollars, le coût de la capacité initiale atteignant 15 milliards de dollars entre 2000 et 2007 et celui de la capacité étendue, 29 milliards de dollars entre 2007 et 2011. · Développer une défense antimissile de théâtre Comme il a été souligné précédemment, la question d'une défense antimissile a été ouverte par le Livre blanc de 1994. Depuis qu'elle s'est retirée du programme MEADS, la France développe un seul programme de défense antimissile, le programme franco-italien Aster. Aster est, dans sa conception initiale, un missile bi-étage de défense antiaérienne classique. Dans cette configuration, il est capable de détruire dans l'espace endoatmosphérique des cibles qui se déplacent lentement telles que des avions ou des missiles de croisière. L'Aster 30 ne repose pas sur la technique de l'interception directe (hit-to-kill), même s'il touche dans les faits 90 % des cibles précitées. Dans sa catégorie, l'Aster surclasse ses concurrents. Il a été décidé de doter l'Aster d'une capacité anti-balistique de base. Le développement de l'Aster bloc 1, version capable de détruire des missiles de type SCUD de 600 kilomètres de portée, a débuté en 2000 et devrait être achevé à la mi-2002, pour un missile opérationnel en 2005. Sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires dans la prochaine loi de programmation... Le bloc 1 représente un coût de 1 milliard de francs. A plus long terme, l'Aster devrait être en mesure d'atteindre les capacités du Patriot dans sa version PAC-3 ou du SM 2 dans le programme MEADS, c'est-à-dire d'intercepter à 1500 m/seconde des missiles balistiques de 1 500 kilomètres de portée, tout en conservant les capacités initiales de l'Aster 30, que ne possèdent pas les missiles du MEADS ou du PAC - 3. Les études de cette version dite bloc 2 ont commencé en 2000 ; si le développement commençait vers 2006, on pourrait envisager une mise en service opérationnel vers 2010. Reste à en prévoir le financement : à cet égard, la mission souhaite vivement que la future loi de programmation militaire prévoie les moyens nécessaires en la matière. D'après les experts, le coût total d'une défense de théâtre de type Aster, qui permet de protéger les forces et les populations européennes du sud de l'Europe contre les missiles balistiques les plus répandus, aujourd'hui de portée de 600 kilomètres maximum (Scud B, M11, Scud C, M9), demain jusqu'à 1 000 à 1 500 kilomètres (Nodong, Shihab IV), est évaluée à 18 milliards de francs, sans compter les moyens de renseignement spatial.
Dans tous les cas de figure, le système d'alerte développé dans le cadre du programme Aster est embryonnaire. Or, cet atout significatif que représente le programme Aster ne pourra cependant être totalement valorisé que si l'Europe se dote des deux systèmes qui lui permettront d'atteindre une véritable autonomie dans la défense antimissile, à savoir la maîtrise de cette technologie d'avenir qu'est le « hit-to-kill » ainsi que des capacités de renseignement et d'alerte, le concept de discrimination se situant in fine au c_ur de la technologie. On en revient là à la question de l'acquisition de moyens de renseignement spatial. Dans le même ordre d'idées, comment la France doit-elle se positionner à l'égard des programmes dits « upper-tier » (« couche haute »), très en vogue aux Etats-Unis ? S'agissant du programme développé par la marine américaine, on notera qu'après sept ans de débats, aucun essai n'a encore été effectué ; quant au THAAD, il a fait l'objet de nombreux essais mais également de nombreux échecs. En conséquence, une attitude prudente s'impose pour l'instant. · Maintenir une veille technologique sur l'interception précoce des missiles balistiques La France doit-elle se doter d'une défense contre les missiles stratégiques ? Une première réponse à cette question pourrait être de considérer que c'est là un faux problème dans la mesure où, en l'état actuel de la technologie, ce type de défense est inefficace. On retrouve là le débat sur l'efficacité réelle de la NMD. A cet égard, il est certain qu'il reste un long chemin à parcourir pour les Etats-Unis, tant sur les techniques d'interception elles-mêmes que sur l'acquisition d'une capacité de discrimination entre les têtes et les leurres. De même, l'interception de missiles multi-ogives est un défi technique pour les Etats-Unis. Enfin, des débats multiples existent quant à l'efficacité de la NMD contre une attaque chimique ou biologique, même si la technique de l'interception directe (hit-to-kill) est la plus efficace contre ce type de dangers. Dans le cas du chimique, il est possible que l'interception du vecteur anéantisse les effets de la charge, faute d'une densité suffisante des molécules ; dans le cas du biologique, la fragilité des organismes, notamment face aux UV, peut leur faire perdre toute nocivité. Il est néanmoins probable, au vu des sommes qui sont investies dans ce programme, qu'un système plus ou moins efficace sera mis en place, dans la configuration actuelle de la NMD ou à travers le système d'interception en phase précoce. La question de savoir ce que fera l'Europe ne peut donc pas être esquivée. A cet égard, trois constats s'imposent : - cette catégorie de programmes implique l'identification d'une menace précise et avérée. Or, la France ne subit pas de menace directe et immédiate de ses voisins les plus proches, y compris au Sud de la Méditerranée ; - a fortiori, de tels programmes ne sont pas polyvalents et ne sauraient être utilisés pour des menaces plus globales. On ajoutera que, n'étant pas une hyperpuissance, la France n'a pas à gérer la menace missilière de la Corée du Nord. - le coût d'opportunité de ce type de système en Europe serait très élevé. L'acquisition d'une défense du territoire européen contre la menace balistique à l'horizon 2012-2015 représenterait un investissement que l'on peut évaluer à 77 milliards de francs environ. Un tel système n'aurait rien à voir sur la NMD telle qu'elle est conçue aux Etats-Unis, dont le coût est évalué à : - 23 milliards de dollars pour un site d'interception et 20 intercepteurs ; - 30 milliards de dollars pour un site d'interception et 100 intercepteurs ; - 50 à 60 milliards de dollars pour sept sites et 400 intercepteurs. LE COÛT D'UNE NMD EUROPÉENNE1 - 2 satellites géostationnaires infra-rouge ▪ développement : ▪ acquisition : ▪ M.C.O. 2 : (remplacement au bout de 10 ans) (BUDGET ESTIME 14GF) - 3 systèmes de missiles exo-atmosphériques ▪ développement : ▪ acquisition (180 missiles) ▪ M.C.O. : - 7 radars bande S assurant de façon maillée la conduite des tir des missiles exoatmosphériques ▪ développement : ▪ acquisition : ▪ M.C.O : - 20 batteries SAMP/T block23 (protection de 20 points sensibles en Europe) ou dérivé ▪ développement : ▪ acquisition/M.C.O. : - l'évolution des moyens de commandement et de contrôle pour la prise en compte des systèmes d'interception exoatmosphérique ▪ développement/acquisition : ▪ M.C.O. - Total : 77 milliards de francs 1 hors taxes et hors coûts induits par une coopération européenne 2 maintien en condition opérationnelle 3 capacité d'interception de missiles de 1 000 à 1 500 kilomètres Ces constats ne doivent cependant pas conduire à renoncer à toute forme d'action : l'existence de risques, jointe à la nécessité pour la France de ne pas se laisser distancer sur le plan technologique, impose le maintien d'une veille technologique poussée. A cet égard, l'approche privilégiée par la Russie et examinée, parmi d'autres, par les Etats-Unis de l'interception en phase initiale de propulsion (Boost phase interception ou BPI) semble la plus prometteuse. De même, la gestion d'une menace balistique par drones équipés de missiles antimissiles a beaucoup de sens. Israël étudie très activement cette solution. Notamment la société RAFAEL étudie un nouveau système d'armes destiné à intercepter, durant la phase propulsée de leur trajectoire, des missiles sol-sol de type SCUD ou dérivés (AL HUSSEIN, AL ABBAS, ...). Ce système d'armes, dénommé MOAB (Missile ptimised Anti-Ballistic) est basé sur l'association d'un drone de type HALE et d'un missile PYTHON IV modifié. Le drone serait équipé d'un senseur infrarouge (IRST) capable de détecter et de poursuivre un missile sol-sol en phase propulsée, d'un télémètre laser, d'une liaison de données et emporterait de 2 à 4 missiles air-air PYTHON IV modifiés. Ce drone HA 10 assurerait une veille sur zone pendant 24 heures dans une plage d'altitude située entre 20 000 et 50 000 pieds. En ce qui concerne le missile PYTHON IV, les modifications porteraient sur l'adjonction d'un accélérateur qui conférerait au missile une portée plus grande de 80 km à 30 000 pieds et 100 km à 50 000 pieds ; l'absence de système de refroidissement de l'autodirecteur infrarouge compte tenu des conditions d'emploi spécifiques ; l'introduction de nouveaux algorithmes de pilotage pour prendre en compte la configuration particulière de l'interception et une charge militaire plus puissante. Une coopération semble exister entre les Etats-Unis et Israël sur ce sujet. La date prévisionnelle d'entrée en service est annoncée à partir de 2005. La prolifération des armes de destruction massive est un fait dont il faut admettre l'existence, aussi dérangeant et angoissant soit-il. A l'origine de ce fait simple se trouve un processus complexe qui conduit un Etat à estimer que sa sécurité justifie l'acquisition d'armes dont la détention suscite pourtant l'opprobre, voire des sanctions internationales. Tous les jugements moraux que l'on est tenté de porter sur la prolifération ne sauraient donc gommer cette donnée essentielle qui préside au fait proliférant : l'existence de motivations complexes liées à la perception qu'a un Etat de sa propre sécurité aggravées par le chaos post-guerre froide. Ce constat ne justifie en rien les entreprises proliférantes que nous avons identifiées ici ou là, quelle qu'elles soient. Mais il est essentiel à la compréhension du phénomène, elle-même nécessaire à la mise en _uvre de politiques de lutte contre la prolifération efficaces. Il serait en effet pour le moins naïf, et même dangereux, de croire que la prolifération résulte d'un processus simple, largement lié à l'irresponsabilité d'un régime non démocratique, et que par conséquent, la déprolifération serait un mécanisme tout aussi simple, qui consisterait à modifier les paramètres qui ont conduit à l'acquisition d'armes de destruction massive. A ce problème complexe par nature qu'est la prolifération ont donc été apportées des réponses elles-mêmes complexes, fondées sur un postulat commun à la majeure partie de la société internationale, à savoir le danger que la dissémination des armes de destruction massive fait peser sur celle-ci. Les politiques de non-prolifération ont ainsi visé à apporter des réponses techniques, comme par exemple, la limitation des transferts de biens et technologies sensibles, et politiques, telles que le développement de coopérations internationales, à un phénomène lui-même technico-politique. L'objectif étant de retarder la prolifération. Aujourd'hui cependant, ces politiques paraissent essoufflées car manque à la base le volontarisme qui en garantit le succès. Le rôle des Etats-Unis dans cette évolution a été largement évoqué, mais c'est aussi dans la difficulté de la communauté internationale à imaginer des réponses nouvelles aux proliférations avérées qu'il faut chercher la cause de ces blocages. Il ne saurait pourtant être question de s'accommoder de cette situation, alors que la présence d'armes de destruction massive dans des zones de tension larvée, voire de conflits ouverts, demeure. C'est pourquoi la mission d'information appelle à une stratégie d'action fondée sur trois lignes de forces. En premier lieu, le bien-fondé et l'efficacité des politiques de non-prolifération doivent être réaffirmés et c'est à l'Union européenne dans son ensemble qu'il revient de le faire, alors qu'aujourd'hui, les Etats-Unis ne souhaitent plus être la locomotive dans ce domaine. L'Union européenne doit donc se résoudre à se donner les moyens de ses ambitions, même dans un secteur qui suscite d'avantage de débat que de consensus entre les Etats membres. L'enjeu impose en effet de dépasser non-dits et tabous, fussent-ils anciens. En deuxième lieu, la réaffirmation du rôle de la non-prolifération ne saurait être exclusive d'une réflexion globale sur la validité des solutions militaires qui peuvent être apportées à la prolifération dès lors que les stratégies de prévention ont échoué. Mais ce débat n'a de sens que dans un cadre contractuel et multilatéral, l'unilatéralisme n'étant en la matière rien d'autre qu'un pis-aller de court terme, contre-productif à long terme. Plus radicalement, le débat, transatlantique notamment, doit porter sur le rôle respectif que les grandes puissances veulent accorder à la protection et à la prévention contre la prolifération, ce qui rejoint une réflexion plus globale sur le rôle de l'arme nucléaire dans le monde de l'après-guerre froide. Cette question, déterminante pour l'avenir de l'équilibre stratégique international, mérite mieux que les oukases d'une grande puissance et les atermoiements des autres. S'agissant plus spécifiquement de l'action de la France, qui doit jouer en la matière un rôle moteur en Europe, elle doit s'orienter également vers une réaffirmation, mais également un rééquilibrage, des moyens militaires existants pour lutter contre la prolifération, à savoir le renseignement, la dissuasion et les défenses, actives et passives. Là encore, c'est à une action déterminée que la mission appelle de ses v_ux, dès lors que les freins ne sont pas techniques, mais financiers. Alors que notre pays définit ses priorités opérationnelles pour l'avenir, il ne peut se contenter de reconduire l'existant et de gérer à court terme, à l'abri de certitudes théologiques, des problèmes qui réclament une vision d'avenir. Sans alarmisme, ni idéalisme, c'est à cette projection dans le monde stratégique du XXIème siècle qu'il faut aujourd'hui appeler. Lors de sa réunion du 6 décembre 2000, la Commission a procédé à l'examen du rapport de la mission d'information sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (MM. Guy-Michel Chauveau, Pierre Lellouche et Aloyse Warhouver, rapporteurs). Le Président Paul Quilès a rappelé que la mission d'information sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, composée de MM. Guy-Michel Chauveau, Pierre Lellouche et Aloyse Warhouver, avait été créée en janvier 2000. Il a indiqué qu'elle avait procédé à une étude approfondie de l'ensemble des questions liées à la prolifération et rappelé que MM. Guy-Michel Chauveau et Pierre Lellouche avaient déjà fait, le 14 juin dernier, une communication à la Commission sur les projets américains de défense antibalistique du territoire. M. Pierre Lellouche, rapporteur, a tout d'abord exprimé ses plus vifs remerciements au Président Paul Quilès pour avoir accepté le principe de la mission d'information et lui avoir donné la liberté intellectuelle et politique, ainsi que les moyens de mener à bien son travail. Il a insisté sur le fait que c'était la première fois qu'un Parlement, à l'exception du Congrès américain, se donnait les moyens d'effectuer une telle étude. Il a salué enfin le caractère bipartisan d'un rapport sur des questions qui touchent aux intérêts suprêmes de la Nation. C'est à un travail ambitieux que la mission d'information s'est attelée, puisqu'elle a choisi de faire porter son analyse sur l'intégralité du spectre des armes de destruction massive : nucléaires, chimiques, biologiques ou bactériologiques ainsi que sur les missiles balistiques. Elle a examiné cette question à l'échelle internationale, faisant plus nettement apparaître les problèmes que posent, au regard de la prolifération, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud et le Proche-Orient. La mission a également procédé à de nombreuses auditions auprès des responsables institutionnels et des experts français et internationaux. A cet égard, M. Pierre Lellouche a une nouvelle fois exprimé ses regrets devant le refus du directeur de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) de recevoir la mission pour l'entretenir d'un sujet qui relève pourtant du c_ur de ses compétences, dans la mesure où la prolifération est un phénomène de plus en plus clandestin à l'égard duquel les services de renseignement doivent remplir une fonction de « tour de contrôle ». Le rapport de la mission d'information sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ne prétend pas s'ériger en « Bible du monde multipolaire » mais vise à poser les bonnes questions sur les conséquences de la prolifération pour la politique de défense de la France à l'horizon 2020-2030. Il considère également ce sujet comme un problème-clé pour l'avenir de la sécurité de l'Europe. L'espoir des membres de la mission est donc, qu'à tout le moins, avec ce rapport, s'ouvre un débat sur ce sujet en France et en Europe. M. Pierre Lellouche a exposé que le rapport de la mission se présentait en trois parties : la première livre une photographie détaillée des quatre types de prolifération et de leurs enjeux géopolitiques ; la deuxième procède à l'analyse politique et juridique des régimes de non-prolifération et montre que les éléments de lutte contre la prolifération nucléaire sont en place, qu'on assiste, dans le domaine chimique, au début de la mise en _uvre du contrôle, que la vérification est inexistante en matière biologique et qu'elle n'existe encore qu'en pointillé pour ce qui concerne les missiles. La dernière partie du rapport examine l'avenir des politiques de non-prolifération, soulignant notamment le lien central entre instruments diplomatiques et militaires. S'agissant de l'état actuel de la prolifération, M. Pierre Lellouche a indiqué qu'il contrastait singulièrement avec les grands espoirs suscités, au début de la décennie, par la fin de la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique. De fait, cet optimisme n'était pas sans fondement. Ce sont d'abord trois traités majeurs de désarmement qui ont été conclus dans un laps de temps très restreint à la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante : traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) en Europe de 1987, qui a permis l'élimination d'une catégorie entière d'armes nucléaires en soustrayant aux arsenaux soviétique et américain l'ensemble des missiles de croisière et balistiques de courte et moyenne portée (500 à 5 000 kilomètres) et traités START I et II entre les Etats-Unis et la Russie en 1991 et 1993. Parallèlement à ces progrès inégalés jusqu'alors en matière de maîtrise des armements, la lutte contre la prolifération a enregistré un certain nombre de succès au début des années 1990. Dans le domaine nucléaire tout d'abord, la liste des pays candidats au nucléaire s'est raccourcie avec la décision de l'Afrique du Sud en 1991, de l'Argentine et du Brésil en 1994 et 1995, d'abandonner et de démanteler leur programme. A ces « repentis » du nucléaire sont venus s'ajouter la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan qui ont décidé de renoncer à l'héritage nucléaire soviétique. De même, les outils juridiques de la non-prolifération nucléaire se sont renforcés et étoffés au cours de cette période. Le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) a vu son universalité et sa légitimité renforcées par l'adhésion de deux puissances nucléaires, la France et la Chine, en 1992, ainsi que par sa prorogation illimitée en 1995. Par ailleurs, la mise au jour du programme irakien a eu au moins pour vertu de conduire à un renforcement des pouvoirs de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA). Il faut ajouter à cette liste la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) en 1996 et le lancement de la négociation du traité d'interdiction des matières fissiles à la suite de la conférence de renouvellement du TNP de 1995. Les autres champs de la lutte contre la prolifération ont également connu des avancées remarquables, avec la conclusion, en 1993, de la convention d'interdiction des armes chimiques et le lancement de la négociation d'un protocole de vérification de la convention sur les armes biologiques de 1972. Ainsi, au milieu de la décennie 1990, il n'était pas illégitime de penser que la multipolarité stratégique était sous contrôle et que la convergence stratégique entre les Etats-Unis, la Russie et l'Europe conduirait à l'instauration d'un nouvel ordre international permettant de limiter les risques de cette multipolarité. M. Pierre Lellouche a estimé qu'en cette année 2000, le panorama global de la situation internationale en matière de prolifération était tout autre et ne pouvait que susciter l'inquiétude. Il a mentionné à cet égard l'évolution de la situation dans le sous-continent indien, qui a littéralement fait exploser les régimes de non-prolifération. Il a notamment jugé extrêmement inquiétant l'affrontement de l'Inde et du Pakistan à Kargil, dans l'Himalaya, en 1999, c'est-à-dire après leur nucléarisation officielle. De même, l'évolution de la Corée du Nord et de la Chine, qui s'installent comme des proliférateurs stratégiques, contribue également à assombrir le paysage en matière de désarmement et de non-prolifération. L'éventuelle installation à Taïwan d'un système antimissile pourrait en outre enclencher un processus conduisant à la nucléarisation du Japon. Enfin, le Moyen-Orient, pour lequel le processus d'Oslo laissait espérer une stabilisation durable, est aujourd'hui soumis aux risques d'un enlisement du processus de paix et d'une guerre d'attrition dans laquelle le terrorisme, y compris à l'aide d'armes de destruction massive, pourrait jouer un rôle majeur. Le deuxième risque qui pèse aujourd'hui sur la sécurité du Moyen-Orient réside dans la réapparition de menaces de la part de pays qui pourraient être à l'origine de crises : l'Irak n'est plus soumis au contrôle de l'ONU, tandis que l'Iran poursuit des programmes d'armes de destruction massive avec l'aide de la Russie. Enfin, le fait nucléaire israélien représente le troisième risque dans cette région. Abordant ensuite le bilan des régimes de non-prolifération, M. Pierre Lellouche a fait observer qu'on assistait à un dérèglement, un affaiblissement voire une érosion des instruments mis en place par la communauté internationale. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer cette évolution, le premier d'entre eux étant l'attitude des Etats-Unis. Le rejet du traité d'interdiction complète des essais (TICE) par le Sénat américain, qui en fait un nouveau traité de Versailles, représente un coup d'arrêt violent pour le processus de maîtrise des armements. En outre, le projet des Etats-Unis de doter leur territoire national d'un système de défense contre les missiles balistiques (NMD), soutenu par les deux candidats à l'élection présidentielle, pose le problème de l'équilibre entre dissuasion et défense et fait peser une hypothèque sérieuse sur l'avenir du traité ABM. L'effet domino d'un éventuel déploiement du système NMD aux Etats-Unis est un risque qui doit être pris très au sérieux. Les conséquences en seraient en effet très lourdes sur la Russie, la Chine et les pays qui en sont proches, l'Inde et le Pakistan. En regard, l'Europe, parfaitement inexistante dans ce domaine, s'est bornée jusqu'à présent à des prises de position déclaratoires. Loin de se poser en garante du système des traités de non-prolifération, elle souffre même d'une absence complète de réflexion autonome sur ce sujet. M. Pierre Lellouche a estimé qu'il y avait là un paradoxe regrettable, les Etats-Unis ouvrant le débat sur un danger auquel l'Europe, du fait de sa géopolitique, est le plus exposée puisqu'elle se trouve à proximité des zones à risques. A cet égard, M. Pierre Lellouche a souligné l'inquiétante adéquation de la carte des proliférations et de la carte des conflits. C'est donc une spirale extrêmement dangereuse qui se développe sous nos yeux, avec d'un côté, le développement d'arsenaux dans des régions instables, et de l'autre, une volonté de désengagement de l'Etat qui s'est toujours posé en garant des divers régimes de non-prolifération, tant en raison de son influence que de sa taille, sans que l'Europe joue un rôle de substitut ou commence même à s'intéresser au sujet. M. Pierre Lellouche a d'ailleurs fait observer que cette volonté de désengagement des Etats-Unis était nourrie par plusieurs facteurs internes à ce pays. Notamment, la révolution dans les affaires militaires en cours dans les forces américaines (Revolution in Military Affairs ou RMA) favorise la marginalisation croissante de l'arme nucléaire dans la pensée stratégique des Etats-Unis, d'autant que la fascination pour la technologie conventionnelle qu'elle reflète a été nourrie par les faits eux-mêmes, avec la guerre du Kosovo. Ce conflit a en effet conforté les Etats-Unis dans l'idée que leur puissance reposait aujourd'hui, non sur des armes de destruction massive, mais sur leurs capacités technologiques, c'est-à-dire sur leur indéniable supériorité conventionnelle. Dans une certaine mesure par conséquent, aux yeux des Etats-Unis, la réalité stratégique mondiale est déjà celle d'un monde post-nucléaire. M. Pierre Lellouche s'est ensuite interrogé sur la position de la France dans un tel contexte : quelles sont les conséquences, pour notre pays, de cette évolution marquée à la fois par le développement de la prolifération des armes de destruction massive dans des régions du monde particulièrement instables et par la tentation des Etats-Unis de se désengager des moyens traditionnels de lutte contre ce phénomène ? Le rapport souligne qu'il faut cesser de concevoir la politique de lutte contre la prolifération comme un binôme dont les deux termes, défense et diplomatie, seraient incompatibles. Une véritable politique de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs doit articuler, de manière équilibrée, les volets militaire et diplomatique. Dans le domaine diplomatique, la priorité doit aller aujourd'hui à un renforcement, et non à la mise au rebut, du système international en place. Pour ce faire, trois conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut amener les Etats-Unis à renoncer à leur démarche unilatérale au profit d'une approche contractuelle et multilatérale. En deuxième lieu, l'Europe doit intégrer dans ses raisonnements stratégiques la probable existence, dans les années à venir, de programmes de défense anti-balistique nationale (NMD) et de théâtre (TMD) et l'inévitable irruption de la défense dans le paysage stratégique mondial. Enfin, l'intégration de la Russie dans ce processus multilatéral représente la dernière condition d'une politique efficace de non-prolifération. Le rapport présente sept axes qui pourraient former le c_ur de l'action diplomatique de la France dans ce domaine : - il faut éviter de créer un précédent irakien. La politique de lutte contre la prolifération menée par la communauté internationale serait décrédibilisée en cas de démantèlement du contrôle sur ce pays. Renoncer à un droit de regard sur les programmes et les arsenaux militaires irakiens reviendrait à envoyer un signal positif aux candidats à la prolifération. L'Irak ne doit pas être pour l'ONU ce que l'Éthiopie fut pour la Société des Nations ; - la Russie doit interrompre ses activités clandestines dans le domaine de la guerre biologique. Elle doit, pour ce faire, procéder à un véritable démantèlement de Biopreparat, institut civil qui a couvert pendant vingt ans le programme pharaonique mené par l'URSS dans le biologique militaire et poursuit aujourd'hui son activité, avec à sa tête les mêmes responsables que durant la période soviétique. M. Pierre Lellouche a ainsi rappelé qu'en 1972, c'est-à-dire l'année même de la signature par l'URSS de la convention d'interdiction des armes biologiques, ce pays lançait dans le plus grand secret un programme d'armes biologiques visant au développement de souches très variées et à leur adaptation à des têtes de missiles. En 1992, la Russie a reconnu l'existence de ce programme auquel elle a officiellement mis fin. Le rapporteur a toutefois indiqué que la mission avait les plus grands doutes sur la reconversion effective des installations de guerre biologique et qu'elle s'était vu refuser l'accès à un des centres de recherche russes soupçonné de poursuivre ces activités, lors de son déplacement en Russie. Il a jugé que l'Europe ne pouvait pas faire comme si cette réalité n'existait pas, notamment au regard des risques considérables de terrorisme qui sont liés à l'existence d'armes biologiques. Il a exprimé sa conviction que les armes biologiques seraient, pour les terroristes, les armes nucléaires du XXIème siècle. Une position très ferme de la France est donc nécessaire en ce domaine ; - il ne faut pas laisser la Chine s'installer dans un rôle de proliférateur stratégique, que ce soit dans les domaines balistique ou nucléaire, comme ce fut le cas avec le Pakistan. Ce rôle est incompatible avec la politique de la Chine à notre égard. A cette fin, l'aide militaire à Taïwan pourrait être modulée en fonction de l'évolution de la politique chinoise en matière d'exportations nucléaires ou balistiques à destination de pays affichant une politique ostensiblement hostile au monde occidental ; - l'Inde et le Pakistan posent un problème extrêmement grave à la communauté internationale. L'existence d'arsenaux nucléaires dans les deux pays et les conditions de déclenchement de la guerre à Kargil en 1999 montrent l'extrême fragilité de la relation de « dissuasion » qu'ils entretiennent. M. Pierre Lellouche a jugé que l'Inde et le Pakistan représentaient le théâtre de guerre le plus probable dans les années à venir, notamment du fait de l'antagonisme religieux, ethnique et frontalier qui les oppose ainsi que du contrôle politique très lâche, notamment au Pakistan, sur l'arsenal nucléaire. Ces pays doivent donc être intégrés dans les régimes de non-prolifération par un réseau très dense d'accords avec les puissances nucléaires. Techniquement, il s'agirait de leur proposer la conclusion d'accords stratégiques conditionnés à un triple engagement de leur part d'adopter des mesures de confiance mutuelle, de cesser leur production de matières fissiles et d'adhérer au TNP, avec un statut spécial adapté à leur situation ; - il faut continuer d'exercer une pression ferme sur la Corée du Nord. On ne peut que regretter, à cet égard, l'empressement excessif de certains pays européens à reconnaître ce pays, alors qu'il n'a entrepris aucune action concrète en faveur de la non-prolifération et s'est contenté de déclarations floues à ce sujet ; - la France doit promouvoir la négociation et la conclusion d'un traité sur la notification des essais de missiles et la transparence balistique. Il s'agirait d'une mesure de confiance extrêmement utile au niveau international ; - enfin, elle doit proposer l'universalisation du traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 1987. M. Pierre Lellouche a jugé qu'aucune politique sérieuse de lutte contre la prolifération ne saurait cependant se limiter à une action exclusivement diplomatique. Dans la mesure où la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs fait peser un risque pour notre sécurité, nous devons développer les moyens militaires destinés à nous en protéger. Les risques émanant des trois régions précédemment citées concernent l'Europe au premier chef. Il faut également prendre en considération, au-delà de ces risques régionaux, la menace transversale et diffuse que représente le terrorisme, biologique et chimique notamment : l'attaque du métro de Tokyo au gaz sarin par la secte Aum en 1995 ne doit pas être considérée comme un acte isolé, d'autant qu'à neuf reprises auparavant, cette secte avait tenté d'utiliser des armes biologiques à des fins terroristes. La question de l'impact militaire de ces menaces a été jusqu'à présent très peu abordée en Europe, si ce n'est par l'OTAN et de manière encore très partielle. De même, en France, la réflexion sur la dimension militaire des conséquences de la prolifération reste confinée à des cercles étroits, voire est purement et simplement écartée. Mais à l'heure où l'Europe de la défense trouve un nouvel élan, alors que la prochaine loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2008 est en préparation, le dogmatisme n'est plus de mise, et poser la question des conséquences militaires de la prolifération pour la France et l'Europe est une nécessité. Car les interrogations soulevées sont multiples : quel est l'impact de l'accélération de la dissémination des armes de destruction massive sur la doctrine de défense française ? Sur ses moyens ? La dissuasion offre-t-elle les meilleures garanties pour y répondre ? Quelles en sont les conséquences sur les outils de notre défense à l'horizon 2020-2030 ? Le traitement institutionnel du phénomène est-il satisfaisant en termes de recueil, de traitement et de diffusion de l'information ? La mission d'information dénonce avec force le curieux paradoxe que présente cette Europe qui se désintéresse de la prolifération, alors même que sa situation géographique la rend beaucoup plus vulnérable aux armes de destruction massive et aux missiles balistiques que les Etats-Unis, qui en font pourtant l'une des données-clés de leur politique de défense. Elle recommande, pour lever ce paradoxe, la mise en _uvre de sept axes d'action, qui pourraient utilement être développés dans un Livre blanc européen de la défense : - l'Union Européenne doit dresser un tableau des menaces directes pesant sur le territoire des Etats européens. A ce jour, cette analyse manque, alors qu'elle représente la condition préalable à la définition d'un format de forces ; - le même bilan doit être établi s'agissant des menaces susceptibles de peser sur des forces militaires européennes déployées sur des théâtres extérieurs. Rappelons que, dès 2003, le scénario de déploiement de forces européennes deviendra réalité ; - l'Europe doit voir au-delà des risques directs qui pèsent sur elle. L'évolution stratégique de l'Asie ou du Moyen-Orient la concerne. Il lui faut par conséquent s'interroger sur les conséquences pour sa sécurité d'une accélération de la course aux armements dans les régions les plus instables du globe ; - l'Union européenne doit s'interroger sur les conséquences pour sa situation stratégique d'une éventuelle remise en cause du traité ABM de 1972 qui réglemente le développement des systèmes de défense antimissile aux Etats-Unis et en Russie ; - aux portes de l'Union Européenne, la Russie stocke des centaines d'armes nucléaires, des milliers de tonnes d'armes chimiques et des souches bactériologiques en tout genre, dans des conditions de sécurité telles que ce pays demande lui même l'aide de la communauté internationale. Or, il n'existe à ce jour aucune évaluation proprement européenne des risques d'accident ou d'emploi non autorisé de ces armes ; - en outre, la menace spécifique d'actes terroristes commis à l'aide d'armes de destruction massive doit être précisément mesurée. Les pays européens sont de longue date familiers des problèmes de terrorisme. Ils doivent donc s'interroger sur les conséquences pour leur sécurité de l'utilisation éventuelle d'armes de destruction massive à des fins terroristes ; - enfin, il est plus que temps de lever le tabou nucléaire qui pèse sur le débat européen, au moment où un autre tabou vient d'être levé avec la constitution d'une force d'intervention européenne. Les Européens ne peuvent plus, aujourd'hui, se contenter d'afficher une position commune sur la non-prolifération nucléaire, sans poser sur la place publique la question du rôle de l'arme nucléaire dans la sécurité européenne au XXIème siècle. Le rapport s'interroge enfin sur les conséquences de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles pour l'appareil de défense français. Jusqu'alors, ce débat a été soigneusement occulté. Notre pays n'est pourtant pas resté inactif, au cours de la décennie qui vient de s'écouler, dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération, bien au contraire. Par une ironie dont l'histoire a le secret, la période récente a même vu notre pays passer du statut de proliférateur militant - qui, en particulier jusqu'en 1976, lui a fait refuser d'intégrer les régimes internationaux et l'a conduit à exporter dans un certain nombre de pays ses technologies et son savoir-faire nucléaires - à celui de champion hors catégorie du désarmement unilatéral. A cet égard, M. Pierre Lellouche a jugé que, contrairement à son collègue Guy-Michel Chauveau, également rapporteur, la France était allée trop loin dans ce désarmement unilatéral et qu'elle aurait pu, à tout le moins, le lier à des contreparties diplomatiques. Il s'est demandé dans quelle mesure ces décisions ne seraient pas source de difficultés si la prolifération devait s'aggraver. La mission d'information est en revanche unanime pour considérer que les conséquences militaires de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles doivent être prises en compte dans notre outil de défense, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut cesser d'examiner ces questions au travers du prisme de la dissuasion pure. L'attachement dogmatique de la France à cette conception de la dissuasion n'est plus de mise : sur quelles bases peut-on décréter que la dissuasion à la française est valide dans le monde multipolaire d'aujourd'hui et suffit à traiter le spectre des risques et des menaces pesant sur notre pays ? Le théorème selon lequel toute velléité de défense signifie ipso facto la mise en échec de la dissuasion, y compris dans une configuration du « fort au fou », est une absurdité, un dogme qui interdit toute réflexion. Il faut a minima ouvrir le débat sur la complémentarité entre l'assurance-vie que doit rester la dissuasion nucléaire et les moyens de défense active et passive destinés à traiter les risques et menaces qu'elle ne saurait suffire à elle seule à écarter. La mission estime que, pour répondre de manière adaptée aux menaces résultant de la prolifération, la France doit développer ses capacités militaires dans quatre domaines : - en matière de renseignement, l'acquisition de données brutes sur l'ensemble des proliférations doit être renforcée, notamment grâce au renseignement humain. S'agissant plus spécifiquement de la prolifération balistique, la mission estime nécessaire l'acquisition d'une capacité européenne de détection de tirs de missiles dont le coût peut être estimé à 10 milliards de francs environ. Sans compter que cette capacité pourrait jeter les bases d'une coopération avec les Etats-Unis et la Russie ; - dans le domaine de la dissuasion, les membres de la mission ont des avis divergents. Aux yeux de M. Guy-Michel Chauveau, l'effort actuel de notre pays en faveur de la dissuasion doit être maintenu car il suffit à préserver sa crédibilité. En revanche, M. Pierre Lellouche a estimé nécessaire d'élargir la gamme des options arrêtées ; - en matière de défense passive, la mission ne peut que constater l'insuffisante sensibilisation de l'opinion et des responsables politiques. C'est donc à un travail pédagogique qu'elle appelle d'abord. Au-delà, la mise en _uvre d'un système efficace de défense en profondeur contre la prolifération et ses conséquences doit être sérieusement envisagée. Elle passe par un accroissement de l'effort budgétaire en ce domaine qui amplifie les progrès modestes faits en 2000 et 2001, après une réduction des dotations au niveau de 4 millions de francs en 1999. Cet effort doit notamment permettre de développer les compétences de base dans la détection des virus bactériologiques ; - s'agissant enfin de la défense contre les missiles, la France doit poursuivre le développement d'une défense antimissile de théâtre, dont le programme Aster représente une base. Il est nécessaire d'acquérir un système de défense contre les missiles tactiques de 600 km de portée dans un premier temps et de 1 500 km à terme. La réalisation de cette capacité représenterait un effort budgétaire de l'ordre de 18 milliards de francs. En outre, afin de préserver les conditions de son autonomie de décision stratégique et industrielle, la France se doit de maintenir une veille technologique poussée sur l'interception précoce de missiles balistiques à longue portée. Quant à la défense totale du territoire européen, elle ne constitue qu'une vue de l'esprit. Remerciant à son tour le Président Quilès d'avoir donné à la mission d'information les moyens d'accomplir un travail nouveau dans une instance parlementaire, M. Guy-Michel Chauveau, rapporteur, a souhaité centrer sa présentation du rapport sur les enjeux européens de la prolifération. Il a souligné que la mission s'était efforcée d'échapper à deux écueils. Le premier aurait été de sombrer dans le catastrophisme, tentation qui a toujours existé chez les spécialistes de la prolifération. Il a rappelé à cet égard qu'en 1974, les experts américains prédisaient d'ici à 25 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, l'existence de 20 à 30 puissances nucléaires. Le deuxième écueil aurait été de céder à l'angélisme, qui est parfois un réflexe chez des experts, généralement européens, désireux de se détacher des analyses américaines. Il a néanmoins admis que le débat était largement monopolisé par ce qu'il a appelé la prolifération des informations d'origine américaine. Or, ce que les Américains appellent, en matière balistique, l'évaluation de la menace, est avant tout une analyse politique qui correspond à leurs intérêts propres, légitimes sans doute et aux attentes de leur opinion publique. Ainsi, aux yeux des Etats-Unis, le fait que la Corée du Nord, l'Irak ou l'Iran possèdent des missiles balistiques représente une menace : la possession ou la maîtrise d'une technologie serait en soi signe d'intentions politiques hostiles. Ce à quoi les experts français ou européens font remarquer qu'il faut distinguer menace et risque : le fait que l'Europe soit à portée de missiles de certains pays du Moyen-Orient, voire d'Extrême-Orient ne signifie pas que pèse automatiquement sur elle une menace. Cette divergence d'appréciation est au c_ur du débat sur la NMD et représente un point fort de la position de la France. M. Guy-Michel Chauveau a néanmoins remarqué qu'il serait dangereux de céder à l'angélisme : il est indéniable que la prolifération balistique s'est accélérée depuis 1998 et que les services de renseignement occidentaux n'ont pas toujours bien pris la mesure de cette évolution qui a permis à la Corée du Nord, au Pakistan, à l'Iran de procéder à des essais de missiles d'une portée supérieure à 1 000 km. S'interrogeant sur les conséquences de la prolifération pour notre outil de défense et sur les solutions qui pouvaient être mises en _uvre au niveau européen pour y remédier, M. Guy-Michel Chauveau a fait observer que les réponses à ces questions en 2000 différaient de celles qui auraient pu être apportées en 1998, du fait de l'évolution du contexte international. Il a jugé que si le débat sur l'instauration d'une défense du territoire national contre les missiles balistiques aux Etats-Unis suscitait autant de controverses, c'est parce qu'il posait, dans un domaine particulier, la question fondamentale de la nature de la réponse qui doit être apportée à la prolifération. Jusqu'alors, la communauté internationale, longtemps sous l'impulsion des Etats-Unis, a choisi la réponse diplomatique : elle a mis en place depuis 25 ans des traités, des systèmes de contrôles coordonnés à l'exportation, des procédures de vérification pour prévenir la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. M. Guy-Michel Chauveau a noté que, dans le domaine nucléaire, ce système avait bien fonctionné. Aujourd'hui cependant, l'un des pays moteurs de cette construction diplomatique semble revenir sur le traitement négocié des problèmes de prolifération et plus largement sur les processus multilatéraux, au profit d'une approche centrée sur les réponses militaires. Il passe ainsi d'une politique de réglementation internationale de la non-prolifération à une politique de contre-prolifération. Dans cette perspective, M. Guy-Michel Chauveau a estimé que la France et plus largement l'Union européenne avaient plus que jamais un rôle propre à jouer face aux risques de la prolifération. Elles doivent rappeler la nécessité de préserver et de développer l'acquis de trente ans de non-prolifération. La non-prolifération n'est pas morte, comme le montre l'adoption récente d'un code de conduite internationale établissant des mesures de confiance et de transparence dans le domaine des lancements balistiques, au sein du MTCR, groupe de fournisseurs de technologies de missiles. Le rapport d'information présente par ailleurs un certain nombre d'initiatives politiques et diplomatiques que la France pourrait proposer en vue notamment de les intégrer dans une stratégie commune de l'Union européenne. M. Guy-Michel Chauveau a également insisté sur la nécessité d'établir un dialogue stratégique avec la Russie, qui le souhaite, comme l'ont montré les initiatives du Président Poutine en matière d'échange de données sur les tirs de missiles ou sur la défense tactique contre les missiles. Certes, la volonté de contrer les offensives américaines est évidente. Mais l'Union européenne participe d'ores et déjà à un grand nombre de programmes de sécurisation et de démantèlement des sites nucléaires ou chimiques en Russie, ainsi qu'à la reconversion des scientifiques russes. M. Guy-Michel Chauveau a indiqué à ce propos qu'en Russie 2 000 spécialistes du nucléaire et 10 000 experts dans les domaines chimique et biologique présentaient des risques en termes de prolifération. Il a également signalé que le programme AIDA MOX de reconversion du plutonium russe constituait un élément important de la coopération russo-européenne. M. Guy-Michel Chauveau a ajouté que ce dialogue entre la Russie et l'Union européenne pourrait conduire à insérer dans un processus global une Chine qui apparaît préoccupée par une éventuelle coopération russo-européenne dans le domaine de la réduction des risques liés aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs. Le rapporteur a fait observer que l'Union européenne n'apparaissait pas pour autant comme un acteur important de la non-prolifération et n'avait jusqu'alors développé qu'une politique essentiellement déclaratoire. La manière dont elle a traité les essais indien et pakistanais est révélatrice de cet état de fait : elle a exprimé sa préoccupation six mois après les faits, certains des 15 s'interrogeant même sur l'opportunité pour l'Union de faire entendre sa voix sur ce sujet. S'interrogeant sur les raisons de cette frilosité, M. Guy-Michel Chauveau a jugé qu'elle tenait à l'absence d'une réflexion globale de l'Union européenne sur la prolifération et sur les stratégies pour la prévenir et la contrer. Quelques actions communes ne font pas une stratégie globale : si les prises de position de l'Union européenne sur la non-prolifération sont peu audibles, c'est qu'elle n'a pas répondu à la question de savoir quelle doit être en ce domaine la part respective de la diplomatie et de la défense. M. Guy-Michel Chauveau a estimé qu'il manquait d'abord une évaluation européenne de l'état de la prolifération, soulignant qu'il était tout à fait paradoxal de constituer des forces européennes sans avoir envisagé au préalable l'ensemble des scénarios de risques et de menaces auxquels elles pourraient être confrontées : quelle est la conséquence pour l'Union européenne du développement de capacités balistiques au Moyen-Orient ? Quelles seraient les implications d'une éventuelle remise en cause du traité ABM ? Que faire quand la prévention a échoué ? L'Union européenne doit-elle réfléchir au développement de moyens militaires de lutte contre la prolifération ? Autant de questions que le Parlement français doit se poser, à l'instar des Parlements britannique ou allemand qui ont récemment travaillé sur certains aspects de ces questions. En outre, à l'OTAN, des systèmes d'armes sont en cours d'étude de faisabilité sans qu'aucun débat de nature politique n'ait eu lieu à ce jour sur leurs hypothèses d'emploi : police d'assurance, dit-on à l'OTAN, quand la question est avant tout politique. Si ces débats manquent aujourd'hui au sein de l'Union, c'est que pèsent sur elle un certain nombre de tabous, de non-dits, au premier chef le tabou nucléaire. Que veulent faire les Européens des armes nucléaires présentes sur leur sol ? Quel rôle veulent-ils voir jouer à l'arme nucléaire au siècle prochain ? Comment les forces européennes qui seront envoyées à l'extérieur seront-elles protégées ? Autant de questions qui n'ont à ce jour pas reçu de réponses : elles sont difficiles certes, et, pour beaucoup d'entre elles, ne sont même pas posées en France. Au-delà d'une démarche volontariste et coordonnée dans les enceintes diplomatiques, l'action de l'Europe sur ces questions pourrait se développer dans trois directions: - la première étape d'une stratégie européenne de lutte contre la prolifération doit passer par l'élaboration d'un Livre blanc européen sur la défense qui présenterait notamment une analyse de la menace et des risques liés aux armes de destruction massive ; - un deuxième axe d'action résiderait dans le lancement d'une étude de faisabilité d'une capacité européenne de détection de tirs de missiles, qui pourrait être acquise par le lancement d'un satellite géostationnaire à détection infrarouge. Outre son intérêt en termes de renseignement, cette capacité permettrait de jeter les bases d'une coopération avec les Etats-Unis et avec la Russie, qui l'a d'ores et déjà proposée alors même qu'aucun programme n'existe à ce jour en Europe. Cette coopération serait en outre politiquement relativement aisée à mettre en _uvre du fait de ses implications duales, civiles (environnement) et militaires ; - le troisième axe d'action passe par la coordination des programmes de défense antibalistique de théâtre (TMD), alors que se constitue une force européenne unique. A l'heure actuelle, la France, avec l'Italie, développe un système à partir d'Aster ; l'Allemagne et l'Italie travaillent avec les Etats-Unis sur le programme MEADS et l'OTAN étudie les divers projets de TMD d'origine américaine. Cette cacophonie est liée au fait que les Européens se refusent à poser le problème du rôle des moyens de défense militaire dans la lutte contre la prolifération, qu'il s'agisse de défense active ou passive, alors même qu'ils construisent une force destinée à intervenir sur des théâtres d'opérations extérieurs. En conclusion, M. Guy-Michel Chauveau a rappelé qu'il y a de cela quelques années, en référence aux propositions françaises sur la dissuasion concertée, Javier Solana, alors Secrétaire général de l'OTAN, avait observé qu'« on ne construit pas une maison en commençant par le toit ». Cette réflexion n'a pas perdu de sa pertinence : l'Europe qui se construit a besoin d'un socle solide. Quels risques, quelles menaces cette Europe devra-t-elle affronter dans les 20 ans à venir ? Quelle stratégie devra-t-elle mettre en _uvre ? La géographie et l'histoire interdisent à l'Europe de faire l'impasse sur la prolifération, risque que l'OTAN ou la France ont identifié dès 1994 comme « multiforme, tous azimuts et aussi difficile à prévoir qu'à estimer ». La France doit, en ce domaine, donner l'impulsion, mais c'est une réponse européenne qui doit être apportée. Le Président Paul Quilès a félicité les auteurs du rapport d'information, le premier de ce genre au Parlement. Après avoir souligné le caractère dense et argumenté de l'analyse, il a insisté sur la nécessité d'affiner certaines propositions et de ne pas s'en tenir à des v_ux pieux pour ce qui concerne, par exemple, les activités clandestines de certains pays comme la Russie. Pour ce qui est de la France, il a estimé qu'un débat devait s'instaurer sur la question de la prolifération, même si le sujet, complexe, ne passionne pas l'opinion ni le monde politique. Il a alors jugé que la Commission pourrait être le creuset de ce débat que les rapporteurs ont eu le mérite de clarifier avec sérieux et rigueur en l'alimentant avec des propositions intéressantes. M. Pierre Lellouche a fait remarquer que les propositions de la mission concernant notamment la Russie avaient été inspirées par un souci de réalisme : alors que la communauté internationale a, jusqu'à présent, préféré se taire sur les programmes d'armement biologique de la Russie, l'expérience montre que le simple fait de discuter avec les autorités russes et d'exercer sur elles une pression politique peut faire évoluer la situation, un certain nombre d'expérimentations et de travaux ayant finalement été reconnus, même si la transparence n'a pas été parfaite et si l'accès aux installations les plus intéressantes a été refusé aux rapporteurs. M. Bernard Grasset a remercié le Président Paul Quilès pour avoir à nouveau permis la réalisation d'un rapport où la majorité et l'opposition s'entendent sur des questions essentielles pour la défense nationale. Il a par ailleurs regretté que le directeur de la DGSE n'ait pas voulu recevoir les rapporteurs jugeant cette attitude dépourvue d'élégance. Il a alors suggéré que la Commission demande à l'exécutif de veiller à ce que les parlementaires soient, à l'avenir, traités avec davantage de considération par cette administration. Après s'être félicité qu'un membre du groupe RPR reconnaisse que le dogme de la dissuasion pure n'avait plus de raison d'être, il a jugé que la guerre contre la prolifération avait été perdue lors de la chute du mur de Berlin. Estimant néanmoins qu'une action efficace restait possible en matière de lutte contre les processus de prolifération et leurs effets, si elle était menée dans un cadre européen, il a souligné l'urgence d'initiatives en ce sens sous peine de voir les Etats-Unis conserver ou acquérir seuls toutes les compétences technologiques et militaires ainsi que la maîtrise des évolutions diplomatiques face aux risques liés à la dissémination des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. M. Bernard Grasset a ensuite insisté sur les risques d'actes terroristes commis avec des armes biologiques, rappelant qu'une dispersion d'anthrax dans l'atmosphère à Sverdlovsk, dans l'Oural, avait fait plusieurs centaines de morts en 1979. Considérant qu'une attaque terroriste ayant recours à des armes chimiques ou biologiques était désormais plus probable qu'une guerre nucléaire, il a regretté la disproportion entre les efforts de défense civile consentis aux Etats-Unis et en France. M. Pierre Lellouche a alors évoqué un entretien des membres de la mission d'information avec le Docteur Khan « père de la bombe atomique pakistanaise ». Il a précisé que ce scientifique leur avait fait part des conditions dans lesquelles le Pakistan avait pu acquérir hors de ses frontières certaines technologies essentielles pour la construction d'armes nucléaires et mené avec succès ses recherches dans le domaine nucléaire militaire, pour un coût de 20 à 30 millions de dollars par an. Par ailleurs, il a insisté sur l'existence de ce qu'il a appelé un « potentiel proliférant », constitué par des milliers de scientifiques russes de haut niveau ne recevant actuellement que de très faibles rémunérations dans leur pays. Le Président Paul Quilès a confirmé ce risque en rappelant l'impression que lui avait laissée une visite dans une installation industrielle russe. M. Arthur Paecht a souligné que les dangers de l'armement biologique pourraient être accrus par les progrès de la recherche, notamment médicale. Il a à ce propos mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser la communauté scientifique, en particulier médicale, aux risques de dissémination des armements biologiques et bactériologiques de manière à l'inciter à garantir la confidentialité de certains travaux. M. Aloyse Warhouver a souhaité mettre en exergue le caractère parfois artificiel de la distinction entre les risques liés à la diffusion des technologies nucléaires, selon qu'elles sont civiles ou militaires. La Commission a alors autorisé à l'unanimité la publication du rapport d'information sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs conformément à l'article 145 du règlement. 2788 - Rapport d'information de M. Pierre Lellouche sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (commission de la défense) (les annexes seront mises en ligne ultérieurement) 1 A cet égard, la mission d'information exprime ses plus vifs remerciements au Dr Amy Sands, Directrice adjointe du Center for Nonproliferation Studies (CNS) au Monterey Institute of International Studies, pour lui avoir permis d'accéder à la très riche base de données sur la prolifération constituée par le CNS. 2 Voir liste des personnes rencontrées en France dans l'annexe I p. 341. La mission ne peut qu'exprimer à nouveau les plus vives protestations sur le refus qui lui a été opposé par le Ministre de la Défense de rencontrer le Directeur de la Direction Générale de la Sécurité extérieure (DGSE). 3 Voir liste des personnes rencontrées à l'étranger dans l'annexe II p. 343. 4 Pierre Lellouche, Le nouveau monde, De l'ordre de Yalta au désordre des nations, Grasset, 1992, p. 82. 5 Pierre Lellouche, op. cit., p. 106. 6 C'est l'auteur qui souligne. 7 Le détail des mesures de désarmement prises par la France dans les années récentes est présenté dans le III, pp. 283 et suivantes. 11 Sur ce sujet, on consultera avec profit l'analyse de Hillary Synnott, The causes and consequences of South Nuclear Tests, Adephi Paper n° 332, December 1999. 12 Traité d'interdiction de production des matières fissiles. 14 Avner Cohen, Israël and the bomb, Columbia University Press, 1998. 15 Cette découverte tardive reste d'ailleurs comme l'un des échecs les plus retentissants des services secrets américains. 17 Pierre Lellouche, op. cit., p. 366. 18 Amy Smithson, Toxic Archipelago, Henry Stimson Center, Avril 2000. 19 Pierre Lellouche, op. cit, pp. 366-367. 20 Pierre Lellouche, op. cit, pp. 367-368. 21 Pierre Lellouche, op. cit, p. 372. 22 Pierre Lellouche, op. cit, p. 373. 23 Avant la guerre Iran-Irak et le massacre des Kurdes à Halabja (8 000 morts) par l'Irak en 1988, les armes chimiques avaient cependant été utilisées à plusieurs reprises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : par l'Egype au Yémen dans les années 1960, par les Etats-Unis au Vietnam (défoliant), le Vietnam au Cambodge et au Laos, l'URSS en Afghanistan, l'Ethiopie en Erythrée, la Libye au Tchad en 1987, la Birmanie contre les rebelles Shan dans les années 1980, l'Afrique du Sud contre les SWAPO en 1978, Cuba contre l'Unita en Angola, en 1985. 25 Claude Eon, L'armement, 1997. 27 Ken Alibek, Biohazard, Random House, 1999. Paru en français sous le titre « La guerre des germes », Presses de la Cité, 2000. 28 Après 17 années passées au service de Biopreparat, agence soviétique officiellement spécialisée dans la recherche pharmaceutique, Ken Alibek, de son vrai nom Kanatyan Alibekov, a fui vers les Etats-Unis en 1992. « Débriefé » tous les jours pendant une année - ponctuellement par la suite - par les experts américains, il a contribué à révéler l'ampleur du programme biologique militaire soviétique, Biopreparat étant en réalité chargée de « développer et de produire des armes à partir des virus, les toxines et les bactéries les plus dangereux connus de l'homme ». 29 Les nombreuses variétés d'armes non conventionnelles étaient appelées par des noms de code : la lettre F était utilisée pour les agents biologiques et chimiques provoquant des troubles du comportement, la lettre L concernait les armes bactériologiques : la peste était L 1, la tularémie L 2, la brucellose, L 3 et l'anthrax L 4. Les armes à base de virus étaient regroupées sous la lettre N : la variole était identifiée sous le code N 1, Ebola N 2, Marburg N 3, etc. 30 On ajoutera que l'URSS, puis la Russie, est dépositaire du traité. 31 Les Etats-Unis ont annoncé la fin de leur programme biologique en 1969. Il avait été initié en 1943, à l'Institut de recherche médicale des maladies infectieuses, à Fort Detrick, dans le Maryland. 32 Voir liste des pays possédant ces deux types d'armes dans l'annexe XV p 475. 33 Michael Mates, rapport pour la commission des sciences et des technologies de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, 1999. 34 La durée d'incubation de l'anthrax est de un à cinq jours. Les premiers symptômes ressemblent à la grippe (douleurs aux articulations, fatigue, toux sèche persistante). A ce stade, il peut être traité par des antibiotiques. Plusieurs jours après survient une période de reflux (éclipse) qui laisse croire à la guérison. En fait, les bactéries prolifèrent dans le système lymphatique, puis dans le sang, pour s'attaquer enfin à tous les organes, dont les poumons, privés peu à peu d'oxygène. La peau prend une couleur bleuâtre, la respiration devient douloureuse, des convulsions surviennent et la mort en est l'issue dans 90 % des cas non traités. 100 kg d'anthrax peuvent tuer, dans des conditions atmosphériques optimales, jusqu'à 3 millions de personnes dans une zone métropolitaine dense. 35 Deux à trois accidents hebdomadaires étaient enregistrés sur ce site. 36 Jessica Stern, « Defending Against Biological Attacks », Herald Tribune, 11 avril 1998. On ajoutera que d'après le FBI, 14 organisations terroristes seraient concernées, dont certains groupes autour de Ben Laden. Du côté des Russes, le ministère de l'Intérieur a révélé qu'avaient été trouvés des documents sur la mise au point d'une arme rudimentaire sur le cadavre d'un soldat tchétchène. 37 Dans ses fonctions antérieures, Ken Alibek était destinataire des notes des services de renseignement sur les programmes étrangers. 38 Voir tableau dans l'annexe XXII p. 505. 41 Le quinzième essai s'est déroulé à partir de Chandipur le 27 janvier, le missile aurait atteint sa cible prévue 250 km plus loin dans le golfe du Bengale. Le seizième tir a été enregistré le 23 février 1997. 42 Il s'agirait d'un test du missile Haft-III. 43 On lira avec profit l'évaluation du rapport Rumsfeld établie en janvier 2000 par Xavier Pasco pour la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), que les pages qui suivent reprennent dans ses grandes lignes. 44 Le Dictionary of Military and Associated Terms édité par le Département de la Défense définit la NIE comme l'« évaluation stratégique des capacités, des vulnérabilités et des directions d'action probables de nations étrangères, qui est produite au niveau national comme vision composite de la communauté du renseignement ». Documents d'une quarantaine de pages, les NIE sont préparées par les 12 National Intelligence Officers du National Intelligence Council, en collaboration avec les Defense Intelligence Officers de la DIA. 45 Contrairement à la NIE de 1993, la NIE de 1995 n'a pas quantifié ses jugements en pourcentage. 46 L'accord de coopération nucléaire pacifique entre les deux pays sera finalement signé en 1985, mais son exécution sera suspendue jusqu'en 1998. 47 Il s'agit d'une filiale à 100 % du CEA chinois, qui est sous le contrôle direct du Conseil d'Etat. Rapport Cox, vol. 1, p. 173. 48 En 1998, une commission de la Chambre des Représentants avait été créée sous la direction du républicain Christopher Cox et chargée d'enquêter sur les transferts de technologies à la Chine, notamment sur les conseils fournis par les entreprises Hughes et Loral, après des échecs de lancement de satellites par Pékin. 50 Les sanctions consistaient en un refus de licence pour l'exportation de satellites, de technologies et d'équipement de missiles et d'ordinateurs à forte capacité vers la Chine. 51 La nature du 3ème étage du missile nord-coréen n'est pas établie. Certains experts, japonais notamment, estiment qu'il s'agit d'un étage à poudre, d'autres pensent qu'il peut s'agir d'un moteur d'apogée voire une charge inerte. 52 Selon les autorités pakistanaises, interrogées sur ce point par la mission, les responsables saoudiens viennent au Pakistan uniquement pour visiter les installations et les armements conventionnels, étant notamment intéressés par l'acquisition de missiles antichars. 53 Chiffre cité par le rapport du Congressionnal Budget Office, Cooperative Approaches to halt Russian nuclear proliferation and improve the openness of nuclear disarmament, mai 1999. 54 Comme son nom l'indique, le traité d'interdiction partielle des essais (Partial Test Ban Treaty) de 1963 n'avait pas cette dimension englobante de l'ensemble du fait nucléaire. 55 Voir texte dans l'annexe III p. 351. 56 Voir liste dans l'annexe IX p. 401. 57 Voir liste des membres dans l'annexe VIII p. 399. 58 Chiffre cité par le rapport du Congressionnal Budget Office, Cooperative Approaches to halt Russian nuclear proliferation and improve the openness of nuclear disarmament, mai 1999. 59 Le MOX est un combustible mixte constitué d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, utilisé dans les réacteurs nucléaires civils. 60 L'Italie devrait se joindre à l'accord prochainement. 61 Le cinquième programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne prévoit d'ailleurs de consacrer 35 millions de francs à des programmes innovants en matière de lutte contre la prolifération. 62 Pierre Lellouche, op. cit, pp. 351-352. Les analyses qui suivent s'inspirent de la démonstration faite dans cet ouvrage. 64 Pierre Lellouche, op. cit, p. 357. 65 Coalition formée en 1998 par l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Egypte, l'Irlande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Suède, qui réclame le désarmement nucléaire selon une approche stratégique plus pragmatique. 66 Les laborieuses négociations sur le cut-off (cf p. 185) sont là pour le rappeler également. 69 Les essais sous-critiques ne sont pas des essais nucléaires, même de faible intensité, dans la mesure où ils ne développent pas d'énergie nucléaire. Ces essais, réalisés avec des matières fissiles, permettent de comprimer les matériaux jusqu'à la masse critique. 71 Le CBO, dans un rapport de mai 1999, évalue à 700 millions de dollars par an le coût de l'ensemble des programmes visant à assurer la sécurité nucléaire en Russie. 72 Voir liste à l'annexe XVIII p. 489. 73 Michael Moodie, « Une décennie de maîtrise des armements chimiques et biologiques », Lettre de l'UNIDIR, 1998. 74 Source : rapport présenté à la commission des Affaires économiques et du Plan par M. Francis Grignon sur le projet de loi relatif à l'application de la Convention du 13 janvier 1993, 1998. 75 L'appellation exacte de la Convention signée à Paris le 13 janvier 1993 est « Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ». 76 Voir texte de la convention dans l'annexe XIII p. 427. 77 Cf. détails en annexe XIV p. 473. 78 Jonathan Tucker, « Challenges to the Chemical Weapon Convention » in Nonproliferation Regimes at risk, CNS, novembre 1999. 79 Ce rapport est disponible sur le site http://cns.miis.edu/pubs/reports/mmsg.htm 80 Chiffres cités par Amy Smithson, op. cit. 81 Les Etats-Unis coopèrent aux projets sur les agents neurotoxiques, tandis que l'Union européenne intervient dans le domaine des vésicants. 82 Elle n'a adhéré à la Convention qu'en 1984, sous réserve de l'élaboration d'un système de vérification. 83 Le titre exact est « Convention sur l'interdiction du développement, de la production et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et toxiques et sur leur destruction ». Voir texte dans l'annexe XVII p. 483. 84 Interview parue dans Arms Control Today, mai 2000. 86 Annabelle Duncan et Kenneth Johnson, « Strenghthening the BWC : lessons from the UNSCOM experience », The Nonproliferation Review, hiver 1997. 88 Brad Roberts, « Biological weapons : new challenges, new strategies ?, in Nonproliferation Regimes at risk, op. cit. 89 Government Accounting Office, « Biological Weapons : efforts to reduce former Soviet threat offers benefits, poses new risks », avril 2000. 90 Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l'action de la France, La documentation française, 2000. 92 Voir directives dans l'annexe XIX p 491. Le MTCR s'applique à l'ensemble des vecteurs aérobies et balistiques non pilotés : missiles balistiques, missiles de croisière, drones, fusées-sondes. 93 On rappellera que la décision d'admettre un nouveau membre se fait par consensus : les partenaires examinent en quoi l'adhésion d'un nouveau membre renforcerait les efforts en faveur de la non-prolifération et si son système de contrôle à l'exportation est efficace. 94 Timothy McCarthy, « The Missile Technology Control Regime », Nonproliferation Regimes at Risk, CNS, novembre 1999. 95 Intervention à la Conférence sur la non-prolifération du Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 11-12 janvier 1999. 97 On peut citer par exemple l'étude de Laurence C. Trost, Ballistic Missile Control and Monitoring Options, Arms Control Studies Department, Sandia National Laboratories, juillet 1996. 98 Camille Grand, l'Union européenne et la non-prolifération des armes nucléaires, Cahiers de Chaillot n° 37, Paris, janvier 2000. 99 Ont été entendus dans ce cadre aussi bien des institutionnels (directeur de la CIA notamment) que d'anciens hauts fonctionnaires (M. Rumsfeld, ancien secrétaire à la défense, ou M. Hadley, ancien secrétaire adjoint à la défense chargé des questions internationales) ou des universitaires membres d'instituts stratégiques (Steve Cambone ou Joseph Cirincione). 102 Sur ces accords, voir ci-dessous. 103 Voir l'historique des projets de défense antimissile aux Etats-Unis dans l'annexe XXIX p. 519. 104 Tel est notamment le cas de Steven Young, Directeur adjoint de la coalition pour la réduction des dangers nucléaires, dans Pushing the limits, The Decision on NMD, avril 2000. 105 Ivo Daalder, James Goldgeier et James Lindsay, « Deploying NMD : Not whether but how », Survival, printemps 2000. 106 La création de cette commission a été autorisée par une loi du Congrès. Ses membres, choisis par le Speaker de la Chambre des représentants, le leader de la majorité du Sénat et par les leaders de la minorité des deux chambres et nommés formellement par le Directeur du renseignement (Director of Central intelligence, qui est aussi le directeur de la CIA), sont : Donald Rumsfeld, Barry Blechman, Général Lee Butler, Richard L. Garwin, William R. Graham, William Schneider Jr, Général Larry Welch, Paul Wolfowitz et James Woolsey. 107 Voir plus haut p. 127 et suivantes. 108 Les analyses qui suivent sont tirées de l'excellente synthèse de Camille Grand, L'Union européenne et la non-prolifération des armes nucléaires, Cahiers de Chaillot n° 37, Paris, janvier 2000. 109 Joachim Krause, « Prolifération des armes de destruction massive : risques pour l'Europe », L'Europe et le défi de la prolifération, Cahiers de Chaillot n° 24, Paris, mai 1996. 110 Voir sur ce point l'annexe XXVI p. 510. 112 C'est en 1976 que la France fournit le réacteur Osirak. 113 Cité par Camille Grand, op. cit. 115 Harald Müller, « Les politiques européennes de non-prolifération nucléaire après l'extension du TNP : succès, lacunes et nécessités », L'Europe et le défi de la prolifération, Cahiers de Chaillot n° 24, Paris, mai 1996. Cité par Camille Grand, op. cit. 118 Christophe Carle, L'Europe et la non-prolifération nucléaire, IFRI, novembre 1994. 121 A cet égard, il semble qu'il ne faille pas faire trop de cas des révélations du New York Times du 16 juin 2000 qui, sur la foi de propos prêtés à de hauts responsables américains, faisaient état d'une nouvelle analyse sur le sujet réalisée par les juristes du département d'Etat, du Pentagone et du Conseil de sécurité nationale. Celle-ci concluait en effet à un élargissement considérable du spectre des travaux compatibles avec le traité ABM en vue de la construction d'une NMD. Comme le notait le journal, une telle analyse marquait une remise en cause de la doctrine juridique qui prévalait sur ce sujet depuis l'Administration Reagan, selon laquelle même les travaux les plus modestes de construction d'infrastructures nécessaires au déploiement d'un système antimissile étaient considérés comme contraires au traité. Auditionné par le Sénat américain sur ce sujet, le Secrétaire d'Etat à la Défense n'a d'ailleurs pas formellement avalisé ces conclusions. 122 Cf. la description des phases de la NMD dans l'annexe XXX p. 521. 124 On ne s'attardera pas sur l'argument relatif au risque de découplage entre les Etats-Unis et l'Europe, notamment opposé par l'Allemagne. Outre que cet argument fourre-tout apporte peu à la réflexion, il met les alliés européens dans une position difficile puisque les Etats-Unis proposent, pour écarter ce risque, d'associer les Européens au projet NMD : la défense élargie viendrait compléter -, voire marginaliser - à la satisfaction d'ailleurs des antinucléaires européens- la dissuasion élargie... De plus, en quoi une Amérique vulnérable serait-elle plus crédible comme protectrice, qu'une Amérique protégée ? En quoi la vulnérabilité favorise-t-elle le couplage ? 125 Thérèse Delpech, « National Missile Defence and Deterrence », la National Missile Defence et l'avenir de la politique nucléaire, Occasional Paper n° 18, Institut d'études de sécurité de l'UEO, septembre 2000. 127 Il a ainsi été impossible à vos rapporteurs de rencontrer un parlementaire américain lors de leur déplacement à Washington. 128 Frédéric Bozo, « La France, la dissuasion et l'Europe », relations internationales et stratégiques, printemps 1996. 129 Bruno Tertrais, L'arme nucléaire après la guerre froide, 1994 131 Voir en annexe XXVI « L'Europe à portée des missiles balistiques » p. 510. 132 Cahiers de Chaillot n° 24, mai 1996. 133 Il est d'ailleurs intéressant de noter que tel a toujours été le principe de la doctrine de dissuasion française qui s'exerçait tous azimuts. De ce point de vue, la doctrine française apparaît aujourd'hui beaucoup plus moderne que celle des Etats-Unis notamment. 134 Bruno Tertrais, « Nuclear Policies in Europe », Adelphi Paper n° 327, mars 1999 135 Cité par Pierre Lellouche, op. cit., p. 348. 136 A l'occasion de la conférence d'examen du TNP du printemps 2000, le gouvernement français a dressé un bilan très complet des actions de la France dans ces domaines, publié sous le titre « Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l'action de la France », La Documentation française, 2000. Une chronologie est présentée dans l'annexe XI p. 407. 137 Les garanties de sécurité négatives consistent en un engagement des Etats nucléaires à ne pas recourir ou menacer de recourir aux armes nucléaires à l'encontre des Etats non nucléaires. Les garanties positives consolident les garanties négatives en engageant les Etats à prendre des mesures (sécurité collective, assistance) en cas de violation de ces dernières. 138 Voir texte dans l'annexe XVI p. 481. 139 Nous renvoyons sur ce point aux travaux en cours de la mission de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale sur les conditions d'engagement des militaires français ayant pu les exposer, au cours de la guerre du Golfe, à des risques de pathologies spécifiques. 140 Source : Paul Quilès, Les Français, la Défense et le rôle du Parlement, rapport Assemblée nationale n° 2185, février 2000. 141 Voir évaluations p. 319 et suivantes. 142 Décret n° 76-845 du 1er septembre 1976. 143 Sur ce point, on consultera avec profit le rapport d'information AN n° 2334 sur « le contrôle des exportations d'armement » établi au nom de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Claude Sandrier, Alain Veyret et Christian Martin. 144 L'article 38 du code des douanes introduit une prohibition d'exportation pour certains biens, qui ne peut être levée que par une autorisation expresse et non cessible. Il offre des pouvoirs adaptés à la nature des contrôles des flux transfrontaliers : droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (article 60), droit d'injonction d'arrêt aux conducteurs et d'immobilisation des moyens de transport (article 61), droit de communication de tout document commercial (article 65). Le code des douanes permet en outre un régime de lourdes sanctions spécifiques (article 414 par exemple). 145 Le JIC est issu de la création, en janvier 1936, de l'Inter-Services Intelligence Committee qui devient rapidement le JIC. D'abord subordonné au Chef d'Etat-major de la Défense, il est transféré au cabinet du Premier Ministre en 1957. 146 On rappellera que la Grande-Bretagne a déjà une pratique du partage du renseignement, certaines réunions du JIC se tenant avec des représentants américains et d'autres pays de l'accord UKUSA de 1947 (Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). 147 Pour une présentation des systèmes existants ou en cours de développement, voir annexe XXVII p. 517. 148 Cette fonction est importante dans la mesure où elle peut permettre de sélectionner les missiles assaillants à traiter, voire de distinguer entre missiles conventionnels et non conventionnels. 150 Richard L. Garwin, « Boost-Phase Intercept : A Better Alternative », Arms Control Today, septembre 2000. 151 Les Russes possèdent également un système d'alerte précoce. Beaucoup a été dit, notamment par des experts américains, sur la dégradation des capacités des systèmes russes, qui seraient non seulement défaillants, mais plus encore dangereux, dans la mesure où le système de « Launch On Warning », ne laisse aux responsables que quelques minutes pour réagir. L'incident d'Andoya en 1995 nourrit les discours les plus catastrophistes : le 25 janvier 1995, une fusée sonde norvégienne lancée d'Andoya a été identifiée comme le lancement d'un missile Trident et a activé la chaîne de commandement russe jusqu'au plus haut niveau. En fait, la réalité est plus mesurée, comme le montrent les travaux de Isabelle Sourbès-Verger, Le système spatial russe d'alerte avancée, FRS, mai 2000. 152 Source : rapport n° 2624, Annexe 38, Commission des Finances, pp. 16-17. 153 Voir annexe XXVIII p. 518. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

