Document mis en distribution le 15 octobre 2001 N° 3320 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2001. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 (n° 3262), TOME I RAPPORT GÉNÉRAL Volume 1 CROISSANCE : MAINTENIR ET CONFORTER PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila. SOMMAIRE - Volume 1 - 1ère partie Pages INTRODUCTION 5 I.- LES BUDGETS ÉCONOMIQUES POUR 2002 : DES ALÉAS PARTICULIERS ENTOURANT LES SCÉNARIOS DE PRÉVISION 7 A.- LES ETATS-UNIS : RALENTISSEMENT OU RÉCESSION ? 8 B.- LA ZONE EURO À LA CROISÉE DES CHEMINS 13 1.- Une appréciation paradoxale de la conjoncture dans la zone euro 13 2.- France : le « cercle vertueux » menacé ? 14 II.- L'INCERTITUDE ACCRUE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 23 A.- UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL TRÈS DÉPENDANT DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE 23 1.- Un environnement international moins favorable 23 2.- Un ralentissement de l'économie américaine anticipé depuis longtemps, mais d'une ampleur plus prononcée que prévu et d'une durée incertaine 29 3.- L'économie japonaise toujours soumise à des tendances déflationnistes 39 4.- Une situation difficile dans les pays émergents, mais néanmoins sous contrôle pour les plus faibles d'entre eux grâce aux interventions du FMI 43 B.- LA ZONE EURO AU PIED DU MUR 49 1.- La croissance essoufflée : quel horizon pour le rebond ? 50 2.- Les faiblesses du moteur interne : l'Allemagne connaît une situation économique difficile 68 3.- Mettre en _uvre des politiques économiques pertinentes et cohérentes dans la zone euro 72 III.- L'ÉCONOMIE FRANÇAISE : DES FONDAMENTAUX SOLIDES QUI PRÉSAGENT D'UNE BONNE CAPACITÉ DE RÉSISTANCE 77 A.- DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS ORIENTÉS À LA BAISSE 77 1.- Une diminution sensible de l'excédent commercial en 2000 77 2.- Une légère amélioration de la balance commerciale en 2001 89 B.- UN AJUSTEMENT LIMITÉ DU CERCLE VERTUEUX EMPLOI/REVENU/CONSOMMATION 98 1.- La progression de l'emploi : moins forte mais toujours robuste 98 2.- Les ménages, pilier de la croissance 108 C.- DES CONDITIONS FAVORABLES POUR L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 115 1.- Une contribution importante à la croissance en 2000 115 2.- En 2001 : des conditions toujours favorables pour l'investissement 117 IV.- UNE ÉCONOMIE DE L'INCERTITUDE QUI CONFIRME LA LÉGITIMITÉ D'UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE VOLONTAIRE 121 A.- PREMIER DÉFI : AMORTIR LE CHOC DU RALENTISSEMENT SANS CONTRARIER L'ASSAINISSEMENT DES DÉSÉQUILIBRES 121 1.- Un consensus européen pour laisser jouer les stabilisateurs budgétaires automatiques 121 2.- Un début de décrue de l'inflation rendant possible une politique monétaire plus accommodante 126 B.- DEUXIÈME DÉFI : RENFORCER LA CROISSANCE POTENTIELLE SANS DEVENIR PRISONNIER DES RHÉTORIQUES LIBÉRALES 130 1.- Encourager l'innovation et soutenir le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication 131 2.- Tirer le meilleur parti de l'ouverture à la concurrence de certains services publics au sein du marché intérieur européen 133 3.- Renforcer l'efficacité de l'Etat 135 C.- TROISIÈME DÉFI : RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 138 1.- Le plein emploi, un objectif ambitieux qui doit guider le choix des dispositifs d'aide à l'emploi 139 2.- La lutte contre la précarité et l'exclusion est plus que jamais à l'ordre du jour 146
CROISSANCE : MAINTENIR ET CONFORTER Mesdames, Messieurs, Ce projet de budget est le dernier présenté sous cette législature. Il s'agit du premier budget présenté en euros. Il est discuté après les événements tragiques du 11 septembre. L'horizon international est plus incertain. La situation conjoncturelle qui sert de cadre à l'élaboration du projet de loi de finances en porte la marque. C'est la raison pour laquelle les économies européennes, à la veille de l'étape décisive de l'euro pour tous, doivent garder toute leur capacité à conforter les ressorts de l'activité économique. En 1997, la France était en panne sur le chemin de la croissance et sur la voie de la convergence européenne. Le Gouvernement et la majorité issue des élections de 1997 ont su remettre la France en mouvement. Pendant quatre ans, ils ont été attentifs à procéder, aux adaptations permettant d'obtenir des résultats et de les conforter. La France a connu une période de croissance forte, moins sujette aux à-coups que celle de ses principaux partenaires. La situation de l'emploi s'est améliorée. Une solidarité accrue en faveur des ménages les plus modestes a pu être assurée. La capacité de maintenir la confiance des consommateurs et des investisseurs est déterminante dans cet environnement plus incertain. Elle passe par la poursuite des objectifs de la stratégie budgétaire définie à l'automne 1997, même si la situation internationale justifie certains ajustements. I.- LES BUDGETS ÉCONOMIQUES POUR 2002 : DES ALÉAS PARTICULIERS ENTOURANT LES SCÉNARIOS DE PRÉVISION La Commission économique de la Nation s'est réunie le mercredi 26 septembre 2001, afin d'examiner les budgets économiques pour 2002. Comme à l'accoutumée, cette séance a été précédée par la réunion d'un « groupe technique », en vue de confronter les prévisions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à celles des principaux instituts de conjoncture et de certaines institutions financières importantes. L'exercice a été rendu particulièrement délicat cette année du fait des attentats commis le 11 septembre dernier aux Etats-Unis, qui ont amené un grand nombre de conjoncturistes à réviser leurs prévisions. Mais le délai très bref séparant la date de la réunion de celle du 11 septembre a parfois empêché que les nouveaux cadrages macro-économiques fussent établis en temps utile pour être communiqués à la direction de la prévision. Ainsi, les tableaux chiffrés constitués à l'appui des débats des experts - dont des extraits sont reproduits dans le présent rapport général - sont entachés de plusieurs biais : - certains organismes n'ont pas communiqué de scénario révisé, alors que, par ailleurs, la lecture de leurs publications économiques récentes suggère que leur scénario central pour l'économie mondiale et pour la zone euro a été affecté par les événements survenus aux Etats-Unis ; - d'autres ont communiqué un scénario révisé pour les Etats-Unis, mais pas pour la zone euro ni pour la France, les travaux nécessaires n'étant pas encore achevés à la date de la réunion ; - d'autres encore ont communiqué oralement, au cours des débats, des chiffres révisés. Cependant, en règle générale, ceux-ci se limitaient au taux de croissance du PIB aux Etats-Unis et ne concernaient pas les autres variables du scénario américain ni, a fortiori, des scénarios européens et français ; - Rexecode n'a pas proposé de « scénario central », mais des fourchettes d'évaluations. Pour la clarté des tableaux joints au présent rapport, votre Rapporteur général a cependant jugé préférable de porter dans la colonne afférente à cet organisme les valeurs médianes correspondantes. C'est donc avec quelque circonspection que votre Rapporteur général évoquera, dans les développements qui suivent, l'opinion « moyenne » du panel des prévisionnistes. D'ailleurs, il semble que l'opinion « moyenne » du panel soit un objet assez insaisissable : comme l'indique votre Rapporteur général à la fin de la présente partie, les prévisionnistes se distinguent nettement entre un groupe de « pessimistes » et un groupe de « sereins ». Dans ce contexte troublé, on ne peut passer sous silence le fait que le climat observé en septembre 2001 est très différent de celui constaté en septembre 2000, lors de la précédente édition de cet exercice de prévision et de confrontation. La « relative sérénité » dont parlait votre Rapporteur général dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2001 (1) a bel et bien disparu chez la plupart des experts et le mot de « récession » - qui jusqu'ici n'avait été employé qu'à propos du Japon - a été utilisé plus qu'à son tour, s'agissant de la conjoncture américaine. A.- LES ETATS-UNIS : RALENTISSEMENT OU RÉCESSION ? En une année, le panorama américain a radicalement changé : l'an dernier, à la même époque, la direction de la prévision et la quasi-totalité des membres du panel des conjoncturistes retenaient la thèse d'un « atterrissage en douceur » de l'économie américaine. Celui-ci l'aurait amené sur un sentier de croissance d'environ 3,3% en 2001. Mais lors de la dernière réunion du groupe technique, l'estimation relative à 2001 a été ramenée à 1,4% pour la direction de la prévision. Celle-ci se montre cependant moins pessimiste que les membres du panel, qui prévoient une croissance du PIB limitée à 1,2% environ en 2001. De l'avis général, les Etats-Unis sont donc entrés dans une phase d'ajustement plus rapide et plus prononcée que ce qui était estimé auparavant. La plupart des économistes s'accordent à penser que les attentats du 11 septembre auront un impact non négligeable sur une économie déjà affaiblie. · Pour autant, il serait incorrect de parler de consensus à propos des conséquences économiques supposées de ces attentats. Assurément, les organismes qui ont indiqué avoir tenu compte de ces événements ont présenté, pour la plupart, des estimations de croissance très faibles pour 2001 : + 1% pour L'Expansion et Goldman Sachs, + 1,1% pour la Société générale, + 1,2% pour l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et l'Association française des économistes d'entreprise (AFEDE). La Caisse des dépôts et consignations (CDC) rappelait, par exemple, que sa dernière prévision antérieure au 11 septembre était assortie d'un « biais négatif » sur la consommation des ménages : « les attentats nous conduisent à considérer que ce biais négatif va se concrétiser ». De même, au cours de la séance, plusieurs organismes ont indiqué qu'ils révisaient sensiblement à la baisse leurs prévisions. Elles sont passées, pour 2001, de + 1,7% à + 1,2% pour BNP-Paribas, de + 1,5% à + 1,1% pour le Crédit agricole et de + 1,2% à + 1% pour le Crédit Lyonnais. Les mêmes institutions ont abaissé leurs prévisions de croissance relatives à l'année 2002 à hauteur, respectivement, de 1 point, 0,6 point et 1,3 point. L'amplitude des écarts entre ces trois révisions montre à elle seule l'incertitude qui entoure les prochains trimestres d'activité aux Etats-Unis et à recevoir les différents chiffrages évoqués çà et là. Enfin, les révisions associées aux attentats du 11 septembre ont conduit les organismes concernés à retarder d'un, voire deux trimestres, le point bas de la phase de ralentissement. Celui-ci se situerait donc au quatrième trimestre 2001 ou, au pire, au premier trimestre 2002. Bien entendu, ce retard a une influence non négligeable sur la prévision de croissance moyenne de l'année 2002. Quelques voix discordantes se sont élevées pour faire pièce à un pessimisme et une « hyper-réactivité » jugés excessifs. Pour Natexis, il est illusoire de vouloir porter dès à présent un jugement, fut-il positif ou négatif, sur les répercussions des attentats : les scénarios géopolitiques envisageables sont trop divers pour en tirer des conclusions quant au climat des affaires et à l'orientation de l'activité. Quant aux indicateurs proprement économiques, il est encore trop tôt pour disposer du recul nécessaire. Le parallèle avec la situation qui prévalait au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak, puis de la guerre du Golfe, n'est pas pertinent : les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles, le taux de chômage américain est également beaucoup plus faible et le prix du pétrole n'a pas « flambé » comme en 1990-1991. En définitive, « il faut distinguer ce que l'on connaît, le concret, et les pures suppositions ». Le Groupe d'analyse macro-économiques appliquée de l'université de Paris-Nanterre (GAMA) a « essayé de tenir compte » des attentats, intention d'autant plus méritoire qu'aucune tendance claire quant à leurs conséquences n'apparaît à ce jour. D'ailleurs, le GAMA se demande dans quelle mesure les effets sur les Etats-Unis ne seront pas minimes, « voire positifs », du fait de la réaction budgétaire immédiate des autorités américaines. Pour le GAMA, le déblocage par le Congrès de 40 milliards de dollars ne peut manquer d'exercer un effet stimulant sur l'ensemble de l'économie. Enfin, le Centre d'observation économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (COE) a bien « creusé » son profil trimestriel d'activité, mais n'a pas estimé pour autant que l'on observerait une récession au second semestre de l'année 2001. C'est donc à l'aune de ces incertitudes que doit être apprécié le choix de la direction de la prévision de ne pas modifier son scénario américain (2) . Assurément, le temps manquait pour procéder à une nouvelle étude complète de l'ensemble du compte prévisionnel : il ne s'agit pas seulement, en l'espèce, de faire simplement « tourner » un modèle, mais d'analyser et, éventuellement, intégrer dans les raisonnements sous-jacents les réactions des agents économiques à un choc émotionnel intense. Par ailleurs, la direction de la prévision a fait valoir que son scénario « intègre déjà une tendance de fond plutôt pessimiste » et que les événements du 11 septembre doivent avant tout apparaître comme un « accélérateur d'ajustements déjà à l'_uvre ». En ce sens, la direction de la prévision ne conteste pas le fait que « le compte [américain] pourrait être chahuté sur les troisième et quatrième trimestres 2001, ce qui introduirait un profil trimestriel d'activité plus marqué que dans le compte actuel et modifierait la valeur des acquis pour l'année 2002 ». Surtout, votre Rapporteur général rappelle que les budgets économiques ne sont pas un exercice à caractère universitaire, mais un élément important dans la construction du budget de l'Etat. Réviser les budgets économiques dans l'urgence, sous la pression d'un événement terrible, certes, mais dont la portée économique reste encore assez floue, ne serait pas une démarche responsable. Il faut être attentif à ne pas « surréagir », c'est-à-dire surestimer les conséquences économiques globales d'un événement comme celui du 11 septembre au détriment de la prise en compte des facteurs plus « structurants » qui, avant même cette date, témoignaient du ralentissement de l'économie américaine. · En effet, les effets réels ou supposés des événements du 11 septembre ne prennent toute leur dimension que lorsqu'ils sont associés à une vision des tendances fondamentales de l'économie américaine, antérieurement aux attentats. Dans ses grandes lignes, le scénario proposé par la direction de la prévision a recueilli l'assentiment des économistes. Il se fonde sur le constat d'un ralentissement très prononcé, l'industrie étant en récession depuis environ un an et la résistance de la consommation des ménages n'ayant pu empêcher, jusqu'ici, la dégradation de cet indicateur synthétique que constitue le PIB. Le ralentissement résulte du resserrement de la politique monétaire engagée en 1999, qui s'est greffé sur la fin d'un cycle d'investissement soutenu, pour donner un coup de frein brutal à la formation brute de capital fixe. Cependant, la réaction vigoureuse de la Réserve fédérale - qui a abaissé les taux objectifs des fonds fédéraux de 350 points de base depuis le mois de décembre 2000 - ainsi que le programme de baisse des impôts de l'administration républicaine devraient conduire à un raffermissement de l'activité d'ici à la fin de l'année 2001. Selon la direction de la prévision, ce raffermissement resterait cependant limité car l'économie américaine n'a pas encore fini de « digérer » les déséquilibres profonds qui ont marqué la croissance ces dernières années : sur-investissement (en particulier dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans certains secteurs dits traditionnels), faible taux d'épargne des agents privés, déficit courant. En définitive, la direction de la prévision a assorti son estimation (1,9% de croissance en 2002) d'un risque baissier dû à l'impact des attentats, qui ne peut pas encore être évalué ou quantifié. Aucun participant ne s'est démarqué de ce scénario. La Société générale indique ainsi que la prévision de + 1,4% en 2001 et + 1,9% en 2002 lui « convenait » avant le 11 septembre. L'OFCE estime également que les attentats du 11 septembre ne sont que le « catalyseur d'un ajustement déjà très fort sur l'investissement » et qu'ils auront pour effet d'« accentuer le phénomène actuel de remise à plat du capital productif ». Tout au plus, votre Rapporteur général doit noter les appréciations plus sombres portées par L'Expansion. Reprenant en cela des idées déjà développées l'an passé, à cette même table, L'Expansion a fait valoir que les déséquilibres évoqués par la direction de la prévision auraient peut-être une influence déflationniste plus marquée que prévu. Pour cet organisme, « la récession commençait à devenir globale, à toucher à la fois l'industrie et les services. Mais surtout, elle commençait à toucher le consommateur ». Dès lors, des enchaînements délétères peuvent se mettre en place : « la baisse de la bourse pourrait tout à fait déclencher une déflation à la japonaise ». En effet, selon L'Expansion, « le problème du financement du secteur privé reste entier » et l'endettement généralisé des ménages comme des entreprises grève les bilans des agents et obère tout espoir de reprise rapide. · Il faut pourtant bien s'attacher à évaluer les ressorts de l'économie américaine, qui devraient lui permettre de reprendre, dans quelques trimestres, le chemin de la croissance. Invoquant la « capacité de rebond de la société américaine », la SFAC ne conteste pas la possibilité d'observer une récession au tournant de l'hiver 2001-2002, mais estime que « l'on sera surpris par un rebond plus fort que prévu au second semestre 2002 ». Chacun s'accorde à dire que la réaction de la politique économique a été à la mesure des difficultés constatées chaque jour plus aiguës dans le système productif. L'Expansion affirme que l'assouplissement du réglage de la politique économique provoque une « reflation sans précédent » et que les deux outils (budgétaire et monétaire) fonctionnent au maximum de leurs possibilités. Selon le COE, c'est pour cette raison que les Etats-Unis connaîtront une « vigoureuse reprise » au second semestre 2002. Pour le Crédit Lyonnais, également, « la reprise sera peut-être très marquée car on a mis beaucoup de charbon dans la chaudière ». Pourtant, bien que l'effort budgétaire engagé immédiatement après les attentats soit jugé massif par tous les participants au groupe technique, certains, comme la Société générale, attirent l'attention sur le fait que les 40 milliards de dollars débloqués par le Congrès ne seront dépensés que progressivement. De même, la Société générale tend à relativiser l'effet à court terme des baisses de taux directeurs décidées par la Réserve fédérale. Pour sa part, l'OFCE n'attend pas d'effet keynésien d'une relance budgétaire massive, tout au moins sur l'horizon de prévision retenu. L'efficacité d'une telle relance, nonobstant son ampleur, est également mise en doute par L'Expansion qui estime que pour traiter les problèmes de bilan des agents privés, « les recettes keynésiennes ne sont certainement pas à la hauteur ». Dans cette perspective, ce serait donc la dynamique propre de l'investissement et de la consommation qui gouvernerait le calendrier du retour à la croissance, plutôt que l'action des finances publiques, peu efficace. Force est de constater que les échanges de vues relatifs à l'investissement des entreprises n'ont pas apporté l'espoir d'un redémarrage rapide. La charge du sur-investissement passé est reconnue par tous, ce que Rexecode traduit autrement en rappelant que la rentabilité de l'investissement a été revue fortement à la baisse dans les mois récents. En conséquence, les chefs d'entreprise ne devraient pas être incités à augmenter leurs dépenses en capital, tout au moins avant le second semestre 2002. La Société générale partage cette analyse et souligne que, dans le passé, l'investissement est toujours reparti très progressivement dans les phases de reprise, aux Etats-Unis. En la matière, la diminution très marquée des profits et les perspectives médiocres de leur redressement n'augurent pas d'un prochain renversement de tendance. De l'avis de tous les participants, la clef du redémarrage américain est donc entre les mains des ménages. Si l'on ne peut pas dire qu'un consensus se soit réellement dégagé des travaux du groupe technique, il n'en apparaît pas moins que la tonalité générale ajoute souvent l'inquiétude à la simple incertitude. En premier lieu, l'ampleur des « effets de richesse » négatifs a été fortement discutée. Pour la Société générale, la baisse de la bourse américaine depuis le printemps 2000 et, de façon accélérée, depuis les dernières semaines, a réduit la richesse des ménages et doit peser sur la consommation. Deux phénomènes interviennent : - le premier est purement mécanique : les ménages ayant consacré à la consommation, ces dernières années, une partie des plus-values enregistrées sur leur portefeuille boursier, la réduction, voire la disparition de ces plus-values réduit le montant du « revenu » susceptible d'être consommé ; - le second est psychologique : la baisse de valeur des portefeuilles inquiète les ménages, qui voient leur horizon financier se détériorer et réduisent leurs dépenses pour préserver l'avenir. La Société générale estime également que l'investissement des ménages en logement devrait fortement ralentir dans les prochains mois. La situation serait cependant moins « instable » qu'avant la crise de 1990-1991, empêchant ainsi d'établir un parallélisme trop marqué avec cette dernière période. C'est seulement si la confiance des ménages était fortement atteinte qu'interviendrait, selon le Crédit Lyonnais, un véritable retournement sur le marché de l'investissement en logement. L'immobilier constitue, en effet, l'actif principal des ménages, bien au-delà des actifs financiers. Une baisse des prix de l'immobilier aurait donc un effet bien plus important que la baisse de la bourse. D'ailleurs, le Crédit Lyonnais estime que l'effet de richesse est d'ores et déjà « dégonflé » : la bourse baisse depuis près d'un an et demi et les ménages ne prennent plus leurs décisions de consommation en fonction de plus-values désormais perçues comme évanescentes, mais en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat de leur revenu. Il semble donc que le comportement de consommation de ménages soit devenu plus sain que ces dernières années, ce qui supprime un facteur de fragilité pour son évolution future. En revanche, le Crédit Lyonnais voit désormais l'évolution défavorable de l'emploi comme le principal risque susceptible d'affecter les tendances de consommation pendant les prochains mois : « on a le sentiment que les dégraissages viennent seulement de commencer ». Ce à quoi fait écho L'Expansion en relevant que l'augmentation du chômage pourrait entraîner à la hausse le taux d'épargne des ménages, privant ainsi la demande intérieure américaine de son socle le plus solide. Ces deux organismes sont rejoints par la Société générale. Estimant elle aussi que les réductions d'effectifs pèsent sur les perspectives de consommation, elle se demande si les allégements fiscaux ne seront pas absorbés par l'augmentation du taux d'épargne. La situation pourrait alors être caractérisée par une analogie avec une « guerre du Golfe prolongée » : au contraire de la confrontation avec l'Irak, en 1991, la confrontation annoncée avec le terrorisme international sera longue et son issue reste très incertaine. Par conséquent, « le taux d'épargne ne devrait pas diminuer de façon sensible dans un proche avenir ». C'est pourquoi « il ne faut pas croire que la consommation va repartir vigoureusement et rapidement : le rebond risque d'être modéré et tardif ». Entre les économistes qui prévoient un fort rebond de l'activité en 2002 (vers le second semestre) et ceux qui jugent que la reprise sera plutôt languissante, il existe donc une marge non négligeable, qui va bien au-delà des quelques rares divergences de vues sur tel ou tel point particulier du panorama économique américain. Là encore, les écarts dans les prévisions chiffrées amplifient certainement les différences d'appréciation entre experts, alors que, globalement, les mécanismes exposés devant le groupe technique par les différents participants sont très largement concordants. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'analyse de la situation économique dans la zone euro et en France, à l'horizon 2002, soit entachée des mêmes décalages. B.- LA ZONE EURO À LA CROISÉE DES CHEMINS 1.- Une appréciation paradoxale de la conjoncture dans la zone euro Pour la direction de la prévision, le taux de croissance du PIB dans la zone euro devrait passer de 1,9% en 2001 à 2,3% en 2002. Cette estimation est assez légèrement supérieure à celle des membres du panel, qui serait égale, en moyenne, à 2%. Faut-il en conclure que la direction de la prévision est exagérément optimiste quant aux perspectives de la zone euro ? Votre Rapporteur général ne le pense pas. Il convient de remarquer, d'une part, que les prévisions des économistes sont relativement dispersées, puisqu'elles s'écartent, en moyenne de _ 25% par rapport à la valeur centrale de 2%. On doit ainsi considérer que les conjoncturistes du groupe technique voient la croissance de la zone euro en 2002 se situer entre 1,5% et 2,5%. Le chiffre avancé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie s'inscrit donc à l'intérieur de la fourchette du groupe technique. D'autre part, l'appréciation portée, en moyenne, par les participants au groupe technique sur le comportement de la zone euro fait apparaître que l'Allemagne rattraperait, en partie, son retard de croissance par rapport à l'ensemble de la zone. Le taux de croissance du PIB allemand étant évalué à 1,7%, l'écart de croissance avec l'ensemble de la zone ne serait plus de 0,3 point de PIB. Pour sa part, la direction de la prévision prévoit que le taux de croissance du PIB allemand serait égal à 1,7%, soit un écart de 0,6 point de PIB avec l'ensemble de la zone. Or, le panel du groupe technique dresse, en moyenne, un panorama international plus sombre que celui présenté par la direction de la prévision : la croissance du PIB des Etats-Unis n'atteindrait que 1,5% en 2002 (1,9% pour la direction de la prévision), alors que le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar progresserait pour se trouver quasiment à la parité (la direction de la prévision retient pour sa part, et de façon tout à fait traditionnelle, le taux de change en vigueur au moment du bouclage de son scénario, à savoir 0,9 dollar pour un euro). Votre Rapporteur général soulignera, dans la suite du présent rapport, que l'Allemagne est un maillon sensible de la zone euro, car, parmi les grands pays de la zone, cet Etat est l'un des plus exposés aux fluctuations de l'environnement international. Il semble donc assez paradoxal que, placée dans un environnement plus défavorable que celui envisagé par la direction de la prévision, l'Allemagne réduise plus fortement son écart de croissance (3). C'est faire, en l'espèce, des hypothèses très fortes quant à la vigueur des déterminants purement internes de la conjoncture allemande. Or, justement, le panel semble s'être rangé derrière les propos de la SFAC, qui affirme que « les raisons du ralentissement de la zone euro ne sont que faiblement exogènes. Elles sont surtout liées à un « malaise allemand », similaire à celui qui frappe le Japon depuis le début des années 1990 et qui ne se réduit pas à un simple phénomène conjoncturel ». Votre Rapporteur général s'interroge donc sur la façon d'interpréter ce qui apparaît comme un décalage surprenant entre les perspectives de la zone euro et les perspectives de l'Allemagne. 2.- France : le « cercle vertueux » menacé ? Si le diagnostic porté par les économistes sur les Etats-Unis recouvre assez largement celui qui est proposé par la direction de la prévision, il n'en est pas de même pour le scénario français. · La direction de la prévision a tracé les lignes d'un scénario dans lequel la France conserverait un écart de croissance favorable vis-à-vis de la zone euro. Sur le marché du travail, les tensions observées ces toutes dernières années resteraient suffisantes pour accélérer les gains de pouvoir d'achat du salaire moyen par tête : ceux-ci atteindraient 1,7% en 2002 après 1,2% en 2001. Cependant, le dynamisme du marché de l'emploi serait moindre, la croissance de l'emploi salarié décélérant de 2,8% en 2001 à 1,7% en 2002 ; pour l'emploi total, ces taux seraient respectivement égaux à 2,1% et 1,5%. Ainsi, le pouvoir d'achat de la masse salariale continuerait à croître de façon significative en 2002, quoique moins vivement qu'en 2001 : 3,1% après 3,5%. Les baisses d'impôts - plus importantes en France que chez ses partenaires - sont évaluées à 1% du PIB en 2000 et 1,5% du PIB entre 2001 et 2002. Elles apporteraient aux ménages 0,5 point de revenu disponible en 2001 et 0,5 point supplémentaire en 2002. Bien que la croissance du pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages passe de 3,4% en 2001 à 2,6% en 2002, cet indicateur, qui est l'un des déterminants principaux de la consommation, resterait donc dynamique. La consommation des ménages accélérerait d'ailleurs légèrement, passant de 2,6% à 2,7% entre 2001 et 2002. L'investissement en logement serait à peu près stabilisé. Les dépenses en capital des entreprises se raffermiraient, sous l'effet d'un taux d'utilisation des capacités de production élevé et des besoins toujours pressants en matière de renouvellement de l'appareil de production et d'intégration du progrès technique. L'ajustement des stocks, achevé au premier semestre, ne pèserait plus sur la croissance au second semestre. Dans ces conditions, le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des entreprises non financières ne faiblirait que légèrement sur l'ensemble de l'année, revenant de 4,9% en 2001 à 3,8% en 2002. La désinflation serait plus faible que dans le reste de la zone euro, l'indice des prix à la consommation ne reculant que de 0,1 point, en passant de 1,7% en 2001 à 1,6% en 2002. Ce décalage s'explique, en premier lieu, par les bonnes performances de la France ces dernières années, le point de départ de la comparaison entre 2001 et 2002 se situant, chez nous, plus bas que chez nos partenaires. Il s'explique également par la situation du marché du travail, où des tensions persisteraient. Du fait des tensions sur les coûts salariaux, l'inflation sous-jacente serait stabilisée légèrement au-dessous de 2%. Enfin, le besoin de financement des administrations publiques serait stabilisé à 1,4% du PIB, la direction de la prévision ne contestant pas le fait que la France connaîtrait donc un retard dans la réalisation de son programme de retour à l'équilibre. Malgré l'augmentation des dépenses sociales, les redéploiements effectués à l'intérieur du budget de l'Etat permettraient de réduire d'environ un demi point la part des dépenses publiques dans le PIB. · A en juger par la valeur moyenne des prévisions du groupe technique, le scénario officiel du Gouvernement semble devoir être qualifié d'« optimiste ». En effet, les conjoncturistes voient la croissance du PIB s'établir à 2,1% seulement en 2002 (4), taux inchangé par rapport à celui avancé pour l'année 2001. Le principal point d'achoppement porte sur les déterminants de la consommation et sur la consommation elle-même. Au lieu de s'accélérer, comme dans le scénario de la direction de la prévision, celle-ci passerait de 2,6% en 2001 à 2,2% en 2002. En fait, ses deux déterminants principaux seraient plus mal orientés que dans les évaluations de la direction de la prévision : - le ralentissement du marché de l'emploi serait plus important : le taux de croissance de l'emploi salarié ne serait plus que de 1,3% en moyenne. Cependant, cette moyenne recouvre une assez sensible différence entre les instituts de conjoncture (1%) et les institutions financières (1,5%), qui se rapprochent plus, en ce sens, de l'opinion de la direction de la prévision. La divergence entre ces deux catégories d'organismes est encore plus marquée, s'agissant de l'emploi total. Les instituts de conjoncture le voient revenir de 2% en 2001 à 0,9% seulement en 2002, alors que les institutions financières envisagent un repli plus limité, qui ramènerait le taux de croissance de l'emploi total à 1,4% en 2002. Cette estimation est très proche de celle de la direction de la prévision, qui s'établit à 1,5% ; - le pouvoir d'achat des revenus perçus par les ménages serait très sensiblement freiné. Pour le salaire moyen par tête, il progresserait de 0,9% seulement (1,1% pour les instituts de conjoncture et 0,8% pour les institutions financières), ce qui représente la moitié du taux retenu par la direction de la prévision (1,7%). Le décalage serait cependant moins fort en ce qui concerne le revenu disponible brut des ménages, qui progresserait de 2,2% pour les membres du groupe technique alors que la direction de la prévision prévoit 2,6%. Derrière ces prévisions plus pessimistes se dessine, en fait, la remise en cause du « cercle vertueux » qui a porté la croissance française depuis 1997, soutenu par les décisions avisées de politique économique décidée par le Gouvernement de Lionel Jospin. La Deustche Bank, par exemple, estime que le scénario dressé par la direction de la prévision fait la part belle à la thèse du « trou d'air ». Mais, selon cette banque, la situation actuelle n'a pas grand chose à voir avec la situation de 1998-1999 : la tendance sous-jacente est bien plus dégradée qu'à l'époque. Ainsi, la diminution des flux commerciaux, à l'intérieur et vers l'extérieur de la zone euro, ne traduit pas seulement un ajustement des stocks mais aussi une réduction de la demande finale, ce qui est beaucoup plus préoccupant. On observe également un début d'ajustement sur le niveau tendanciel d'investissement et l'environnement international de la zone euro est, lui-même, beaucoup plus difficile qu'en 1998-1999, au premier chef en raison du ralentissement aux Etats-Unis. De plus, la zone euro a subi un choc de prix, avec la montée des prix du pétrole et la montée des prix alimentaires, qui se sont diffusées partiellement à l'ensemble de l'économie et dont on commence à voir les effets, non pas seulement en matière d'inflation mais aussi en matière de compétitivité. Ces chocs de prix ne sont pas terminés et l'inflation sous-jacente n'est pas encore maîtrisée. En France même, de nombreux participants mettent en avant un possible retournement du marché du travail. La SFAC redoute que la montée des faillites ne poussent les chefs d'entreprises à ajuster leurs effectifs plus rapidement et plus fortement que prévu. Goldman Sachs s'interroge sur l'évolution récente de la montée du chômage : au-delà d'effets très ponctuels, comme la suppression du service national, n'y a-t-il pas derrière le renversement de la courbe du chômage une tendance plus profonde que la simple influence d'un cycle ? Pourquoi le chômage est-il reparti si vite à la hausse ? Pourquoi avec cette ampleur ? Il est à craindre, selon Goldman Sachs, que la France ne se comporte moins bien que le reste de la zone euro dans les prochains mois, au contraire de ce que l'on pouvait observer auparavant. La confiance des ménages, qui a soutenu la consommation dans les temps difficiles, pourrait faire défaut désormais, alors que se répand ce que la SFAC appelle une « grande peur de la rentrée ». · Il faut pourtant se garder de toute vision à « sens unique ». La réunion du groupe technique a fait apparaître un certain nombre d'éléments qui permettent d'affirmer que le pire n'est pas sûr et qu'il existe une chance non négligeable pour que les développements fâcheux évoqués ci-avant ne prennent pas une importance inconsidérée. Nombreux sont les économistes qui ont observé qu'il ne fallait pas nourrir de trop grand pessimisme sur le comportement des entreprises. Par exemple, l'AFEDE remarque que la situation des entreprises reste très saine et que l'incitation à investir reste forte : la pression du progrès technique et le taux élevé d'utilisation des capacités de production sont aussi des éléments importants dans les décisions des chefs d'entreprise. L'OFCE estime que, comme aux Etats-Unis, la zone euro et la France connaissent une phase baissière du cycle d'investissement et que la clef de la reprise réside donc dans l'investissement. Or la zone euro, comme la France, sont entrées dans ce cycle avec un retard important d'investissement par rapport aux Etats-Unis, ce qui constitue un facteur positif incontestable. Contrairement aux Etats-Unis, les pays européens n'ont pas à « absorber » un excès passé d'investissement, ce qui rend celui-ci beaucoup plus réactif aux bonnes nouvelles. La Société générale elle même - qui a pourtant développé un scénario parmi les plus pessimistes - reconnaît que l'appréciation du comportement d'investissement des entreprises doit prendre en compte des « éléments contradictoires ». Au chapitre des éléments positifs, la banque relève qu'en phase de ralentissement, il est normal que l'on observe une baisse de l'investissement productif et que les tendances récentes ne peuvent pas être prolongées outre mesure. De même, l'absence d'excès d'investissement dans la phase antérieure du cycle est un facteur positif qui n'est peut-être pas apprécié pleinement. En matière de stocks, la direction de la prévision juge que la situation est déjà « clarifiée », ce qui est corroboré par les évaluations des économistes : tous estiment que les stocks devraient apporter une contribution positive à la croissance en 2002. Il va de soi que, si cette remontée des stocks était due, pour l'essentiel, à une mauvaise appréciation de la demande par les entreprises, elle serait plutôt inquiétante. Cependant, le consensus qui s'est dégagé au sein du groupe technique quant à la forte réactivité des entreprises lors du ralentissement actuel incite plutôt à croire qu'une partie de la reconstitution des stocks traduit la confiance des chefs d'entreprise dans leurs perpectives de production plutôt qu'une chute non anticipée de la demande finale. Par cohérence, on peut considérer qu'il s'agit d'un signe indirect selon lequel la situation du marché de l'emploi ne devrait pas être fondamentalement affectée par le ralentissement actuel. En définitive, faut-il rester les yeux rivés sur la « moyenne » des économistes, au risque de croire à un réel décalage entre le scénario de la profession et celui du Gouvernement, ou faut-il aller au-delà pour apprécier de façon plus fine les espoirs et les chances réelles de l'économie française ? Votre Rapporteur général ne peut manquer de relever que l'OFCE prend quelque distance avec les enchaînements mis en avant par la plupart des conjoncturistes. L'analyse du scénario de l'OFCE montre que cet organisme ne remet pas en cause la thématique du « cercle vertueux », même si, au final, le taux de croissance qu'il propose n'est pas très éloigné de la moyenne du panel. De même, il n'est pas indifférent de signaler que Natexis-Banques populaires envisage une croissance de 2,7% en France en 2002 et qu'un certain nombre d'organismes (le Bureau d'informations et de prévisions économiques, ou BIPE, le GAMA, le Crédit agricole et Morgan Stanley (5)) présentent un taux de croissance très proche de celui du Gouvernement. Enfin, il convient de remarquer que la moyenne générale du panel des économistes est, en fait, très influencée - dans un sens défavorable - par les prévisions les plus pessimistes. Cinq organismes prévoient une chute de la croissance française de 0,6 point en moyenne entre 2001 et 2002. Au contraire, neuf organismes prévoient une augmentation de 0,2 point en moyenne entre 2001 et 2002. L'AFEDE est « neutre », envisageant une stabilité de la croissance à 2,1% entre 2001 et 2002. Votre Rapporteur général relève donc que les prévisionnistes se séparent en deux groupes bien distincts : les « pessimistes » et les « sereins ». Mêler ces deux groupes en une même appréciation moyenne revient à brouiller les messages que chacun d'eux souhaite adresser à la communauté économique nationale. LES PESSIMISTES ET LES SEREINS
Comment interpréter le tableau ci-avant ? Votre Rapporteur général est tenté d'y voir un résumé des risques et des chances auxquels est confrontée l'économie française, au seuil de l'année 2002. Avec des prévisions sensiblement équivalentes (7), le Gouvernement et les « sereins » jugent que la France est bien armée pour faire face au ralentissement américain et surmonter, grâce à son dynamisme propre, les influences négatives de son environnement international : il s'agit là du scénario le plus probable. Les « pessimistes », pour leur part, rappellent que l'on ne peut exclure de voir une détérioration plus profonde de la conjoncture, même si ce scénario est moins probable. Par la voix de M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Gouvernement a fait savoir, le 18 septembre dernier devant la Commission des finances, qu'il avait choisi de faire preuve de mesure et de vigilance et qu'il serait prêt, le cas échéant, à apporter les adaptations nécessaires en laissant louer les stabilisations automatiques, en redéployant les crédits publics vers les mesures les plus adaptées au soutien de l'activité et de l'emploi et en favorisant une nouvelle baisse des taux d'intérêt au niveau européen. C'est donc lui aussi avec sérénité, même si elle s'accompagne de vigilance, que votre Rapporteur général accueille le cadrage macro-économique présenté par le Gouvernement à l'appui du projet de loi de finances pour 2002. EXTRAITS DES SCÉNARIOS MACRO-ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉS DEVANT LE GROUPE TECHNIQUE (septembre 2001)
(a) Taux de croissance annuelle, en %. (c) SMT : salaire moyen par tête. Taux de croissance, en %. (b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB. (d) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %. (e) En % du PIB. B.I.P.E. : Bureau d'informations et de prévisions économiques. REXECODE : Centre de recherches pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. C.D.C : Caisse des dépôts et consignations. G.A.M.A. : Groupe d'analyse macro-économique appliquée (CNRS et Université de Paris-Nanterre). O.F.C.E. : Observatoire français des conjonctures économiques. C.O.E. : Centre d'observation économique (Chambre de commerce et d'industrie de Paris). A.F.E.D.E : Association française des économistes d'entreprises. Expansion : Centre de prévision de L'Expansion. EXTRAITS DES SCÉNARIOS MACRO-ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉS DEVANT LE GROUPE TECHNIQUE (septembre 2001)
(a) Taux de croissance annuelle, en %. (b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB. (c) SMT : salaire moyen par tête. Taux de croissance, en %. (d) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %. (e) En % du PIB. II.- L'INCERTITUDE ACCRUE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL A.- UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL TRÈS DÉPENDANT DE L'ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE 1.- Un environnement international moins favorable a) L'affaiblissement de la croissance international et du commerce mondial L'affaiblissement de la conjoncture internationale, sous l'effet du ralentissement de l'économie américaine, a été constaté par le Fonds monétaire international (FMI), qui a ramené, en septembre dernier, avant les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, de 3,2% à 2,7% sa prévision (8) de croissance pour l'économie mondiale pour 2001. On rappellera que la prévision établie, pour cette année, en septembre 2000 était une croissance de 4,8%. Néanmoins, le FMI a anticipé un rebond en 2002 avec une croissance mondiale de 3,6%, grâce à l'amélioration de la croissance de l'économie américaine, qui s'élèverait à 2,5%. Cet affaiblissement entraîne une perte de dynamisme du commerce mondial, qui après une forte progression en 2000 (12,5%), n'augmenterait que de 2,5% en 2001, selon la Note de conjoncture internationale établie en juin 2001 par la direction de la prévision, soit un rythme très inférieur à la moyenne de long terme constatée entre 1980 et 1999, qui est de 6,1%. Soulignons que, ces données, déjà incertaines, le sont encore plus après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. b) Une forte correction des marchés financiers Après être passés par des maxima au cours de l'année 2000, à des périodes légèrement différentes, aux Etats-Unis le 11 janvier pour l'indice Dow Jones des valeurs traditionnelles et le 10 mars pour l'indice du marché des valeurs technologiques Nasdaq, le 12 mars pour l'indice Dax de la bourse de Francfort, le 12 avril pour l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo et le 4 septembre tant pour l'indice Footsie de la bourse de Londres que pour l'indice Cac 40 de la bourse de Paris, les grandes places financières ont fortement chuté. Avant les attentats du 11 septembre dernier, la diminution par rapport à ces maxima était de 18% pour l'indice Dow Jones, de 66,4% pour le Nasdaq, de 51% pour le Nikkei et de 36,7% pour l'indice Cac 40. L'ampleur et la durée de ces baisses, ainsi que leur synchronisation, ont conduit certains économistes, tels M. Christian de Boissieu, à les qualifier de « krach lent ». Cette forte correction des marchés financiers s'est effectuée dans une atmosphère de grande nervosité, marquée par une forte augmentation de la volatilité des cours ainsi que de la volatilité de l'évolution des indices au cours d'une même séance. On constate cependant d'importantes différences sectorielles. La meilleure résistance de l'indice Dow Jones provient de ce que l'essentiel de la baisse s'est concentré sur les valeurs technologiques, et d'une manière générale, sur les valeurs de la nouvelle économie, représentées par le Nasdaq aux Etats-Unis, et peu représentées dans le Dow Jones. Les indices des autres places financières sont plus composites. Si son origine ne peut être établie avec certitude, cette évolution a été alimentée, notamment à partir de l'automne 2000, par les premiers signes d'un retournement du cycle dans les nouvelles technologies de l'information et des communications, ainsi que par l'augmentation considérable du nombre d'avertissements sur profits, invalidant les anticipations et prévisions antérieures, il est vrai particulièrement optimistes. Elle s'est poursuivie en dépit des interventions répétées de la Réserve fédérale américaine dans la mesure où elle prend également en compte la situation des marchés financiers pour la fixation de ses principaux taux d'intérêt. La Réserve fédérale a ainsi procédé par sept fois, entre janvier et août 2000, à la modification de ces derniers (9). Lorsque l'on se reporte en arrière, cette correction n'est pas sans fondement dans la mesure où elle intervient après une très forte augmentation des cours entre 1995 et les maxima de l'année 2000. Si l'on s'en tient aux deux marchés américains, qui jouent le rôle de marchés directeurs dans un environnement financier largement synchrone, on constate, comme le montrent les graphiques suivants, que l'indice Dow Jones est passé de 6.000 points à l'automne 1997 à près de 12.000 points en janvier 2000 et l'indice des valeurs technologiques du Nasdaq d'un peu plus de 1.000 points à l'automne 1996 à près de 5.000 points, soit presque un quintuplement. ÉVOLUTION DE L'INDICE DOW JONES SUR CINQ ANS 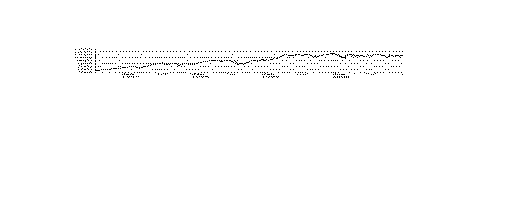 ÉVOLUTION DU NASDAQ SUR CINQ ANS 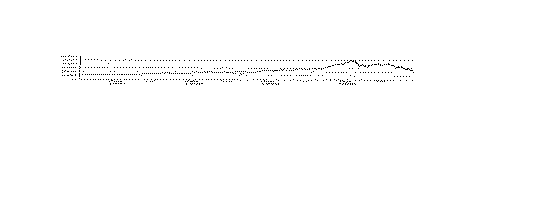 Le cycle de croissance qui s'est achevé l'an dernier s'est ainsi accompagné d'une forte progression des marchés d'actions, les fortes baisses intervenues à certains moments, notamment lors de la crise asiatique en 1997 ou de la crise russe en 1998, ayant été rapidement compensées. Une telle évolution ne pouvait s'avérer fondée que si les profits évoluaient, a posteriori, dans les mêmes proportions que les anticipations. Comme tel n'a pas été le cas, il y a eu un phénomène de bulle financière, particulièrement marquée sur les valeurs des nouvelles technologies et des sociétés liées à l'Internet (les « dot.coms »), cotées sur le Nasdaq et étudiées par M. Patrick Artus dans son ouvrage intitulé La nouvelle économie (La découverte, mars 2001). Ainsi, la capitalisation boursière des entreprises de nouvelles technologies, qui représentait moins de 5% du PIB américain au début de l'année 1995 a connu un pic à hauteur de 50% du PIB au début de l'année 2000, sous l'effet d'un important mouvement d'investissement. Les montants placés en capital risque sont passés de 3,3 milliards de dollars en 1990 à 104 milliards de dollars en 2000, avec une très forte accélération en fin de période puisqu'ils ne représentaient que 11,3 milliards de dollars en 1996. Ce phénomène de bulle sur les valeurs technologiques a d'ailleurs été observé sur l'ensemble des places financières, ainsi que le rappelle la Banque des règlements internationaux dans son 71e rapport annuel (1er avril 2000 - 31 mars 2001). Le coefficient de capitalisation des valeurs technologiques (le PER) est, en effet, passé, entre mars 1995 et mars 2000, de 34,5 à 120,8 en Suède, de 16,9 à 63,3 en Allemagne, de 11,3 à 63,8 en France, de 19,2 à 53,2 aux Etats-Unis, de 15,4 à 72,1 au Royaume-Uni et de 57,3 à 169,3 au Japon. Cet engouement a été d'autant plus marqué que le calendrier de financement des entreprises s'est accéléré, l'introduction en bourse intervenant beaucoup plus tôt qu'auparavant, que les investisseurs se sont dans l'ensemble trouvé démunis pour évaluer la valeur d'entreprises jeunes, déficitaires et aux perspectives de profits des plus incertaines, mais opérant dans des secteurs nouveaux susceptibles d'engendrer d'importants rendements qui constituaient la contrepartie d'un risque certain et que certains analystes et économistes ont cru déduire de l'importance des mutations en cours que l'on assistait à la fin des cycles économiques. Au-delà de ce phénomène, on peut, d'une manière plus générale, considérer que la forte croissance du prix des actions, sur l'ensemble des marchés financiers, a pu également être alimentée par plusieurs éléments : - la croissance de la proportion des ménages d'âge intermédiaire, composés de personnes nées pendant le baby boom (entre 40 et 60 ans), en situation d'épargner, ce qui a stimulé la demande d'actifs financiers ; - une certaine raréfaction de l'offre de titre, en raison de la politique des rachats d'actions par les entreprises ; - l'augmentation du nombre des fusions et acquisitions qui a non seulement raréfié le nombre de titres, mais également suscité d'importants espoirs quant à la rentabilité des nouveaux groupes ainsi constitués ; - la pression des fonds de pension, dont les exigences en termes de rentabilité, avec un taux de retour sur investissement de 15%, ont pu donner l'impression d'une nouvelle ère où le rendement des actifs serait durablement supérieur aux niveaux constatés antérieurement, alors que ces taux de rentabilité sont de toute évidence incompatibles avec le constat selon lequel les profits évoluent à long terme comme le PIB. On peut en outre considérer que ces phénomènes ont pu être alimentés, aux Etats-Unis, c'est à dire sur les marchés directeurs, pour les particuliers, par l'accroissement du crédit, puisque celui-ci est accordé aux Etats-Unis sur la base du patrimoine et non du revenu, et cela d'autant plus que la politique monétaire américaine a été particulièrement accommodante lors de la correction de 1998 consécutive à la crise russe, baissant par trois fois de 25 points de base son taux directeur, qui est ainsi passé de 5,25% le 28 septembre 1998 à 4,75% le 17 novembre. Le débat sur la portée réelle d'une telle correction boursière reste cependant très ouvert. Les incidences de cette correction sur l'économie réelle appellent plusieurs observations. En ce qui concerne les ménages, s'il est clairement apparu lors de la phase de forte croissance des marchés financiers que l'effet de richesse lié à la croissance des actifs détenus directement par les particuliers se traduisait par une augmentation de la consommation, il semble que l'on assiste au phénomène inverse, notamment aux Etats-Unis où le rythme de progression de la consommation, même s'il est resté favorable, s'est néanmoins réduit. En outre, la Banque des règlements internationaux a pu constater que, depuis 1998, l'évolution du Nasdaq était un élément qui pesait plus que le taux de chômage dans l'indice de confiance des consommateurs américains (71e rapport annuel). S'agissant des entreprises, l'hypothèse d'un impact direct sur l'investissement a été avancée. Le produit brut des introductions sur les quatre principaux marchés, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Japon est, en effet, passé de 49 milliards de dollars au premier trimestre 2000 à 29 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon la Banque des règlements internationaux (71e rapport annuel). Cette institution considère que ce phénomène a pu empêcher ou pour le moins retarder l'accès des entreprises nouvelles ou start up aux ressources nécessaires au financement de leurs investissements. L'OCDE fait un constat similaire, s'agissant des émissions d'obligations à haut risque, tout en observant que celles-ci ont repris fortement au cours des premiers mois de 2001 (10). Par ailleurs, la Banque des règlements internationaux observe, en ce qui concerne les entreprises américaines, que la chute des cours peut se traduire par un déficit financier des régimes de retraites qui leur sont liés, ce qui aggrave leurs charges, ainsi que par une augmentation de leurs impôts due à la baisse des déductions opérées lors de l'exercice de leurs options par les salariés bénéficiaires d'un programme d'attribution d'actions (stocks options). c) Une évolution cependant favorable des cours des produits de base · La régularisation des cours du pétrole L'évolution des prix du pétrole, qui a fortement augmenté en 1999 et en 2000, après avoir connu une chute spectaculaire en 1998, a constitué l'une des préoccupations majeures de la période de préparation et d'examen de la loi de finances pour 2000. Tel n'est pas le cas cette année, pour l'instant tout au moins, dans la mesure où la politique de l'OPEP, fondée sur un contrôle de l'offre afin de maintenir les cours à l'intérieur d'une fourchette de 22 à 28 dollars le baril, avec un cours cible situé à 25 dollars le baril, a atteint ses objectifs. Après un pic à 32,4 dollars le baril en novembre 2000, le cours du « brent daté » (11) qui fait référence a baissé à 25,6 dollars le baril en décembre et s'est maintenu depuis entre 24,5 et 28,4 dollars le baril, en moyenne. Cette stabilisation des cours du pétrole résulte directement de la réduction de la production de l'OPEP, à concurrence de 2,5 millions de barils par jour, destinée à éviter que la baisse de la demande consécutive au ralentissement de l'économie mondiale ne conduise, comme il y a trois ans, en 1998, à un effondrement des cours. L'OPEP est apparue attentive au maintien de l'équilibre qu'elle a défini. Ainsi, lors de l'interruption des livraisons de pétrole par l'Irak à la fin du printemps, elle a garanti l'approvisionnement du marché, ce qui a évité toute flambée des prix. Pour la France, le principal facteur de variation du prix du pétrole a été le cours relatif du dollar exprimé en euros. Ainsi, le cours du baril de « brent daté » est passé de 179,5 francs en janvier 2001 à 212,3 francs en juin, soit une progression de 18,3%, alors que le cours exprimé en dollars ne progressait que de 7,8%. · Les produits de base non pétroliers La contraction de l'activité industrielle dans les principales économies s'est accompagnée d'une baisse des cours des matières premières et produits de base, depuis l'automne 2000. Exprimés en devises, on observe l'évolution suivante pour les principaux indices recensés par l'INSEE (base 100 pour l'ensemble de l'année 2000) : - une réduction de 104,1 à 88,1 de l'indice des cours de minerais, entre septembre 2000 et juillet 2001, avec une légère augmentation pour le fer (de 100 à 104,4), mais une forte réduction pour les métaux non ferreux, de 105,3 à 86,1 ; - une chute, sur la même période, de 99,1 à 94 de l'indice des produits alimentaires, indice très inférieur à son maximum de 1997 (180) ; - une diminution de l'indice des matières premières agricoles non alimentaires (produits agricoles à usage industriel, tels que les fibres et le caoutchouc), qui est passé de 103,4 en septembre 2000 à 88,5 en juillet dernier, malgré une forte augmentation du prix du cuir, dont l'indice est passé de 94,9 en juillet 2000 à 112,6 en juillet 2001, avec un pic à 134,3 en avril à la suite de la réduction de la production consécutive à l'élimination des bovins prévue dans le cadre du plan de lutte contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni. Au plan mondial, il faut cependant rappeler que l'évolution à la baisse des prix des produits de base est toujours ambiguë, dans la mesure où elle se traduit par une perte de recettes pour les économies productrices, notamment les économies en développement des pays les moins avancés. 2.- Un ralentissement de l'économie américaine anticipé depuis longtemps, mais d'une ampleur plus prononcée que prévu et d'une durée incertaine a) Un ralentissement marqué de l'activité en 2000 Depuis plusieurs années, la plupart des économistes s'attendaient à un ralentissement de l'économie américaine et une inversion du niveau de la croissance entre les Etats-Unis et l'Europe. Leurs anticipations se sont révélées fausses tant pour l'année 1999 que pour l'année 2000, avec des taux de croissance de 4,1% pour chacune des deux années aux Etats-Unis (il s'agit des derniers chiffres, révisés, publiés par le Bureau of economic analysis le 29 août dernier) et de respectivement 2,4% et 3,4% pour la zone euro. Néanmoins, leur pronostic final s'est révélé exact puisqu'une forte chute du taux de croissance est intervenue aux Etats-Unis au cours du deuxième semestre 2000, achevant ainsi par une rupture marquée le cycle de croissance le plus long depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale. La croissance du PIB américain ne s'est établie qu'à 0,3% au troisième trimestre 2000 et à 0,5% au dernier trimestre 2000, soit un rythme de progression très inférieur à ceux des périodes précédentes : 0,8% au premier trimestre 2000 et 1,3% au deuxième trimestre. Cette évolution s'est aggravée au début de l'année 2001, l'activité n'ayant crû que de 0,3% au premier trimestre et de 0,05% au deuxième trimestre, soit respectivement 1,3% et 0,2% en rythme annualisé. Les différentes composantes de la demande privée se sont affaiblies, d'une manière cependant moins marquée pour la consommation, qui reste dynamique, que pour l'investissement des entreprises, en forte chute. Les entreprises américaines ont procédé à des investissements massifs au cours de la dernière décennie. Le rythme de progression de la formation brute de capital fixe du secteur privé, hors investissements résidentiels, a été en moyenne de 10% par an de 1993 à 1999 et a oscillé entre un minimum de 8,4% en 1993 et un maximum de 13% en 1998. Ces entreprises ont sensiblement moins investi à partir du deuxième semestre de l'année 2000, révisant ainsi à la baisse leurs programmes d'équipement. L'évolution des dépenses d'équipement et de logiciel a, en effet, marqué le pas dès le troisième trimestre 2000, avec une augmentation de 1,2%, soit 4,7% en rythme annualisé, caractéristique d'une période de transition, car inférieur aux taux fort élevés des deux trimestres précédents : + 4,5% au premier trimestre 2000, soit une progression de + 18,1% en rythme annualisé, et 4,1% au deuxième trimestre 2000, soit + 12,4% en rythme annualisé. Cet ajustement à la baisse a été particulièrement violent, puisque la diminution a été de 0,25% au quatrième trimestre 2000 (1,1% en rythme annualisé), puis de 1,25% au premier trimestre 2001 (4,1% en rythme annualisé) et de 3,8% au deuxième trimestre (15,1% en rythme annualisé). S'agissant des constructions des entreprises, la baisse est plus tardive puisqu'elle ne serait intervenue qu'au deuxième trimestre 2001, avec une baisse de 3,35%, soit 3,4% en rythme annualisé. Les entreprises ont également procédé à un ajustement de leurs stocks, dans des délais rapides. A l'augmentation de 42,8 milliards de dollars intervenue au dernier trimestre 2000, ont succédé une diminution de 27,1 milliards de dollars au premier trimestre 2001 et de 38,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit un effet de l'ordre de 0,4 point PIB sur cette dernière période. Les investissements en logement, orientés à la baisse au cours de l'année 2000, avec une diminution de 0,5%, sont en revanche repartis à la hausse, avec une progression de 2,1% au premier trimestre 2001 (+ 8,5% en rythme annuel) et de 1,5% (5,8% en rythme annualisé) au deuxième trimestre, révélateur d'un certain boom immobilier vraisemblablement temporaire dont il faut reconnaître qu'il est assez paradoxal dans un contexte de réduction de l'activité économique et de diminution de l'emploi. S'agissant de la consommation, celle-ci a connu un affaiblissement certain, avec une évolution en retrait par rapport aux taux de progression très élevés de ces dernières années, mais reste néanmoins dynamique. On observe, en effet, une progression de 0,7% au premier trimestre 2001, soit 3% en rythme annualisé, et de 0,6% au second trimestre, soit 2,5% en rythme annualisé. Ces taux sont inférieurs à ceux de l'année 2000, qui était de 4,8%, comme à celui de 1999, à raison de 5%. Enfin, la demande extérieure s'est également affaiblie, les exportations diminuant car handicapées par le niveau très élevé du dollar ainsi que par le ralentissement économique dans les autres parties du monde. Les exportations de biens ont ainsi chuté, en rythme annualisé, de 6,9% au quatrième trimestre 2000, de 2,4% au premier trimestre 2001 et de 17,4% au deuxième trimestre. Le déficit des échanges de biens tend d'ailleurs à s'aggraver puisque la diminution des importations a été moins importante, avec respectivement 0,6%, 6,7% et 9,7% au cours des mêmes périodes. Sur le plan sectoriel, les évolutions sont contrastées. Le moindre dynamisme de la consommation concerne essentiellement les matériels informatiques et le secteur automobile. La chute des investissements a particulièrement affecté le secteur des nouvelles technologies, sur lequel s'est concentrée une majeure partie de l'effort d'équipement ces dernières années. On observe ainsi une très grande différence entre le secteur des biens et celui des services. Le secteur industriel est entré en récession, avec un recul dès le dernier trimestre de l'année 2000, récession assez longue puisqu'elle n'est pas achevée. La production industrielle a reculé de 0,2% au quatrième trimestre 2000, puis de 1,7% au premier trimestre 2001 et de 1,1% au deuxième trimestre. Cette tendance ne semble pas se résorber au troisième trimestre avec un recul de 0,1% en juillet et de 0,8% en août. C'est donc la bonne tenue de la consommation des ménages et la persistance d'une certaine croissance dans le secteur des services qui expliquent le maintien d'une certaine progression du PIB aux Etats-Unis au cours du premier semestre 2001 et l'absence de récession d'ensemble, à la différence des retournements de cycles précédents. En conséquence de ces évolutions, on observe une dégradation de la situation de l'emploi, corroborant l'impression résultant des annonces, fortement médiatisées et nombreuses, de plans de licenciement, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, de l'électronique, des composants, de l'informatique et de l'automobile. Ces plans de réduction d'effectifs font d'ailleurs l'objet d'une attention d'autant plus grande qu'ils concernent non seulement les sites américains, mais également les établissements étrangers des entreprises américaines. Le taux de chômage, qui a connu un minimum de 3,9% en octobre 2000, est remonté à 4,5% depuis le mois d'avril 2001, puis après une période de stabilité, a de nouveau fortement progressé, passant de 4,5% en juillet à 4,9% en août. L'emploi total, qui a atteint un pic à 135,99 millions en janvier 2001, s'est établi à 134,39 millions en août 2001. Les programmes de licenciements prévus n'ayant pas encore produit leurs effets, on peut anticiper encore une augmentation du chômage aux Etats-Unis dans les mois qui viennent. Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie a, par ailleurs, fortement chuté, passant de 84,9% en septembre 2000 à 76,2% en août 2001. La chute est encore plus spectaculaire dans les secteurs liés à la nouvelle économie, avec un taux d'utilisation des capacités de production de 65% au deuxième trimestre 2001 contre 90% un an plus tôt. Sur le plan conjoncturel, l'affaiblissement des composantes de la demande est attribué, par la Note de conjoncture internationale établie par la Direction de la prévision en juin 2001, d'une part, à la forte augmentation du taux directeur de la Réserve fédérale, intervenue entre l'été 1999 (le taux a été porté de 4,75% à 5% le 30 juin) et le printemps 2000, avec un taux relevé, une dernière fois, de 6% à 6,50% le 16 mai 2000, pour prévenir les risques inflationnistes issus de la vigueur excessive de la demande, d'autre part, à la hausse des prix du pétrole, qui a pesé sur le pouvoir d'achat et la profitabilité des entreprises, soit un contexte favorable au repli des marchés boursiers, amorcé dès janvier 2000 pour les valeurs traditionnelles représentées dans l'indice Dow Jones et en mars 2000, après un maximum le 10 mars, pour les valeurs technologiques et de la nouvelle économie cotées sur le Nasdaq, comme au resserrement des conditions d'accès au crédit. Dans ses perspectives économiques précitées (12), l'OCDE indique, d'une manière complémentaire à ces éléments, que « la longue période de forte expansion des investissements dans les technologies de l'information et des communications (TIC) semble s'être traduite, pour bon nombre d'entreprises, par des dépenses excessives » et que « cela a entraîné à son tour une révision à la baisse des prévisions de profits, une baisse du prix des actions, des compressions d'effectifs et des licenciements. » Le retournement serait ainsi le résultat d'un cycle d'investissement. Cette hypothèse est corroborée par les études économétriques du service de recherche de la Caisse des dépôts et consignations (13). b) Une absence de rebond en 2001 qui permet de mesurer l'importance des nouvelles technologies comme facteur de croissance et, surtout, de compensation des nombreux déséquilibres de l'économie américaine D'abord prévu pour le premier trimestre 2001 par la plupart des économistes, le rebond de l'économie américaine ne s'est pas encore produit, ce qui a conduit à écarter l'hypothèse d'un simple « trou d'air » et à s'interroger sur les enjeux d'un prolongement de la situation actuelle de faible croissance. L'exceptionnelle croissance des années 1992 à 2000 apparaît avant tout comme le résultat d'un cycle sectoriel résultant de l'effort massif d'investissement dans les nouvelles technologies, suivant les mécanismes très clairement mis en lumière par M. Patrick Artus (14). Ces mécanismes sont les suivants : - le développement d'un nouveau secteur, celui de la « nouvelle économie » ou des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), qui recouvre plusieurs activités : la fabrication des matériels informatiques, électroniques et de communication ; la fabrication des composants électroniques ; les activités de création des sites Internet ; la réalisation de logiciels ; les services liés (conseil, télécommunication, services informatiques, traitement de données) ; la commercialisation de ces équipements. La part des technologies de l'information et de la communication dans le PIB américain est ainsi passée de 6,2% en 1990 à 8,2% en 1998 ; - un taux d'investissement productif très élevé. Celui-ci a fortement augmenté aux Etats-Unis, passant de 6% en 1992 à près de 12% en 2000, essentiellement sous l'effet des investissements informatiques (micro-ordinateurs, réseaux), ce qui a entraîné une croissance du stock de capital d'environ 6% par an ; - une progression de cet effort d'investissement tout au long du cycle, le taux d'investissement des entreprises en nouvelles technologies passant de 1,6% du PIB en 1990 à 2,7% en 1995 puis à 3,1% en 2000. Cette progression a été largement facilitée par la baisse du prix des équipements et matériels concernés ; - un haut niveau de dépenses de recherche et de développement, dans le secteur des nouvelles technologies, qui représentait 0,8% du PIB américain en 1997 contre 0,37% pour la France ; - une augmentation du rapport entre le capital et l'emploi, mesurée à environ 3,5% par an, le capital croissant beaucoup plus vite que l'emploi. Ce renforcement de l'intensité capitalistique a entraîné une forte progression des gains de productivité du travail, qui sont passé de 1% en 1996 à presque 4% à la mi-2000, en rythme annuel ; - une bonne maîtrise des coûts salariaux, les coûts unitaires de main d'_uvre dans le secteur des entreprises ayant progressé de 2,5% en 1998, 1,6% en 1999 et 1% en 2000, selon l'OCDE, et le taux de salaire réel ayant progressé moins vite que la productivité du travail, sauf du début de l'année 1997 au milieu de l'année 1998, comme l'indique le graphique ci-joint ; EVOLUTION EN % DE LA PRODUCTIVITÉ ET DU SALAIRE RÉEL 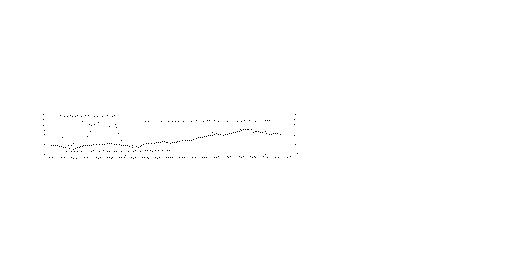 Source : La nouvelle économie - La découverte, mars 2001 - de M. Patrick Artus. - mais aussi une diminution de la productivité du capital, de l'ordre de 1,75% par an, diminution inéluctable puisque le capital a augmenté beaucoup plus vite que le PIB. Une comparaison avec les précédents cycles de croissance de l'économie américaine montre que c'est l'importance de cet effort d'investissement, et de ses incidences sur les gains de productivité du travail, lesquels n'ont pas faibli en fin de cycle, qui est à l'origine de ce cycle d'expansion aussi long sans tension inflationniste majeure. Trois autres facteurs complémentaires ont également joué, selon M. Patrick Artus : l'absence de tensions inflationnistes au niveau mondial en raison de la faiblesse de la croissance européenne en début de cycle, des conséquences de la crise asiatique en 1997 et des crises russe et latino-américaine en 1998 ; une combinaison favorable de la politique monétaire et de la politique budgétaire aux Etats-Unis, la résorption du déficit budgétaire, puis l'apparition d'excédents permettant de maintenir une politique monétaire expansionniste, avec un taux d'intérêt réel à court terme oscillant autour de 3% à partir de 1994, soit un taux inférieur à celui de la croissance ; une évolution particulièrement favorable du taux de change, avec une dépréciation réelle du dollar de 1992 à 1996, puis une appréciation à partir de 1996, ce qui aide à contenir les tensions inflationnistes. La question clef est celle de la durée des mécanismes à la base de ce cycle de croissance : s'agit-il seulement d'un cycle d'investissement correspondant à une innovation technologique qui entraîne un supplément de croissance de plusieurs années, certes, mais transitoire, pendant la seule phase d'investissement à l'origine duquel il se trouve ? Est-on, au contraire, en présence d'un cycle technologique de long terme, qui entraîne un bouleversement en profondeur de l'ensemble de l'économie et s'accompagne d'une accélération durable de la croissance, le supplément de croissance persistant une fois que l'effort d'investissement a cessé. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la nouvelle économie s'accompagne d'une véritable mutation, caractérisée par une capacité à provoquer une augmentation de la productivité globale des facteurs dans l'ensemble de l'économie. Les données disponibles en 2000 ne permettaient pas d'affirmer cette hypothèse, puisque l'on constatait une augmentation de la productivité globale des facteurs dans le seul secteur de l'informatique. Néanmoins, elles ne pouvaient pas non plus l'exclure. La révision à la baisse, en août 2001, des chiffres de la croissance américaine pour la période 1998-2000 constitue un élément plutôt défavorable à l'hypothèse de l'entrée dans un cycle long de progrès technologique, car elle entraîne mécaniquement une révision à la baisse de la productivité. Cette révision ne permet cependant pas d'écarter d'une manière définitive cette hypothèse d'une transformation en profondeur de l'économie américaine. La question est en fait celle de l'apport que représente Internet pour le fonctionnement de l'économie et des entreprises, ainsi que de la rapidité de diffusion de cet apport dans l'ensemble des secteurs économiques.. C'est, en définitive, de la réponse à cette question que dépend la capacité de l'économie américaine de renouer rapidement avec une très forte croissance. Cet élément est d'autant plus important que le dernier cycle de croissance s'est accompagné d'importants déséquilibres dont la compensation dépend directement du dynamisme des entreprises américaines. Celle-ci conditionne, en effet, la capacité des entreprises et des ménages à supporter sans difficulté le poids des dettes qu'ils ont contractées, ainsi que, en grande partie, le financement de l'important déficit des paiements courants. _ Le premier déséquilibre que l'on peut observer dans les développements récents de l'économie américaine est celui d'un éventuel conflit dans le partage de la valeur ajoutée entre les salaires et les profits. Ainsi que l'observe M. Patrick Artus dans son ouvrage précité, si la nouvelle économie exige un renforcement continu de l'intensité capitalistique, elle peut entraîner une baisse de la profitabilité. La part des coûts salariaux ne peut en effet être réduite, comme le montre l'expérience des années passée où le ratio des coûts salariaux dans la valeur ajoutée est passé par un minimum de 46% en 1994 avant de remonter au-dessus de 48% en 1999, puis de redescendre un peu. Si la productivité globale des facteurs augmente fortement, en revanche, la tension pour le partage de la valeur ajoutée est moins forte et la rentabilité du capital peut être mieux préservée, ce qui réduit les risques de forte correction financière en cas de modification des anticipations. La question est d'autant plus importante que les deux acteurs économiques concernés, les entreprises comme les ménages, sont fortement endettés. _ Le deuxième déséquilibre tient à l'augmentation considérable de l'endettement du secteur privé, celui des ménages comme des entreprises. Le solde financier du secteur privé est négatif aux Etats-Unis depuis 1996. Pour 2000, le besoin de financement du secteur privé est de l'ordre de 6% du PIB, alors qu'en 1991, la capacité de financement du secteur privé en représentait un peu moins de 6%. Cette mutation est d'autant plus importante que, simultanément, les administrations publiques américaines ont dégagé une capacité de financement depuis 1998. L'augmentation du crédit au secteur privé s'est constamment accrue et a même atteint une progression de 10% en 2000. S'agissant des entreprises, on observe que la progression de l'endettement ne représente pas, pour l'instant, une menace. En effet, si la dette du secteur des entreprises non financières, qui représentait moins de 500% de la trésorerie des entreprises en 1996 et 1997, est progressivement remontée à un niveau supérieur à 600% en 2000, soit un niveau un peu comparable à celui de 1989, mais inférieur au pic de 1990, avec 650%, le faible niveau des taux d'intérêt fait que la charge des intérêts n'a jamais été aussi faible depuis le milieu des années 1970. Elle représente actuellement moins de 20% de la trésorerie, même si cette proportion a légèrement augmenté depuis le début de l'année 1999. De plus, l'envolée des cours des actifs fait que le rapport de la dette et du capital estimé au prix du marché, est restée assez faible, à raison de 40% en 2000, contre 90% en 1990. Néanmoins, cet indicateur dépend fortement de la valorisation des actifs. Il était de 30% à la fin de l'année 1999. En ce qui concerne les ménages, leur taux d'épargne est faible, de l'ordre de 2,2% en 1999 et 0% en 2000, selon l'OCDE, alors qu'il était encore de 4,8% en 1996. La dette des foyers américains est passée de 85% du revenu disponible en 1992 à plus de 105% en 2000, signe d'une tendance de long terme à l'augmentation de l'endettement domestique. La charge du service de cette dette, qui était de 12% à la fin de l'année 1992, s'est élevée à 14,35% au premier semestre 2000, selon la Réserve fédérale. Cette augmentation est, en presque totalité, liée au développement du crédit à la consommation, au service duquel les ménages américains ont affecté 7,91% de leur revenu disponible au premier semestre 2001, contre 6% à la fin de 1992. C'est donc le développement du crédit à la consommation dont l'encours est passé de 782 milliards de dollars en septembre 1992 à un maximum de 1.591 milliards de dollars en mai 2001, et non la croissance des revenus, qui explique l'appétence des foyers américains pour la consommation ces dernières années. Néanmoins, on peut considérer que la situation financière des ménages américains n'est pas dramatique dans la mesure où le crédit hypothécaire représente la majeure partie (70%) de la dette : le rendement de l'immobilier, caractérisé par une hausse modérée des prix au cours de la dernière décennie, à l'exception de la région de San Francisco, reste positif. _ Le troisième déséquilibre est celui du déficit des échanges extérieurs et des paiements courants des Etats-Unis. Le déficit de la balance commerciale a fortement progressé, selon l'OCDE, de 96,1 milliards de dollars en 1992 à 449,5 milliards de dollars en 2000, soit 4,5% du PIB. La croissance du solde, positif, des services, qui est passé de 60,4 milliards de dollars en 1992 à 81 milliards de dollars en 2000, n'ayant pas été suffisante pour compenser cette aggravation et le solde des revenus d'investissement, traditionnellement positif, étant, en outre, devenu négatif à partir de 1998 (- 6,2 milliards de dollars en 1998 et - 13,7 milliards de dollars en 2000), le solde déficitaire des opérations courantes est passé de 0,8% du PIB en 1992 à 4,4% en 2000. La dégradation a été particulièrement marquée au cours des trois dernières années de la dernière décennie, puisqu'il s'établissait encore à 1,7% en 1997. Ce déficit commercial s'explique aisément sur le plan macro-économique puisque lorsque l'investissement croît plus vite que le PIB, l'ajustement des grands équilibres se fait soit sur la dépense publique, soit sur la consommation, qui stagne ou qui diminue, soit sur le commerce extérieur, avec une baisse des exportations ou une augmentation des importations. Or, comme on l'a vu, l'économie américaine a connu ces dernières années une demande intérieure dynamique tant pour l'investissement que pour la consommation. L'aggravation du déficit des opérations courantes ne s'est pas traduite par un affaiblissement du dollar, dans la mesure où, comme l'observe la Banque des règlements internationaux dans son 71e rapport annuel (1er avril 2000-31 mars 2001), « les entrées nettes au titre de l'investissement direct étranger et des flux de portefeuille à long terme se sont accrues parallèlement à l'aggravation du déséquilibre des transactions courantes au cours de trois dernières années ». Ainsi, alors que le déficit courant était de 217 milliards de dollars en 1998, 331 milliards de dollars en 1999 et 435 milliards de dollars en 2000, les flux nets d'investissements directs se sont respectivement établis à 174 milliards de dollars, 338 milliards de dollars et 487 milliards de dollars. L'importance des investissements étrangers a été le résultat des nombreux investissements directs des entreprises, notamment des entreprises européennes, sur le marché américain, comme des opérations de portefeuille des investisseurs, ceux de la zone euro entre autres. En effet, le flux net d'investissements directs et d'investissements en portefeuille de la zone euro a été négatif de 1998 à 2000, avec un déficit de 218 milliards de dollars en 1998, 166 milliards de dollars en 1999 et 144 milliards de dollars en 2000. Ces investissements ont été fondés sur l'anticipation d'un potentiel de croissance supérieur tant pour l'ensemble de l'économie américaine que pour les entreprises situées aux Etats-Unis. Ce flux d'investissements, directs ou en portefeuille, n'est d'ailleurs pas sans lien avec la forte progression des marchés financiers américains, mentionnée plus haut. A la fin de l'année 2000 et au début de l'année 2001, le ralentissement des flux d'investissement direct aux Etats-Unis a été compensé par une forte augmentation des investissements en portefeuille. Ce flux ne peut se maintenir que si les investissements qui sont la contrepartie de ces titres sont rentables, ce qui est étroitement lié aux perspectives de croissance de l'économie américaine. c) Une politique macro-économique accommodante tant sur le plan budgétaire que monétaire, qui offre des perspectives de reprise mais ne lève pas toute incertitude sur la date et l'ampleur de cette reprise Après avoir procédé à sept réductions du taux directeur des fonds fédéraux, qui est passé de 6,5% en décembre 2000 à 3,5% le 21 août dernier, la Réserve fédérale américaine a procédé, postérieurement au 11 septembre, à deux réductions supplémentaires, l'une le 17 septembre, de 3,5% à 3%, l'autre le 2 octobre dernier, de 3% à 2,5%. A raison d'une diminution de 50 points de base (0,5%) sur un rythme presque mensuel de janvier à mai, les 3 janvier 2001, 31 janvier, 20 mars, 18 avril, les 15, suivie de deux réductions de 25 points de base, l'une le 27 juin, l'autre le 21 août, et de deux nouvelles réductions de 50 points les 17 septembre et 2 octobre, l'effort de réduction du coût du crédit est l'un des plus importants auquel n'ait jamais procédé la Réserve fédérale, pour soutenir tant l'investissement que la consommation. Cette politique a pu être menée grâce à l'absence de déficit budgétaire, qui a réduit les problèmes de concurrence entre le secteur privé et le secteur public pour l'accès au crédit, et à la réduction des risques inflationnistes. L'évolution générale des prix américains est en effet restée sous contrôle, le déflateur de la consommation privée s'établissant à 1,1% en 1998 et 1,8% en 2000. Pour l'année 2001, les tendances inflationnistes consécutives à l'augmentation des prix de l'énergie et à une reprise de l'inflation sous-jacente ont commencé à diminuer au second semestre. Ainsi, l'indice des prix à la consommation établi par le département du travail hors énergie et alimentation a progressé de 0,2% en juillet, soit une augmentation des prix de 2,7% depuis juillet 2000. Sur le plan budgétaire, la nouvelle administration a pris deux initiatives essentielles : une baisse des impôts acquittés par les ménages et une augmentation des crédits militaires. En ce qui concerne les impôts, le Congrès a adopté un plan de baisse des impôts d'un montant total de 1.348 milliards de dollars sur dix ans, qui concerne pour l'essentiel les ménages et se traduit, cette année, par une remise rétroactive d'impôt versée aux contribuables entre juillet et septembre, au titre de la réduction de 15% à 10% du taux de la première tranche, pour un montant total de 38 milliards de dollars, ainsi que par des allégements d'impôt complémentaires pour un montant de 3 milliards de dollars. Ces mesures devraient accroître le revenu disponible brut des ménages de 0,4 point de PIB en 2001 et de 0,6 point de PIB en 2002. En ce qui concerne les dépenses, la perspective développée par la nouvelle administration américaine était la création d'un bouclier anti-missile. Le montant de la dépense, même partiellement gagé par la réduction de certaines dépenses militaires, a donné lieu à un vif débat, d'autant plus difficile que les mesures fiscales et l'affaiblissement de la croissance ont réduit de 275 milliards (15) de dollars à 135 milliards de dollars l'excédent du budget fédéral pour l'exercice 2001. A la suite des attentats du 14 septembre, il est clair que la sensibilité et l'opinion publiques ont changé sur les questions de sécurité et sur la question du niveau du déficit budgétaire. L'adoption par le Congrès d'une aide d'urgence de 40 milliards de dollars a montré que les paramètres relatifs au niveau souhaitable du déficit budgétaires n'étaient plus les mêmes. En outre, après des années d'évolution de la consommation publique inférieure à celle du PIB, à raison, selon l'OCDE, de 1,5% contre 4,4% en 1998, 2,1% contre 4,2% en 1999 et 2% contre 5% en 2000, avec un solde financier positif pour les administrations publiques, avec 0,3 point de PIB en 1998, 1 point en 1999 et 2,2 points en 2000, ainsi qu'avec une dette publique qui est passée de 75,8% du PIB en 1993 à 58,8% en 2000, l'administration américaine se trouve dans une situation exceptionnellement favorable à l'intervention budgétaire. S'il est vrai que la réduction des taux d'intérêt diminue le coût du crédit, elle n'affecte que l'un des éléments de l'investissement dont la motivation est de toute évidence complexe. Faute de besoins d'investissements nouveaux justifiés par de solides perspectives, notamment sur des secteurs ou des produits nouveaux, la baisse du coût du crédit, si elle intervient à un moment où ce n'est pas l'insuffisance de liquidité qui nuit à la croissance, peut conduire à des comportements d'investissements purement financiers susceptibles d'engendrer des bulles sur le prix des actifs, et cela d'autant plus que des activités non rentables sont maintenues grâce à la réduction artificielle du coût du capital. Dans ce climat d'incertitude, l'économie américaine dépend essentiellement de l'évolution de la consommation, seule composante de la demande qui ait soutenu l'activité au cours du premier semestre 2001 et de l'efficacité de la politique budgétaire de l'administration Bush, dans la mesure où les conditions monétaires ne sauraient faire obstacle à la croissance. Dans l'ensemble, les prévisions établies avant les attentats du 11 septembre étaient plutôt optimistes. Le Fonds monétaire international avait maintenu, au début de septembre dernier, sa prévision de croissance à 1,5% en 2001 pour l'économie américaine et à 2,5% pour 2002, soit un retour rapide à un niveau de croissance acceptable (16). 3.- L'économie japonaise toujours soumise à des tendances déflationnistes Le Fonds monétaire international a ajusté à la baisse sa prévision de croissance pour le Japon, en 2001. Alors qu'il anticipait une très modeste croissance de 0,6% en avril, il a prévu en septembre une récession, avec une évolution négative, de 0,2% du PIB. Le PIB japonais a, en effet, reculé de 0,8%, en rythme annualisé, au deuxième trimestre, après une très modeste progression de 0,1% au premier trimestre. La production industrielle est en baisse depuis mars 2001, avec notamment une diminution de 0,5% en avril, 0,3% en mai, 0,2% en juin et 0,7% en juillet. Cette incapacité du Japon de renouer avec la croissance et à corriger d'importantes tendances déflationnistes est d'autant plus préoccupante qu'elle est durable. La faible croissance de l'année 2000 a, en effet, clôturé, compte tenu de l'atonie de l'économie japonaise depuis l'effondrement de la croissance en 1991, comme le rappelle le tableau suivant :
On observe toutes les composantes d'une tendance dépressive au sein de l'économie japonaise. La consommation privée stagne depuis plusieurs années, avec des taux de croissance de 0,1% en 1998, 1,2% en 1999 et 0,5% en 2000. Les taux de croissance de 0,6% au premier trimestre 2001 et de 0,5% au deuxième trimestre montrent que l'atonie persiste. L'investissement non résidentiel, qui a connu un net regain en 2000, en raison notamment des nouvelles technologies, avec une croissance de 4,4% en rupture avec les évolutions négatives de 1998 (- 2,3%) et de 1999 (- 4,2%), est à nouveau en baisse, à raison d'une diminution de 0,9% au premier trimestre 2001 et de 2,8% au deuxième trimestre. L'investissement en logement, qui avait légèrement repris en 1999 (+ 1,1%) et en 2000 (+ 1,5%), après une année 1998 très négative (- 13,7%), est à nouveau en baisse avec une chute, en rythme trimestriel, de 4,8% au premier trimestre et de 8,8% au deuxième trimestre. Les exportations, qui avaient subi une chute en 1998 à la suite de la crise asiatique de 1997 (- 2,4%), avant de connaître une reprise en 1999 (+ 1,4%) et surtout en 2000 (+ 12%), sont à nouveau en diminution, de 3,4% au premier trimestre 2001 et de 3,7% au deuxième trimestre. D'un point de vue sectoriel, la production du secteur des technologies de l'information et de la communication, qui avait connu une expansion en 1999 et en 2000, a décliné dès le deuxième semestre 2000, en raison d'un recul des exportations. Les nouvelles technologies ont donc été le vecteur de la transmission au Japon des difficultés de l'économie américaine et ont aggravé les difficultés de l'économie nippone. Sur le plan financier, la bourse de Tokyo a suivi le mouvement général des bourses depuis 1999. Après avoir fortement progressé en 1999, l'indice Nikkei passant de 13.000 points en début d'année à 21.000 points en mars 2000 a fortement chuté depuis, puisqu'il se situe autour de 10.000 points. L'économie japonaise est, en outre, loin de s'être départie de ses tendances déflationnistes ces derniers mois, puisque les économistes anticipent pour le troisième trimestre un recul de la consommation privée et une poursuite du recul de l'investissement. Cette situation permet de constater l'échec des politiques monétaires et des interventions budgétaires, pourtant largement expansionnistes, menées depuis le début de la décennie 1990. La politique budgétaire a pris la forme, en effet, de nombreux plans de relance, qui ont provoqué une forte augmentation du déficit public, à raison de 5,5% du PIB en 1998, 7% en 1999 et 6,3% en 2000 et ont porté le niveau de la dette publique à 130% du PIB cette année, alors que ce rapport n'était que de 80,4% en 1995. La politique monétaire est particulièrement accommodante depuis plusieurs années, avec, notamment, un taux de réescompte de 0,5% depuis 1995, ainsi qu'un objectif de taux au jour le jour proche de 0% du début de l'année 1999 au milieu de l'année 2000. Elle se heurte au phénomène, identifié par Keynes, de la « trappe à liquidité ». Plusieurs éléments expliquent que ces politiques expansionnistes n'aient pas porté leurs fruits et la persistance de l'atonie de l'économie japonaise et la succession, dans les années récentes, de récessions et de débuts de reprises sans lendemain au Japon, qui traduit une incapacité à entrer dans un cycle de reprise auto-entretenue. En premier lieu, les revenus des ménages n'ont guère progressé, avec une évolution du revenu disponible positive de 1,1% en 1998, mais négative de 0,2% en 1999 et de 0,6% en 2000, selon l'OCDE. Certes, la baisse des prix liée au contexte déflationniste a contribué à soutenir le revenu réel des ménages et la consommation, puisque le déflateur de consommation privé a baissé de 0,1% en 1998, 0,7% en 1999 et 1,2% en 2000, mais la diminution de l'emploi, de 0,7% en 1998, de 0,8% en 1999 et encore de 0,2% en 2000, ainsi que l'augmentation corrélative du taux de chômage, qui est passé de 4,1% en 1998 à 4,9%, niveau inconnu au Japon ces dernières décennies, n'ont pu que limiter l'appétence à consommer des Japonais. En outre, les ménages japonais sont fortement endettés. Leurs dettes représentent environ 120% de leur revenu disponible depuis le début de la décennie, même si cette proportion est globalement stable depuis 1990. La capacité de remboursement des ménages a été réduite, il est vrai, par la stagnation des revenus, ainsi que par la forte baisse du prix du foncier et de l'immobilier, qui a réduit considérablement le montant du patrimoine net. En deuxième lieu, les entreprises japonaises souffrent d'un excès d'endettement, structurel depuis l'éclatement de la bulle financière au début des années 1990. S'agissant des entreprises non financières, le rapport de l'endettement aux ventes reste élevé, à raison de 160%, chiffre très élevé même s'il est inférieur au maximum de 180% atteint plusieurs fois depuis 1992. Cet important niveau d'endettement a été rendu supportable grâce à la politique monétaire, fondée sur des taux d'intérêt extrêmement faibles, aux garanties de crédit accordées par l'Etat et à la possibilité pour les emprunteurs de reporter sur les exercices ultérieurs leurs dettes venues à échéance. Les dépenses nettes d'intérêts, qui représentaient plus de 2,5% des ventes en 1990 et 1991, se sont stabilisées autour de 1% des ventes depuis 1996. Cette évolution a évité, jusqu'en 2000, les faillites. En troisième lieu, la politique monétaire, bien qu'accommodante, n'a pas permis de régler le délicat problème des créances dites improductives ou irrécouvrables, en grande partie lié à la bulle immobilière des années 1980, et estimées, en avril dernier, à 32 trillions de yens, soit environ 1.920 milliards de francs. On observera qu'une ambiguïté subsiste sur l'ampleur du problème à traiter, d'autres estimations portaient sur un montant de 50 trillions de yens, soit environ 3.000 milliards de francs de créances douteuses, ou à risque, non provisionnées (17), voire 60 trillions de yens (3.600 milliards de francs). En proportion du PIB, ces créances représentaient 6% du PIB japonais, en septembre 2000, selon l'OCDE. Le maintien de certaines de ces créances dans le bilan des banques et l'accumulation rapide de nouvelles créances improductives au fur et à mesure que les créances antérieures sortaient du bilan constituent un obstacle à un redémarrage de l'offre de crédit par les établissements financiers japonais. Les profits des banques japonaises, de l'ordre de 6 à 7 trillions de yens (360 millions de francs) par an sont, en effet, insuffisants pour provisionner l'ensemble du stock de créances. Ce problème est d'autant plus prégnant que la chute de la bourse ne permet pas aux banques de compenser par des plus-values mobilières leurs pertes sur créances douteuses et qu'un changement des règles comptables oblige les banques japonaises à évaluer leurs actifs financiers au prix du marché à compter de l'exercice 2001, ce qui fait apparaître les moins-values latentes et tend à renforcer l'érosion de leurs fonds propres. En pratique, cette politique se traduit par une forte augmentation de la base monétaire du Japon, selon des modalités très particulières, puisque la Banque du Japon procède à d'importants achats d'obligations publiques et que les établissements financiers japonais prêtent à des non-résidents et procèdent à l'achat de titres publics plus qu'ils ne développent les prêts aux résidents. Par ailleurs, la faillite de plusieurs sociétés d'assurance-vie japonaises, Nissan life en 1997, Kiyoe life et Chiyoda life en octobre et novembre 2000, a mis en évidence les fragilités de l'ensemble de ce secteur, qui tiennent à ce que le rendement des actifs est très inférieur à celui promis aux assurés. La compensation de cet écart par des plus-values sur cession d'actifs, comme cela a été le cas pour l'exercice clos en mars 2000, présente l'inconvénient d'entamer les réserves latentes des établissements concernés. En outre, la chute de la bourse japonaise depuis mars 2000 ne permet plus de procéder à de telles opérations. Ainsi, après la création, en 1998, d'un dispositif d'indemnisation des assurés des sociétés d'assurance-vie en faillite, une nouvelle loi entrée en vigueur en juin 2000 permet d'accélérer la liquidation et la réorganisation des sociétés d'assurance en faillite, dans le cadre d'un processus de démutualisation qui permet de faire appel à des capitaux extérieurs et de nouer des partenariats. En quatrième lieu, la nécessité d'envisager une stabilisation de la dette publique dans les années future, fût-ce à un très haut niveau, implique une réduction du déficit budgétaire et donc une diminution de l'investissement public, qui a encore évolué d'une manière favorable au premier semestre 2001 en raison du report du programme budgétaire de novembre 2000. L'OCDE a prévu au printemps que l'endettement public atteindrait 138% du PIB en 2002. L'Agence de notation Standard & Poor's s'interroge sur une éventuelle dégradation de la note souveraine du Japon, anticipant un endettement public brut de 175% du PIB d'ici à 2005. L'Agence Moody's a placé sous surveillance la dette intérieure japonaise. En l'absence de facteur favorable à l'amorce d'un cycle autonome de reprise du crédit, de l'investissement et de la consommation, l'avenir de l'économie japonaise est donc fortement dépendant des conséquences de l'assouplissement supplémentaire de la politique monétaire et des résultats du programme de réformes engagé par le nouveau Premier ministre, M. Junichiro Koizumi, sur la question clef de l'assainissement du secteur bancaire. S'agissant de la politique monétaire, la Banque du Japon a, d'une part, réduit son taux de réescompte à 0,35 % le 13 février 2001, puis à 0,25% le 13 mars 2001 et, d'autre part, ramené l'objectif retenu pour le taux de l'argent au jour le jour à près de 0% en février dans le cadre de la politique de taux zéro, et, enfin, relevé de 50%, de 400 à 600 milliards de yens, le plafond de ses prises en pension mensuelles d'obligations de long terme et augmenté l'encours des banques laissées chaque jour sur le marché. Présenté le 21 juin dernier, ce programme prévoit pour les établissements financiers une aide à l'apurement des bilans bancaires, avec un rachat des créances qui n'auraient pu être provisionnées, dans un délai de trois ans, par l'Agence de règlement et de remboursement. L'hypothèse d'un fonds de rachat des actions des banques a également été envisagée. Ce plan prévoit également la privatisation de certaines activités, ainsi que la déréglementation de certains secteurs, et des actions en faveur des nouvelles technologies. Il repose, en outre, sur une réduction de la dépense publique, notamment les investissements dans le secteur de la construction. La perspective de l'adoption d'un budget supplémentaire pour cette année, fondée sur des mesures en faveur du travail et des dépenses de travaux publics montre toutefois que cette contrainte peut être interprétée avec souplesse. A court terme, il est permis de penser que les réformes de l'économie japonaises ne manqueront pas d'avoir un impact négatif sur l'activité économique. Il pourrait entraîner une augmentation du nombre de faillites et du chômage qui pèserait sur la demande intérieure. A moyen terme, elles sont essentielles, puisque seules des réformes structurelles permettraient au Japon de retrouver la voie d'une croissance effective, solide et stable. L'autre voie favorable à une reprise de l'économie japonaise, qui serait dans la logique de la politique monétaire expansionniste, celle de la dépréciation du yen et d'une certaine inflation de croissance qui apurerait les bilans des entreprises et des banques, évoquée par M. Patrick Artus (Les Echos, 3 juillet 2001), n'est pas envisageable en raison de l'opposition des pays asiatiques et des Etats-Unis qui subiraient une importante perte de compétitivité. On peut donc considérer qu'une première étape, psychologique mais essentielle, a été franchie à la fin du mois de juillet, puisque les réformes ont été validées par le corps électoral lors des élections sénatoriales de la fin du mois de juillet dernier, et que la voie étroite et difficile de l'assainissement structurel a été validée. 4.- Une situation difficile dans les pays émergents, mais néanmoins sous contrôle pour les plus faibles d'entre eux grâce aux interventions du FMI Les pays émergents connaissent dans l'ensemble des évolutions favorables en 1999 et en 2000, après avoir surmonté les difficultés de la crise asiatique de 1997 et des crises russe et latino-américaine de l'année 1998 et du début de l'année 1999. Ils pâtissent cependant fortement en 2001 du ralentissement de l'économie américaine dont ils sont étroitement dépendants, à des titres divers. Les plus fragiles d'entre eux sur le plan financier, parmi les plus endettés, l'Argentine et la Turquie, ont dû faire face à des crises financières graves. Tel est également le cas, dans une moindre mesure, du Brésil. Ces risques sur les pays émergents d'Amérique latine sont cependant sous contrôle grâce à l'intervention du FMI en faveur de ces trois pays, pour un montant de l'ordre de 100 milliards de dollars depuis l'automne dernier. a) Les cas spécifiques de l'Argentine et de la Turquie La crise turque et la crise argentine sont venues rappeler la faiblesse des pays émergents au développement desquels les capitaux internationaux sont indispensables. Si un élément vient alimenter la défiance des investisseurs, la diminution des flux d'investissements et le désengagement des capitaux à court terme entraînent une crise des changes. C'est ce scénario qui a affecté cette année les économies de la Turquie et de l'Argentine, selon des modalités diverses. _ La crise turque En 1999, la Turquie s'est dotée d'un programme de stabilisation macro-économique et financière qui a permis de réduire l'inflation, progressivement passée de 69% en glissement annuel à 39% un an plus tard, de connaître une forte croissance de 7,2% en 2000, alors que l'année 1998 avait été marquée par une sévère récession, avec une chute du PIB de 4,7%. Ce programme a néanmoins échoué. L'inflation, bien que réduite, est restée supérieure à l'objectif de 25% pour la hausse sur un an des prix à la consommation, et a entraîné une dégradation de la compétitivité internationale, ainsi qu'une augmentation du déficit des paiements courants, qui a atteint 5% du PIB. Les taux d'intérêt se sont alors tendus et la liquidité s'est tarie sur le marché interbancaire, provoquant la faillite d'une banque de moyenne importance et mettant en lumière les insuffisances du secteur bancaire résultant tant de l'insuffisance des réformes structurelles que de la forte chute des taux d'intérêt dès le début de l'année 2000. Ces derniers, devenus négatifs, avaient certes contribué au soutien de la demande, mais ils ont déséquilibré les conditions d'exploitation des banques. Un premier plan de sauvetage, sous l'égide du Fonds monétaire international, est intervenu, assorti d'une ligne de crédits de 10 milliards de dollars, qui a permis de résorber la crise et de maintenir l'ancrage glissant de la livre turque. Une deuxième crise est intervenue en février 2001, crise de confiance liée à l'insuffisance de la mise en _uvre des réformes d'accompagnement du plan, notamment de la régulation de l'exposition extérieure des banques, ainsi qu'à des inquiétudes sur la solvabilité de l'Etat, fortement endetté à court terme. L'abandon d'un objectif de change pour la livre turque a alors entraîné sa forte dépréciation, de 40%. Un nouveau programme a reçu le soutien du FMI, qui a accordé une ligne de crédits de 19 milliards de dollars. Il met l'accent sur les réformes structurelles à opérer : restructuration des banques, dont les bilans sont affectés par la forte hausse des taux d'intérêt, la dépréciation de la livre, qui a accru d'autant le poids de leurs engagements en devises et, d'une manière plus structurelle, par les difficultés des entreprises qui accroissent le volume des créances improductives ou douteuses ; restructuration des dépenses publiques et maîtrise du déficit ; assainissement du secteur des entreprises publiques, dans la perspective d'une privatisation. Si la situation semble stabilisée, le retour à des taux d'intérêt réels fortement positifs, la chute du pouvoir d'achat des ménages et la montée du chômage ont provoqué un effondrement de la demande, et se traduisent cette année par une forte récession dont l'ampleur reste encore incertaine. _ La crise argentine L'économie de l'Argentine n'est pas sortie de la récession en 2000, même si le niveau de la diminution du PIB est inférieur à celui de 1999, avec des baisses respectivement de 3,5% et 0,5%, à la différence de celle des autres pays d'Amérique latine. C'est en partie la conséquence du rattachement du peso au dollar, l'appréciation de ce dernier ayant handicapé la compétitivité argentine, alors que l'atonie du marché du travail, l'orientation défavorable des salaires et les mesures de restriction budgétaire destinées à respecter les objectifs négociés avec le FMI ont pesé sur la demande. Cette situation, matérialisée par l'exigence d'une prime de risque relevant les taux d'intérêts à un niveau supérieur à celui d'autres pays émergents, a provoqué la défiance des investisseurs vis-à-vis de la capacité de l'Argentine à rembourser sa dette extérieure et une crise importante de solvabilité, le pays étant dans l'incapacité de refinancer sa dette publique sur le marché obligataire. La dette extérieure de l'Argentine, qui est le plus important emprunteur souverain émergent sur le marché obligataire international, s'élève actuellement, en effet, à 128 milliards de dollars, soit 45% du PIB et son service est estimé à 18 milliards de dollars pour l'année 2002. La part de la dette publique dans la dette extérieure au pays est d'environ 65%. Lors de la première phase de cette crise, à l'automne dernier, l'Argentine a fait face à un important problème de refinancement, les investisseurs se défaisant des obligations qu'ils détenaient et n'en souscrivant pas de nouvelles, situation qui s'est également traduite par une forte augmentation de la prime de risque, pourtant d'un niveau déjà très élevé, depuis la crise russe de 1998, et le relèvement jusqu'à 16% des taux d'intérêt pour permettre la cession sur le marché domestique des titres habituellement destinés au marché international. Cette première phase s'est achevée grâce à la mise en place, sous l'égide du FMI en collaboration avec des banques privées, plusieurs institutions internationales, dont la Banque mondiale, ainsi que certains pays dont l'Espagne, d'un prêt de 39,7 milliards de dollars, dont 19 milliards de dollars d'aide d'urgence du FMI. La crise a cependant perduré, avec le maintien à un niveau élevé des taux d'intérêt et une nouvelle phase de défiance à la mi-juillet, malgré le plan établi par le ministre des finances nommé en mars, M. Domingo Cavallo, réputé avoir été à l'origine du miracle argentin au début de la décennie. Il est vrai que ce plan, qui prévoit un assainissement budgétaire avec un déficit zéro (the « zero deficit law ») et repose sur un arrimage du peso pour moitié au dollar et pour moitié à l'euro, s'est également heurté au scepticisme des prêteurs internationaux. Le FMI a ainsi accordé 8 milliards de dollars de plus à l'Argentine, contre une restructuration de sa dette et une application sans faille du programme de rigueur. La ligne de crédit de l'Argentine auprès du FMI est ainsi passée de 14 à 21,5 milliards de dollars. b) Les pays émergents d'Amérique latine : un ralentissement marqué en raison de l'importance des liens avec les Etats-Unis Les économies des pays d'Amérique latine sont dépendantes de celle des Etats-Unis à un double titre. Leurs exportations extra-régionales sont destinées pour près de 70% à l'économie américaine et la couverture de leurs déficits courants dépend des flux de capitaux provenant des Etats-Unis, soit sous la forme d'investissements directs, soit sous celle d'investissements en portefeuille. L'importance des produits de base dans les économies de la plupart d'entre eux les rend également très sensibles à la conjoncture internationale. Les effets du ralentissement de la croissance américaine se manifestent dès cette année sur les économies d'Amérique latine. L'économie du Mexique est entrée en récession au début de l'année 2001, subissant les conséquences de la chute des importations américaines, alors que la croissance a été vigoureuse en 2000 avec une augmentation du PIB de 6,9%. L'évolution de l'économie mexicaine fait l'objet d'une grande attention de la part de l'administration des Etats-Unis ainsi que du FMI, même si la réduction drastique de la dette extérieure et des déficits publics intervenue depuis quatre ans a nettement réduit le risque. Le Brésil a subi au début de cette année les premiers effets du ralentissement mondial, alors que son économie avait renoué avec la croissance en 2000, le PIB ayant progressé de 4,7% contre 0,8% en 1999. Le ralentissement perceptible dès le début de l'année, en raison de l'affaiblissement de la demande externe et de difficultés d'approvisionnement en électricité, qui a conduit à une véritable crise de l'énergie et à un plan de rationnement de 20% de la consommation d'électricité, s'est traduit par une dégradation du solde commercial, qui a rendu hypothétique l'amélioration de la dette extérieure et a entraîné une dégradation des perspectives financières d'autant plus importantes que les craintes de contagion de la crise argentine sont fortes. Le real a fortement chuté et est tombé, début septembre, à un taux très proche de son plus bas niveau face au dollar, soit une chute de l'ordre de 30% depuis le début de l'année, en dépit d'une forte augmentation de ses taux directeurs par la Banque centrale brésilienne. Un programme économique et financier a été mis en place, avec le soutien du FMI qui a accordé un crédit de 15 mois d'un montant de 15,58 milliards de dollars, le 14 septembre. Le FMI a prévu, au début du mois de septembre dernier, pour le Brésil, une croissance de 2,2% en 2001 et 3,5% en 2002. S'agissant du Chili, qui a renoué avec la croissance en 2000 (+ 4,9%) après une récession en 1999 (- 2,6%), les perspectives sont moins favorables cette année en raison du ralentissement de la demande mondiale de cuivre, lequel représente 40% des exportations, ainsi que des conséquences directes de la crise qui a frappé l'Argentine, qui s'est traduite par une forte dépréciation du peso par rapport au dollar, ainsi que par une diminution des échanges de produits de base avec ce pays. La croissance pourrait cependant atteindre près de 3% cette année. c) Les pays émergents d'Extrême-Orient : une récession due à leurs spécialisations dans les produits du cycle technologique Amorcé dès le deuxième semestre de l'année 2000, le ralentissement des économies émergentes d'Asie s'est accentué au cours du premier trimestre de cette année, et la plupart des pays sont actuellement en récession. Cette évolution s'explique par la faiblesse de la demande provenant des Etats-Unis et du Japon, phénomène aggravé par la spécialisation de ces économies dans le domaine de l'électronique, dont le retournement de cycle a été le plus marqué. Elle affecte les différents pays de la zone à des degrés divers, en fonction de leurs difficultés internes, mais se caractérise toujours par une chute, au moins temporaire, de la production industrielle. En ce qui concerne la Corée du Sud, la période de forte croissance, avec 10,9% en 1999, a pris fin dès le dernier trimestre 2000, avec une chute du PIB de 0,4% en rupture complète avec la forte croissance du trimestre précédent, de 2,4%. La progression de l'année 2000 a cependant été remarquable, à raison de 8,8%. Au premier semestre 2001, l'économie coréenne a renoué avec la croissance, mais sur un rythme très lent avec une progression de 0,3%. La croissance du deuxième trimestre a été à peine supérieure, à raison de 0,5%. Cette évolution est principalement due à la contraction de l'activité industrielle, sous l'effet tant d'un ralentissement des exportations que des investissements. Le ralentissement des exportations a été spectaculaire en 2000. A une croissance de 10,2% (en rythme trimestriel, soit plus de 40% en rythme annuel) au premier trimestre, ont succédé des progressions plus modestes de 0,4% au deuxième trimestre et 4,4% au troisième trimestre et une diminution de 0,7% au quatrième trimestre. Si le début de l'année 2001 a pu être encourageant, avec une progression de 4% au premier trimestre, la contraction de 6% a montré les limites d'un espoir d'une reprise des débouchés extérieurs. L'investissement a également perdu de son dynamisme. Dès le deuxième trimestre 2001, les dépenses de machines et d'équipements des entreprises ont chuté de 3,2%. Cette tendance s'est aggravée tout au long de l'année 2000, avec une diminution de 0,5% au troisième trimestre et de 9,3% au quatrième trimestre. La progression du premier trimestre 2001 (+ 2,3%) ne s'est pas poursuivie au deuxième trimestre puisque l'on constate à nouveau une diminution de 3,2%. Les problèmes de la restructuration du secteur des entreprises et du secteur financier, mis en lumière en 1997 au moment de la crise asiatique, n'ont pas été réglés, ce qui représente le principal facteur interne de récession. Les difficultés financières des entreprises affiliées aux conglomérats, les « chaebols », ont aggravé le risque de faillite. Le gouvernement coréen a d'ailleurs mis en place un dispositif de recyclage des obligations, géré par la Banque de développement de la Corée, institution financière publique, pour éviter les problèmes liés à la venue à échéance d'un total de 65.000 milliards de wons d'obligations de sociétés, soit 12% du PIB. Les autorités ont également mis en place un plan de restructuration financière dès l'automne 2000, pour la recapitalisation des banques en difficulté et le traitement des problèmes du secteur de l'assurance-vie. On peut observer qu'au total les dépenses nettes engagées au titre de la restructuration financière, depuis 1998, représentent 25% du PIB annuel de la Corée. La confiance des ménages a cependant été affectée, au moins temporairement. La consommation privée dont le dynamisme a fléchi dès le deuxième trimestre 2000, après avoir crû de 11% en 1999 et de 6,2% en 2000, a diminué, en rythme trimestriel de 1,4% au premier trimestre 2001. Toutefois, elle s'est inscrite en progression de 3% au deuxième trimestre. Il est vrai que le taux de chômage est revenu à 3,7% au deuxième trimestre 2001, après un pic à 4,2% au premier trimestre (4,8% hors prise en compte des variations saisonnières). L'ampleur de la reprise en Corée reste donc très dépendante de l'évolution de l'économie américaine, en l'absence de perspective favorable de l'économie japonaise et de l'impact exact des nécessaires restructurations du secteur industriel, dont l'engagement apparaît indispensable depuis 1997. S'agissant de Taïwan, le commerce extérieur diminue et la demande intérieure n'est pas en mesure de prendre le relais. Sur le plan financier, on observe une diminution du crédit aux entreprises au premier trimestre 2001. L'incertitude politique aggrave la situation et renforce l'inquiétude des milieux d'affaires. En ce qui concerne Hong Kong, la croissance est affectée par la chute des exportations vers les pays autres que la Chine continentale depuis le début de l'année, ainsi que par la diminution de l'investissement. La croissance prévue est de 0,7% cette année, après 10,5% en 2000 et 3% en 1999. La consommation évolue favorablement, mais les ménages sont handicapés par la chute du foncier qui engendre un effet de richesse négatif. L'économie a frôlé ainsi la récession avec une contraction du PIB de 1,7% au deuxième trimestre 2001. La Chine continentale apparaît moins affectée, dans la mesure où la structure de ses exportations la rend moins sensible aux variations cycliques du secteur de l'électronique et où l'Etat a reconduit son plan de relance des investissements et des infrastructures. La croissance pourrait être de 7,5% en 2001, chiffre dans la continuité de ceux des années 1999 et 2000, avec respectivement 7,1% et 8%. L'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, décidée à la mi-septembre, offre d'intéressantes perspectives économiques. Les autres pays émergents, Philippines, Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Singapour, sont affectés de la même manière par le ralentissement de l'économie américaine et la stagnation de l'économie japonaise. B.- LA ZONE EURO AU PIED DU MUR Après la grande frayeur de 1998, motivée, d'une part, par les conséquences hypothétiques de la crise financière, puis économique, en Asie et, d'autre part, par les violentes turbulences enregistrées sur les marchés financiers des pays développés à l'automne de cette même année, les pays européens avaient connu en 1999 une certaine euphorie. Celle-ci peut être attribuée à la fois à la mise en place réussie de la zone euro, le 1er janvier 1999, et à une conjoncture économique traversant sans dommages le « trou d'air » mondial de l'hiver 1998-1999, selon l'expression retenue à juste titre par M. Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vue globalement, l'année 2000 ne fut pas en reste. Portés par un contexte international et interne particulièrement favorable, les onze pays composant alors la zone euro se prirent à envisager une période prolongée de forte croissance, à l'image des Etats-Unis dans les années 1990, ère nouvelle qui leur permettrait de résorber le chômage, d'améliorer le bien-être de leur population, d'entrer de plain-pied dans le monde des technologies de l'information et de la communication et de redonner à l'Europe le lustre qu'elle avait perdu dans les années de crise. Ainsi devaient s'accomplir les promesses d'une intégration européenne qui avait marqué un point d'orgue avec le remplacement de onze monnaies nationales par une monnaie unique. Exposées dans les développements de la partie A ci-avant, les incertitudes afférentes au comportement, en 2001 et en 2002, des différents pays ou zones composant l'« environnement mondial » de la zone euro éclairent d'une lumière nouvelle la scène où se déroule, chaque année, l'exercice de prévision relatif à la France et à ses partenaires européens. Maintes fois annoncé mais toujours démenti par les faits, le ralentissement américain est désormais patent et la question qui est posée aujourd'hui concerne en fait l'éventualité d'une récession aux Etats-Unis, voire, pour les plus pessimistes, la confirmation prochaine d'une récession considérée comme inévitable. De plus, la dernière prévision de croissance du FMI pour 2001 (2,7%) est à peine supérieure au taux de 2,5% généralement considéré comme le seuil « technique » de récession pour le monde pris dans son ensemble (18). Soumise désormais à l'atonie d'une économie mondiale qui semble comme privée de moteur, la zone euro se retrouve face à elle-même, seule. Elle doit en quelque sorte subir un « examen de passage » - une épreuve d'adversité - grâce auquel elle pourra démontrer la pertinence et la viabilité du choix politique essentiel que représente l'introduction de la monnaie unique. 1.- La croissance essoufflée : quel horizon pour le rebond ? Lorsqu'au tournant de l'hiver 2000-2001, il apparaît clairement que les Etats-Unis se sont enfin engagés dans une phase de ralentissement qui va mettre fin à un cycle long de croissance commencé en 1991, l'heure n'est pas à l'inquiétude. Après être convenu que la décélération de l'économie américaine exercerait une influence modératrice sur les exportations européennes, M. Wim Duisenberg, président de la Banque centrale européenne, indiquait ainsi, lors de la conférence de presse du 1er février 2001, que « la zone euro est un espace économique important, dans lequel les exportations de biens et services représentent seulement 17% du PIB. De ce fait, l'activité économique de la zone euro est essentiellement déterminée par des facteurs domestiques ». Cette opinion était à l'époque largement partagée. Nombreux étaient les économistes qui estimaient que la zone euro pourrait supporter sans difficulté les conséquences du ralentissement américain, du fait de son caractère relativement « fermé » (19). Au demeurant, le thème du rééquilibrage - ou de la redistribution - de la croissance mondiale était vu comme un facteur de réduction des déséquilibres et comme une condition nécessaire pour maintenir un niveau élevé d'activité, à court comme à moyen terme. Mais, les mois passant, ces certitudes se sont évanouies et les conjoncturistes n'ont pas cessé d'abaisser leurs prévisions de croissance pour les années 2001 et 2002, comme l'illustre le tableau ci-après. EVOLUTION EN 2001 DES PRÉVISIONS DE CROISSANCE POUR LA ZONE EURO (taux de croissance du PIB, en moyenne annuelle)
(a) Conjoncture & marchés, « Zone euro » (d) Inside the Euro Economy (b) Éclairages (e) Global Data Watch (c) Analyse mensuelle de la situation économique (f) Cité dans la revue Éclairages a) Le mythe de la tour d'ivoire Assurément, l'Europe n'est pas aussi exposée que d'autres zones aux vicissitudes de la conjoncture américaine. Votre Rapporteur général a exposé précédemment comment les pays d'Asie émergente ont subi de plein fouet le retournement du cycle technologique, secteur d'activité dans lequel ils possèdent une forte spécialisation. De même, le développement de la sous-traitance et l'externalisation de certaines fonctions de la production ont rendu le Mexique et la Canada extrêmement dépendants de la vitalité de leurs donneurs d'ordres situés aux Etats-Unis. Au seuil des années 2000, les exportations à destination des Etats-Unis représentent 25% du PIB mexicain et 32% du PIB canadien (20). A l'évidence, les relations économiques entre l'Europe et les Etats-Unis n'ont pas cette intensité. Pour autant, l'argument d'un relatif isolement de la zone euro du fait de sa « fermeture » vis-à-vis de son environnement international se révèle largement inopérant. Il existe plusieurs canaux par lesquels les fluctuations de la conjoncture américaine peuvent se transmettre aux pays européens. · Le canal le plus manifeste est celui des transactions commerciales. Si l'on exclut les échanges intra-zone, les exportations de biens et services de la zone euro ont représenté en 2000 près de 19% du PIB, pourcentage nettement supérieur à celui que l'on pouvait observer au milieu des années 1990 (par exemple : 15% seulement en 1996) (21). Les statistiques du commerce extérieur montrent que les Etats-Unis sont, après le Royaume-Uni, le deuxième partenaire commercial de la zone euro. Son poids relatif dans les exportations de la zone s'est d'ailleurs accru dans les années récentes. Les Etats-Unis représentaient 16,7% des exportations de la zone en 1999, puis 17,2% en 2000 ; malgré leur ralentissement avéré, ils absorbaient encore, en mai 2001, 17,4% des exportations de marchandises de la zone euro (22). Ce dernier résultat pourrait paraître paradoxal, mais il ne fait que traduire le parallélisme quasi parfait entre la chute des exportations vers les Etats-Unis et celle des exportations totales de marchandises de la zone euro. Au demeurant, ceci marque bien le caractère global du ralentissement qui affecte actuellement l'économie mondiale (23). Le graphique ci-après illustre ces évolutions parallèles. ÉVOLUTION MENSUELLE DES EXPORTATIONS DE LA ZONE EURO (2000-2001) (variation par rapport à la même période 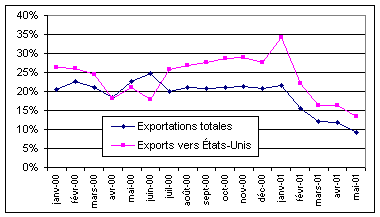 Les pourcentages d'évolution représentés chaque mois s'appliquent au montant cumulé des exportations depuis le mois de janvier de l'année concernée. En faisant abstraction de la part revenant aux matières premières et énergétiques, le commerce mondial « contient » une proportion plus importante de produits semi-finis, de biens d'équipement et de biens de consommation durables que la production. Ses évolutions conduisent donc à amplifier les fluctuations de la production, puisqu'il est organisé autour de certaines de ses composantes les plus volatiles. En particulier, le commerce mondial est particulièrement sensible aux évolutions de l'investissement des entreprises, donc au « climat » économique tel qu'il est perçu par les chefs d'entreprise. Au plan sectoriel, l'industrie est beaucoup plus exposée que les services aux fluctuations des échanges commerciaux. Ce phénomène amplificateur est essentiel lorsqu'on cherche à quantifier les effets d'une réduction de la demande dans un pays donné sur le niveau d'activité chez ses partenaires commerciaux, par le biais de leurs exportations. Force est de constater qu'en ce domaine, il est difficile à votre Rapporteur général d'apporter des éléments d'explication définitifs. Ainsi, en se fondant sur une démarche analytique qui met successivement en relation les évolutions de la croissance américaine, leur impact sur les exportations européennes à destination des Etats-Unis puis l'impact des exportations sur la croissance européenne, les services de la Commission européenne estiment qu'une réduction d'un point du taux de croissance américaine a pour effet direct une baisse de 0,1 point du taux de croissance des pays européens (24). Les effets indirects, qui résultent de la propagation de ce choc externe au sein de l'économie, ne sont pas chiffrés. Pour sa part, Goldman Sachs estime qu'une baisse de 1% des exportations totales de la zone euro se traduirait par une baisse de 0,18% du PIB de la zone en ne tenant compte que des effets directs, ou de 0,3% en tenant compte des effets indirects (25). Compte tenu de la part des Etats-Unis dans les exportations de la zone euro (17% environ), ceci revient à dire qu'une baisse de 1% des exportations de la zone à destination des Etats-Unis provoquerait une diminution de 0,05% du PIB européen, en tenant compte des effets indirects. Le chaînon manquant doit relier l'évolution du PIB américain et celle des exportations européennes vers les Etats-Unis : en retenant un coefficient multiplicateur compris entre 3 et 4 (26), il apparaît qu'une variation de 1% du PIB aux Etats-Unis est susceptible de provoquer une variation de 0,2% du PIB dans la zone euro, en tenant compte des effets indirects. Ces deux résultats « analytiques » sont tout à fait cohérents. Cependant, ils sont en décalage avec l'étude statistique directe des corrélations calculables entre le PIB américain et le PIB européen. Au demeurant, l'exercice statistique est rendu d'autant plus difficile que le choix de la période sur laquelle on mesure la corrélation a une influence cruciale sur le résultat. Ainsi, les économistes de CDC-Ixis mettent en évidence les corrélations retracées dans le tableau ci-après. CORRÉLATION DES TAUX DE CROISSANCE DU PIB AMÉRICAIN ET EUROPÉEN
Source : Flash, n° 2001-9 (26 janvier 2001) et n° 2001-162 (19 septembre 2001). Il est clair que le décalage entre les récessions américaine (1991) et européenne (1993) explique pour l'essentiel la faible corrélation mesurée sur la décennie 1990. La mise en évidence d'une corrélation « utilisable » pour effectuer une prévision à l'horizon 2001-2002 nécessite donc de retenir une période différente. Mais, faute d'assortir les éléments statistiques de considérations proprement économiques, il n'est pas évident de choisir a priori entre les intervalles 1985-2000 et 1994-2000... En tout état de cause, on peut légitimement tirer la conclusion que la conjoncture américaine exerce une influence non négligeable sur la conjoncture européenne, bien plus que ce que pouvait donner à penser la simple considération de l'ouverture extérieure de la zone euro. Il est vrai que l'étude directe des corrélations statistiques ne permet pas de distinguer la contribution spécifique des échanges commerciaux parmi les autres facteurs susceptibles de « connecter » les conjonctures de part et d'autre de l'Atlantique. · En particulier, le canal du taux de change peut compléter, voire amplifier l'impact des fluctuations conjoncturelles transmis par le biais du commerce. Chacun sait que l'euro a connu, depuis sa création, un mouvement de dépréciation quasi continu qui a amené sont taux de change vis-à-vis du dollar de 1,2, le 1er janvier 1999, à 0,8252 à la fin du mois d'octobre 2000. La vigueur du dollar peut s'expliquer en partie parce que les opérateurs sur les marchés estimaient que les perspectives de croissance de la zone euro étaient structurellement inférieures à celles des Etats-Unis. La dépréciation devenue manifestement excessive de la monnaie européenne ainsi que le signal adressé aux marchés par les interventions de la Banque centrale européenne ont stabilisé les sentiments des opérateurs. Puis, les indications en provenance des Etats-Unis ont renversé le sens des anticipations et l'euro est remonté, à la fin de l'année 2000, à une parité de 0,93. Au cours du premier semestre 2001, il est apparu que la zone euro était également touchée par le ralentissement mondial. Les anticipations baissières ont alors repris le dessus et le taux de change entre l'euro et le dollar est revenu aux environs de 0,85 à la fin du premier semestre. Par la suite, les inquiétudes croissantes sur l'état de l'économie américaine ont provoqué une érosion de la valeur du dollar vis-à-vis de l'euro, celui-ci cotant légèrement au-dessus de 0,90 dans le courant du mois de septembre 2001. Votre Rapporteur général rappellera simplement que la dépréciation d'une monnaie, à la suite d'un ralentissement économique - ou de l'anticipation d'un tel ralentissement - aboutit à transférer vers les partenaires du pays concerné une partie du poids de ce ralentissement. En effet, la position concurrentielle de ce pays s'améliore avec le degré de dépréciation de sa monnaie, ce qui tend à augmenter la demande étrangère qui lui est adressée - toutes choses égales par ailleurs (27). Les variations de taux de change agissent donc dans le sens d'une corrélation accrue des conjonctures entre les deux pays partenaires. A l'évidence, les mouvements observés depuis l'automne 2000 sur la parité euro-dollar sont insuffisants pour exercer une influence sensible sur l'activité économique : leur amplitude est restée limitée et leur sens s'est renversé deux fois sur onze mois. Il n'empêche qu'une détérioration éventuelle des perspectives et des performances américaines pourrait favoriser une revalorisation plus durable de l'euro et sinon exercer une influence dépressive sur la zone euro, du moins priver celle-ci du soutien qu'a représenté, pendant près de vingt mois, l'amélioration de sa compétitivité externe. · On peut également s'interroger sur les conséquences pour la conjoncture européenne de la globalisation du système productif. Dans un monde où les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent dépasser dans leur structure même le cadre des frontières nationales en développant leurs investissements directs à l'étranger, il n'est pas impossible que se mettent en place des mécanismes nouveaux de connexion conjoncturelle entre zones géographiques différentes. En effet, le ralentissement américain menace directement les profits des entreprises résidentes, et en particulier ceux des filiales américaines d'entreprises européennes. La dégradation de la profitabilité globale de l'entreprise-mère, mesurée en termes consolidés, peut amener ses dirigeants à entreprendre des restructurations, dont le déploiement n'est pas nécessairement limité au continent américain mais peut concerner la zone euro. Le même raisonnement peut être tenu pour des firmes américaines qui, confrontées à la dégradation de la conjoncture interne, peuvent décider de redéfinir leur organisation géographique et le volume de leurs implantations mondiales. La relation entre les Etats-Unis et la zone euro passerait ainsi par une action directe sur les facteurs de production et non pas, comme dans les cas évoqués traditionnellement, par l'intermédiaire des marchés de produits. Trois éditions consécutives du quotidien Les Echos, à la fin du mois d'août 2001, ont rapidement donné à votre Rapporteur général trois exemples éclairants. En premier lieu, on a pu voir un grand constructeur automobile américain annoncer un plan mondial de restructuration - n'épargnant pas l'Europe - pour réduire ses capacités globales et surmonter en partie les déficits de ses activités américaines. On a vu aussi, à la même date, le président d'un important constructeur informatique justifier en ces termes la suppression de 1.100 emplois en Irlande et 5.000 emplois en Asie ainsi qu'une prochaine restructuration de ses activités européennes : « nous n'avons pas besoin d'être un groupe mondial pour réussir ». Enfin, dans le cadre du plan de restructuration annoncé en juin 2001 par le principal équipementier canadien d'équipements de télécommunications, plusieurs centaines d'emplois seraient menacés en France. Il convient de remarquer qu'avant même d'envisager des restructurations, la dégradation du revenu global des firmes européennes possédant des filiales aux Etats-Unis peut conduire à différer ou annuler des projets d'investissement. Les conséquences seraient alors sensibles sur la demande de biens d'équipement ou de dans le secteur de la construction. Pour autant, cet « effet de revenu » devrait être assez faible, en l'état des informations recueillies par votre Rapporteur général. Le groupement européen de recherche économique de Goldman Sachs estime, par exemple, qu'une chute de 10% du revenu brut des investissements directs à l'étranger n'aurait qu'un impact équivalent à 0,1% du PIB (28). En tant que tel, ce pourcentage ne laisse pas présager d'un canal de contagion très efficace entre les deux pays partenaires. Cependant, le revenu de l'investissement direct à l'étranger, mesuré en monnaie nationale, dépend non seulement de la rentabilité intrinsèque de l'investissement, mesurée dans la monnaie du pays d'accueil, mais aussi de l'évolution du taux de change entre ces deux monnaies. · Existe-t-il, à côté des canaux de transmission des chocs conjoncturels, certains mécanismes stabilisateurs qui tendraient, au contraire, à désynchroniser Europe et Etats-Unis ? Si l'on peut en évoquer deux, à titre principal, il ne semble pas qu'ils aient une importance significative et que leur capacité stabilisatrice soit ainsi très affirmée. On peut penser, tout d'abord, à l'influence apaisante que pourrait avoir un affaiblissement de l'activité américaine sur le prix des matières premières industrielles ou énergétiques. M. Patrick Artus, directeur de la recherche de CDC Ixis, conteste un tel effet. Il estime ainsi qu'il est « difficile de voir un lien systématique entre le prix des matières premières et la croissance américaine : en 1990-1991 et 1996, le pétrole est cher ; en 1997-1998, les matières premières hors pétrole ont leur prix qui baisse malgré la forte croissance aux Etats-Unis. La corrélation entre le PIB mondial et les prix des matières premières et du pétrole semble bien meilleure que celle entre le PIB américain et les prix des matières premières » (29). Dans le même esprit, la Note de conjoncture publiée par l'INSEE au mois de juin 2000 indiquait que l'hypothèse selon laquelle les chocs de prix du pétrole dépendent essentiellement d'événements extérieurs à la marche globale de l'économie « est assez aisément recevable jusqu'au choc de prix de 1991. Il n'est pas du tout certain qu'elle ait la même validité pour la période la plus récente. [...] Il semble que depuis [1994], le prix du pétrole épouse plus nettement les inflexions de la croissance mondiale » (30). Votre Rapporteur général serait enclin à voir dans ces conclusions la traduction, dans les grands équilibres de l'économie mondiale, de la montée en puissance des pays émergents, essentiellement en Asie. Chacun sait que ces pays « absorbent » progressivement une partie de la substance industrielle de la production, ce qui rend leurs importations plus intenses en énergie et matières premières industrielles. La place grandissante des services dans les économies anciennement industrialisées affaiblit progressivement le lien entre la croissance de leur PIB et la croissance de leur demande en matières premières énergétiques et industrielles. Nonobstant ces considérations, on ne peut oublier que la croissance américaine est, en elle-même, une composante importante de la croissance mondiale et qu'elle reste donc corrélée, même de façon imparfaite, aux évolutions du prix du pétrole ou des matières premières. Le deuxième élément stabilisateur de la conjoncture internationale pourrait être une connexion des taux d'intérêt entre les différents pays, résultant de l'intégration toujours plus poussée des marchés de capitaux. Un ralentissement dans la puissance financière dominante, les Etats-Unis, provoque en règle générale une baisse des taux d'intérêt américains : sur le segment court, les taux de marché se calquent sur les taux objectifs de la Réserve fédérale, que celle-ci abaisse afin de stimuler le crédit et de ranimer la consommation. Sur le segment long, les taux des titres obligataires reflètent la baisse de l'inflation anticipée. Dans un marché global, où les opérateurs peuvent arbitrer librement entre les titres émis dans différents pays, la fluidité des mouvements de capitaux amène à l'égalisation des taux d'intérêt, compte tenu des paramètres spécifiques à chaque pays, comme une prime de risque inflationniste, une prime de risque de défaut ou une prime de risque pour dépréciation éventuelle du taux de change. Si le niveau absolu des taux peut donc être différent, leurs évolutions n'en deviennent pas moins très similaires. Les partenaires du pays où se produit le ralentissement bénéficient donc, toutes choses égales par ailleurs, de conditions de financement plus favorables par le biais d'une évolution parallèle des actifs financiers dits « de taux » (bons du Trésor ou titres de créance à moyen terme, obligations). Pour que cet effet joue pleinement, il faut que les obstacles à l'intégration des marchés soient les plus faibles possibles. Le régime juridique et fiscal des placements en actifs financiers fait partie de ces obstacles, mais votre Rapporteur général ne s'attardera pas sur cette question, qui peut être considérée comme extérieure à la problématique développée ici. L'observation des données historiques montre que les taux d'intérêt à long terme évoluent de façon très parallèle depuis 1980. Il est possible d'interpréter ce résultat à la lumière de deux phénomènes : - une libéralisation financière qui a conduit au développement des marchés à terme sur devises (essentiellement les contrats d'échange, ou swaps), alors qu'auparavant, les marchés à terme n'étaient réellement efficaces que sur le segment des titres à trois mois et qu'ils n'existaient pratiquement pas pour les échéances supérieures ou égales à deux ans. Grâce à cet approfondissement, les opérateurs ont eu la possibilité de couvrir leur risque de change pour les placements à longue échéance, ce qui a considérablement augmenté la substituabilité entre titres longs de nationalité différente (31) ; - le consensus nouveau entre banques centrales, à la suite du second choc pétrolier, en 1979, pour éradiquer l'inflation par le biais d'une politique monétaire restrictive, sous l'impulsion de la Réserve fédérale américaine et de son président de l'époque, M. Paul Volcker. Cette politique a conduit à une hausse généralisée sur la partie longue de la courbe des taux, dans tous les pays occidentaux, puis à une baisse très largement commune, reflétant le succès de la politique engagée. Par la suite, dans les toutes dernières années précédant l'introduction de l'euro, les taux d'intérêt à long terme des pays européens susceptibles de faire partie de la première vague d'Etats membres ont convergé très fortement. Pour autant, les estimations quantitatives effectuées dans le cadre des travaux du FMI ne montrent pas de corrélation nettement supérieure à 50%, ce qui veut dire que les évolutions respectives des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et dans la zone euro répondent également, chacun pour sa part, à des impulsions spécifiques. En définitive, l'ensemble des éléments détaillés ci-avant plaide pour une appréciation très nuancée de la prétendue « autonomie » de la zone euro vis-à-vis de son partenaire américain. Celle-ci ne pouvait pas être qu'effleurée par le ralentissement de la puissance économique dominante : elle est en fait d'autant plus vulnérable que les ressorts internes de la croissance en Europe se sont révélés, le temps passant, plus fragiles que ce qui était escompté au seuil de l'hiver 2000-2001. b) Une croissance alanguie depuis deux semestres Après une année 1999 marquée par le ralentissement consécutif à la crise des marchés émergents, le taux de croissance du PIB de la zone euro ayant atteint 2,6%, l'année 2000 a marqué un fort rebond de l'activité, le PIB ayant progressé de 3,4% en volume, en moyenne annuelle (32). Il s'agit là de la hausse la plus importante depuis 1990. Néanmoins, l'examen du profil trimestriel de la croissance révèle un panorama moins heureux. En effet, le deuxième semestre 2000 a été l'occasion d'un décrochage sensible du taux de croissance trimestriel par rapport à ses tendances immédiatement antérieures. Aux troisième et quatrième trimestres 2000, la croissance du PIB s'est établie successivement à 0,5% puis 0,6% ; durant les deux trimestres précédents, elle s'élevait encore à 0,9%, puis 0,8%. Avec la stabilisation du taux de croissance trimestriel à 0,5% environ au premier trimestre 2001, on pouvait espérer que l'économie de la zone euro allait progressivement se diriger vers un rythme de croissance annuelle de 2% environ. Cependant, les résultats provisoires relatifs au deuxième trimestre 2001 font apparaître un taux de croissance pratiquement réduit à zéro (0,1%), ramenant à 1,7% seulement la croissance du PIB par rapport au même trimestre de l'année 2000 (33). La demande intérieure est le facteur principal de cet affaiblissement. Alors qu'elle avait crû en moyenne de 3,1% pendant l'année 1999, en accélérant progressivement depuis le deuxième trimestre (+ 0,4%) jusqu'au quatrième trimestre (+ 1,1%), elle semblait devoir se stabiliser, aux deux premiers trimestres 2000, autour d'un taux de 0,8%, ce qui correspondait à une croissance annuelle de 3,2% environ. Cependant, le troisième trimestre 2000 a connu une quasi-stagnation de la demande intérieure (+ 0,2%), à peine corrigée le trimestre suivant (+ 0,5%). L'année 2001 a confirmé jusqu'à présent à la fois la baisse de régime de la demande intérieure (croissance nulle au premier trimestre et limitée à 0,5% au deuxième) et la volatilité de cette composante du PIB. En définitive, le taux de croissance de la demande intérieure par rapport au même trimestre de l'année précédente connaît une érosion régulière depuis l'été 2000, comme le montre le graphique ci-après. ÉVOLUTION DU TAUX ANNUEL DE CROISSANCE (en % par rapport au même trimestre 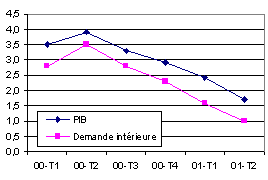 Source : BCE, Bulletin mensuel, août et septembre 2001 L'analyse des deux principales composantes de la demande intérieure confirme le diagnostic d'un ralentissement qui affecte l'ensemble des agents économiques de la zone euro. ÉVOLUTION DU TAUX ANNUEL DE CROISSANCE (en % par rapport au même trimestre 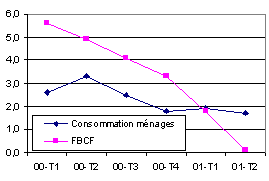 Source : BCE, Bulletin mensuel, août et septembre 2001 La consommation des ménages est passée d'un rythme de croissance annuelle de 3% en moyenne sur le premier semestre 2000 à un rythme de 2% sur le premier semestre 2001. La formation brute de capital fixe, qui augmentait de près de 5% par an entre 1998 et 1999, a brutalement freiné tout au long de l'année 2000. Elle a même diminué de 0,1% au quatrième trimestre 2000 et de 0,8% au deuxième trimestre 2001, ce qui, compte tenu de l'inertie positive acquise au cours des autres trimestres, ramène à zéro la croissance du deuxième trimestre 2001 par rapport au deuxième trimestre 2000. Les développements précédents suggèrent que le ralentissement mondial n'a pas fait « dérailler » à lui seul le train de la croissance européenne en sapant les bases de la demande interne : - d'une part, le recul temporel montre qu'un ralentissement américain n'exerce d'impact sur la croissance européenne qu'avec un délai de un à deux trimestres. Or, dans le cas présent, les ruptures de tendance de la demande interne sont quasi simultanées, ce qui suggère que les Etats-Unis n'ont pas eu de rôle moteur dans la rupture constatée en Europe ; - d'autre part, nul ne conteste le fait que les économies de la zone euro ont été soumises à des chocs indépendants de la conjoncture américaine. Ainsi, la remontée des prix du pétrole observée à partir de 1999 et consolidée en 2000 a rogné le pouvoir d'achat des ménages et fragilisé l'appétence de ceux-ci pour la consommation. De plus, la formation brute de capital fixe a pu subir les contrecoups des investissements importants consentis, ces dernières années, dans des secteurs bien déterminés, comme les équipements informatiques ou de télécommunications. Il faut reconnaître également que l'érosion de l'euro sur le marché des changes a renchéri les prix à l'importation et pesé, de ce fait, sur les conditions de profitabilité des entreprises. Enfin, le resserrement progressif de la politique monétaire de la Banque centrale européenne - caractérisé par celle-ci comme un processus de normalisation après les conditions très accommodantes instaurées entre avril et novembre 1999 - a exercé une influence restrictive sur la demande des ménages comme des entreprises (34). Le ralentissement de 2000-2001 apparaît donc très différent de celui de 1998-1999. c) L'image du « trou d'air » n'est pas adaptée au ralentissement actuel Il est intéressant de comparer la situation actuelle avec les deux précédents ralentissements, en 1995 et 1998 (35). Le ralentissement de 1995 a consisté en sept trimestres de croissance au taux annuel moyen de 1,3% et a été caractérisé par la faiblesse de l'investissement et des exportations ainsi que par mouvement général de déstockage. Le ralentissement de 1998 s'est limité à trois trimestres de croissance au taux annuel moyen de 1,5% et a été essentiellement causé par un retournement brutal et intense du commerce extérieur - du fait de la profonde crise dans laquelle étaient plongés, à l'époque, les pays d'Asie émergente, alors que le déstockage a été plutôt modeste et que les investissements n'ont été affectés qu'à la marge. Pendant ces deux épisodes, la consommation n'a pas subi de choc mesurable avec les méthodes et agrégats de la comptabilité nationale, étant entendu qu'elle était sensiblement inférieure en 1995 (taux de croissance de 1,5%) par rapport à 1998 (taux de croissance de 3% environ). S'interroger sur les perspectives de l'année 2002 implique d'abord que l'on tente de rendre intelligible le processus engagé en 2000 et développé en 2001. Trois approches peuvent être retenues pour caractériser la phase que traverse depuis quelques trimestres l'économie européenne. · On peut, en premier lieu, considérer que celle-ci est en train de « revenir à la normale » après une période de croissance forte qui ne correspond pas à sa tendance de long terme. Sous l'autorité de M. Patrick Artus, le service de la recherche de CDC Ixis considère ainsi que la forte croissance récente a son origine dans des causes essentiellement transitoires (36). Selon lui, « les gains de productivité atteignent 1½% environ, la population active croît à peine avec le vieillissement, de 0,1 à 0,2% par an. Le surplus de croissance des trois dernières années n'est donc pas en réalité dû à une hausse de la croissance réalisable à long terme, mais à des facteurs exceptionnels et transitoires ». Les facteurs identifiés sont au nombre de trois. La politique économique est devenue plus neutre, dans ses composantes monétaire et budgétaire. La baisse de l'euro a stimulé l'activité industrielle. La plus grande flexibilité du marché du travail (en dehors de l'Allemagne) a permis un rattrapage de l'emploi dans les services et la distribution. « Mais les effets de ces améliorations de l'environnement macro-économique n'apparaissent qu'une fois et ne se renouvelleront pas dans le futur. La zone euro n'était donc pas protégée par une si forte dynamique interne ». Il semble que des considérations similaires aient prévalu dans l'analyse de la situation économique de la zone euro effectuée, pendant tout le premier semestre de l'année 2001, par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. En février et mars 2001, M. Wim Duisenberg, président de la BCE, estimait que la croissance devait se poursuivre à un rythme « raisonnablement robuste », tout en faisant part de l'existence d'un aléa négatif. Au mois d'avril 2001, M. Duisenberg indique que l'affaiblissement de la croissance sera plus fort que ce qui était envisagé auparavant. Cependant, il estime que l'économie de la zone euro devrait se caler désormais sur sa croissance potentielle (37). La référence à la croissance potentielle est maintenue, au cours des conférences de presse ultérieures. Il faut attendre celle tenue le 30 août dernier pour la voir disparaître du discours du président de la BCE. Il semble donc que, pendant quelques mois, le Conseil des gouverneurs ait caressé l'idée d'une « normalisation » des conditions de croissance dans la zone euro, à la faveur du ralentissement mondial qui pouvait agir comme le catalyseur d'une évolution souhaitable - puisque chacun sait que, dans l'optique traditionnelle des banquiers centraux, il n'est pas prudent qu'une économie dépasse de façon prolongée son taux de croissance potentielle. · On peut, par ailleurs, analyser les évolutions de la croissance européenne en termes de cycle. Dans cette optique, le ralentissement des années 2000 et 2001 peut trouver une interprétation qui le fasse apparaître comme une phase particulière, mais normale, d'un cheminement cyclique européen qui reste à découvrir. En association avec la London School of Economics, le département des études de l'OFCE a publié récemment une tentative de caractérisation des mouvements cycliques, qui s'intéresse au partage de la trajectoire des PIB des pays de la zone euro et de cette zone elle-même entre tendances de long terme et cycles conjoncturels (38). De cette étude très riche, votre Rapporteur général se limitera à extraire les éléments suivants. Il apparaît que l'on peut mettre en évidence un mouvement cyclique de la zone, prise dans son ensemble. Ce mouvement mêle, pour une moitié, des oscillations courtes - d'une période approximativement égale à trois ans - et, pour l'autre moitié, des fluctuations plus lentes, dont la période est légèrement inférieure à une décennie. La composition de ces deux mouvements indépendants rend complexe le profil global du cycle européen mais semble avoir un pouvoir descriptif correct, comme en témoignent les schémas qui illustrent l'article publié, au-delà même des calculs proprement économétriques. Les auteurs montrent que le cycle court est lié au comportement de stockage des entreprises alors que le cycle long recouvre les rythmes fondamentaux de l'investissement. Par ailleurs, les auteurs analysent les relations entre le cycle européen et les différents cycles nationaux des pays composant la zone. Ils font apparaître une composante commune des cycles nationaux, qui transparaît dans le cycle européen global, et des composantes spécifiques, qu'ils associent à des impulsions différenciées entre les Etats membres (chocs asymétriques). Votre Rapporteur général reviendra sur l'hétérogénéité de la zone euro, notamment dans sa réponse à un choc économique, dans les parties ultérieures du présent rapport général (39). A ce stade, votre Rapporteur général souhaite souligner le point suivant : « les deux composantes cycliques européennes peuvent, selon les circonstances, s'amplifier réciproquement (au moment du premier choc pétrolier, ou lors de la récession de 1993, par exemple) ou au contraire se compenser, jusqu'à se neutraliser (en 1994-95, la reprise du stockage est largement neutralisée par l'inertie de l'investissement). Au milieu des années 1990, les deux composantes cycliques ont été largement disjointes : la langueur persistante de l'investissement européen, après la récession du début de la décennie 1990, s'est opposée aux sursauts conjoncturels qui ont pris appui sur le comportement de stockage ». Les conclusions de cette étude font donc apparaître deux risques : - il n'est pas impossible qu'un point bas du cycle long soit atteint au cours de l'année 2002, compte tenu de la périodicité mesurée pour le cycle (9 à 10 ans) et de la date du précédent point bas (1993) ; - il n'est pas impossible que le cycle court soit en phase avec le cycle long, provoquant ainsi une multiplication des effets dépressifs de chaque cycle pris séparément. Bien sûr, le pire n'est pas certain : les calculs des auteurs, comme les graphiques inclus dans la publication précitée, montrent que la périodicité effective du cycle court est assez variable et que les dates des points haut et bas successifs peuvent être sensiblement décalées d'un cycle sur l'autre. Il résulte de cette « régularité souple » que l'on ne peut prédire avec certitude le positionnement relatif des cycles long et court. D'ailleurs, votre Rapporteur général estime que l'analyse des fluctuations ne peut se limiter à mettre en _uvre le cadre théorique mécanique, rigide, des cycles mais qu'elle doit nécessairement s'appuyer sur une appréciation globale des faits et tendances qui influent sur le comportement des acteurs économiques. · En dernier lieu, on peut estimer que les tendances récentes de l'économie européenne peuvent être interprétées comme un freinage violent - plus violent et plus rapide que ce que pourrait laisser supposer les mécanismes classiques d'ajustement en fin de cycle - qui révèle les faiblesses structurelles de la zone et, de plus, limite les moyens d'y remédier car ce freinage intervient à un mauvais moment dans la dynamique européenne. Dans cette optique, le ralentissement actuel pourrait n'être que le prélude à une phase prolongée de croissance « molle ». Par exemple, le bureau de recherche économique européenne de Goldman Sachs estime que l'Europe reste handicapée par le rythme trop lent, à son goût, de réformes de structure (40). Pourtant, le Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, avait fixé aux Etats de la Communauté européenne l'objectif ambitieux de devenir l'économie la plus dynamique à la fin de la décennie. Cet élan avait été renouvelé lors du Conseil européen de Stockholm, en mars 2001, et entériné lors de l'adoption des Grandes orientations de politique économique par le Conseil des ministres, en mai 2001. Cependant, les experts de Goldman Sachs estiment que les progrès réalisés jusqu'ici et prévisibles dans un proche avenir ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sans dénier toute pertinence à certains des arguments avancés, force est à votre Rapporteur général de constater que les appréciations portées sur les politiques conduites en Europe ressemblent par trop au florilège classique des zélateurs du libéralisme conquérant : - les politiques économiques (notamment budgétaires) ne seraient pas assez hardies, comme en témoigneraient les perspectives d'aggravation des déficits publics en 2001 et les réactions irlandaises au regard des observations présentées par les Etats membres quant aux orientations de sa politique budgétaire ; - les réformes du marché du travail ont été importantes mais se heurteraient encore à des résistances d'arrière garde des syndicats, quant aux modes de détermination des salaires. Par ailleurs, des « reculs » auraient été observés dans certains pays (41) ; - la déréglementation serait confrontée à des pratiques d'obstruction de la part de certains pays, notamment dans le secteur des télécommunications et de l'énergie (la France peur être visée...) - l'harmonisation européenne en matière de services financiers serait inutilement bloquée par des malentendus entre la Commission européenne et le Parlement européen ; - les charges fiscales pesant sur les entrepreneurs seraient toujours trop élevées, malgré les évolutions jugées positives qui ont été observées ces dernières années, dans la plupart des pays. D'autres griefs s'accumulent encore, avant que tombe la sentence : « Compte tenu de la faible visibilité des réformes, la confiance des marchés dans les politiques économiques européennes reste faible, ainsi que les perspectives de croissance ». Il va de soi qu'en la matière, il convient de se garder de toute appréciation excessive. Votre Rapporteur général ne disconvient pas que l'Europe n'est pas ce paradis ultra-libéral dont rêvent peut-être encore certains. Et c'est bien heureux ainsi. Il est certainement hâtif d'en tirer des conclusions aussi définitives quant aux perspectives européennes de croissance. d) Quelles perspectives pour 2002 ? Contrairement aux attentes qui avaient pu être formulées au début de l'année, la zone euro ne pourra vraisemblablement pas être en 2002 un pôle de croissance suffisamment puissant pour entraîner l'économie mondiale et pallier le freinage brutal imposé par les Etats-Unis. Votre Rapporteur général souhaite pourtant se garder de toute vision « catastrophiste » car les facteurs de résistance de l'Europe ne sont pas négligeables. · En premier lieu, la zone euro ne souffre pas des déséquilibres massifs qui grèvent aujourd'hui la capacité des Etats-Unis à absorber le choc de la récession annoncée : - il est exact que la balance des paiements courants a connu un déficit de 5,8 milliards d'euros en 1999 et de 34,7 milliards d'euros en 2000. Cependant, votre Rapporteur général remarque que le déficit courant du premier semestre 2001 a été ramené à 11,2 milliards d'euros au lieu de 20,7 milliards d'euros sur la même période de l'année 2000 (42). De plus, la valeur du déficit de la zone euro pour l'année 2000 est de dix fois plus faible que celle du déficit des Etats-Unis, qui a atteint le chiffre record de 435 milliards de dollars. Chacun sait que le déficit courant des Etats-Unis est considéré de longue date comme un facteur essentiel de fragilité des échanges extérieurs américains, de la valeur du dollar et, in fine, de la croissance américaine ; - il ne semble pas que l'économie européenne ait constitué des capacités de production excessives pendant la période récente de croissance élevée. La mesure du taux d'utilisation des capacité de production pendant la décennie 1990 montre que, par delà les fluctuations cycliques attendues (1993-94, 1996, 1999), le taux d'utilisation des capacités de production suit une tendance légèrement croissante, ce qui traduit un effort d'investissement moindre qu'aux Etats-Unis (43). Dans ce pays, le taux d'utilisation des capacités de production se situe sur une tendance très sensiblement décroissante depuis 1995. Tout au plus peut-on s'interroger sur la situation de certains secteurs d'activité, comme les télécommunications, où l'explosion de la demande a pu provoquer des anticipations excessives de la part de certains opérateurs (pour la construction des réseaux) et des fournisseurs d'équipement ; - l'endettement du secteur privé ne paraît pas excessif, même si les taux de croissance, de l'ordre de 10%, observés depuis dix-huit mois peuvent paraître élevés. Bien que les pays de la zone euro se trouvent, sur ce point, dans des situations assez diverses, il apparaît que l'endettement des ménages représente environ 50% du PIB en 1999 et celui des sociétés non financières 60% environ (44). Ces taux se comparent très favorablement à ceux relevés pour les Etats-Unis, à savoir 74% du PIB pour les ménages et 73% du PIB pour les entreprises, sur la période 1996-2000 (45). L'économie européenne est donc moins exposée que l'économie américaine au processus dangereux de « déflation par la dette », qui peut plonger un pays dans une période prolongée de stagnation, comme le montre l'exemple éclairant du Japon depuis l'éclatement des « bulles » immobilières, boursières et de crédit, en 1990. · Par ailleurs, votre Rapporteur général considère que certains adjuvants de la demande interne n'ont pas encore produit tous leurs effets bénéfiques. Le processus de désinflation a été retardé par les impacts transitoires des crises alimentaires sur les prix à la consommation, comme par une transmission peut-être plus forte que prévue des augmentations de prix de l'énergie aux autres secteurs de l'économie. Les résultats des tout derniers mois suggèrent qu'en matière d'inflation, le pire est passé et que la zone euro est désormais sur un chemin de désinflation qui devrait ramener dans quelques mois les indices harmonisés en deçà de la valeur critique de 2%, surveillée par la Banque centrale européenne. On peut prévoir que cette désinflation apportera au pouvoir d'achat des ménages une contribution très favorable, donnant ainsi une source de dynamisme à la consommation privée. Le revenu disponible des ménages devrait également être soutenu par les programmes massifs d'allégements d'impôts décidés par plusieurs Etats européens, antérieurement à la détérioration de la situation économique. En la matière, la France n'est pas en reste, avec le plan triennal engagé dès l'an dernier par le Gouvernement. Il semble que ces programmes n'aient pas encore produit tous leurs effets et que l'on puisse donc attendre de ce retard des influences positives, en 2002, sur la situation financière des ménages et la consommation. · Pour qu'apparaisse réellement un supplément de revenu disponible, il faudra, bien entendu, que deux conditions soient remplies. D'une part, la situation de l'emploi ne doit pas se détériorer. Il est d'ores et déjà acquis que l'emploi ne devrait pas progresser au même rythme que les années précédentes et que, dans certains pays, le taux de chômage pourrait voir sa baisse stoppée. Cependant, il existe encore trop peu d'éléments permettant d'estimer de façon précise si le frein ainsi opposé à l'augmentation globale du revenu distribué dans l'économie excédera ou non les effets bénéfiques de la désinflation. D'autre part, le partage du revenu disponible entre épargne et consommation ne devra pas être affecté de façon significative par la détérioration de la confiance des ménages. Votre Rapporteur général ne se hasardera pas à émettre un quelconque pronostic sur les évolutions du taux d'épargne entre les années 2001 et 2002 : le comportement d'épargne des ménages résiste encore assez largement aux tentatives de modélisation, même si la littérature économique suggère de nombreuses pistes explicatives. Au demeurant, le jugement que l'on peut porter sur les perspectives d'achèvement de l'année 2001 et de déroulement de l'année 2002 ne peuvent faire l'impasse sur le caractère hétérogène de la zone euro et sur les différences sensibles qui peuvent exister entre les pays membres. L'Allemagne, notamment, est l'un des « lieux » dans lesquels se joue la vigueur ou la faiblesse de la croissance européenne en 2002. 2.- Les faiblesses du moteur interne : l'Allemagne connaît une situation économique difficile a) La conjoncture économique de l'Allemagne est aujourd'hui plus difficile que celle de la zone euro Après une expansion de son PIB de 1,6% en 1999, l'économie allemande a connu une croissance de 3% en 2000, soit le taux le plus élevé depuis la réunification. Pourtant, il apparaît que l'année 2000 a été très hétérogène et que, notamment, le rythme de la croissance s'est fortement ralenti dès le troisième trimestre de l'année 2000. Ainsi, alors que le PIB avait cru de 1% et 1,2% respectivement aux premier et deuxième trimestres de 2000, la croissance ne s'est élevée qu'à 0,3% et 0,2% au cours, respectivement, des troisième et quatrième trimestres. De fait, en glissement annuel, la croissance s'est établie à 4% au cours du premier semestre de 2000 et à 1% au cours du second. Ce ralentissement soudain du rythme d'expansion a été suivi d'une stagnation à faible niveau du taux de croissance au cours du premier semestre 2001. Ainsi, la croissance s'est élevée à 0,4% et 0,1% au cours des premier et deuxième trimestres de l'année 2001. Il apparaît qu'en glissement annuel, l'expansion de l'économie a atteint 1,4% et seulement 0,6% respectivement aux premier et deuxième trimestres de l'année 2001. Ce dernier taux constitue le résultat le plus faible constaté depuis le premier trimestre de l'année 1997. Si l'activité de la zone euro a connu une évolution similaire à celle de l'Allemagne depuis le début de l'année 2000, il apparaît que le ralentissement de l'expansion y a été moins brusque et moins violent que dans ce pays. Ainsi, pour chacun des quatre trimestres de l'année 2000, la croissance s'est établie à 0,9%, 0,7%, 0,6% et 0,6%. Au total, d'ailleurs, la croissance s'est élevée en 2000 dans la zone euro à 3,4% contre 3% pour la seule Allemagne. En rythme annuel, la croissance s'est établie à 3,5% au début de l'année 2000 et à 2% à la fin du quatrième trimestre, soit des taux supérieurs à ceux constatés en Allemagne. Selon la direction de la prévision du ministère de l'économie des finances et de l'industrie, ce décalage devrait s'accentuer au cours de l'année 2001 : « Au total, la croissance de la zone euro atteindrait 2,1% en 2001 [contre 1,3% en Allemagne]. Les rythmes de croissance [...] resteraient supérieurs à la moyenne en France et en Italie, tandis que l'écart de croissance entre l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro se creuserait. » (46). Par ailleurs, les prévisions pour l'année 2002 confirment le maintien d'une croissance plus forte dans la zone euro qu'en Allemagne. A titre d'exemple, les études économiques de la banque BNP-Paribas estiment que la croissance de la zone euro devrait s'élever à 2,2% en 2002, contre 1,9% en Allemagne (47). b) Ce constat s'explique par une plus forte sensibilité de l'économie allemande au commerce international, mais aussi par des faiblesses intrinsèques La dégradation prononcée de la situation économique en Allemagne peut être expliquée, en premier lieu, par la dégradation de la situation économique internationale à compter du second semestre 2000. On peut synthétiser cette situation par deux éléments : - l'économie allemande a subi un choc négatif d'offre dû à l'augmentation des prix du pétrole tout au long de l'année 2000. Il apparaît que ce choc a rendu nulle, dès l'été 2000, la progression jusqu'alors constatée du pouvoir d'achat des ménages. Cela signifie que la demande a été touchée de façon substantielle dès cette date ; - l'économie allemande a subi un choc extérieur négatif de demande dû au ralentissement de l'expansion de l'économie des Etats-Unis d'Amérique à compter du second semestre de l'année 2000. Il n'est pas difficile de constater que ces chocs n'ont en aucun cas été spécifiques à l'économie allemande. Il apparaît que certaines caractéristiques propres à l'économie allemande ont cependant entraîné une dégradation accrue de sa situation. Il est certain, en premier lieu, que l'économie allemande est plus sensible que les autres économies de la zone euro à la conjoncture internationale. Ainsi, depuis la fin de la récession du début de la décennie 1990, la contribution du commerce extérieur à la croissance, positive ou négative, est plus aiguë en Allemagne que partout ailleurs dans la zone euro. Ce constat peut être directement relié à la structure de l'économie allemande et, notamment, à la structure de son commerce extérieur, comparée à celui de la zone euro dans le tableau suivant :
Il ressort de ce tableau que le commerce extérieur allemand est plus sensible que celui de la zone euro dans son ensemble aux fluctuations de la demande en biens d'équipement et en automobiles. Or, les fluctuations de la progression du commerce mondial sont aujourd'hui avant tout des fluctuations liées au commerce international des biens d'équipement. En conséquence, l'économie allemande est plus liée au cycle mondial que ne le sont les autres économies de la zone euro. Il apparaît de surcroît que la structure globale de l'économie allemande constitue un accélérateur des chocs externes issus de la situation du commerce international. En effet, l'économie allemande, à l'image, d'une certaine façon, de la structure de son commerce extérieur, est plus dépendante que les autres économies de la zone euro de la production industrielle, c'est-à-dire de la production de biens d'équipement et d'automobiles. On relève ainsi qu'en 1998, les secteurs de l'industrie et de la construction rassemblaient 34% des emplois privés en Allemagne contre 24% en France. Par ailleurs, le secteur des services rassemblait 40% des emplois en Allemagne contre 51% en France. En volume, 33% de la valeur ajoutée en Allemagne a pour origine le secteur industriel en 1998, contre 21% en France en 2000 (48). Dès lors, un choc de demande négatif externe signifie aussi un choc négatif interne de demande, notamment par les conséquences du choc externe en termes d'emplois. Ce raisonnement peut constituer une explication à la forte remontée du chômage constatée depuis le mois de janvier 2001 en Allemagne. Cette remontée du chômage a été plus forte et plus précoce que partout ailleurs dans la zone euro. Elle ne peut avoir que des effets très négatifs sur la vigueur de la demande intérieure, que l'on considère directement le volume de la demande ou la propension à consommer, c'est-à-dire le moral des ménages. L'économie allemande a donc été plus affectée que les autres économies de la zone euro par les chocs externes intervenues au cours de l'année 2000, du fait de la place privilégiée de la production des biens industriels, notamment des biens d'équipements, dans la valeur globale créée par elle ainsi que dans son commerce extérieur. Cependant, s'il est certain que la faiblesse actuelle du rythme d'expansion de l'économie allemande a au moins en partie pour origine sa vulnérabilité particulière aux chocs externes, il apparaît que cette économie souffre de faiblesses intrinsèques, dont les effets sont visibles depuis la sortie de la récession de 1993 qui avait suivi la réunification. Il faut en effet relever que depuis 1995 et à l'exception du premier semestre de l'année 2000, la croissance allemande est continuellement moins élevée que l'expansion observée dans la zone euro. Il existe donc aussi des raisons structurelles à l'actuelle faiblesse économique de l'Allemagne. La part relativement importante de la production industrielle dans la valeur ajoutée créée par l'économie allemande, au regard de la structure des économies comparables d'autres pays occidentaux, constitue certainement l'indice d'une faiblesse économique. Il semble en effet que l'économie allemande ne parvienne pas à créer d'emplois de service, notamment dans le secteur des services à la personne ou encore dans le commerce de détail. Deux éléments peuvent permettre d'expliquer ce phénomène : - il faut reconnaître que le coût du travail en Allemagne constitue un obstacle à la création d'emplois de service à faible valeur ajoutée ; - l'existence d'une certaine rigidité dans la rencontre de l'offre et de la demande n'est pas propice au développement des emplois dans le commerce de détail. On peut notamment évoquer la réglementation relative à l'ouverture des magasins le samedi. La spécialisation économique relative de l'Allemagne, soit une place importante de la production industrielle dans l'ensemble de l'économie, a donc aujourd'hui peut-être autant son origine dans le maintien d'une tradition économique industrielle que dans une certaine incapacité de cette économie à développer le secteur des services. Il faut relever que le problème évoqué du coût du travail est certainement issu de phénomènes économiques assez anciens. Il est évident que la progression de la productivité dans les Länder orientaux depuis la réunification n'a pas été suffisamment rapide pour qu'elle puisse être calée sur la forte progression des salaires, observée depuis dix ans dans cette partie de l'Allemagne. Par ailleurs, il semble que la compétitivité-coût de l'Allemagne soit aujourd'hui largement réduite du fait du taux de change au niveau duquel le mark (DM) a été intégré dans l'euro. Il faut rappeler que, pour l'essentiel, ce taux de change a été fixé au moment de la réunification, soit à un moment où la politique monétaire allemande était très restrictive, afin notamment de limiter les risques d'inflation issus de la réunification, risques en grande partie liés au choix, politiquement légitime mais économiquement risqué, d'une parité de un pour un entre le DM et l'Ostmark. Le DM s'est ainsi beaucoup apprécié à cette époque, notamment après les dévaluations des monnaies britannique, italienne et espagnole en 1992 et 1993. Au regard de la compétitivité et de la croissance de l'Allemagne après la récession de 1993, il n'aurait pas été économiquement absurde de procéder à une dépréciation du DM, avant de fixer les taux de change sur la base desquels a été mis en _uvre l'euro. Les mécanismes décrits ont sans doute abouti à une augmentation assez forte du coût du travail, elle-même partiellement à l'origine de la difficulté de l'économie allemande s'agissant du développement de l'emploi dans le secteur des services à faible valeur ajoutée. Il est probable que l'augmentation évoquée du coût du travail aura pour effet, à l'avenir, une dégradation de la position relative de l'Allemagne s'agissant du commerce international. Cette baisse probable des parts de marché de l'Allemagne sur les marchés internationaux n'a pas encore eu lieu du fait, certainement, d'un certain délai d'ajustement des choix des opérateurs internationaux face aux prix qui leur sont proposés et aussi de la réputation dont bénéficient les produits allemands sur les marchés internationaux, avantage qu'il appartient d'ailleurs aux entreprises allemandes d'entretenir. Au total, la dégradation de la compétitivité allemande a pour effet un niveau d'investissement productif faible, de la part des entrepreneurs allemands mais aussi de la part des investisseurs allogènes, ce qui limite, par définition, les taux de croissance constatés et à venir. Une autre faiblesse de l'économie allemande est le vieillissement de sa population qui, entamée déjà depuis 1995, est plus précoce et sera plus durable et brutal que le vieillissement de la population des autres pays européens, comme le montre le tableau suivant :
Quelles que soient les solutions, augmentation des cotisations, baisse des taux de remplacement ou encore création de systèmes de retraites par capitalisation, envisagées et mises en _uvre afin de limiter la perte de revenus des retraités qui devrait résulter du vieillissement évoqué, il ne paraît pas possible d'éviter à l'avenir un affaiblissement structurel de la demande intérieure dû à la limitation du niveau des pensions et à la hausse du taux d'épargne des ménages. L'ajustement devrait être en Allemagne plus sévère que dans le reste de la zone euro, sachant cependant qu'il sera lissé sur plusieurs années. Au total, il semble que l'Allemagne subit de façon plus aiguë que les autres pays de la zone euro, les effets du ralentissement actuel du rythme d'expansion de l'économie mondiale et devrait connaître à l'avenir, de façon durable, une croissance moins élevée que celle qui sera constatée en moyenne dans lesdits pays. Il est donc nécessaire de considérer les moyens par lesquels il serait possible de mettre en _uvre des politiques économiques pertinentes et concertées au sein de la zone euro, alors même que la situation de l'Allemagne démontre que les situations économiques des Etats de cette zone devraient sensiblement diverger à l'avenir. 3.- Mettre en _uvre des politiques économiques pertinentes et cohérentes dans la zone euro a) Le maintien à l'avenir de divergences économiques structurelles au sein de la zone euro crée un risque potentiel de mise en _uvre de politiques économiques incohérentes et contre-productives au sein de cette zone Il est certain que les difficultés actuelles de l'économie allemande ont un effet négatif sur la conjoncture des autres pays de la zone euro et ce, du fait de la forte intégration commerciale qui caractérise la zone euro. Ceci est d'ailleurs avant tout vrai pour la France. Par ailleurs, les problèmes internes de l'Allemagne et l'affaiblissement global du rythme d'expansion de l'économie mondiale rendent visibles l'hétérogénéité des situations économiques de la zone euro, qui leur préexistait, mais que les bons résultats économiques de la période 1998-2000 avaient contribué à masquer. L'apparition de difficultés économiques entraîne naturellement une attention plus soutenue concernant la mise en _uvre des politiques économiques monétaire et budgétaire, précisément parce que celles-ci sont sollicitées de façon plus aiguë. L'hétérogénéité des situations économiques dans la zone euro se manifeste douloureusement, dès lors que le constat est fait que la politique monétaire est, par définition, unique au sein d'une union économique et monétaire. Aujourd'hui, l'hétérogénéité des situations économiques dans la zone euro n'est pas contestable, au-delà de la sensibilité commune à chacune des économies de cette zone à la situation économique du reste du monde. Il existe au moins un pays à croissance faible et à inflation assez forte, soit l'Allemagne. Il existe des pays à croissance encore soutenue et à inflation faible, comme la France. Par ailleurs, l'Irlande est un pays à croissance très forte et à inflation forte. Il est évident que le réglage d'une politique monétaire commune à ces pays ne peut être que difficile. En admettant que les canaux de transmission à l'économie de la politique monétaire soient efficaces, on constate qu'il faudrait, dans l'absolu, des taux d'intérêts réels de court terme assez forts en Irlande afin d'éviter une augmentation trop importante de l'inflation, ce qui, dans le pis des cas, n'aurait pour effet que de freiner très partiellement la croissance, qui est forte. Par contre, pour la France, il faudrait des taux d'intérêt réels de court terme faibles, pour soutenir la croissance, une telle politique étant possible du fait de la faiblesse de l'inflation. Or, dans une union économique et monétaire, il ne peut jamais y avoir qu'un seul taux d'intérêt nominal de court terme. Si les taux d'intérêt réels de court terme sont différents d'un pays à l'autre, cela n'est possible qu'à raison de taux d'inflation différents dans ces pays. Le paradoxe vient du fait que si deux pays ont un même taux d'intérêt nominal de court terme, c'est le pays dont le taux d'inflation est le plus fort qui bénéficie du taux d'intérêt réel le plus bas et inversement. Autrement dit, dans une union économique et monétaire, plus l'inflation subie par un pays est forte, plus il bénéficie d'une politique monétaire accommodante et expansionniste et inversement. En conséquence, il est probable qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont négatifs en Irlande, alors que les autorités françaises peuvent légitimement estimer que la politique monétaire est par comparaison moins accommodante du point de vue de la situation économique française. Ce problème est consubstantiel à l'existence d'une union économique et monétaire au sein d'une zone dont les parties ne connaissent pas une situation économique homogène en termes de croissance de l'économie et d'inflation. On peut observer que, dans la zone euro, cette situation n'est corrigée ni par l'existence d'un budget fédéral dont le poids permettrait une redistribution entre pays compte tenu de l'hétérogénéité de leur situation économique respective, ni par une mobilité naturelle du facteur travail. Cependant, votre Rapporteur général estime qu'il est possible, comme il l'exposera ci-après, de fixer des règles de fonctionnement de la zone euro, relatives aux politiques économiques qui y sont menées, à même de corriger cette difficulté. Votre Rapporteur général estime par ailleurs que cette dernière ne remet pas en cause les gains économiques issus de l'euro que sont l'approfondissement de l'intégration du marché intérieur et l'économie des efforts produits dans un système de taux de changes flexibles ou ajustables, afin de définir les taux de changes les plus pertinents et de les défendre, le cas échéant, contre la spéculation. Il faut évoquer de plus, un autre risque, celui d'une absence de coordination entre la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE) et chacun des Etats de la zone euro, en charge des politiques budgétaires nationales. Si une certaine méfiance existe entre l'autorité monétaire communautaire et les autorités budgétaires nationales, ces dernières peuvent lutter contre les effets jugés indésirables d'une politique monétaire restrictive dont elles soupçonnent la mise en _uvre à l'avenir, par un accroissement du déficit budgétaire. De même, si l'autorité monétaire communautaire anticipe un tel accroissement, elle aura bien sûr tendance à mettre en _uvre une politique monétaire restrictive. Dans une telle situation, plus probable dès lors que le rythme d'expansion de l'économie est ralenti, le résultat est la mise en _uvre d'une politique monétaire trop restrictive pour chaque économie et la mise en _uvre de politiques budgétaires trop expansionnistes par chaque gouvernement. Il s'agit du policy mix qu'un certain nombre de pays européens, dont la France, ont connu dans la première moitié de la décennie 1990. Il est peu souhaitable que soient de nouveau mises en _uvre de telles politiques économiques. b) Améliorer la coordination des politiques économiques dans la zone euro L'élaboration d'un ensemble de politiques économiques pertinentes et cohérentes dans l'ensemble de la zone euro a certainement pour condition l'ajustement de certains des objectifs qui leur sont aujourd'hui assignés. S'agissant de la politique monétaire, il convient de s'interroger sur la pertinence de l'objectif chiffré de la BCE en termes d'inflation. Il ne s'agit ici de contester ni la nature de l'objectif, l'inflation, ni la valeur chiffrée choisie, soit 2% par an. Par contre, il est possible de s'interroger sur les deux points suivants : - l'objectif de la BCE ne tient pas compte des situations nationales ou des situations propres aux zones économiques distinctes de la zone euro. En effet, s'agissant de l'appréciation de l'objectif du plafond du taux d'inflation, la zone euro est considérée comme constituant un seul pays. En conséquence, le dialogue entre les autorités publiques en charge des politiques budgétaires et l'autorité publique en charge de la politique monétaire est presque impossible ; - la fixation d'un plafond du taux d'inflation comme objectif unique de la politique monétaire conduit inévitablement à des comportements de surréaction de la part de l'autorité publique en charge de la politique monétaire, dès lors que le taux d'inflation constaté s'approche du taux plafond ou oscille autour dudit taux. Deux pistes peuvent être évoquées, s'agissant respectivement de chacun de ces deux points : - la BCE pourrait utilement mettre en _uvre une réflexion s'agissant de l'introduction dans les indicateurs de conjoncture sur la base desquels elle met en _uvre sa politique monétaire, la situation propre à chaque Etat membre de la zone euro, en considérant notamment que l'hétérogénéité des situations doit être combattue. Le dialogue entre l'autorité publique en charge de la politique monétaire et chacune des autorités publiques en charge des politiques budgétaires de la zone euro deviendrait possible. De plus, la lutte contre l'inflation couplée à la lutte contre la dispersion des taux d'inflation permettrait une meilleure identification de la cause des décisions de la BCE, en permettant de lier celles-ci à la situation de certains Etats dont les taux d'inflation seraient, le cas échéant, éloignés de la moyenne communautaire ; - la BCE pourrait par ailleurs moduler un objectif de taux d'inflation avec des indicateurs relatifs à l'utilisation du crédit. Il est en effet peut-être plus pertinent d'agir dès lors qu'il est constaté que le crédit est utilisé avant tout pour acquérir des actions ou pour entretenir une spéculation sur les prix d'actifs immobiliers, plutôt que de se concentrer sur un dépassement minime de l'objectif de plafond du taux d'inflation. On peut d'ailleurs s'interroger sur le lien entre l'absence de ce type d'objectifs relatifs à l'utilisation du crédit dans la mise en _uvre des politiques monétaires contemporaines et la spéculation aberrante, sur le marché des actions, qui a concerné les entreprises de la dite « nouvelle économie » jusqu'au mois de mars 2000. Une évolution des objectifs de la politique monétaire de la zone euro devrait être accompagnée d'une modification et d'un renforcement des règles de la zone euro relatives aux politiques budgétaires qui y sont menées. En effet, même si les objectifs de la politique monétaire dans la zone euro prennent en compte, à l'avenir, la situation propre à chaque Etat membre de ladite zone, le fait que les Etats qui ont les plus forts taux d'inflation « bénéficient » ou « subissent » la politique monétaire la plus accommodante et inversement, demeurera inchangé. Dans ces conditions, chaque politique budgétaire devrait être suffisamment contra-cyclique, afin de tempérer ou neutraliser les effets d'une politique monétaire toujours pro-cyclique. Or, l'engagement du pacte de stabilité et de croissance, soit le maintien sous peine de sanctions d'un solde positif des comptes publics ou d'un solde négatif desdits comptes inférieur à 3% du PIB, ne permet en rien de qualifier la qualité d'une politique budgétaire et donc de constater dans quelle mesure celle-ci est contra-cyclique ou est pro-cyclique. Dès lors, il serait plus pertinent que soit fixé contractuellement pour chaque Etat, entre les autorités de la zone euro et cet Etat, une cible de politique budgétaire, qui serait définie en tenant compte de l'écart entre la croissance potentielle et la croissance constatée et la part de la dépense publique dans l'économie dudit Etat. L'écart évoqué permettrait de s'assurer du caractère contra-cyclique de la politique budgétaire mise en _uvre. La prise en compte de la part de la dépense publique dans l'économie nationale permet de régler la politique budgétaire sur la réalité de l'économie nationale. De plus, le choix de la part de la dépense publique dans l'économie nationale demeurerait ainsi celui de chaque Etat. Bien sûr, l'Etat dont le solde budgétaire constaté serait plus dégradé que le solde contracté, serait susceptible d'être sanctionné, pour le risque qu'il fait prendre à chacun des autres Etats de la zone euro d'une augmentation des taux d'intérêt réels. Ce dispositif permettrait, à tout le moins, de clarifier les débats communautaires relatifs à la politique budgétaire de certains Etats de la zone euro et, ainsi, d'apprécier l'opportunité des critiques émises par la Commission européenne au début de l'année 2001 à l'encontre des choix budgétaires de l'Irlande, pour laquelle la politique monétaire est aujourd'hui trop accommodante. Par ailleurs, ce raisonnement permet de légitimer les choix de la France. L'utilisation raisonnable, par la France, du stabilisateur budgétaire constitue un accompagnement approprié à l'actuelle politique monétaire, dont les effets accommodants sont en France moins marqués que dans le reste de la zone euro, du fait de la faiblesse relative de notre taux d'inflation. ___________________ N° 3320.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2002 : rapport général, tome I, volume 1. () D. Migaud, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2001, Tome I, volume 1, (p. 55). () Depuis la réunion du 26 septembre 2001, la direction de la prévision a estimé, dans le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances, à 0,7 point de PIB, en 2002, le possible impact dépressif des attentats sur la croissance américaine. () Il convient de noter, également, que Goldman Sachs présente une prévision de croissance pour l'Allemagne supérieure à celle retenue pour la France : 1,5% pour la première contre 1,3% pour la seconde. Cette vigueur relative de l'économie allemande peut surprendre, dans la mesure où le scénario international de Goldman Sachs est l'un des plus « noirs » parmi ceux de l'ensemble des membres du groupe technique : la prévision de croissance du PIB aux États-Unis est ramenée de 1% en 2001 à 0,5% en 2002, alors que le taux de change de l'euro passe de 0,95 en 2001 à 1,10 en 2002. () La Caisse des dépôts a indiqué, au cours de la réunion du groupe technique, qu'elle ramenait sa prévision de croissance pour 2002 de 2% à 1,6%. Cependant, votre Rapporteur général n'a pas cru devoir intégrer cette nouvelle évaluation dans le tableau récapitulatif présenté ci-après. En effet, la Caisse des dépôts a fait valoir qu'elle était en train de réviser l'ensemble de son compte prévisionnel relatif à la France. L'intégration du seul taux de croissance révisé dans le tableau récapitulatif aurait donc conduit à présenter un scénario français non homogène, ce qui n'est pas apparu satisfaisant à votre Rapporteur général. Il convient de remarquer, au demeurant, que la prise en compte de cette révision du taux de croissance du PIB ne modifie pas la moyenne des membres du panel, calculée avec une décimale de précision. () Il s'agit là des prévisions antérieure au 11 septembre, Morgan Stanley n'ayant pas fait connaître, à la date de la réunion ni à celle de la rédaction du présent rapport, ses éventuelles estimations révisées. () Dans ce tableau, par souci de sincérité et de transparence, votre Rapporteur général a considéré qu'il convenait de retenir la prévision révisée de la Caisse des dépôts, soit 1,6% en 2002, alors que la prévision antérieure au 11 septembre, portée dans les tableaux récapitulatifs, était de 2%. () Chacun conviendra qu'un écart de 0,1 point sur le taux de croissance n'a pas grande signification. () Le rapport annuel du FMI, publié le 26 septembre dernier, a de nouveau évalué les perspectives de croissance pour 2001 à 2,6% au niveau mondial et a estimé qu'un rebond interviendrait en 2002 à 3,5%. () Deux baisses supplémentaires sont intervenues les 17 septembre et 2 octobre 2001. () Perspectives économiques (n° 69, juin 2001). () Le cours du pétrole brut « brent daté » est l'un des cours de référence en la matière. Pour l'application du dispositif de stabilisation de la fiscalité sur les produits pétroliers, en vertu de l'article 12 de la loi de finances pour 2001, le décret n° 2001-58 du 18 janvier 2001 a précisé que « les cours du pétrole « brent daté » [...] sont les cours de clôture du « brent daté », exprimés en dollar par baril et publiés par l'organisme choisi par le directeur chargé des carburants ». Cet organisme est l'agence de presse Reuters. La particularité du cours du « brent daté » est de faire référence aux prix des livraisons de pétrole brut effectivement réalisées et non aux prix des transactions à terme. () Cf. flash n° 2001-157, 13 septembre 2001 () La nouvelle économie (La découverte, mars 2001). () Estimation officielle du Congressional Budget Office en mai 2001. () 1,3% pour 2001 et 2,1% en 2002. () M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de la Caisse des dépôts et consignations. () On pourra se reporter, par exemple, aux analyses de M. Stephen Roach dans « The New Global Contagion (II) », Global Economic Forum, Morgan Stanley Dean Witter, 20 juin 2001. () Par exemple, au mois d'avril 2001, l'OFCE estimait que « les pays de l'Union européenne seront relativement moins touchés. Leurs exportations vers les États-Unis ne représentent en moyenne qu'environ 8% de leurs échanges, soit 2 points de PIB, un peu moins pour la seule zone euro, et environ la moitié de leurs échanges sont intra-européens. [...] L'impact du ralentissement sur les exportations européennes sera atténué du fait de l'importance du poids des échanges intra-européens », OFCE, Observations et diagnostics économiques, n° 77, avril 2001 (p. 38). () S. Roach, « The New Global Contagion (I) », Global Economic Forum, Morgan Stanley Dean Witter, 18 juin 2001. Votre Rapporteur général rappellera également l'importance du Canada comme fournisseur de matières premières. () Source : Banque centrale européenne, Bulletin mensuel, août 2001 (p. 40). Le passage des exportations totales aux exportations extra-zone retient l'hypothèse d'un partage égal entre les expéditions intra-zone et les exportations extra-zone, sur la base des résultats du commerce extérieur en 2000 (voir Eurostat, communiqué de presse n° 35/2001, 23 mars 2001). () Source : Eurostat, communiqués de presse mensuels, mars 2000 à septembre 2001. () La chute des exportations s'observe en données corrigées des variations saisonnières. Elle s'établit à - 1% entre le deuxième et le premier trimestre 2001, pour le commerce de marchandises (Eurostat, communiqué de presse n° 93/2001, 7 septembre 2001). Mesurée sur l'ensemble des biens et services, en comptabilité nationale, elle s'établit à - 1,2% entre les deux mêmes périodes (Eurostat, communiqué de presse n° 94/2001, 13 septembre 2001). () Source : Prévisions économiques du printemps 2001, Économie européenne - Supplément A, n° 3-4, mars-avril 2001. Ce chiffrage s'applique à l'ensemble des quinze pays de la Communauté européenne et non à la seule zone euro. () T. Mayer, « How large is Euroland's external exposure ? », European Daily Comment, Goldman Sachs, 20 mars 2001. () L'étude de Goldman Sachs étant muette sur ce point, votre Rapporteur général retient ici le coefficient multiplicateur évoqué par les services de la Commission européenne dans ses prévisions de printemps 2001. () Cette analyse, qui ne prétend pas être profondément novatrice, ne prend évidemment pas en compte les effets néfastes de la dépréciation monétaire en termes de prix des importations. Au-delà des effets inflationnistes, par ailleurs bien connus, du renchérissement des importations, la dépréciation monétaire n'a que des effets limités sur la compétitivité des exportations qui incorporent une quantité élevée d'« entrants » importés, dont le coût augmente à raison même de cette dépréciation. () T. Mayer, « How large is Euroland's external exposure ? », European Daily Comment, Goldman Sachs, 20 mars 2001. () P. Artus, « Un ralentissement aux États-Unis peut-il conduire à une accélération de la croissance en Europe ? », CDC Ixis, Flash, n° 2001-9, 26 janvier 2001. () INSEE, Note de conjoncture, juin 2000 (p. 29). () J.M. Berk, K.H. Knot, « Co-Movements in Long Term Interest Rates and the Role of PPP-Based Exchange Rate Expectations », Document de travail du FMI, WP/99/81, juin 1999. () Source : Banque centrale européenne, Bulletin mensuel, septembre 2001 (p. 37). () Eurostat, communiqué de presse n° 94/2001, 13 septembre 2001. () La Banque centrale européenne a fait passer son principal taux directeur de 2,5% à 4,75% entre les mois de novembre 1999 et octobre 2000. () Les développements de ce paragraphe sont inspirés d'une note de recherche économique publiée par JP Morgan : « Euro area growth is slipping below potential », Global Data Watch, 8 juin 2001 (p. 11). () P. Artus, « Pourquoi a-t-on cru que la conjoncture européenne était indépendante de la conjoncture américaine ? », CDC Ixis, Flash, n° 2001-101, 15 juin 2001. () On sait que la BCE estime que la croissance potentielle de l'économie de la zone euro est approximativement égale à 2,5% par an. () G. Bentoglio, J. Fayolle, M. Lemoine, « Unité et pluralité du cycle européen », Observations et diagnostics économiques, n° 78, juillet 2001. () Le lecteur pourra, à cet égard, se reporter aux points 2 et 3 de la présente partie B. () European Economic Research Group, « Restructuring Euroland : Watching the Grass Grow », European Weekly Analyst, n° 01/17, 11 mai 2001. () Les experts évoquent ici la France et le choix du Gouvernement, approuvé par sa majorité, de renforcer récemment les exigences en matière de licenciements afin de mettre fin à des pratiques ou abus inadmissibles. La politique du gouvernement Schröder en matière de temps partiel ne trouve pas non plus grâce aux yeux des experts financiers. () BCE, Balance des paiements de la zone euro, Communiqué de presse statistique, 23 août 2001. () P. Artus, « Sur ou sous-investissement ?, Flash, n° 2001-157, 13 septembre 2001. () Calculs effectués à partir de D. Besnard, H. Vreeswijk, « Comptes de patrimoine financier dans l'Union européenne », Statistiques en Bref, Économie et finances - n° 33/2001, 1er août 2001. () Banque des règlements internationaux, 71ème Rapport annuel, juin 2001 (p. 31). () Direction de la prévision, Note de conjoncture internationale, juin 2001, page 60. () BNP-Paribas, études économiques, Conjoncture-taux-change, septembre 2001, pages 18 et 22. () Ces chiffres sont issus de la publication Flash, n° 2000-143 du 28 juillet 2000, publié par CDC Marchés, « L'Allemagne va-t-elle mieux ? Une comparaison avec la France. », pages 6 et 7. Cette publication utilisait en l'espèce des informations publiées par l'OCDE. © Assemblée nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

