-
 Financement de l'adaptation au changement climatique : audition de la Fédération bancaire française
Financement de l'adaptation au changement climatique : audition de la Fédération bancaire françaiseMercredi 3 avril, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a auditionné M. Etienne Barel, directeur général délégué de la Fédération bancaire française (FBF), accompagné de M. Jérôme Pardigon, directeur du département « Relations institutionnelles France » de la FBF, sur le financement de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique.
partager -
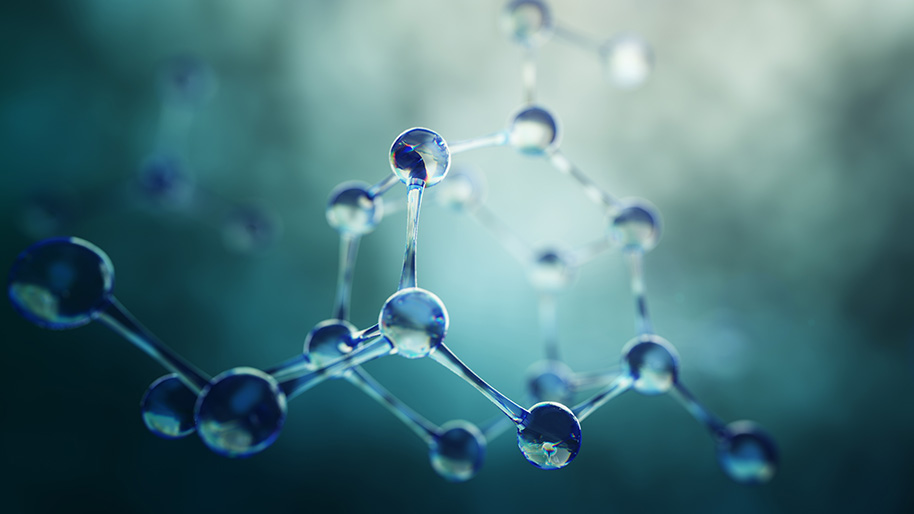 Protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées : adoption d'une proposition de loi
Protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées : adoption d'une proposition de loiMercredi 27 mars 2023, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné puis adopté la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées. Le texte sera débattu en séance publique le jeudi 4 avril dans le cadre de la journée réservée au groupe Ecologistes-NUPES. Nicolas Thierry (Ecolo-NUPES, Gironde) en est le rapporteur.
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ou « polluants éternels » sont un ensemble de familles de substances chimiques qui regroupent chacune plusieurs combinaisons d’atomes et que l’on ne trouve pas à l’état naturel. Le nombre de PFAS est difficile à évaluer. Si l’OCDE a répertorié 4 700 substances, le rapporteur explique qu’il en existerait entre 10 000 et 12 000. Elles ont pour point commun d’avoir une chaîne d’atomes de carbone et de fluor qui leur confère des propriétés très recherchées notamment un caractère à la fois hydrophobe et lipophobe et une grande résistance à la chaleur. Ces matériaux sont ainsi déperlants, antiadhésifs ou imperméables, aux graisses notamment. Les poêles et casseroles traitées au téflon constituent un exemple emblématique de l’usage de PFAS.
On retrouve ainsi des PFAS dans de nombreux produits et donc dans de nombreux secteurs industriels : dans les emballages alimentaires, des vêtements, certains équipements de sport, les mousses anti-incendie, les produits phytosanitaires, les dispositifs médicaux, les produits de nettoyage, les ustensiles de cuisine, les produits cosmétiques, des matières utilisées pour les revêtements de surface, etc…
L’ensemble de ces substances se caractérise par la grande stabilité chimique et thermique de la chaîne carbonée. Cette stabilité ralentit la dégradation de ces substances dans l’environnement et facilite ainsi l’intégration des PFAS dans des milieux où ils ne devraient pas être présents : dans les sols, dans l’eau, dans l’air et dans les tissus organiques aussi bien des êtres humains que de la faune et de la flore.
Nicolas Thierry explique que depuis plusieurs décennies les PFAS sont détectés dans divers milieux, au niveau mondial, et à des niveaux de concentration élevés. Par effet de bioaccumulation et de bioamplification, ils ont été retrouvés dans divers tissus animaux et humains. Le rapporteur souligne ainsi que selon Santé Publique France, 100 % de la population française présenterait des traces de PFOA et de PFOS dans le corps.
Selon l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, le principal mode d’exposition aux PFAS reste l’eau potable ou les aliments pollués, qui pourraient être contaminés par des ustensiles de cuisines, des emballages alimentaires ou par des sources résiduelles de PFAS dans l’environnement.
Le rapporteur s’alarme des « sérieux risques » et du « problème sanitaire d’une gravité et d’une portée inédite » que semblent représenter les PFAS : « altération de la fertilité, maladies thyroïdiennes, taux élevé de cholestérol, lésions au foie, cancer du rein et des testicules, réponse réduite aux vaccins ou faible poids à la naissance ».
Selon l’estimation fournie par les États membres de l’Union européenne qui ont déposés auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (Echa) une proposition de restriction de l’usage des PFAS en mars 2023, la quantité globale de PFAS émise à raison de produits nouvellement commercialisés dans l’Union était, en 2020, comprise entre 18 694 et 54 593 tonnes auxquelles s’ajoutent en stock 38 000 tonnes de gaz fluoré.
Le règlement européen POP, issu de la Convention de Stokholm, interdit certains PFAS (les PFOS depuis 2009, les PFOA depuis juillet 2020 et les PFHxS depuis juin 2022). Toutefois, les autres PFAS ne font pas l’objet de règlementation. Ils pourraient cependant faire l’objet de restrictions d’usage dans le cadre de la révision en cours du règlement REACH suite à une proposition de restriction visant spécifiquement les PFAS déposée par plusieurs États membres. Par ailleurs, la révision de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, transposée par l’ordonnance du 22 décembre 2022, élargit la recherche et la surveillance de certains PFAS dans l’eau potable.
Nicolas Thierry explique que la proposition de loi s’inscrit dans le cadre des travaux récents de la commission du développement durable : une table ronde sur les PFAS du 5 avril 2023 et l’examen de la proposition de loi de David Taupiac (LIOT, Gers) le 31 mai 2023 qui constituait « le premier texte soumis à la Représentation nationale sur les polluants éternels ». La proposition s’inscrit également dans la suite du rapport remis au Gouvernement le 4 janvier 2024 par Cyril Isaac-Cybille (Dem, Rhône) qui avait été chargé d’une mission temporaire sur les PFAS. Le député a présenté les conclusions de son rapport aux commissions des affaires sociales et du développement durable le 6 février 2024.
L’article 1er vise à réduire l’exposition de la population aux PFAS. Il introduit deux principales dispositions. Il vise, d’une part, à interdire dès le 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS (produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits cosmétiques, fart, produits textiles), avant d’interdire tous les produits contenant des PFAS le 1er janvier 2027. L’article 1er vise, d’autre part, à étendre le champ du contrôle sanitaire de l’eau potable à toutes les substances PFAS connues.
Sur le premier point, en commission, les députés ont restreint le champ de l’interdiction de fabrication, d’importation et d’exportation des PFAS aux ustensiles de cuisine, aux cosmétiques, au fart et aux textiles d’habillement qui est, par ailleurs, reportée au 1er janvier 2026. Ils ont également restreint l’interdiction générale aux seuls textiles et ont reporté l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2030 (CD85).
Sur le second point, les députés ont précisé que le décret encadrant la recherche des PFAS dans l’eau potable devrait fixer une liste non limitative de PFAS (CD69).
Enfin, les députés ont créé l’obligation pour le ministre chargé de la prévention des risques d’élaborer une carte publique, révisée chaque année, des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS (CD11).
En commission, les députés ont introduit un article additionnel interdisant les rejets industriels aqueux de PFAS par les installations classées IPCE (CD70).
L’article 2 introduit une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l’eau.
Les députés ont introduit un article additionnel créant l’obligation pour les agences régionales de santé de présenter le niveau d’exposition des populations (CD16).
partager -
 Révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques : présentation d'une proposition de résolution européenne
Révision du règlement européen REACH sur les substances chimiques : présentation d'une proposition de résolution européenneMercredi 20 mars, Nicolas Thierry (ECOLO-NUPES) a présenté la proposition de résolution européenne, adoptée par la commission des affaires européennes, visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Consulter le dossier législatif de la proposition de résolution
Revoir la réunion sur le portail vidéo
Chaque année, 300 millions de tonnes de substances chimiques sont produites sur le sol de l’Union, dont 74% sont considérées comme potentiellement dangereuses pour la santé et pour l’environnement par l'Agence européenne de l'environnement.
Le règlement REACH, clé de voûte de la régulation de la production et de l’emploi des substances chimiques dans l’Union européenne, date de 2007. Quatorze ans après, alors que l’état des connaissances scientifiques a désormais progressé, le rapporteur appelle à la révision de cette réglementation, alors que la Commission a reporté à plusieurs reprises sa mise à l'agenda depuis 2020.
La proposition de résolution européenne adoptée par la Commission européenne appelle notamment à un renforcement du rôle de l'Agence européenne pour les produits chimiques dans les procédures d'évaluation de la dangerosité des substances et à une meilleure prise en compte des "effets cocktails", soit des conséquences des mélanges entre produits chimiques dans la nature.
partager -
 Favoriser le réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires : adoption d'une proposition de loi
Favoriser le réemploi des véhicules au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires : adoption d'une proposition de loiMercredi 20 mars, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a adopté la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires.
Rapporteure : Marie Pochon (ECOLO-NUPES)
Le texte est issu d’une proposition de loi sénatoriale adoptée le 29 novembre 2023. Celle-ci sera examinée en séance publique le mercredi 27 mars 2024.
La rapporteure, Marie Pochon, explique que la proposition de loi est née du constat du « tarissement » de dons de voitures particulières aux garages solidaires du fait de la concurrence du dispositif de la prime à la conversion. Le texte vise ainsi à récupérer les véhicules les moins polluants et en état de rouler du flux des véhicules destinés à la casse dans le cadre de la prime à la conversion pour mettre les mettre à disposition des garages solidaires.
Les quelques 150 garages « solidaires », « participatifs » ou encore « associatifs » installés en France représentent les premiers services de location solidaire sur le territoire et souvent l’unique solution de mobilité solidaire existante. Ils permettent, avec les plateformes de mobilité, de mettre en œuvre le droit à la mobilité reconnu par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Citant les chiffres du Baromètre 2022 de la Fondation pour la nature et l’homme et Wimoov, la rapporteure rappelle que 13,3 millions de personnes sont en situation de précarité en matière de mobilité en France, soit plus d’un quart de la population âgée de 18 ans et plus. Parmi elles, 4,3 millions de Français, soit 8,5 % de la population, n’ont aucun équipement individuel ou abonnement à un service de transport collectif. Elle souligne qu’il s’agit donc « des personnes sans voiture, sans permis, sans abonnement aux transports en commun ou à un service partagé ».
La rapporteure poursuit en indiquant que plus d’un Français sur quatre déclare avoir renoncé à un déplacement au moins une fois lors des cinq dernières années et que 28% des demandeurs d’emploi ont renoncé au moins une fois à un emploi.
Le dispositif de prime à la conversion (PAC) mis en place 2015 permet de remettre son ancien véhicule polluant – Crit’Air 3 ou plus ancien -, à des fins de destruction, pour acquérir une voiture particulière peu polluante. Aussi, la part des véhicules mis au rebut dans le cadre de la PAC s’est élevée à 10 % du total des véhicules pris en charge par les casses (les centres de traitement de véhicules hors d’usage) entre 2015 et 2022. Rien qu’en 2022, 59 % des véhicules détruits du fait de la PAC sont classés Crit’Air 3 (soit environ 54 000 véhicules). La rapporteure relève que s’ils sont classés Crit’Air 3, ces véhicules sont aussi bien classés que 32 % du parc automobile actuel.
Elle indique que la proposition de loi vise à « introduire davantage de rationalité dans le système en maintenant en circulation les véhicules les moins polluant pour une durée limitée au profit des personnes qui en ont le plus besoin plutôt que de les envoyer directement à la casse ». Elle affirme que le texte apporte également un bénéfice environnemental en réemployant des véhicules moins polluants que ceux dont disposent actuellement les garages solidaires et en permettant de maintenir plus longtemps en circulation les véhicules et d’amortir ainsi le coût environnemental de leur fabrication.
L’article 1er permet aux autorités organisatrices de la mobilité de se voir remettre gracieusement les véhicules, classés Crit’Air 3 ou mieux et retirés de la circulation à des fins de destruction dans le cadre de la prime à la conversion, afin de mettre en place des services de location solidaire par le biais d’une convention conclue avec des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.
La rapporteure explique que le maintien en circulation de ces véhicules ne sera permis que pour une durée limitée, définie par décret.
L’article 1er bis prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement permettant l’évaluation du dispositif prévu par l’article 1er de la proposition de loi, dans un délai de trois ans à compter de la publication de son décret d’application.
L’article 2 prévoit enfin la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les mesures permettant de soutenir et favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilité solidaire.
La commission n’a adopté aucun amendement et a adopté le texte conforme.
partager -
 Conséquences de la géothermie profonde : présentation des conclusions de la mission flash
Conséquences de la géothermie profonde : présentation des conclusions de la mission flashMercredi 13 mars 2024, Gérard Leseul (SOC, Seine-Maritime) et Vincent Thiébaut (HOR, Bas-Rhin), co-rapporteurs, ont présenté à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire les conclusions de la mission d’information sur les conséquences de la géothermie profonde.
La géothermie profonde exploite les nappes d’eau souterraines situées au-delà de 200 mètres de profondeur. L’exploitation de la chaleur s’effectue le plus souvent par un système de doublet géothermique. Ce système consiste à forer un premier puits dit producteur qui extrait de la ressource en eau chaude pour en valoriser les calories par échange thermique en surface, puis un second puits dit injecteur réinjecte l’eau refroidie dans son milieu d’origine.
Les usages de la géothermie profonde dépendent à fois de la composition géologique du sous-sol et des besoins des consommateurs en surface. Alors que dans l’hexagone, là où le gradient thermique est de 3 à 4°C par 100 mètres, la ressource est presque exclusivement valorisée pour la production de chaleur et parfois de froid, les unités situées dans les zones volcaniques en outre-mer permettent, grâce à un gradient de plusieurs dizaines de degrés, la production d’électricité.
En 2024, 79 doublets géothermiques sont exploités en France pour de la production de la chaleur, dont 58 se trouvent sur le bassin parisien, permettant de chauffer l’équivalent de 350 000 logements.
A la différence du solaire et de l’éolien, la ressource géothermique offre l’avantage d’être disponible en continu sans problème d’intermittence. Source d’énergie locale, faiblement émettrice en CO2, elle est exploitée à partir d’installations ayant une faible emprise foncière. Elle reste toutefois encore marginale dans le mix énergétique du pays et reste méconnue du grand public.
Le potentiel de développement de la géothermie profonde est considérable.
Si la géothermie profonde suscite un certain attrait, ces dernières années se sont exprimés un certain nombre d’inquiétudes par rapport au développement de projets.
La mission trouve ainsi sa genèse dans les événements de Vendenheim en Alsace. Le 9 décembre 2020, la préfecture du Bas-Rhin a décidé d’arrêter définitivement les travaux sur le site du projet de géothermie profonde qui devait alimenter en électricité et en chaleur près de 20 000 logements. La préfecture a expliqué « qu’une série d’événements sismiques dont un séisme de magnitude 3,59, ressenti le 4 décembre a remis en cause, de par son caractère non prévisible et son ampleur, la poursuite des opérations du projet en zone urbanisée ».
Les rapporteurs formulent des recommandations visant, d'une part, à renforcer l’acceptabilité de la géothermie profonde. Ils soulignent que l’objectif de doublement du nombre de projets de géothermie profonde d’ici à 2030 devra s’appuyer sur une déclinaison territoriale de son déploiement. Ils recommandent également d’améliorer la connaissance des sous-sols en vue de prévenir les risques inhérents à la géothermie, notamment sismique.
Ils formulent, d’autre part, des recommandations en vue de consolider le modèle économique pour faciliter l’émergence d’une filière française de géothermie profonde.
partager -
 Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne : examen pour avis
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne : examen pour avisJeudi 7 mars, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a examiné pour avis le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Consulter le dossier législatif
Consulter le document faisant état de l'avancement des travaux (EAT)
partager -
 Fast fashion : adoption d’une proposition de loi
Fast fashion : adoption d’une proposition de loiMercredi 7 mars 2024, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné puis adopté la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Anne-Cécile Violland (HOR, Haute-Savoie) en est la rapporteure.
Le texte sera examiné en séance publique le jeudi 14 mars dans le cadre de la journée réservée au groupe Horizons et apparentés.
Anne-Cécile Violland a expliqué, en commission, que la montée en puissance de la « fast fashion » ou « mode éphémère » a entraîné un emballement de l’industrie textile. Selon l’Ademe, chaque année, dans le monde, ce sont plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus. Leur production a doublé entre 2000 et 2014. Selon l’éco-organisme de la Filière Textile d’habillement, Linge de maison et Chaussure « Refashion », en France, en l’espace d’une décennie, le nombre de vêtements proposés annuellement à la vente a progressé d’un milliard, et atteint désormais 3,3 milliards de produits, soit plus de 48 par habitant.
Elle précise que sans qu’il y ait de nouveaux besoins, cette abondance conduit ces nouveaux vêtements à être moins portés et à être jeté plus rapidement. Alors que seulement un tiers des vêtements en fin de vie le sont du fait de leur usure ou de leur détérioration, elle précise qu’on qualifie d’obsolescence émotionnelle pour qualifier cette faible durabilité extrinsèque des vêtements.
Elle indique que les marques de la « fast fashion » renouvèlent de manière quasi-permanente leurs collections pour une durée de commercialisation très courte et avec des promotions continues afin de créer des effets de mode et provoquer un réflexe d’achat chez les consommateurs. Elle déplore que ce modèle tend à s’imposer et écrase toute la concurrence dont notamment les acteurs traditionnels du secteur.
Anne-Cécile Violland précise que les bas prix proposés par la « fast fashion » le sont « au détriment des exigences sociales et environnementales élémentaires ».
Elle explique que l’industrie textile représente à elle seule 10 % des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que l’aérien et le maritime réunis, et pourrait atteindre 26 % des émissions en 2050 si les tendances actuelles se poursuivent. Elle poursuit en indiquant que le polyester, qui est la matière première la plus produite, nécessite pour sa fabrication 70 millions de barils de pétrole par an, tandis que le coton, première alternative végétale aux fibres synthétiques, est la première culture consommatrice de pesticides au monde, mobilisant plus de 10 % des volumes épandus. Elle ajoute qu’au stade de la fabrication des vêtements, la teinture de ces derniers requiert la mobilisation de substances toxiques, qui finissent dans les milieux aquatiques. 20 % de la pollution des eaux dans le monde serait ainsi imputable à la teinture et au traitement des textiles. En Chine, cela représente 70 % des rivières et des lacs. Enfin, au fil de la durée de vie des vêtements, lors de chaque lavage, ceux qui comportent des matières synthétiques relâchent des microfibres plastiques dans l’environnement, qui représentent au total, chaque année, l’équivalent de plus de 24 milliards de bouteilles en plastique. L’Agence européenne de l’environnement estime que près 35% des mircoplastiques primaires émis dans les océans proviennent du secteur textile.
L’article 1er défini la mode express comme la pratique commerciale propre au secteur du textile et de l’habillement qui consiste à renouveler très rapidement les collections en proposant un grand nombre de nouveaux modèles de vêtements ou d’accessoire sur une période de temps déterminée. Il prévoit également que les personnes qui mettent en œuvre cette pratique commerciale, lorsqu’elles pratiquent la vente en ligne, sont tenues d’afficher des messages encourageant au réemploi et à la réparation et sensibilisant à l’impact environnemental des produits.
En commission, les députés ont précisé la définition de la mode express qui sera donnée par décret en Conseil d’Etat en indiquant que la pratique commerciale consiste à proposer un nombre élevé de nouvelles référence pour une faible durée de commercialisation (CD185, CD105, CD59, CD188 et CD187).
Les députés ont adopté un amendement prenant en compte la durabilité dans l’éco-score mis en place par la loi « Climat et résilience » (CD135).
L’article 2 vise à responsabiliser les entreprises du secteur en renforçant le dispositif d’éco-modulation des contributions versées par les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs. La rapporteure explique que l’article met concrètement en place un système de primes et de pénalités permettant aux prix de refléter d’avantage l’impact environnemental des produits. Le montant de cette pénalité, qui sera déterminé par décret, ne pourra pas dépasser dix euros par produit.
Par amendement, les députés ont introduit le principe d’une variation de l’écomodulation selon la teneur en polyester des textiles (CD163).
L’article 3 vise à interdire, à partir du 1er janvier 2025, la publicité relative à la commercialisation de produits textiles lorsque ces derniers relèvent de la pratique commerciale de la mode express ainsi que la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. En commission, les députés ont étendu cette interdiction à l’influence commerciale (CD200).
Enfin, les députés ont introduit une amende administrative punissant le manquement à l’obligation d’afficher des messages de sensibilisation et à l’interdiction de publicité (CD169 et CD173).
Consulter le dossier législatif
Consulter le document faisant état de l'avancement des travaux (EAT)
partager -
 Audition de Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF
Audition de Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCFMercredi 6 mars, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a auditionné Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF, sur les investissements en matière de matériel et de réseau ferroviaires et les problématiques de dysfonctionnements.
partager -
 Organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection : adoption d'un projet de loi
Organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection : adoption d'un projet de loiMercredi 6 mars 2024, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté le projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
Adopté le 13 mars 2024 par le Sénat en première lecture, le projet de loi a été examiné pour avis, avec délégation au fond pour les articles 2 ter, 12, 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18, par la commission des affaires économiques le 4 mars 2024.
Le rapporteur au fond est M. Jean-Luc Fugit (RE, Rhône) et le rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques est M. Antoine Armand (RE, Hautes-Alpes).
Le projet de loi a pour objet de rapprocher l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dans une autorité administrative indépendante unique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).
Le projet de loi reprend et complète l’article 11 bis du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, qui avait été introduit par l’adoption d’un amendement lors de son examen par la commission des affaires économiques, puis supprimé lors de l’examen du projet de loi en séance publique.
En France, la sûreté nucléaire repose à titre principal sur l’exploitant. Elle est contrôlée par deux acteurs distincts : l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), souvent qualifiée de « gendarme » du nucléaire, et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), souvent qualifié d’« expert ».
Autorité administrative indépendante, l’ASN a été créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sûreté nucléaire. Elle est chargée de prendre les décisions individuelles et réglementaires. Établissement public industriel et commercial, l’IRSN a été créé par la loi du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire et environnementale et est issu de la fusion de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).
Dans son rapport, Jean-Luc Fugit explique qu’il existe une séparation fonctionnelle claire entre les deux entités. L’ASN est chargée de rendre les décisions en matière de conformité aux règles de sûreté nucléaire et rend à ce titre environ 1 800 décisions par an. Pour les dossiers complexes nécessitant une expertise (environ 300 par an), elle s’appuie sur l’expertise de IRSN. L’IRSN fournit un « appui technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche » indispensable à l’exercice par l’ASN de ses missions. Cet appui technique se matérialise notamment par une convention revue annuellement et par le fait que le président de l’ASN est membre de droit du conseil d’administration de l’IRSN. Le rapport souligne que ce système, « fruit d’une longue histoire […] est internationalement reconnu pour sa qualité technique, son indépendance et sa capacité à rendre compte au public de manière transparente ».
Il avance toutefois que la fusion entre les deux entités au sein d’une nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) est désormais nécessaire pour s’adapter à un contexte « hors norme » et « inédit dans l’histoire du nucléaire français ». Il précise que le système doit en effet faire face à la poursuite de l’exploitation du parc nucléaire existant au-delà de cinquante ans, voire de soixante ans ; au lancement d’un programme de construction de trois paires de réacteurs à eau pressurisée (EPR2) et à la mise à l’étude de huit réacteurs supplémentaires ; au contrôle de l’émergence de nouveaux acteurs privés dans les technologies nucléaires (notamment dans le domaine des petits réacteurs modulaires) ; au projet Cigéo et à la prévention des risques liés notamment au changement climatique et aux cyberattaques.
Le titre Ier du projet de loi vise à créer une nouvelle entité, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), rassemblant l’essentiel des compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
En commission, les députés ont supprimé l’article 1er qui prévoyait la création de l’ASNR (amendements identiques CD10, CD57, CD66, CD80, CD143, CD293).
Les autres articles du titre Ier visant à définir les missions et le fonctionnement de l’ASNR ont toutefois été adoptés, à l’exception des articles 2 ter et 4 bis, qui ont été supprimés.
Le titre II, sur lequel a été sollicité l’avis de la commission des affaires économiques, adapte les règles des marchés publics à la réalisation de grands projets nucléaires.
partager -
 Avis favorable du Parlement sur la nomination de Franck Leroy aux fonctions de président du conseil d’administration de l'Afit France
Avis favorable du Parlement sur la nomination de Franck Leroy aux fonctions de président du conseil d’administration de l'Afit FranceMercredi 28 février, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a auditionné, en application de l’article 13 de la Constitution, M. Franck Leroy, dont la nomination a été proposée par le Président de la République aux fonctions de président du conseil d’administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Elle a ensuite procédé au vote sur cette nomination.
En application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commissions compétentes en matière de transports de l’Assemblée nationale et du Sénat émettent un avis sur cette nomination.
Le résultat du scrutin est le suivant :
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat
Nombre de votants
40
37
Abstentions, bulletins blancs ou nuls
3
11
Suffrages exprimés
37
26
Avis favorables
25
14
Avis défavorables
12
12
Revoir l'audition de M. Franck Leroy sur le portail vidéo
partager -
 Agence de la transition écologique : audition de Sylvain Waserman, président-directeur général
Agence de la transition écologique : audition de Sylvain Waserman, président-directeur généralMercredi 14 février, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a auditionné M. Sylvain Waserman, président-directeur général de l’Agence de la transition écologique, sur le bilan de son « tour de France des régions » et les axes de travail prioritaires de l’agence.
partager -
 Geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : rejet d'une proposition de loi
Geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : rejet d'une proposition de loiMardi 13 février, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté la proposition de loi visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Rapporteur : Olivier Faure (SOC)
Consulter le dossier législatif
Consulter le document faisant état de l'avancement des travaux (EAT)
partager

Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
16e législature (22 juin 2022 - 9 juin 2024)
Présidence de Jean-Marc Zulesi, député de la huitième circonscription des Bouches-du-Rhône